La Corse [3 ed.] 2130443907, 9782130443902
Les préjugés sur la Corse ont la vie dure. Qui n'a pas entendu le discours qui voudrait ne voir en l'île de Be
156 118 3MB
French Pages 128 [131] Year 1992
La Corse
ISBN 2 13 044390 7
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE
LES CORSES, UNE HISTOIRE, UN « PEUPLE »
Chapitre I
LA CORSE, UNE COLONIE
I. — De la Préhistoire aux colonisations antiques
1. Temps obscurs.
2. Des Grecs aux Romains.
3. La Corse romaine.
II. — Les dominations italiennes
1. Des influences changeantes.
2. Pisans et Génois.
III. — Les luttes pour l’indépendance
1. Les révolutions de Corse.
2. Pascal Paoli.
3. L’échec.
IV. — La Corse française
1. Le « royaume de la misère ».
2. Démarrage et croissance.
3. « Une terre qui meurt »?
Chapitre II
LES CORSES, UNE COMMUNAUTÉ ÉCLATÉE
I. — Terre d’exode, terre d’accueil
1. Des échanges anciens.
2. L’émigration massive.
3. L’insuffisante immigration.
II. — La population insulaire aujourd’hui
1. Des changements profonds.
2. Des héritages durables.
III. — Les Corses hors de Corse
1. Les concentrations nationales.
2. Les dispersions outre-mer.
IV. — Un « peuple corse »
1. La force du groupe.
2. L’attachement au pays.
3. La langue.
DEUXIÈME PARTIE
DE L’ENGOURDISSEMENT AU RÉVEIL
Chapitre I
LE DÉPÉRISSEMENT DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES
I. — Les replis agricoles
1. La peau de chagrin.
2. La sclérose.
3. La fossilisation.
4. Les survies factices.
II. — Les résistances pastorales
1. Des effectifs amenuisés.
2. Des traditions conservées.
3. Des migrations maintenues.
4. Des activités en crise.
III. — Heurs et malheurs de l’industrie
1. Succès et faillites d’hier.
2. Disparitions et survies d’aujourd’hui.
IV. — Le bilan du dépérissement
1. La régression.
2. Les palliatifs.
Chapitre II
LES COMMOTIONS DE LA FIN DU XXe SIÈCLE
I. — Le choc du nouveau
1. La prise de conscience des disparités régionales.
2. L’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord.
II. — Les révolutions agricoles
1. Le recul du maquis.
2. Les innovations techniques.
3. Les mutations structurelles.
III. — L’irruption du tourisme
1. Les impulsions.
2. La conversion au tourisme de masse.
3. Les flux estivaux.
TROISIÈME PARTIE
LES PROBLÈMES DE CROISSANCE
Chapitre I
LES DISPARITÉS INSULAIRES
I. — Des villes gonflées
1. Des dynamismes différenciés.
2. Ajaccio et Bastia, deux villes comparables.
3. Ajaccio et Bastia : deux villes dissemblables.
II. — Une périphérie littorale bouleversée
1. Les bourgeonnements touristiques.
2. Une flambée passagère : le vignoble.
3. Une conquête plus stable : le verger d’agrumes.
III. — Et l’intérieur ?
1. Le délabrement.
2. Des tentatives de rénovation.
IV. — Une croissance ambiguë
1. Les contradictions de la croissance.
2. Une économie préoccupante.
Chapitre II
LE TEMPS DES RÉBELLIONS
I. — La montée des revendications
1. Rétrospective.
2. La fermentation des années 60.
II. — Régionalismes et nationalismes
1. L’action violente.
2. Les incidences.
III. — Le présent
1. Des signes de revitalisation.
2. Un malaise.
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIÈRES
Recommend Papers
File loading please wait...
Citation preview
LA CORSE JANINE RENUCCI
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
QUE
SAIS-JE ?
La Corse JANINE RENUCCI Professeur à l’Université de Lyon II
Troisième édition mise à jour
18e mille
ISBN 2 13 044390 7 Dépôt légal — lre édition : 1982 3e édition mise à jour : 1992, mai
© Presses Universitaires de France, 1982 108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
INTRODUCTION
« ... Ce n’est pas un paysage, c’est un pays. Ce n’est pas une population, c’est un peuple... » Ce jugement d’Aimé Césaire sur la Martinique peut-il s’appliquer à la Corse ? Sans doute, dans la mesure où il met l’accent sur les caractères singuliers que les habitants ont depuis longtemps donnés à la terre sur laquelle ils vivent. Le voyageur qui découvre Minorque ou Majorque, celui qui pénètre en Sardaigne, a l’impression aussi qu’il entre dans un pays. Chacun offre le spectacle d’un petit monde. Où réside l’originalité de la Corse ? Avec une étoffe territoriale comparable à l’étendue de la Crète ou de Chypre, elle est celle où la mon tagne occupe le plus de place. Une vraie montagne, avec des sommets d’allure alpine, une couverture nivale prolongée, des alpages, des forêts épaisses de conifères et de feuillus, et une multitude de villages campés sur les éperons ou accrochés aux pentes. Encombrante présence qui restreint l’im portance des plaines côtières, minces liserés de piedmont ou conques menues, épanouies au fond des golfes. Présence qu’a valorisée la longue insécurité des rivages. Aussi la Corse a-t-elle été comme sa voisine sarde, une île de terriens, de bergers et de paysans, étrangère à la mer, malgré l’exception du Cap Corse. D’où le contenu d’une image de marque qui a eu la vie dure : société rurale repliée, archaïque, mœurs d’un autre âge associant vendetta et bandi tisme, sens de l’honneur et violence. Tel était le 3
portrait sommaire à travers lequel le grand public a longtemps identifié la Corse et les Corses. La bruyante publicité dont bénéficie l’île d’à présent est d’un autre aloi. Le vieux pays est devenu partiellement un pays neuf. Il a accueilli des techniques venues d’ailleurs, comme il s’est ouvert au flot des vacanciers. Il participe désormais au jeu économique du continent. Mais le changement a accru les dépendances. Par sa brutalité, il fait un peu figure de viol. Il a suscité déséquilibres, hypertrophies, lacunes, incertitudes. Il a laissé des insatisfactions. Y a-t-il un problème corse ou des problèmes en Corse ? Un problème corse existait au début du siècle, celui de la pauvreté, du dépeuplement, du retard technologique. Aujourd’hui, les problèmes économiques se perpétuent, modifiés : la cherté des transports, l’écoulement des produits agricoles, la brièveté de la saison touristique, la revitalisation de l’intérieur... Le « problème corse » revêt une autre dimension : il réside dans la confrontation île-continent. La modernisation est venue menacer l’originalité insulaire ; le faisceau des dépendances n’a pas laissé aux Corses la maîtrise de leurs propres transformations. Voilà l’aliment du sursaut régional qui a favorisé les aspirations nationalistes. L’affir mation de l’ « identité corse », du « droit à la diffé rence » comme de la nécessité pour l’Etat, main tenant pour la CEE, de secourir cette terre isolée vient d’aboutir à l’obtention, grâce au nouveau statut, d’un régime dérogatoire qui doit créer une nouvelle collectivité territoriale. Ainsi s’exalte une personnalité qui a traversé les siècles sans perdre le sentiment d’elle-même.
4
PREMIÈRE PARTIE
LES CORSES, UNE HISTOIRE, UN « PEUPLE »
Chapitre I LA CORSE, UNE COLONIE
Escales, comptoirs, points d’appui, objets de con voitises, de concurrences et de conflits, aucune des îles méditerranéennes n’échappa à l’histoire tour mentée des continents proches avec leurs remous maritimes. Toutes ont vécu les avancées et les reculs de la Chrétienté et de l’Islam, de l’Europe et de l’Afrique, et les fluctuations de dépendances chan geantes sans maîtriser jamais elles-mêmes leur propre destin. La Corse n’eut pas un sort plus tragique que Minorque, la Sardaigne ou l’une des grandes îles grecques, mais peut-être subit-elle, plus que beau coup d’autres, la contradiction entre une situation coloniale et l’existence d’une personnalité vigou reuse, rétive à l’assimilation totale.
I. — De la Préhistoire aux colonisations antiques 1. Temps obscurs. — La Préhistoire corse est sortie de l’ombre depuis peu sans dévoiler, il s’en faut, 5
toutes ses énigmes. Comme dans les autres îles médi terranéennes, les traces de l’homme ne se manifes tent ici, dans l’état actuel des recherches, qu’à partir du Néolithique, à partir du VIIe millénaire exacte ment. Ce sont surtout les régions méridionales, Taravo, Alta Rocca, Sartenais, alentours de PortoVecchio, qui ont livré les témoignages les plus nom breux d’une population de chasseurs et de pasteurs, pratiquant la cueillette avant de connaître l’agri culture. Dès le IIIe millénaire existait un habitat groupé dans la montagne. A la civilisation mégalithique appartiennent les vestiges les plus célèbres qui remontent au IIe millénaire. Stazzone et stantare, dolmens et menhirs étaient connus au siècle dernier puisque Mérimée, inspecteur des monuments historiques, les avait partiellement recensés en 1839. Mais les fameuses statuesmenhirs de Filitosa et Cauria ont surgi de l’oubli, il y a une trentaine d’années. Bien qu’elles n’aient probablement pas la valeur d’originalité qui leur fut attribuée, ces stèles anthropo morphes, paraissant représenter souvent des guerriers en armes, attestent le degré d’évolution de leurs sculpteurs, déjà entrés dans l’âge du Bronze. Elles coexistent avec des constructions appelées torre, fréquemment arrondies, érigées dans des positions élevées et dépourvues de l’aspect monumental des nuraghes sardes. Certaines, trop petites pour abriter des hommes, pourraient avoir eu une fonction religieuse. D’autres, au contraire, cernées par des enceintes cyclopéennes, ont servi de forteresses. Prouvent-elles l’arrivée d’envahisseurs venus de la mer ou de propagations étrangères plus pacifiques ? L’île préhisto rique n’a jamais vécu en vase clos. Les relations avec la Sar daigne, la Toscane et la Ligurie furent précoces, ont peut-être véhiculé des influences ibères. Les « Peuples de la Mer » débarquèrent-ils sur ces rivages ? S’agissait-il d’Occidentaux, de Crétois ou de Mycéniens (1) ?...
2. Des Grecs aux Romains. — Quoi qu’il en soit la Corse est entrée dans l’histoire comme une colonie. La première mention en est faite au VIe siècle par (1) R. Grosjean, La préhistoire et la protohistoire, dans Histoire de la Corse, sous la direction de P. Arrighi, Privat édit., 1971.
6
Hécatée de Milet qui signale que « Kurnos est une île sous le vent du nord par rapport à la Iapygie ». Ne bénéficiant que d’une localisation sommaire visà-vis de la région active dominée par les Grecs de Tarente, elle n’a donc pas alors d’existence en soi. Désireux de trouver des métaux et des lieux de pêche, les Phocéens y avaient fondé, vers 560, le comptoir d’Alalia qui était un relais entre Marseille et le détroit de Sicile. Convoité par les Etrusques qui fréquentaient probablement ces côtes depuis long temps, occupé temporairement par les Carthaginois quand se déclenchèrent les guerres Puniques, il fut conquis par Rome pour sept siècles en 259 av. J.-C. Pour punir les révoltes insulaires, Sylla transforme, en 81, l’ancienne cité en colonie militaire, puis Au guste en fait une base navale qui sert de point d’at tache aux galères de la flotte de Misène. Elle survé cut jusqu’en 420 apr. J.-C., date de sa destruction par des Vandales venus d’Afrique (2). Bien que les ruines d’Aléria n’aient aujourd’hui ni l’ampleur, ni la beauté poignante d’Ostie ou de Timgad, elles apportent le témoignage d’une animation urbaine dont la durée excède dix siècles. Acropole sur la butte qui se dresse au-dessus de la basse vallée du Tavignano, la ville possédait un port de commerce sur l’estuaire du petit fleuve tandis que l’étang de Diane abritait la flotte de guerre. Les attachantes vitrines du musée qui exposent les objets exhumés dans la nécropole et la cité révèlent, à travers la diversité des matériaux, des formes et des éléments décoratifs, les multiples relations, proches et lointaines, qui atteignirent ce rivage. Les Phocéens, grands commerçants, ont apporté de tout l’Orient méditerra néen les vestiges les plus anciens ; coupes et bols ioniens, céra mique rhodienne, verre égyptien, surtout de beaux échantillons de la céramique attique à figures noires ou rouges. Vases et amphores sont aussi venus de toute l’Italie : la production étrusque plus grossière, avec ses palmettes stéréotypées, con traste avec les plats et les cratères d’Apulie où les délicats rinceaux de feuilles de lierre ornent élégamment le vernis
(2) J. Jehasse, La Corse antique - La Corse romaine, dans Histoire de la Corse, sous la direction de P. Arrighi, Privat édit,, 1971.
7
noir (3). Et l’Espagne et la Gaule ont également envoyé leurs poteries, l’Afrique ses lampes et ses vases, surtout à l’époque impériale.
3. La Corse romaine. — La richesse des contacts avec l’extérieur efface-t-elle complètement le subs trat indigène ? En réalité celui-ci demeure bien que sa place soit discrète. Alalia-Aléria n’a pas surgi ex nihilo : les fouilles ont révélé, auprès des étangs, les traces de populations évoluant du Néo lithique à l’âge du Bronze et à l’âge du Fer. Les Phocéens se sont établis à proximité de ces « Corsi » qui devaient laisser leur nom au pays. D’ailleurs, les fabrications locales n’ont jamais disparu à l’époque antique : les tombes renfermaient souvent de la céramique sans vernis ni décor peint, qui perpétuait la tradition préhistorique ou imitait les formes étrangères. Elles contenaient aussi une fibule à pied relevé en spatule, d’un type particulier, dit type « corse ». La cité semble donc avoir correspondu à une « communauté de civilisation » où vivaient des indigènes à côté des éléments arrivés du dehors, Grecs, Etrusques, puis Romains, et colons partis de Provence, d’Italie, d’Orient... Les colonisateurs cependant imposèrent leur langue : la langue corse d’aujourd’hui provient direc tement du latin. C’est une langue d’oc parente du toscan et du catalan. Les colonisateurs favori sèrent aussi la pénétration des influences religieuses d’origine orientale : les cultes solaires sont attestés par des invocations au Soleil, tandis que se mani festent, dès le IIe siècle, des signes précoces de chris tianisation. L’activité économique, enfin, semble avoir été largement modelée par les besoins de la puissance romaine. De façon continue, Aléria a possédé un centre actif de pêcheries et salaisons (3) Jean et Laurence Jehasse, La nécropole préromaine d’Aléria, Centre national de la Recherche scientifique, 1973.
8
dont les produits alimentaient l’exportation grâce aux salines proches du port. D’autre part, peut-être dès l’époque grecque, la plaine a été divisée en lots réguliers. De taille moyenne au moment de l’établis sement de la colonie militaire, ils cédèrent progressi vement la place à des latifundia, exploités par la main-d’œuvre servile qui cultivait blé, vigne, oliviers et entretenait des troupeaux. Mais ce sont surtout les richesses naturelles qui attiraient les convoitises. Les voies de pénétra tion vers l’intérieur desservaient, toutes, des gise ments métallifères : cuivre et fer du Mercurio et du Venacais, plomb de Ghisoni. La plupart des écri vains latins qui connurent l’île, ont vanté l’exubé rance des forêts dont les plus beaux échantillons furent utilisés pour la construction des bateaux tandis que les goudrons et les résineux, la cire, per mettaient le calfatage des coques. Produits si pré cieux que Rome établit, semble-t-il, l’impôt du liège et préleva de lourds tributs en cire. Tournée vers le dehors, cette économie coloniale a contribué à affirmer la périphérie littorale. Au Ier siècle, Pline l’Ancien cite 32 villes et les 2 colonies d’Aléria et de Mariana, celle-ci créée par Marius à l’embouchure du Golo vers 100 av. J.-C. Ptolémée, au siècle suivant, à part 5 villes intérieures, cite 21 autres cités proches de la mer et 4 ports. Simples mouillages ou centres commerciaux actifs ? Villes véritables ou gros villages ? La rareté des ves tiges, hors des 2 colonies, n’autorise guère un tableau précis. Il existait probablement un établissement à Ajaccio. De vastes villae occupaient les plaines cô tières et s’immisçaient dans l’intérieur. Que sont devenus les Corsi ? La fameuse description de Diodore de Sicile montre « qu’ils se comportent dans les rapports sociaux selon la raison et la justice, contrairement à presque tous les autres Barbares ». Strabon dépeint des in digènes « pires que des bêtes féroces... qui tiennent les crêtes
9
et vivent de brigandages ». Mais ces jugements ne sont pas fondés sur des observations directes. Pour la période posté rieure, les témoignages manquent : l’évolution des populations locales échappe à l’attention. Peut-être parce qu’elles vécurent en paix après les révoltes successives des deux premiers siècles d’occupation romaine ? ... La carte de Ptolémée énumère 12 tribus, localisées en majorité dans les montagnes centrales et méridionales. Sans doute, une partie d’entre elles a-t-elle été attirée par les grosses exploitations agricoles et les villes puis qu’une osmose évidente avec les colonisateurs est prouvée à Aléria. Mais Solin, au IIIe siècle, parle encore, des « bourgs for tifiés » qui ne paraissent pas avoir été abandonnés. La coloni sation romaine n’a certainement jamais submergé le vieux fonds autochtone qui s’est perpétué dans la montagne.
La Corse romaine a périclité en même temps que l’Empire lui-même, s’appauvrissant dès le IVe siècle. Aléria disparaît au Ve siècle, Mariana sub siste encore au vie. Les ports s’ensablent, l’agri culture se rétracte, la malaria s’installe, les popu lations se réfugient en altitude. C’est le début d’une régression de quinze siècles pour les régions côtières.
II. — Les dominations italiennes
1. Des influences changeantes. — Les troubles et les destructions provoquées par les invasions barbares encouragèrent le Saint-Siège, héritier de Rome, à affirmer son autorité sur la Corse : Grégoire le Grand, dès le VIe siècle, s’était préoccupé de protéger l’île en manifestant le souci de l’évangéliser. Mais le harcèlement des razzias sarrasines poussa la papauté à demander d’abord l’aide des marquis de Toscane pour exercer sa mission, puis elle confia la Corse à l’archevêque de Pise à la fin du XIe siècle. Hégémonie éphémère à cause de l’ambitieuse rivalité des Génois : ils s’installèrent à Bonifacio (1195), puis à Calvi (1268), avant d’écraser les Pisans à la bataille navale de la Meloria (1284). Avec le xive siècle s’ouvrit une longue période 10
d’anarchie suscitée par une féodalité frondeuse. La prépondérance génoise ne put réellement s’affir mer qu’après l’élimination de l’impérialisme aragonais tenu en échec devant Bonifacio qu’Alphonse V avait assiégée (1420). Encore fallut-il écarter en suite la France d’Henri II dont l’intervention avait été encouragée par Sampiero, mais qui renonça à ses prétentions au traité de Cateau-Cambrésis (1559). Et la durable menace des Barbaresques sur les côtes obligea la République à construire, à partir du XVIe siècle, une ceinture complète de tours de guet et de défense afin de protéger cette possession convoitée. Quels furent pour le pays les résultats de l’affrontement des rivalités continentales pendant la longue période d’insé curité perpétuelle ? Avec le reflux de la population vers l’inté rieur montagnard s’altérèrent les activités urbaines et commer ciales au bénéfice des genres de vie agro-pastoraux. Ils se sont développés dans le cadre de communautés rurales vivaces, repliées dans les hautes vallées ou au sommet des coteaux, à l’écart de la mer. Sans doute ce type d’organisation socio-économique plonge-t-il ses racines dans le vieux fonds préhistorique. Il s’est affermi ici en même temps que dans toute l’Europe médiévale et dans les mêmes conditions histo riques. Bien que son extension soit attribuée au légendaire Sambucuccio d’Alando qui l’aurait établi dans le nord de l’île, l’En Deçà des Monts, après la révolte de 1358 contre les féo daux, les institutions communautaires sont attestées beaucoup plus tôt : les statuts accordés à leurs vassaux, dès le XIIe siècle, par certains seigneurs du Cap Corse affirment le principe de la propriété communale indivise. Ce système devint exclusif dans l’En Deçà après 1358, mais il se répandit partout dans l’Au-Delà des Monts après l’écrasement des féodaux en 1511. Il s’incrustait dans les mailles d’unités administratives d’origine religieuse, les pièves, les premières paroisses, créées progressivement par l’Eglise à l’époque de la christianisation. Celles-ci se moulèrent souvent sur le compartimentage du relief, l’unité administrative correspondant à une unité topo graphique, parfois à une vallée. L’insécurité a donc favorisé l’affermissement d’une société rurale abritée dans son refuge montagnard, appuyée sur des structures qui étaient, sinon originales, du moins authentiques dans la mesure où elles reproduisaient un vieil état de choses.
11
2. Pisans et Génois. — Quelle fut néanmoins l’ac tion des puissances dominantes ? Le gouvernement des Pisans eut une réputation bienfaisante. Il favo risa les échanges commerciaux et traita les Corses sur un pied d’égalité avec les Pisans. Sous l’autorité de son archevêque, Pise s’attacha à effectuer une réor ganisation religieuse. Elle créa de nouvelles pièves. Les églises et les chapelles romanes qui, dans leurs modestes dimensions, s’inspirent de la prestigieuse architecture toscane, apportent peut-être, lors qu’elle se dressent dans les plaines vides, comme la Canonica de Mariana, le témoignage d’un effort de réoccupation des espaces désertés. La colonisation génoise a laissé de mauvais souvenirs. La Corse qui fut d’abord aux mains d’une société financière, la Maona, puis de l’Office de Saint-Georges, ne fut directement administrée par la République qu’à partir de 1562. Elle avait obtenu la reconnaissance de ses « Statuts » qui lui laissaient théoriquement une certaine autonomie. A la base survivait la démocratie égalitaire de la tradition ; chaque paroisse élisait au suffrage direct un podestat et deux pères du Commun. Un Conseil des Douze, puis des Dix-Huit, représentait le peuple pour l’En Deçà et l’Au-Delà des Monts, tandis que deux ora teurs résidaient à Gênes. Tous furent peu à peu réduits à des fonctions honorifiques, alors que les Corses étaient évincés des plus hautes charges. Leur noblesse n’était pas reconnue comme un corps privi légié analogue à celle de Gênes, dure épreuve pour l’orgueil local. La Corse était réellement placée sous l’autorité de son gouverneur génois, installé à Bastia. La métropole se réservait, en outre, le contrôle des échanges commerciaux. Elle s’était octroyé le monopole des exportations de blé, et y ajouta celui des exportations de vin. Tout transport était soumis à l’obtention d’une licence ou tratta qui 12
n’était que rarement consentie pour d’autres desti nations que la Ligurie. Elle s’arrogea aussi le fruc tueux monopole du sel, entraînant la destruction des salines de Porto-Vecchio, de Saint-Florent, de Bonifacio. Les exigences fiscales paraissaient lourdes : non seulement la taille, contribution par feu égale pour tous, mais encore les trotte, la gabelle du vin, les gabelles diverses qui frappaient les mouvements de marchandises. L’entrée des importations était aussi soumise à des taxes calculées pour décourager les petites industries insulaires, surtout les forges et fonderies de l’En Deçà qui recevaient le minerai de fer de l’île d’Elbe. Une « révision historique », accomplie depuis peu, incite cependant à considérer que l’action de la République de Gênes revêt des aspects positifs dans le domaine économique. Elle s’attacha, en effet, à stimuler la mise en valeur des plaines aban données qui étaient capables de produire le blé dont elle manquait. Elle s’efforça aussi d’aider le déve loppement de l’arboriculture dans une île qui vivait surtout des grains qu’elle récoltait et des ressources des troupeaux, alors qu’huile et vin faisaient défaut en Ligurie. Tâches difficiles. La première formule tentée par Gênes pour susciter l’occupation stable des plaines fut la concession en fiefs à des particuliers (1587). Deux concessions, celle du Fium-orbo et celle de Porto-Vecchio, échouèrent toutes deux. Avec des seigneurs génois et des familles de colons ligures, le fief de Porto-Vecchio créait une enclave étrangère : la popu lation y fut décimée par la malaria. Avant que cette faillite ne soit consommée, la Sérénissime avait renoncé aux fiefs en optant pour des contrats d’emphytéose destinés autant aux Corses qu’aux Génois. De nombreux domaines emphytéo tiques, les procoï, apparurent dans les zones côtières : dans les Agriates, à Paomia, proche du golfe de Sagone, dans la plaine orientale enfin. Pour encourager l’agriculture, Gênes élabora un vaste plan d’ensemble (1637-1639). Deux commissaires étaient chargés de le faire appliquer, aidés par un système de prêts. L’arboriculture bénéficia de la plus grande sollicitude. Dès 1572, tous les propriétaires furent soumis à l’obligation
13
de planter chaque année, sous peine d’amende, quatre pieds de vignes et cinq à dix arbres fruitiers choisis de préférence parmi les « cinq espèces », c’est-à-dire châtaigniers, figuiers, mûriers, oliviers, vignes. Les témoignages prouvent que les plantations se sont développées beaucoup dans l’En Deçà, moins dans l’Au-Delà. Au sein des communautés rurales, ce sont les éléments les plus riches qui purent s’enorgueillir des vergers les plus étendus ; pour les protéger, ils ont déclenché une vague d’enclosures en s’appropriant les espaces collectifs. Ainsi l’arbre qui a favorisé les progrès de la propriété privée a entraîné simultanément l’affermissement de la classe des notables, les principali. Mais cette évolution, en enlevant aux troupeaux une partie des terres ouvertes au parcours, a provoqué l’hostilité et les manifestations belliqueuses des bergers.
III. — Les luttes pour l’indépendance 1. Les révolutions de Corse. — La « guerre de Quarante ans » qui éclata en 1729 fut le soulèvement le plus virulent qui se déclencha contre une domina tion extérieure depuis la conquête romaine. Au dé part, elle ne fut pourtant ni organisée, ni unanime. A la suite d’un incident mineur, elle prit naissance à Bustanico, dans le Bozio, mais elle enflamma rapide ment la Castagniccia et gagna toute l’île. Il est intéressant de constater qu’elle se manifesta d’abord comme une révolte des montagnards contre les éta blissements littoraux, villes largement étrangères, domaines agricoles spoliateurs. Tous furent assiégés. Il ne s’agit pas de détailler ici une suite d’évé nements confus, mais de constater l’essentiel : ré volte de petites gens, bergers ou bandits au début, elle fut rapidement accaparée par les notables qui en prirent la tête, sans jamais pouvoir la dominer à cause de leurs rivalités personnelles. Gênes, inca pable de maîtriser la sédition, demanda l’aide étran gère, celle de l’empereur d’Autriche, puis du roi de France. Il s’ensuivit un roman à épisodes où, entre les interventions étrangères, le fait le plus surpre nant fut l’apparition d’un aventurier westphalien, 14
Théodore de Neuhoff, qui acquit assez de popularité pour être sacré roi de Corse à Alesani en 1736 ; souverain éphémère puisqu’il ne régna que sept mois. C’est néanmoins la preuve que la « révolution » cher chait un chef efficace, et la Corse un moyen d’unité.
2. Pascal Paoli. — La Corse ne le trouva qu’après vingt-six ans de troubles lorsque Pascal Paoli fut dé signé comme général de la nation en 1755. Agé de trente ans, il arrivait de Naples où il avait passé sa jeunesse aux côtés de son père exilé. Respectant la tradition insulaire, il avait choisi le métier des armes et, à défaut de servir la France qu’il avait solli citée, il était sous-lieutenant dans un régiment du roi de Naples. Appelé par son frère qui présidait, dans le désarroi, un Directoire élu par les insurgés, il avait pris un congé pour se rendre en Corse. Son œuvre représente « l’effort conscient le plus important de l’histoire corse pour transformer un peuple en nation moderne » (4). En quoi consistet-elle ? La fameuse « Constitution » établit, certes, une démocratie puisque l’Assemblée générale qui a le pouvoir législatif est élue, au sein des communes, par les électeurs qui ont vingt-cinq ans. Mais seuls les chefs de famille votent, et toutes les charges, modestes ou élevées, reviennent aux notables : podestats, pères du commun, juges... De plus, bien que le pouvoir exécutif appartienne à un Conseil d’Etat, il est entre les mains du général à vie qui le préside. Fixé à Corte dès 1758, celui-ci a l’autorité d’un souverain sur un pays qui frappe monnaie et choisit son drapeau, adoptant le célèbre emblème à tête de More. Préoccupé d’enrichir l’économie insulaire, Paoli (4) Pierre Antonetti, Histoire de la Corse, Paris, Robert Laffont, 1973, p. 357.
15
a repris, au bénéfice de la Corse, la politique agri cole de Gênes, soucieux du développement de l’arboriculture, de l’introduction de cultures nou velles, telle la pomme de terre, décidé à encourager la prospection des mines et des carrières et à activer l’industrie. Malgré sa capitale sise au centre de l’île, au cœur du refuge des montagnes, il a voulu s’affirmer sur le littoral, favoriser l’ouverture sur le dehors par des relations commerciales : aussi créa-t-il une flotte marchande et le port d’Ile-Rousse. Enfin, le nouvel Etat avait besoin de s’affranchir de la dépendance culturelle qui entraînait depuis toujours « l’émigration des intelligences » vers les lieux de savoir continentaux où s’accomplissaient les études supérieures. En 1765, naquit l’Université de Corte qui ne fonctionna que trois ans. Dans l’Europe des Lumières, Paoli a suscité un intérêt passionné, attirant la remarque célèbre de Rousseau dans son Contrat social : « J’ai quelque pressentiment qu’un jour cette petite île étonnera l’Europe. » Tout pénétré des théories de son siècle, il avait su appliquer les idées de Montesquieu en les adaptant aux traditions démocratiques locales. Aussi, en 1764, demanda-t-il à Rousseau un projet de Constitution ; il n’existe qu’à l’état d’ébauche car son auteur renonça à aller s’établir en Corse. La Nation corse modelée par Paoli demeura d’ail leurs bien imparfaite. Imparfaitement conquise d’abord : s’il était parvenu à étendre son autorité sur le sud et jusqu’au Cap Corse, il s’est heurté constamment aux ambitions rivales des grandes familles. En outre, les villes littorales ne furent jamais soumises. Il est vrai que Paoli ne disposait pas d’une armée digne de ce nom, mais de régiments de mercenaires peuplés de Génois, de Prussiens, ... même de Français ! Le service national perma nent se révélait inapplicable dans un milieu où
16
chaque soldat était aussi un paysan qui devait participer aux semailles et aux moissons.
3. L’échec. — A l’époque de Choiseul qui en avait formulé l’exigence en échange de son aide à Gênes, les places fortes côtières furent occupées par les forces françaises. Finalement, par le traité de Versailles du 15 mai 1768, Gênes confiait à la France sa souveraineté sur la Corse... jusqu’à ce qu’elle puisse acquitter la dépense qui représentait le prix de l’intervention française. Il s’agit donc d’une cession pour dette, plutôt que de la vente véritable qui a été évoquée. Bien que Paoli lui-même ait tenté de négocier avec la France, il encouragea la résistance à l’appli cation du traité de Versailles. Battus à Borgo, les Français écrasèrent les Corses à Ponte-Novo. Paoli s’embarqua en 1769, fut reçu avec égard par plu sieurs souverains éclairés, puis s’installa à Londres, pensionné par Georges III. Amnistié en 1789, il retrouva la Corse l’année suivante et, en même temps, le pouvoir avec les titres de président du Congrès du nouveau départe ment et de commandant en chef des Gardes na tionales. Une brouille avec la Convention l’entraîna à sa dernière tentative autonomiste : il fit appel aux Anglais qui s’installèrent en 1794. Inspirée par la Constitution de 1755 et le souci de satisfaire la nouvelle puissance dominante, une Constitution garantit les libertés du royaume anglo-corse. Mais, Paoli, hostile au vice-roi, partit en 1795. L’année suivante, les victoires de Bonaparte en Italie et le débarquement d’un corps expéditionnaire contrai gnirent les Anglais à la retraite. Ainsi s’achevèrent les luttes pour l’indépendance. Elles avaient démontré simultanément la sincérité de l’aspiration à l’autonomie et l’incapacité d’y parve nir. Les causes sont aisément discernables : les diffi17
cultés de la « Nation » corse à s’affirmer tiennent à l’absence d’unité « nationale », Les révolutions corses sont sorties de la montagne et ont abouti à la créa tion d’un Etat appuyé sur le centre de l’île. Elles n’ont jamais été bien accueillies sur le littoral où les villes leur échappaient. Elles ont été ruinées par l’esprit de parti qui opposa toujours les prin cipaux chefs entre eux. Avec l’irruption d’une nouvelle domination extérieure, leur conséquence essentielle fut d’arracher le pays à l’aire d’influence italienne.
IV. — La Corse française 1. Le « royaume de la misère ». — Comment se pré sente le nouveau territoire que raillait ainsi le duc d’Aiguillon ? La meilleure photographie de l’époque en est donnée par le Plan Terrier, établi pour servir de base d’impositions à partir de 1770, et achevé en 1796 (5). La Corse, pays d’Etats, n’a pas été soumise à un régime d’assimilation brutale. Les divisions admi nistratives s’inspirèrent de celles qui existaient au temps des Génois, même au moment des remode lages révolutionnaires. Les deux départements du Golo et du Liamone, créés en 1793, reproduisaient l’En Deçà et l’Au-Delà des Monts ; les districts rappelaient les anciennes provinces, Bastia, Corte, Calvi, pour le Golo, Ajaccio, Vico, Sartène pour le Liamone. Les 60 cantons correspondaient aux pièves et ils regroupaient 380 communautés. La population, très diminuée par les guerres pro longées, s’élevait à 150 000 hab. inégalement ré partis : 94 779 pour le département du Golo, (5) Antoine Albitreccia, Le Plan Terrier de la Corse au XVIIIe siè cle, Paris, puf, 1942.
18
55 879 seulement pour le Liamone. Aussi les den sités reflétaient-elles des contrastes accusés : la moyenne insulaire était de 16,9 hab. au kilomètre carré, mais Bastia en avait 31,7 ; Ajaccio, 17,3 ; Corte, 15,6 ; Calvi, 14,1. Les oppositions existant entre les cantons étaient encore plus marquées : Orezza, en Castagniccia, possédait 90 hab. au kilo mètre carré, Capo Bianco dans le Cap Corse, 54 ; Porto-Vecchio, 1,2. Les habitants étaient concentrés en altitude, surtout dans les villages « à mi-côte », vers 4-500 m, tandis que le littoral restait vide, à l’exclusion des rivages du Cap parsemés de marines fragiles. Les villes demeuraient médiocres : Bastia, la plus importante, ne réunissait que 8 000 hab., Ajaccio en avait 4 000, grâce à son faubourg proche du port, Bonifacio, 3 000, groupés à l’intérieur des remparts, Calvi, 1 150, et Corte, 1 711. La description des activités atteste la prépondérance de l’économie agro-pastorale, signalée dans 358 communautés sur 360 : culture et élevage conjugués pour 328, élevage exclusif pour 6, culture exclusive pour 30. L’industrie n’intervient que dans 41 communautés et le commerce ne l’emporte que pour une seule. Les activités engendrent la mobilité, en particulier pour les pasteurs qui, accompagnés de leurs troupeaux, transhumaient, l’hiver, vers les herbages des basses terres, l’été vers les pâturages d’altitude. Des migrations agricoles s’y associaient ou s’y ajoutaient, les montagnards récoltant, en haut, seigle, orge, châtaignes, glands, en bas, blé et olives... Les terres cultivées n’occupaient que 30 % de la surface totale, mais cette proportion atteignait 40,7 % dans le district de Bastia, contre 17,6 % dans celui d’Ajaccio. La force de l’économie de subsistance conférait aux céréales une impor tance écrasante : plus de 50 % de la superficie en moyenne, même 69 % à Calvi, mais 30,7 à Ajaccio vu l’extension des forêts. En revanche, malgré les efforts génois, la place des vignes et de» oliviers était très restreinte et celle des prés, déri soire. Seuls les districts de Bastia et de Corte accordaient aux châtaigniers une place notable. Les techniques agricoles étaient jugées partout très archaïques : brûlis, longues jachères, labours si superficiels que les mauvaises herbes étouffaient les grains. Les propriétaires ne pouvaient nulle part mettre en valeur tous leurs biens : était-ce une preuve du manque de bras ? Dans cette île privée de manufactures, l’industrie était
19
insignifiante. Et les routes faisaient défaut, remplacées par un réseau de sentiers rocailleux où les déplacements s’effectuaient à pied, à cheval, à dos d’âne ou de mulet. Les premiers « che mins de voiture » apparurent avec l’occupation française.
Le Plan Terrier s’achevait par un « Etat à venir » qui comportait un plan de régénération. Il expri mait les intentions officielles formulées, dès le dé part, par l’Ancien Régime qui encouragea l’arbori culture, l’industrie, amorçant la construction des principales routes. Mais les résultats furent minces. D’ailleurs, les troubles révolutionnaires, puis les guerres de l’Empire ne favorisèrent pas les progrès économiques : la Corse souffrit d’une crise de pé nurie, même de disette en 1811. Napoléon s’attacha à la remise en ordre après la reconquête : partisan de la « francisation », il accepta néanmoins d’accorder un ensemble de mesures fiscales particulières, dimi nuant les droits d’enregistrement, supprimant les droits de timbre et de patente, excluant l’île du monopole du tabac... Le bilan total restait maigre en 1815. 2. Démarrage et croissance. — Une situation générale médiocre se prolongea sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Dans ce département pauvre, le régime censitaire a favorisé les excès funestes de la politique de clan avec la domination des grandes familles, les Pozzo di Borgo et les Sébastiani. Le malaise a encouragé le maintien de vieilles habitudes de violence, les sévices du banditisme asso ciés aux méfaits de la vendetta. Il faut attendre le Second Empire pour que soit interdit le port d’armes (1853) qui atteint, certes, le banditisme, mais n’affecte guère la brutalité des mœurs. Sur le plan économique, un renouveau d’intérêt s’est manifesté dès le règne de Louis-Philippe : le réseau routier a progressé, les ports ont été amé liorés comme les liaisons avec le continent grâce à 20
l’apparition de la marine à vapeur en 1830. Les villes sont les principales bénéficiaires de ces trans formations : Ajaccio, pourvue d’une préfecture et d’un théâtre, a embelli. Bastia a vu son trafic com mercial grossir, alors que sa population doublait. C’est Napoléon III qui a fait preuve de la plus grande sollicitude à l’égard de la Corse, accentuant les résultats acquis sous le régime précédent. Les routes nationales se sont allongées, débloquant Bonifacio, Calvi, la Castagniccia ; routes forestières et chemins vicinaux ont fait leur apparition. A la tête de leur compagnie de navigation, les frères Valéry, Cap-Corsins d’Erbalunga, ont stimulé la prospérité bastiaise, car ils ont assuré, pendant quarante ans, les transports par vapeurs entre Bastia et Ajaccio, d’une part, Marseille et Nice, d’autre part, mais aussi entre la Corse et Livourne, et entre Ajaccio et la Sardaigne. La même époque a vu l’asséchement des marais de Calvi, de Saint-Florent et de l’embouchure du Golo. Des cultures nouvelles, mûrier, tabac, coton ont été encouragées, comme la production des cédrats, de la soie, des fourrages, l’agri culture demeurant cependant très archaïque. Le gonflement rapide de la population qui, en 1866, comptait 260 000 hab. a entraîné la dilatation de Faire cultivée. Les rythmes de crois sance ont changé par rapport au passé : ce sont les régions retardataires du sud qui se sont alors montrées les plus dynamiques. L’industrie, elle-même, a bénéficié d’initiatives nombreuses, mais elles n’ont suscité que des réussites rares et brèves. Les progrès ont profité surtout aux villes : avec 21 500 et 14 500 hab., Bastia et Ajaccio ont trois fois plus d’habitants qu’à la fin du XVIIIe siècle. Etant donné le caractère rudimentaire des méthodes de production et les lacunes du développement, la croissance du Second Empire a coïncidé avec des manifestations de surcharge.
3. « Une terre qui meurt »? — Ce cri d’alarme lancé en 1909 dans le titre d’un article consacré à la Corse venait à la suite de la grande enquête de 1908 et du rapport de Clemenceau attirant l’attention sur « la misère et le dénuement » qui existaient. Diagnos21
tic pessimiste porté moins d’un demi-siècle après les progrès fugaces du Second Empire. L’île com mençait à connaître le déclin des espaces périphé riques et des montagnes restées à l’écart de la révolution industrielle qui favorisait les zones bien situées, urbanisées, ou pourvoyeuses de charbon. Dure conséquence du rattachement à un Etat riche, au sein d’une économie libérale qui entraînait la libre concurrence des capacités régionales entre elles : la Corse subissait déjà les effets d’une position marginale. La population ne progressait plus parce que l’émigration attirait au-dehors des éléments de plus en plus nombreux. Des signes d’abandon se manifestaient dans l’agriculture frappée par les crises successives de la fin du siècle. Et la dégrada tion perpétuait les retards multiséculaires qui pe saient sur les activités productives... Ainsi, depuis le Plan Terrier, aucun programme de régénération n’avait apporté de mutations pro fondes. Les changements se produisaient lentement, par la force des choses ou grâce aux bienfaits spora diques d’un gouvernement lointain... Eternelle colonie mal colonisée, la Corse est parvenue au cours de son histoire, en dépit de sa peti tesse et de sa situation dominée, à modeler un ensemble socio-économique et socioculturel, donc un type de civilisation, sinon original, du moins autoch tone. Sa vulnérabilité l’a contrainte à subir ou solliciter tour à tour les Etats continentaux voisins. D’où le dilemme fondamental entre le désir d’être et l’impossibilité d’y parvenir. « Il y a au moins vingt-cinq siècles que nous portons sur nos épaules le poids de civilisations magnifiques, toutes venues de l’extérieur. Aucune n’a germé chez nous ; nous n’avons donné le la à aucune... » T. de Lampedusa a mis ces paroles dans la bouche du prince sicilien du Guépard. Elles pourraient trouver une résonance dans l’île, mais elles seraient modérées par la conviction 22
qu’une Corse authentique existe malgré tout, celle qui s’est forgée dans l’isolement, quand les influences du dehors se relâchaient, celle qui a survécu à travers le temps et qui s’exprime dans l’évidence d’une communauté insulaire.
23
Chapitre II LES CORSES, UNE COMMUNAUTÉ ÉCLATÉE
La Corse de 1975 rassemble 227 000 hab. parmi lesquels 143 000 sont nés dans l’île. Les départe ments de l’Hexagone possèdent au même moment 94 660 hab. nés en Corse, alors que l’ensemble des familles dont le chef de ménage est Corse y forme un groupe de 236 000 personnes. La Corse se trouve rait-elle plus hors de Corse que dans l’île ? Mais de quels éléments est constituée la popula tion corse ? Les historiens de l’Antiquité, lorsqu’ils évoquaient l’origine du peuplement, l’attribuaient aux Ibères et aux Ligures ; des recherches médicales récentes ont décelé la présence d’influences « sub négroïdes » venues d’Afrique et d’ « infiltrations protoceltiques méridionales » (1). Les hommes de la préhistoire résultaient donc déjà d’un melting pot qui a été enrichi par une succession d’apports nouveaux depuis vingt-cinq siècles. Sénèque était-il doué d’un sens prophétique lorsqu’il écrivait : « Tant de fois a changé la population de ce rocher aride et broussailleux... Il réside ici plus d’étrangers domiciliés que de citoyens... ? » (1) Pierre Antonetti, Histoire de la Corse, Paris, Robert Laffont, 1973, p. 18.
24
Pourtant, la solidarité des insulaires n’est pas un mythe, ni leur sentiment d’appartenir à un groupe particulier. Ces notions ont résisté aux transfusions et à la dispersion, se sont peut-être même renforcées : il n’y a pas bien longtemps que l’on parle d’« iden tité corse ». Autant en Corse que hors de Corse. Comme si la mer n’existait pas. Alors que les revendications exaspèrent l’efficacité de cette bar rière, les Corses la nient dans leurs comportements. I. — Terre d’exode, terre d’accueil
1. Des échanges anciens. — Les Corses sont partis de tout temps hors de Corse, de gré ou de force. Esclavage et mercenariat paraissent avoir suscité les premiers départs dans l’Antiquité. Strabon rapporte que des esclaves corses se vendaient sur les marchés romains. Si le jugement de Sénèque est retenu, il est probable que ceux qui quittèrent l’île furent moins nombreux que ceux qui y entrèrent ; les échanges auraient laissé des gains pour la popu lation locale qui s’est accrue à l’époque de la paix romaine. Troubles violents et insécurité perpétuelle déclen chèrent souvent l’émigration médiévale. Dès le dé but du IXe siècle, la peur des razzias sarrasines poussa un groupe de familles à chercher refuge à Rome où le pape Léon IV les aurait installées. La fin de l’apai sante domination pisane et les conflits incessants du xive siècle eurent des conséquences identiques : vers 1350, Pise abritait une véritable colonie corse ainsi que Livourne. Les relations commerciales avaient établi les directions de l’exode qui paraît s’être poursuivi puisque, à la fin du XVIe siècle, le chroniqueur Filippini donnait une liste copieuse d’agriculteurs vivant dans les Marennes italiennes, constatant que l’état de guerre permanent qui sévis sait aurait dû inciter tous les habitants au départ. 25
Peut-être est-ce la raison qui poussa les Corses à effectuer, au xviiie siècle, le repeuplement de la Gallura sarde (2). Les émigrés les plus célèbres étaient les navigateurs cap-corsins de Morsiglia, les Lenci, qui possédaient un palais à Marseille. En outre, dès le Moyen Age, ceux qui entraient dans les ordres allaient compléter leur instruction à Rome, à Pise, à Florence... Et l’habitude de porter les armes donna longue vie au mercenariat ; la papauté eut sa garde corse, tandis que Sampiero préféra servir le roi de France avant son fils Alphonse d’Ornano. Ces habitudes du rèrent jusqu’à la fin de la période génoise. Quels furent les résultats de ces ponctions ? Il n’est guère possible d’isoler les pertes dues à l’émigration de celles qui furent provoquées par les épidémies, les homicides, les razzias des Barbaresques... Mais le dépeuplement sévit. Toscane et Ligurie alimentèrent pourtant des courants compensateurs. La légende attribue à un comte romain Ugo Colonna la mission de défendre la Corse contre les infidèles. Des marquis toscans acquirent ensuite les mêmes fonctions. Les premiers seigneurs féodaux insulaires furent ainsi d’origine italienne, comme les ordres monastiques qui s’implantèrent au temps des Pisans. Ce sont les Génois qui créèrent des colonies de peuplement à Bonifacio, Calvi, Ajaccio enfin où arrivèrent, en 1493, 100 familles de la Riviera di Ponante. Ils tentèrent vainement d’interdire le départ des mercenaires ; aussi lorsque la Sérénissime voulut encourager l’agriculture, le manque de maind’œuvre la poussa à faciliter la venue de tâcherons toscans et ligures. C’est encore elle qui attribua à un groupe de Grecs de Morée, fuyant l’invasion turque, le territoire de Paomia, au bord du golfe de Sagone, en 1676. Après bien des vicissitudes et un exil à Ajaccio, les Grecs, installés à Cargèse en 1775, s’y stabilisèrent à partir de 1811. Avec leurs noms grecs corsisés, leur Eglise de rite grec, ils apportent aujourd’hui une note d’originalité au gros village qu’ils peuplent encore.
2. L’émigration massive. — Quelle qu’ait été l’importance des provenances étrangères, la popu lation corse restait faible à la fin du xviiie siècle : (2) Maurice Le Lannou, Pâtres et paysans de la Sardaigne, 2e éd., Cagliari, La Zattera Fratelli Cocco, 1971, p. 151.
26
122 000 hab. au moment de l’élimination des Génois. Le maximum démographique a probablement été atteint en 1881 avec 273 000 hab. C’est justement cette période de forte croissance qui a aggravé le mécanisme ancien du mouvement de départ jus qu’à le transformer en émigration massive. La Corse offre le paradoxe d’avoir nourri un exode intense depuis le siècle dernier sans jamais avoir possédé un peuplement dense. A l’époque du maximum, elle n’a pas rassemblé plus de 30 à 32 hab. au kilomètre carré, 24 comme densité rurale. Mais il existait des zones de surpeuplement localisé dans les régions les plus riches, Castagniccia, Cap Corse, Balagne. Ce sont elles qui ont sécrété, semble-t-il, les déracinements les plus précoces vers 1850-1860. La haute montagne cristalline a été atteinte plus tard ; le Nord, à partir de 1890-1900 proba blement ; le Sud, peu avant la guerre de 1914. La chronologie montre que l’île s’est comportée vis-à-vis de la France conti nentale comme une région à l’écart, parvenant tardivement au maximum et à la phase d’hémorragie violente. Bien sûr, il s’agit essentiellement d’un exode rural. Ce sont les plus dému nis qui sont partis les premiers : les journaliers sans terre, les petits propriétaires possédant des biens insuffisants ou trop morcelés. Les crises agricoles ont joué leur rôle : le phylloxéra a probablement chassé les habitants de Monaccia d’Aullène ainsi que trois groupes d’habitants de Cargèse qui allèrent s’établir en Algérie en 1874, 1875, 1876. L’effondrement du prix du blé, la mévente de l’huile touchèrent plus tardive ment les grands propriétaires, les « Sgio » (3).
La vague de départs du XIXe siècle a été provoquée par la conjonction des causes autant internes qu’ex ternes : la révolution des transports, le rattache ment à un Etat riche, lancé dans l’aventure colo niale, alors que surpeuplement et pauvreté sévis saient sur place. La guerre de 1914 aggrava la situation car les pertes en hommes jeunes décimè rent les forces de travail des cellules rurales, ache vant de les ébranler. C’est après 1920 que se (3) Janine Renucci, Corse traditionnelle et Corse nouvelle, Lyon, Audin, 1974, p. 135-137.
27
déclencha la ponction généralisée qui agit partout, sur le nord et le sud de l’île, les villes et les villages, amputant toutes les familles. Le déficit migratoire se serait élevé à la moyenne de 6 322 personnes chaque année pendant la période 1931-1938. Le mouvement renaquit avec une vigueur moindre après la phase d’accalmie de la seconde guerre mondiale. En 1960, la population totale ne devait pas dépasser 160 à 170 000 hab. Avec 100 000 hab. de moins en trois quarts de siècle, la Corse avait subi une régression de 35 %. Mais la saignée réelle a pré levé des contingents plus nombreux, vu la perma nence des excédents naturels et d’un courant d’immi gration. Séduits par les mirages de la réussite, ce sont probablement plus de 200 000 hab. qui sont partis, attirés autant par les horizons lointains que par les activités nationales. Comme la plupart des terres méditerranéennes, la Corse a donc projeté son modeste capital démographique sur la France et sur le monde. 3. L’insuffisante immigration. — L’immigration n’a pas suffi pour éviter le dépeuplement. Il est vrai que l’arrivée des Français du continent, les « Pinzuti », les « Pointus » puisqu’on les appelle ainsi avec un peu de mépris xénophobe, est toujours restée limitée. Le gouvernement parisien y a envoyé des militaires et des fonctionnaires, les cadres supérieurs de l’administration en particulier. Gouverneurs et intendants sous l’Ancien Régime, plus tard préfets et sous-préfets, ingénieurs des Ponts et Chaussées, mais aussi juges de paix et gendarmes... passèrent sans se fixer à l’exception de ceux qui contractaient mariage avec une jeune fille corse. Les tentatives faites pour établir de petites colonies de peuple ment ont toutes échoué : avec des Lorrains au sud de Bastia dès 1773, avec des Alsaciens aux alen tours d’Ajaccio et de Bonifacio en 1838. 28
La traditionnelle venue des Italiens n’a pas été interrompue par l’installation française. Tout le xixe siècle a connu la régu larité d’un flux saisonnier qui se répétait d’année en année. En octobre-novembre, plusieurs milliers d’ouvriers débar quaient à Bastia du bateau de Livourne, puis repartaient en mars-avril. C’étaient des Lucquois, des Toscans, des gens de Parme ou de Modène, désignés collectivement sous l’épithète péjorative de « Lucchesi ». Ils travaillaient en escouades dans les campagnes bastiaises, vivant chichement pour rapporter chez eux le plus d’argent possible. Mais tous ne rentraient pas : un petit nombre se répandait dans l’île, colporteurs ou négociants, recherchant activement les métiers du bâtiment. Les villages montagnards ont accueilli des bûcherons qui effectuaient des coupes en forêt. Tous les ports virent arriver des pêcheurs, au nord des Toscans et des Génois, au sud des Napolitains. Stoppé par les deux guerres, le mouvement reprit ensuite ; moins important en nombre, attirant autant de Sardes que d’habitants de la péninsule, même des Méridionaux d’origine calabraise et sicilienne, constitué autant par des ouvriers du bâtiment que par des ouvriers agricoles. La majorité préfère aujourd’hui la résidence citadine : Bastia et Ajaccio possèdent depuis longtemps des jardiniers éparpillés dans la banlieue maraîchère, mais aussi des maçons, des artisans, coiffeurs, tailleurs ou chauffeurs de taxi, des commerçants. Cette fraction industrieuse connaît souvent l’enrichissement qui permet l’ascension sociale ; plusieurs gros entrepreneurs et commer çants sont parvenus au stade de la concentration capitaliste. Car l’assimilation a toujours été facile grâce aux similitudes de langues et aux effets conjugués de l’école et des mariages.
Malgré sa permanence, l’infiltration italienne n’a pu compenser la régression démographique. Il a fallu la mise en culture de la plaine orientale après 1957, l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord, les progrès du tourisme, pour inverser l’évolution en cours. II. — La population insulaire aujourd’hui (4)
1. Des changements profonds. — 176 000 hab. en 1962, 249 000 en 1990 : 73 000 hab. supplé(4) Toutes les données statistiques sont extraites des enquêtes par sondages réalisées par l’insee (Ajaccio) après les derniers recen sements. Les sondages sont indispensables parce que les recense ments sont restés, jusqu’à 1975, entachés d’hypertrophies grossières. Les résultats sont publiés depuis 1976 par la revue Economie corse (Ajaccio, insee).
29
mentaires en vingt-huit ans. Le taux moyen annuel de croissance avait atteint 3,3 % de 1962 à 1968 ; il est tombé à 0,5 % de 1982 à 1990, analogue au taux national. Pour cette dernière période, les progrès profitent plus à la Corse du Sud (+ 9 570 hab.) qu’à la Haute Corse (—11 hab.). La Corse est sortie de l’évolution régressive qui la vidait. Après avoir subi l’hémorragie de l’exode, elle a retrouvé sa vieille fonction de terre d’accueil. La répartition des gains montre, en effet, que l’excédent des arrivées sur les départs a apporté plus de 80 % des acquisitions insulaires : 92,2 % de 1962 à 1982, 85 % de 1982 à 1990. C’est l’immi gration qui a provoqué la croissance et principa lement l’immigration d’origine étrangère qui a lourdement prédominé jusqu’à 1975. Les rapatriés d’Afrique du Nord n’ont constitué, dans ce flux, qu’une fraction minoritaire tandis que la maind’œuvre étrangère, attirée par les transformations agricoles, l’expansion urbaine et touristique, l’em portait en volume. Au contraire, après 1975, les échanges avec l’étranger sont devenus déficitaires pendant que les arrivées du continent gonflaient. Bien que la composition de la population locale se soit peu à peu modifiée, les Corses gardent la majorité dans leur île comme l’attestait une en quête insee de 1982. Celle-ci a montré que, sur 240 000 hab. à cette date, 166 600 personnes étaient d’origine corse dont 86 % nées en Corse, 33 600 d’origine continentale et 39 800 d’origine étrangère. La population étrangère qui avait qua druplé entre 1962 et 1975, faisant de la Corse la première région d’accueil en France avec 30 090 per sonnes, a diminué ensuite. Il y a, en 1990, 24 818 étrangers, 9,9 % du total, alors que la pro portion s’élève à 6,6 % à l’échelon national. La régression a été provoquée, non seulement par les mesures restrictives françaises, mais, en outre, 30
par le rétrécissement de l’emploi dans le bâtiment et l’agriculture. La vieille prééminence italienne a cédé devant l’entrée en force des Maghrébins. Les étrangers hors CEE constituent plus des deux tiers du groupe ; bien qu’ils possèdent encore une majorité masculine, la venue des familles a entraîné rajeunissement et féminisation. Ils jouent toujours un rôle notable dans les activités puisqu’ils forment 12 % de la population active, au lieu de 18 % en 1982, absorbés essentiellement par les métiers du bâtiment et de l’agriculture. Aussi leur présence est-elle plus visible dans la plaine orientale où leurs enfants peuplent les classes des écoles, et où ils célèbrent des mariages, le samedi, avec défilé de voitures et concerts d’avertisseurs. Moins homogène, plus mobile, la population insulaire, même accrue, conserve sa faible densité. Avec 29 hab. au kilomètre carré, la Corse tient la lanterne rouge dans le clas sement des grandes îles méditerranéennes, faisant piètre figure à côté de la Sicile (194) ou des Baléares (140). Celui qui découvre cette terre, de l’avion ou du bateau qui l’amène, est encore frappé par la vacuité des paysages, la fragilité des accrochages humains qui ne s’étoffent qu’aux abords des deux principales villes. A l’exclusion des campagnes de la façade orientale, la plus grande partie des espaces ruraux est victime d’un grave phénomène de désertification. Toute la dorsale cristalline, du Monte Cinto au Coscione, a moins de 5 hab. au kilomètre carré, parfois 1 ou 2. Beaucoup de villages, surtout les plus élevés, ont perdu de 60 à 90 % de ceux qui y vivaient au début du siècle. Bien des communes sont devenues squelettiques : 222 sur 349 rassemblent officiellement moins de 200 hab., mais certaines en abritent moins de 10 en hiver. Partout, en particulier dans le Cap Corse et en Castagniccia, nombreux sont les hameaux fantômes et les hameaux mori bonds où subsistent moins de 5 personnes. Ils font office de reliquaires, résidences de personnes âgées qui n’enregistrent presque que des décès. Les communes rurales de montagne ont perdu plus de 4 000 hab. en 1982-1990, accablées par le déficit des naissances et un solde migratoire négatif.
En revanche, la croissance des trente dernières années a transfiguré les campagnes de la plaine orientale et surtout les villes. Avec trente-cinq 31
ans de retard sur le territoire national, la Corse s’est muée en terre urbanisée qui compte, mainte nant, 53 % de citadins. Après une longue stagna tion, les villes ont gagné plus de 60 000 hab., c’est-àdire presque autant à elles seules que toute l’île, La prolifération des nouveaux quartiers confère à Ajaccio et Bastia l’aspect de bourgeonnantes petites cités américaines éprises de développement vertical : leur progression a été plus vigoureuse, en trente ans, que pendant tout le siècle précédent. Et elles parviennent au stade évolutif de bien des métropoles continentales. Le centre-ville perd des habitants alors que les communes périphériques connaissent un essor brutal : + 44 % pour le Grand Ajaccio, en 1982-1990, + 31 % pour le Grand Bastia, si l’on en juge à travers leurs parcs de logements. Dans un environnement qui dépérit, les villes concentrent une bonne part de la vitalité régionale puisqu’elles possèdent 57,8 % des nais sances contre 47 % des décès (1988). Le temps multimillénaire de la Corse pastorale et paysanne paraît révolu. 2. Des héritages durables. — Les organismes urbains qui ont peine à compenser les pertes du milieu rural n’en suppriment pas le poids sur la démographie. Le repeuplement récent n’a pas mini misé le vieillissement, fruit de l’exode. Le troisième âge réunit 57 350 personnes de plus de soixante ans 23,4 % des habitants contre 19,9 % en France. Aussi, la pyramide des âges a-t-elle un profil pyra midal très perturbé, pourvue d’un sommet alourdi et d’une base rétrécie. Si l’immigration a gonflé les classes d’adultes, le capital de jeunesse accuse une déficience marquée. Pour la première fois en 1990, le groupe des moins de vingt ans est devenu inférieur en nombre à celui des plus de soixante ans avec 23,1 % du total. 32
L’ampleur du vieillissement a depuis longtemps engendré la dénatalité, associée à une mortalité élevée. Le baby-boom d’après-guerre ne paraît pas avoir eu ici l’efficacité ressentie à l’échelon national. Dès 1960, le taux de natalité était proba blement tombé à 14,4 ‰ tandis que le taux de mortalité atteignait 12,8 ‰. La situation s’était améliorée pendant la phase de croissance rapide, avant que la Corse ne subisse à son tour la chute généralisée des naissances. A l’exclusion des périodes de guerre, elle avait toujours joui d’excédents copieux ; or, de 1974 à 1979, son bilan naturel est parvenu au déficit. S’il a retrouvé ensuite un solde positif, il ne procure, depuis 1984, qu’un excédent modeste (+ 0,9 ‰), beaucoup plus faible qu’au niveau national (+ 4,4 ‰), avec un taux de nata lité de 12 ‰ et un taux de mortalité de 11,2 ‰. L’habitude passée des grandes familles, qui s’était perpétuée en montagne, s’est détériorée comme ailleurs. A l’image de bien des régions européennes évoluées, la Corse sort de la « transition démo graphique » avec une croissance naturelle proche de zéro. La revitalisation, due à l’immigration, a eu des effets sensibles sur l’amélioration des taux d’acti vité. Pourtant, la faiblesse des contingents labo rieux est restée longtemps une réalité insulaire. Fallait-il une meilleure preuve pour accréditer le mythe de la paresse corse ? En 1962, 29,1 % des habitants étaient actifs ; en 1975, cette proportion s’était hissée à 35,1 %. Elle atteint 40 % en 1990, hausse a priori surprenante. En vérité, sur 99 543 actifs, il n’y a que 84 070 personnes ayant un emploi, à côté de 15 000 demandeurs d’emplois. Le chômage a progressé plus vite que l’emploi depuis 1982, mais les évaluations de la Direction régionale du Travail réduisent celles du recensement (12 000 au lieu de 15 000). Au cours des dernières 33
années, c’est la brutale poussée du taux d’activité féminin qui a apporté le facteur dynamique le plus agissant. Jusque-là, les femmes corses figuraient parmi les moins occupées de France : 21,5 % d’entre elles travaillaient, en 1982, contre 34,4 % en France. Les causes tenaient, certes, aux séquelles des préjugés méditerranéens qui les cantonnaient, jadis, aux tâches domestiques. Elles tenaient aussi aux particularités des structures économiques, à la médiocre attraction du secteur primaire, dominé par l’élevage et la viticulture, à l’absence d’indus tries d’appel, textile, habillement, constructions électriques et électroniques, au fait que 9 sur 10 se dirigeaient vers le tertiaire où elles se trouvaient en concurrence avec les hommes. Aujourd’hui, 35,3 % d’entre elles sont actives, grâce au renforcement du tertiaire. Mais un chômeur sur deux est une femme ; le chômage est surtout élevé entre vingt et vingtquatre ans. Il est moins grave en Corse du Sud parce que les emplois tertiaires sont plus nombreux. La faiblesse des taux d’activité masculins chez les Français demeure inchangée. L’importance du vieillissement n’apporte qu’une explication par tielle ; s’y ajoute l’effet des retraites prématurées acquises dans l’armée, par exemple. Pourtant, le rôle des Français a grossi, depuis 1975, puisque le chiffre des étrangers actifs a diminué. Mais il est fréquent que l’offre soit inadaptée à la demande. Les possibilités provenant du bâtiment, du tou risme, de l’agriculture consistaient généralement en occupations manuelles, alors que la demande locale concerne surtout des métiers non manuels. Le gonflement du tertiaire qui réunit 70 % des actifs a progressé, et la fonction publique reste lourdement développée : avec près de 30 % des salariés au service de l’Etat, la Corse se trouve en tête du palmarès national. C’est la recherche du tertiaire « évolué » qui légitime l’ancienneté du flux migratoire. 34
III. — Les Corses hors de Corse
1. Les concentrations nationales. — Les Corses sont partis et continuent à partir. A quelle cadence ? L’incertitude des données statistiques n’a pas per mis d’appréhender pendant longtemps le phéno mène qui s’est éclairé depuis peu. De 1968 à 1975, 8 905 personnes nées en Corse sont parties vers la France continentale, 7 345 sont revenues : le déficit s’est élevé à 1 560. Mais, de 1975 à 1982, la Corse a gagné 3 440 hab. grâce à un solde migratoire positif puisque 8 632 personnes sont arrivées, alors que 5 192 seulement ont quitté l’île natale. Ces chiffres accréditent la notion d’un ralentisse ment de l’émigration traditionnelle car, en 1975, 94 660 hab. nés en Corse vivaient dans l’Hexagone. A cinquante ans, un Corse sur deux vivrait hors de Corse. Il existe deux zones de concentration préfé rentielle. La Provence - Côte d’Azur rassemble plus de la moitié des expatriés, les Bouches-du-Rhône en particulier qui en possédaient plus du quart à cette date. Marseille a le privilège d’être la plus grande ville corse, tandis que Toulon et Nice figu rent en bonne place. Comme au temps où la domi nation pisane mobilisait les migrants vers le littoral toscan, c’est la côte française d’en face qui exerce l’attraction la plus efficace. Le choix des proximités et des affinités a traversé les siècles. Paris et la région parisienne recueillent, en outre, près du quart des ménages corses et leur rôle paraît s’être affirmé au cours des deux dernières décennies. La région Rhône-Alpes, le Languedoc-Roussillon, le Sud-Ouest réunissent les principaux foyers d’implantation secondaire parce que Lyon, Montpellier, Toulouse même abritent des essaims bien étoffés. La répartition nationale varie peu d’un recensement à l’autre ; cette stabilité des localisations tient à la composition
35
du flux d’arrivées autant qu’à sa ventilation professionnelle. Les trois quarts de ceux qui partent ont moins de quarantecinq ans : ils vont faire des études ou faire carrière au-dehors comme le démontre la présence d’un groupe important d’ado lescents et de jeunes adultes. En 1976, il y avait 3 500 étudiants inscrits dans les universités dont les parents résidaient en Corse. Les taux d’activité sont plus élevés sur le continent qu’en Corse, surtout pour les femmes. Hommes et femmes possèdent plus de diplômes que la moyenne des Français, alors que c’est le contraire pour ceux qui vivent dans l’île natale, signe que l’exode ponctionne toujours une bonne partie des meilleurs éléments, perpétuant son écrémage sélectif. Enfin la vieille prédilection pour les emplois de « cols blancs » reste écrasante puisque le secteur tertiaire occupe 70 % des hommes et 84 % des femmes. Et la préférence fameuse pour les services de l’Etat se maintient immuable : un Corse sur trois s’y consacre. Il est donc normal que ce soient les grandes agglomérations, les plus capables de procurer les places les plus prisées, qui rassemblent les émigrés.
Au siècle dernier, lorsque démarra l’hémorragie massive, ceux qui partaient étaient d’ordinaire dépourvus de qualification, contraints de choisir les métiers que leurs goûts et leurs possibilités pouvaient leur donner. L’art de manier les armes, le respect de l’uniforme les portèrent vers l’armée, la gendarmerie, la police, les douanes, les prisons... Plus tard, l’acharnement aux études leur permit l’enseigne ment, les ptt, la justice et, pour les plus brillants, l’accès dans les ministères et la haute administra tion. La pauvreté de la société traditionnelle, l’ob session de l’incertitude des ruraux dans le passé, légitiment l’attrait pour le fonctionnariat, avec ses profits réguliers et sa réconfortante sécurité. Malgré la diversification grandissante des profes sions du secteur tertiaire, les anciennes spécialisa tions conservent leur magnétisme. Beaucoup de Corses occupent des positions flatteuses comme en témoigne la forte proportion de cadres supérieurs et de professions libérales. Le corps préfectoral comptait récemment douze préfets corses ; les mi nistères parisiens de Il’ ntérieur, des Finances, de 36
l’Education, des Universités, du Travail, de la Santé, des Anciens Combattants, la Préfecture de Police, possèdent tous un noyau d’insulaires. La variété s’est accrue dans les métiers plus modestes ; si les hommes appartiennent encore quatre fois plus souvent que la moyenne des Français à l’armée ou à la police, s’il y a toujours des gardiens de musée ou de prison, des agents de lycée ou des huissiers dans les administrations, les compagnies de navigation et les compagnies aériennes, les transports urbains de Paris, Marseille ou Nice, l’edf-gdf, les spectacles accueillent des éléments de plus en plus nombreux. Les industries les mieux pourvues sont celles des constructions navales et des corps gras, mais l’en semble du secteur industriel retient moins d’un Corse sur quatre. La place de l’agriculture demeure insignifiante.
2. Les dispersions outre-mer. — Que reste-t-il de la dispersion des Corses en terre étrangère ? Régu lièrement mis à jour, un Annuaire « mondial » des Corses apporte encore la preuve de leur projec tion planétaire. Serviteurs de l’Etat, ils s’étaient répandus de l’Indochine à l’Afrique noire, l’Afrique du Nord concentrant les cristallisations les plus denses. Parmi les 17 500 rapatriés revenus, un quart était d’origine corse. Avec la disparition de l’empire colonial, les destinations lointaines ont perdu leur pouvoir d’attraction. Elles laissent surtout des retraités nostalgiques, évoquant leurs souvenirs devant les objets exotiques qu’ils conservent : ivoires guinéens, cuivres ou tapis arabes, statuettes indochinoises... Des sondages effectués dans plu sieurs villages tels Borgo, Peri, Sisco, Piedicroce... sur les lieux d’implantation des jeunes gens partis ont montré que moins de 5 % quittaient aujourd’hui la France. Pour une population qui n’a pas perdu le goût de la découverte, les carrières internationales, 37
l’attirance des dom-tom, envoient toujours les plus aventureux au-delà des mers ; certains échos de presse, au hasard des nominations ou des promo tions, rappellent parfois l’existence d’un ensei gnant installé à Nouméa ou à Papeete, d’un consul qui réside à Porto Rico ou à Tananarive. Comme l’émigration coloniale, l’émigration vers l’Amé rique qui avait entraîné tant de Cap-Corsins et d’habitants du Nebbio, dès l’Ancien Régime, s’est détériorée. Au Vene zuela et à Porto Rico survivent les incrustations les plus ty piques. 6 000 Corses auraient créé jadis une petite France au Venezuela : leur descendance a été évaluée à 200 000 per sonnes. Planteurs de vanille ou d’hévéas, exportateurs, pros pecteurs de pétrole, gros négociants participent activement à la vie économique. La réussite politique a forgé la célébrité des plus connus : le général Morrazzani et Raoul Léoni accé dèrent à la Présidence de la République. A Porto Rico, 4 % de la population seraient d’origine corse, davantage même à Yanco, Rosario, Savana Grande. Minorité entreprenante, les Corses de Porto Rico, comme ceux du Venezuela, se sont assimilés aux antres habitants par le mariage et l’adoption de la langue espagnole. Beaucoup sont devenus étrangers à la Corse qui exerce encore pour quelques-uns un attrait sentimental. Elle garde d’ailleurs la trace de leur munificence car bien des communes ont bénéficié de leurs largesses. Le Cap Corse leur doit la plupart de ses demeures cossues, dans l’écrin de leurs parcs, et de ses orgueil leuses chapelles funéraires.
Les liens tenaces qui, malgré la distance, unissent souvent ceux qui sont partis à leur île prouvent qu’il s’agit d’une « émigration à attache », selon l’expression des sociologues. IV. — Un « peuple corse »
Qu’est-ce qu’un peuple ? Un groupe de ressem blance qui a ses caractères propres. Un alinéa du Littré dit « une multitude d’hommes qui, n’habitant pas le même pays, ont la même religion ou la même origine ». Les expressions, race corse, ethnie corse, peuple corse, sont d’emploi courant. Un puriste ne 38
saurait retenir la première, peut juger la seconde suspecte. La dernière, moins compromettante, tra duit mieux l’existence de cette communauté d’êtres humains unis par l’appartenance au même sol, par la même langue, par un ensemble de similitudes de réflexes et de sentiments. Fait remarquable d’ail leurs compte tenu de la diversité des éléments cons titutifs du peuplement, de l’ampleur du déracine ment, de la proportion de mariages mixtes qui atteint 82 % pour les Corses du continent. L’explication de cette réalité durable associe en une alliance indissoluble la nature et l’histoire. Elle provient de l’insularité qui n’a pas évité le brassage, mais qui procure la notion d’être issu d’un milieu particulier, d’un pays distinct de tous les autres, enveloppé par une marche frontière dont la pré sence se révèle moins dans le temps nécessaire pour la traverser, une heure d’avion ou une nuit de bateau, que dans l’obligation de prendre l’avion ou le bateau. Elle tient à l’efficacité du refuge montagnard qui a joué son rôle depuis la préhistoire : minimisé pendant la Paix romaine, il a été imposé ensuite par quinze siècles d’insécurité. C’est la montagne qui a forgé une humanité rude, ignorant les richesses, prête à la défense batailleuse, habituée au repliement qui donne le sens de l’indépendance, contrainte à la solidarité parce que l’individu isolé ne pouvait survivre dans ce monde difficile. 1. La force du groupe. — A quoi s’identifie un Corse ? Quels sont ce que l’ethnologue appelle ses cadres de référence ? Un Corse appartient à sa famille, à son village (paese), à son canton (pieve), à sa région, à son île, espèces de coquilles successives auxquelles il adhère par une sorte de cordon ombi lical. Enumération banale a priori ; l’originalité réside dans la force du lieu qui l’y attache. La famille traditionnelle associait le père, symbole 39
d’autorité, obéi et respecté, à la mère, gardienne vigilante du foyer, tous deux entourés d’une progé niture nombreuse ; vivant à leurs côtés, les parents âgés du père, des tantes et oncles célibataires... Si ce modèle n’existe plus guère, il subsiste cette « fureur de parenté » qui a souvent été décrite. Dissociée, éparpillée, la famille reste un groupe d’entraide et de défense qui continue à s’étendre au-delà de la famille conjugale. Ainsi se perpétue le clan. Ce type de solidarité a accru dans le passé le carac tère interminable de la vendetta : vengeance héré ditaire et « transversale », elle ne se limitait pas à la famille directement touchée mais frappait aussi les collatéraux. Le soutien familial a des aspects plus positifs : il a orienté fréquemment l’émigration jadis et intervient toujours avec constance dans les périodes difficiles. Le vieux proverbe, qui énonçait « Mieux vaut des gens que du bien », n’a pas encore perdu sa signification. L’attachement à la famille, c’est l’attachement à la maison. La fusion famille-maison s’exprime à travers le langage comme la démonstration en a été faite (5) : la maison se dit a casa, le patrimoine u casale, le patronyme a casata. La maison patriarcale du passé s’agrandissait avec le nombre de ceux qui l’habitaient, en particulier lorsqu’un fils se mariait. Aujourd’hui, qu’elle soit peuplée ou vide, elle demeure le lieu de retrouvailles au temps des vacances. Quelle que soit sa rus ticité, elle est entretenue, améliorée même par l’adjonction d’une salle d’eau, d’un balcon, d’un garage... Au moment des partages quand les patrimoines ne sont pas suffisants pour en maintenir l’intégrité, elle est divisée entre frères et sœurs, chacun ayant une ou deux pièces ou un étage. Il n’est pas rare de voir des maisons scindées par le fractionnement effectif des héritages. On cite avec désapprobation ceux qui les ven dent. Ce conservatisme donne aux citadins corses l’occasion d’établir un record : alors qu’un Français sur dix possède une résidence secondaire, 55 % des Ajacciens et 45 % des Bastiais
(5) Georges Ravis-Giordani, Espaces et groupes sociaux : orga nisation objective et appréhension symbolique, dans Pieve e Paesi, cnrs, 1978, p. 135.
40
sont dans ce cas. Il s’agit en général de biens familiaux préservés et l’étroitesse des relations ville-campagne en porte témoi gnage. Une enquête récente a montré que, sur 100 000 hab. vivant dans les deux principales agglomérations, 12 000 « mon tent au village » tous les dimanches, selon l’expression usuelle, 18 500 y vont à la belle saison, 35 000 pendant les vacances.
Il est vrai que l’attachement à la maison se confond partiellement avec l’attachement au village où elle est située. La force ancienne des institutions communautaires a laissé survivre ce sentiment profond d’appartenance qui, seul, a résisté au dépérissement de la cellule villageoise. Dans son sein existèrent de véritables exemples d’exploitation en commun et l’entraide fonctionnait pour tous les grands travaux, défrichements, récoltes... Au jourd’hui, cette solidarité se traduit par l’aspect fréquemment moléculaire de l’émigration. La réus site professionnelle d’un expatrié provoque souvent autour de lui un regroupement originaire du même village, quelquefois au même lieu de travail ou dans la même catégorie d’emploi.
2. L’attachement au pays. — Ceux qui sont partis vivre ailleurs restent moralement présents. Ils sont devenus des « Corses de l’extérieur » qui s’efforcent de revenir fidèlement pendant les vacances. Les maires s’enorgueillissent de cet afflux qui donne à leur commune l’illusion passagère de son impor tance perdue : dix-huit d’entre eux ont sollicité l’insee, en 1978, afin que soit mesurée l’ampleur du phénomène. Tavera, aux portes d’Ajaccio, qui compte 270 hab. en hiver, en attire 1 012 en été. Les minuscules villages de Castagniccia se trans forment en ruches animées : Polveroso passe de 30 à 161 hab., Castiglione de 64 à 200. Ce contingent d’habitants temporaires a depuis longtemps en couragé les responsables municipaux à étoffer les listes de recensement : outre l’intérêt, c’est une des 41
raisons qui légitime les célèbres falsifications qui les ont enflées et qui, totalisées, ont donné à l’île une population officielle de 27 % supérieure à sa population réelle (289 000 hab. au lieu de 227 000 en 1975). Le volume disproportionné des listes électorales atteste aussi l’attachement militant dont les villages font l’objet. Puisque tout propriétaire payant des impôts dans une com mune a le droit d’y voter, un assez grand nombre de ceux qui en sont originaires préfèrent y demeurer inscrits bien qu’ils résident à Bastia, Ajaccio ou au-delà. D’où la curieuse atrophie du corps électoral dans les deux villes... et l’arrivée, à chaque élection difficile, d’un contingent venant en aide aux candidats menacés. La publicité a évoqué les « charters électoraux » et les ponts aériens qui s’établissent à chaque élection municipale toujours âprement disputée. D’ailleurs les maires désignés sont quelquefois installés au-dehors : le maire d’Ile-Rousse habite Nice, celui de Calenzana a longtemps vécu à Paris, celui d’Olmiccia à Saigon ! Voter en Corse permet non seulement de participer au jeu excitant de la politique, mais encore de rester fidèle au partitu, le parti-clientèle auquel la famille accordait ses suffrages de père en fils, dans le passé, et qui n’a pas tout à fait disparu dans le présent. Dépourvu d’idéologie, susceptible d’apporter privilèges et avantages, c’était une nouvelle structure de soutien qui s’ajoutait pour les individus à la famille et à la communauté.
L’appartenance au sol, inséparable de l’adhésion aux divers éléments de l’encadrement traditionnel, se dilate au-delà du village. Un Corse appartient aussi à son canton qui est fréquemment désigné, tant se perpétuent les vieux usages, par le nom de la piève à laquelle il a succédé. Un montagnard sort du Cruzzini ou de l’Ornano plutôt que du canton de Salice ou de Sainte-Marie Sicché. Le canton, à son tour, s’incruste dans une région qui s’appelle Cap Corse, Balagne, Castagniccia... et enfin dans l’En Deçà ou dans l’Au-Delà des monts, c’est-à-dire dans l’aire bastiaise ou dans l’aire ajaccienne. Un Corse du Nord se sent chez lui à Bastia alors qu’il éprouve parfois l’impression d’être étranger à Ajac cio ; c’est le contraire pour un Corse du Sud. 42
Ces distinctions subtiles perdent provisoirement leur valeur aux yeux d’un Corse expatrié ; de loin, il ne voit plus qu’un peuple et qu’une île. Il en idéalise l’image, y revit un peu dans les multiples associa tions ou amicales qui regroupent les émigrés. Il y retourne souvent finir ses jours après une carrière faite au-dehors. L’immigration de retraite n’a pas cessé de compenser partiellement l’émigration d’em ploi. Bien que les retraités se disséminent partout, ils résident de préférence dans les villes, gagnant leurs villages à la belle saison. Lorsque les émigrés ne re joignent pas l’île de leur vivant, il est fréquent que leurs familles les escortent, après avoir traversé la mer, jusqu’à leur sépulture définitive.
3. La langue. — Les vacances, les élections, la re traite, le tombeau, expressions multiples d’une com munauté qui se retrouve aussi en parlant sa langue. Incorporant un certain nombre de termes d’origine préindoeuropéenne ou préromaine, cette langue latine a subi profondément l’influence toscane, puis la contamination du français. Bien que tous les Corses puissent se comprendre, elle présente des dif férences régionales. Jusqu’au xixe siècle elle n’a servi qu’à l’expression orale, les langues officielles, seules écrites, étant d’abord l’italien, plus tard le français. De nombreuses sollicitudes se sont effor cées, depuis, de la fixer à tel point qu’elle a acquis, en 1974, le statut de langue régionale et qu’elle peut donc être enseignée. Un sondage INSEE, effectué en 1977, a montré que presque tous les hommes nés en Corse parlent corse, 80 % des femmes et 78 % des enfants lorsque leur père et leur mère l’emploient. Dans les deux principales villes, c’est le cas de 74 % des chefs de ménage à Ajaccio et de 84 % à Bastia, moins ouverte sur l’extérieur. Quels que soient l’âge et la catégorie sociale, les femmes font moins souvent usage du corse que leurs maris et les enfants moins souvent que leurs parents. Il est plus cou rant dans les villages que dans les villes, plus habituel pour les 43
personnes âgées que pour les jeunes. C’est la langue de la vie quotidienne, des problèmes domestiques, de la vie rurale, tandis que le français est la langue professionnelle (6). Les expatriés qui se retrouvent s’en servent avec délectation, en une sorte de complicité, heureux de recréer une communauté dont ceux qui ne le parlent pas sont exclus.
Un portrait complet mériterait que soit esquissée une psychologie collective. Quelques traits majeurs en permettent l’ébauche ; l’orgueil d’être Corse, la conscience que la Corse est supérieure à tout, que nul étranger ne peut la comprendre, la fidélité à un sys tème de valeurs où la solidarité reste essentielle. En contrepartie, la susceptibilité, le complexe de la vic time, la xénophobie quand est menacée l’intégrité du groupe, la peur des intrusions extérieures... Une dissociation planétaire, une histoire coloniale ont laissé subsister ce noyau humain. Le sursaut régional l’a réanimé depuis que l’île est sortie d’un siècle d’engourdissement pour être brutalement confrontée à la modernité. Les remous provoqués par l’insertion, puis le rejet, de l’expression « peuple corse » dans le nouveau statut de 1991, vu leurs répercussions politico-juridiques, montrent la réa lité de la situation. Une communauté d’êtres humains est-elle un « peuple » ?
(6) Fernand Ettori, La langue, dans Corse, Ed. Christine Bonneton, 1979, p. 184.
44
DEUXIÈME PARTIE
DE L’ENGOURDISSEMENT AU RÉVEIL
Chapitre I LE DÉPÉRISSEMENT DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES
Si l’on considère les îles méditerranéennes qui sont autre chose que des rochers pelés, aucune n’offre avec autant d’ampleur le spectacle des espaces in cultes abandonnés à la friche, au maquis ou à la lande ; nulle part, l’homme ne paraît occuper aussi peu de place. Certes, la faiblesse du peuplement n’y est pas étrangère, mais l’ancienne économie agro-pastorale, vu son extensivité, s’étendait sur de vastes surfaces. Le maquis et la lande recouvrent souvent des terres qui ont porté des récoltes, des escaliers de terrasses abandonnées, des versants coupés de rideaux irrégu liers, témoignage des labours passés. La Corse a été victime d’une évolution régressive sévère qui est simultanément le fruit de l’exode et de la longue absence d’activités-relais capables de remplacer celles qui ont périclité. 45
I. — Les replis agricoles 1. La peau de chagrin. — La santé de l’agriculture était liée à celle de la démographie. L’essor de la population au xixe siècle avait dilaté l’aire exploitée, engendré une vague de construction de terrasses, accru l’occupation partielle des basses terres. L’émi gration et la première guerre mondiale ont déclenché un recul radical. Les statistiques dévoilent le rétrécissement brutal de la portion cultivée : elle représentait 30,3 % du sol à la fin de l’Ancien Ré gime, 36,5 % en 1913, mais seulement 7,4 % en 1929, 7,6 % en 1946, 6,8 % en 1957, 5,3 % en 1967. De 318 500 ha en 1913, les cultures étaient tombées à 46 527 ha en 1967. Maquis, landes et pacages constituaient alors les deux tiers du territoire au lieu de 41 % en 1913. Ils envahissaient même la surface agricole utilisée puisque les seuls terrains de parcours couvraient plus du tiers des exploita tions de 10 à 50 ha, et près de 60 % des domaines dépassant 100 ha.
2. La sclérose. — L’abandon a été accompagné par une profonde sclérose des structures foncières car l’ampleur des départs a altéré l’exercice des droits de propriété. Dans chaque commune, une partie des terres appartient toujours à des familles absentes ou dont les biens sont restés indivis parce que la plupart de leurs membres sont dis persés. Le phénomène peut acquérir localement une grande importance : des enquêtes effectuées par la Somivac en 1962-1965 ont révélé que l’indivision atteignait 52,5 % des propriétés à Calenzana, et même 83 % à Porto-Vecchio. Les non-résidents ignorent parfois ce qu’ils possèdent, n’en connais sent ni la surface, ni le lieu exact, ignorent même qu’ils possèdent quelque chose. D’où la fréquence des parcelles pour lesquelles personne ne paie plus d’impôts. 46
Ce relâchement de l’emprise humaine sur le sol a figé les vieilles situations. Il a maintenu jusque vers 1960 les structures de propriété caractéristiques du XIXe siècle, signalées par l’enquête agricole de 1867 : lourde prépondérance des microfundia (93 %), existence d’un petit nombre de grands domaines (1 %), faible place de la catégorie inter médiaire. Pulvérisation et morcellement qui étaient associés aux fortes densités, à la prééminence de l’arbre et du jardin, sont restés l’apanage du Cap Corse, de la Castagniccia, de beaucoup de communes de Balagne. Typiques des régions méditerranéennes négligées, les latifundia se dilataient dans les zones naturellement stériles ou peu occupées, c’est-à-dire les plaines et le sud de l’île. L’organisation des finages a été simultanément paralysée. Souvent apparaît encore autour des villages la distinction entre le circolo groupant les petites parcelles closes réservées aux vergers et aux jardins, et les preses, jadis des tinées à la culture des céréales, soumises aux rota tions collectives et dépourvues de clôtures internes.
3. La fossilisation. — La disparition totale ou par tielle des anciennes cultures vaut à la Corse d’offrir un musée de paysages agraires fossiles. Ils sont plus répandus dans l’En Deçà des Monts qui a été plus densément peuplé et plus complètement mis en valeur. Les espaces ruiniformes existent à toute alti tude, de la plaine au coteau et à la montagne. Les plus vastes ont été modelés par les cultures céréalières que l’économie de subsistance avait développées au-delà des aptitudes naturelles : blé au-dessous de 600 m, seigle et orge au-dessus. En 1867, elles couvraient 74 586 ha dont 48 636 pour le blé. En 1929, elles ne représentaient plus que 8 320 ha dont 1 900 pour le blé. En 1957, ne subsis taient que 3 650 ha. Avant 1850, la Corse avait re cours aux farines continentales car la faiblesse des 47
rendements ne permettait pas d’assurer les besoins. Le déclin s’accéléra, à la fin du siècle, avec l’entrée à bas prix des blés étrangers. La culture céréalière survivait à peine après la première guerre quand la seconde lui donna un coup de fouet passager. Les vestiges de son extension se manifestent avec insis tance. Ils envahissent la dépression centrale. Ils existent en montagne jusqu’à 1 200 m, sur des pentes raides, aménagées en ressauts irréguliers, dénuées de soutien construit. Les aires et les paillers de pierres désertés subsistent par centaines. La disparition des plantes textiles est contem poraine de celle des céréales. Chanvre et surtout lin n’avaient jamais suffi à la demande, mais ils étaient répandus dans de nombreuses communes, basses et hautes. Les femmes filaient le lin à la quenouille et possédaient des métiers à main pour tisser la toile. L’usage des tissus venus du continent élimina pro gressivement ces cultures qui ne survécurent pas à la guerre de 1914. 4. Les survies factices. — Le témoignage des sta tistiques accrédite une meilleure résistance de l’arbo riculture : 31 000 ha de châtaigniers et 12 000 ha d’oliviers en 1897, 25 000 ha de châtaigniers et 11 000 d’oliviers en 1967. Mais ce recul modéré cache mal la situation réelle. Le rôle nourricier de la châtaigneraie s’est achevé, après 1920, avec toute l’animation que la forêt-verger engendrait, en particulier en Castagniccia : les migrations sai sonnières de jeunes filles qui arrivaient en octobre, pour la récolte, du Fium’orbo ou de Balagne, le commerce des muletiers d’Orezza qui allaient vendre dans les pays bastiais et jusqu’en Balagne. Les sé choirs à châtaignes (grataghiu), comme les moulins au fil de l’eau, sont vides et inutiles. Même les usines de tanin qui avaient été ouvertes à la péri phérie ont fermé leurs portes. Les coupes avaient été 48
encouragées par le remplacement de la farine de châtaigne par la farine de blé, par la chute des exportations vers Marseille, par la maladie de l’encre... Malgré sa luxuriance, la forêt d’aujourd’hui est largement, elle aussi, entre 700 et 900 m, un pay sage fossile puisqu’elle a perdu ses fonctions. L’en quête communautaire de 1967 estimait que, sur 25 000 ha, 4 394 étaient encore exploités. Les bras manquent pour le ramassage si bien que ce sont les porcs vagabonds qui consomment la plus grosse part des châtaignes tombées. L’oliveraie porte davantage les traces de sa décré pitude car sa position, au-dessous de 600 m, l’a rendue plus vulnérable aux incendies, a entraîné la réapparition du maquis sous les arbres lorsqu’elle n’est plus entretenue. Seuls 3 474 ha étaient exploi tés, en 1967, sur 11 000 ha. Les olivettes négligées ou leurs vestiges épars tapissent encore les coteaux de Balagne, la plaine de Regino, la conque du Nebbio, qui étaient, avec le causse de Bonifacio, les seules régions spécialisées, bien que l’olivier existât partout à la même altitude. Le commerce des marchands d’huile de Balagne qui circulaient dans l’île entière a disparu. Des expéditions sortaient, au siècle dernier, par tous les ports, alimentant souvent les savonneries marseillaises. Mais la concurrence des huiles italiennes, puis tunisiennes, l’irruption des huiles d’arachide bouleversèrent le marché, entraînant un recul déjà sensible à travers les statistiques de 1911. Les exportations actuelles sont devenues dérisoires bien que quelques moulins fonctionnent encore. L’entrée massive des huiles importées a pris la relève. La régression du vignoble a eu, en apparence, une ampleur plus grande puisque, de 18 000 ha en 1867, il s’est rétréci à 11 000 en 1913, 3 149 en 1929, pour atteindre 5 537 en 1959-1960. C’est le phylloxéra dont les méfaits furent tardifs qui a dé49
clenche l’évolution, aggravée par la crise de sur production si retentissante dans le Languedoc, peu après. La guerre de 1914 et l’exode l’ont certaine ment accentuée. L’échine du Cap Corse qui prati quait depuis longtemps la viticulture commerciale grâce à la réputation de ses muscats et de ses vins cuits, étale, sur les escaliers de terrasses qui décou pent ses longs versants raides, les paysages fossiles les plus spectaculaires. La dégradation rurale ne se limite pas ici au déclin de la vigne et de l’olivier, qui l’accompagnait souvent, mais aussi au déclin du cédratier, source appréciable de revenus pour les petits cultivateurs après 1870. Les exportations furent perturbées par la production californienne qui provoqua l’effondrement des cours pendant la décennie précédant la première guerre mondiale. Rien n’est venu compenser la déchéance progres sive des principales activités agricoles : la Corse n’a pu passer de l’économie de subsistance à l’économie de profit qui lui a ailleurs succédé. Aussi les espaces délaissés ont-ils été réoccupés par le bétail.
IL — Les résistances pastorales 1. Des effectifs amenuisés. — Bien que les statis tiques des effectifs animaux soient aussi suspectes que les statistiques de population, péchant plutôt par défaut que par excès, vu le souci des éleveurs d’échapper au fisc, le recours aux chiffres est néces saire pour évaluer l’évolution :
Bovins Ovins Caprins Porcins
50
1896
1929
1949
1967
54 540 432 230 232 600 81 000
40 000 200 000 200 000 35 700
39 150 273 000 200 000 39 500
46 000 120 000 40 000 30 000
Il ne s’agit plus des troupeaux considérables qu’évoquaient les observateurs du passé. Alors que la Corse possédait deux fois plus de bêtes que d’hommes pendant tout le XIXe siècle, elle garde des effectifs animaux à peine supérieurs à sa population. Mais le siècle écoulé n’a pas consommé la disparition de cette activité, opposant toutefois la stagnation relative du gros bétail à la diminution sévère du petit bétail. Il n’empêche que, aux yeux du voyageur qui découvre le pays, l’île apparaît encore comme une espèce de terre pro mise pour le bétail errant, à travers une série d’images : ânes hiératiques somnolant au bord des chaussées, troupeaux de chèvres solitaires broutant sur les talus, files de porcs et de porcelets sur les routes de montagne, et dans le Sud, partout, des bovins isolés ou en groupes. Ainsi se manifestent encore les vieux impérialismes pastoraux qui ignoraient clôtures et cultures.
Seules les brebis font l’objet d’une vigilance réelle. La prépondérance ancienne des ovins a été pérennisée par l’installation des sociétés de Roque fort qui ont créé la première laiterie en Balagne dès 1893. Elles n’ont monopolisé qu’après la der nière guerre l’essentiel de la production de lait de brebis, près de 90 % vers 1965-1970. Les cinq grosses usines de la Société anonyme des Caves et Producteurs réunis, implantées à Ile-Rousse, Ajac cio, Corte, Bastia et Aléria, fabriquaient, en année moyenne, de 16 à 18 000 t de pâte de fromage envoyées vers les caves de Roquefort pour l’affinage. C’est l’existence de ce débouché sûr, l’élévation régulière des prix du lait au rythme de la hausse des prix, l’ouverture du marché intérieur à la produc tion domestique, qui ont accru et stabilisé les profits des bergers. Bovins, caprins, porcins engendrent des activités résiduelles. Bien qu’elle ait été précieuse à l’époque où toutes les familles s’efforçaient d’assurer leur subsistance, la chèvre a été victime de sa vieille réputation de destructrice. Elle peut procurer des profits égaux et même supérieurs à ceux de la brebis, mais le fromage qui passe entre les mains des cour51
tiers de Calenzana est restreint au seul marché insulaire. Ni la viande bovine, ni la viande porcine ne satisfont la consommation, surtout la première qui en couvre le dixième. L’élevage du porc l’em porte sur tous les autres par le poids de la viande pro duite : c’est la spécialité des hautes communes mon tagnardes, riches de châtaigniers, qui fournissent spontanément l’essentiel de la nourriture. La répu tation de la charcuterie s’est pervertie avec le gonflement de la demande et l’industrialisation de la fabrication. Le fléchissement de l’offre en face d’une demande croissante s’explique par la faiblesse de la productivité. 2. Des traditions conservées. — Les méthodes traditionnelles continuent à l’emporter : l’habitude immémoriale du libre parcours fait de l’animal un nomade endurci par la vie de plein air, l’absence d’étable ou d’abri, et la sous-alimentation. Une enquête sur les ovins, effectuée en 1974 par les services de l’Agriculture, a montré que 52 % des 941 éleveurs pratiquaient intégralement le plein air, et qu’une trentaine seulement possédaient de vé ritables bergeries. Le parcours naturel représentait 90 % de la surface utilisée : pourtant, à cause de l’ari dité estivale et de l’appauvrissement progressif de la végétation, les disponibilités fourragères, même les meilleures années, sont estimées insuffisantes. Or, quoique les brebis constituent, avec les vaches lai tières, la fraction la mieux soignée du cheptel, la proportion des éleveurs préoccupés d’améliorer l’ali mentation de leurs bêtes est encore faible. En 1974, un sur trois seulement procédait à des cultures pour les nourrir, un sur trois achetait des fourrages. Les chèvres ne reçoivent comme complément, en saison froide, que des châtaignes ou des branches de chênevert et de chêne-liège. Plus frugales, elles s’accom modent généralement des tiges ligneuses du maquis. 52
La réticence des bergers à devenir cultivateurs de fourrages s’explique par le fait que les propriétaires des troupeaux sont rarement propriétaires des terres, et, lorsqu’ils le sont, ils possèdent rarement des superficies assez vastes. Beaucoup dépendent donc des propriétaires du sol qui leur consentent, non des baux durables, mais de véritables ventes d’herbe, contrats oraux d’une année décourageant les cultures. Aussi, alors qu’en 1952, René Dumont avait jugé que 100 000 ha étaient indispensables, il n’y avait, en 1974, que 1 411 ha de prairies artificielles et temporaires et 2 240 ha de fourrages verts ou plantes fourragères. La productivité reste soumise à la va riabilité des chutes de pluie : abondantes de l’automne au printemps, elles gonflent les rendements en lait qui peuvent fléchir de 20 à 40 % en année sèche. Quant au bovin corse, les services vétérinaires évaluent son poids à la moitié de celui du bovin importé qui atteindrait en moyenne 600 kg.
3. Des migrations maintenues. — La survie des mi grations transhumantes atteste la force des tradi tions pastorales. Les villages élevés de la montagne cristalline, Asco, Bastelica, ceux du Niolo et du Haut-Taravo, n’ont pas perdu leur rôle moteur dans le déclenchement des mouvements caracté risés par l’alternance ; descente en automne vers les « plages » (impiaghia), montée en fin de prin temps vers les hautes terres herbeuses (muntana). Les directions se maintiennent comme les itinéraires, mais le camion intervient de plus en plus souvent pour le transport des bêtes, et les familles, lors qu’elles suivent, voyagent isolément en voiture. La longueur des parcours varie d’ordinaire de 20 à 50 km, quelquefois supérieure pour les Niolins qui descendent de la Balagne à Ajaccio, et attei gnent l’extrémité du Cap Corse. La montagne au-dessus de 1 400-1 500 m, surtout les plateaux d’Ese et du Coscione, les pâturages du Haut-Tavignano, apparaissent comme des reli quaires conservant, immuables, les frustes cabanes de pierres qui accueillent les bergers chaque été. Les « plages », en revanche, offrent plus de com plexité. La distribution du petit bétail n’a jamais été 53
homogène : les régions les plus pauvres, les plus accidentées, que couvrent les maquis les plus éten dus, Cap Corse, Agriates, Balagne déserte au sud de Calvi, reçoivent les chèvres, tandis que les régions riches qui possédaient jadis céréales et oli vettes, la Balagne, le Nebbio, les basses vallées de la Gravone, du Prunelli, du Taravo attirent les brebis plus exigeantes. La plaine orientale a toujours pré senté les caractères d’une vaste zone d’imbrication. A cause de leur position littorale, les pacages hiver naux ont évolué sous la pression plus ou moins efficace des conquêtes agricoles, de l’expansion ur baine et touristique. Bien des bergers s’y sont fixés, depuis le siècle dernier, soit dans les villages de coteau, Borgo, Belgodère, Bastelicaccia, Tomino..., soit au bord de la mer, à Centuri, Galeria, PortoPollo... La transhumance « mixte », déclenchée à partir des villages les plus hauts, a donc cédé la place à une transhumance « normale » ou « di recte » issue des villages d’en bas. Et celle-ci, parfois, a fini par disparaître : terme ultime de la dégra dation.
4. Des activités en crise. — Malgré ses capacités de résistance, l’élevage traditionnel est en crise. Les effectifs s’amenuisent : de 127 000 ovins et 40 000 ca prins en 1967, ils sont tombés à 103 000 et 30 000 en 1974. Le nombre des éleveurs d’ovins passe si multanément de 1 055 à 941. Une soixantaine d’ex ploitations disparaissent chaque année. Les migra tions transhumantes s’appauvrissent : en 1974, 56 % des bergers n’y participaient plus et 28 000 bre bis fréquentaient les pâturages d’altitude contre 50 000 en 1950. Il arrive que les déplacements ne déterminent plus un genre de vie. Les bergers trop âgés renoncent à leur existence mobile, finissent par vendre leurs bêtes quand ils n’ont pas d’héritier pour leur succéder. Les cas de déshérence se multi54
plient vu la désaffection des jeunes pour le métier. Le pasteur traditionnel avait pourtant bénéficié, au cours du siècle écoulé, du déclin de l’agriculture. Resté souvent seul exploitant du sol, pourvu d’une source de revenus grandissants, il s’était progressive ment affirmé dans la société insulaire, au fur et à mesure que le rôle du propriétaire cultivateur s’affaiblissait. Il était devenu petit, moyen, quelque fois gros possesseur de terres, en particulier dans le bas pays recherché en hiver. Aujourd’hui le phéno mène inverse s’affirme : l’emprise foncière est en tamée par les cessions aux sociétés immobilières, et aux promoteurs d’ensembles résidentiels. Elle a été grignotée dans la plaine orientale par l’extension de l’agriculture nouvelle. Le berger est tenté par des transferts d’activité : selon les lieux, le choix se porte sur le commerce, l’hôtellerie, la construction, la viti culture, le maraîchage... Mais il s’agit exceptionnelle ment d’une mutation vers l’élevage pour la bouche rie, ou vers un élevage spécialisé pour le lait. L’archaïsme prolongé des méthodes a compromis l’adoption de formes intensives, c’est-à-dire le pas sage de la vie pastorale à l’élevage moderne. Après l’époque du « triomphe » des bergers, il a donc contri bué à entraîner leur décadence. III. — Heurs et malheurs de l’industrie
1. Succès et faillites d’hier. — La Corse pastorale et paysanne a toujours pratiqué l’artisanat, insépa rable de l’économie de subsistance, et dépendu très tôt de l’extérieur pour une partie des produits éla borés qu’elle consommait. Dès l’époque pisane ve naient de Toscane le fer, l’acier, les draps et même des étoffes de luxe recherchées par les seigneurs et les prélats. Aussi conservait-elle, au temps de la révolution industrielle, des activités de type pré capitaliste orientées vers la fabrication des biens de 55
consommation courante. L’agriculture, l’exploita tion des richesses naturelles fournissaient la plupart des matières premières ainsi que l’indispensable source d’énergie, le bois. La révolution industrielle se manifesta par quel ques tentatives qui entraînèrent des créations peu durables. La plus célèbre fut l’éphémère industrie sidérurgique. Vers 1830, la Corse possédait de petites forges qui utilisaient le minerai de fer de l’île d’Elbe grâce à la force intermittente des cours d’eau. Sous l’impulsion de l’initiative privée, plusieurs hauts fourneaux firent leur apparition entre 1837 et 1843 : deux à l’embouchure de la Solenzara, puis deux autres à Toga, dans la banlieue bastiaise. Ces derniers durent à leur situation favorable d’être les plus prospères. Ils avaient été achetés, en 1851, par les frères Jakson, industriels de la Loire, qui développèrent l’entreprise de telle sorte qu’elle éleva la Corse au rang des premiers départements producteurs de fonte. Fers et fonte étaient expédiés à Rive-de-Gier. Le minerai de l’île d’Elbe ne suf fisait plus ; un supplément arrivait d’Algérie par le port de Bône. Une autre usine fut installée à PortoVecchio en 1860. Mais les difficultés surgirent vite après l’euphorie, dès la fin du Second Empire. L’usine de Porto-Vecchio disparut la première, celle de Solenzara suivit. Les établissements de Toga furent fermés en 1885. La crise de la demande, dé tournée vers la grosse industrie continentale en plein essor, explique ces faillites (1). 2. Disparitions et survies d’aujourd’hui. — Fail lites identiques dans l’exploitation minière, même dépourvue d’industrie d’aval. Il est intéressant de constater que de nombreuses concessions furent (1) Antoine ALBITRECCIA, La Corse, son évolution au XIXe siècle et au début du XXe siècle, Paris, puf, 1942, p. 103-113.
56
accordées de 1850 à 1920 : fer et sulfure d’antimoine du Cap Corse, plomb argentifère de l’Argentella (1874), cuivre de Ponte-Leccia (1881) et de Tox, anthracite d’Osani (1889)... Au total, vingt et un gisements ont été exploités, puis abandonnés. La mine d’amiante de Canari, dont les déchets blan chissent encore les escarpements de la côte occi dentale du Cap Corse, a disparu la dernière. C’était la seule que possédait la France ; ouverte à partir de 1949 par la Société minière de l’Amiante, filiale d’Eternit, elle exportait intégralement par Bastia une production qui satisfaisait le quart des besoins nationaux. La nécessité d’une modernisation oné reuse, en face de possibilités d’extraction peu du rables, la condamna, vu la concurrence de l’amiante canadien qui arrivait à un prix inférieur. Elle ferma ses portes en 1965. Les usines d’extraits tannants ont connu un sort analogue. Afin d’utiliser le bois de châtaignier, elles s’étaient installées à la périphérie de la Castagniccia, bénéficiant des voies ferrées qui fonctionnèrent à partir de 1888. La première, Champlan, naquit dans la vallée du Fium’alto en 1885, la seconde à Folelli, les autres à Casamozza, Barchetta, Ponte-Leccia (1928) le long du Golo. Jusqu’à la première guerre, celle de Casamozza appartenait à une société alle mande, Lovenstein & Cie. En 1914, Champlan n’existait déjà plus. La crise des débouchés emporta les deux dernières, Barchetta en 1954, puis Ponte Leccia en 1963. Pourtant, l’industrie du bois a pu faire figure de « grosse » industrie dans la médiocrité générale. Elle a animé non seulement de nombreuses scieries, mais aussi deux usines de liège qui fabriquaient des bou chons ainsi qu’une troisième qui se servait du pin lariccio pour façonner des séparateurs d’accumula teurs. Elles ne résistèrent pas mieux que les précé dentes aux difficultés économiques. D’où la consta57
tation désabusée de l’Inventaire départemental de 1949 : « Il n’existe pas à proprement parler d’industrie véritable en Corse. » Une seule usine d’importance notable paraît avoir des chances de longévité supérieures : c’est la Manufacture de Tabac Job, devenue Job-Bastos, implantée à Bastia en 1924, qui bénéficia du soutien de l’Etat puisque la transformation et la vente du tabac en Corse échappent à son contrôle. Occupant 180 personnes, elle ne sert pas de débouché aux res sources locales qui ne lui apportent que 5 % du tabac utilisé, le reste étant importé d’Amérique du Sud, Albanie, Bulgarie... La production, qui atteint 40 à 50 millions de paquets de cigarettes par an, est vendue au-dehors pour 85 %. L’artisanat rural, si vivace au XIXe siècle, le travail du bois, la fabrication de la toile et du drap ont périclité avant 1914, comme les petites usines qui produisaient des pâtes alimentaires, des savons, ou qui tannaient les peaux. Vers 1960-1965 subsis taient néanmoins quelques industries agricoles ac tives : des distilleries, des fabriques de boissons et d’apéritifs, comme Casanis et Mattei à Bastia, les laiteries de Roquefort, des fabriques de yaourts ou de pâtés de merle. Les plus prospères étaient liées néanmoins à la seule fraction dynamique du secteur secondaire, la construction : il s’agissait des fabriques d’agglomérés, carrelages, planchers en béton, d’une briqueterie-tuilerie, des scieries... L’inventaire est maigre finalement : des espoirs toujours déçus, des initiatives extérieures insatis faites, peu d’initiatives locales, aucune qui soit d’envergure. L’industrie représentait 3 % du re venu en 1965 et occupait 4 100 personnes, 6,6 % de la population active en 1968. Aussi le secteur secondaire est-il dominé par la toute-puissance du bâtiment. On ne trouve rien ici qui soit comparable à l’industrie de la chaussure, ou à celle des bijoux 58
fantaisie de Minorque, animée par la « débrouillar dise inventive » des Catalans (2). Il n’y eut pas de bourgeoisie sollicitée par des investissements pro ductifs parce que la classe dirigeante, appuyée sur une solide assise foncière, est attirée vers les professions en honneur dans les classes aisées, le barreau, la médecine, surtout la tribune liée au pouvoir politique. L’industrie n’a donc apporté aucune compensation au déclin de l’économie traditionnelle. IV. — Le bilan du dépérissement
1. La régression. — Agriculture moribonde, éle vage amenuisé à l’extrême, industrie insignifiante, balance commerciale déficitaire, tel était, vers 19501960, le bilan de trois quarts de siècle de régression. Le dépérissement ne pouvait être un simple phé nomène économique car les activités du passé en gendraient un genre de vie qui avait façonné des structures sociales, donc un type de civilisation étroitement adaptée au milieu, plongeant ses racines dans les temps les plus anciens. La dégradation des institutions communautaires et de la société traditionnelle a accompagné la chute de la produc tion liée au dépeuplement. Le déclin de la vieille Corse s’accomplit en même temps que s’effritent les cellules villageoises avec les usages qui les sou daient : possessions collectives et organisation col lective des travaux agricoles sur les terres ouvertes. Les assolements ont disparu progressivement entre 1870 et 1920-1925, comme les droits acquittés par les habitants sur les communaux pour la culture et le pacage. (2) Pierre Deffontaines, La Méditerranée catalane, p. 117.
puf,
1975,
59
Le mécanisme régressif n’a pas agi également sur l’en semble de l’île : il a été plus corrosif pour le Nord que pour le Sud, parce que l’intensité de la mise en valeur a toujours été plus grande. Aussi a-t-il touché avec une sévérité particu lière les régions les plus évoluées. L’évolution a été aussi plus grave pour la montagne et les coteaux qui concentraient les vil lages et les cultures, que pour les basses terres qui n’ont jamais été totalement occupées, surtout quand se dilataient les plaines littorales malsaines. Il a fallu attendre la fin de la dernière guerre et l’arrivée des Américains, armés de DDT, pour que soit extirpée la malaria, entretenue par l’abandon. La régression en soi n’est ni surprenante, ni exceptionnelle : toutes les régions rurales, toutes les montagnes l’ont connue. Elle s’est manifestée ici plus tardivement qu’ailleurs à cause de l’éloignement. Le fait anormal a été la lenteur des côtes et des villes à bénéficier de la décongestion de l’intérieur. Les gains urbains et littoraux apparaissent dérisoires par rapport aux décharges montagnardes. C’est la preuve de leur faible attractivité par suite de l’absence d’activités relais : ni cultures nouvelles, comme les cultures fruitières qui se sont développées dans l’Ardèche par exemple, ni industries nouvelles, ni dé marrage touristique réel malgré la station d’hiver d’Ajaccio, puis la naissance de Calvi et d’Ile-Rousse au tourisme d’été dans les années 30.
Quelles ont été les conséquences de la situation sur une terre pauvre ? La Corse avait toujours souffert sinon de misère, du moins de gêne. L’histoire n’a laissé nulle part l’empreinte de la richesse ; l’archi tecture civile et religieuse conserve une sobriété peu commune. Il est notoire que les grandes fortunes privées sont restées exceptionnelles. La population insulaire aurait pu profiter de l’exode : de coutume, ceux qui restent vivent plus à l’aise. Mais pas quand la vie rurale s’effondre et quand l’artisanat se dété riore. Or, tandis que la Corse s’appauvrissait, les Corses ont amélioré leur situation. Une étude de la fortune moyenne par habitant a montré, en effet, que la Corse occupait le dernier rang du pays, autant en 1903 qu’en 1953 ; mais, entre les deux dates, l’écart par rapport à la moyenne française s’est restreint. Pourquoi ?
60
2. Les palliatifs. — La première solution-refuge contre l’engourdissement des activités productives a été la recherche compensatoire des emplois du sec teur tertiaire. Palliatif méditerranéen courant que l’hypertrophie des services en face de l’atrophie industrielle. En 1962, le tertiaire en Corse réunissait déjà 50 % des actifs, contre 40,7 % en France. L’examen des groupes laborieux révèle qu’il ne s’agit pas du ter tiaire primitif qui affecte les régions insuffisamment développées, mais d’un tertiaire « évolué ». Le sec teur le plus lourdement gonflé est celui de la fonction publique qui s’arroge une place deux fois supérieure à la moyenne nationale : 20 % contre 11 %. L’Etat est le premier employeur ici, et aucune région ne lui accorde une primauté aussi écrasante. Pourtant le chiffre des fonctionnaires de l’Etat est normal par rapport à celui des habitants : il ne paraît excessif qu’à cause des déficiences du reste de l’économie. Si l’on y ajoute les agents des collec tivités locales, départements et communes, la quête obstinée des emplois administratifs, qui a suscité l’ironie des observateurs, dès le siècle dernier, s’impose avec plus de force. La dégradation des activités traditionnelles s’est soldée par une autre conséquence : le repli sur des revenus rentiers. Le préfet constatait le phénomène, dans l’Inventaire départemental de 1949. En 1965, un nouvel examen montrait que l’inactivité rap portait à l’île, sous forme de pensions, prestations sociales et assistance, 36,2 % des ressources an nuelles, alors que la moyenne nationale ne parvenait qu’à 22 %. En 1975, dans les dépenses de l’Etat en Corse, qui atteignaient près de trois fois les recettes, les pensions civiles et militaires (49 % du total) étaient supérieures aux traitements du per sonnel en exercice, tandis que l’action sociale s’éle vait à 10 %. Le poids des pensions est confirmé par 61
les bases d’impositions : les traitements et salaires ne constituent, en 1975, que la moitié de la base im posable contre les deux tiers ailleurs, mais les pen sions et rentes, avec 22 % en Corse du Sud et 21 % en Haute Corse, procurent les plus fortes valeurs du territoire (3). Certes, la Corse possède un groupe étoffé de personnes âgées, donc de retraités. L’aide sociale par habitant représente, cependant, une somme de 480,23 F en 1974, contre 185,35 F en France. Si pensions et assistance paraissent évidemment des ressources « normales », légitimement acquises pour les premières, il est bien connu qu’un système astucieux d’utilisation des lois sociales en gonfle les retombées pour la population. Même modiques, les profits qu’il permet atténuent la dureté du manque à gagner. Au terme de la phase séculaire de dépérissement, la notion de « crise compensée » par l’émigration de « promotion », qui avait éparpillé tant de Corses dans les villes du continent et l’empire colonial, a été évoquée avec justesse (4). La compensation est aussi venue de ces palliatifs adroits, mais paraly sants, qui se perpétuent aujourd’hui, malgré le bouleversement économique.
(3) Statistiques extraites de la revue Economie corse, Ajaccio, INSEE. (4) « Corse, les raisons de la colère », numéro hors série d’Economie et Politique, revue marxiste d’économie, juillet 1974.
62
Chapitre II LES COMMOTIONS DE LA FIN DU XXe SIÈCLE La Corse est sortie de la débilitante « tendance au déclin » qui l’anémiait et la sclérosait pour entrer dans le monde moderne. Progrès ou seulement croissance ? Développement ou « contre-dévelop pement » ? Les avis diffèrent et les opinions s’af frontent. Quoi qu’il en soit, à la marginalisation dont elle était victime a succédé une mutation presque aussi profonde, en vingt ans, que pendant les deux siècles de présence française qui avaient précédé. D’où l’intensité du traumatisme, non seulement pour les structures économiques mais pour les esprits, et l’ampleur bouillonnante des réajustements.
I. — Le choc du nouveau
1. La prise de conscience des disparités régionales. — Le changement est venu du dehors : il s’inscrit dans une conjoncture nationale. C’est pendant la période de reconstruction d’après-guerre que s’af firma, à travers l’image du « désert français », la notion du déséquilibre Paris - province et de l’appauvrissement relatif des régions les moins favo risées par la nature. 63
Dans le cadre des études de préparation du Plan, l’Inventaire départemental de 1949 apportait un premier bilan des déficiences. La Corse inspirait de « légitimes inquiétudes » : d’abord à cause du dépeuplement, dont la sévérité était dévoilée pour la première fois, mais aussi à cause du vieillissement de sa population, de l’archaïsme de son outillage, du retard de ses équipements. D’autre part, vu l’insignifiance de ses activités, elle apparaissait tri butaire de la France continentale dans tous les domaines de l’économie. L’examen final insistait sur le caractère fallacieux de l’excédent de la balance des comptes puisqu’il était provoqué par l’importance des fonds que l’Etat versait au dépar tement sous forme de traitements, retraites, allo cations, assistance, subventions d’équipement... Il n’était donc pas « l’expression de la richesse de l’île, mais de ressources improductives ayant leur origine dans l’impôt ». Bien qu’elle ait été rattachée à la région ProvenceCôte d’Azur, la Corse bénéficia, en 1957, d’un Plan d’Action Régionale particulier, au moment de la mise en marche de la politique d’aménagement du territoire. Celui-ci établissait un constat de dépé rissement, montrant l’intensité de l’exode et la faiblesse des densités par rapport aux îles voisines. Il en attribuait la cause à la médiocrité du niveau de vie, « probablement le plus bas de la métropole puisque le chiffre des voitures neuves et des postes de radio y était de deux tiers inférieur à la moyenne nationale ». Il révélait aussi le rétrécissement tragique des espaces productifs : labours et cultures maraîchères occupaient 2 % du sol, contre 64 % aux terres incultes, obligeant le département à recourir aux achats extérieurs pour tous les produits courants, fruits, viande, huile, lait, légumes... Il constatait que les possibilités industrielles étaient réduites 64
par l’étroitesse du marché, autant que par l’absence d’initiatives économiques. Il dégageait enfin le rôle des « handicaps créés par l’insularité », c’est-à-dire le poids des frais acquittés pour le transport par mer de toutes les marchandises, montrant qu’ils pouvaient freiner tous les secteurs de l’économie. « L’action régionale » se soldait par un ambitieux programme de rénovation. Il reposait essentielle ment sur le tourisme, « levier de renaissance » capable de réanimer toutes les activités, stimulant l’agriculture par sa demande, entraînant l’amélio ration des communications intérieures comme des liaisons avec le continent. La régénération de la vie rurale s’appuyait, en outre, sur un aménagement agro-sylvo-pastoral qui devait aboutir à restreindre les surfaces incultes à 20 % de la superficie totale. Quoique des inter ventions aient été prévues pour toutes les zones d’altitude, le rôle majeur était dévolu aux plaines littorales, les plus susceptibles d’accueillir une agri culture moderne, irriguée ou mécanisée. Pour traiter et commercialiser les produits, la création d’instal lations industrielles était envisagée : coopératives viticoles ou oléicoles, conserveries de fruits et légumes, même de viande ! Généreux dans ses intentions, le Plan d’Action Régionale était démesuré dans ses objectifs, mal adaptés aux réalités régionales. Il attendait « le concours » des populations, oubliant qu’elles étaient démunies de capitaux, amputées de leurs élites, engluées dans le scepticisme légué par un siècle d’engourdissement. La Corse fut néanmoins dotée de deux sociétés d’économie mixte chargées des premières réalisations, la Société pour la Mise en Valeur agricole de la Corse (somivac) et la Société pour l’Equipement touristique de la Corse. Le programme régénérateur n’était certes pas le premier que l’île ait suscité : aucun n’avait engendré 65
de résultats spectaculaires. Le pessimisme désabusé qu’il a souvent provoqué était donc justifié. Mais un fait accidentel, imprévu au départ, vint en accroître la répercussion.
2. L’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord. — Les retours se sont échelonnés de 1957 à 1965 avec un afflux brutal en 1962, au moment de l’indépen dance algérienne. Officiellement, 17 500 rapatriés sont arrivés, bien que le comptage soit difficile. C’est le chiffre le plus faible enregistré dans un département méditerranéen, mais il représentait près de 10 % de la population totale. Les villes d’Ajaccio et de Bastia ont attiré la majorité des nouveaux venus, 53 % d’entre eux, et Ajaccio seule en a accueilli le tiers. Mais le flux s’est dilué dans l’île entière, atteignant médiocre ment les petites villes, plus copieusement les cam pagnes littorales : 500 familles se sont installées, plus nombreuses dans la plaine orientale, surtout autour d’Aléria et de Ghisonaccia, plus dispersées dans les dépressions méridionales, de Porto-Vecchio à Figari, autour de Sartène, en Balagne et dans le Nebbio. Ils comptaient, dans leurs rangs, quelques grands viti culteurs et agrumiculteurs, accompagnés de pépiniéristes, d’anciens producteurs de primeurs ou de plantes à parfum. Il y avait aussi, parmi eux, des ingénieurs agricoles, des vinificateurs, des œnologues, des courtiers en vins... Le milieu urbain n’a pas été aussi profondément touché que le milieu rural, mais il a bénéficié d’une impulsion qui s’est traduite par l’apparition de commerces, la création de cabinets den taires ou médicaux, de laboratoires, l’ouverture d’hôtels ou de campings dans les stations touristiques. Les gains d’Ajaccio ont été égaux à ceux de tout le reste de la Corse. Alors que Bastia a plutôt subi les effets des transformations rurales, puisqu’elle a accueilli des chais, des ateliers de mécanique agricole et de conditionnement des fruits et légumes, des ma gasins de vente de matériel agricole, Ajaccio s’est enrichie de librairies, d’imprimeries, de bijouteries, de magasins d’alimen tation... Partout, les acquisitions du secteur secondaire ont été 66
maigres, malgré quelques entreprises de construction, tandis que la part du secteur tertiaire s’est révélée écrasante. Les rapatriés considèrent généralement qu’ils ont trouvé en Corse, au départ, un climat assez favorable. Il est vrai qu’un sur quatre portait un nom corse, et qu’un sur cinq y était né. Certains maires les ont attirés et aidés à s’installer. Ils n’ont été, nulle part, assez nombreux pour avoir un poids véritable dans l’électorat. Peu ont pénétré au sein des conseils municipaux. Mais ils ont vite engendré la suspicion et l’envie : parce qu’ils ont acheté ou loué des terres constituant souvent de vastes domaines, parce que le ministère des Rapatriés a accordé des crédits à la Somivac pour leur concéder des exploitations, parce qu’ils ont bénéficié de l’appui financier de l’Etat. Certains ont affiché imprudemment réussite et enrichissement rapides, éveillant chez les insulaires des senti ments de frustration.
La venue des rapatriés a amorcé le « repeuple ment » de l’île, entraîné d’autres arrivées, apportant des éléments jeunes, des énergies tournées vers l’action, quelquefois des compétences réelles et même, sinon toujours de grandes fortunes, du moins des possibilités d’investissement. Alors que l’Etat avait déclenché l’incitation initiale, leur présence introduisait un facteur supplémentaire de mutation au moment où s’affirmait l’expansion urbaine et où gonflait le courant touristique. C’est ce faisceau de causes agissantes, étroitement soudées, qui a bouleversé la situation primitive. L’impulsion est d’origine extérieure : l’île était trop anémiée pour la sécréter. Mais, surpris par la rapi dité des transformations qui s’accomplissaient de vant eux, les Corses y ont vite participé, autant dans les campagnes que dans les villes.
II. — Les révolutions agricoles La Corse était restée, en 1960, à l’écart des deux révolutions enregistrées par l’agriculture européenne depuis le xviiie siècle : celle des engrais et celle des machines. Elle a dû tout absorber en dix ans. 67
1. Le recul du maquis. — La première tâche fixée à la Somivac, en 1957, était la récupération de 20 000 ha situés en plaine orientale. Elle devait provoquer le démarrage des grands travaux d’in frastructure, électrification, construction des che mins ruraux, qui incombaient aux collectivités locales, tandis qu’elle était chargée de réaliser ellemême l’irrigation et l’assainissement après avoir entrepris le défrichement, la préparation des sols, même les plantations à l’intérieur d’exploitations nouvellement créées. Au sens propre du terme, il s’agissait donc d’une mission de colonisation rurale intégrale qui s’apparente aux travaux accomplis sur l’instigation de la Cassa per il Mezzogiorno en Italie et de l’Institut National de Colonisation en Espagne. C’est la commune de Ghisonaccia, riche de 2 460 ha de terrains communaux emmaquisés qui proposa d’accueillir le premier périmètre. Les éten dues obtenues, grâce au bail emphytéotique de cinquante ans, ont été grossies par des achats aux particuliers. Les subventions représentaient 50 % des frais, même 60 % pour les infrastructures, le reste étant couvert par le Crédit agricole avec un différé d’amortissement de quinze ans. Au départ, le choix des attributaires des nouvelles exploitations devait combiner l’introduction d’éléments venus de l’extérieur avec l’accession des insulaires considérés prioritaires. Aussi la Somivac fut-elle créatrice de zones cultivées remplaçant le maquis disparu. Elle a provoqué l’apparition de quatre périmètres couvrant 3 300 ha et groupant 101 exploi tations. Le plus ancien est celui de Ghisonaccia : sur 770 ha, 20 domaines, d’une quarantaine d’hectares chacun, s’étendent sur des nappes d’alluvions anciennes rouges, truffées de galets. Ils sont pourvus d’un habitat dispersé, comme c’est le cas sur le lotissement de Linguizetta où 33 lots de 20 à 30 ha se dilatent sur le talus en pente forte qui tapisse le pied de la Castagniccia. Le groupement des habitations en hameau qui diminue les frais d’infrastructure a été préféré à Mignataja, 68
au sud de Ghisonaccia, où existent des lots morcelés, d’une vingtaine d’hectares, de même que sur le lotissement de Calenzana, en Balagne : 17 exploitations de 20 à 30 ha ont été installées sur les épandages caillouteux déposés par les torrents montagnards. Parmi les attributaires, les rapatriés furent ma joritaires au début ; il est vrai que peu de Corses locaux ont été solliciteurs. Ils ne croyaient guère à la réussite, man quaient de capitaux et de connaissances techniques. Puis l’intérêt vint... Au total, 43 insulaires, 22 Corses rapatriés et 36 rapatriés non corses figurent dans la liste des exploitants. Mais les espaces les plus vastes sur lesquels s’est exercée l’action de la Somivac sont ceux qui furent transformés dans le cadre des interventions sur propriétés privées ; cette formule, la plus originale de celles qui ont été appliquées, était légitimée par l’abandon de nombreux domaines. Les bénéficiaires obtenaient les mêmes conditions que ceux des périmètres énumérés. Aussi les demandes ont-elles été nombreuses, se multipliant à partir des lieux initiaux de la mise en culture comme si le phénomène faisait tache d’huile. 16 000 ha ont été touchés, dont 7 700 au titre de la rénovation agricole en montagne effectuée depuis 1974. Près de 20 000 ha de friches ont été récupérés, dont 12 000 en plaine.
Le recul du maquis a eu néanmoins une ampleur bien plus grande. Les décisions de l’Etat, associées à l’arrivée des Pieds-Noirs, ont provoqué une véri table flambée des initiatives privées. Les terres ne faisaient pas défaut, bien souvent délaissées sous le maquis, de faible valeur au début. Les vastes domaines indivis dont les possesseurs résidaient au loin offrirent les plus belles proies. Même les petits propriétaires, nantis de quelques parcelles inutiles, triomphèrent peu à peu de leur réticence et du respect religieux des biens familiaux pour les céder avantageusement. Cependant, beaucoup de terres concédées n’ont pas fait l’objet de ventes mais de baux de longue durée, de trente-cinq, cinquante, voire quatre-vingt-dix-neuf ans..., en particulier dans les régions de grande propriété comme le Sartenais et les alentours de Porto-Vecchio. Les défricheurs les plus nombreux furent tout d’abord les rapatriés qui s’installèrent sans l’aide de la Somivac. Elle n’a finalement aidé qu’une 69
minorité sur les 500 familles qui ont choisi des implantations rurales. D’autres initiatives exté rieures s’y sont associées : anciens coloniaux d’Afrique noire, investisseurs continentaux gros et petits. Enfin il y eut une belle floraison d’initiatives locales. Méfiants au départ, les Corses suivirent prestement les exemples qui se multipliaient sous leurs yeux, défrichant quand ils possédaient quelque chose, achetant quand ils le pouvaient. Plusieurs centaines ont sollicité l’intervention de la Somivac. D’autres ont su pallier astucieusement leurs diffi cultés de financement par la vente ou la location partielles. Certains capitaux urbains, acquis dans le commerce, les entreprises de travaux publics, par les professions libérales, migrèrent vers les cam pagnes. L’engouement s’y mit, entraînant même des retours à la terre... Près de 30 000 ha ont été ainsi gagnés sur le maquis ; ils ont favorisé la nais sance d’une nouvelle agriculture insulaire. 2. Les innovations techniques. — La Corse de 1850 ne connaissait ni l’engrais ni la brouette. Avant la dernière guerre, l’usage des engrais chimiques com mençait à peine et, en 1949, la consommation corse s’élevait au chiffre dérisoire de 156 t d’éléments fertilisants. L’outillage ne présentait pas une situa tion plus évoluée : en 1936, l’araire traditionnel, tiré par deux bœufs, et la herse à dents de bois, pour émietter les mottes derrière la charrue, étaient utilisés dans la majorité des exploitations. N’exis tait alors qu’une quarantaine de tracteurs localisés dans les rares domaines modernes ; il y en avait 122, en 1949. Le bilan actuel révèle la profondeur du boule versement, même si les résultats restent en deçà des moyennes nationales. Pendant la campagne 1989-1990, 4 054 t d’éléments fertilisants ont été 70
utilisées. La crise des années 80 a provoqué un fléchissement, aggravé par la régression du vigno ble ; pourtant, en quarante ans, la consommation d’azote a été multipliée par 37. Le parc de matériel agricole a fait simultanément des progrès impres sionnants : 2 558 tracteurs, 1 391 motoculteurs, 200 machines à traire, ce dernier chiffre ayant brutalement gonflé récemment car, avant 1975, la Corse n’en possédait que deux. Enfin, il y a en 1988, 85 machines à vendanger et l’hélicoptère, précieux pour les traitements insecticides urgents contre la cicadelle ou contre la flavescence dorée, a opéré sur certaines plantations de vignes et d’agrumes, avec des frais horaires peu supérieurs à ceux d’un tracteur. Tout aussi sophistiqué est le matériel d’irriga tion. Pourtant, jusqu’en 1957, seuls les jardins étaient arrosés, grâce à des sources ou de modestes dérivations au fil des torrents, plus rarement par des puits ou de petits canaux. Les huertas aux ombrages touffus, si souvent décrites, parmi les paysages méditerranéens classiques, du Levant à Majorque, de la Campanie à la Sicile, restaient à peu près inconnues. En 1988, 16 053 ha étaient irrigables et 10 446 irrigués grâce au réseau hydrau lique mis en place par la Somivac qui a cédé son rôle à l’Office d’Equipement hydraulique de la Corse. Le réseau est alimenté par des prises d’eau sur le Fium’orbo et le Tavignano, surtout par les barrages de Calacuccia sur le Golo et de l’Alesani, entretenu par les réserves basses d’Alzitone, Teppe Rosse et Péri, tandis que la région de PortoVecchio a bénéficié du barrage de l’Ospedale et la Balagne de celui de Codole. Des ouvrages s’achèvent à Sampolo, à Figari. La liste des projets est longue : Rizzanèse, Ortolo, Cap Corse, Nebbio... Les exploitations irriguées ont recours soit à l’irrigation individuelle (pompages, forages), soit à 71
l’irrigation collective fournie par l’Office hydrau lique. La première l’emporte en Corse du Sud ; en Haute Corse, elle a diminué dans l’intérieur alors que l’irrigation collective progresse en plaine orien tale où a disparu pourtant la vigne irriguée. La Corse a été la région française la plus précocement équipée en goutte-à-goutte, système très prisé en Israël pour économiser l’eau ; ici, son succès s’explique par l’économie de main-d’œuvre qu’il permet. L’arrosage et la fertilisation simultanée de vastes superficies ne demandent qu’un tour de robinet. L’investigation scientifique a abouti à des résul tats rapides. Défrichement et mise en culture ont démarré dans un milieu physique dont la connais sance restait sommaire, alors que la réussite du programme agronomique dépendait de son adap tation intime aux conditions locales. Pédologie, hydrologie, micro-climats ont fait l’objet d’obser vations et d’études permanentes, tandis que sont nées trois stations de recherches. San Giulano a été acquise par l’Institut national de la Recherche agronomique en 1965. D’abord agrumicole, elle est devenue agronomique depuis 1974 : elle a montré l’intérêt du clémentinier pour la Corse. Migliacciaro appartenait à la Somivac ; elle a été remise à l’Office de Développement agricole et rural de la Corse. Spécialisée dans l’expérimentation du maté riel et des techniques d’irrigation, elle a contribué à répandre le goutte-à-goutte. Altiani est orientée vers l’élevage de la brebis corse et vers les problèmes fourragers.
3. Les mutations structurelles. — Mutations pro fondes, tout d’abord, dans les structures d’exploi tation : celles de 1955 étaient encombrées de microfundia et d’exploitations marginales ne détenant que des superficies dérisoires. Le remodelage trans72
paraît à travers les recensements agricoles suc cessifs. De 12 279 en 1955, le nombre total est tombé à 7 038 en 1980 et à 5 116 en 1988. La régres sion a affecté les exploitations les plus petites, augmentant la superficie moyenne qui atteint aujourd’hui 24,4 ha en face de 28,1 ha pour la moyenne nationale. L’originalité régionale s’est traduite par une forte progression des exploitations supérieures à 50 ha : il y en avait 260 en 1955, 589 en 1980, 709 en 1988. Mais cette apparente concentration révèle des aspects moins positifs, aggravés depuis l’arra chage de la vigne. Partout se sont étendus les par cours et les jachères ; en Haute Corse, dans les exploitations de plus de 100 ha, ils occupent 80 % de la surface agricole utilisée. Le remembrement n’a pas eu beaucoup d’effi cacité pour atténuer le morcellement séculaire. La Somivac y a procédé officiellement dans deux communes de la plaine orientale, Ghisonaccia et Antisanti. Certains exploitants l’ont effectué euxmêmes au moment de leurs achats. Jusqu’en 1977, aucune safer ne pouvait favoriser le regroupement parcellaire. Créée à cette date, la safer corse a distribué les biens des faillis dans la région d’Aléria ; elle est intervenue en Balagne, dans le Sartenais, la région d’Ajaccio..., profitant de la transparence du marché foncier qu’elle a établie. Elle s’est efforcée de délimiter une série d’exploitations moyennes viables, confiées de préférence à de jeunes agriculteurs. La multiplication des grandes et des moyennes exploitations a rajeuni le milieu agricole car les éliminations ont touché surtout des exploitants âgés. Alors que 41,7 % avaient dépassé soixante ans en 1970, il y en avait 19,9 % en 1988 ; alors que 6,2 % avaient moins de trente-cinq ans en 1970, 20 % étaient dans ce cas en 1988. 73
Enfin, le vieil individualisme paysan a été ébranlé. En 1949, à part une coopérative de culture mécanique à Porto-Vecchio, rien n’existait dans l’île en fait d’association. Avec trois quarts de siècle de retard sur les caves languedociennes, la première coopérative vinicole a été créée en Casinca, sous l’impulsion de l’Etat en 1957. Aujourd’hui, renforcées par cinq Sociétés d’Intérêts collectifs agricoles, il y en a huit, répandues autant dans les vieux vignobles, Patrimonio et Sartenais, que dans les vignobles plus récents, à Aléria et Ghisonaccia. Toutes, qui ne traitaient que 30 % de la récolte avant le recul du vignoble, en vinifient maintenant près des trois quarts. A leurs côtés sont apparues plusieurs coopératives d’appro visionnement et des coopératives spécialisées dans le com merce en gros des fruits et légumes. Bien que tous ces orga nismes soient dispersés, c’est la plaine orientale qui possède les plus nombreux et les plus puissants. Avec son laboratoire, sa chaîne d’embouteillage, sa salle de dégustation-vente, la cave d’Aléria dont la cuverie atteint 200 000 hl était une imposante usine à vin avant le déclin. Et la Copacor de Moriani Plage (Coopérative agricole d’Aléria-Moriani) associe à une cuma une société d’études et de gestion agricoles. Elle conditionne et commercialise les agrumes, transformant les petits calibres en marmelades et confitures. Elle reçoit et expédie la récolte des 200 petits producteurs groupés dans le syndicat des producteurs de noisettes. Elle prévoit aussi de s’orienter vers les châtaignes. Confrontés aux problèmes de vente, les groupements de producteurs grossissent et s’organisent. En 1976, un Comité économique des Fruits et Légumes a réuni trois coopératives et une sica. En même temps est née l’Union des Viticulteurs de l’Ile-de-Beauté qui rassemble les caves de Casinca et d’Aléria et deux domaines producteurs ; tous représentent 130 000 hl produits chaque année dont 15 à 16 000 de vins labellisés. Or, l’uvib n’est que le principal des trois groupe ments qui, avec l’uvicor et l’uval, commercialisent près de la moitié du vin insulaire, tandis que l’Association UVA corse (1979) réunit la plupart des caves particulières avec près de 50 % de la production aoc.
C’est donc un monde agricole radicalement dif férent de celui du passé qui s’est constitué. Les divers syndicats et organismes nationaux s’y pro longent désormais. Il existe deux Centres d’Eco nomie rurale et de Gestion. Une confédération paysanne a vu le jour en 1990... Tout ne va pas sans mal dans le mouvement associatif : il y a bien 74
des tâtonnements, des tiraillements, des échecs... Mais l’isolement des exploitants de jadis a disparu.
III. — L’irruption du tourisme 1. Les impulsions. — La venue des aristocrates de la Belle Epoque n’a guère laissé de traditions dans l’île. La station d’hiver d’Ajaccio est restée isolée avec sa clientèle cosmopolite et ses établis sements animés par des hôteliers suisses. La ville en a gardé des vestiges : le Grand Hôtel, aujourd’hui reconverti à côté de l’église anglicane, édifiée par une riche Anglaise à l’intention des visiteurs britanniques. L’essor de la saison d’été à Calvi, qu’avaient lancée des étrangers et des artistes, a été brisé par la seconde guerre, alors que des hôtels confortables avaient fait leur apparition, situés dans des positions avantageuses à L’Ile-Rousse, Piana, Zonza... Ce sont les clubs de vacances, offrant des séjours à bas prix, qui ont joué le rôle d’éléments pionniers dans le démarrage du tourisme populaire, après la dernière guerre. Le Club olympique occupait, dès 1948, une portion de la magnifique pinède de Calvi, tandis que le Club Méditerranée installait, en 1957, ses paillottes polynésiennes au bord d’une baie dé serte, au sud de Porto-Vecchio. A cette date, naissait la Société pour l’Equipement Touristique de la Corse (setco) qui devait créer, en cinq ans, 3 000 chambres dans une centaine d’hôtels dis persés dans les lieux les plus favorables et destinés à une clientèle moyenne et populaire. L’impulsion de l’Etat n’eut pas l’effet détermi nant qui fut le sien dans l’agriculture. L’action de la Setco, privée de moyens, a été restreinte : elle a construit quatre hôtels de bon standing comportant 300 chambres. En 1966, la mission interministérielle recevait la charge de la relayer et, en 1977, elle 75
cédait la place à la Corsam dont la vocation était élargie à l’aménagement et à l’équipement urbain. C’est la convergence des initiatives privées qui a entraîné la croissance, mais celle-ci a été souvent aidée par la partici pation du Crédit hôtelier. L’intervention de la grande finance française et internationale a cependant engendré les gros villages de vacances, les gros ensembles touristiques et les lotissements résidentiels les plus vastes. La Banque Lafond a financé le prestigieux lotissement de la Résidence du Golfe à Porticcio ; la Société financière pour les Industries du Tou risme, qui associait, parmi ses administrateurs, les Chargeurs réunis, la Compagnie plm, la Compagnie Générale Trans atlantique..., a investi dans la construction des ensembles rési dentiels de Saint-Florent. La Banque de Paris et des Pays-Bas a soutenu le Club Méditerranée qui garde deux villages en Corse. Les capitaux étrangers, rarement exclusifs, se sont tôt manifestés : capitaux allemands dans les camps naturistes de la côte orientale, capitaux belges à Sant’Ambroggio où figurait Immobufa, la Société immobilière de l’Union financière d’An vers. Les compagnies de transport ont précocement pris position ; l’uta a ouvert l’un des premiers villages de vacances, celui d’Anghione, la Compagnie Paquet l’un des premiers lotissements, celui de Cala Rossa à Porto-Vecchio. La pénétration du tourisme social a été plus tardive, mais vigoureuse. Si Tourisme et Travail et l’OCCAJ se sont retirée, Villages Vacances Familles, aidés par la Caisse des Dépôts, ont créé les ensembles de gîtes de Losari, à Belgodère-Palasca, et de Borgo qui peuvent abriter 4 000 personnes. Les comités d’entreprises et les organismes publics sont bien représentés : la Caisse centrale d’Activités sociales de l’edf-gdf à Porticcio, la Caisse nationale de Retraite des Ouvriers du Bâtiment à Taglio-Isolaccio, la Caisse d’Allocations familiales de la Somme à Serra di Ferro, la snecma à Portigliolo, aux côtés d’une pléiade de villages et centres de vacances ouverts par les Associations régionales des Œuvres éducatives de Vacances de l’Education nationale, les PTT, les Armées...
Les Corses seraient-ils exclus des structures d’hé bergement qui ont fait boule de neige chez eux ? Il n’en est rien. Avant 1950, ils exploitaient les petits hôtels familiaux disséminés dans l’intérieur, ainsi que la plupart des hôtels urbains. Le démar rage de la croissance, s’il a laissé la part belle aux initiatives extérieures, a vite suscité la contri76
bution des insulaires. C’est la construction de nou veaux hôtels modernes qui a attiré d’abord les investissements, drainant des capitaux accumulés par des entrepreneurs du bâtiment, de nombreux commerçants, des professions libérales, des méde cins en particulier, mais aussi des capitaux arrivés du dehors. Plusieurs hôtels 3 ou 4 étoiles ont été édifiés ainsi à Ajaccio, Bastia, Propriano... Alors que les premiers campings sont nés d’im pulsions externes, les Corses en ont rapidement ouvert à leur compte, surtout lorsqu’ils étaient pour vus de terres favorablement situées, s’immisçant même dans le naturisme. Ils possèdent la plupart des bars, des cafés-restaurants, des night-clubs, et parfois, enrichis, rachètent des hôtels. Encouragés par les exemples d’improvisation, l’engouement s’y est mis, provoquant des transferts d’activités : des bergers, des commerçants ont opté pour l’hôtellerie, et des instituteurs ont pris leur retraite dans ce but. Quant aux Pieds-Noirs, leur présence est restée discrète, bien qu’ils aient créé quelques hôtels confortables et le premier camping 4 étoiles de l’île, à Porto-Vecchio. 2. La conversion au tourisme de masse. — La multiplicité des initiatives et des réalisations a vite accru la capacité de réception : de 25 000 personnes en 1960, elle est passée à 100 000 en 1970, et elle dépasse 300 000 aujourd’hui (120 000 en héber gement professionnel). Telle quelle, elle reste très inférieure à l’offre des Baléares, mais sa composition est beaucoup plus diversifiée. L’hôtellerie n’y occupe pas une place prépondérante. Les 455 hôtels avec 12 027 chambres peuvent accueillir 24 000 personnes. L’hôtellerie de qualité 3 et 4 étoiles réunit 34,7 % des chambres classées, mais la catégorie supérieure, malgré l’ef fort accompli, ne compte que 7 établissements parmi lesquels le célèbre Thalassa-Porticcio. 77
Les formes d’hébergement complémentaires l’em portent sensiblement en importance. Près de 33 000 personnes logent simultanément, en haute saison, dans les 89 villages de vacances. Le record d’expansion revient aux campings : 182 terrains peuvent rassembler 59 639 personnes, créant pres que une situation de suréquipement, car près de 80 000 visiteurs, chaque année, pratiqueraient exclusivement ou partiellement le camping sau vage. Ce sont cependant les 52 527 résidences secondaires qui détiennent les grosses possibilités d’accueil puisque leur capacité théorique s’élève à 260 000 personnes ; possédées ou louées, en immeubles urbains ou en pavillons isolés, cons tructions neuves ou anciennes maisons familiales. Ces der nières ont longtemps formé la presque totalité du parc : désertées par l’émigration elles sont partout répandues, surtout dans les villages de montagne. La portion de celles qui ont été vendues à des acheteurs étrangers à l’île reste modeste. Cependant, les amateurs de demeures rustiques s’ouvrant sur des horizons illimités ont été séduits par les hameaux vides de la pointe cap-corsine, ceux de Canelle à Canari ou de Soprana à Rogliano. L’attraction des lieux élevés sur les classes aisées a entraîné les succès des villages perchés de Balagne, Saint-Antonino, Monticello, Santa Reparata et Lumio. Néanmoins, la majorité des acquéreurs de résidences secon daires s’est tournée vers les constructions neuves. Il est vrai que le choix était facile vu la prolifération des lotissements au bord de mer. Luxueux au début, ils ont fait place peu à peu à des édifices de taille réduite, même des bungalows. La vague d’expansion a culminé en 1974 pour fléchir ensuite.
La crise a raréfié les grands projets et réduit les investissements importants. Mais la croissance n’est pas stoppée : de 1982 à 1990, l’hébergement professionnel a progressé de 19 % et les résidences secondaires de 24 %. Des hôtels familiaux, de petite ou moyenne capacité, ont fait leur appa rition. Les campings se sont multipliés sur le littoral. Des complexes de loisirs ont surgi, tels ceux d’Alba Serena ou d’Erba Rossa sur la côte 78
orientale. En 1991, le prestigieux golf de Sperone, « 500e création » du célèbre R. Trent Jones, a été inauguré à Bonifacio ; il est associé à un ensemble résidentiel de luxe, les Hameaux de Piantarella. Même les gîtes ruraux, jadis inexistants, offrent maintenant 2 203 places... Les prévisions du schéma d’aménagement de 1971 qui envisageaient une capacité de 250 000 à 350 000 lits sont donc atteintes, mais le flot des visiteurs attendus, 1,5 à 2 millions de personnes, se maintient au niveau le plus bas de ces évaluations optimistes. 3. Les flux estivaux. — Plus de 500 000 touristes dès 1970, 1 million en 1978, près de 1 500 000 en 1990, puisque l’estimation de mai à septembre s’élève à 1 310 000. Après le repli de 1983-1984, le flux a grossi régulièrement : la hausse, depuis 1985, serait de 7,3 %/an. L’île reçoit donc trois fois moins de touristes que les Baléares, un flux compa rable à celui de la Sardaigne. Le volume des nuitées n’a pas gonflé au rythme de la clientèle, à cause du raccourcissement de la durée moyenne des séjours : entre 1981 et 1988, celle-ci est tombée de 23 à 14,5 jours. Si bien que les 23 millions de nuitées de 1982 n’ont jamais été égalées depuis ; le chiffre s’est stabilisé au niveau de 21 millions de nuitées annuelles. Comme la Sardaigne, et plus que la plupart de ses voisins méditerranéens, la Corse se singularise par l’extrême concentration de la fréquentation en été. Pourtant, il y a vingt-cinq ans, des efforts de publicité avaient vanté les attraits du prin temps, espérant la venue des Scandinaves. Depuis 1975, Calvi, L’Ile-Rousse, Ajaccio accueillent des groupes du troisième âge, d’avril à juin, et de septembre à novembre. Quoi qu’il en soit, la véri table saison dure encore deux mois : juillet et août 79
bénéficient de 68 % des nuitées, et les quatre mois de juin à septembre en totalisent 87 %. Les enquêtes récentes ont montré qu’à la pointe du 15 août la population présente en Corse équivaut à 2,4 fois celle de l’hiver, c’est-à-dire à près de 600 000 personnes dont 350 000 visiteurs. Il y aurait 560 000 habitants du 4 au 19 août. D’où les rythmes spasmodiques des services de transport qui s’espacent en hiver et s’intensifient en été pour faire face à la demande : l’ensemble des entrées et sorties de passagers culmine en août avec un volume trois fois supérieur au trafic mensuel moyen, dépassant alors 1 million de passagers. C’est le bateau qui en achemine la majorité grâce aux lignes fran çaises de la Société nationale Corse-Méditerranée, au départ de Marseille, Toulon et Nice, et aux lignes italiennes des Corsica Ferries et des Navarma Lines au départ de Gênes, La Spezia, Livourne, Piombino... vers Bastia, de Gênes encore vers Calvi et Ajaccio ; ces dernières se sont multipliées depuis peu, s’ajou tant à la vieille liaison Bonifacio-Sardaigne. La primauté surprenante du transport maritime provient, certes, de ses tarifs plus démocratiques, mais surtout de son aptitude à charger les voitures sur les énormes car-ferries mis en service : plus de la moitié des touristes se déplacent avec leurs véhicules. Le trafic aérien, qui prédomine d’octobre à mai, passe au second rang en été, bien qu’il ait la préférence des vacanciers les plus éloignés et de ceux qui choisissent les séjours à forfait. La prépondérance du transport aérien, en particulier du trafic charter, aux Baléares pourrait caractériser un type d’insularité plus affirmé que celui de la Corse. Celle-ci s’in cruste, de façon évidente, dans les aires littorales de loisir des citadins de l’Europe occidentale que l’héliotropisme a engen drées, de l’Espagne à l’Italie, favorisées par la facilité de leurs accès autoroutiers. D’ailleurs, qui vient en Corse ? L’île appartient encore aux régions de vacances des Français. La clientèle nationale conti nue à l’emporter bien que sa supériorité se soit beaucoup réduite : 75 % en 1977, 52 % en 1989. La moitié de ceux qui viennent du continent sont dépourvus d’attaches locales, tandis que le cinquième est composé de Corses qui retrouvent ici leurs origines, le temps d’un été. Aussi Paris, Marseille, Toulon, Nice, Lyon, envoient-elles une bonne partie de la marée saisonnière. La clientèle étrangère a grossi fortement sous l’impulsion de la ruée italienne qui représente, aujour d’hui, 45 % du flux, surpassant les arrivées allemandes qui n’en constituent plus qu’un tiers. Les autres nationalités sont 80
plus discrètes, mais les Suisses (7 %), les Britanniques (6 %), les Belges et les Néerlandais, comme les Allemands, peuvent être attirés par l’avant- et l’arrière-saison. Ce sont les Français et les Italiens qui portent la responsabilité du phénomène d’hyperconcentration de juillet-août. Comment la clientèle se répartit-elle entre les différents modes d’hébergement ? Le sondage insee, effectué en 1988, montre que les campings recueillent, à eux seuls, 43 % des nuitées en hébergement professionnel, précédant les villages de vacances (33 %), et enfin les hôtels (23 %). C’est la durée des séjours qui détermine ce classement : 17 jours en moyenne pour un campeur, 15 pour un touriste en village de vacances, 11 pour un touriste en hôtel. En réalité, les résidences secon daires, les logements chez les parents-amis, les locations, le camping sauvage, donc les « hébergements non professionnels », abritent la majorité des nuitées touristiques en Corse, 54 % du total. Situation imputable aux Français et, surtout, aux Corses en vacances séjournant dans les maisons familiales. Les Français fréquentent aussi les villages de vacances à but non lucratif. En revanche, les étrangers l’emportent dans les campings, attractifs en priorité pour les Italiens et les Alle mands, dans les hôtels et les villages de vacances commerciaux. Toutes les observations ont prouvé que la clientèle reçue est relativement aisée : il y a davantage de cadres supérieurs (22,4 %) et moyens (16,3 %) que d’employés et d’ouvriers (30 %) ainsi qu’une bonne proportion de retraités (9 %), espoir pour l’allongement de la saison. Néanmoins, la fréquen tation se démocratise : c’est cet aspect qui frappe les profes sionnels locaux. L’invasion des caravanes et camping-cars, souvent italiens et allemands, chargés de bicyclettes et planches à voile, traînant des bateaux, pourvus, dit-on, de frigidaires emplis de provisions, est un spectacle quotidien en été. Si Anglais et Suisses recherchent les hôtels de standing, les Allemands envoyés par les touropérateurs, tui ou Neckermann, ont la réputation d’être peu portés à la dépense... Beaucoup pensent que l’époque du tourisme riche est révolue, bien que la presse signale la présence de Giovanni Agnelli au couvent d’Alziprato, à Zilia.
Temps incertains, temps difficiles. Transformée, la Corse partage le sort des régions « évoluées », soumises aux fluctuations de la conjoncture, aux crises et aux perpétuels réajustements. A un cycle a succédé un autre cycle, à la léthargie, la croissance, les problèmes de croissance, les défaillances, l’instabilité. Est-ce le seul résultat des mécanismes du changement ? 81
TROISIÈME PARTIE
LES PROBLÈMES
DE CROISSANCE
Chapitre I
LES DISPARITÉS INSULAIRES L’amorce d’un « repeuplement », l’explosion ur baine, les bouleversements économiques n’ont pas agi harmonieusement sur l’ensemble de l’île. Ils ont privilégié la périphérie littorale et les côtes, long temps défavorisées par le phénomène d’inversion qui avait refoulé dans le passé la population en alti tude ; la montagne est restée à l’écart. Et toutes les basses terres n’ont pas également bénéficié des transformations récentes : les aires proches des principales villes, les plaines se sont révélées plus attractives. La croissance a donc exercé des effets inégalisateurs, accusant l’absence d’homogénéité na turelle de l’espace insulaire.
I. — Des villes gonflées
1. Des dynamismes différenciés. — La longue médiocrité urbaine résulte des conditions histo riques. A l’exclusion d’Ile-Rousse et de Propriano, les principales cellules littorales sont d’origine étran83
gère : forteresses chargées de veiller sur une colonie peu sûre, elles n’ont engendré longtemps que des ports languissants qui entretenaient de maigres échanges à cause de l’étroitesse du marché local. Celle-ci provenait autant de la faiblesse industrielle que de la pauvreté des habitants. Les ports n’ont jamais fait figure d’opulentes cités marchandes. L’essor du XIXe siècle a été entravé par la dégra dation des activités et l’émigration : de 1891 à 1954, les villes n’ont gagné que 15 à 20 000 hab. exerçant un faible pouvoir fixateur sur l’exode puisque les communes rurales en ont perdu simultanément environ 130 000. Or, alors qu’elles réunissaient 55 000 hab. et 20 % de la population en 1891, 75 000 hab. et 42 % en 1954, elles concentrent, en 1990, 132 247 personnes et 53 % des habitants. Cette expansion brutale a transfiguré totalement Ajaccio et Bastia, tandis qu’elle a provoqué des change ments plus mesurés dans les petites villes. Les deux premières ont gagné 50 000 hab. en trente ans, doublant presque leur importance initiale. Les der nières n’ont acquis que 10 000 hab. supplémen taires, grossissant d’un tiers depuis 1954 pour atteindre 29 000 hab. Il ne s’agit pas d’une croissance homogène, et elle n’a pas été régulière : c’est la période 1962-1968 qui a apporté les gains les plus copieux, puis le dyna misme s’est ralenti. Les progrès ont été partout provoqués par l’arrivée de nouveaux habitants, venus plus nombreux de l’extérieur que de l’île. Le fléchissement reflète l’évolution nationale : il recèle le danger de minimiser le rôle des organismes urbains qui compensent par leur vitalité les déficits de l’intérieur. Pourront-ils continuer à entretenir l’essor ? Chaque agglomération possède des aspects qui lui sont propres. Bonifacio a perdu son étiquette 84
urbaine puisqu’elle ne rassemble plus 2 000 hab. ; malgré l’animation touristique de sa marine, c’est une forteresse fossile qui survit dans un site pitto resque. Le départ de la Légion, en lui enlevant sa fonction militaire, en a fait un lieu de visite plus recherché. Sartène, qui a végété longtemps, bien qu’elle possède une sous-préfecture, semble avoir retrouvé quelque vigueur : elle a éliminé le déficit des naissances qui sévissait, peut-être grâce à un groupe d’immigrés assez jeune. Pourtant, sa population reste plutôt âgée, et elle apparaît peu transformée ; elle garde, avec ses hautes maisons de pierre, le caractère défensif des temps agités où elle s’est perchée à l’écart du golfe du Valinco et de ses menaces. Parmi les stations littorales dynamiques, Calvi et Porto-Vecchio ont bénéficié des progrès les plus importants, et c’est la seconde qui a connu la mutation la plus profonde. Elle a perdu son aspect chétif, étoffé son centre modernisé, occupé sa marine. Prospérité comparable à Propriano qui, en grandissant, s’équipe, se structure, prend d’as saut les pentes qui la dominent. A Calvi, se densi fient rapidement les antennes côtières greffées sur le centre ancien restauré. Seule, L’Ile-Rousse, qui se dilate largement sur la commune contiguë de Monticello, a perdu des habitants pour le recensement et souffre d’un solde naturel défi citaire. La résonance historique de son nom, sa situation centrale sur l’axe Ajaccio-Bastia, son rang de souspréfecture ont aidé Corte, qui n’a que 5 693 hab., à acquérir des fonctions universitaires. Elles ris quent d’accuser la dichotomie qui oppose le vieux Corte, ville-rue accolée à sa fière citadelle, et les quartiers neufs qui s’étendent en contrebas, sur des espaces peu accidentés. Dans un environnement rural dégradé, Corte, grâce à ses équipements, 85
exerce une forte attraction qui touche 55 communes des cantons voisins, de Vivario à Vezzani, Bustanico et Calacuccia. 2. Ajaccio et Bastia, deux villes comparables. — Après une longue période d’incertitudes et de sur évaluations, le recensement de 1990 accorde 58 315 hab. à Ajaccio, et 37 845 hab. à Bastia, chiffre que la « petite couronne » des communes septentrionales, qui appartiennent à la dernière ville, permet d’augmenter à 45 087. Déception pour Bastia qui l’emportait jadis. Quoi qu’il en soit, la similitude de leurs développements vaut aux deux cités des structures urbaines très voisines. Les vieux centres associaient la citadelle et le port, le noyau dense des quartiers anciens et les quartiers plus aérés, disposés en damier, qui s’étaient formés, depuis le siècle dernier, le long du cours Napoléon et du cours Grandval à Ajaccio, au bord du boule vard Paoli et de la place Saint-Nicolas à Bastia. Ils n’occupent plus aujourd’hui qu’une place limitée dans l’agglomération tant la poussée subie a été impétueuse. Ajaccio comme Bastia sont des villeschampignons où plus et près des trois quarts des logements ont été achevés après 1949, et où les centres commencent à se dépeupler au bénéfice de la périphérie. D’où l’extension accélérée de l’espace construit, mais la place manque entre mer et montagne ; aussi la marée des grands immeubles a-t-elle gravi les pentes, et lancé des antennes littorales sur la côte du Cap Corse, au nord de Bastia, sur la route des Sanguinaires à Ajaccio. Elle s’est étalée surtout dans les plaines proches où elle constitue des unités satellites : c’est le cas de Lupino-Montesoro à Bastia, des Cannes et des Salines à Ajaccio. Et la croissance ne finit pas, la permanence du chantier s’éternise ; les routes nationales sont des axes de 86
progression ininterrompue. L’explosion du péri urbain s’affirme une réalité tangible, gonflant brutalement les hameaux de plaine, des villages de coteau proches, plaine de Peri, Porticcio pour Ajaccio, Casatorra... pour Bastia ; la « banlieue d’Ajaccio » rassemble 16 339 hab. en 1990, celle de Bastia 18 012. Les ressemblances ne se limitent pas aux pay sages ; elles réapparaissent dans la composition de la population qui compte une fraction notable de migrants de fraîche date. Dans l’une et l’autre ville, un habitant sur cinq s’est installé depuis 1975, mais, parmi les arrivants, le flux étranger s’est réduit. Aussi la répartition des groupes d’âges estelle peu différente : une base de jeunesse assez maigre pour les deux, une bonne proportion d’adultes, des générations du troisième âge bien étoffées. Le taux de population active ayant un emploi, 36,5 % et 34,7 %, est plus élevé que la moyenne insulaire, avec une participation fémi nine accrue, et la proportion des chômeurs est plus faible. La somme des similitudes suffit-elle pour associer les deux villes dans un portrait identique ?
3. Ajaccio et Bastia : deux villes dissemblables. — Aucun Corse ne pourrait les confondre ; d’ailleurs, une certaine susceptibilité réciproque en fait parfois des rivales ou des concurrentes. De son passé de petite capitale, Bastia a gardé, jusqu’à une date récente, une dignité urbaine mieux affirmée. Seul l’accident napoléonien avait valu à Ajaccio de l’éclipser, en 1811, lorsqu’elle était deve nue l’unique préfecture insulaire. La création de deux départements, en 1975, n’a fait que restituer à Bastia le rang qu’elle avait perdu. Amoindrie dans ses fonctions administratives, Bastia n’a possédé jusque-là, avec sa sous-préfecture, que la cour d’appel, le génie rural et le commandement mili87
taire auxquels s’était jointe, en 1957, la Somivac. Mais elle a peu pâti de la situation parce que c’est la ville de l’industrie, du commerce et des affaires. Elle a toujours eu le port le plus actif de l’île, concentrant plus de la moitié du trafic de marchan dises, et la moitié du trafic de voyageurs à cause des liaisons avec l’Italie. Elle est devenue le débou ché de la plaine orientale. Et son aéroport assume un mouvement à peine inférieur à celui d’Ajaccio. Aussi, bien qu’elle soit comme Ajaccio une ville tertiaire, le secteur secondaire occupe plus d’actifs (24,5 %), et la prépondérance du tertiaire est moins écrasante (73,5 %). Elle possède de grosses entre prises de construction et de travaux publics, des industries agro-alimentaires plus vivaces, grâce à la Manufacture Corse-Tabacs, aux Etablissements Damiani, et même des constructions électroniques avec l’aeta. Alors que le tertiaire bastiais accorde moins de place aux services de l’Etat qu’Ajaccio, il est pourvu d’un secteur transports et commerce de gros plus développé grâce à des agences mari times et des entreprises de transit plus nombreuses et à quelques entreprises de distribution. La société urbaine reflète cet échantillonnage. Bastia compte, dans ses murs, plus d’agriculteurs. A côté d’une bourgeoisie enrichie dans les affaires et les professions libérales, elle rassemble plus d’ouvriers et moins d’employés. Aussi Bastia dispose-t-elle de plus de logements sociaux, et, au moment des consultations électorales, ses votes sont plus nettement orientés à gauche. Bastia, enfin, est une ville plus « corse » qu’Ajaccio car elle exerce une attraction plus forte sur les flux qui proviennent du reste de l’île. Peut-être parce qu’elle sert de pôle à une zone d’influence plus vaste et plus peuplée : la Haute-Corse correspond à l’En Deçà des Monts. Ainsi semble se perpétuer sa vieille fonction historique de capitale. 88
Dans le cadre prestigieux de son golfe, Ajaccio paraît avoir spontanément une vocation résiden tielle. En réalité cette aptitude a été valorisée par la fortune napoléonienne qui lui a donné d’abord ses attributions administratives, et qui a favorisé ensuite la naissance de la station d’hiver car l’ini tiative du lancement revient au comte Bacciochi, premier chambellan de Napoléon III. Aujourd’hui, tandis que Bastia n’est qu’un lieu de passage, Ajaccio demeure pour les visiteurs une ville de séjour. Elle est donc absorbée dans les fonctions de services ; plus de trois actifs sur quatre appartien nent au tertiaire (78,8 %), et l’un d’entre eux aux services de l’Etat. Elle a groupé toutes les adminis trations départementales jusqu’en 1975, conser vant depuis une légère prééminence sur Bastia puisqu’elle est chef-lieu de la Région corse. Elle est pourvue, en outre, de services de santé plus étoffés, et d’un embryon de secteur quaternaire, grâce à des banques et des compagnies d’assurance plus nombreuses. A l’exclusion du bâtiment (11 %), l’industrie y reste déficiente (8 %), représentée par un secteur agro-alimentaire modeste. Pourtant, malgré une opposition tumultueuse, la centrale thermique du Vazzio fonctionne ainsi que la centrale expérimentale hélio-électrique de Vignola, alors que deux usines, l’une de composants élec troniques, l’autre de matériel aéronautique se sont installées. Est-ce le début d’une mutation ? Pour l’instant, la société ajaccienne rassemble plus de professions libérales, plus de cadres supé rieurs et moyens, plus d’employés (40 % des actifs), plus de retraités que la société bastiaise. C’est un milieu de « cols blancs » qui a la réputation, surtout à Bastia, d’être moins tourné vers le labeur, de rechercher davantage le luxe et l’ostentation. Il est vrai que les commerces de qualité tiennent 89
plus de place qu’à Bastia, mais l’activité touristique les encourage. L’évaluation récente de la pression touristique théorique a montré qu’à côté d’une moyenne corse de 153 lits pour 100 hab., le grand Ajaccio atteint 177 lits répartis moins en hébergement profes sionnel (54) qu’en résidences secondaires (123), alors que le grand Bastia n’en totalise que 70. Aussi la population gonfle-t-elle au cœur de l’été ; l’impor tance des fluctuations saisonnières est liée au mouvement du port et de l’aéroport qui voient passer plus d’un million de passagers par an depuis 1979. Les fonctions économiques légitiment les préoccupations esthétiques de l’agglomération : aidée par son contrat ville moyenne, elle a essayé de triompher de la vétusté du centre, d’intégrer les quartiers récents. Elles expliquent aussi son ouverture sur le dehors, le fait qu’elle draine moins d’habitants que Bastia dans le reste de la Corse. Le Schéma directeur de 1972 signalait déjà que la population d’origine locale, avec une part de 46 %, était minoritaire. Les sources du dynamisme urbain sont extérieures à l’île. C’est aussi le cas du dyna misme touristique qui contribue également à accroître le poids du littoral dans la région. IL — Une périphérie littorale bouleversée
1. Les bourgeonnements touristiques. — L’appa reil statistique exprime l’écrasante prépondérance des zones côtières : les rivages ont attiré 90,9 % de l’hôtellerie, 91 % des campings, 97 % des villages de vacances. Ils concentrent finalement 91,6 % des capacités de réception de l’hébergement pro fessionnel et aménagé. La fréquentation estimée diminue un peu la puissance des installations litto rales : 6 touristes sur 10 y séjournent principale90
ment, 1 choisit l’intérieur, 3 sont itinérants, et ces derniers ont tendance à se multiplier. Peut-on conclure à une invasion tyrannique ? En réalité, un rapport du Service d’Etude et d’Amé nagement du Littoral a montré, en 1978, que sur 800 km de côtes, 600 demeuraient à peu près vides tandis que 231 km étaient considérés urbanisés. Mais l’urbanisation dense n’occupait que 31 km au niveau des villes, alors qu’une urbanisation diffuse, un « mitage », s’allongeait sur 200 km en segments discontinus. Malgré son expansion pro gressive, nulle part n’existent les murs de béton écrasants qui se dressent au bord de tant de plages espagnoles, de Benidorm à Platja d’Aro et à Palma de Majorque. Pour les amateurs de nature sauvage, la Corse offre encore des paysages préservés, sables déserts ou grandioses escarpements rocheux qui se déroulent sur les côtes occidentales les plus acci dentées. Car la densité estivale reste modérée. Le 13 août 1987, il y aurait eu 372 000 touristes sur les 600 000 hab. qui peuplaient la Corse ce jour-là. Elle possédait donc 69 hab. au kilomètre carré, et probablement 180 sur les rivages. Mais la vague des visiteurs se dilue de façon très irrégulière, engendrant des noyaux importants là où les bour geonnements touristiques sont les plus étoffés. En chiffres bruts, c’est la zone Ajaccio-Porto qui l’emporte sur toutes les autres. Pourtant la pression touristique par rapport à la population permanente est plus élevée dans la région de Porto-Vecchio et en Balagne qui reçoivent simultanément de deux à trois touristes par habitant. L’étude réalisée, en 1987, pour la Chambre de Commerce d’Ajacio a montré que la région Ajaccio-Porto attirait 22,5 % des séjours (itinérants exclus), 180 000 sur 799 000 de mai à septembre. L’aire majeure de cristallisation est le golfe d’Ajaccio où se manifestent localement des signes de surcharge
91
car le flux saisonnier s’y conjugue avec le flux urbain. C’est le cas de la corniche des Sanguinaires où se succèdent les plages engorgées et où s’intensifie la pression des constructions dominant la route littorale. La rive Sud, vide il y a trente ans, est devenue une zone balnéaire continue, la plus spécialisée en Corse, juxtaposant tous les types d’hébergement : les lacunes s’y comblent peu à peu, et le maquis recule sur les pentes devant l’ascension agressive des lotissements. Porticcio, qui n’est même pas une commune, est en train de se muer en ville ; 1 300 hab. en 1982, et 44 % d’augmentation en 1990. Sa population décuple chaque été. Le développement du golfe de Sagone est plus ponctuel. Dans un site somptueux, l’essor de Porto est entravé par une topographie que resserre la chute brutale de la montagne dans la mer. La Balagne, qui perd de son importance relative, a concentré 16,8 % des séjours en 1987. Une véritable « riviéra » est née entre Calvi et Ile-Rousse, déjà recherchées dans l’entre-deuxguerres. Ancienne et nouvelle station, Calvi reste la plus caractéristique en Corse : au pied de sa citadelle, sa marine rappelle celle d’Ibiza, impérativement modelée par la fonction d’accueil. Elle a doublé son port de plaisance, et gonflé ses hébergements. Au-delà, Sant’Ambroggio, seule « urbanisation » spécialisée autonome, a surgi ex nihilo au bord d’une anse, tandis qu’Algajola et Ile-Rousse fortifient leur croissance. Surpassant la Balagne, la région de Porto-Vecchio, la plus attrayante pour les étrangers, a rassemblé 21 % des séjours, 168 000 en 1987. Région neuve, espace de conquêtes ininter rompues tant sont vastes les étendues boisées bordant la côte, nombreuses les baies qui la festonnent, riches de plages para disiaques, de Pinarello à Palombaggia ou Santa Giulia. D’où l’éclosion envahissante de lotissements luxueux, de pavillons isolés, de campings et de villages de vacances très dispersés. Porto-Vecchio s’est emparée d’un front de mer qu’elle a long temps négligé, et a gagné un port de plaisance. Bonifacio s’enorgueillit d’être le site le plus prisé des visiteurs en Corse ; grâce à l’aéroport proche de Figari, grâce à ses résidences confortables et son golf de Spérone, elle séduit une clientèle exigeante. Au fond du golfe du Valinco, Propriano imite Calvi avec une activité saisonnière très dominatrice. Aux deux extrémités, Porto-Pollo et Campomoro ont leurs rythmes propres, la première recherchée par une fréquentation populaire, la seconde par les équipages des yachts qui y relâchent devant un imposant paysage de mer et de montagne. Toutes les côtes sont touchées par l’invasion estivale. Les longues plages monotones de la façade orientale ont fixé un chapelet de villages de vacances et campings en grosses unités, en même 92
temps que s’affirmait la vivante petite station de Moriani, et que s’ouvrait le port de plaisance de Campoloro. Les marines cap-corsines ne restent pas à l’écart de cette fièvre, alors que Saint-Florent s’étoffe dans son cadre romantique, et que pro gresse l’équipement du cordon sableux de Biguglia, au sud de Bastia. Le littoral du passé a pris sa revanche, imposant désor mais sa force d’attraction, comme les plaines proches.
2. Une flambée passagère : le vignoble. — L’évo lution de la plaine orientale en est le témoignage le plus frappant. A l’exclusion de quelques clairières cultivées en Marana et en Casinca, la route BastiaBonifacio traversait jadis des solitudes emmaquisées. Elle parcourt aujourd’hui des campagnes humanisées où rares sont les lambeaux de maquis, mais où se sont rétractées les conquêtes viticoles et insinuées les friches. Toutes les plaines périphériques n’ont pas été aussi profondément transformées. Les zones qui furent ou sont encore plantées parsèment la région de Porto-Vecchio, le couloir Sotta-Figari, les dépres sions du Sartenais ; elles ponctuent les côteaux ajacciens, offrent plus de continuité dans la plaine de Calvi-Calenzana, se disséminent dans le Nebbio. Les chiffres révèlent les pulsations du vignoble : 5 537 ha en 1959-1960, 26 387 ha en 1970, 23 837 ha en 1980, 9 140 ha en 1990. Le maximum a été atteint après 1975 avec 31 000 ha. Les arrachages ont commencé en 1976, encouragés par la prime de reconversion instituée par la CEE. Le mouvement s’est accéléré peu à peu, entraînant la disparition de 22 000 ha. Pourquoi les objectifs du Programme d’Action régionale qui prévoyait l’essor des cultures irriguées ont-ils été déviés ? Le nouveau vignoble a été une solution de circonstance, imposée par la nécessité et poursuivie en marge de la légalité ; le statut viti cole n’a pas été appliqué ici avant 1967. La sûreté d’un revenu rapide permettait de faire face aux 93
investissements colossaux qu’exigeaient le défriche ment, les plantations, la construction des bâti ments... La vigne paraissait une culture facile, connue de tous, Corses et Pieds-Noirs. L’exemple du Languedoc, les dangers de surproduction n’ont pas découragé les initiatives : ceux qui plantaient étaient persuadés que la production locale ne com penserait que très modestement la disparition de la production algérienne sur le marché national. L’invasion viticole s’est propagée à travers les terres basses, occupant, avant qu’ils ne soient complètement dominés par l’irrigation, la plus grande partie des espaces conquis en plaine orientale, 40 % des lotissements Somivac. Les deux tiers du vignoble s’étendaient entre Bastia et Solenzara : c’est sur la pianiccia de Tallone, sur l’ample plateau d’Aghione qui s’incline lentement jusqu’à Casabianda, autour d’Aléria et de Ghisonaccia, que régnait la monoculture. Imposé par le manque d’eau, le vignoble s’était répandu dans toutes les régions méridionales et occidentales où il se juxtaposait aux vieilles plantations. Sa prédilection pour les surfaces peu accidentées prove nait de la mécanisation des travaux : les parcelles étaient vastes, les ceps palissés, les rangées écartées de 2,70 m à 2,85 m pour le passage des engins. Dès 1977, le quart du vignoble était vendangé mécaniquement. La recherche de la qualité aurait dû être impérative : pourtant, c’étaient les cépages provençaux à gros rendements, Cinsault et Carignan, qui prédominaient. La production s’était orientée vers la quantité, des degrés bas et une qualité moyenne sur le plan œnologique, la chaptalisation, licite jusqu’en 1973, devant assurer la rentabilité. Le vignoble spécialisé a entraîné le développement de la grande exploitation capitaliste peu connue jusque-là : 59 exploi tations de 50 à 100 ha et 32 exploitations supérieures à 100 ha ont été dénombrées, en 1977, sur un total de 2 017. Elles représentaient 10 000 ha. C’étaient de véritables usines à vin, possédant d’énormes caves, de grosses équipes de salariés permanents, généralement maghrébins, d’où la comparaison avec l’ancienne Mitidja algérienne. Les 315 moyennes exploi tations de 20 à 50 ha avaient une importance comparable aux précédentes puisqu’elles couvraient 9 200 ha ; leurs déten teurs, Corses ou Pieds-Noirs, adhéraient plus souvent à une coopérative. Le vignoble traditionnel se maintenait sur 2 000 ha autour 94
d’Ajaccio et à Patrimonio. Situé sur les pentes des coteaux, il bénéficiait d’un encépagement en variétés locales, nielluccio et sciacarello, dans le cadre d’exploitations familiales de taille moyenne ou petite, fréquemment pourvues de caves privées. Les deux types s’interpénétraient dans la région de Sartène et de Porto-Vecchio, en Marana et en Casinca, en Balagne aussi. C’est là que les préoccupations de qualité s’imposaient avec insistance, là que le secteur coopératif trouvait ses positions les plus fortes.
De 1970 à 1980, la production a oscillé de 1,7 à 2,2 millions d’hectolitres, soit de 2,5 à 3 % de la production nationale. La chaptalisation interdite, la pratique de la concentration avait pris le relais. Les vins de coupage, supérieurs à 12 % qui en étaient issus, procuraient 78 % des ventes ; 10 % étaient des vins consommables en l’état, et 12 % des vins labellisés aoc et vins de pays. Alors que la production était essentiellement tournée vers les vins rouges, 40 % des vins de qualité étaient blancs ou rosés. Le marché insulaire offrant un débouché pour 300 000 hl, le reste était exporté. La viticulture apportait alors 53 % de la production agricole. Aujourd’hui, la production s’est effondrée audessous de 500 000 hl, mais sa composition a changé. 70 à 80 000 hl de vins de qualité proviennent des aoc d’Ajaccio et de Patrimonio, des appellations villages de Calvi, Sartène, Figari, Porto-Vecchio et Cap-Corse, ainsi que des « vins de Corse » qui réunissent les meilleures cuvées de la plaine orien tale. Celles-ci donnent 100 000 hl de vins de pays et 10 000 de vins de cépages. Vins de table, de cou page, distillation, représentent de 200 à 300 000 hl. Le repli signifie donc restructuration et diversifi cation qui s’intensifient depuis 1985, appuyées sur l’amélioration des cépages, les efforts réels des viticulteurs stimulés par une organisation collec tive renforcée de la profession. Le vignoble nouveau apparaît comme une spéculation valable pour les 95
exploitants. Le véritable problème réside dans la réaffectation des terres libérées par les vignes : le tiers seulement a été réoccupé par d’autres cultures. Sur le reste progresse la lèpre des friches... 3. Une conquête plus stable : le verger d’agrumes. — L’apparition d’un verger d’agrumes de 2 200 ha est le résultat le plus positif des mutations accom plies. Les recherches effectuées à la station de San Giuliano ont contribué à définir son orientation vers la production de clémentines lourdement prédominante. Spécialisation adaptée aux condi tions climatiques : la Corse est située à la limite septentrionale de la zone de l’oranger, et la proxi mité des hautes montagnes, enneigées en hiver, peut favoriser les sévices du gel qui furent parti culièrement sévères en mars 1971. Le clémentinier donne une récolte précoce, cueillie de novembre à février, en général avant les grands froids. Citron niers, orangers, cédratiers, maintenant pomélos, qui s’étendent, n’occupent que 10 % des surfaces. Dépendant des possibilités d’irrigation, le verger est localisé surtout en plaine orientale, avec une prédilection marquée pour les terroirs de piedmont qu’épargnent les températures les plus rudes. Cloi sonné de haies brise-vent, arrosé par aspersion ou au goutte-à-goutte, il crée parfois des îlots de mono culture, à Antisanti par exemple. Mais il est associé aux vignes pour 50 exploitations, aux vignes et aux kiwis pour 52 autres, ou à d’autres cultures maraîchères et fruitières. Sur les 509 exploitations dénombrées en 1988, la plupart sont de petites tailles puisque la surface moyenne n’est que de 4,5 ha ; pourtant une dizaine d’agrumiculteurs, disposant de plus de 100 ha de sau, détiennent 20 % des plantations d’agrumes. La clémentine corse sans pépins, ornée de quelques feuilles, est connue sur le marché national 96
où elle se heurte à la concurrence de l’Espagne et du Maroc. La production, après un record de 32 000 t en 1982-1983, a atteint 28 740 t en 1988 dont 24 940 t de clémentines. Les trois quarts partent vers le continent. C’est beaucoup moins qu’il n’était prévu : on attendait 60 000 t avec un rendement de 25 t/ha, alors que 19-20 t sont obte nues. Pourquoi ? Les accidents climatiques inter viennent fréquemment, mais aussi le matériel végétal qui, au départ, a été importé au hasard, puis s’est révélé mal adapté au milieu. La nécessité d’une restructuration s’est imposée dès 1970. Les primes octroyées par le plan communautaire de 1982 l’ont stimulée : surgreffage ou arrachagereplantation pour l’amélioration des variétés ont été accomplis et commencent à porter leurs fruits. D’où un regain de faveur pour l’agrumiculture qui avait été auparavant remise en cause. Si le verger « 6 espèces » où domine le pêcher s’est rétracté, d’autres spéculations fruitières se sont développées. Le kiwi a provoqué un engouement si communicatif qu’il occupe 1 450 ha, remplaçant parfois des plantations d’agrumes, et la Haute Corse est devenue le premier département producteur. L’avocatier (70 ha), l’amandier, le prunier d’ente (315 ha) ont progressé. Mais les arrachages de vignes ont plutôt encouragé, outre les friches, l’ex tension des fourrages irrigués, des céréales, du maïs, de quelques oléagineux, colza, soja, tournesol. Des efforts de diversification ont accru les pépi nières et quelques cultures florales, jadis inconnues, récemment les scaroles d’hiver, destinées à l’expor tation, qui représentent 10 % de la production nationale. Malgré les régressions, les difficultés, un monde nouveau est né sur le pourtour de l’île, en opposition brutale avec l’intérieur montagnard.
97
III. — Et l’intérieur ?
1. Le délabrement. — Victime d’un repli ininter rompu depuis un siècle, il offre la physionomie classique des régions rurales de montagne qui se sont peu à peu vidées de leur substance. Combien conserve-t-il d’habitants ? D’après l’insee, sur les 249 737 hab. de 1990, les communes rurales de coteau possèdent 25 889 hab. et la mon tagne proprement dite, au-dessus de 450 m, en conserve 23 829, c’est-à-dire 4 167 hab. de moins qu’en 1982. La déperdition frappe sévèrement les petites communes, épargnant relativement les plus grosses. De 1962 à 1990, les cantons élevés ont vu disparaître 14 992 personnes. Des taux d’hémor ragie affectent certaines zones : le recul annuel, depuis 1982, a atteint 32,1 ‰ pour le NioluOmessa, 30 ‰ pour Zicavo et pour les Deux Sorru, 27 ‰ pour Bustanico en Castagniccia. Aussi le poids du vieillissement est-il lourd : une personne sur trois a plus de soixante ans en mon tagne. Proportion parfois dépassée localement : 50 % des habitants sont dans ce cas en Orezza, 47 % à Zicavo, 46 % en Alesani, 40 % en Ampugnani ! En revanche, il y a rarement plus d’un jeune sur six personnes. D’où l’importance des anomalies habituelles : l’infériorité numérique des femmes, le célibat deux fois plus répandu que dans les régions rurales françaises, la natalité dérisoire. Dès 100 m d’altitude, le solde naturel devient négatif, et le déficit s’aggrave au-delà de 450 m : les communes de coteau ont subi un déficit naturel annuel de — 0,68 ‰, de 1982 à 1990, gonflant à — 1,15 ‰ dans les communes de montagne par l’effet de ce seul mécanisme qui se révèle, mainte nant, plus intense que l’exode.
98
Le délabrement économique accompagne la détérioration de la démographie. 11 ne reste guère d’éléments laborieux : rarement plus d’un pour quatre personnes, souvent moins. Les équipements ont dépéri en même temps que sont partis les habitants : 143 communes n’ont plus d’école. Peu de commerces survivent, quelquefois aucun dans une série de villages, à l’exclusion d’un café. Il arrive même aux chefslieux de canton d’être privés du médecin, du pharmacien, du percepteur et des gendarmes. Le tertiaire est donc modeste, l’artisanat squelettique, le bâtiment excepté, le taux des actifs agricoles élevé, excédant souvent 30 %. Mais de quels actifs s’agit-il ? La régression rapide du nombre des exploitations et des exploitants âgés a entraîné le rajeunissement des actifs ; 30 % des exploitations, situées audessus de 500 m, sont dirigées par des agriculteurs de moins de trente-cinq ans. C’est une activité-refuge, faute d’autres emplois. Pourtant, les petits troupeaux se sont raréfiés, les petits vergers familiaux ont presque disparu tandis que les primes ont encouragé l’explosion de l’élevage bovin, constitué généralement « d’animaux errants dans des espaces aban donnés » comme le constatent les rapports agricoles. Moins de quatre exploitants sur dix ont des chances d’avoir un suc cesseur, et moins d’un sur trois travaille à temps complet dans l’intérieur. La plupart vivent de ressources extérieures : nombreuses retraites civiles et militaires ou activités paral lèles très répandues au sein des familles agricoles. Les revenus non ruraux encouragent la persistance des activités rurales. Il existe plusieurs types d’association : le boucher-éleveur, le restaurateur-éleveur pourvu d’un jardin, l’exploitant agri cole marié à une institutrice... Finalement, la conjugaison se révèle positive. D’ailleurs, les formes extensives de l’élevage revêtent curieusement des aspects fructueux. Le gros bétail, les porcs, qui divaguent librement, ne coûtent rien à leurs propriétaires, ni pour les nourrir, ni pour les soigner. Vu la faiblesse du capital investi et du capital de roulement, la rentabilité s’avère satisfaisante. Or l’intérieur réunit presque tous les bovins et les porcs, une bonne partie des brebis et des chèvres.
La montagne se convertit-elle au tourisme ? De la marée estivale, elle n’obtient que la portion congrue : un vacancier sur dix. Elle attire les Corses qui retrouvent leurs villages, mais aussi les iti nérants et les campeurs sauvages que séduisent la fraîcheur des forêts, les possibilités de longues 99
marches vers les sommets. Les hébergements demeu rent modestes : depuis longtemps, des hôtels fami liaux servent de lieux d’étape et de séjour sur les principaux itinéraires à Bocognano, Vizzavona, Vivario, Saint-Pierre de Venaco, Calacuccia, Evisa, Aullène ou Zonza. En hiver, les citadins d’Ajaccio et de Bastia se dirigent vers les stades de neige du Val d’Ese, de Vergio, d’Asco, de Ghisoni, tandis que des foyers de ski de fond sont nés à Evisa, Bastelica, Zicavo, Quenza... Est-ce un signe de progrès, comme l’arrêt de la régression des effectifs animaux ?
2. Des tentatives de rénovation. — La plupart des Corses sortent des villages, c’est-à-dire de l’inté rieur montagnard. La sollicitude exclusive pour les plaines, au début de l’application du Programme d’Action régionale, ne pouvait qu’engendrer des réactions de frustration. Créé en 1971, le Parc naturel régional qui regroupe aujourd’hui 138 com munes, fut le premier élément susceptible de tenter un effort en faveur de la montagne. Il englobe toute la haute dorsale cristalline, du Monte Cinto à l’Incudine, atteignant la mer entre les calanques de Piana et l’Argentella, et s’achevant dans l’Alta Rocca et l’Ospedale, au-dessus du golfe de PortoVecchio. Sa charte lui avait donné mission, non seulement de protéger la nature et les sites, mais encore de rénover l’économie rurale, puis d’amé liorer les relations entre mer et montagne. Une équipe de 55 personnes, guides, chefs de secteur, agents de développement, installés dans les com munes, est chargée de l’animation ; elle a la respon sabilité des réalisations, vivant au contact des habitants. Quelles ont été les tâches effectuées ? Le Parc devait accorder sa vigilance aux activités pasto rales et touristiques ; il a choisi d’intervenir, au départ, dans des opérations sélectionnées très pré100
cises. La première a été la restauration des bergeries d’altitude, fréquentées en été, quand bergers et troupeaux séjournent sur les alpages. Construc tions très sommaires, elles peuvent, par leur total inconfort, décourager les transhumants. Pour les inciter à maintenir leurs déplacements tradi tionnels, le Parc a proposé son aide sous la forme du transport en hélicoptère, et parfois de la fourni ture gratuite du matériel indispensable à la réfec tion des bâtiments. Bien des opérations ont été réalisées au bénéfice de plusieurs dizaines de communes. Ce n’était que la première phase d’une politique de rénova tion rurale beaucoup plus ambitieuse. Le Parc s’est consacré simultanément à l’entretien de l’élevage et à la protection de la nature : il s’est donc attaché à la lutte contre l’écobuage séculaire avec le souci de mettre au point de nouvelles tech niques de gestion de l’espace pastoral. L’amélioration des pâturages après girobroyage du maquis devrait créer des parefeux naturels en évitant le recours systématique à l’incendie. L’expérience a démarré par une action concertée sur la com mune de Poggio di Venaco dès 1977. En 1984, est née la Casa Pastureccia à Riventosa, à l’initiative du Parc et du Sivom de Venaco ; elle doit aider au développement du Venacais, du Cortenais et du Bozio, en favorisant la formation des exploi tants, des artisans et des commerçants, afin qu’ils diversifient leurs activités, qu’ils s’adaptent au tourisme, et proposent des produits touristiques. Car le Parc travaille aussi à stimuler le tourisme : il a suscité la création de « métiers de la neige » qui peuvent donner un emploi à quelques jeunes Corses, encourageant la pratique des sports d’hiver. En outre, le célèbre GR 20, qui traverse la haute montagne de Bonifato à Conca, a été balisé, jalonné de chalets, de refuges, de bivouacs, à tel point que les amateurs de randonnée pédestre ont afflué en grand nombre. Randonnée équestre, cyclotourisme, kayak n’ont pas été négligés. Enfin, des interventions variées ont multiplié les centres d’intérêt : l’ouverture du musée et du centre culturel de Lévie, de maisons d’information pour les visiteurs, la restauration de construc tions dignes d’estime, moulins à châtaignes, vieilles chapelles romanes du Cortenais, pont d’Asco, tours génoises littorales... Le Parc donne également soutien à l’artisanat, contribue à l’éveil de la curiosité grâce à des publications ou des séances
101
d’initiation à la connaissance de la botanique ou de l’orni thologie... C’est une entreprise décidée visant à dire « non au désert » qui menaçait les hautes terres (1).
Toutes ces actions n’ont pas été conduites dans l’isolement. La Somivac a apporté son aide, en 1974, lorsqu’elle a décidé d’étendre ses activités à l’inté rieur de l’île, en accomplissant des travaux de mise en valeur sur les exploitations et les propriétés privées. L’Office de Développement agricole et rural, qui lui a succédé depuis 1984, assume les mêmes responsabilités, et le Parc lui a abandonné ses attributions agricoles parce qu’il se consacre au développement micro-régional autant qu’à la sauvegarde de l’environnement. De nouvelles struc tures se sont mises en place : deux contrats de pays pour le Haut-Taravo et la « petite Castagniccia » (1979) ont engendré deux comités de développe ment en 1985-1987, un contrat est signé pour l’Alta Rocca et de nombreuses associations inter viennent. La Corse bénéficie, depuis 1975, d’être simulta nément zone de rénovation rurale et zone de mon tagne. Elle est classée, d’autre part, dans les zones rurales prioritaires pour 1989-1993 au double titre de massif de montagne et de zone rurale fragile, donc soutenue par le Fonds interministériel de Développement et d’Aménagement rural. Les efforts et les moyens libérés ont déjà amélioré les équipe ments, eau, assainissement, habitat, fortifié l’intérêt pour la châtaigne et la charcuterie traditionnelle, favorisé l’éclosion des gîtes, des tables d’hôtes, des campings à la ferme. Bien que les résultats soient inégaux, la montagne oubliée est devenue objet de sollicitude. Au moment où elle subit une crise généralisée, cette action tar) Pierre Simi. Le cadre naturel, dans Corse, Ed. Ch. Bonneton, (1 1979, p. 280.
102
dive semble un peu une gageure. Servira-t-elle d’aiguillon de survie ? Il est certain que les jeunes exploitants sont plus nombreux qu’en 1970. Mais les montagnes européennes encore très vivantes sont celles que traversent les flux de la grande circulation internationale et qu’anime, hiver comme été, la venue massive des citadins en vacances. La Corse n’a guère de chances de faire jamais partie de ces aires privilégiées. Parviendra-t-elle à éviter que ses villages soient réduits au rôle de résidences saisonnières ?
IV. — Une croissance ambiguë 1. Les contradictions de la croissance. — C’est la constatation qui se dégage de l’esquisse d’un bilan, au terme des trente années qui viennent de s’écouler. La Corse a gagné 73 000 hab. : s’agit-il vraiment d’un « repeuplement » ? Si le handicap perpétuel que représente une population faible pour l’économie s’est un peu atténué, il n’en demeure pas moins. D’ailleurs, l’essor s’est ralenti depuis le fléchissement de la vague d’immigration et la chute de la natalité. Mais le maintien de l’excédent migra toire, dû aux venues du continent, peut accréditer l’idée que la Corse acquiert une évidente attraction résidentielle. L’analyse de la population nouvelle montre, d’autre part, que sur 73 000 hab. supplémentaires, il y a 17 000 étrangers. Ils ont apporté une maind’œuvre, en majorité maghrébine, qui s’est réduite, depuis 1982, puisque 3 500 hommes sont partis après la fermeture de nombreux foyers en plaine orientale. Cependant, avec 12,7 % des actifs et 12 737 personnes en 1990, ils forment encore, malgré les 1 985 chômeurs, une portion importante des effectifs dans le bâtiment et l’agriculture, un salarié sur cinq, car la demande insulaire se porte sur les professions du tertiaire. Et la population 103
étrangère n’a que peu diminué parce qu’elle s’est féminisée par la reconstitution des familles. L’agriculture moderne a fait son apparition dans les plaines, malgré les reculs, mais l’industrie a peu progressé et le bâtiment, auparavant hypertrophié, s’est rétracté. De 12 244 personnes en 1982, il n’en occupe plus que 9 965 en 1990, restant une activité dominante dans le secteur secondaire avec 60,8 % des effectifs et 66,4 % des entreprises. Car ce dernier qui ne représente, au total, que 20 % de l’emploi insulaire, ne réunit, dans l’industrie que 6 411 per sonnes. Pourtant un certain dynamisme se mani feste ; depuis 1980, il y a une centaine d’entreprises créées chaque année. Les industries de consom mation courante, bois, ameublement, édition, en ont bénéficié, bien que les industries agro-alimen taires continuent à l’emporter. Quant aux zones industrielles d’Ajaccio et de Bastia, elles n’ont été remplies que douze et treize ans après leur naissance, quoique les Chambres de Commerce aient élargi la destination des lots aux activités commerciales et tertiaires. Encouragée par le financement de l’Etat, de la Région et de la cee, une série d’autres zones d’activités économiques a vu le jour ou est prévue : il leur faut attirer les investisseurs. A côté de ces difficultés, le déséquilibre des échanges subsiste, aggravé. En 1989, 1 193 512 t ont été importées et 176 690 t ont été exportées ; le déficit est énorme puisque le taux de couverture n’est que de 14,8 % contre 25 % en 1978. Hydro carbures et matériaux de construction constituent toujours les deux tiers des achats, et les denrées agricoles et alimentaires 21 %, en forte hausse depuis vingt ans. C’est l’indice d’une amélioration sensible du niveau de vie. Les indicateurs habituels révèlent que de gros progrès ont été accomplis. L’infériorité flagrante, dénoncée par le Programme d’Action 104
régionale, a été, sinon totalement, du moins large ment résorbée en ce qui concerne l’équipement et la consommation des ménages. Electricité, lignes télé phoniques, immatriculations de voitures neuves, ont été affectées de taux de croissance plus élevés que la moyenne nationale. Grâce à une société qui préfère la parole à l’expression écrite, la Corse se classe après Paris et la Provence-Côte d’Azur pour la consommation téléphonique par habitant. Mesuré par la présence du réfrigérateur, de la voiture, du téléphone, de la télévision ou du lave-vaisselle, le confort des ménages ajacciens et bastiais est supé rieur à celui des ménages des villes françaises de même taille. Les habitants de l’intérieur sont un peu moins favorisés. Aussi tous les décalages ne sont-ils pas comblés. Si on a immatriculé en Corse, en 1987, 7,3 voitures neuves pour 100 hab., alors que le chiffre était de 3,4 pour la France entière, la consommation d’élec tricité par habitant est une des plus faibles du pays avec celle de la Lorraine, et la production d’énergie par habitant n’a atteint que 3 183 kWh, en 1988, contre 6 696 pour la moyenne française. Un ménage sur deux est imposé ici contre quatre sur cinq dans l’ensemble du territoire, et l’impôt sur le revenu par habitant est beaucoup moins élevé, le moins élevé de tous : 2 598 F contre 4 121 F en moyenne. Pourtant la Corse dépense presque autant au jeu qu’elle donne au percepteur : loto et PMU drainent l’équivalent des trois quarts des sommes versées à l’Etat. En 1982, elle a même battu un record, celui de la dépense par habitant au pmu. Aspects déconcertants d’une situation où des signes d’aisance voisinent avec des déficiences durables.
2. Une économie préoccupante. — L’économie insulaire est appuyée sur un petit nombre d’acti vités peu productives ou vulnérables. 105
La santé de l’agriculture reposait, dans les années 80, sur la production et l’exportation du vin et des clémentines. Elle était exposée aux risques de mauvaises récoltes et aux difficultés de commer cialisation. Les agrumes avaient déjà subi les effets des aléas climatiques : 60 000 arbres avaient été coupés en 1971. Aujourd’hui, les ventes ne satis font toujours pas les espoirs qu’elles ont engendrés : ni en quantité, ni en valeur. Leur stagnation tient au fait que la restructuration est inachevée, que ses effets sont progressifs. En outre, les fruits qui sont de petit ou moyen calibres sont expédiés massivement en novembre-décembre, époque où les prix sont les plus bas. D’où une rémunération décevante ; il est vrai que le marché français est dominé par l’Espagne qui obtient à meilleur compte des clémentines de calibre supérieur, donc mieux payées. Aussi faudrait-il aux agrumiculteurs de bons rendements pour compenser : malgré des résultats améliorés, ils n’obtiennent encore que 19-20 t/ha au lieu de 15 auparavant. Quant au vignoble, son repli ampute gravement les exportations et le revenu agricoles : en 1988, il ne représente que 25 % du produit agricole dans le pib. Pourtant, le reflux a eu l’effet salutaire d’ac croître la part des vins de qualité et des vins blancs de prix plus élevé. Les plus clairvoyants pensaient que cette orientation aurait dû être amorcée dès la fin de la chaptalisation. Les primes de restruc turation, au sein de schémas rigoureux, encouragent le remplacement des Cinsault et des Carignan par des cépages « nobles » : 2 200 ha ont été touchés entre 1980 et 1990. La conversion a progressé pour l’uvib qui survit résolument. Les trois grou pements de producteurs sont parvenus, en 1990, à un chiffre d’affaires de 155 millions de francs dont près de 25 à l’exportation. Les ventes de l’uvib vers l’Allemagne et le Danemark progressent, 106
tandis que l’uval considère que Etats-Unis et Japon offrent des marchés prometteurs. Cependant, la superficie du vignoble diminue... Se rétrécira-t-il jusqu’aux 5 000 ha de 1959 ? A ses côtés, les succès du kiwi paraissent arriver à leur terme car ils se heurtent à de vives concurrences et à la chute des prix. En réalité, la situation de l’agriculture moderne est inquié tante. En 1982, le ministre a révélé que le problème reposait moins sur le montant des prêts que sur l’énorme part des impayés qui atteignait, avec 150 millions de francs, 25 % de la production brute annuelle et 65 % du revenu brut des exploitations. Les plus virulents ont dit que l’agriculture corse était structurellement non rentable ! Aujourd’hui, la Confé dération paysanne manifeste pour obtenir l’effacement total de la dette. Mais cette solution n’a été envisagée que selon les cas. Parmi les activités traditionnelles, l’élevage garde une place importante puisque 53 % des 5 116 exploitations de 1988 s’y consacrent, et que 19 % l’associent, en outre, à l’agricul ture. L’élevage ovin laitier est resté jusqu’à présent l’élément le plus fructueux avec un effectif stabilisé, des troupeaux qui ont grossi, des bergers plus jeunes. Sa survie a été liée au ramassage des sociétés de Roquefort qui collectaient 80 % du lait en 1970, mais moins de 50 % dès 1980. Leur rôle s’est rétracté : la fabrication de la pâte de roquefort pour l’affinage dans les caves de l’Aveyron a cessé, les usines d’Ajaccio, IleRousse, Corte ont fermé. Cette évolution a contraint les éleveurs à développer la production de fromage fermier. Des coopératives sont nées à Afa, à Corte... Pourtant, les bovins sont la seule espèce animale dont les effectifs s’accroissent, « effet pervers » de l’Indemnité spéciale Montagne, depuis 1973, additionnée de la prime à la vache allaitante depuis 1980. Localisés surtout en montagne et dans les régions emmaquisées parce que condamnés au libre parcours, ils ne satis font que 15 % de la demande. Aussi les spécialistes de l’Insti tut national de la Recherche agronomique, constatant simul tanément le maintien des porcs coureurs, appréciés par la charcuterie, considèrent que l’élevage est de plus en plus extensif.
Le reste de l’économie est dominé par l’activité du bâtiment et du tourisme. Le premier a perdu 3 000 emplois de 1975 à 1982, et 2 000 de plus 107
jusqu’en 1985. Si la chute est actuellement stoppée, il ne représente plus que 12,1 % des emplois et 11,3 % du pib ; la reprise est moins forte que dans l’Hexagone parce que tourisme et urbanisation n’exercent plus les mêmes effets stimulants que pendant les années d’euphorie antérieures à 1980. La croissance du mouvement touristique a été régulière après le recul de 1983-1984 : plus de 4 millions de passagers/an sont arrivés et partis depuis 1988. L’afflux se maintiendra-t-il en 1991 ? D’ailleurs, si le nombre des touristes s’est accru, celui des nuitées a baissé par rapport à 1981-1982 et les recettes ont peu augmenté. Les conséquences varient selon le type d’hébergement : les villages de vacances obtiennent les meilleurs résultats, les campings parviennent à compenser la diminution des nuitées par la hausse de la dépense quotidienne, mais ce n’est pas le cas des hôtels. Au total, les dépenses des touristes ont atteint 3 206 millions de francs en 1987, et la consommation touristique correspond à 20 % de la consommation des mé nages ; 44 % des dépenses effectuées servent à payer les importations nécessaires. La fuite hors du circuit économique insulaire est importante, moindre, néanmoins, a-t-on fait remarquer, que dans la consommation des résidents où elle s’élève à 63 % ! D’ailleurs, l’apport de ressources que le tourisme engendre lui permet d’être considéré par les décideurs et la Société centrale pour l’Equipe ment du Territoire comme une activité locomotrice. Insuffisamment différenciée, l’économie corse est une économie vulnérable que tout fléchissement peut perturber. Pourtant, elle n’est pas dépourvue d’éléments encourageants : les quelques résultats déjà acquis par la revitalisation de l’intérieur et le développement micro-régional, les progrès et l’essor attendu de l’aquaculture comme les succès de la culture des scaroles d’hiver... L’enrichissement ne 108
va pas sans inégalités, la réanimation insulaire sans ombres ni sans faiblesses. Il est vrai que la crois sance imposée de l’extérieur au départ a un carac tère partiellement artificiel qui a contribué à entre tenir l’agitation contestataire.
109
Chapitre II LE TEMPS DES RÉBELLIONS
La Corse n’a pas l’exclusivité de son « nationa lisme provincial » puisque Basques, Bretons, Occi tans même l’ont précédée dans les manifestations qui l’accompagnent. Il correspond plus ici à une résurrection qu’à une tradition. Les références per manentes au passé, aux révolutions du XVIIIe siècle et à Paoli, engagent, en effet, à y voir l’expression actuelle d’un phénomène historique. Certes, les causes tiennent à une conjoncture générale : le défi à l’Etat centralisé à l’heure où les prises de conscience régionales dévoilent les retards et les difficultés de certaines extrémités du territoire. La situation locale, c’est-à-dire l’agression brutale de la modernité avec ses incidences perturbatrices sur l’ancien état de choses, a aggravé les tensions.
I. — La montée des revendications 1. Rétrospective. — Si les revendications d’au jourd’hui, sont, dans leur acuité, un produit du dernier quart de siècle, elles s’intégrent néanmoins dans une évolution dont les origines remontent plus loin dans le temps. Les problèmes économiques de l’île, qui avaient fait l’objet de tant de rapports et de propositions durant le XIXe siècle et jusqu’au gouvernement Clemenceau, avaient déjà sensibilisé l’opinion. Il y 110
eut un « Congrès de Corte » dès 1909, même des « Etats généraux » en 1934. Dès cette époque, c’étaient les soucis matériels qui légitimaient les doléances. Mais ils coexistaient avec un désir d’af firmation sur le plan culturel, réaction probable contre la francisation qui s’était imposée à partir du Second Empire. En 1896 a été publié le premier journal en corse, la Tramuntana : son fondateur souhaitait donner au dialecte quotidien l’occasion de devenir une langue écrite. La première « renais sance » a surtout bénéficié à la poésie, ce mode d’expression traditionnel si spontané et si prisé. A ce mouvement littéraire s’attache une valeur affective. Pour ceux qui l’ont incarné, il apportait une sorte de compen sation au dépérissement de la vieille Corse, peu à peu emportée par l’émigration et par le démantèlement de ses structures. Avant 1914, il a attiré l’attention sur la situation menacée de la société insulaire, sur l’indifférence de l’Etat, sur l’ineffi cacité des hommes politiques. Il a engendré la notion d’auto nomie culturelle, en rejetant autant l’influence française que l’influence italienne. Après la guerre, le mouvement s’est prolongé par l’appa rition de deux revues qui se sont progressivement opposées. La Muvra de Petru Roca a entraîné la naissance du Parti corse d’Action qui est devenu, en 1927, le Parti corse auto nomiste. L’Annu Corsu d’A. Bonifacio et Paul Arrighi, apolitique, a été animée de préoccupations félibres.
Aux intellectuels revient donc la responsabilité de cette fermentation, alors que la Corse faisait, au même moment, l’objet des convoitises italiennes dirigées vers les terres « irrédentes ». Doctrine offi cielle depuis 1867, l’irrédentisme a été ressuscité par le fascisme en 1923. Il a provoqué, en Italie, un mouvement de recherche très fructueux sur l’île de la part des érudits. Malgré la propagande qu’elle subit, celle-ci resta largement indifférente ; seul le Parti autonomiste manifesta sa sympathie. Sur l’instigation du comte Ciano, les intentions annexionnistes furent clairement exprimées en 1938 ; elles déclenchèrent des protestations virulentes et 111
des manifestations d’attachement à la France avec le serment de Bastia. Le Parti autonomiste ne sur vécut pas à la seconde guerre.
2. La fermentation des années 60. — La renais sance de la contestation ne s’est pas produite dans l’immédiat après-guerre, quand s’est aggravée l’évo lution régressive dont souffrait le département. Elle s’est amorcée, au contraire, pendant la période de démarrage du Plan d’Action Régionale (par), alors que les Corses doutaient que l’entreprise pût avoir quelques résultats. La formation des premiers mouvements reven dicatifs n’a donc pas été provoquée par les muta tions de la plaine orientale : elle prit l’aspect d’une réaction défensive suscitée par les difficultés écono miques. La menace de suppression du chemin de fer, 232 km de voie étroite, lente, archaïque et... déficitaire, a mobilisé tout d’abord l’opinion, égale ment sensibilisée par la crainte de voir disparaître certains avantages fiscaux dont l’île bénéficiait. Ainsi sont nés, en 1960, le Mouvement du 29 no vembre à Ajaccio, puis le Groupement pour la Défense des Intérêts économiques de la Corse à Bastia. Dès le départ, la contestation acquiert des carac tères durables : elle sort d’une bourgeoisie qui ne détient pas le pouvoir politique, attirant un avocat, un journaliste, un pharmacien, des commerçants... Elle ne s’appuie pas sur une idéologie solide, mais elle exprime une susceptibilité qu’avivent surtout les problèmes matériels spécifiques de la Corse. Elle entraîne l’apparition de plusieurs groupes d’action qui n’ont jamais nourri le sentiment d’une néces saire unité, car elle a toujours réuni les représentants de tendances variées. Mouvement du 29 novembre et DIECO, par leurs analyses, ont contribué à une meilleure connaissance des « handicaps
112
de l’insularité » qu’avait évoqués le par, en 1957, et qui continuaient à peser sur les activités. Les publications admi nistratives s’en sont inspirées, en particulier le Rapport Neuwirth de 1963 : il a insisté sur l’aspect coûteux de l’isole ment, montrant que les majorations de prix, dues à la traversée de la mer, oscillaient de 20 à 110 % selon les produits, attei gnant 40 % en moyenne pour les matériaux de construction, triplant la valeur des eaux minérales entre Marseille et un port corse. Il rappelait que, pour pallier ces inconvénients, la Corse disposait d’un statut fiscal particulier institué par les arrêtés Miot et le décret impérial de 1811, révélant que les avantages accordés s’étaient petit à petit « effilochés ». D’où la tendance à considérer l’insularité comme une pénalité infligée par la nature et la nécessité pour l’Etat d’apporter des avantages compensatoires. Ainsi s’établit un programme revendicatif : l’amélioration du système de trans ports Corse-continent, l’exigence d’un véritable statut fiscal, l’érection de l’île en région économique détachée de la ProvenceCôte d’Azur.
La création à Paris, en 1963, de l’Union Corsel’Avenir qui réunissait surtout des intellectuels et des étudiants, a donné au mouvement une dimen sion politique. Reprenant à son compte les préoc cupations matérielles, elle a mis en relief la poursuite de l’ « émigration catastrophique des habitants », alors que les terres de la plaine s’offraient à « l’im plantation massive d’éléments étrangers au dépar tement » ; elle a proclamé : « La mise en valeur de la Corse doit profiter d’abord aux Corses. Un renou vellement culturel doit aller de pair avec l’effort économique », en dénonçant les inconvénients de la centralisation. Le Ier Congrès de l’Union nationale des Etudiants corses à Corte, en 1963, qui rassem blait tous les représentants des associations de jeunes, des bonapartistes aux communistes, a con crétisé ces aspirations en exprimant pêle-mêle un ensemble de vœux qui ont fait long feu : la fin du monopole de la Compagnie Générale Transatlan tique, le retour de la jeunesse dans l’île, la nécessité d’une université et la transformation profonde des 113
structures politiques. C’était déjà le contenu du programme régionaliste. L’année suivante, Max Siméoni fondait le Comité d’Etude et de Défense des Intérêts de la Corse. Il se proposait d’étudier « les données du problème corse en vue des meilleures solutions possibles dans le cadre de la sauvegarde de l’ethnie corse, et dans la perspective de l’administration et de l’économie régionales ». La situation générale évoluait rapide ment ; l’arrivée des Pieds-Noirs, les modalités de la mise en valeur s’ajoutaient au problème des transports pour favoriser l’irritation. La Somivac servait de cible, après la Compagnie Générale Tran satlantique. Les premiers attentats contre les cons tructions Somivac ont eu lieu à Ghisonaccia, en 1965, sur des exploitations destinées aux PiedsNoirs. Tous les mouvements revendicatifs ont pré conisé l’abstention aux élections de 1965. En 1966, les assises régionalistes de la Jeune Corse ont repris les thèmes, devenus leitmotive, de l’Union corse et du Cedic : reconnaissance de la personnalité insulaire, érection de la Corse en région de programme, statut particulier. Mais le rappro chement ne s’est pas fait entre les différentes for mations : au contraire, tandis que les intellectuels parisiens fondaient le Front régionaliste corse, d’ins piration socialiste, Max Simeoni et ses amis main tenaient le Cedic, moins préoccupé de prises de position politiques, et lançaient le journal Arritti. Ils décidaient de jouer le jeu des urnes en présentant leurs candidatures aux élections, puis créaient l’Ac tion régionaliste corse, en 1967. Elle restera long temps apolitique, ancrée sur le souhait d’une auto nomie de gestion. II. — Régionalismes et nationalismes
1. L’action violente. — La Somivac, incarnation du « colonialisme » extérieur, a été la principale 114
victime des plasticages isolés qui se sont produits avant 1969. D’ailleurs, les premières manifestations violentes, organisées sur l’instigation de l’arc, ont eu lieu à Ghisonaccia, en 1969, quand la mairie a été prise d’assaut. La cause de l’affrontement était la dévolution du terrain d’aviation désaffecté, c’està-dire de nouveaux biens communaux, aux entre prises de mise en valeur, alors que certains jeunes agriculteurs volontaires manquaient de terres. Peu après, des incidents éclataient à Porto où le comité d’action avait barré la route. Ainsi a débuté la phase active de la contestation régionaliste : l’arc possédait un noyau de militants dévoués, intensifiait sa propagande, polarisant sou vent l’intérêt de la vie publique. L’érection de la Corse en région économique, en 1970, n’a pas apporté d’apaisement : entraînée à une perpétuelle surenchère, l’arc préconisait déjà pour l’île l’obten tion d’une assemblée régionale élue au suffrage universel. Elle est intervenue bruyamment dans tous les problèmes en suspens, engageant la bataille contre le paiement de la vignette-auto, affirmant de nouveau avec vigueur la nécessité du chemin de fer, encore menacé en 1972. Une nouvelle étape dans l’escalade a été franchie en 1973, à l’occasion d’une rencontre arc-frc : c’est alors qu’a été proclamé le moment venu de faire la Corse « corse ». Le but de la lutte est l’auto nomie. Le souhait du frc qui devient le Partitu di u Populu Corsu, n’a pas été ouvertement adopté par l’arc ; elle finit par se rallier à une position ambiguë, l’autonomie interne « dans le cadre de la France ». La vigueur de l’action, colorée de nationalisme, s’est amplifiée au cours des mois qui ont suivi. L’affaire des « boues rouges », déversées par la Montedison italienne dans le canal de Corse, a servi de catalyseur. Une sorte d’émeute dont la cause ne 115
pouvait être strictement écologique a éclaté à Bastia où la sous-préfecture fut attaquée. L’annonce de la création d’une université à Ajaccio a déclenché ensuite deux ans de tumulte car, seule, Corte pou vait accueillir cet établissement afin que revive l’institution ouverte par Paoli. L’événement le plus grave, le premier événement sanglant, l’affaire d’Aléria, en 1975, a eu, cependant, une autre ori gine : c’est la dénonciation de fraudes célèbres dans la fabrication des vins, la responsabilité de quelques grands propriétaires pieds-noirs de la plaine, me nacés de faillites, qui a provoqué l’investissement de la cave Depeille, protestation symbolique contre cette autre forme de pollution qui souillait la société insulaire. Avant cette date, l’action clandestine fomentée par des groupes mal identifiés, Fronte Paesanu Corsu di Liberazione et Ghjustizia Paolina, s’était intensifiée. De 40 plasticages en 1973, le chiffre passa à 111 en 1974, 226 en 1975, 298 en 1976... Furent-ils tous des actes terroristes ?... Quoi qu’il en soit, les cibles étaient variées, généralement considérées comme les témoignages du colonialisme français et du capitalisme extérieur : banques, agences immobilières et agences de voyages, caves vinicoles, camps de vacances. Parmi les épisodes les plus retentissants : le plasticage du village du Club Méditerranée à Cargèse. Une pléthore de groupes nouveaux proliféra en 1976. La fusion fpcl-gp a engendré le Front de Libération nationale de la Corse qui combat réso lument pour l’indépendance, possède une organi sation efficace et des armes redoutables. En même temps se manifeste le mouvement francia, le Front d’Action nouvelle contre l’Indépendance et l’Autonomie. L’Association des Patriotes corses a remplacé l’arc dissoute, puis s’est transformée en Unione di u Populu Corsu, en 1977, après la sortie 116
de prison d’Edmond Simeoni ; celui-ci a alors proclamé son nationalisme et son hostilité vis-à-vis des méthodes brutales du flnc. Ce sont les élections successives à l’Assemblée de Corse, en 1982 et 1984, qui ont introduit légalement autonomistes et indépendantistes dans la vie poli tique. Aujourd’hui, les contestataires se sont disso ciés en factions nombreuses. Il y a les plus modérés, l’upc de Max Simeoni, le Mouvement pour l’Auto détermination (mpa), le flnc « canal habituel ». Les plus radicaux sont : le flnc « canal historique », A Cuncolta Naziunalista, « Resistenza », qui reven diquent de nombreux attentats. La fréquence s’est accrue au fil des années. L’ « île impossible » s’habitue-t-elle passivement à la violence ?
2. Les incidences. — Quelle est l’attitude des Corses devant les tumultes de la contestation ? Dans le passé, les mouvements régionalistes et auto nomistes n’ont jamais réuni un grand nombre d’adhésions officielles : 200 adhérents au frc en 1973, 500 militants de l’arc en 1974-1975, tandis que l’upc avait limité au maximum de 1 500 le volume de ses forces. La participation aux manifes tations a beaucoup varié : les évaluations les plus élevées ont atteint 10 000 personnes. Aujourd’hui, grâce à une infiltration décidée au sein des asso ciations syndicales ou culturelles, l’influence des séparatistes s’est affirmée. Car les thèmes de la propagande ne peuvent laisser la masse insensible : l’attachement à la terre natale, à sa langue et à ses traditions, la défense des intérêts économiques, l’amélioration des liaisons avec le continent, l’hostilité à l’égard de la main mise des gros capitaux étrangers à l’île, font vibrer aisément la corde du patriotisme corse. Le slogan « Vivre et travailler au pays » ne peut guère, non plus, rester sans résonance pour la jeunesse qui a 117
perdu les débouchés qu’offrait jadis l’empire colonial et se heurte aux difficultés d’insertion de la France actuelle. Sympathie ne signifie pas approbation. A l’action terroriste, par exemple, et à ses cibles. Les protes tations fusèrent après la destruction du réémetteur de télévision de Bastia, celle du village du Club Méditerranée, l’attentat contre le Dr Lafay à Corte, le récent plasticage d’un lotissement résidentiel à Cargèse... L’Association pour la Corse française et républicaine est justement sortie de cette commune, en 1983, réunissant les antiséparatistes et les adhé sions d’une bonne partie des élus contre les mani festations violentes. Le corps électoral reste fidèle aux hommes poli tiques en place et aux partis de la tradition. Par peur du désordre et par désir de stabilité. Les 6 sièges obtenus à l’Assemblée de Corse, en 1984, par l’upc et le MAC représentent 14 307 voix, 10,4 % des suffrages. Parce que cette île turbulente, conser vatrice de tempérament, offre le paradoxe d’une vieille docilité aux gouvernements en exercice : 4 députés rpr en 1978, 3 mrg en 1981, 2 rpr et 2 mrg en 1986 sont sortis des urnes. Malgré le progrès des voix de gauche subsiste une majorité modérée. Or les élus ont toujours montré leur hostilité aux revendications nationalistes. Le ralliement des notables à l’Etat français correspond à une réalité ancienne et durable. Les clans, les partis-clientèles dont ils sont issus, qui s’adaptent tant bien que mal aux partis nationaux dans leur nécessaire ajuste ment avec le continent, ont été l’objet de critiques acerbes de la part des autonomistes, soucieux de purifier les mœurs politiques, par respect pour le peuple corse qu’ils veulent préserver. Cependant, élus et autonomistes ont parfois combattu pour les mêmes causes dans le zèle qu’ils ont mis à défendre les
118
intérêts locaux. Les gains sont appréciables. Après l’érection en région et l’obtention de l’Université, une charte de dévelop pement, en 1975, a ressuscité le par en y ajoutant le vœu d’améliorer l’infrastructure des transports, la réalisation de la continuité territoriale, la sauvegarde de l’identité culturelle. Le 1er avril 1976, la continuité territoriale était établie avec la création de la Société nationale Corse-Méditerranée, service public sous la responsabilité de la sncf qui a abaissé sensible ment les tarifs. Une Société d’Aménagement foncier et d’Eta blissement rural (safer) a vu le jour en 1977, tandis que, sur l’instigation de la charte, démarrait, grâce au Conservatoire du Littoral, une politique d’acquisitions côtières, visant à assurer la protection des rivages menacés de « baléarisation ». C’est le statut particulier proposé par le gouvernement socialiste, concrétisé par l’élection à l’Assemblée de Corse, en 1982, qui, en permettant la première expérience française de décentralisation, a modifié la nature des relations entre l’Etat et la Région. Le nouveau statut de la Corse, adopté en 1991, a affirmé la spécificité insulaire. L’Assemblée qui doit être élue en 1992 sera dotée d’un bureau et d’un conseil exécutif, désignés en son sein. Le conseil dirigera l’action de la collectivité avec des pouvoirs étendus. Les Corses pos sèdent désormais les moyens de prendre leurs affaires en main. Est-ce le début d’une époque nouvelle ? Le bilan publié de neuf ans d’action régionale pourrait le laisser espérer.
III. — Le présent 1. Des signes de revitalisation. — La croissance et l’enrichissement, malgré leurs déficiences, l’agi tation contestataire, malgré ses violences, ont exercé des effets positifs qu’un effort d’analyse ne saurait omettre. L’accent a déjà été mis sur la revalorisation acquise par l’île aux yeux de ses propres habitants. « Le mythe du paradis perdu que tout Corse du continent porte en lui, la crise de l’emploi dans les grandes villes, et la méditation critique généralisée sur les conditions de la vie moderne se rejoi gnent »... (1) pour aboutir à ce résultat. L’émigra(1) Antoine Ottavi, Des Corses à part entière, Editions du Seuil, 1979, p. 140.
119
tion a été souvent justifiée par la conviction amère qu’il n’y avait rien à faire sur place. Cette constata tion désabusée a disparu du langage. La preuve tangible existe partout qu’il n’en est rien, et même que l’audace peut payer à condition d’avoir des idées et de trouver les moyens de les réaliser. L’émigration était aussi justifiée jadis par la recherche du mieux-être et d’une vie plus agréable. Le rôle de l’inconfort du logement dans le mécanisme de l’émigration féminine a été depuis longtemps démontré. Il faudrait y ajouter, pour la Corse, l’attractivité réduite des villes qui, jusqu’à une date proche, ne pouvaient guère sécréter des promesses d’eldorado. Les progrès foudroyants qui ont été accomplis ont modifié toutes les données. En 1962, 54 % des résidences principales dans les campagnes disposaient de l’eau courante et 81 % dans les villes, tandis qu’en 1982 les taux atteignaient 98,4 et 99,5 %. En 1962, sur dix résidences principales, trois avaient une douche ou une baignoire dans les villes, une seule à la campagne. Actuellement, 87 % des foyers ruraux et 94 % des foyers urbains en sont pourvus. La disposition des biens durables a subi une évolution comparable. Bien qu’installés au bord de la mer, les citadins d’Ajaccio et de Bastia partent maintenant en vacances comme partent ceux des villes fran çaises de même taille : 54 % l’ont fait en 1977. A quoi bon quitter la Corse alors ? L’essentiel est de pouvoir y travailler.
Cet intérêt récent que les Corses portent à la Corse trouve son expression dans le renouveau culturel qui se manifeste depuis 1970. L’île est devenue, tout d’abord, un passionnant objet d’é tudes : son passé archéologique le plus reculé, son histoire, ses caractères ethnologiques, sa langue suscitent recherches et découvertes. Des vestiges préhistoriques inconnus, des ruines oubliées, des monuments négligés ont retrouvé une existence, s’insèrent désormais dans le déroulement du temps. Une fièvre de publications, souvent fort savantes, emplit les vitrines des librairies de livres nouveaux, chaque mois plus nombreux, effaçant les carences d’une époque peu lointaine. Les spécialistes insistent sur la « seconde renais120
sance » littéraire (2) qui se produit après une véri table « traversée du désert », inspirant la multipli cation des écrits en langue corse. Ne peut-on pas aussi évoquer une renaissance musicale à travers la sollicitude accordée au chant ? Non pas aux ro mances, d’imitation napolitaine, qu’affectionnent les cabarets prisés des touristes, mais au chant corse authentique : il s’agit moins du lamentu ou du vocero que de la paghjella, cette polyphonie à trois voix, chœur masculin rustique aux rauques sono rités mélancoliques. Le récital de paghjella s’ajoute parfois mainte nant aux « journées » de foires organisées en été, quand viticulteurs et artisans se réunissent pour écouler leur production en attirant des clientèles nombreuses. Car la résurrection de l’artisanat est une autre forme de cette vigilance qui s’attache à la survie des traditions. Même si tous les artisans ne sont pas des Corses héréditairement formés à la fabrication des vieux objets, ne vaut-il pas mieux, néanmoins, que les visiteurs, friands de souvenirs, emportent la fatoghja, la corbeille de jonc du berger, ou la poterie sans ornement, ou même la liqueur et le miel du « maquis », plutôt que le Napoléon de porcelaine d’importation continentale ? Bien que ces mouvements récèlent le danger de s’abîmer dans un folklore facile, ils n’en représentent pas moins, malgré les outrances, un fait positif par rapport au vide d’antan.
2. Un malaise. — L’insouciance joyeuse des étés ensoleillés dans l’île, le bien-être léthargique que peuvent y procurer les vacances qui s’y déroulent demeurent des évidences bien réelles. Pourtant les signes de malaise transparaissent fréquemment. Cause de remous constants, le malaise économique (2) Fernand Ettori, dans Corse, Ed. Christine Bonneton, 1979.
121
se perpétue. Privilégiée par la mise en valeur, l’agri culture n’a pas rempli les promesses qu’elle avait suscitées. Les dernières données comptables révèlent que la production de 1988 est lourdement inférieure à celle du début des années 70 où le vin représentait plus de la moitié des livraisons globales. La période 1987-1990 apporte une rupture : les vignes à haut rendement ont disparu, alors que la restructuration, appuyée sur les vins de qualité, les kiwis, les agrumes..., ne se manifeste pas encore. La part du pib agricole s’effondre à 3,2 % du total insulaire. Dans la plaine orientale, seule véritable région productrice, l’extensification a gagné 10 000 ha ; le spectacle des exploitations abandonnées sur les anciens lotissements somivac offre une vision déprimante pour ceux qui ont vu leur éclosion. Quoiqu’il domine parmi les types d’exploitation, l’élevage ne procure que le tiers des livraisons de l’agriculture tant le cheptel est peu productif. La production s’essouffle, les charges augmentent, la valeur ajoutée diminue. « Sans les subventions, le résultat serait presque nul. » A ce gouffre financier s’associe un milieu rural instable. Un certain nombre d’exploitants, surtout pieds-noirs ou continentaux, se sont retirés. Quel ques « planteurs » des années 60 arrivent aussi à l’âge de la retraite sans assurer leur succession. De jeunes Corses se sont installés, parfois après avoir occupé les terres comme sur le domaine de Pinia, à Ghisonaccia. Il y a, certes, des initiatives décidées et réussies ; mais l’avenir des autres est-il bien solide? Beaucoup de transferts provoquent, en outre, des fragmentations de propriétés. En 1988, il ne reste que 1 229 salariés agricoles, au lieu de 2 200 en 1982. Le pari sur la vigne a échoué. C’est probablement un fait positif s’il n’entraîne pas l’abandon. Bel exemple des vicissitudes de toute entreprise de « colonisation » dans une plaine méditerranéenne. 122
L’économie corse serait-elle vouée à l’échec ou au demi-succès ? Les créations industrielles tant espé rées sont rares. L’actualité laisse entrevoir l’appa rition possible d’une cimenterie. Mais tant de tenta tives se sont soldées par des faillites : la conserverie de Casamozza a disparu, comme la fabrication des machines à vendanger Féménia. L’insee a montré que la structure des entreprises exprime le maintien d’un artisanat à grande échelle et que la produc tivité y est inférieure à celle observée dans neuf autres « départements semblables », à cause d’une main-d’œuvre plus abondante. Le tissu socioéconomique local revêt des aspects spécifiques : il repose sur quelques secteurs vitaux, certains ayant une place disproportionnée. L’industrie apporte à peine plus de la moitié de la valeur ajoutée du bâtiment. Le tertiaire-refuge accroît sa prépon dérance. D’abord au bénéfice des catégories prisées : les services publics rassemblent 3 214 personnes de plus qu’en 1982, le commerce 1 500, l’industrie 693 seulement. Le secteur hôtels-cafés-restaurants pèse autant dans la valeur ajoutée que l’industrie. L’activité insulaire est fortement saisonnière ; 10 000 emplois liés au tourisme ne durent que « le temps d’un été ». Et l’augmentation de la popu lation active ne vaut qu’un progrès limité puisque, avec 11 279 actifs supplémentaires, elle compte 5 357 chômeurs de plus. Pourtant, le niveau de vie ne paraît guère affecté, appuyé sur l’efficace soutien de cette « économie souterraine » qui associe profits dissimulés, travail temporaire ou au noir, indemnités ou expéditents variés. La Corse serait-elle particulièrement déshé ritée ? La presse a montré que l’Etat-providence qui récolte un milliard dans l’île, en verse trois, et il est sollicité sans cesse pour stimuler l’industrie, aider les agriculteurs, abaisser les tarifs de trans port... 123
Voilà qui ne peut qu’entretenir le malaise poli tique. S’agit-il de l’imbroglio souvent décrit ? L’expérience de l’autonomie régionale ne l’a pas dissipé. Les trois assemblées ont été tiraillées par leurs divisions, offrant le vieux spectacle des fac tions insulaires. L’obtention du nouveau statut va entraîner des élections en 1992 ; elles se préparent fièvreusement, d’abord par la refonte des listes électorales surchargées. Le souci de l’intérêt général parviendra-t-il à l’emporter sur le jeu exaltant de la politique ? Beaucoup d’habitants sont corses et français, généralement corses avant d’être français, conciliant sans angoisse les deux appartenances. Les luttes électorales ont lieu pour eux entre la droite et la gauche, ou entre les deux partis traditionnels, aujourd’hui attachés au pouvoir régional. Bien qu’intégrés dans le système, autonomistes et natio nalistes lui ont été hostiles, mais le mpa voudrait constituer un « front démocratique » en présentant une liste ouverte aux élections de 1992. Pourtant le terrorisme ne cesse pas : attentats contre les administrations, les résidences secondaires, les camps de vacances se succèdent. Le plus spectaculaire a soufflé la salle de réunion du Conseil général de Haute Corse à Bastia, le 29 mai 1991. Les moti vations politiques ne sont pas toujours évidentes puisque certains incidents s’associent au racket ou au banditisme. « Dérive à la sicilienne », dit-on parfois... De l’amour-propre blessé à la revendication vio lente, la distance a été franchie. Provoqué par des insatisfactions économiques, le débat s’est déplacé vers des interrogations fondamentales.
124
CONCLUSION Analyser la situation et les tensions de la Corse d’aujourd’hui est tâche malaisée. L’île conjugue des aspects contradictoires comme le prouvent ses indicateurs économiques. Avec 75 400 F par habi tant, son pib est toujours le plus faible du pays, bien qu’il se soit accru depuis 1982 au même rythme que dans l’ensemble national. Elle demeure la région qui paie les impôts les plus réduits. En revanche, elle est l’une des mieux équipées en lignes télé phoniques et en télévision couleur, et les transferts reçus de l’Etat s’élèvent à 2 000 F par habitant, près du double de la moyenne française (1). Même si tous les retards ne sont pas résorbés, nul ne peut plus l’accuser d’être « un morceau de Moyen Age » subsistant au cœur de la Méditerranée. Le changement est lent, mais s’insinue partout. Ce qui reste de l’agriculture moderne se présente comme une activité sophistiquée grâce au raffinement des procédés d’irrigation, au perfectionnement du ma tériel. Elle fait, néanmoins, figure de création factice, reposant sur le prêt, les indemnités, les subventions, pourvue de productions peu compé titives dans des circuits de commercialisation qui se sont dilatés à l’échelle du Marché commun où les concurrences sont vives. Aux yeux de nombreux exploitants, elle est acculée dans l’impasse revenus limités-gros endettement. Le tourisme-providence s’appuie sur des struc tures d’hébergement qui figurent parmi les plus récentes du pays : près de deux chambres d’hôtel sur trois ont été construites ou rénovées depuis moins de quinze ans. Pourtant, malgré son rôle stimulant sur le bâtiment, le commerce, les trans(1) Observations effectuées à travers les statistiques des « Col lections de l’insee » : Statistiques et indicateurs des régions françaises, annexe au projet de loi de finances pour 1990.
125
ports, il n’a pas été la panacée attendue de projets utopiques : la brièveté d’une saison trop concentrée se traduit par un chiffre restreint d’emplois perma nents et une proportion majoritaire d’emplois esti vaux de deux à quatre mois, occupés par des élé ments recrutés hors de Corse pour une bonne part. Le tourisme contribue mal à résoudre le problème de l’emploi. La greffe de la révolution novatrice qui a exercé une action sélective sur l’espace insulaire laisse donc, à côté des acquisitions positives, des résultats incertains ou décevants. Venue en allogène, elle a déclenché un indéniable « bond en avant », avec la participation des habitants, en même temps qu’un phénomène de rejet de la part d’une fraction de l’opinion. Par bien des traits, la protestation corse rappelle la protestation bretonne (2). Elle associe le désir du changement et le regret du passé, le souci des progrès matériels et l’aspiration à une culture tra ditionnelle retrouvée. L’affirmation têtue de la per sonnalité régionale s’exprime comme une réaction défensive contre les agressions qui la menacent : les hommes, les idées, les capitaux, les techniques qui sont arrivés du dehors, ne condamnent-ils pas la survie de ce « paradis fragile » (3) que découvrent encore avec ravissement l’ethnologue, le musicolo gue... ou le touriste, quand ils pénètrent à l’inté rieur ? Ne risquent-ils pas d’asservir la vie locale comme les mécanismes de l’économie ? A travers problèmes et drames, se manifeste ainsi le particularisme obstiné d’une terre qui n’a jamais ni pu, ni su, maîtriser sa solitude. Le pari du nou veau statut et de la nouvelle collectivité territo riale le lui permettra-t-il ? (2) Maurice Le Lannou, La Bretagne et les Bretons, puf, « Que sais-je ? », 1978, 128 p. (3) Fernand Ettori, dans Corse, Ed. Christine Bonneton, 1979, p. 9.
126
BIBLIOGRAPHIE I. --- SUR l’histoire
Albitreccia (Antoine), Le Plan Terrier de la Corse au XVIIIe siècle, Presses Universitaires de France, 1942. Albitreccia (Antoine), La Corse, son évolution au XIXe siècle et au début du XXe siècle, Presses Universitaires de France, 1942. Antonetti (Pierre), Histoire de la Corse, Robert Laffont, 1973,480 p. Arrighi (Paul), Histoire de la Corse, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », n° 262, 1966, 128 p. Arrighi (Paul) (sous la direction de), Histoire de la Corse, Toulouse, Privat édit., 1971, 454 p. Arrighi (Paul), La vie quotidienne en Corse au XVIIIe siècle, Hachette, 1970, 281 p. Caisson, Casanova, Casta, Defranceschi, Ettori, Giacomo, Leca, Pomponi, Ravis-Giordani, Pieve e Paesi, Communautés rurales corses, Paris, Editions du Centre national de la Recherche scientifique, 1978, 379 p. Carrington (Dorothy), La Corse, île de granit, Arthaud, 1980,355 p. Jehasse (Jean et Laurence), La nécropole préromaine d’Aléria, Paris, Editions du Centre national de la Recherche scientifique, 1973, 626 p. Moracchini (Geneviève), Les églises romanes de Corse, Paris, 1967.
ii. —
sur l’économie, la géographie les problèmes d’actualités
Delors (J.-P.), et Muracciole (S.), Corse, la poudrière, Paris, Alain Moreau, 1978, 380 p. Ettori (F.), Pomponi (F.), Ravis-Giordani (G.), Renucci (J.), Simi (P.), Corse, Christine Bonneton édit., 1979, 363 p. Kolodny (Emile), La géographie urbaine de la Corse, Paris, Sedes, 1962, 334 p, Ottavi (Antoine), Des Corses d part entière, Editions du Seuil, 1979, 109 p. Renucci (Janine), Corse traditionnelle et Corse nouvelle, Lyon, Audin, 1974, 454 p. Rondeau (André), La Corse, A. Colin, 1964, 194 p. Sanguinetti (Alexandre), Lettre à mes compatriotes corses, Albin Michel, 1980, 225 p. Silvani (Paul), Corse des années ardentes, Paris, Albatros, 1976. Simi (Pierre), L’adaptation humaine d la Dépression centrale, Gap, Editions Ophrys, 1965.
127
TABLE DES MATIÈRES
Introduction 3
PREMIÈRE PARTIE LES CORSES, UNE HISTOIRE, UN « PEUPLE »
Chapitre I — La Corse, une colonie 5 I. De la Préhistoire aux colonisations antiques, 5 — II. Les dominations italiennes, 10 — III. Les luttes pour l’indé pendance, 14 — IV. La Corse française, 18.
Chapitre II — Les Corses, une communauté éclatée 24 I. Terre d’exode, terre d’accueil, 25 — II. La population insulaire aujourd’hui, 29 — III. Les Corses hors de Corse, 35 — IV. Un « peuple corse », 38.
DEUXIÈME PARTIE DE L’ENGOURDISSEMENT AU RÉVEIL Chapitre I — Le dépérissement des activités traditionnelles 45 I. Les replis agricoles, 46 — II. Les résistances pastorales, 50 — III. Heurs et malheurs de l’industrie, 55 — IV. Le bilan du dépérissement, 59.
Chapitre II — Les commotions de la fin du XXe siècle 63 I. Le choc du nouveau, 63 — IL Les révolutions agricoles, 67 — III. L’irruption du tourisme, 75.
TROISIÈME PARTIE LES PROBLÈMES DE CROISSANCE Chapitre I — Les disparités insulaires 83 I. Des villes gonflées, 83 — II. Une périphérie littorale bouleversée, 90 — III. Et l’intérieur ?, 98 — IV. Une croissance ambiguë, 103.
Chapitre II — Le temps des rébellions 110 I. La montée des revendications, 110 — IL Régionalismes et nationalismes, 114 — III. Le présent, 119.
Conclusion 125 Bibliographie 127 Imprimé en France Imprimerie des Presses Universitaires de France 73, avenue Ronsard, 41100 Vendôme Mai 1992 — N° 37 776
COLLECTION ENCYCLOPÉDIQUE fondée par Paul Angoulvent
2635 Les procréations médicalement assistées (R. Frydman) 2636 La protection internationale de l’environnement (J.-L. Mathieu) 2637 Les options de change (M. Chesney et H. Loubergé)
2638 La numismatique (C. Morrisson) 2639 L’Ecole de Chicago (A. Coulon) 2640 Le ragtime (J. B. Hess) 2641 Les politiques de l’emploi (G. Grangeas et J.-M. Lepage) 2642 Les petites et moyennes entre prises (A. Bizaguet) 2643 Le droit des élections politiques (J.-C. Masclet)
2644 Le media-planning (T. Fabre) 2645 L’inceste (de Lannoy et Feyereisen) 2646 La gestion des ressources hu maines (J.-M. Le Gall) 2647 Le Conseil général (J. Bourdon et J.-M. Pontier) 2648 Hollywood (D. Royot) 2649 Introduction à l’économie (F. Teulon) 2650 La philosophie des valeurs (J.-P. Resweber) 2651 Le Théâtre national de l’Opéra de Paris (J.-P. Saint-Geours) 2652 La communication politique (J. Gerstlé) 2653 La négociation collective (G. Caire) 2654 SICAV et fonds communs de placement, les OPCVM en France (G. Gallais-Hamonno) 2655 La détention provisoire (B. Callé) 2656 La didactique du français (J.-F. Halté) 2657 Le patrimoine industriel (J.-Y. Andrieux)
LA CORSE
Derniers titres parus 2626 Le MATIF (F. Aftalion et P. Poncet) 2627 L’économie des Temps modernes (H. Legohérel) 2628 Vocabulaire monétaire et finan cier (F. Teulon) 2629 Texte, hypertexte, hypermédia (R. Laufer et D. Scavetta) 2630 Le marché de l’art (E. et M. Hoog) 2631 Averroès et l’averroïsme (M.-R. Hayoun et A. de Li bera) 2632 L’agriculture biologique (C. de Silguy) 2633 La Contre-Révolution (L.-M. Clénet) 2634 La science de la communication (J. Lazar)
1981 9 782 30 443902


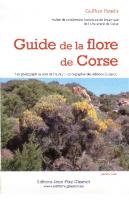
![Histoire de la Corse [6 ed.]
2130448216, 9782130448211](https://ebin.pub/img/200x200/histoire-de-la-corse-6nbsped-2130448216-9782130448211.jpg)



![Parc naturel régional de la Corse : plantes et fleurs rencontrées [2 ed.]](https://ebin.pub/img/200x200/parc-naturel-regional-de-la-corse-plantes-et-fleurs-rencontrees-2nbsped.jpg)
![G.R. 20 - Sentier de la Corse (de Calenzana à Conca) [4 ed.]
2856990991, 9782856990995](https://ebin.pub/img/200x200/gr-20-sentier-de-la-corse-de-calenzana-a-conca-4nbsped-2856990991-9782856990995.jpg)

![La Corse [3 ed.]
2130443907, 9782130443902](https://ebin.pub/img/200x200/la-corse-3nbsped-2130443907-9782130443902.jpg)