Jacques Leduc, trois pommes à côté du cinéma 2894197349, 9782894197349
Jacques Leduc fait son entrée au cinéma en 1964. Le cinéma direct vient de brouiller définitivement les frontières entre
179 66 3MB
French Pages [175] Year 2020
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Robert Daudelin
File loading please wait...
Citation preview
ROBERT DAUDELIN
JACQUES LEDUC
Trois pommes à côté du cinéma LES HERBES ROUGES / ESSAI
jacques leduc trois pommes à côté du cinéma
du même auteur Lee Konitz. Portrait de l’artiste en saxophoniste, film, production indépendante, 1988. L’œil au-dessus du puits. Deux conversations avec Johan van der Keuken, Les 400 coups, collection « Cinéma », 2006.
ROBERT DAUDELIN
Jacques Leduc Trois pommes à côté du cinéma essai
LES HERBES ROUGES
Les Herbes rouges remercient le Conseil des arts du Canada, le Fonds du livre du Canada ainsi que la Société de développement des entreprises culturelles du Québec pour leur soutien financier. Les Herbes rouges bénéficient également du Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres du gouvernement du Québec. Financé par le gouvernement du Canada.
L’autrice remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre du partenariat territorial Montérégie-Est pour son soutien à l’écriture de ce livre.
© 2020 Éditions Les Herbes rouges Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Bibliothèque et Archives Canada, 2020 ISBN : 978-2-89419-735-6 (pdf)
Pour tous ceux et celles qui ont fait équipe avec Jacques Leduc au cours de ces riches années
1 Une vie en cinéma
Le texte qui suit trouve sa source principale dans neuf entretiens enregistrés avec Jacques Leduc, à son domicile, entre le 24 janvier et le 9 mai 2019 ; les passages en italique dans le texte sont extraits de ces entretiens.
La découverte du cinéma Comme pour tous les adolescents de cette génération, pour Jacques Leduc, le cinéma, c’est le cinéma américain. Déjà cinéphile à quinze ans, il voit trois ou quatre films par semaine, notamment le mercredi après-midi, alors qu’il y a congé d’école. Sa famille habitant alors Ottawa, c’est en version originale anglaise qu’il voit tous ces films, notamment les westerns de John Ford et de Howard Hawks, deux cinéastes auxquels il restera toujours fidèle. Quelques années plus tard, c’est à un film de Hawks, Hatari, qu’il consacrera l’un de ses premiers textes critiques. Le premier film dont je me souvienne, c’est KonTiki 1. C’était dans un cinéma de notre quartier, l’Imperial de la rue Bank ; ma sœur m’y avait emmené. J’ai tellement aimé ça que je suis resté pour la séance suivante et rentré tard à la maison où tout le monde se demandait où j’étais passé. Un des films de cette époque qui m’a beaucoup mar qué, c’est Blackboard Jungle 2 avec Glenn Ford. Le film m’avait bouleversé. Je me souviens être rentré à la maison en disant à mes parents : « Allez voir ce film : c’est très bon ! » Plusieurs années plus tard, alors que j’étais devenu amateur de polars, j’ai découvert Ed McBain, que j’ai beaucoup lu. Or, voulant en savoir 11
plus sur lui, j’ai découvert que McBain était un nom de plume et que son vrai nom était Evan Hunter, l’auteur de The Blackboard Jungle, le livre dont avait été tiré le film. Pensionnaire au Collège Bourget de Rigaud où il termine son cours classique, il découvre le cinéma européen à travers les séances du ciné-club qu’anime Jean Pierre Lefebvre 3. Un des premiers films que j’ai vus au ciné-club, c’était Rome, ville ouverte de Rossellini, qui traitait d’une période de l’histoire dont je ne savais rien… À l’été de 1961, Leduc, à titre de représentant du ciné-club du Collège Bourget, participe au « Stage de cinéma pour les jeunes gens » organisé par le Centre diocésain du cinéma de Montréal, organisme catholique qui coordonne alors l’activité des ciné-clubs dans les collèges. La direction du stage est assurée par deux pères de la congrégation de Sainte-Croix, les pères Blain et Sénécal, qui ont, entre autres adjoints, Jean Pierre Lefebvre. Au nombre des conférenciers invités figuraient le cinéaste Guy L. Coté, dont le nom sera bientôt étroitement lié à la création de la Cinémathèque québécoise, et le jésuite Jacques Cousineau. Au nombre des stagiaires que côtoie Jacques Leduc, on note les noms de Carol Faucher, Richard Gay, JeanClaude Lord, Pierre Maheu, Claude Ménard et Christian Rasselet, qui tous, à un titre quelconque, croiseront son chemin ultérieurement. Ce stage est aussi l’occasion pour le jeune cinéphile de découvrir des films qu’il n’oubliera jamais ; c’est le cas notamment du Septième sceau d’Ingmar Bergman, de Nuit et brouillard d’Alain 12
Resnais et de La pointe courte d’Agnès Varda. En octobre, de retour au Collège Bourget pour entreprendre sa première année de philosophie, il envoie une lettre à la revue Séquences pour dire son enthousiasme vis-à-vis de l’expérience du stage : « Cinq jours à ne penser qu’en termes de cinéma ne peut faire autrement que de nous mener droit au palais de la sagesse… cinématographique 4 ! » À l’automne, à la suggestion de Jean Pierre Lefebvre, désormais étudiant en lettres françaises à l’Université de Montréal, Leduc soumet un texte à la revue montréalaise Objectif. Sa critique de Concrete Jungle de Joseph Losey est publiée dans le numéro de décembre. Comme on pouvait s’y attendre, l’enthousiasme est au rendez-vous, le jeune critique proclamant d’entrée de jeu que « Losey, avec Concrete Jungle, se hisse au niveau des grands auteurs lyriques 5 ». Mais les activités du ciné-club du collège ne répon dent plus au besoin de cinéma qui habite désormais le collégien cinéphile. Détenteur d’une chambre individuelle, comme tous les pensionnaires en fin d’études, il s’en échappe périodiquement pour descendre à Montréal « sur le pouce », retrouver des copains qui l’emmènent au cinéma. Quelques jours avant les examens de fin d’année, les autorités du collège découvrent ces sorties clandestines et il est renvoyé, sans même pouvoir se présenter aux examens, qu’il réussira ultérieurement dans un établissement privé.
Les métiers du cinéma Été 1962, Jacques Leduc est un collégien en vacances qui rêve de cinéma. Le hasard (et son père !) faisant bien les choses, il décroche un emploi d’été à l’Office national du film : J’étais l’assistant du gars qui tenait le registre du département caméra. On prenait note des caméras qui sortaient, des numéros de lentilles, etc. Du coup, j’ai fait la connaissance de tous les caméramen qui travaillaient à l’onf. J’ai même été assistant-caméraman pendant la toute dernière journée de mon contrat : Michel Thomas-d’Hoste devait passer une journée sur un train qui faisait une balade entre Montréal et le Lac-Saint-Jean et il m’a invité à tra vailler avec lui – ce fut ma première job d’assistantcaméraman… En septembre, retour aux études, histoire de terminer le cours classique ; retour aussi à Objectif où, depuis juillet, il fait désormais partie du comité de rédaction 6, y publiant un texte vitriolique sur Seul ou avec d’autres de Denis Héroux, Denys Arcand et Stéphane Venne, produit par l’Association générale des étudiants de l’Université de Montréal. Même Michel Brault et Gilles Groulx, collaborateurs du film dont il admire le travail, n’échappent pas à sa plume déchaînée 7. À Objectif, Leduc se sent chez lui : On se retrouvait entre cinéphiles : on mangeait du cinéma ! Je pouvais 14
aller au cinéma jusqu’à cinq fois par semaine. Nous étions admis aux projections de presse avec les journalistes en titre, y compris celui de The Gazette, qu’on allait bientôt écorcher. On n’était pas toujours tendres avec les films d’ici et plusieurs d’entre nous rêvaient déjà de faire du cinéma… Au printemps 1963, alors qu’il termine sa deuxième année de philosophie à Montréal, au Collège SaintDenis, l’onf propose à Jacques Leduc un emploi d’assistant-caméraman. Il dit oui sans hésiter et « entre » en cinéma, comme on entre en religion, prêt à porter l’équipement, à charger les caméras et prêt, pour quelques années, à courir derrière Jean-Claude Labrecque, Michel Brault, Georges Dufaux, Bernard Gosselin, John Spotton et Gilles Gascon. J’ai beaucoup travaillé avec ce dernier ; c’est même devenu un ami et je me souviens avoir fêté le Nouvel An chez lui plus d’une fois. J’étais notamment son assistant sur La neige a fondu sur la Manicouagan (1965) d’Arthur Lamothe. C’est dans ce film que Gilles Vigneault chante « Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver » pour la première fois. J’ai un souvenir très précis de ce tournage parce que j’y ai connu mon premier (et mon seul) accident d’auto ! C’est moi qui conduisais la familiale avec l’équipement. Claude Pelletier, l’ingénieur du son, voyageait avec moi. C’était l’hiver, la déneigeuse venait de nettoyer la route et avait laissé une sorte de rempart dans un tournant ; j’ai raté le tournant et nous nous sommes retrouvés quatre-vingt-dix pieds plus bas, avec de la neige jusqu’au milieu des fenêtres. Heu reusement, nous avions avec nous les 15
walkie-talkies de la production et on a pu téléphoner à nos camarades, qui sont venus nous sortir de là… Mais je crois que mon tout premier travail d’assistant, ce fut avec Jean-Claude Labrecque sur La vie heureuse de Léopold Z de Gilles Carle. Le film est sorti en 1965, mais le tournage avait débuté beaucoup plus tôt. La production avait besoin de plans d’une tempête de neige sur Montréal et nous avons passé une semaine sur le toit d’un édifice de l’est de la ville à attendre la neige qui ne venait pas… Mais je me trompe peut-être. J’ai aussi travaillé sur Natation de Carle ; Michel Thomas-d’Hoste en faisait la photo et il m’avait demandé de l’assister ; on s’est très bien entendus et il m’a repris comme assistant sur Sire, le Roy n’a plus rien dit que le cinéaste français Georges Rouquier était venu tourner ici, à l’invitation de l’onf : un curieux de film, et un tournage assez curieux aussi… J’ai aussi été assistant de John Spotton sur Nobody Waved Goodbye (1964) de Don Owen, un film tourné à Toronto, en 16 mm. Le travail avec Spotton était très agréable, mais Don Owen, qui était torontois, n’aimait pas beaucoup les francophones et il n’a pas mis mon nom au générique 8. Ça m’a déçu parce que le film est plutôt réussi et qu’en plus, j’étais devenu copain avec Peter Kastner… Pour un jeune qui voulait faire du cinéma, l’onf de ces années-là était un lieu extraordinaire ; c’était la meilleure école de cinéma au monde ! J’y ai appris mon métier avec des gens extraordinaires 9, généreux de leur savoir, et nos rapports étaient toujours impeccables. À l’époque, on tournait beaucoup avec l’Arriflex, une 16
caméra très bruyante qu’on devait insonoriser avec une couverture ; les caméras silencieuses sont arrivées beaucoup plus tard. En 1966, après une dizaine de films comme assistant-caméraman, Leduc devient l’un des deux assis tants du réalisateur Jacques Godbout sur Yul 871 – l’autre est son ami Arnie Gelbart.
La réalisation Chantal : en vrac À l’été de 1966, après avoir été chef opérateur sur Il ne faut pas mourir pour ça de son ami Jean Pierre Lefebvre, Leduc dépose au Comité du programme de l’onf un projet dont il souhaiterait assurer lui-même la réalisation. Fernand Dansereau, qui s’apprêtait à quitter l’onf, travaillait alors à un projet : un portrait de trois femmes, à trois âges différents. Il a lui-même fait le portrait de la femme de quarante ans, Ça n’est pas le temps des romans (1967), avec Monique Mercure ; quelqu’un d’autre devait faire la femme de soixante ans ; et je me suis proposé pour faire la femme de vingt ans. Je n’avais pas de véritable projet : je voulais faire un film ! J’avais besoin de faire un film ! C’était une sorte de « devoir d’école » et l’onf m’a permis de le faire. J’avais préparé un texte qui ne faisait même pas deux pages et dans lequel j’essayais de décrire le film… Thomas Vamos, que Leduc a connu sur le tournage de Yul 871 de Jacques Godbout, en sera le directeur photo. Jacques Kasma, collaborateur de Gilles Groulx sur Le chat dans le sac se chargera du montage. Enfin, comme il faut bien un producteur, c’est Guy L. Coté qui en sera le « producteur adoptif », comme le précise le générique. Nous étions tous influencés par la Nouvelle 18
Vague : le monologue de Chantal sur le quai, en plan séquence, est directement emprunté à Godard. Avec le recul, on s’aperçoit que le film, qui n’est pas réussi pour autant, est traversé par l’esprit du temps, dans son écriture, dans les propos désarticulés des personnages… Le budget est plus que modeste et le tournage rapide : quelques jours dans les Laurentides à la fin septembre 1966, un plan avenue Bernard, le 6 décembre, et c’est terminé. Lee Gagnon, musicien de jazz du Lac-Saint-Jean, bien connu à l’époque, se charge de la musique. Si le texte de présentation de l’onf, signé Jacqueline Saint-Pierre, parle d’une « œuvre qui traduit à un point indicible le désarroi d’une certaine jeunesse », Jacques Leduc, plus prosaïque, déclare à Luc Perreault : « Ce film a été fait en réaction contre tous les films faits à l’onf jusqu’ici 10. » Avec le recul, il affinera sa pensée : « Chantal : en vrac, ce n’est pas un film au sujet d’une jeune fille, c’est un film au sujet du cinéma11. » Ce n’est malheureusement pas ce que comprirent les spectateurs du Festival international du film de Montréal 12 présents à la première mondiale du film, à l’Expo Théâtre, l’après-midi du 15 août 1967. Leduc en témoigne : « Des spectateurs se sont mis à interpeller l’écran et à échanger des dialogues avec les personnages du film. Puis les quolibets, les sifflets et les huées bien senties 13. » Venus voir sur grand écran la blonde chanteuse qui animait alors Jeunesse oblige à la télévision, ils se retrouvent face à un film déroutant (« un film de 45 minutes », précisait le générique), voire agressif. Le malentendu est complet ; Chantal Renaud 19
donne raison aux spectateurs en confiant à la journaliste de La Patrie qu’elle ne correspond pas au personnage : « Je ne suis pas cette jeune femme moderne, indifférente à tous les problèmes tant internationaux que locaux 14. » Et la presse est unanime : Le Droit, Montreal Star, La Patrie, La Presse et Photo-Journal n’ont que du mal à dire du film ; seul André Pâquet, qui couvre le festival pour Le Soleil de Québec, est sensible au caractère dénonciateur du film – on doit pourtant rappeler qu’il apparaît lui-même dans le film… L’écrivain français Dominique Noguez, résidant au Québec au début des années 1970, sera plus accueillant au discours de Leduc en écrivant : « Il ne s’agit en somme que de gagner, par le fou rire, le droit d’être grave et, par la référence à l’Histoire, le droit de ne raconter qu’une histoire sans histoires15. » Cette froide réception ne semble pourtant pas avoir influencé le jury, présidé par Jean Renoir (entouré de Bruno Bozzetto, Christopher Chapman, Beryl Fox, Monte Hellman, Richard Lacroix et Glauber Rocha), qui sacre Chantal : en vrac meilleur film dans la catégorie moyen métrage « pour son modernisme et son caractère critique ». J’étais en bonne compagnie : Jean Pierre Lefebvre, avec Il ne faut pas mourir pour ça (dont j’avais fait la photo), partageait le prix du long métrage avec Allan King, et Pierre Hébert remportait le prix du meilleur court métrage avec Hop Op. C’était la bande d’Objectif qui débarquait ! Baptême du feu un peu rude pour un jeune cinéaste, ce n’est pas ça qui va ralentir Leduc dans son désir de cinéma : au moment où l’on chahute Chantal : 20
en vrac à l’Expo Théâtre, il publie dans l’ultime numéro d’Objectif un texte dénonciateur sur « la télévision considérée comme un divertissement » et termine le montage d’un nouveau film qui était en chantier depuis le printemps 1967. Nominingue… depuis qu’il existe Malgré la réception plutôt fraîche réservée à Chantal : en vrac, l’onf permet immédiatement à Leduc de tourner un second film (du 19 juin au 21 juillet 1967), beaucoup plus long, et qui, en ce qui concerne son sujet à tout le moins (le portrait d’une petite ville), correspond davantage aux habitudes de production de la maison. Mais le modèle est violenté : le noir et blanc et la couleur alternent, comme le documentaire et la fiction. Nominingue… depuis qu’il existe, c’est le film de quelqu’un qui a passé ses vacances à Nominingue ! C’était mon cas : ma sœur avait loué un chalet sur les bords du lac Nominingue et j’étais allé passer une partie de l’été avec elle. C’est un film impressionniste pour lequel je n’avais fait aucune recherche historique. De fait, je me suis limité à enregistrer les témoignages des vieux de la place et ce sont ces témoignages qui tiennent lieu de recherche historique. Or, ils enjolivent parfois les affaires. « Print the legend », dirait John Ford. J’ai récemment projeté le film aux gens de Nominingue et un historien du lieu a pris la parole pour compléter et, au besoin, corriger certaines choses. De fait, c’est un film que je voudrais refaire ! 21
Dans le projet déposé au Comité du programme, j’avais déjà mentionné que le film mélangerait documentaire (en noir et blanc) et fiction (en couleur). J’imagine que je voulais renouveler le genre ! Ironie de ce choix : dans le film, les jeunes sont en couleur, regardent le temps passer et s’ennuient, alors que les vieux, en noir et blanc, regrettent le bon vieux temps. Faut dire qu’être jeune à Nominingue en 1967 n’avait rien à voir avec ce que c’est aujourd’hui. Pour ce qui est de la petite fiction, j’avais proposé le rôle du jeune séducteur à mon ami Denys Arcand et c’est à la suggestion de Guy L. Coté, mon producteur, que je suis allé rencontrer Françoise Sullivan dans un bar de la rue Mont-Royal. Pas trop compliqué comme casting ! Nominingue… depuis qu’il existe fut aussi l’occasion d’une autre rencontre, déterminante celle-là, celle de Pierre Bernier, qui s’attaque au montage du film à l’automne de 1967. Leduc fera équipe avec lui pour une douzaine de films, passera des centaines d’heures avec lui à déplacer des plans et ils deviendront des amis inséparables. L’idée d’équipe, si chère au cœur du cinéaste, s’incarnera d’abord dans la complicité avec son monteur, seule la mort prématurée de ce dernier mettra fin à leur collaboration 16. Nominingue… depuis qu’il existe fut lancé à la Télévision de Radio-Canada le mercredi 25 septembre 1968. Le communiqué de l’onf présente le film comme « un documentaire expérimental d’une forme originale et insolite ». Histoire de rassurer les téléspectateurs, le texte précise que « Jacques Leduc a voulu appliquer à 22
ce genre de film les méthodes qu’il avait déjà employées avec succès lors du tournage de Chantal : en vrac ». Deux jours plus tard, c’est Luc Perreault qui, signant exceptionnellement la chronique « Radio télévision » de La Presse, publie une critique plutôt sévère du film : « Leduc a finalement pondu un de ces petits documentaires style onefien, sans portée sociale, sans valeur esthétique, d’un intérêt tout au plus anecdotique 17. » Même le travail de montage de Pierre Bernier lui semble avoir « été fait à la va comme je te pousse ». Jean-Pierre Bastien et Pierre Véronneau ne seront pas beaucoup plus tendres quelques années plus tard quand ils concluront leur analyse en ces termes : « La principale contradiction de Nominingue… depuis qu’il existe est qu’il évacue le contexte social et économique que nécessiterait le sujet et que l’option de Leduc doit supprimer pour son expression 18. » Il faudra attendre Georges Privet, en 2013, pour s’apercevoir, le recul aidant, qu’il s’agit d’une « réflexion sur le temps et l’espace, où le passé et le présent vivent côte à côte… dans une ville qui se meurt sans même s’en rendre compte. Leduc a 27 ans, et sa vision du monde, ses thèmes et la manière de les articuler s’affirment déjà clairement 19 ». Là ou ailleurs Coréalisé avec Pierre Bernier, à partir d’une idée de Leduc, Là ou ailleurs, si on en croit la fiche publiée à l’époque par l’onf, est « le miroir et la satire de la société moderne et des diverses formes d’oppression 23
qui l’oppriment ». Pour Jacques Leduc, c’est un film « purement impressionniste 20 ». Tourné en avril et mai 1969 au Lac-Saint-Jean avec Réo Grégoire à la caméra et Joseph Champagne au son – ce dernier rentrera à Montréal après quelques jours, les réalisateurs ayant compris qu’ils n’avaient pas besoin de son. (Des sons, il y en aura pourtant beaucoup dans ce film, mais ils seront créés au montage et au mixage.) C’était moi qui avais proposé le projet : mon idée, c’était de faire le tour de la région en une semaine, en faisant de belles images… Un autre projet exemplaire de la liberté dont nous disposions alors à l’onf. Nous avons monté le film ensemble, Bernier et moi, et j’étais toujours dans la salle de montage avec lui. Pierre était un monteur méticuleux (logique, rationnel), qui voulait toujours voir les choses deux fois. Nous étions rapidement devenus amis, en plus nous étions voisins à la campagne et de même force au tennis ! Le film n’a aucun commentaire en voix-off, ou plutôt, c’est la bande sonore (« semi-figurative », disait Leduc) qui tient lieu de commentaire, ce qui n’a pas échappé à Dominique Noguez qui écrivait que : « Son titre pourrait faire croire que ce film de montage sur un coin du Québec est désabusé et comme somnolent. Au contraire, peu de films suggèrent autant une explosion imminente. Renforcée par l’absence de commentaire et par le caractère insolite du montage et du bruitage, l’impression est d’un bouillonnement contenu, d’une rage rentrée et cependant corrosive21. » Tourné en 35 mm et vraisemblablement destiné à une sortie en salle 22, Là ou ailleurs, comme l’a si bien 24
compris Noguez, « est un film-essai, c’est-à-dire un film ouvert (ouvert sur la révolte, mais une révolte menée au nom d’un amour très manifeste de la terre québécoise – témoin ce mélange de sarcasmes muets et de tendresse visuelle). Leduc a sa place auprès de Groulx et de Lefebvre – auprès des cinéastes qui savent dire non 23 ». Beaucoup plus qu’une parenthèse, ou même que l’exercice de style que certains y ont vu, Là ou ailleurs, malgré sa brièveté, est une œuvre forte qui s’inscrit éloquemment dans la filmographie de Leduc et qui, par ce qu’il faut bien appeler son « discours », annonce déjà les grands films qui vont suivre. Ça marche / A Total Service Ce film à part dans la filmographie de Leduc existe en deux versions, française et anglaise, à peu près iden tiques et produites simultanément en 1969. C’était une commande pour faire connaître les services du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration : les fonc tionnaires y vantent leurs bons offices et des industriels disent combien ils apprécient le soutien du ministère, etc. Les commandites gouvernementales emmenaient de l’argent à l’onf et on acceptait, à tour de rôle, d’en faire une. On était libre d’accepter ou de refuser. Je crois me souvenir que c’est Guy L. Coté, mon fidèle producteur, qui m’a suggéré d’accepter de tourner celle-ci en attendant de pouvoir faire un autre film. C’est la seule commandite que j’ai jamais faite. 25
Une fois le film terminé, je suis allé à Ottawa avec Arnie Gelbart projeter le film à un groupe de représentants du ministère : la moitié d’entre eux ont dormi pendant la projection ! Je n’ai aucune idée de l’usage qu’on a fait du film ; ce n’était pas l’onf qui s’occupait de la distribution. Cap d’espoir À l’été de 1969, Jacques Leduc a un nouveau producteur à l’onf : Pierre Maheu, l’un des fondateurs de l’influente revue Parti pris, qu’il a peut-être croisé à Objectif où Maheu vient de publier un texte sur le nouveau film de Jean Pierre Lefebvre, Patricia et JeanBaptiste, et l’esprit « Ti-Pop ». Après le Lac-Saint-Jean, c’est vers la Gaspésie que la caméra de Leduc souhaite se tourner. Le film qu’on connaît n’est pas du tout le film qu’on devait faire… Le projet déposé, et approuvé, consistait à faire le tour de la Gaspésie avec un groupe d’adolescents, l’équipe du film devant s’installer avec eux dans l’autobus qui les baladait. Or, pendant le trajet entre Montréal et Québec, on a vite compris que tout ce dont allaient parler ces jeunes-là, c’était des paysages gaspésiens, mais que rien de la réalité sociale qui se cache derrière ces beaux paysages ne serait présent. On a donc quitté l’autobus à Québec et on s’est dit : on continue par nos propres moyens et on fait ce qu’on voulait faire, ou on rentre à l’onf et on informe notre producteur que le film ne se fera pas. 26
Denis Drapeau, que j’avais connu alors qu’il était un des étudiants qui avaient dirigé l’occupation du cégep de Sainte-Thérèse, était comme notre « agent double » : nous l’avions fait inscrire pour le voyage et il devait agir comme animateur au sein du groupe. À Québec, on l’a fait descendre et on lui a proposé de continuer le film avec nous. On a fait la même proposition à Sylvie Paquette, la jeune femme qui figure périodiquement aux côtés de Drapeau dans le film. À toute fin pratique, on a détourné le projet d’origine, mais en nous disant : on va faire le même périple que l’autobus. On a donc loué une familiale et on est partis pour sept jours, en toute liberté… On composait avec ce qu’on trouvait sur notre chemin : tout était improvisé. La vieille télé, que Denis Drapeau démolit et jette à la mer, était sur le quai – la télévision, comme institution, est régulièrement prise à partie dans le film et ça reste à propos aujourd’hui, mais aujourd’hui, on ne jetterait plus à la mer les morceaux de l’appareil démoli… Tout ici est exagéré. La séquence d’ouverture où Alain Dostie, le directeur photo du film, s’empiffre annonce bien la couleur. Le résultat est un film pamphlétaire qui, au-delà de ces « énormités », traduit bien l’esprit du temps : Il faut voir le film dans son époque, en 1969. Il y a alors un écœurement général et il ne reste que « Mange d’la marde » comme réponse, ce qui me semble bien correspondre au sentiment social de l’époque. Et tous les membres de l’équipe partageaient ces mêmes sentiments vis-à-vis ce qui se passait alors au Québec, ou plutôt vis-à-vis ce qui ne se passait pas. 27
De retour à l’onf avec un matériel peu volumineux, Leduc s’installe dans la salle de montage avec Claire Boyer. Le travail est rapide : « Monté à toute vitesse, les titres filmés à la mitaine sur des cartons, mixé sommairement, le film sortit très rapidement et c’est au visionnement de la première copie zéro que la véritable nature du travail que nous avions fait est apparue et que les problèmes ont commencé. Le patron du labo, Bernie Laroche, qui ne parlait pas français, outré quand il a vu le film, a refusé d’en tirer d’autres copies et s’est empressé de prévenir le bureau du commissaire 24. » L’interdit sera prononcé par le commissaire de l’époque, Hugo McPherson, et ratifié par son successeur Sydney Newman, le motif de « bad taste » étant invoqué. Mais j’étais en bonne compagnie… On venait d’interdire On est au coton d’Arcand et 24 heures ou plus de Groulx. La décision de la haute direction fit des vagues. Rapidement, le film d’Arcand circula sous le manteau. Mais l’interdit des trois films fut maintenu et la controverse durait ; en témoigne un étonnant document interne de mars 1973, signé par Paul Larose, alors producteur à l’onf. Larose y refait l’histoire de la censure dans l’institution et s’arrête, cas par cas, pour essayer de comprendre, mais surtout de contester le bien-fondé de ces décisions. Parlant de Cap d’espoir, il écrit ceci : « Je considère ce film comme un prototype du genre. Il va plus loin que tous les autres de l’époque. C’est un film de fiction réalisé avec des techniques de “candid”. Il interroge par sa subjectivité les choses et les évé nements objectifs. Cap d’espoir, retenu par timidité, 28
à cause de l’atmosphère entière du film qui agace, dérange 25. » Commissaire à la cinématographie et Président de l’onf à compter 1975, André Lamy décida d’autorité de lever la censure sur les trois films en février 1976. Le 17 mars suivant, Cap d’espoir était projeté « en première mondiale » à la Cinémathèque québécoise. André Lamy avait bien compris que le brûlot qu’aurait pu être Cap d’espoir à la fin des années 1960 n’était plus qu’un « pétard mouillé » en 1976 ; l’histoire s’était accélérée au Québec et certains noms qu’on brûlait dans le film étaient déjà oubliés. Restait pourtant, comme Leduc aime le dire avec le recul, « une envie commune de rejeter les contraintes habituelles du discours qu’on entendait, et du cinéma qu’on connaissait 26 ». L’influence de Godard est encore tangible, dans le besoin de provoquer, dans la longueur des plans aussi. Film improvisé, souvent méchant, Cap d’espoir, avec son titre ironique, est un cri qui définit bien le cinéaste quand il déclare à Réal La Rochelle, en 1971 : « Pendant tout le film, on assiste à une espèce de révolte teintée d’un grand désespoir qui s’accroît 27. » On est loin du soleil Quelque part en 1969, Pierre Maheu dépose au Comité du programme de l’onf un texte intitulé « Les quatre grands » dans lequel il propose de consacrer quatre films à quatre héros populaires québécois : Maurice Richard, le frère André, Maurice Duplessis et 29
Willie Lamothe. En octobre 1971, Maheu reprendra son argumentaire à l’occasion d’un entretien avec son collègue Jean-Yves Bégin ; il y déclare notamment : « C’est une sorte de catharsis […]. Il s’agit en somme de ressortir la vieille culture canadienne-française au sujet des grands hommes. Ce sont des représentants d’une culture maintenant morte, dépassée – mais dans quelle mesure l’est-elle tellement ? » Gilles Gascon (avec qui Jacques Leduc a appris son métier), qui vient de réaliser Québec en silence, un portrait du peintre Jean-Paul Lemieux, parlera de Maurice Richard (Peut-être Maurice Richard, 1971) ; Denys Arcand, historien de formation, célébrera Duplessis (Québec : Duplessis et après…, 1972). Restent le frère André et Willie Lamothe, deux « grands » sur mesure pour Jacques Leduc. Le frère André, c’est mon choix. Mais j’avais prévenu Maheu que je ne ferais pas une biographie du frère André : il fallait trouver une autre façon de parler du frère André. J’ai donc demandé à travailler avec un scénariste, Pierre Tremblay, qui a été associé au projet très tôt. Pour la première fois dans mon travail, il y a un vrai scénario qui précède le film. Et c’était très clair, avant même de démarrer le tournage, que le film serait fait à partir d’une approche bien définie. Comme je l’ai déjà dit, nous étions tous influencés par la Nouvelle Vague, qui avait changé la façon de faire des films. Le générique de On est loin du soleil est constitué d’une liste de noms, par ordre alphabétique, sans mention de fonctions, ce qui correspond à l’idée chère à Leduc qu’un film est le résultat d’un travail d’équipe. 30
Je peux toujours écrire dix lignes, annonçant ce que je souhaite faire, mais après ça, je dois travailler en équipe. Je n’ai jamais travaillé autrement. C’est ce que ce générique veut dire : ce que vous allez voir, c’est le travail de l’équipe suivante. Le film s’ouvre sur un fond noir et la voix de Leduc (pour échapper à la voix trop belle d’un professionnel) qui résume la biographie d’Alfred Bessette, un homme d’origine modeste, devenu célèbre sous le nom du frère André. Ce sont les qualités particulières à cet homme qui vont s’incarner tout au long du film dans les six membres d’une famille québécoise modeste. Film d’une écriture rigoureuse (noir et blanc, plans séquences, silences, parenthèses documentaires), On est loin du soleil n’en est pas moins un film d’émotions 28 qui atteint son but notamment par une distribution de premier ordre. C’est moi-même qui étais responsable du « casting », la fonction n’existait pas encore dans le cinéma québécois. Marthe Nadeau et J.-Léo Gagnon étaient connus comme couple ; ils avaient déjà joué ensemble à quelques reprises. C’était le premier rôle d’Esther Auger, qui est formidable. J’ai rencontré tous les comédiens avant le tournage, mais il n’y a pas eu de « screen test ». Et il y a aussi des « caméos » : Denis Drapeau, héros de Cap d’espoir, est très convaincant en ouvrier, comme Claude Jutra en médecin. Quant à Willie Lamothe, qui est le gardien de nuit, collègue du père de la famille, c’était un ami de Lucien Ménard, le régisseur du film ; c’est Lucien qui nous l’a suggéré, et c’est sa « performance » qui m’a convaincu qu’il y avait un film à faire avec lui. 31
L’émotion tient aussi au poids des lieux éclairés par Alain Dostie : les corridors du Collège Bourget (bien connus de Leduc), l’Orphelinat Saint-Arsène, le bureau de l’Assurance chômage, le coin salle à manger de l’usine, la cuisine familiale, tous ces lieux définissent les personnages et, par addition, deviennent un seul lieu : la société québécoise de l’époque. Le film est en noir et blanc, à l’exception d’un plan en couleur qui surprend et dont on cherche le sens : les fossoyeurs (Leduc et Dostie) recouvrent de terre le cercueil de la jeune fille de la famille et cette couleur soudaine vient nous ramener brutalement à notre réalité, celle d’un Québec toujours réel qu’incarnait, dans toutes ses contradictions, le bon frère André. Bien que travaillant désormais en fiction, Leduc ne remise pas son héritage documentaire au vestiaire : la séquence de la salle de jeux des petits orphelins est bien là pour nous le rappeler. Les petits garçons filmés ne tiennent aucunement compte de la caméra qui les observe dans leur quotidien le plus ordinaire – comme dans un documentaire ! La scène en question n’était évidemment pas dans le scénario ; elle s’est présentée à nous et nous avons décidé de l’intégrer au film. Tournage rapide (du 22 juin au 31 juillet 1970) et sans histoire, avec une équipe d’amis, qui se poursuit avec une période de montage relativement courte. J’étais toujours aux côtés de Pierre Bernier dans la salle de montage. Connaissant bien le matériau, je pouvais, par exemple, lui suggérer d’aller chercher un plan ailleurs pour équilibrer une séquence. Ça n’a pas été un travail très long, contrairement à ce qui se passe avec un 32
documentaire où tu dois composer avec un matériel volumineux, ce qui n’était absolument pas le cas avec On est loin du soleil. La sortie en salle tarde et en juin, Leduc peut reprendre son rôle de chef opérateur pour Ultimatum de Jean Pierre Lefebvre. On est loin du soleil est enfin lancé le 15 septembre 1971, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle saison de la Cinémathèque québécoise, puis projeté à Sherbrooke quelques jours plus tard 29. À la fin de ce même mois, Leduc accompagne le film en Abitibi (Val-d’Or, Senneterre, Rouyn). Les droits de distribution ayant été acquis par la société Faroun Films, On est loin du soleil prend enfin l’affiche à Montréal, dans les Cinémas du Vieux-Montréal, rue Saint-Paul, le 24 décembre 1971. André Leroux, dans Le Devoir, parle d’un film « d’une poésie stupéfiante, d’une densité peu commune, d’une écriture éblouissante », alors que Robert Lévesque, dans Québec-presse, donne longuement la parole à Leduc pour inciter ses lecteurs à aller découvrir le film. Jean Pierre Lefebvre, pour sa part, avait déjà pris de l’avance en écrivant un long texte dans Cinéma/Québec dans lequel il proclamait que : « On est loin du soleil marque, à l’intérieur du cinéma québécois, une date aussi importante que celle du Chat dans le sac 30. » (Il reviendra à la charge dix ans plus tard pour dire toute son admiration pour le film, dans la revue Format Cinéma.) Rapidement, le film trouve une reconnaissance à l’étranger : dès décembre 1971, il fait partie d’une Semaine du nouveau cinéma canadien à Lausanne et 33
dans le Jura suisse ; du 3 au 14 février, le film fait partie du programme de New Cinema from Quebec, préparé par Laurence Kardish pour le Museum of Modern Art de New York ; au même moment, il est projeté à Poitiers, dans le cadre des Journées du cinéma canadien ; en avril, c’est le Festival international d’art contemporain de Royan, en France, qui invite le film ; en mai, il est projeté au San Francisco Museum of Modern Art ; en juillet, il est invité au Festival international d’expression française de Dinard et, enfin, en novembre, il est sélectionné pour le Challenge international des cinémas d’art et d’essai de Benalmádena (Espagne). En 1979, toujours d’actualité, On est loin du soleil sera programmé à la Télévision de Radio-Canada, dans le cadre de l’émission Cinéma onf, animée par Claude Jutra. Enfin, en octobre 1980, il fait partie de la rétrospective que la Cinémathèque française consacre au cinéma québécois. Ultime bémol… Ce film, unique dans notre cinématographie et véritable début de la filmographie de Jacques Leduc, n’est pas mentionné dans le Dictionnaire des films québécois de Marcel Jean paru en 2014. Je chante à cheval avec Willie Lamothe À l’été 1971, le projet de Pierre Maheu de célébrer « les quatre grands » est très avancé : le film de Gilles Gascon sur Maurice Richard est terminé ; Arcand tourne son Duplessis ; Leduc prépare la sortie de son Frère André ; restait Willie Lamothe, qui était déjà au courant 34
qu’on voulait faire un film sur lui. Or, Lucien Ménard, qui avait été régisseur sur Cap d’espoir et On est loin du soleil, était copain avec Willie ; il était donc tout désigné pour faire le film. Mais pour l’onf, Lucien n’était pas un réalisateur ! J’ai donc accepté d’être associé au projet pour qu’il se fasse. Ceci étant dit, je n’ai pas pris beaucoup de décisions au tournage : certains jours, je n’étais même pas au tournage. Ainsi je n’étais pas présent quand a été tourné l’entretien avec Willie dans son jardin. Par contre, j’étais aux côtés de Pierre Bernier tout au long du montage. Tournage léger, s’il en fut : jamais plus de trois personnes pour suivre le chanteur dans ses pérégrinations. Nous avons filmé Willie dans toutes les situations possibles : chez lui, en spectacle, sur un plateau de télévision, au volant de sa grosse voiture quand il part en tournée. Willie était en confiance ; il jasait avec des amis. Ce n’était pas intimidant : on n’éclairait même pas… Bien qu’on y sente un côté un peu bricolé, Je chante à cheval avec Willie Lamothe est un portrait réussi ; même Pierre Hébert y collabore en animant les joyeux dessins de Vittorio Fiorucci. Véritable héros de la culture populaire, Lamothe y est foncièrement attachant et le film évite le piège de la caricature qui assurément guettait les cinéastes. Tendresse ordinaire Fin mars 1972, à Notre-Dame-du-Portage, Jacques Leduc démarre le tournage de Tendresse ordinaire. Un 35
film intimiste qui ambitionne de mettre en scène l’attente et le temps qui s’étire n’en est pas moins tourné en 35 mm. C’est le fidèle Alain Dostie qui relève le défi de trouver un espace adéquat pour la grosse caméra dans la maison de campagne qui va servir de décor au film. C’est Alain qui a tout filmé : les intérieurs à NotreDame-du-Portage, le train, les paysages de la Côte-Nord, tout ! Guy Rémillard l’aidait pour les éclairages, mais nous éclairions minimalement, seulement quand c’était absolument nécessaire. Il n’y a pas de tournage en studio : nous avions loué une maison et tout y a été tourné. Il y a maintenant une affiche devant cette maison qui dit : « Le film Tendresse ordinaire a été tourné ici. » Le film a été scénarisé par Robert Tremblay, mais beaucoup d’éléments viennent de souvenirs de Leduc. Mon frère aîné avait travaillé à déboiser la forêt pour permettre l’installation des pylônes électriques ; il avait alors passé beaucoup de temps à Schefferville pendant que sa femme, elle, l’attendait ailleurs. Cette histoire de mon frère m’était restée en mémoire et c’est peut-être de là que m’est venue l’idée du film. Ce qui est clair, c’est que je voulais faire un film sur l’attente. Cette femme qui attend le retour de son mari pendant que s’étire l’hiver, c’est Esther Auger, à nouveau bouleversante, totalement identifiée à son personnage ; lui tient compagnie, tentant de meubler son attente, une amie plus âgée, Luce Guilbeault, dans l’un de ses plus beaux rôles, tout en subtilités, en non-dits. L’un des moments les plus étonnamment magiques de cette amitié, c’est la fabrication (presque en temps réel) d’un gâteau « tout simple ». J’avais décidé dès le départ 36
qu’on devait voir la fabrication du gâteau au complet. Luce et Esther ont fait le gâteau une première fois pour qu’Alain et moi puissions voir quand il y avait des temps morts pendant lesquels on pourrait couper. Il fallait aussi décider où on pourrait placer la caméra – on tourne en 35 mm, la caméra prend beaucoup de place. Après ce premier gâteau, on recommence et on tourne tout, d’un seul trait ! Dans cette scène, comme dans plusieurs autres, le film fonctionne comme un documentaire. C’était malgré nous. Le documentaire, c’est notre héritage et on ne peut pas s’en défaire. Ainsi, on laissait souvent filer et le plan tourné est beaucoup plus long que celui qu’on voit dans le film fini. C’est le cas du plan où Jocelyn décrit la Côte-Nord à sa femme en utilisant des cartes d’état-major qu’il a étendues sur le sol ; c’est un plan qu’on a beaucoup raccourci. La séquence du voyage en train a aussi une qualité documentaire, bien que les acteurs y soient très présents. C’était le train régulier, qui va de Schefferville à Sept-Îles. Nous n’avions pas loué de wagon ; on s’est installés parmi les voyageurs tout bonnement, sans déranger. Plume Latraverse était là pour mettre de l’atmo sphère ! Et J.-Léo Gagnon est descendu de Montréal pour faire le voyage avec nous. Je trouve que Jocelyn Bérubé a une très belle présence : on sent bien son personnage, sa discrétion, sa réserve par rapport aux autres qui voudraient faire les fous un peu… Tout s’est fait en un seul voyage et J.-Léo est reparti pour Montréal. Je n’ai que de bons souvenirs de ce tournage, un tournage relativement court (février-mars 1972), facile. 37
Même la séquence finale où Esther tourne en rond, comme un animal en cage, qui était une scène difficile techniquement, ne nous a pas compliqué la vie. J’avais une confiance absolue en Dostie : notre complicité nous permettait de travailler sans avoir besoin de beaucoup discuter. Il connaissait l’espace de la maison par cœur ; il pouvait intervenir, faire des suggestions. Même chose avec Luce et Esther : nous parlions beaucoup durant les repas, de l’attente de cette femme seule dont le mari est à des centaines de kilomètres, et le film se précisait. Rentré à Montréal, Leduc s’installe dans la salle de montage avec Pierre Bernier pour plusieurs semaines. La production demande que le montage final soit prêt fin octobre, de manière à avoir une copie zéro à la fin novembre. La première de Tendresse ordinaire aura finalement lieu le 3 avril 1973, à Sherbrooke, au Kiné-art du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, en présence de Luce Guilbeault, Esther Auger et Leduc. La Tribune, le journal du lieu, fait bon accueil au film, sous la plume de René Berthiaume. Dans la semaine qui suit, le film est présenté trois fois au Ciné-Campus de Trois-Rivières et bien accueilli par Le Nouvelliste. Et ça se poursuit, à Chicoutimi, Rimouski, Québec et Montréal (au cinéma Outremont), souvent en présence de Pierre Bernier, Alain Dostie et Leduc. Le film recueille de bonnes critiques dans Le Soleil de Québec et dans Québec-presse où Robert Lévesque n’hésite pas à écrire : « Tendresse ordinaire, comme On est loin du soleil, est un cas à part dans le cinéma québécois.
38
Tous les deux sont l’œuvre d’un de ses cinéastes les plus originaux et les plus personnels. S’ils sont encore difficiles d’accès pour le grand public, la faute n’en est pas à Leduc. Leur simplicité en déroute plusieurs pour qui le cinéma, ce n’est pas la vie. Pourtant… » RobertClaude Bérubé est également enthousiaste et proclame sans ambages : « Le voilà le vrai film d’avant-garde qui va à contre-courant, en dehors de toutes les modes 31. » Seul l’inénarrable Robert Guy Scully fait bande à part et pourfend le film au moyen d’un très long texte dans Le Devoir pour expliquer « L’échec de la Tendresse ordinaire ». Même Variety publiera une critique du film dans son édition du 25 avril. Quelques mois plus tard, dans le cadre des échanges franco-québécois, le Conseil québécois pour la diffusion du cinéma et le groupe culturel français ATAC concluent une entente grâce à laquelle vingt films québécois, courts et longs métrages, seront diffusés en France d’octobre 1974 à la fin janvier 1975. Tendresse ordinaire est du programme et sera projeté notamment à Grenoble, Valence et Lyon, en présence de Leduc dans cette dernière ville. En février-mars 1975, c’est au tour de la Belgique d’accueillir des Journées du cinéma québécois dans lesquelles figure de nouveau le film. Sélectionné pour le très prestigieux « New Directors / New Films » du Museum of Modern Art de New York d’avril 1974, Tendresse ordinaire a droit à une critique très élogieuse de Vincent Canby, dans le New York Times du 6 avril. Le 14 du même mois, le film sera présenté à la télévision, dans le cadre de l’émission
39
Ciné-Club de Radio-Canada. En novembre, il est sélectionné par le Edinburgh International Film Festival. En juin 1978, Laurence Kardish, programmateur du Department of Film du MoMA de New York et grand défenseur du cinéma québécois, revient à la charge avec le grand cycle Cinéma québécois 19721978 : Tendresse ordinaire y est projeté le même jour que… Chronique de la vie quotidienne. L’un et l’autre film font l’objet d’une critique très favorable de Terry Curtis Fox dans The Village Voice. Alegria À peine terminé le montage de Tendresse ordinaire, Jacques Leduc s’attèle à un projet beaucoup plus sage : le portrait, tout en silences, d’un retraité qui fabrique des guitares classiques dans son sous-sol. Frederick Anders travaillait à l’onf, dans les services techniques. Je le croisais à la cafétéria et on partageait parfois un café. J’avais aussi découvert que, de temps en temps, il allait fumer un joint dans sa Volkswagen qui était dans le stationnement ; c’est comme ça que nous avons fait plus amplement connaissance et que j’ai appris qu’il faisait des guitares durant ses heures libres. J’ai tout de suite compris qu’il y avait un film là ! Nous sommes débarqués chez lui (à Pierrefonds), tout au long de juillet 1972, et l’avons filmé au travail, avec ses gestes d’une précision magnifique. Je crois me souvenir que le film a été fait d’une seule traite, 40
sans doute en utilisant plusieurs guitares qui étaient à des étapes différentes de leur fabrication. Encore une fois, ce petit film illustre bien le genre de liberté dont on bénéficiait à l’onf à cette époque. Un retraité qui fait des guitares dans son sous-sol… est-ce vraiment un sujet de film ? C’est bien mon avis, et on me laisse faire le film ! En revoyant un film de ce genre, en retrouvant le personnage si attachant de Fred, je me demande toujours : « Où sont passés tous ces gens que j’ai filmés ? » Plusieurs sont morts, assurément. Reste leur image. C’est une question qui me poursuit… Alegria est un film qu’on oublie souvent d’inclure dans la filmographie de Jacques Leduc, comme si, à l’image de son protagoniste, il était trop discret. Filmé presque furtivement par Réo Grégoire, qui sait toujours se trouver un coin dans le sous-sol de Fred, sans déranger, le film avance selon son propre souffle, sans qu’aucun commentaire soit nécessaire à notre compréhension des gestes de l’artisan. Une fois la guitare terminée, c’est un autre cinéaste, l’animateur Laurent Coderre, qui vient en tirer quelques beaux accords suffisamment éloquents pour qu’on entende enfin la voix de Frederick Anders : « Not bad. » Chronique de la vie quotidienne Après deux films de fiction considérés par plusieurs comme des œuvres majeures du cinéma québécois, Jacques Leduc revient au documentaire avec un 41
projet ambitieux dont le titre, Chronique de la vie quotidienne, est explicite. C’est un saut délibéré. Au milieu des années 1970, on filmait des têtes parlantes pour la télévision. Mais où était donc passé le cinéma direct des années 1960 ? C’est cette réflexion qui m’a emmené à proposer à Jacques Bobet de faire un long documentaire de six heures. Chronique de la vie quotidienne fera finalement quatre heures quarante. On a tourné pendant près de dix mois et on s’est retrouvés avec plus de cent heures de matériel en 16 mm. Pierre Letarte, un directeur photo qui sera étroitement associé à la dernière étape de la carrière de Leduc, insiste pour dire que le projet est né d’une soirée mémorable à l’hôtel d’Hemmingford : le Grand Roméo y donnait un spectacle d’hypnotisme auquel Pierre Bernier avait invité ses amis Leduc et Letarte32. Si Leduc confirme la présence de Bernier dès la conception du projet, il apporte néanmoins quelques précisions : C’est moi qui ai fait un court texte – moins de trois pages – que je suis allé présenter et défendre au Comité du programme de l’onf. J’avais apporté avec moi la bouteille de petit format dans laquelle on achetait la crème à l’époque ; je l’ai posée sur la table et j’ai dit : « Je veux faire un film sur ça ! » Et le projet a été très bien accueilli… Si cette version des faits est fidèle à l’esprit de la démarche, la lettre est légèrement différente ; dans un texte de présentation de 1973, Leduc est relativement précis dans ses intentions : « J’aimerais qu’on me permette de rattraper quelques signes de ces temps qui courent. J’aimerais pouvoir m’appliquer, 42
avec minutie, lentement, pendant les cent cinquante jours que durera le tournage, à mettre sur film, en compagnie de quelques compagnons de travail qui s’enthousiasment pour le projet, selon une méthode qui se rapproche du documentaire, des notes, rien de plus, au gré des jours et de l’inspiration quotidienne que chacun à sa manière amène. J’aimerais filmer ces notes et les réunir, ultimement, dans un corpus de six heures, constitué de fragments de diverses longueurs et à être distribués dans n’importe quel ordre ou au gré des demandes et des affinités de programme 32. » Le travail d’équipe, célébré tant et plus par Leduc, semble avoir trouvé dans ce projet son terrain d’élection. L’équipe dont on va retrouver les noms (Jean Chabot, Gilles Gascon, Roger Frappier) aux généri ques des sept films de Chronique de la vie quotidienne existe déjà, en bonne partie, au moment où Leduc dépose le projet au Comité du programme. Nous étions plusieurs à nous poser les mêmes questions quant à la disparition des documentaires et on avait discuté du projet, avant même que j’aille en parler à Bobet. Une fois le projet accepté, on nous a donné une salle de montage au sous-sol de l’onf. C’est devenu notre atelier, notre permanence : salle de réunions, lieu de travail, lieu de rencontres. On y passait tous régulièrement et tous les collaborateurs s’y retrouvaient une fois par semaine pour une réunion de discussion, de planification34. On identifiait des sujets ou des événements susceptibles de nous intéresser : des femmes qui travaillent dans une conserverie, un déménagement dans un quartier populaire, une journée à Blue Bonnets, 43
etc. Il y avait tellement de sujets à explorer ! On était fébriles… Il n’y avait pas de hiérarchie dans le groupe. On jetait les sujets sur la table et celui qu’un sujet intéressait partait le tourner. On ne demandait pas le vote ! C’était un travail de camarades. Inutile de dire que, moi qui adore le travail en équipe, ce mode de fonctionnement me convenait tout à fait. Je tenais Jacques Bobet régulièrement informé de ce que nous faisions, comment ça se passait : nos rapports étaient très cordiaux, amicaux même. Une équipe qui partait tourner, c’était toujours trois personnes. On débarquait dans un lieu et on tournait « à chaud ». D’ailleurs, de temps en temps, on voit un micro apparaître dans un plan ; on a gardé ces plans-là : ils disent la présence de l’équipe. Notre rapport de tournage était entre 10 et 15 pour 1. Pierre Perrault avait droit à du 20 pour 1. Dans notre cas, c’était plutôt 10 ou 12 – 15 pour 1, c’était limite, limite. Le budget avait fait l’objet d’un débat au Comité du programme. Notre argumentaire, c’était de dire : « Nous allons faire six heures de films qui ne coûteront pas plus cher à l’onf que la production normale d’un seul documentaire ! » C’est la secrétaire-comptable de Jacques Bobet qui veillait au budget. Un jour, elle m’a convoqué pour me dire qu’il fallait être prudent, que ça commençait à être « serré »… Je me suis jeté par terre et j’ai roulé sur moi-même, puis je me suis rassis sur ma chaise. Ce fut la fin de notre conversation.
44
Quand Jacques Bobet a eu vent de ça, il a trouvé ça très drôle ! On avait donc carte blanche. On avait devant nous neuf mois de tournage. Il y avait toujours une équipe en « stand-by » et toujours une caméra et une voiture familiale à notre disposition. Alain Sauvé, qui jusque-là était assistant-monteur, a hérité de la tâche de monter cet énorme matériel. On avait cent dix heures de matériel. J’ai moi-même réduit ça à plus ou moins trente-cinq heures, puis je me suis installé avec lui dans la salle de montage, tous les jours, pendant dix-huit mois. D’ailleurs, il est important de comprendre que c’est au montage que les sujets, et ultimement le « chapitrage » par jour de la semaine, sont apparus. Bobet était très enthousiaste ; il voyait les films un à un, à mesure qu’ils étaient montés. Mais la salle de montage est restée un lieu de rencontres. À certains moments, nous étions quinze dans la salle de montage : tout le monde venait y faire son tour. Il y avait même un backgammon dessiné sur la table de réunion. Comme cette salle était au sous-sol, non pas à l’étage avec les autres salles de montage, nous étions totalement indépendants. Pour Samedi : « Le ventre de la nuit », qui prenait des allures de long métrage, c’est Fernand Bélanger qui a pris la relève. J’avais mis de côté le matériel qui me semblait nécessaire au film, mais Fernand voulait voir plus que ça, aller fouiller dans les boîtes empilées dans la salle de montage. Il a effectivement visionné beaucoup plus que ce que j’avais mis de côté pour cet
45
épisode. Il avait une façon très personnelle de regarder le matériel : il y trouvait toujours des choses que tu n’avais pas vues, qui t’avaient échappé complètement. Travailler avec Fernand Bélanger, c’était comme travailler avec un poète. C’était ma décision de lui confier le Samedi, qui a un souffle très particulier, différent de tous les autres films de la série. C’était un long métrage, une gageure différente qui supposait une approche différente. Chronique de la vie quotidienne était un projet qui s’était développé au fur et à mesure. L’esprit de notre démarche, comme je l’ai déjà dit, c’était de retrouver le cinéma direct, de le renouveler. Arrêtons de filmer des champs-contrechamps et allons filmer comme on filmait dans les années 1960 : notre motivation était là. À cheval sur l’argent, avec sa description de l’intérieur d’un après-midi à Blue Bonnets, est un film de cinéma direct, comme ceux que nous tournions dans les années 1960. J’aime beaucoup Les chars aussi, peutêtre parce qu’il a été tourné dans un garage près de l’onf : les gens du garage nous connaissaient tous ; ils nous ont même fait une place pour tourner. Dans l’ensemble de mon travail, Chronique de la vie quotidienne, c’est l’une des choses dont je suis le plus fier. J’aime bien la qualité « archives » de ces films : dans cinquante ans, on regardera ces films et on saura comment vivaient les Québécois dans les années 1970. Les 9 et 10 mars 1978, Chronique de la vie quotidienne est projeté en avant-première à la Cinémathèque québécoise, en deux parties et en présence de Jacques Leduc. Le 14, le film est projeté d’un seul trait 46
au cinéma Outremont. Jean-Pierre Tadros consacre un long texte au film dans Le Devoir. Ron Burnett lui consacre une analyse dans le numéro printemps-été de la revue montréalaise anglophone Ciné-Tracts. En juin, comme déjà mentionné, le film est projeté au Museum of Modern Art de New York ; le critique du Village Voice y voit « among the most important movie events of the series ». En octobre, il est sélectionné au festival Visions du Réel de Nyon (Suisse) et y remporte le Prix spécial du jury pour « le courage, la vision et la liberté d’expression d’une réalisation hors des conventions et des structures traditionnelles ». Malgré une distribution timide, Chronique de la vie quotidienne continue à faire son chemin : en octobre 1980, le film est présenté à la Cinémathèque française dans le cadre de la grande rétrospective du cinéma québécois déjà mentionnée ; en novembre, il est projeté d’un seul trait et en présence de Leduc dans le cadre du Grierson Documentary Seminar à Niagaraon-the-Lake – le cinéaste américain Les Blank et le cinéaste belge Boris Lehman sont parmi les spectateurs enthousiastes. Enfin, le 19 février 2012, dans le cadre de la 30e édition des Rendez-vous du cinéma québécois, la Coop Vidéo organise un hommage à Jacques Leduc qui comprend la projection intégrale de Chronique de la vie quotidienne et une rencontre publique avec Leduc, animée par Georges Privet et à laquelle participent les cinéastes Louis Bélanger, Robert Morin et Pierre Letarte. D’entrée de jeu, Robert Morin déclare que, selon lui, Chronique « est le film le plus représentatif 47
de l’époque ». Filmée par les soins de la Coop Vidéo, la rencontre fera l’objet d’un DVD intégré au livre que Georges Privet consacrera à Leduc quelques mois plus tard. Film unique dans l’histoire du documentaire québécois et film qu’on redécouvre périodiquement, l’im portance de Chronique de la vie quotidienne est bien résumée par Marcel Jean quand il écrit : « [U]n monumental exercice de modestie cinématographique : filmer la quotidienneté, consacrer un grand cycle à la vie telle qu’elle se présente à la caméra, sans sujet prédéterminé, sans le support du commentaire ni celui des artifices de mise en scène […]. Le résultat est à la fois d’une grande liberté et d’une étonnante qualité méditative35. » Petite parenthèse Les 23 et 24 septembre 1979, avec ses amis Jean Chabot et Francine Allaire, Leduc participe aux Journées de Bruxelles consacrées au cinéma documentaire. Il y retrouve Boris Lehman et Johan van der Keuken, qu’il avait connus lors de leur passage à Montréal, et fait la connaissance de Frederick Wiseman, Richard Dindo et Nicolas Philibert. Mais surtout, il se lie d’amitié avec le cinéaste français Gérard Guérin, dont le film Lo Païs l’avait enthousiasmé. Nous faisions un cinéma assez semblable. Nous avons donc décidé de travailler ensemble et l’onf a accepté de s’associer à
48
une coproduction franco-canadienne qui serait réalisée par Guérin et moi. Je suis parti en France à l’automne de 1979 avec un assistant, René Pothier. Pendant plus ou moins trois mois, j’ai passé toutes mes matinées chez Guérin à travailler au scénario ; l’après-midi, j’allais au cinéma. Or, dès le premier jour de tournage, je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucune place pour moi là-dedans : je ne pouvais même pas regarder dans le viseur. C’était le film de Guérin, point à la ligne ! J’ai claqué la porte et suis rentré à Montréal avec Pothier. Un vrai flop ! L’onf s’est retiré de la production. Je n’ai jamais vu le film et jamais revu Guérin. On m’a dit que mon nom est au générique comme coscénariste… Pendant son séjour parisien, bien qu’il ait touché un salaire de la production et non pas directement de l’onf, Leduc n’en demeurait pas moins un employé permanent de l’Office. Dès son retour à Montréal, JeanMarc Garand insiste pour qu’il se remette au travail sur un nouveau projet. À l’été 1981, tout en rêvant d’un nouveau film, Jacques Leduc convainc un groupe d’amis, cinéastes et gens de cinéma en tous genres, de publier un tabloïd bimensuel. Format Cinéma publie son premier numéro le 1er juin 1981 ; c’est Leduc lui-même qui signe le texte de présentation, dans lequel il explique la nécessité d’une telle publication : « Dû à la démobilisation générale, dû à l’effritement de la solidarité indispensable pour affirmer un cinéma libre, affranchi des idées toutes faites et des routes pavées de l’acculturation, dû à
49
l’absence de lieu où réunir les voix diverses de l’opposition. » Format Cinéma, boîte aux lettres d’un milieu en pleine évolution, souvent provocateur, publiera les textes de plusieurs dizaines de cinéastes. La préparation des numéros sera l’occasion de nombreuses réunions au domicile de Leduc, réunions qui souvent se prolongeaient en des soupers tardifs concoctés par le maître des lieux. Aventure unique dans la petite histoire du cinéma québécois, Format Cinéma publiera son dernier numéro (le no 48) le 15 avril 1986 ; on y retrouve les signatures de Pierre Falardeau, Michel Euvrard, Thomas Waugh et… Jacques Leduc. Albédo Le 15 septembre 1982, dans le no 19 de Format Cinéma, Jacques Leduc rappelle l’origine d’Albédo : « C’est une histoire de “chien écrasé”, un vieux journal de fin de semaine retrouvé parmi les projets oubliés, une page un peu jaunie depuis le temps, quelques photographies devenues illisibles et un article “d’intérêt humain”. » J’ai des dossiers dans lesquels j’accumule les coupures de presse ; c’est là que j’ai retrouvé une entrevue avec David Marvin. Mais Marvin était décédé et le Montreal Star n’existait plus. À force de chercher, j’ai retrouvé le journaliste qui avait fait l’entrevue et le directeur de la galerie où j’avais vu les photos de Marvin. Enfin, j’ai rencontré son fils et l’ai photographié au bowling où il travaillait. 50
Renée Roy, qui avait été productrice déléguée sur La cuisine rouge de Paule Baillargeon et Frédérique Collin, était alors sous contrat à l’onf, collaboratrice de Raymond Brousseau sur Un Québécois retrouvé. Jacques Bobet, qui avait gardé des relations très amicales avec Jacques Leduc et souhaitait le voir réaliser un nouveau film le plus rapidement possible, prit sur lui de lui proposer la collaboration de Renée Roy. C’était une amie, puis, comme je le dis sans arrêt, j’aime travailler en équipe, il me semblait donc intéressant d’attaquer un tel sujet à deux voix. Je connaissais Griffintown pour y avoir habité pendant un an, après avoir quitté la campagne ; nous étions donc sensibles au caractère très particulier du quartier et sa présence se devait d’être prioritaire. Le 9 novembre 1981, premier jour de tournage d’Albédo 35, Leduc envoie une carte postale à ses camarades de Format Cinéma dans laquelle il avoue tenter de « faire autour de soi le vide de la vie quotidienne pour mieux en retirer les fines entournures, s’aménager une tranche de temps pour plonger dans le monde onirique du cinématographe et se refaire une chronologie 37 ». Albédo est un film très construit dans lequel, audelà de la forme documentaire dominante, la présence de la fiction est très importante. Il y a ici un va-et-vient permanent entre fiction (la balade des amoureux, la vie de famille de David Marvin) et documentaire (l’histoire d’un quartier populaire). C’est le personnage de David qui fait le lien entre le documentaire et la fiction : lui, il a arpenté Griffintown de part en part ; il 51
connaissait le quartier mieux que quiconque ; il en a même été l’archiviste. Albédo est aussi un film sur la photographie, un art que Leduc pratiquera abondamment tout au long de ces années. En 1975, à l’invitation de Françoise Picard, j’ai siégé à un jury du Conseil des arts du Canada ; j’y avais comme collègue Robert Frank dont je connaissais le travail et que j’admirais beaucoup. Or, un jour, il sort de sa poche un petit appareil Minox et prend la photo du jury en étirant son bras en l’air, sans même regarder ce qu’il photographiait… Je venais de voir au travail un des grands photographes du xxe siècle ! Une fois rentré à Montréal, je me suis précipité dans un magasin de photo pour m’acheter un Minox. C’est comme ça que j’ai commencé à faire de la photo. Aujourd’hui, j’ai quelque mille trois cents planchescontacts bien rangées chez moi. Il y a dans Albédo une stylisation, à la fois dans le jeu des comédiens – notamment chez Jean-Pierre Saulnier qui interprète David Marvin – que dans les décors minimalistes de l’intérieur familial. Selon Leduc la stylisation des décors s’explique par les contraintes budgétaires : nous n’avions pas de budget pour les décors, alors si quelqu’un devait ouvrir une porte, on installait une porte dans un cadre et le spectateur devait comprendre que le personnage changeait de pièce. À l’inverse, les scènes avec Paule Baillargeon et Pierre Foglia sont totalement improvisées : je trouvais marrant de faire découvrir Griffintown à travers leur promenade d’amoureux.
52
Albédo sort au Cinéma Parallèle au début de décembre 1982 avec, en complément de programme, Souvenirs de guerre de Pierre Hébert. Si Richard Gay est enthousiaste vis-à-vis du film d’Hébert, il manifeste quelques réserves à l’endroit d’Albédo qu’il qualifie de « tentative » et d’« expérience 38 ». Carol Faucher, lui, est totalement enthousiaste et consacre un long texte au film dans Format Cinéma : « Voilà du cinéma de pointe qui cherche et qui explore tant par sa forme que par ce qu’il révèle. Voilà le cinématographe qui propose une expérience unique que le spectateur ne pourra trouver ailleurs : ni dans les livres, ni dans les tableaux, ni au théâtre, ni dans la musique, ni dans le cinéma traditionnel 39. » En avril 1983, Albédo sera invité au San Francisco International Film Festival. En décembre 1986, Denis Bellemare consacrera une étude au film dans le numéro spécial de Copie Zéro sur « Le documentaire : vers de nouvelles voies ». Le dernier glacier Le 2 novembre 1982, Brian Mulroney, président de l’Iron Ore, annonce l’arrêt des activités de la compagnie à Schefferville. Je travaillais à un projet de film avec Roger Frappier quand nous avons entendu un bul letin de nouvelles annonçant la fermeture des mines de Schefferville. On s’est dit : « Il faut faire quelque chose ! » On est immédiatement allés voir Jean-Marc
53
Garand, le directeur de la production française, qui nous a dit : « Très bonne idée ! Allez-y ! » Jean Dansereau a été affecté à la production et le projet sur lequel on travaillait a été remis à plus tard… Il n’y a pas eu de véritable travail de recherche. Nous sommes montés à Schefferville très rapidement : on a écrit sur place et le tournage a démarré presque simultanément. C’est ainsi qu’on s’est retrouvés à filmer la conférence de presse de Brian Mulroney. Il ne voulait pas qu’on le filme ; on l’a fait quand même… Dès la naissance du projet, les deux cinéastes déci dent que le film sera un mélange de documentaire et de fiction, de manière à mieux évoquer le drame humain provoqué par la fermeture des mines. Nous avons immédiatement associé les comédiens au projet. On a choisi les comédiens ensemble ; on connaissait Robert Gravel, notamment à cause du film de Paul Tana Les grands enfants, et on le voulait absolument pour jouer Raoul. Michel Rivard, comédien, mais aussi chanteur, interprète une ballade qui de fait résume tout le film… Cette ballade, c’était son initiative. Effectivement, elle tombe pile. Comme tout ce qui se passe dans le film, c’est arrivé tout bonnement. Le film se faisait au jour le jour ; il y avait peu de dialogues écrits et les comédiens travaillaient avec nous à bâtir le film. Tournage rapide (du 7 mars au 24 avril 1983) et très particulier : deux réalisateurs, deux caméramen, des comédiens professionnels et des non-acteurs… C’est moi qui faisais la caméra pour la partie documentaire : la Côte-Nord et sa nature très particulière, l’hiver, les Amérindiens qui chassent, les camions 54
géants de la mine. Pierre Letarte tournait tout ce qui était fiction, les séquences avec les comédiens. Avec Roger, c’était une complicité parfaite, très harmonieuse : nous partagions tout et je ne me souviens d’aucun moment de désaccord, encore moins d’affrontement. On savait à peu près ce qu’on allait faire, mais, comme dans tout tournage documentaire, tu as prévu tourner telle chose, mais ce n’est pas ce qui se passe, alors, tu changes de bord ! Le film fait assez largement usage, et avec beaucoup de justesse, du « split screen », une technique peu utilisée dans le cinéma québécois de l’époque. C’était ma suggestion et j’y tenais ! Monique Fortier n’était pas très enthousiaste au départ ; ça compliquait évidemment son travail de montage. Mais elle a accepté le défi et c’est formidable comment elle a réussi à intégrer le « split screen » au déroulement du film : il y ajoute un réel dynamisme. Il faut dire que le laboratoire de l’onf de l’époque était formidable et c’est aussi grâce à ses techniciens que l’intégration du « split screen » est réussie. On est en 1983 : il n’y a pas un ordinateur qui trafique les images pour toi ! Le dernier glacier est présenté en avant-premières presque simultanées à Sept-Îles le 18 octobre 1984 et à Matane le lendemain, en présence de Leduc et Frappier. Sa grande première, c’est en ouverture du Festival international de cinéma en Abitibi-Témiscamingue, au Théâtre du cuivre de Rouyn, le 1er novembre. Projection reprise à Fermont le lendemain, c’est ensuite la sortie dans l’ensemble du territoire québécois qui se poursuit tout au long de novembre et décembre : Montréal 55
(cinéma Berri), Québec (cinéma Cartier), Rimouski, Sherbrooke, Rivière-du-Loup, Chicoutimi, Alma. En 1985, le film sera sélectionné au Festival international du film de Tróia (Portugal), projeté en Belgique, puis invité aux rencontres du cinéma documentaire INPUT de Marseille – Leduc y sera présent. Projeté au Centre national des Arts d’Ottawa, il sera diffusé à l’antenne de Radio-Québec en mai de la même année. En 1986, Le dernier glacier sera projeté en ouverture du festival de cinéma de Belfort, en présence de Jean-Pierre Chevènement, maire de Belfort et ministre du gouvernement Mitterrand. En 1989, Le dernier glacier sera projeté en Écosse à l’occasion du 50e anniversaire de la Cinémathèque de Glasgow. L’originalité du film et sa portée politique n’échap pent à personne. Au besoin, les cinéastes précisent leur pensée dans leurs rencontres avec les journalistes ; ainsi en est-il de Jacques Leduc qui déclare à Louis-Guy Lemieux du Soleil de Québec : « La fermeture de cette mine nous est apparue comme le signe le plus manifeste de la fin de la Révolution tranquille. C’est la fin de toute une mythologie qui a fait que l’avenir du Québec devait passer par le Moyen-Nord. Par le nord, par l’exploitation de nos richesses naturelles : le bois, les minerais 40… » Frappier pour sa part insiste, dans le même article, sur le drame humain de l’affaire : « Notre film aurait pu faire le procès du dossier de la compagnie, montrer le côté machiavélique de la décision arrêtée d’une compagnie prévue d’avance et gardée secrète. Nous avons choisi de montrer ce que les travailleurs avaient à exprimer à ce moment-là. » 56
Enfin, l’importance du film est soulignée par Richard Gay qui commence son article du Devoir par la remarque suivante : « Au moment même où l’Office national du film célèbre ses 25 ans de production française, voilà que sort sur nos écrans Le dernier glacier produit par l’onf et coréalisé par les cinéastes Jacques Leduc et Roger Frappier. Heureux hasard ou stratégie bien pensée, peu importe. Mais comment ne pas cons tater que, dans sa facture même, Le dernier glacier témoigne éloquemment des meilleures tendances qui ont prévalu à la production française de l’onf, les actualise et les pousse même plus avant 41. » Petit détour chez les militantes et les militants Tout en collaborant comme caméraman à trois films de son amie Tahani Rached, Leduc demande au professeur et essayiste Jean-Marc Piotte de l’aider à réunir des hommes et des femmes qui ont été militants à un moment de leur vie et qui sont maintenant rendus au moment des bilans. Les deux premiers films sont très courts : le premier, Notes de l’arrière-saison, rassemble (fin novembre 1985) autour d’une table de café trois militants ayant vécu diverses formes d’engagement ; le second film, Le temps des cigales, plus élaboré, poursuit la même enquête auprès de femmes qui comparent également leurs expériences militantes. Le premier film porte en sous-titre Une courte réflexion sur le passage du temps : c’est ça, mon projet, le véritable propos du film. Le film est coupé en 57
deux par un intermède, après quoi on tombe dans le présent : la soirée des élections à la télévision, élections qui reportent le Parti libéral au pouvoir. À l’époque, je voyais assez régulièrement Jean-Marc Piotte avec qui j’avais pas mal de choses en commun. C’est lui qui a rassemblé les participants de cette table ronde improvisée. À tour de rôle, ils font état des illusions qui ont jalonné leurs vies, mais aussi des rêves auxquels ils restent attachés. Tourné durant la première semaine de mai 1986, Le temps des cigales reprend, en plus développé, la formule du film précédent, avec de nouveau la collaboration de Jean-Marc Piotte pour rassembler les intervenantes. Trois anciennes militantes se retrouvent autour d’un verre pour faire leur bilan. Une quatrième dessine dans son atelier en nous parlant de sa vie après le militantisme : elle a l’avantage d’être une artiste ; elle est bien dans sa nouvelle vie parce qu’elle a quelque chose à exprimer. Puis elle a un très bel atelier ! C’était un lieu lumineux qui ouvrait sur une terrasse dominant la rue Rachel. J’aime beaucoup la séquence où je la suis sur cette terrasse avec la caméra. De manière générale, il y a une très belle énergie chez les quatre femmes : elles ne sont pas nostalgiques, au contraire, elles sont encore capables d’enthousiasme. La question du « temps », présente dans les tout premiers films de Leduc, et qui le sera encore davantage dans les grands films de la fin des années 1980 et des années 1990, est très présente dans ces petits films modestes. La question est même explicite dans le sous-titre de Notes de l’arrière-saison. 58
Le cinéma est un art du temps, comme la musique : les notes ont une durée, les plans aussi – la musique contemporaine est là pour nous le rappeler. La question du temps, c’est quelque chose où je reviens souvent, pas seulement pour évoquer « le temps qui passe », mais pour me rappeler que le temps n’existe pas ! Bien sûr, pour les besoins de la planète, on a inventé le temps, mais ce n’est rien d’autre qu’une réflexion humaine… Le temps nous habite malgré nous, ne serait-ce que parce qu’on a un temps limité sur la planète ! Dans Le dernier glacier, les personnages affrontent le temps de trente-six façons… Histoire de refaire le point sur les deux films de 1985, Jacques Leduc propose à leurs protagonistes de se retrouver avec quelques invités pour le week-end de la Saint-Jean-Baptiste de juin 1986. C’est aussi pour le cinéaste l’occasion, comme il aime bien le faire, de remettre leurs images à ceux qu’il a filmés. Onze personnes, de deux générations distinctes, se retrouvent donc dans une auberge des Cantons-de-l’Est pour visionner Notes de l’arrière-saison et Le temps des cigales, en discuter et essayer de comprendre où l’on s’en va. Le projet du film était très simple : revoir les deux films précédents avec les gens que j’avais filmés et en discuter. C’est exactement comme ça que j’avais présenté le projet au Comité du programme. Au moins le tiers du film est fait d’éléments empruntés aux deux films. C’était aussi pour moi l’occasion de réfléchir au documentaire. L’équipe était minimaliste et le tournage très improvisé : on passait une fin de semaine ensemble, on regardait les films, on en 59
discutait, on prenait un verre, on faisait plus ample connaissance. C’est un nouvel exemple de la liberté que l’onf nous permettait. Le Comité du programme était formé de tes pairs, ce qui a été modifié par la suite : les producteurs sont venus y siéger, puis on a invité une ou deux personnes de l’extérieur. Malgré son caractère très particulier, Charade chi noise a eu droit à une première, le 17 janvier 1988, à la salle Marie-Gérin-Lajoie de l’Université du Québec à Montréal ; il prit ensuite l’affiche au Cinéma onf du Complexe Guy-Favreau, du 19 au 29 du même mois. Le film continua à circuler au cours de l’année ; il est notamment projeté au Centre socioculturel de Chicoutimi le 29 novembre. Les projections de Montréal furent l’occasion pour Francine Laurendeau d’un long texte dans Le Devoir du 16 janvier. Elle y rappelle la carrière de Leduc et son combat « inéluctable » pour la survie du cinéma direct. Comme plusieurs spectateurs de l’époque, elle est d’avis que « le discours des femmes passe mieux à cause de la spontanéité, de la complicité et de l’humour qui s’en dégagent ». Et de conclure sur une question : « Quant au projet initial, je ne suis pas très sûre que Charade chinoise nous apprenne grand-chose sur le cheminement suivi par les militants de gauche depuis vingt ans. Mais était-ce vraiment le but profond poursuivi ? » Serge Dussault, écrivant dans La Presse quelques jours plus tard, conclut son bref compte-rendu par ces lignes : « Charade chinoise, je dirais, est un film sur 60
l’amitié. Sur la fraternité des intelligences et des cœurs. Peut-être est-ce cela que Leduc a mis de lui dans son documentaire 42. » Trois pommes à côté du sommeil Désormais installé rue Duluth, à deux pas du parc La Fontaine, Jacques Leduc a transformé une pièce de son nouveau logis en bureau. C’est là qu’il travaille avec Michel Langlois à la scénarisation d’un projet qui lui tient à cœur et qui, quelques mois plus tard, deviendra Trois pommes à côté du sommeil. Le film est une coproduction entre l’onf et le Groupe Malofilm. Michel passait chez moi plusieurs fois par semaine. C’était un processus d’échanges. Il écrivait mieux que moi et, surtout, il maîtrisait cette mécanique dramatique que je connaissais mal. Il débarquait avec des propositions qu’on discutait : c’était un travail agréable, très harmonieux. Une fois le travail terminé 43, il est retourné dans sa campagne travailler à ses projets. Il n’a pas assisté au tournage. Bien qu’élaboré avec un scénariste, le générique du film précise : « Scénario de Michel Langlois d’après une idée de Jacques Leduc. » Le personnage du film, c’est un peu moi. D’ailleurs, il n’a ni nom ni prénom : c’était délibéré, dans le scénario, il s’appelle Lui. Normand Chouinard est impeccable : il colle parfaitement au personnage. La mise en scène, au-delà du scé nario, m’appartenait entièrement : rien dans le scénario ne précisait comment le film serait mis en scène. La 61
structure très particulière du film s’est progressivement imposée au tournage et, bien entendu, précisée au montage avec Pierre Bernier. Le synopsis préparé au moment de la pré-production résume le film en ces termes : « Voici une journée dans la vie d’un homme, à travers ses activités quotidiennes, depuis le rêve qu’il fait à son réveil jusqu’à ses dernières pensées avant son sommeil. Une journée qui est comme toute autre, à ce détail près que cet homme a aujourd’hui quarante ans et que nous le suivons, pour une bonne part, dans ses pensées. » Et le texte de préciser que « le film procède par associations d’idées, dans lesquelles il est question de l’amour et du désamour, de la natalité et de la mort, de l’esprit et de la matière, du cœur qui aime et du corps qui vieillit ». D’ailleurs, le film s’ouvre avec cette phrase : « Une journée dans la vie d’un homme d’aujourd’hui. » Je n’ai jamais fait de raccourci entre le cinéaste et son personnage, mais c’est sans doute inévitable : je faisais mon bilan ! Je crois cependant que le projet esthétique est davantage déterminant. Je faisais un film et je cherchais une écriture juste, comme le fait un peintre, ou un musicien. En plus, j’avais la chance d’être entouré de mes collaborateurs de longue date (Pierre Letarte, Pierre Bernier, Claude Beaugrand, Jean Derome), qui sont autant de complices dans cette aventure : c’est encore une fois mon idée du travail en équipe qui est incarnée dans le film. C’est un héritage du documentaire que j’ai transposé dans le tournage d’une fiction. Film d’une structure très éclatée, avec un nombre imposant de plans (pas loin de cinq cents), Trois pommes 62
à côté du sommeil repose aussi sur un important travail avec les comédiens. Je travaillais à l’italienne : « Allezy, faites votre truc : on vous regarde ! » Puis j’interviens : « Peut-être que si tu te tournais en disant ça, ce serait mieux… ok. C’est ça. Moteur ! » C’est sur le plateau que je trouvais la réponse, pas dans le découpage. Peut-être une fois sur cent, j’arrivais avec des idées très précises ; parfois même je me faisais un petit « storyboard ». De façon générale – et c’était déjà vrai quand je tournais des documentaires –, il y avait toujours cette souplesse : si le caméraman me dit : « Ne mets pas la caméra ici, plutôt là », je regarde et je vois bien qu’il a raison, alors on déplace la caméra ! Et c’est de nouveau l’idée de travail d’équipe… On n’y échappe pas ! De toute manière, je n’aurais jamais réussi à imposer mon point de vue en gueulant fort : ce n’est pas tellement mon genre ! Trois pommes à côté du sommeil est remarquable aussi par son montage, virtuose autant qu’imprévisible. On avait un scénario, qu’on voulait tourner le mieux possible ; on verrait au montage comment ça se met en place. On tournait plus ou moins dans le désordre, et il y avait toujours une part d’improvisation. Le montage suppose que le spectateur travaille un peu, mette lui-même les images bout à bout et leur trouve un sens. Pierre Bernier venait aux projections de « rushes » et attendait qu’on lui envoie le matériel dans sa salle. Une fois le tournage terminé, je me suis installé avec lui pour la durée du montage. (À la mort de Pierre, j’ai compris que, dans ma vie de cinéaste, la personne avec qui j’ai passé le plus de temps, c’est lui.) 63
L’esprit du temps habite ce film et son personnage, ce que Leduc explique en nous rappelant : Je suis un produit de l’onf ; ma formation, c’était le documentaire. Et cet héritage a sûrement joué un rôle dans ma façon d’approcher un tel sujet, de raconter l’histoire de cet homme. (Jacques Leduc termine l’année 1988 en tournant une bande-annonce d’une minute pour ses amis du Festival en Abitibi-Témiscamingue. Cadeau de l’onf au festival, cette bande-annonce très élaborée et ayant mobilisé plusieurs personnes ne semble pas avoir plu aux organisateurs du festival…) Le 3 février 1989, Trois pommes à côté du sommeil ouvre la 7e édition des Rendez-vous du cinéma qué bécois. L’accueil est très positif. Ceux et celles qui écrivent sur le film, quelles que soient leurs réserves, reconnaissent l’importance et l’originalité du film. Robert Lévesque y voit « le film de la morosité, le pouls cinématographique d’un temps précis où un pays tout entier se prend de vague à l’âme et ne sait plus au juste ce qu’il va devenir 44 ». Luc Perreault écrit pour sa part que « d’abord un peu dérouté, le spectateur finit par accrocher à cette œuvre qu’on sent parfaitement accordée à l’état d’esprit de son auteur et fort représentative de l’air du temps 45 ». La carrière proprement commerciale du film démarre aux cinémas Berri et Complexe Desjardins de Montréal en avril et se poursuit au Cineplex Charest de Québec, en mai ; partout, la critique lui fait un bon accueil. Un texte enthousiaste de La Presse Canadienne est repris partout, de Charlottetown à Winnipeg. En 64
septembre, le film est sélectionné dans la section Perspective Canada du Toronto Festival of Festivals. En février 1990, l’Association québécoise des criti ques de cinéma décerne son prix L.-E.-Ouimet-Molson à Jacques Leduc pour Trois pommes à côté du sommeil : « Pour la richesse de sa construction dramatique ; pour sa bande sonore extrêmement élaborée ; pour ses magnifiques portraits de femmes ; pour la lucidité et la sérénité dans l’évocation d’une génération en déroute. » En mai, dans le cadre de Vues du Québec, le film est projeté à Paris, dans la salle des Services culturels du Québec, rue du Bac. Montréal vu par… Six variations sur un thème : « La toile du temps » À l’automne 1989, la productrice Denise Robert propose à Jacques Leduc de réaliser l’un des six sket ches de Montréal vu par…, un projet parrainé par la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal. Leduc y travaille avec Marie-Carole de Beaumont : une première version, sous le titre Les hivers sont longs, est déposée dès octobre. Un scénario dialogué est terminé le 20 janvier 1990 et approuvé début février. Le tournage se fera finalement en 1991, du 28 mai au 18 juin, sur le grand plateau de l’onf. Belle ironie : ce tournage tiendra lieu d’adieu de Leduc à l’onf, qu’il a quitté le 31 août 1990, après vingt-six ans de « loyaux services », comme le veut la formule d’usage – c’est Youppi, la mascotte des Expos de 65
Montréal, qui préside la fête de départ, dans la « mythique » cafétéria de l’onf. La toile du temps a été tourné à peu près entièrement en « back screen ». Tout le monde était très excité parce que personne n’utilisait plus cette technique. Nous utilisions un très grand écran sur lequel nous pouvions projeter des images d’archives. Je me suis amusé ! J’étais loin du documentaire, dans l’artifice total… J’étais très fier de me retrouver avec le groupe de cinéastes (Denys Arcand, Atom Egoyan, Michel Brault, Patricia Rozema, Léa Pool) rassemblés par Denise Robert et de travailler à nouveau avec Normand Chouinard, le peintre qui fait le portrait du maire Viger. Lancé en grande pompe et en présence du maire Jean Doré au cinéma Impérial le 6 novembre 1991, Montréal vu par… n’est pas le succès escompté : le film de Leduc, au mieux, est qualifié d’« expérimental ». L’enfant sur le lac Au début de 1991, ayant renoncé à son statut de fonctionnaire fédéral, Jacques Leduc se retrouve pigiste. Son ami Roger Frappier, devenu un producteur indépendant de premier plan, va lui fournir une première occasion de tourner. L’enfant sur le lac était un truc pour la télévision dans le cadre d’une série, avec, pour chaque film, un budget analogue de l’ordre de huit cent mille dollars et des conditions très précises inscrites à mon contrat (nombre de jours de tournage et de montage, etc.). Le 66
scénario m’a été remis alors qu’il était prêt à être tourné et je n’avais à peu près pas de latitude par rapport au texte 46. J’étais pourtant content d’accepter une « commande », même s’il n’y avait pas grand place là-dedans pour des choses personnelles, à l’exception de quelques petits éléments – l’enfant qui marche sur le lac, par exemple. Il n’y avait pas de découpage : tout ce qui était mise en scène, c’était ma responsabilité. Je devais mettre ça en film. Yvon Rivard n’est jamais intervenu ; il n’est pas venu au tournage, n’a pas retouché les dialogues. Le tournage débute en mars et durera dix-huit jours. C’est un tournage rapide, sans histoire ; ainsi, le 19 mars, on tourne sept prises, pour la plus grande satisfaction du producteur. Je remplissais une commande, au mieux de mes moyens, et avec un certain plaisir. Parallèlement, je travaillais déjà à l’adaptation du roman de Danièle Sallenave, La vie fantôme, avec Yvon Rivard, qui était l’auteur de L’enfant sur le lac. Bien que destiné à la télévision, L’enfant sur le lac est projeté au Festival des films du monde de Montréal le 27 août. Les journalistes présents parlent davantage des conditions de projection désastreuses que du film. Radio-Canada le diffusera dans le cadre des Beaux dimanches le 19 janvier 1992. La vie fantôme Fin des années 1980, en vacances dans le sud de la France, j’avais lu, par accident, Les portes de 67
Gubbio de Danièle Sallenave, que j’avais beaucoup aimé. Puis, à nouveau par accident, j’ai vu La vie fantôme dans la vitrine d’un libraire montréalais. Je l’ai lu d’une traite, et je l’ai immédiatement relu, convaincu qu’on pouvait en faire un film. J’ai faire lire le livre à Yvon Rivard et on s’est attablés pour écrire. Ça n’a pas été très long, ni très difficile : toute la matière était là. C’est l’histoire d’un triangle amoureux et l’auteure a situé l’action dans une ville de province, d’où notre choix de Sherbrooke. Histoire d’un homme également amoureux de deux femmes, La vie fantôme est surdéterminé par son caractère amoral. Je ne voulais attribuer la culpabilité à aucun des personnages ; on ne fait porter la culpabilité à personne. C’était mon parti pris et cela a joué beaucoup dans toute la démarche, dans notre façon d’aborder les choses. C’est une approche que Rivard partageait avec moi. Beaucoup de spectateurs ont d’ail leurs été sensibles à ça ; j’ai eu beaucoup de commentaires en ce sens. Le budget officiel de La vie fantôme, selon son producteur, est de deux millions six cent mille dollars. Le tournage débute le 6 octobre 1991 et se poursuivra jusqu’au 30 novembre. Exception faite des séquences à New York et en Floride, tout le film est tourné à Sherbrooke et dans un studio du Vieux-Montréal. Roger Frappier invite à l’occasion des journalistes à visiter le plateau ; c’est le cas de Serge Dussault qui s’y arrête fin novembre et à qui Leduc déclare : « Je m’intéresse aux petites affaires du quotidien. Je suis dans le courant anthropologique, à la recherche de quelque 68
chose, sans savoir quoi. Mes films relèvent du work in progress 47. » C’est Pierre Mignot qui est chef opérateur et qui apporte à Leduc, avec qui il travaille pour la première fois, sa collaboration exceptionnelle. Pierre a été un collaborateur précieux, qui faisait une lecture bien à lui des choses, et éclairait souvent différemment de ce que j’aurais fait – et souvent il avait raison ! Je lui faisais une confiance totale. Faut dire que j’ai surtout fait la caméra sur des documentaires, ce qui est fort différent de la photo sur des films de fiction. Quand j’ai fait la caméra sur des films de fiction, j’avais toujours un bon éclairagiste avec moi (souvent Maurice de Ernsted), ce qui facilitait sûrement mon travail. Ceci étant dit, même en fiction, ce n’est pas toujours nécessaire de beaucoup éclairer… Je travaillais aussi avec un nouveau monteur, Yves Chaput, et je privilégie délibérément un montage linéaire : on est loin du montage éclaté de Trois pommes à côté du sommeil. Je voulais essayer de raconter une histoire. Comme cela a été le cas dans plusieurs films antérieurs – dans Trois pommes à côté du sommeil, notamment –, La vie fantôme est une réflexion sur les relations amoureuses. C’est un film de passion dans lequel les scènes au lit sont nombreuses… Je voulais même faire pire ! Dans une scène où Pierre est sur le dos et Laure agenouillée sur lui, j’avais suggéré que l’homme dise à la femme : « Fais pipi sur moi. » Les deux ont dit : « Il n’en est pas question ! » C’est curieux de penser à ces moments du film, alors que je ne supporte 69
même plus les longs baisers, filmés en gros plan pendant quarante-cinq secondes. On peut suggérer qu’il y a un long baiser, sans avoir besoin d’un plan de quarantecinq secondes. Dans Trois pommes, il y a une dimension très personnelle, dans La vie fantôme, la dimension personnelle, elle est dans la mise en scène, pas dans la narration, pas dans l’anecdote… Le montage terminé, Leduc s’envole pour le Portugal où il veut s’offrir une sabbatique pour ses cinquante ans. Il reviendra à Montréal en coup de vent pour la première de La vie fantôme au Festival des films du monde, au cinéma Impérial, le 29 août. Le film est bien reçu – les scènes de lit ne passent pas inaperçues – et Pascale Bussières remporte le Prix d’interprétation féminine. En septembre, le film est projeté au Festival international du film de Vancouver, puis « nominé » aux Genie Awards dans la catégorie Meilleure adaptation. En novembre, c’est le Festival en Abitibi-Témiscamingue qui l’inscrit à son programme. La sortie commerciale, initialement prévue en octobre, est régulièrement reportée… Le film sort finalement en salle en janvier 1993, au Berri et au Loew’s, à Montréal ; au Clap, à Québec ; à Sherbrooke et dans d’autres villes, par la suite – pas le moment idéal pour lancer un film québécois, comme plusieurs l’ont fait remarquer à l’époque. Plusieurs critiques ont écrit sur le film au moment de sa projection au FFM ; c’est le cas de Luc Perreault qui, très enthousiaste, écrit : « Leduc a choisi la voie du film intimiste. On savoure son œuvre comme une musique de chambre, un peu comme ces trios à cordes 70
de Beethoven qui servent dans le film de ponctuation. Mais on ne saurait en douter : La vie fantôme est une œuvre de maturité, tout à fait maîtrisée, un film élégant et sensible, finalement très beau 48. » Robert Lévesque est moins enthousiaste dans Le Devoir ; Odile Tremblay, dans le même journal, partagera ses réticences quelques mois plus tard, quand le film prendra enfin l’affiche. Huguette Roberge, dans La Presse, suivra Leduc sur son terrain d’élection en écrivant : « L’intérêt de La vie fantôme tient, non pas tant à son sujet ou aux scènes torrides qu’il justifie, qu’au regard d’entomologiste, sans l’ombre d’un jugement, que Jacques Leduc pose sur l’intimité des êtres, leurs doutes, leurs contradictions, leur innocence et leur cruauté foncières. Ses images sont dépouillées, et souvent lumineuses49. » Dans les revues spécialisées où l’on suit le travail de Leduc depuis longtemps, on saisit immédiatement l’importance du film, la gravité de son propos et du regard du cinéaste. Ainsi en est-il du long texte de Guy Ménard dans Ciné-Bulles, de la critique très positive de Janick Beaulieu dans Séquences et de l’analyse remarquable d’André Roy dans 24 images qui se termine par cette phrase prophétique : « Jacques Leduc filme la fin de la fiction. Comme une vie banale jusqu’à n’être que le fantôme d’elle-même, c’est terrible, et c’est fort parce que c’est terrible 50. » Le 30 janvier 1992, Jacques Leduc avait écrit à Danièle Sallenave pour la « remercier d’avoir écrit La vie fantôme […], de nous avoir permis de le filmer, d’avoir été lointainement responsable de tout le bon temps que j’ai pu vivre depuis, d’avoir contribué à 71
changer ma vie ». L’histoire ne nous dit pas si l’écrivaine a jamais vu le film… L’âge de braise Au printemps 1993, Jacques Leduc quitte le Portugal pour rentrer à Montréal ; en route, il fait un arrêt à Rennes pour participer à une table ronde à l’occasion de la projection à l’université du lieu d’Albédo et de La vie fantôme. Rentré chez lui, il reprend sa caméra comme outil de travail et gagne-pain, tout en remettant à l’ordre du jour un projet de film auquel il pense depuis un bon moment ; pour ce faire, il engage un scénariste, Jacques Marcotte, dont il connaissait le travail avec André Forcier. On se voyait très régulièrement. Ça se passait à nouveau sur le mode échanges : nous apportions de la matière à tour de rôle. On jouait même certaines scènes, à l’italienne. Cela s’est fait assez rapidement : quelques semaines et le film était prêt. En février 1994, une version préliminaire du scénario est prête sous le titre Retour au blanc. Leduc sollicite alors l’avis d’anciens amis de l’onf. Monique Fortier, sa monteuse du Dernier glacier, lui fait part de ses commentaires dans une lettre datée du 1er mai dont le post-scriptum mérite d’être cité : « Et puis, il ne faudrait pas que ton film exclue l’angoisse : la mort, c’est aussi le néant, le saut dans le vide ! » Quant à Jacques Bobet, il envoie une longue lettre à Leduc, commencée le 22 mai et terminée le 25 juin, dans laquelle il analyse le personnage de Caroline jusque 72
dans ses contradictions les plus intimes, souhaitant au cinéaste d’aller les débusquer. La mise en chantier du film est lente 51, mais progresse. Le 30 mars 1995, un premier contrat de réa lisation est signé entre Leduc et Luc Vandal des Productions du Lundi Matin (1985) inc. Ce contrat sera remplacé par un second contrat, en date du 29 avril 1996 ; un dernier contrat de réalisation clarifiera définitivement l’entente le 9 mai 1997. Entretemps, un contrat de droits aura été signé par Leduc et Vandal, le 23 avril 1997. Le tournage pourra enfin débuter le 12 mai et se poursuivre jusqu’au 20 juin 1997. Quelques journalistes, Marc-André Lussier de La Presse et Martin Bilodeau du Devoir entre autres, sont invités à rencontrer Leduc et Annie Girardot sur le plateau au premier jour de tournage. Le tournage est sans histoire. On tourne en décors naturels, la production ayant réquisitionné une maison dans un quartier à l’ouest de Montréal. On y faisait des transformations, au fur et à mesure qu’on avançait dans l’histoire. J’aurais même voulu aller plus loin dans cette direction : le film aurait commencé avec des murs de couleur, décorés de photos, et, de séquence en séquence, les murs auraient pâli, seraient devenus blancs. Mais le budget m’a interdit ça… Pour la première fois de sa carrière, Jacques Leduc travaille avec une comédienne étrangère, qui est aussi une vedette. Le film était une coproduction avec la France : Annie Girardot, comme Élisabeth Guido, la monteuse, faisait partie de l’entente de coproduction. Ça s’est très bien passé ! On avait un très bon rapport, 73
une réelle complicité. J’allais la chercher tous les matins pour l’emmener sur le tournage. Je l’avais vue dans plusieurs films et je l’imaginais bien dans la peau de mon personnage ; ce qui s’est avéré juste : elle porte le personnage magnifiquement ! Je suis passé par Paris quelques années après le tournage et j’ai voulu aller saluer Annie Girardot, mais il était trop tard : elle était déjà morte. Dans L’âge de braise, les dialogues sont très importants. Je tenais pourtant à ce qu’il y ait toujours une certaine souplesse là-dedans. Parfois, ce sont les comédiens qui proposaient de dire les choses autrement : j’étais toujours ouvert à ça. Inspiré des derniers mois de la vie de la mère du cinéaste, le film se termine sur l’image de son héroïne qui s’abrite sous un drap avant de se transformer en milliers de pépites lumineuses qui s’élèvent vers le ciel. Quand ma mère est morte, j’étais à ses côtés et je lui tenais la main. Or, au moment où elle est morte, j’ai vu des pépites s’envoler. Cette image est toujours restée gravée dans ma tête : je les ai vues, ces pépites… Sorti en salle à Montréal le 24 avril 1998, L’âge de braise déconcerte les critiques qui ne savent pas très bien quel usage en faire. Leduc a beau insister : « Il faut voir L’âge de braise comme une métaphore, sans l’avaler au premier degré 52. » Le public ne le suit pas et le film quittera l’affiche après trois semaines. Certains (Éric Fourlanty, dans Voir) reprochent à L’âge de braise son rythme, son symbolisme aussi ; d’au tres (Luc Perreault, dans La Presse du 25 avril) considèrent que le film « tient de l’essai cinématographique ». 74
Étrangement, Échos Vedettes, sous la plume de JeanFrançois Brassard, est plus réceptif, soulignant « l’approche poétique où les silences parlent autant que les mots ». Il faudra attendre les revues spécialisées pour lire les textes plus accueillants de Denyse Therrien, Élie Castiel et Gérard Grugeau. Mais il sera malheureusement trop tard : le film aura déjà disparu des écrans, voire des mémoires… (Il n’existe même pas un DVD pour nous obliger à réévaluer le film.) Jacques Leduc tenait beaucoup à L’âge de braise. Il était attaché à ce film, content de l’avoir fait et trouvant même « salutaire » (ce sont ses termes) de l’avoir fait. Il aurait aimé que son film trouve un public ; il savait aussi que ce n’était pas gagné d’avance. Quand tu fais de la mort le sujet du film, ça ne passe pas ! Tu peux montrer six cents morts à l’écran, ça va. Mais un film sur « la » mort, non ! Or, L’âge de braise, c’est ça : l’histoire d’une femme qui prépare sa mort. Sans compter que, comme il le faisait remarquer à Luc Perreault : « Sortir un film, c’est la loterie. Tu ne peux rien en attendre. Si t’es le moindrement sérieux, t’attends rien. Ce qui est important pour moi, c’est l’écho intime. Je veux savoir comment le film va toucher 53. » Quinze ans plus tard, c’est Georges Privet qui saura trouver le ton juste pour conclure : « Ce portrait incandescent d’une femme qui se consume au crépuscule de sa vie est pourtant l’un des plus beaux films de Jacques Leduc 54. »
75
Un homme libre L’âge de braise est le dernier film portant la signature de Jacques Leduc comme réalisateur. Il n’a pas chômé pour autant : depuis 1998, son nom est apparu, comme directeur photo ou caméraman, sur quelque vingt-cinq films. Souvent, cette collaboration est un geste d’amitié (avec Tahani Rached, Sylvain L’Espérance, Paule Baillargeon, par exemple) ; parfois, un coup de main à un cinéaste débutant ou fauché. Puis il a fait de nouvelles photos ; retiré les anciennes aussi ; imaginé d’en faire un livre… Et donné beaucoup de temps à la Casa Obscura, un lieu culturel dont il a été l’un des animateurs depuis sa création. En 2003, la Cinémathèque québécoise lui a consacré une rétrospective, belle occasion pour une nouvelle génération de cinéphiles de découvrir un des cinéastes les plus originaux, et en même temps les plus secrets de notre cinéma. En 2008, le gouvernement du Québec lui a remis le prix Albert-Tessier, officialisant en quelque sorte son apport unique à l’histoire culturelle du Québec. Le cinéma a beaucoup changé depuis Chantal : en vrac. Les outils du cinéaste se sont renouvelés à une vitesse qui défie tout apprentissage. Alors le cinéaste fait son bilan, sans désespérer de découvrir de temps en temps un film qui va l’enthousiasmer – c’est arrivé avec Impetus de Jennifer Alleyn. Il n’en revient pas d’avoir pu vivre dans le cinéma pendant tant d’années et son éternel sourire d’adolescent en dit long sur la qualité de ses souvenirs – les souvenirs d’un homme libre. 76
* Depuis 1975, comme il le précise lui-même dans le texte, Jacques Leduc pratique également la photographie, au Minox ou au Leica, en chambre noire aussi. Le geste de photographier lui est devenu familier, précieux aussi. À preuve les quatre albums qu’il a assemblés lui-même, dans lesquels textes et photos sont autant de traces de son passage sur cette terre dont il se réclame : de Gaspésie en Liban, en passant par la Côte-Nord ou Monument Valley, Leduc est citoyen du monde et il aime que la terre colle à ses semelles. Certaines de ces photos ont été exposées, trop furtivement : il serait temps de les revoir, aux côtés des films dont elles sont le prolongement organique.
NOTES
1. Thor Heyerdahl, 1950. 2. Richard Brooks, 1955. 3. Le ciné-club du Collège Bourget était très dynamique : en 1961, cent cinquante-sept de ses membres étaient abonnés à Séquences, dont Lefebvre était un collaborateur prolifique. 4. Séquences, Montréal, no 26, octobre 1961. 5. Objectif, Montréal, no 11, décembre 1961. 6. Avec Roland Brunet, Robert Daudelin, Jacques Lamoureux, Jean Pierre Lefebvre, Claude Nadon, Jean-Claude Pilon et André Poirier. 7. Objectif, Montréal, no 14, juillet 1962. 8. Belle ironie, dans le no 20 (mai 1963) d’Objectif, Leduc avait publié une critique très positive de Toronto Jazz du même Don Owen. 9. L’enthousiasme de Leduc est tangible dans l’article « Les caméramen de l’O.N.F. » qu’il publie dans le no 33 (mai 1963) de Séquences. 10. La Presse, Montréal, 19 août 1967. 11. Dans un entretien inédit du 9 septembre 1971 avec Réal La Rochelle, en prévision d’une tournée abitibienne de On est loin du soleil. 12. Le film avait été retenu par un comité de présélection composé de René Boissay, Robert Daudelin, Monique Fortier, Claude Nadon, Gerald Potterton, Robert Russel et Roland Smith. 13. « Barreau de chaise 6 », 24 images, Montréal, no 112113, automne 2002. 14. La Patrie, Montréal, 17 septembre 1967. 78
15. Dominique Noguez, Essais sur le cinéma québécois, Montréal, Éditions du Jour, 1970. 16. Pierre Bernier est décédé en 2006. Voir le texte de Jacques Leduc « Lettre à Pierre Bernier » dans le no 126 (mars-avril 2006) de 24 images. 17. La Presse, Montréal, 27 septembre 1968. 18. Jean-Pierre Bastien et Pierre Véronneau, Jacques Leduc, Montréal, Conseil québécois pour la diffusion du cinéma, « Cinéastes du Québec 12 », 1974. 19. Chroniqueur de la vie quotidienne, Montréal, Coop Vidéo, 2013. 20. Entretien inédit avec Réal La Rochelle, 9 septembre 1971 (voir note 11). 21. Dominique Noguez, op. cit. 22. Dans le cadre de l’entente avec Columbia Pictures qui permettait périodiquement à un court métrage de l’onf d’accompagner un long métrage américain lors de sa sortie en salle commerciale. Selon Leduc, le film n’a jamais connu cet honneur ; il n’en a pas moins reçu le prix de la meilleure photographie en couleur au Palmarès du film canadien, à Toronto, en 1969. 23. Dominique Noguez, op. cit. 24. « Barreau de chaise II », 24 images, Montréal, no 121, février 2005. 25. Paul Larose, « La censure et la tradition du documentaire international », document interne à l’Office national du film du Canada, 10 mars 1973. 26. « Barreau de chaise II », 24 images, op. cit. 27. Entretien inédit du 9 septembre 1971 avec Réal La Rochelle (voir note 11). 28. « Il faut parvenir à réconcilier l’émotion avec le didactisme », dira Leduc à Réal La Rochelle, dans l’entretien de 1971 déjà cité (voir note 11). 79
29. Leduc raconte cette soirée, « catastrophique » selon lui, dans le no 112-113 de 24 images (automne 2002). Le critique de cinéma de La Tribune de Sherbrooke, René Berthiaume, avait pourtant publié une critique très favorable au lendemain de cette projection. 30. Cinéma/Québec, Montréal, vol. 1, no 3, août-septembre 1971. 31. Séquences, Montréal, no 73, juillet 1973. 32. 24 images, Montréal, no 141, mars-avril 2009. 33. Cité par Jean-Pierre Tadros, Le Devoir, Montréal, 15 avril 1978. 34. Pierre Letarte corrobore ses dires : « On se rencontrait là tous les matins, avant de partir en tournage, pour faire le point, discuter de l’approche à adopter, de langage cinématographique. » 24 images, Montréal, no 141, mars-avril 2009. 35. Marcel Jean, Dictionnaire des films québécois, Montréal, Somme toute, 2014. 36. Le tournage se poursuivra jusqu’au 15 décembre. 37. Format Cinéma, Montréal, no 8, 30 novembre 1981. 38. Le Devoir, Montréal, 4 décembre 1982. 39. Format Cinéma, Montréal, no 21, 22 novembre 1982. 40. Le Soleil, Québec, 24 novembre 1984. 41. Le Devoir, Montréal, 17 novembre 1984. 42. La Presse, Montréal, 23 janvier 1988. 43. La version finale du scénario est datée de janvier 1988, le tournage a pourtant démarré le 24 août 1987, se poursuivra en octobre, pour se terminer en janvier et février 1988. 44. Le Devoir, Montréal, 3 février 1989. 45. La Presse, Montréal, 3 février 1989. 46. « C’eût été facile mais bien malvenu d’exploiter, au travers d’une mise en scène un peu tordue et plus explicite, les sentiments troubles que ressentait le personnage principal 80
vis-à-vis de sa mère et de rendre visible ce qui était latent. » Jacques Leduc, 24 images, Montréal, no 114, hiver 2003. 47. La Presse, Montréal, 23 novembre 1991. Voir aussi Ciné-Bulles, Montréal, no 48, avril-juin 1992. 48. La Presse, Montréal, 30 août 1992. 49. La Presse, Montréal, 23 janvier 1993. 50. 24 images, Montréal, no 62-63, septembre-octobre 1992. 51. Cette lenteur permet à Leduc de retourner au Portugal pour siéger au jury des VI Encontros Internacionais de Cinema Documental de novembre 1995. 52. Déclare-t-il à Odile Tremblay dans Le Devoir du 25 avril 1998. 53. La Presse, Montréal, 25 avril 1998. 54. Chroniqueur de la vie quotidienne, Montréal, Coop Vidéo, 2013.
Geneviève (Michel Brault, 1965). Geneviève Bujold, Jacques Leduc (assistant-caméraman), Michel Brault.
Chantal : en vrac. Chantal Renaud et Robert Barbaud.
On est loin du soleil La famille endeuillée : Marthe Nadeau, J.-Léo Gagnon, Pierre Curzi (de dos) et Marcel Sabourin.
Alegria Fred Anders dans son atelier, sous l’œil admiratif de Jacques Leduc.
Tendresse ordinaire Esther Auger et Luce Guilbeault : la scène de la mosaïque.
Jacques Leduc, Esther Auger, Alain Dostie (directeur photo), et Luce Guilbeault préparent la scène de la mosaïque.
Chronique de la vie quotidienne / samedi « Le ventre de la nuit » Fêter la Saint-Jean-Baptiste sur la galerie arrière.
Chronique de la vie quotidienne / vendredi « Les chars » Un curé au garage pendant la tempête de neige.
Albédo Luce Guilbeault et Jean-Pierre Saulnier.
La vie fantôme Ron Lea et Pascale Bussières.
L’âge de braise Annie Girardot et Jacques Leduc.
2 Filmographie commentée
1967 – Chantal : en vrac Scénario : Jacques Leduc. Images : Thomas Vamos (assisté de Claude Larue). Son : Maurice Paradis. Montage : Jacques Kasma. Musique : Lee Gagnon. Interprétation : Chantal Renaud, Robert Barbaud, Jean Le Moyne, Huguette Roy, André Pâquet, Jacques Kasma. Production : onf / Guy L. Coté. 50 minutes. Chantal et Robert ont vingt ans. Ils sont insouciants et pourtant ils se cherchent. Par un bel aprèsmidi d’automne, ils vont se balader dans les Laurentides. Pendant ce temps, les Américains bombardent le Vietnam ; le maire Jean Drapeau inaugure le métro de Montréal et Expo 67 ; des ouvriers de Saint-Jérôme manifestent pour le salaire minimum ; et les cinéastes québécois défilent pour réclamer la création d’une Régie du cinéma. Ce résumé est sans doute assez juste, pourtant il ne dit rien de ce qu’est réellement le premier film portant la signature de Jacques Leduc. Chantal : en vrac, primé pour « son modernisme et son caractère critique », est beaucoup plus que le brûlot que plusieurs dénoncèrent à l’époque. Geste un peu brut d’un très jeune cinéaste qui « avait un besoin impérieux de faire un film 1 », ce film frappe d’abord – agresse, diront certains – par sa grande liberté : liberté de ton, de construction (d’écriture), de propos. 91
Le côté foncièrement brouillon de l’entreprise fait aussi partie de sa richesse : Chantal : en vrac témoigne de l’air du temps. Dès l’ouverture du film, Leduc affiche ses références : Chantal se présente au spectateur avec à peu de choses près les mêmes mots, et sur le même ton, que la Barbara de Gilles Groulx, en ouverture du Chat dans le sac, le film qui a donné à la génération de Leduc le goût de faire du cinéma. Le film emprunte assez manifestement son écriture aux premiers courts métrages de Jean-Luc Godard, dans son montage (les « jump cuts »), ses ruptures de ton, son plaisir à provoquer aussi (les propos de Chantal sur la guerre du Vietnam) : la Nouvelle Vague n’est pas très loin. Quant à l’onf, producteur du film, est-il besoin de le rappeler 2, Leduc l’écorche gentiment au passage avec un petit film dans le film (très NFB classique) sur la beauté des paysages de l’automne laurentien, avec musique maison à l’appui. Mais il met davantage en question la production onefienne, y compris les films du cinéma direct, par le mélange de genres et de tons qui anime son film. Ainsi en est-il de la petite conférence de Jean Le Moyne sur Rabelais devant les deux auditrices médusées que sont Chantal et Claire Boyer 3 : le discours savant du docte essayiste vient évidemment rompre avec les dialogues « au ras des pâquerettes » du reste du film ; il s’agit à nouveau d’un film dans le film, mais d’un autre registre. Enfin, Chantal : en vrac est à l’évidence un film sur le cinéma. Si, dans son écriture même, le film pose la question du « comment » faire du cinéma, raconter une histoire, questionner, émouvoir – c’est bien la 92
question que pose le double montage de la conversation sur le quai –, la présence du cinéma, dans sa matérialité même, est fréquente : dans la claquette que filme Thomas Vamos, en ouverture du petit film sur l’automne ; dans le micro qui vient gâcher un plan bien cadré ; dans l’apparition soudaine de l’« Academy leader » et le déroulement de ses chiffres. Mais le cinéma est aussi bien présent, et très concrètement, dans les plans de la manifestation des cinéastes québécois qui réclament la création d’une Régie du cinéma : on y reconnaît Michel Brault, Gilles Groulx, Fernand Dansereau, Pierre Patry, Denys Arcand, René Bail, Jean Pierre Lefebvre et même Jacques Kasma, le monteur de Chantal : en vrac – tous gens qui ont compté, d’une manière ou d’une autre, dans l’arrivée de Jacques Leduc dans le cinéma. En évoquant le premier film de Jacques Leduc, certains se souviendront des accords de la guitare de Tony Romandini sur les premières images du métro de Montréal ; d’autres se demandent encore que vient faire le party de cuisine (avec bière Molson et crème fouettée en bombe) dans le film ; plusieurs se rappelleront combien était fraîche Chantal Renaud ; et tous auront encore en mémoire son désarroi, sous la pluie de l’avenue Bernard, jeune femme de vingt ans perdue dans un monde insaisissable que Jacques Leduc s’entêtera à filmer pour les trente prochaines années.
93
1967 – Nominingue… depuis qu’il existe Scénario : Jacques Leduc. Images : Réo Grégoire (assisté de Claude Larue). Son : Claude Pelletier, Serge Beauchemin. Montage : Pierre Bernier. Interprétation : Denys Arcand, Danièle Berthelot, Françoise Sullivan. Production : onf / Guy L. Coté. 73 minutes. Pour plusieurs, Chantal : en vrac n’était qu’une pochade inoffensive ; pour d’autres, un brûlot agressif. Heureusement, certains, pas très nombreux, il faut bien le dire, avaient compris qu’il y avait là un cinéaste – ce qui n’est pas si courant… Jacques Leduc semble pourtant né sous une bonne étoile, puisqu’il peut immédiatement s’attaquer à un nouveau film, plus long, plus ambitieux, plus conforme aussi (à première vue) aux modèles pratiqués par l’onf. C’est à nouveau Guy L. Coté qui encadre la production et, pour la première fois, le nom de Pierre Bernier fait son apparition au générique, lui qui deviendra un complice à peu près permanent du cinéaste. Ce film est le portrait impressionniste d’une petite ville des Laurentides où Leduc, adolescent, passait ses vacances. Fidèle à l’approche du cinéma direct, le film donne la parole aux habitants les plus âgés de Nominingue, qui témoignent de son âge d’or – l’époque du chemin de fer de la compagnie d’exploitation forestière –, mais aussi de la vie difficile des premiers colons (pain brun et souliers de « bœu »). Mais Leduc bouscule l’approche habituelle de ce genre de sujet : il fait alterner noir et blanc (les témoignages 94
des anciens) et couleur (la vie actuelle), bouscule le documentaire en y introduisant des éléments de fiction (un flirt entre une estivante et le jeune héritier du magasin général) et mélange astucieusement passé et présent. De toute évidence, le cinéaste est attaché à ce lieu riche de souvenirs. Il filme avec une certaine nostalgie – une tristesse certaine aussi – les déplacements des jeunes entre le restaurant Chez Généreux et la salle de danse et son concours d’amateurs. L’ennui semble être une composante essentielle du quotidien de la nouvelle génération ; même filmés en couleur, ces jeunes n’ont pas l’énergie des plus vieux à qui les belles images en noir et blanc semblent étrangement inculquer une réjouissante vitalité. Quant à l’apport de la fiction, au-delà de sa présence expérimentale dans un tel projet, il faut bien admettre qu’il n’est guère convaincant. Ni Arcand ni Françoise Sullivan ne sont de grands acteurs, et leur batifolage a vite fait de lasser. Leduc voulait faire violence au modèle dominant, en refusant de s’astreindre aux règles déjà codifiées du cinéma direct ; il comprendra plus tard qu’on peut y arriver de l’intérieur, avec même beaucoup plus d’efficacité. Dans ce film qu’on pourrait presque dire « paresseux », Jacques Leduc n’en continue pas moins son apprentissage du cinéma. Il filme déjà différemment, se préoccupe des composantes plastiques de l’image et fait confiance au montage (et au monteur !) pour nous impliquer dans sa redécouverte de Nominingue. Film éclaté, dans lequel l’hier et l’aujourd’hui s’affrontent, et à travers lequel un cinéaste se fraie un 95
chemin. Si la forme demeure approximative, voire boiteuse, Leduc impose néanmoins une vision des lieux et des gens. Nominingue… depuis qu’il existe est un « film d’atelier », une étape nécessaire qui permet d’aller plus loin. 1969 – Là ou ailleurs / No Matter Where Réalisation et montage : Jacques Leduc et Pierre Bernier. Images : Réo Grégoire (assisté de Michel Kieffer). Son : Joseph Champagne. Production : onf / Guy L. Coté. 10 minutes. Le monteur Pierre Bernier, qui est désormais associé de près à presque tous les projets de Leduc, prétend que Là ou ailleurs tire son origine d’une boutade (typique) du cinéaste : « Ça serait le fun de faire un film sur le Lac-Saint-Jean vu par des gens qui ne le connaissent pas 4. » Faux « travelogue », exercice de montage, vidéoclip avant la lettre, ce très court métrage n’en est pas moins une image percutante, non seulement du Saguenay, mais du Québec de la fin des années 1960, à la veille d’éclater. Tourné en 35 mm, au hasard d’une balade nonchalante de quelques jours autour du Lac-Saint-Jean, le film se présente comme un catalogue de lieux et de signes qui parlent de travail et de loisirs, de bruit et de fureur, d’un pays qui bouge.
96
Empilage de plans très courts, montés en rafale sur une bande sonore surchargée, Là ou ailleurs est un film agressif qui traduit bien l’inquiétude de Leduc face à un Québec qui n’arrive pas à secouer sa torpeur. Brillant exercice de montage – Leduc et Bernier en sont responsables ensemble –, le film a un côté formel qui l’apparente à un certain cinéma expérimental. Beaucoup plus structuré que les films précédents, Là ou ailleurs est le geste d’un jeune cinéaste impatient qui voudrait que les choses bougent davantage et qui utilise ses outils pour secouer le spectateur-citoyen. 1969 – Ça marche / A Total Service Scénario et réalisation : Jacques Leduc et Arnie Gelbart. Images : Michel Thomas-d’Hoste. Son : Joseph Champagne. Musique : Lee Gagnon et Pierre Hébert. Production : onf / Marc Beaudet, Guy L. Coté. 19 minutes (version française) et 18 minutes (version anglaise). Film de commande produit par l’onf pour le ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, Ça marche fait partie de ces devoirs imposés que devaient affronter périodiquement les cinéastes permanents de l’ins titution fédérale. Leduc et son ami Arnie Gelbart alignent les « talking heads » qui délivrent le message du ministère ; des images d’usines et de bureaux, empruntées vraisemblablement au département « stock shots » de l’Office, viennent rythmer les discours. Les
97
cinéastes s’autorisent quelques plans joliment cadrés. Surprise au générique de fin : le cinéaste d’animation Pierre Hébert est responsable du son synthétique. 1969 – Cap d’espoir Réalisation : Jacques Leduc. Images : Alain Dostie, Claude Larue. Son : Yves Sauvageau. Montage : Claire Boyer. Interprétation : Denis Drapeau, Sylvie Payette. Production : onf / Pierre Maheu. 57 minutes. Film-scandale (interdit pendant plus de cinq ans par l’onf), plus que scandaleux, Cap d’espoir est né d’un projet avorté sur la jeunesse québécoise, ses idées et ses préoccupations. Il s’agit essentiellement de sept jours d’improvisation, avec une absolue liberté, « filmant ce qui nous tombait sous la main, et on a fait un film qui nous ressemblait, avec beaucoup d’innocence, d’emprunts, de scènes filmées dans le désordre 5 ». Film brouillon, décidé à choquer à tout prix, Cap d’espoir, même s’il est révélateur d’un certain esprit du temps, n’est pas un objet qui a très bien vieilli. Le film attaque sur tous les fronts : la société de consommation, la léthargie des Québécois, la télévision, le pouvoir de l’information, le bilinguisme, le pouvoir masqué de l’Église (c’est la main d’un évêque qui assassine le héros). Son porte-parole est un enfant gâté qui se croit révolutionnaire et dont le désœuvrement est tout, sauf mobilisateur. Le recours aux propos scatologiques
98
désamorce pour de bon le discours dénonciateur qui animait les cinéastes. Cap d’espoir demeure un curieux objet, inclassable, dans la filmographie de Leduc, comme dans l’histoire du cinéma québécois. Film dont on cherche désespérément la structure, il est pourtant périodiquement monté, avec un réel dynamisme et certaines outrances visuelles (le ketchup sur les frites et la moutarde sur le hot dog envahissant l’image), et certains plans abusivement longs (le juke-box) laissent à penser que son côté « ras-le-bol » aurait pu s’articuler en un discours décapant. L’idée de brûler Renaude Lapointe, Frenchie Jarraud et Réal Giguère dans un feu de camp sur la plage de Percé était, en 1969, plutôt réjouissante, malheureusement, dans son laisser-aller paresseux, le film a éteint le feu. Pour le critique Georges Privet : « Cap d’espoir se voit comme un cri d’impuissance de la jeunesse québécoise face à un Québec où la révolution reste un peu tranquille au goût de certains 6. » Pour Jacques Leduc, le film marque la fin d’une époque, époque d’apprentissage, mais aussi de confrontation avec la société ; il a sans doute brûlé quelques étapes, mais il est désormais prêt à faire un grand bond en avant et à mettre en chantier ce qu’il faut désormais appeler son œuvre.
99
1970 – On est loin du soleil Réalisation : Jacques Leduc. Scénario : Robert Tremblay, d’après une idée originale de Pierre Maheu. Images : Alain Dostie. Son : Jacques Drouin. Montage : Pierre Bernier. Musique : Michel Robidoux. Interprétation : Esther Auger, Reynald Bouchard, Pierre Curzi, Denis Drapeau, J.-Léo Gagnon, Claude Jutra, Willie Lamothe, Marthe Nadeau, Marcel Sabourin. Production : onf / Paul Larose. 79 minutes. Film de rupture qui laisse loin derrière lui les essais souvent approximatifs qui l’ont précédé, On est loin du soleil, par ses parti pris d’écriture, comme par les thèmes abordés, contient en germe tous les films à venir de Leduc. Portrait, pourrions-nous dire par réfraction, du frère André, le film est rigoureusement construit, à la façon d’un puzzle dont toutes les pièces, une fois réunies (dans la cuisine familiale), constituent une image aussi complète qu’harmonieuse. La biographie du bon frère André nous est résumée en voix hors champ (celle du cinéaste) sur fond noir, après quoi il ne sera plus fait mention de son nom ; ce sont les éléments de cette biographie qu’incarneront les personnages que le film va désormais suivre. Filmé (magnifiquement par Alain Dostie) en noir et blanc – à l’exception de l’avant-dernier plan en couleur, où Leduc et son caméraman sont fossoyeurs –, le film assume sereinement son héritage documentaire, les lieux (portes, corridors, escaliers, toilettes) devenant 100
autant de personnages qui habitent le film de tout leur poids. Les protagonistes sont pourtant bien dessinés et s’intègrent à ces divers lieux comme faisant partie de leur architecture même. Le montage de Pierre Bernier, assurément rigoureux, n’en est pas moins ouvert, respectant en cela le caractère éclaté du film. Quelques plans en temps réel (l’attente au bureau du ministère de la Main-d’œuvre, le lunch à la manufacture) ralentissent délibérément le déroulement du film qui y trouve un ancrage supplémentaire dans le réel. Pour toutes ces raisons, On est loin du soleil est déjà une « chronique de la vie quotidienne », celle, précise et précieuse, d’une famille ouvrière canadiennefrançaise dont chaque membre nous devient familier et intime à mesure que s’élabore le film. La justesse du choix des interprètes est remarquable : Marthe Nadeau et J.-Léo Gagnon sont bouleversants d’humilité 7. Marcel Sabourin, trousseau de clés pendouillant sur son pantalon, semble être né concierge ; Esther Auger, troublante d’innocence devant sa mort annoncée, est inoubliable ; Reynald Bouchard, en recherche de travail, et Pierre Curzi, déjà ouvrier, sont les discrets représentants des classes populaires. Même le grand Willie Lamothe a droit à un sympathique « caméo », très bien intégré au quotidien de monsieur Bessette, gardien de nuit à l’onf. Conçu, selon Leduc, « en fonction de principes théoriques bien délimités », On est loin du soleil n’en est pas pour autant un exercice formel. Tout au contraire, c’est un film bouleversant et d’une justesse 101
exceptionnelle dans sa peinture d’un milieu social, voire d’une culture bien réelle. Avec cinquante ans de recul, ces personnages nous touchent toujours autant, tellement ils sont vrais, dans leurs silences, comme dans leurs gestes. Avec On est loin du soleil, Jacques Leduc devient cinéaste à part entière : son regard sur le monde lui appartient et est désormais identifiable, ce que ne manqueront pas de confirmer les films qui vont suivre. 1971 – Je chante à cheval avec Willie Lamothe Réalisation : Jacques Leduc et Lucien Ménard. Images : Alain Dostie. Son : Serge Beauchemin. Montage : Pierre Bernier. Production : onf / Paul Larose. 57 minutes. Portrait du chanteur western faisant suite à son apparition fortuite dans On est loin du soleil, Je chante à che val démarre en grand spectacle par le défilé inaugural du Festival western de Saint-Tite. Jean Chrétien, revêtu des plus beaux atours d’un chef amérindien, est en tête de cortège, alors que Willie Lamothe doit se contenter d’un « covered wagon ». Mais il reprendra la vedette dès le plan suivant et tout le film sera désormais à son service. Chanteur immensément populaire à travers tout le Québec – et même en Ontario francophone, c’est lui qui le rappelle au passage –, Willie Lamothe était un personnage haut en couleur, ce que le film traduit bien. Qu’il soit sur scène avec son fidèle Bobby Hachey, ou dans son jardin aux côtés de son épouse, l’artiste se 102
livre généreusement, sachant que ses interlocuteurs sont des amis, soucieux de transmettre de lui un portrait aussi chaleureux que cocasse. L’opération est réussie ! Ce film sans prétention est le portrait attachant d’un artiste issu d’un milieu populaire modeste (lui-même ayant pratiqué trente-six métiers et ayant quitté une job en usine pour devenir chanteur professionnel) qui le reconnaissait comme l’un des siens. Willie Lamothe – et ce n’est pas là sa moindre qualité – ne se prenait pas au sérieux : il donnait « un bon show » et était heureux de voir les gens s’amuser à ses blagues et à ses chansons. Il chantait « pour les pauvres, pour les gens qui s’ennuient » (ce sont ses mots) et avait un respect profond pour son public. Je chante à cheval avec Willie Lamothe célèbre sans prétention la culture populaire québécoise et l’un de ses héros. Le contact chaleureux que les cinéastes ont réussi à installer avec le chanteur est à porter à leur crédit ; pour le spectateur, ce retour dans le temps est un précieux voyage. (Willie Lamothe jouera par la suite dans trois films de Gilles Carle, deux films de Jean-Claude Lord et sera sur le même plateau que Jeanne Moreau dans Je t’aime de Pierre Duceppe.) 1973 – Tendresse ordinaire Réalisation : Jacques Leduc. Scénario : Robert Tremblay. Images : Alain Dostie (assisté de Guy Rémillard). Son : Jacques Drouin. Montage : Pierre Bernier. 103
Musique : Jocelyn Bérubé, Plume Latraverse. Interprétation : Esther Auger, Jocelyn Bérubé, Luce Guilbeault, Jean-Pierre Bourque, Claudette Delorimier, J.-Léo Gagnon, Plume Latraverse, Jean-René Ouellet. Production : onf / Paul Larose. 82 minutes. Sur plusieurs points, Tendresse ordinaire prolonge l’expérience de On est loin du soleil : même parti pris d’écriture, même montage (en coupes franches), même rapport au temps – sans parler de la présence d’Esther Auger et J.-Léo Gagnon, transfuges bienvenus du film précédent. Film sur l’attente (une jeune femme attend le retour de son mari, travailleur saisonnier sur la CôteNord), Tendresse ordinaire est un film sur le temps qui passe et qui, souvent malgré nous, définit nos vies. Dans Tendresse ordinaire, on « prend son temps » (en faisant un gâteau, en pelant une orange) ; on « tue le temps » (sur le train, au supermarché) ; on « trouve le temps long », pendant que le mari est au loin. Le temps est partout ; il pèse sur les gestes et les choses et donne tout son poids à l’hiver qui dure trop longtemps. Les femmes ont beau « faire des gâteaux en Espagne », le temps les rattrape, menace leur amitié. L’hiver, les choses ont un poids différent, comme le suggère la série de plans très courts filmés comme autant de natures mortes quand la jeune femme décide de provoquer le printemps ; ce poids aussi se traduit en temps étiré, la saison devenant un sablier trop lent, surtout pour celle qui attend. Dans Tendresse ordinaire, faire un gâteau blanc très simple (« sans crémage ») est un événement majeur, à l’occasion duquel naît la complicité qui permet de 104
survivre à l’attente. Exemplaire de la méthode Leduc, cette séquence installe le film dans sa durée propre : la farine tamisée étant tout à la fois l’hiver magnifié et le temps qui file entre les doigts. La justesse du point de vue, la sensibilité du cinéaste à la beauté de ces gestes pourtant si simples apportent au rituel du gâteau une grandeur et une émotion exceptionnelles. La plastique du film participe aussi de cette émotion : lumière éclatante de l’hiver, paysages dramatiques de la Côte-Nord, chaleur de la maison du jeune couple, tout concourt à la création d’un univers qui nous devient vite familier et accueillant. C’est d’ailleurs dans la lumière, une lumière miraculeuse, que le film se termine, apothéose miraculeuse après cet hiver trop long, magnifiquement annoncée par le son amplifié des bottes de Jocelyn au premier plan du film. 1973 – Alegria Réalisation : Jacques Leduc. Images : Réo Grégoire. Son : Claude Lefebvre. Montage : Marthe de la Chevrotière. Production : onf / François Séguillon. 28 minutes. Frederick Anders est luthier amateur. Depuis sa retraite, il fabrique des guitares dans le sous-sol de sa maison de Pierrefonds. La voix de Leduc nous invite à le regarder travailler. Nouveau portrait. Nouveau registre. Après Willie, l’exubérant qui a besoin d’un public pour exister, voici Fred, effacé, discret, qui aime travailler seul. Admis 105
dans son atelier, le cinéaste, respectueux des rituels du lieu, cherche un coin d’où ne pas déranger ; fait l’inventaire des outils ; enregistre les gestes du luthier ; essaie de comprendre comment naît une guitare. Ce film très simple, dans son montage comme dans son filmage, est un film contemplatif qui nous permet de nous approcher d’un sage – ce sont les mots de Leduc. D’où les plans du visage de Fred concentré sur son travail qui est fait de minutie et d’intuition ; d’où ce plan de son regard ébloui par les sons que le guitariste invité tire de la guitare à peine terminée. Une histoire d’amitié aussi qui fait bon usage des acquis de On est loin du soleil. 1977-1978 – Chronique de la vie quotidienne Lundi : « Une chaumière, un cœur » Réalisation : Jacques Leduc, Roger Frappier. Images : Pierre Letarte, Gilles Gascon, Jean-Charles Tremblay. Son : Claude Lefebvre, Jacques Drouin. Montage : Alain Sauvé. Production : onf / Jacques Bobet. 1977. 45 minutes. Un jeune couple se fait construire un bungalow de banlieue, pendant qu’une technicienne en laboratoire fait appel à une agence de rencontres pour se trouver un partenaire. Et le salon de l’automobile bat son plein. Portrait en mineur de la société de consommation, celle qui nous rattrape chaque lundi matin, au moment de retourner au travail. 106
Construit sur un montage parallèle très efficace, le film passe de celle qui « cherche l’âme sœur » auprès du conseiller de l’Institut humaniste, à celle qui cherche davantage d’espaces de rangement pour sa petite famille. Mais, comme le dit le conférencier jovialiste, « on n’attend pas le bonheur », il faut aller le chercher, et l’orgasme parfait n’est pas donné à tout un chacun ! Tournage in situ, selon les principes du cinéma direct (équipe réduite, son synchro), les cinéastes se fondent dans le décor – seul le micro qui apparaît de temps en temps dans l’image atteste leur présence. Mardi : « Un jour anonyme » Réalisation : Jacques Leduc, Jean Chabot, Jean-Guy Noël. Images : Pierre Letarte, François Beauchemin, Martial Filion, Gilles Gascon. Son : Claude Lefebvre, Claude Hazanavicius, Pierre Blain, André Dussault, Serge Beauchemin. Montage : Alain Sauvé. Production : onf / Jacques Bobet. 1978. 27 minutes. Le titre est ironique : ce mardi, bien observé par Leduc et ses camarades, est loin d’être anonyme. C’est peut-être un mardi comme les autres, mais il s’y passe beaucoup de choses : à la campagne, le cultivateur rassemble son troupeau, prépare la traite des vaches et distribue la moulée ; en ville, le laitier démarre sa « run », les enfants vérifient les pneus de leurs vélos. Caméra à l’épaule, les cinéastes captent la vie fébrile d’un quartier populaire : le trottoir comme terrain de jeu pour les enfants, le balcon improvisé pour 107
y installer sa berceuse ; un déménagement qui suscite la curiosité ; un chien qui fait le beau. Ailleurs, le marché Jean-Talon s’anime, un cassecroûte accueille ses habitués, une « ruine-babines » fait danser les retraités : partout la vie installe sa diversité. Plaisir de saisir des gestes à l’improviste, de regarder vivre la ville, de faire descendre le cinéma dans la rue. Mercredi : « Petits souliers, petit pain » Réalisation : Jacques Leduc, Jean Chabot, Gilles Gascon. Images : Gilles Gascon, Martial Filion, Pierre Letarte, Benoît Rivard. Son : Claude Hazanavicius, André Dussault, Serge Beauchemin. Montage : Alain Sauvé. Production : onf / Jacques Bobet. 1977. 34 minutes. Portrait polémique de deux groupes de femmes (celles qui travaillent et celles qui jasent), Petits souliers, petit pain est aussi un véritable documentaire industriel sur le haricot jaune, du champ où il pousse jusqu’à la boîte de conserve de l’épicerie de quartier. Enfin, c’est un film sur des hommes et (surtout) des femmes au travail. La caméra est très présente en ce mercredi ; nous savons toujours qu’elle est là et qu’elle nous invite à regarder attentivement ; au besoin, elle est portée à l’épaule – long plan athlétique du serveur qui rapporte un bac aux cuisines – pour mieux nous faire sentir l’effort. Rien n’échappe à l’œil des cinéastes : la coquetterie bien mondaine des bénévoles qui se retrouvent, en 108
toute simplicité, par un beau mercredi midi du mois d’août, dans une résidence secondaire de SaintSauveur ; pas plus que les gestes, abrutissants autant que répétitifs, de celles qui bossent à la conserverie : nul besoin de commentaire, ces images parlent d’ellesmêmes, avec l’éloquence si particulière du cinéma direct. Jeudi : « À cheval sur l’argent » Réalisation : Jacques Leduc. Images : Gilles Gascon, Pierre Letarte, Benoît Rivard. Son : Claude Lefebvre. Montage : Alain Sauvé. Production : onf / Jacques Bobet. 1977. 17 minutes. C’est la plus courte des chroniques, la plus structurée aussi. Bien que les images appartiennent à plusieurs caméramen, Leduc semble avoir été le seul maître d’œuvre. Blue Bonnets, hippodrome où l’argent (et la défense de l’argent) semble unir tout le monde, s’oppose aux balcons d’un quartier populaire de Montréal, sans doute en voie de disparition et où l’argent, on peut facilement le deviner, est aussi une préoccupation permanente. Si certains perdent leur maigre salaire en misant sur un cheval, d’autres calculent leur pension de retraite au dollar près, en rêvant de voyages. Et l’argent circule, au besoin par tube pneumatique ! La caméra capte les moindres gestes, nous permet de pénétrer dans l’arrière-boutique de l’hippodrome, fidèlement accompagnée par un preneur de son (dont 109
la perche apparaît inopinément dans un plan) qui enregistre tous ces chiffres porteurs d’espoir, de malheur aussi. En dix-sept minutes, ce petit film sans prétention est exemplaire : toutes les qualités du cinéma direct y sont réunies. Une sorte de « classe de maître ». Vendredi : « Les chars » Réalisation : Jacques Leduc. Images : Gilles Gascon, Pierre Letarte. Son : Jacques Drouin, Joseph Champagne, Claude Lefebvre. Montage : Alain Sauvé. Production : onf / Jacques Bobet. 1978. 24 minutes. Le titre dit déjà tout ! Carambolage sur le boulevard Métropolitain, camion-citerne renversé, auto qui perd une roue, camion qui fait du surplace dans la neige, nouvelle Chrysler Cordoba au Salon de l’auto : il n’est ici question que d’autos. S’il s’annonce modeste dans son propos, Les chars est un tour de force d’unité et de cohérence. La vie d’un garage, son atmosphère des soirs de tempête, les propos colorés des garagistes, s’échappe du quotidien pour devenir un geste de théâtre. Pendant ce temps, à l’extérieur, la tempête s’abat sur la ville et n’épargne personne. La caméra a tout vu, tout entendu aussi, et jamais nous n’oublierons cette tempête !
110
Samedi : « Le ventre de la nuit » Réalisation : Pierre Bernier, Jean Chabot, Roger Frappier, Claude Grenier, Jacques Leduc. Images : Martial Filion, André Gagnon, Pierre Letarte, Benoît Rivard, Jean-Charles Tremblay. Son : Pierre Bernier, Jacques Blain, Alain Corneau, André Dussault, Claude Lefebvre. Montage : Fernand Bélanger. Production : onf / Jacques Bobet. 1977. 82 minutes. Seul long métrage de la chronique, Le ventre de la nuit est aussi le chapitre où le caractère collectif de l’entreprise est le plus en évidence, cinq réalisateurs se partageant la paternité du film. Bien malin le cinéphile qui pourra déterminer auquel d’entre eux appartient tel ou tel épisode… Cette Saint-Jean-Baptiste de 1973 est totalement éclatée : du party de balcon au bingo d’aréna, en passant par un concours de danse et la fermeture du cinéma Capitol de la rue Sainte-Catherine, on y rencontre à chaque détour une espèce de tristesse ordinaire qui laisse chez le spectateur un goût plutôt amer. Si on rigole à la séance d’hypnotisme et à la gigue en sabots, l’ensemble est surtout imprégné d’un sentiment de grande défaite dans cette lutte contre l’ennui. Seul film de la série monté (brillamment) par Fernand Bélanger, Le ventre de la nuit est un film complexe dans lequel le passage d’un lieu à un autre, d’un sujet à un autre, se fait fréquemment par le biais de la bande sonore. Souvent la musique tient lieu de point de vue des cinéastes sur le moment saisi : la 111
musique mécanique de manège qui ouvre le film en annonce bien la couleur. Si les cinéastes s’interdisent tout jugement, il n’en reste pas moins que leur regard sur cette journée de la Saint-Jean n’est pas neutre : il y a ici bien peu de raisons de se réjouir. On peut toujours aller au ciné-parc, jouer à la roue de fortune ou au bingo, danser jusqu’à l’épuisement, ou caler quelques bières sur son balcon, le temps est toujours lourd et la fête n’est pas vraiment au rendez-vous. Dimanche : « Granit » Réalisation : Jacques Leduc. Images : Pierre Letarte, Jean-Charles Tremblay, Gilles Gascon. Son : Claude Lefebvre, Claude Hazanavicius, Claude Delorme. Montage : Alain Sauvé. Production : onf / Jacques Bobet. 1977. 30 minutes. L’inscription du nom de Gertrude Adler dans le gra nit d’une pierre tombale est le prétexte à une réflexion sur la vie. Loin de tout discours philosophique, le film convoque des images « ordinaires » (une excursion de pêche, une manifestation de grévistes, le départ à la retraite d’un vieil employé de l’onf) pour illustrer l’expression « le temps qui passe ». Même inscrite dans le granit, la vie est toujours trop courte et le regard attentif des cinéastes traduit en toute simplicité le poids réel des choses.
112
Le plan sentimental Réalisation : Jacques Leduc. Traitement sonore : Yves Daoust. Montage : Serge Viau, Anne Whiteside. Animation : Jacques Drouin. Production : onf / Jacques Bobet. 1978. 10 minutes. Au moment de faire le grand ménage de la salle de montage, Jacques Leduc retrouve dans le chutier des plans qu’il aime beaucoup, mais qui n’avaient pas trouvé place dans la Chronique… Une fois montées, ces images disparates, qui n’ont pour lien que le regard des cinéastes, deviennent une sorte de résumé de cette grande aventure qu’a été Chronique de la vie quotidienne. Le plaisir de filmer, de regarder vivre les gens, est partout dans ces plans, heureusement sauvés par un cinéaste sentimental. 1982 – Albédo Réalisation et scénario : Jacques Leduc, Renée Roy. Images : Jean-Pierre Lachapelle, Pierre Letarte, Jacques Tougas. Son : Yves Gendron, Serge Beauchemin. Musique : René Lussier, Jean Derome (d’après le Nocturne no 5 de Gabriel Fauré), Pierre St-Jacques, Ti-Lou Babin. Montage : Pierre Bernier, Suzanne Bouilly. Interprétation : Paule Baillargeon, David Chagnon, Pierre Foglia, Luce Guilbeault, Jean-Pierre Saulnier. Production : onf / Jacques Bobet. 52 minutes.
113
Essai documentaire ou fiction documentée, Albédo est un objet inclassable ; c’est ce qui fait sa richesse et sa modernité. Véritable coupure dans le travail de Leduc, le film puise à son expérience documentaire pour alimenter (enrichir) le désir de fiction qui habite désormais le cinéaste. Portrait d’un quartier, Griffintown, et d’un homme, David Marvin, qui l’a arpenté avec son appareil photo, Albédo trouve un équilibre étonnant entre le tragique et le léger : la vie d’un homme atteint de surdité et qui se réfugie « dans le silence du passé » se conjuguant avec les badineries d’un couple d’amoureux en balade dans le quartier en question. David Marvin s’est enlevé la vie en 1975 pour mettre fin à l’isolement dans lequel sa surdité le confinait. « J’étais sourd et le monde m’était devenu étranger… J’étais complètement isolé des autres », confie-t-il à son journal. Il n’en essaie pas moins d’établir des liens avec ce monde, l’appareil photo venant remplacer l’oreille qui est morte : c’est désormais en photographiant qu’il va entendre le monde. Mais Griffintown, la « basse ville » des prolétaires et des Irlandais fuyant la famine du milieu du xixe siècle, est un quartier que la ville moderne violente, charcute au besoin. Le film nous parle avec la même empathie de cet homme et de ce quartier : les deux en pleine déconstruction. David a bien compris ce qui se passe : « Mon histoire ressemble à celle de Griffintown », note-t-il dans son journal. Pour nous dire ces deux histoires parallèles, Leduc n’hésite pas à emprunter les codes d’une mise en scène 114
théâtrale : absence de dialogues, gestes appuyés, décors minimalistes – à la limite de l’abstraction. La séquence d’ouverture, le suicide de Marvin, est exemplaire de ce choix audacieux. Ainsi stylisé, le quotidien éprouvant de David Marvin affiche son tragique avec violence ; le silence qui le gouverne est une véritable chape de plomb qui piège les situations les plus ordinaires – le réveil de son fils, par exemple. Cette stylisation assumée se retrouve également dans le traitement sonore du film : certaines images n’ont aucun accompagnement sonore, alors que la musique hypnotisante qui intervient en d’autres moments est une transcription hautement stylisée d’un Nocturne de Fauré due à Jean Derome et René Lussier. « Inspiré des écrits et des photographies de David Marvin », comme le rappelle le générique, ce film, par son personnage tragique, comme par l’allure de certains lieux (le Griffintown Horse Palace, notamment), semble tout droit sorti de Dostoïevski. D’où le choix déroutant des cinéastes d’opposer à ce décor la légèreté du couple Pierre Foglia-Paule Baillargeon qui traverse le film en batifolant, histoire, pourrait-on supposer, de souligner encore davantage le côté tragique de la vie de David Marvin. Sur un plan plus strictement cinématographique, Albédo annonce explicitement la volonté de Leduc de continuer le travail avec des comédiens : Luce Guilbeault est de retour, dans un rôle silencieux, mais éloquent, et Jean-Pierre Saulnier, par sa présence physique, donne à David Marvin une présence aussi émouvante que pleine de mystère. 115
Film de transition qui annonce déjà les thèmes et les choix esthétiques qui marqueront les œuvres de la maturité, Albédo est un film déterminant dans l’œuvre de Jacques Leduc. Œuvre ouverte, il pourrait avoir été tourné en 2019 – et il étonnerait ! 1984 – Le dernier glacier Réalisation et scénario : Roger Frappier, Jacques Leduc. Images : Jacques Leduc, Pierre Letarte. Son : Claude Beaugrand. Montage : Monique Fortier. Musique : Jean Derome, René Lussier. Interprétation : Robert Gravel, Louise Laprade, Martin Dumont, Michel Rivard, Marie St-Onge, Renato Battisti. Production : onf / Jean Dansereau. 84 minutes. Le 2 novembre 1982, l’Iron Ore, par la voix de son président, Brian Mulroney, annonce la fermeture de sa mine de Schefferville. Les cinéastes décident de réagir immédiatement, à chaud, avant que la ville ne se vide de ses habitants, tous dépendant de la mine pour leur gagne-pain. Film exemplaire sur la fin d’une ville – tout y est : l’histoire du lieu, les discours officiels, les analyses économiques –, Le dernier glacier est aussi un film sur le Nord, sur le travail qui décide de la vie, sur la solitude, mais aussi sur la solidarité, l’amour qui s’essouffle et l’amour filial. Mêlant avec un art consommé documentaire et fic tion, Leduc et Frappier dépassent le constat et installent 116
leur film dans l’émotion. Bien servis par des acteurs, en commençant par le grand et regretté Robert Gravel, qui habitent littéralement leurs personnages, les cinéastes multiplient les points de vue sur la réalité complexe qui s’abat sur les travailleurs de Schefferville. Le film est également exemplaire de ce que peut apporter un usage intelligent du « split screen ». Permettant de mettre en parallèle propos officiels et propos des habitants, images d’archives et images actuelles, témoignages et rires d’enfants, le « split screen » dynamise l’information, l’inscrit naturellement dans le récit. De même en est-il de l’image dans l’image (Raoul dans le train), qui prend des allures de citation, ou mieux d’encadré dans le texte principal. Seule une monteuse chevronnée comme Monique Fortier pouvait réussir ce tour de force : rendre normale, et plastiquement réussie, l’inclusion de cette astuce technique qui, entre d’autres mains, n’eût été que décorative. Territoire réputé inatteignable et inhabitable, ce pays est pourtant habité par des Autochtones (très présents dans le film), puis par des Inuits, depuis des millénaires, comme le rappelle au passage un anthropologue. Quant aux Blancs, ils sont venus dans les années 19361937 y chercher des échantillons de minerai qui ont provoqué la création de Schefferville et l’émigration vers le Nord de plusieurs centaines de travailleurs qui devront désormais retourner au Sud – c’est-à-dire à Québec, Rimouski, Matane, voire Sherbrooke dans le cas de Raoul. Bâtisseurs d’un pays rude qu’ils ont appris à aimer, la plupart d’entre eux n’acceptent pas l’idée que leur 117
ville va disparaître. Les cinéastes donnent délibérément la parole aux enfants qui y sont nés et pour qui Schefferville, c’est chez eux. Même pour Carmen, qui pourtant a suivi Raoul à reculons, c’est ici qu’elle veut continuer à vivre et à élever le fils qui était dans son ventre quand elle y est arrivée. La nature, très présente dans le film et magnifiquement filmée par Pierre Letarte et Leduc lui-même, est une raison supplémentaire de rester. Cette nature, avec ses hivers redoutables, n’a aucun équivalent ailleurs ; ces gens l’ont apprivoisée et ne veulent plus s’en séparer : « On veut vivre icitte ! », proclame l’un d’eux. Plus philosophiquement, comme le dit le personnage de Léonard, « c’est quoi, avoir sa vie ? », à Schefferville ou ailleurs… Film ambitieux dans son propos, Le dernier glacier réussit harmonieusement à filmer des comédiens comme s’ils étaient citoyens de la ville ; à articuler his toire ancienne (les premiers forages, la construction de la ville) et histoire actuelle ; à passer du public (la fermeture de la mine) au privé (la séparation du couple). Tout cela bien résumé dans la belle complainte de Michel Rivard : « J’ai vu mourir ma ville sous le soleil du Nord. » 1987 – Notes de l’arrière-saison Réalisation : Jacques Leduc, avec la collaboration de Jean-Marc Piotte. Images : Jean-Pierre Lachapelle, Pierre Letarte. Son : Claude Beaugrand, Richard Besse. 118
Montage : Pierre Bernier. Musique : Jean Derome, René Lussier. Production : onf / Éric Michel. 20 minutes. Leduc insiste pour faire précéder le film d’un soustitre : Une courte réflexion sur le passage du temps. « Courte » est le mot juste ! Compte tenu de l’époque – « autour du 2 décembre 1985 », nous précise le film – et des enjeux sur la table (une élection provinciale qui va ramener au pouvoir un gouvernement libéral majoritaire), les propos des militants rassemblés par le politicologue Jean-Marc Piotte nous semblent bien légers. Il y a dans ce discours un côté « anciens combattants » qui est assez gênant ; c’est du moins le cas avec le recul. Et on s’explique mal le silence de Piotte qui aurait pu réveiller le feu sous la braise… « On a perdu nos illusions, mais on n’a pas perdu nos rêves » semble être le leitmotiv des conversations des quarantenaires rassemblés d’abord au café, puis pour regarder ensemble la soirée des élections à la télévision. Pendant ce temps, une étudiante en communication fait campagne pour un jeune professeur de cégep, candidat (sans illusions) du NPD. Le Québec était-il à ce point défaitiste au milieu des années 1980 ? Où était donc passé l’enthousiasme, au besoin utopiste, des années 1960 ? C’est peut-être là le vrai mérite du film : nous faire réfléchir sur « le passage du temps », comme nous le suggère le cinéaste.
119
1987 – Le temps des cigales Réalisation : Jacques Leduc, avec la collaboration de Jean-Marc Piotte. Images : Jacques Leduc. Son : Esther Auger. Montage : Pierre Bernier. Musique : Jean Derome, René Lussier. Production : onf / Éric Michel. 29 minutes. Leduc, ce n’est pas d’hier, est sensible à l’air du temps. À l’occasion du défilé du 1er mai 1986, caméra à l’épaule, il rend visite à quelques femmes qui toutes, en des lieux divers (syndicats, groupes de gauche, organisations de femmes), ont été militantes. La révolution ayant été différée, c’est maintenant le temps des bilans. Si Sylvie savoure ses quarante ans (en chantant les bienfaits de l’assurance-chômage) et la sérénité lucide qui les accompagne, d’autres demeurent inquiètes, voire angoissées face à la vie qu’il faut affronter, davantage encore si on est femme. Les angoisses, ce n’est pas le fort du jeune négociateur en bourse qui planifie son avenir radieux, après des vacances bien méritées au Club Med. L’air de rien, sans discours, le cinéaste donne la parole aux femmes, remet en question le rôle toujours dominant des hommes. Un film d’écoute, d’espoir aussi, même si le 1er mai est désormais un peu convenu. « Ce n’est qu’un début, continuons le combat. »
120
1988 – Charade chinoise Réalisation : Jacques Leduc avec la collaboration de Jean-Marc Piotte. Images : Jean-Pierre Lachapelle, Jacques Leduc, Pierre Letarte, Roger Rochat. Son : Richard Besse, Claude Beaugrand, Esther Auger. Mon tage : Pierre Bernier. Musique : René Lussier, Jean Derome, Robert Marcel Lepage, Bernard Buisson. Animation : Pierre Hébert. Production : onf / Éric Michel. 91 minutes. Pour fêter la Saint-Jean-Baptiste, Leduc invite des militants de son âge (la génération de quarante ans), plus quelques jeunes (« pour donner l’heure juste »), à passer la fin de semaine dans une auberge des Cantonsde-l’Est. La voix de Leduc précise la nature du projet en signalant notamment le « rapport d’affection entre ceux qui filment et ceux qui ont été filmés », d’où la présence majoritaire dans le groupe des militantes et militants qui apparaissaient dans les deux films précédents. Le programme de cette fin de semaine pluvieuse est clairement annoncé : revoir Notes de l’arrière-saison et Le temps des cigales et en faire une sorte de critique (ou d’autocritique) collective. Les deux films sont très largement cités, la plupart du temps dans leur montage original : aux protagonistes d’en évaluer la pertinence. Au besoin, notamment au moment d’une panne de courant, les dessins de Pierre Hébert apporteront un commentaire supplémentaire. L’exercice n’est pas toujours facile : les hommes admettent volontiers que les propos des femmes sont plus sentis, moins théoriques ; 121
la jeune militante du NPD refuse l’image qu’elle projette ; le négociateur en bourse n’accepte pas d’être devenu le symbole du capitalisme. Très tôt – de fait, dès le générique du début –, Charade chinoise devient aussi une réflexion sur le cinéma, le cinéma documentaire en particulier. Au besoin, des membres de l’équipe technique traversent l’image ; le cinéaste lui-même converse avec l’un des participants dans la séquence finale. Mais c’est d’abord dans la démarche même du film que la question du cinéma est posée : « Peut-on filmer des idées ? » semble nous demander Leduc, qui témoigne à plusieurs reprises de son attachement au documentaire, en admettant néanmoins que, dans le geste de filmer, « le hasard est plus fort que le cinéma ». Bilan d’un bilan – c’est bien le sens des tête-à-tête de la séquence de clôture –, Charade chinoise est aussi la réflexion salutaire d’un cinéaste qui croit au pouvoir de ses outils, tout simplement parce que « les images filmées deviennent le contenu des films » et que « filmer, c’est intervenir », voire changer un peu le monde… 1989 – Trois pommes à côté du sommeil Réalisation : Jacques Leduc. Scénario : Michel Langlois, Jacques Leduc. Images : Pierre Letarte. Son : Claude Beaugrand, Esther Auger. Montage : Pierre Bernier. Musique : René Lussier, Jean Derome (d’après JeanSébastien Bach). Interprétation : Normand Chouinard, Paule Baillargeon, Josée Chaboillez, Paule Marier, 122
Hubert Reeves, Guy Nadon, Elzbieta Koczorowski. Production : Groupe Malofilm et onf / Suzanne Dussault, Pierre Latour. 96 minutes. Trois pommes à côté du sommeil 8 est un film grave servi par une écriture aussi complexe que maîtrisée. Jamais l’art de Pierre Bernier (sa complicité avec le réalisateur) n’a été aussi déterminant dans la mise en forme du discours du cinéaste. Jacques Leduc a quarante-sept ans quand il entreprend avec Michel Langlois le travail de scénarisation qui mènera à un film unique dans sa filmographie, un film qui s’impose comme l’aboutissement heureux de plus de vingt années de travail. Trois pommes à côté du sommeil se présente comme « une journée dans la vie d’un homme d’aujourd’hui ». Cet homme de quarante ans (impeccablement interprété par Normand Chouinard), troublé par ce moment où, nous dit-on, « la vie commence », se cherche et se fuit simultanément. Le film décrit son errance et son questionnement, les questions venant davantage des femmes qu’il côtoie, de celle notamment avec laquelle il a longuement partagé sa vie, que de lui-même, plutôt adepte de la fuite en avant. Pour peindre cet homme en fuite, Leduc pratique une écriture en mosaïque – un film « cubiste », a-t-il dit lui-même –, où les plans se succèdent dans un apparent désordre, où les saisons et les histoires s’entremêlent dans un ordre qui appartient au rêve et à la poésie davantage qu’à une narration bien structurée. Les premiers plans du film (les pommes en équilibre, 123
la tête endormie du héros) ne laissent d’ailleurs aucun doute à ce sujet. Cette temporalité bousculée n’a rien d’arbitraire : elle traduit parfaitement l’état d’esprit du personnage, notamment son côté sans domicile fixe. Réflexion sur la quarantaine, Trois pommes à côté du sommeil, dans son propos, mais davantage encore dans sa construction, est un film sur le temps : le temps qui passe, le temps qui fuit, le temps qui s’arrête. Et Madeleine d’enfoncer le clou en disant à son ancien com pagnon : « Tu bouges tout le temps. » Alors qu’Hubert Reeves lui conseillera plus tard de « prendre le temps », voire de le « capturer ». Cette bougeotte qui le mène d’une femme à l’autre, d’une idée saugrenue (écrire un article scientifique sur la pomme) à un discours savant avec l’astrophysicien écologiste Hubert Reeves, l’essouffle de plus en plus, l’enferme dans sa confusion. Seule l’amitié retrouvée, le temps d’un souper de Saint-Valentin, lui donnera momentanément confiance dans la vie. Mine de rien, le film est aussi une réflexion sur l’art – sur le cinéma, bien sûr. Si L’homme rapaillé est cité à deux reprises, réaffirmant la pertinence du discours poétique, dans le public comme dans le privé, c’est l’art, comme lieu, qui est défini par un des personnages (une femme de nouveau) : la fonction de l’œuvre d’art, c’est de capter l’émotion. Ce qui pourrait bien être le programme du film de Leduc : tout ici concourt à capter l’émotion que le héros essaie de bannir de sa vie – l’annonce de la grossesse de Madeleine (bouleversante Paule Baillargeon) est exemplaire de cette quête, à contre-courant de la dérive de l’homme. 124
Incité par sa rencontre avec Hubert Reeves à « rechercher le silence intérieur », à la limite à « devenir arbre » pour regarder la vie, l’homme de quarante ans constate sa fragilité ; saura-t-il lui faire échec ? Ou continuera-t-il à aller de Madeleine en Geneviève, en passant par Pascale et Nicole ? Le film nous laisse avec la question. Ce beau film qui, à travers son héros, nous interpelle intimement, est aussi une œuvre inscrite dans le temps historique : les lendemains référendaires, le passé militant de Madeleine et les funérailles de René Lévesque sont là pour nous rappeler que la crise du protagoniste de Trois pommes à côté du sommeil appartient à une époque précise, qu’elle dépasse largement le héros et son destin. Héritier du documentaire des années 1960, Leduc n’a aucun mal à mélanger harmonieusement les genres, au besoin ouvrant une parenthèse pour nous proposer une galerie de portraits ou s’attardant – comme au temps de Chronique de la vie quotidienne – sur les autos en lutte avec l’hiver. Tout l’art de Jacques Leduc est ici résumé, du travail d’équipe (ses vieux complices Letarte, Bernier, Beaugrand et Derome sont de la partie) au regard chaleureux qui s’interdit tout jugement, au plaisir de bousculer le récit pour nous emmener ailleurs. Il n’y a pas de doute, Trois pommes à côté du sommeil est l’un des grands moments du cinéma québécois.
125
1989 – Bande-annonce du Festival international de cinéma en Abitibi-Témiscamingue Réalisation : Jacques Leduc. Images : Jacques Leduc. Son : Philippe Scultety. Montage : Pierre Bernier. Animation : Jacques Drouin. Musique : Robert Marcel Lepage. Production : onf. 1 minute. Film de commande (et cadeau de l’onf) réalisé par amitié pour le festival. « Ce serait beaucoup plus facile si j’avais soixante minutes », aurait dit Leduc aux commanditaires. 1991 – Montréal vu par… Six variations sur un thème : « La toile du temps » Réalisation : Jacques Leduc. Scénario : Jacques Leduc, Marie-Carole de Beaumont. Images : Pierre Letarte. Son : Serge Beauchemin. Montage : Pierre Bernier. Musique : Jean Derome. Interprétation : Jean-Louis Millette, Normand Chouinard, Monique Mercure, Yves Jacques. Production : Atlantis Films et Cinémaginaire international / Denise Robert. 124 minutes (durée totale). Projet typique de producteur, Montréal vu par… invitait six cinéastes à parler de la ville à travers un court métrage de fiction. Plutôt que d’utiliser Montréal comme décor, Leduc en fait le sujet même de son film à travers les cent quarante années d’histoire d’un 126
supposé portrait du premier maire de Montréal, Jacques Viger. Entièrement tourné en studio et en faisant usage du procédé « back screen » qui permet d’utiliser des images d’archives pour dater le récit, le film devient une véritable gageure technique que Letarte et Leduc remportent haut la main, avec l’aide d’une distribution hors pair – le comique Claude Blanchard y fait même une apparition remarquée ! Réflexion sur l’histoire, ses incohérences et ses mensonges, La toile du temps est un divertimento à moitié réussi qui permet au cinéaste de reprendre son souffle après l’entreprise exigeante qu’avait été Trois pommes à côté du sommeil. 1991 – L’enfant sur le lac Réalisation : Jacques Leduc. Scénario : Yvon Rivard. Images : Daniel Jobin. Montage : Yves Chaput. Musique : Pierre Cartier. Interprétation : René Gagnon, Patricia Tulasne, Monique Lepage, Nathalie Coupal, Lionel Villeneuve, Marc-André Grondin. Production : Max Films, onf et Producteurs TV-Films Associés / Roger Frappier. 78 minutes. Ce film de commande doit être considéré comme une parenthèse dans l’œuvre de Leduc. Formaté comme un téléfilm (ce qu’il devait être), rien dans son écriture, malgré certains thèmes chers au cinéaste (le passé qui colle à la peau, la fidélité) ne renvoie à ses recherches 127
antérieures : scénario psychologisant servi par un comédien trop lisse, montage mécanique alourdi par des flashbacks télégraphiés, musique envahissante qui souligne chaque émotion, mise en scène illustrative… Où est donc passée la liberté d’écriture de Trois pommes à côté du sommeil ? Le cinéaste prend plaisir à diriger les comédiens et prouve à son producteur qu’il peut « livrer la marchandise », mais son cœur est ailleurs : dans la scénarisation de La vie fantôme à laquelle il travaille – belle ironie ! – avec Yvon Rivard. 1992 – La vie fantôme Réalisation : Jacques Leduc. Scénario : Yvon Rivard, Jacques Leduc (d’après le roman homonyme de Danièle Sallenave). Images : Pierre Mignot. Son : Richard Besse, Claude Beaugrand. Montage : Yves Chaput. Musique : Jean Derome (d’après Beethoven). Interprétation : Ron Lea, Pascale Bussières, Johanne-Marie Tremblay, Élise Guilbault, Gabriel Gascon, Rita Lafontaine. Production : Max Films et onf / Roger Frappier. 98 minutes. La vie fantôme se termine sur une question : « Estce ça, notre vie ? » Cette question, que Laure se pose après avoir calculé qu’elle passera deux mois avec son amant au cours des dix prochaines années, hante tout le film, sans jamais que les personnages, ou le cinéaste, n’osent y répondre. Et pour cause : cette réponse n’existe pas ; elle appartient au monde de l’amour fou dans 128
lequel passion, désir, attachement, complicité et autres choses mystérieuses se rencontrent en un mélange explosif. Décidé – une fois n’est pas coutume ! – à raconter une histoire, Leduc emprunte à la romancière Danièle Sallenave l’histoire d’un triangle amoureux qu’il choisit de servir scrupuleusement par une direction d’acteurs serrée et un montage classique, presque linéaire. Si la durée de certains plans (l’amour en forêt, le choix d’une place dans le lit) atteste du poids des choses, ou, au contraire, de leur légèreté, comme a toujours si bien su le faire le cinéaste, l’ensemble du film est plutôt classique, peut même paraître manquer d’audace. De fait, son audace est ailleurs : dans ce regard presque neutre, amoral, pourrions-nous dire, que le cinéaste porte sur ses personnages. Le bonheur conjugal (la chaleur du foyer, la présence des enfants) et les rencontres amoureuses clandestines de Pierre sont filmés avec la même focale, dans une sorte d’équilibre, fragile bien sûr, mais qui semble pourtant exister. Cette vie fantôme, dans laquelle les gestes affectueux sont « également » distribués, vraisemblablement sanctionnés par une complicité mensongère, le film nous la révèle progressivement, sans jamais juger les protagonistes. Pierre est-il un lâche ? Laure, une opportuniste ? Annie, une manipulatrice ? Le cinéaste se garde bien de trancher, de prendre parti. Dissimuler, mentir, « faire comme si » devient un mode de vie, le seul qui permette les amours impossibles, ces amours soumises à des horaires rigoureux (« on n’a plus qu’une heure »), à des pirouettes au téléphone, à des mises en scène ridicules. 129
Jamais psychologisant, le film de Leduc compte beaucoup sur la musique (les trios à cordes de Beethoven revus par Jean Derome) pour commenter, discrètement mais efficacement, les actions des personnages. Jamais cette musique ne souligne, ou encore moins nous impose, une émotion, elle ajoute une voix : celle du spectateur peut-être… Les relations amoureuses ont toujours constitué un thème récurrent dans les films de Jacques Leduc ; Trois pommes à côté du sommeil en constituait jusqu’à maintenant l’aboutissement. Si La vie fantôme, à travers le personnage de Pierre, poursuit cet examen de l’homme de quarante ans, il le confronte aussi à un autre homme, plus vieux, serein face à son âge et qui se garde bien lui aussi de juger Pierre. Le personnage du professeur Lautier permet au cinéaste de prendre un certain recul face à son héros dont il est pourtant profondément solidaire. (La vie fantôme a été presque entièrement tourné à Sherbrooke, un cas rare à une époque où le cinéma québécois était majoritairement montréalais. Autre particularité : le mari anglophone se prénomme Pierre, alors que son épouse, francophone, se nomme Annie Blackburn.) 1998 – L’âge de braise Réalisation : Jacques Leduc. Scénario : Jacques Leduc, Jacques Marcotte. Images : Pierre Letarte. Son : Claude Beaugrand. Montage : Élisabeth Guido. Musique : Jean 130
Derome. Interprétation : Annie Girardot, France Castel, Michel Ghoyareb, Rose-Andrée Michaud, Domini Blythe, Widemir Normil, Mireille Metellus, Pascale Bussières, Denise Bombardier. Production : onf / Luc Vandal et Productions du Lundi Matin (1985) inc. 97 minutes. Sur un scénario original écrit avec Jacques Marcotte, collaborateur émérite d’André Forcier, L’âge de braise est un conte moral sur l’attente de la mort ; c’est aussi l’un des films les plus personnels de Jacques Leduc – un film imprégné d’une grande tendresse et, en même temps, d’une lucidité admirable. Échec scandaleux au box-office, ce beau film devenu invisible est une œuvre forte dont la redécouverte s’impose. Caroline, le temps de la retraite étant venu, rentre à Montréal après avoir vécu le plus clair de sa vie en Afrique au service d’une ONG. Porteuse d’une vie aussi riche que complexe, elle décide de quitter ce monde sans laisser de traces et de brûler ses souvenirs dans un feu purificateur. Caroline, c’est Annie Girardot, bouleversante dans sa façon très physique d’habiter ce personnage de femme forte dont la détermination à bien quitter la vie n’accepte aucun compromis. Tout le film repose sur elle : l’écran lui appartient et elle l’occupe entièrement, au point où les rôles secondaires sont tous un peu pâlots – à l’exception de France Castel, magnifiquement déchaînée, comme elle sait si bien le faire. Ce jeu éminemment physique est évidemment ce qu’il fallait pour traduire la volonté de cette femme belle et 131
forte de renoncer à son corps à l’heure où la vie ne semble plus vouloir lui apporter quoi que ce soit. Dure avec elle-même, autant qu’avec les autres, Caroline ne veut plus de son image, au point de décrocher les miroirs de sa maison ou de cacher ceux de l’hôtel où l’a logée le gouvernement du Canada au moment de lui remettre le Prix du Gouverneur général. Caroline fait son bilan, regarde sa vie dans les yeux, fait le vide dans sa maison pour être seule avec ellemême, au besoin caresse son corps avec la terre d’un pot de fleurs pour l’habituer à sa nouvelle demeure. Si, comme le dit sa fille aînée, businesswoman de choc, Caroline n’a été qu’« une mère imaginaire », elle aura été une femme entière et bien réelle jusque dans la mort. Pour servir ce portrait, le cinéaste a fait le choix d’une mise en scène sobre, sans coup d’éclat, entièrement au service de son personnage et de la rigueur morale qu’il incarne. Seule la séquence du cauchemar, alors que Caroline s’est endormie dans son vieux fauteuil, vient rompre ce parti pris, mais nous sommes justement dans un cauchemar et ce fauteuil en apesanteur est totalement justifié. Film grave, film de l’âge adulte d’un cinéaste dont on a toujours célébré la jeunesse intempestive, L’âge de braise, fût-il condamné à demeurer l’ultime film de Jacques Leduc, aura toujours une place à part dans l’histoire du cinéma québécois.
NOTES
1. Luc Perreault, La Presse, Montréal, 19 août 1967. 2. Guy L. Coté est identifié comme « producteur adoptif » au générique. 3. Dite « préposée au budget » au générique. 4. Dans Jean-Pierre Bastien et Pierre Véronneau, Jacques Leduc, Montréal, Conseil québécois pour la diffusion du cinéma, « Cinéastes du Québec 12 », 1974. 5. Chroniqueur de la vie quotidienne, Montréal, Coop Vidéo, 2013. 6. Ibid. 7. Ils seront de nouveau en couple pour Les dernières fiançailles de Jean Pierre Lefebvre, alors qu’Esther Auger et Reynald Bouchard, de frère et sœur, deviendront jeunes amoureux, la même année, dans Noël et Juliette de Michel Bouchard. 8. Le titre du film s’inspire d’un poème (After Apple-Picking) de l’écrivain américain Robert Frost.
ANNEXES
1. Deux textes de Jacques Leduc sur le cinéma documentaire En direction du regard éclaté Comme c’est souvent le cas dans les petits pays colonisés, le cinéma qui s’est développé au Québec, à l’ombre des produits imposés par les usa, est un cinéma qui s’est consacré à nommer le pays et ses habitants. C’est dire que le cinéma québécois contemporain a sa source dans une solide tradition documentaire. Hélas, les cinéastes vieillissent aussi, et les plus jeunes se tour nent plus spontanément vers les films de fiction. L’industrie s’est développée depuis dix ans et beaucoup d’excellents techniciens font aujourd’hui du long métrage quand, autrement, ils auraient fait du cinéma documentaire. Je regrette donc un certain appauvrissement du milieu du cinéma documentaire traditionnel ; les curés auraient dit : « Ça manque de vocations ! » Ce n’est là qu’un autre des signes qui indiquent l’es pace de plus en plus étroit qui est fait à la part documentaire dans notre cinématographie. Les pressions qui s’exercent sur les cinéastes pour qu’ils fassent des produits facilement comestibles sont fortes. Et l’esprit de recherche s’en ressent. C’est de plus en plus difficile de se lancer dans des aventures cinématographiques.
137
Les ventes nécessaires à la télévision et les tatillonnages constants sur les sujets ont rétréci la marge de manœuvre, et cela taxe toujours l’imagination sinon l’audace. Depuis dix ans, ça continue et il faut regretter cette masse importante de films qui sont le produit bâtard du croisement de la paresse intellectuelle et du manque de moyens financiers, et qui ne sont rien d’autre, somme toute, que des interviews filmés, entièrement asservis à l’esthétique télévisuelle ; c’est le syndrome de la plante verte : il y a toujours une plante verte qui pointe le bout de sa feuille, et c’est parfois ce qu’il y a de plus vivant dans l’image ! Ça me gêne aussi cette manière qu’on a de se servir de la parole des autres pour dire ce qu’on pense soi-même. Suffit-il d’interviewer des pacifistes pour faire un film pacifiste ? Et puis est-ce qu’on filme la parole des gens parce que leurs gestes, leurs attitudes et leurs comportements ont perdu toute signification ? Les documentaires, depuis dix ans, posent de moins en moins de regard anthropologique. Comme si on avait fait tout le tour de notre jardin social. Il est clair que la télévision impose sa marque sur un genre cinématographique qui s’est d’abord développé dans un esprit d’indépendance et surtout indépendamment de la télévision. Et je pense que la présence (maintenant indispensable) de la télévision dans l’axe financement-diffusion des documentaires a eu comme effet d’appauvrir les films, jusqu’à les rendre terriblement ennuyeux. C’est vrai aussi que les points de vue gênent ! Il y a quelques années, à l’onf, ils ont fait une enquête 138
dont le sigle, comme la marque de savon, était FAB. L’enquête FAB ! FAB pour Fairness, Accuracy, Balance. C’est une enquête qui se présentait en anglais… On y posait donc des questions sur l’équité, l’exactitude et l’impartialité. C’est un débat aussi creux que celui qui porte régulièrement sur l’objectivité. Je n’ai jamais pensé que les documentaires devaient faire plaisir à tout le monde. J’étais sans doute naïf, mais je pensais que les cinéastes se distinguaient les uns des autres par la qualité de leur vision et qu’ils devaient se faire les interprètes de la réalité et non seulement ses témoins. J’ai même toujours cru que les cinéastes devaient épouser un point de vue bien franchement et pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, bien l’afficher. Mais cela sied mal à la télé qui se veut objective. Ce qui manque donc le plus dans les documentaires que diffuse (à l’occasion) la télévision d’État, c’est la variété des points de vue. Oh ! Il y a bien un point de vue, toujours le même, qui consiste, au nom de la neutralité et de l’objectivité, à ne prendre aucun parti, à n’épouser aucune cause. Cela me semble contraire à l’esprit même du documentaire, à l’esprit qui a animé Flaherty, Grierson, Ivens et chez nous Gilles Groulx et Pierre Perrault. Cette attitude de la télé confirme la suprématie des sujets sur les points de vue ; les films sont soumis à la transmission de l’information (c’est neutre et cool) et pas à celle des idées (c’est un point de vue et hot !). J’ai pourtant toujours cru que le sujet était secondaire et, parfois, sans importance. Ce qui risque d’être intéressant par contre c’est le regard qui est porté. Car il faut 139
bien l’admettre : tous les sujets ont été filmés ! Mais filmer est un acte de la pensée créatrice : si je pense ici et si je pense là, je peux donc filmer ici et je peux donc filmer là ! Le sujet importe peu. Mais, malgré les difficultés de financement de plus en plus éprouvantes, malgré la censure exercée par la télé, malgré la rareté de la relève, malgré tout cela, depuis dix ans, il y a bien eu quelques tentatives intéressantes dans le cinéma documentaire. Dans la direction de ce que j’appellerais « le regard éclaté », quelques films ont été montés qui obéissent à une logique proprement cinématographique, poétique, et qui ont réussi à faire vibrer tout un univers, bien audelà des sujets que ces films ont explorés. Ce sont des films construits en spirale, par opposition au mode linéaire, et à l’instar de la peinture cubiste, ils s’attachent à regarder la vie sous plusieurs facettes, simultanément. Depuis le temps que le cinéma documentaire s’appliquait à décrire la réalité, voilà que le « regard éclaté » cherche un sens aux choses et ose des rapprochements qui, pour être inattendus, n’en sont pas moins révélateurs. C’est une voie à suivre qui a le mérite de donner des films surprenants, d’être excessivement féconde et d’être peu fréquentée par les cinéastes… Le mélange de cinéma documentaire et de cinéma de fiction dans un même film n’est pas nouveau ; Flaherty, déjà, mettait ses documentaires en scène… D’aucuns nomment ces efforts des docu-drames. Je n’aime pas beaucoup cette appellation, je lui préfère semi-fiction. Je trouve ça plus joli. Cela, étant dit, il s’est fait au Québec, depuis dix ans, des semi-fictions qui ont exploré 140
de toutes sortes de manières les interactions possibles du cinéma documentaire et du cinéma de fiction. Et, nonobstant les résultats divers qui ont été obtenus, cette méthode permet au moins de filmer des moments qui sont parfois très difficiles à tourner en direct, soit que les protagonistes soient disparus, soit que ces moments soient trop intimes, et cette méthode permet aussi de proposer sur l’écran des images qui autrement n’y arriveraient jamais. En somme, la situation du cinéma documentaire au Québec ressemble à celle de bien d’autres pays et les cinéastes sont aux prises avec les mêmes difficultés. Pour le moment, la force de notre tradition nous protège quelque peu, mais il m’apparaît qu’à l’avenir et de plus en plus, les cinéastes devront faire preuve de courage et de détermination s’ils ne veulent pas s’enliser dans la misère télévisuelle et s’ils veulent explorer le documentaire. Les années les plus difficiles sont devant nous. Texte inédit, vers 1975
La face cachée du documentaire À cinquante milles au nord de Schefferville, nous sommes à filmer un Montagnais qui lève ses pièges quand il se retourne vers nous pour demander : « Voulezvous que je fasse ça comme dans les films d’Arthur ? » Le voilà, le sentiment, qui confine à l’impuissance, que tout a été filmé. Ce sont : les Jeux olympiques, ou les fonds sous-marins avec Cousteau, ou le violon d’Ingres 141
d’un travailleur à la retraite, ou une série sur les flos à la polyvalente, ou l’évocation de la Grande crise cum stockshots, ou des catalogues d’objets sacrés ou artisanaux. On a la funeste impression que le champ habituellement couvert par le documentaire est entièrement exploré et qu’il ne reste plus rien à filmer. Ce qui ne veut pas dire qu’il faille arrêter de faire des documentaires, mais qu’il faut en questionner les approches, les méthodes et la véritable nature, sa face cachée. Et si l’on veut parler de la continuité de l’onf – Équipe française, il faudra aussi parler du renouvellement d’un genre cinématographique. Ce qui a priori ne devrait surprendre personne étant donné que le documentaire entretient, depuis ses débuts, des ambiguïtés de genre. Il est un peu hermaphrodite, le documentaire. Il est utile de se rappeler que c’est en s’inspirant du mouvement de la machine à coudre, qui est l’instrument prosaïque par excellence, que Louis Lumière, au cours d’une nuit d’insomnie fiévreuse, incapable de rêver sans doute, inventa cette machine à rêves par excellence qu’est le cinématographe. Lumière revient à la charge en filmant sa famille et des centaines de reportages plus ou moins fictifs. L’ambiguïté est génétique ! La suite est mieux connue : Vertov monte ses documentaires comme si c’était de la fiction, Flaherty, lui, les met carrément en scène et Grierson finit par trancher : « The use of natural material has been regarded as the vital distinction. » Point à la ligne. Et mis à part le bond, qui n’est pas négligeable, fait grâce à l’avènement du cinéma direct, nous en sommes toujours au même point. Or, la vie est 142
globale et le cinéma n’y peut rien, surtout quand il s’enferme dans des catégories et des genres. La face cachée serait donc cela : l’impression que le documentaire est un genre en voie de disparition, soumis à la méfiance du public, et à la domination de la télévision qui n’en veut plus, mais qui en a toujours besoin, consommation oblige, quitte à les acheter ailleurs, ou, de guerre lasse, à en produire. Il faut dire que la télévision est en train de tuer le documentaire en imposant, du monde, une représentation narrativo-romantico-linéaire qui s’apparente, on le sait, à la littérature du siècle dernier. C’est ça, la face cachée du documentaire, c’est la prudence excessive, toute l’incertitude bien sociale-démocrate dont on l’entoure, pour finir par en faire un objet aussi précieux qu’une « grosse vue », sans véritable nature propre, objet formel sans véritable centre. Si nos films ressemblent aux films qu’ils sont (exception faite des films qui sont faits pour ressembler aux films américains), c’est qu’on a l’impression d’habiter une société qui est en train de mourir et que les films, même quand ils désavouent cette société, ne font qu’en confirmer la dissolution. Il arrive que la cinématographie corresponde à un projet de société ; mais quand ce projet, dans le courant duquel nos films se sont situés, s’estompe, ce n’est plus la société qu’il faut questionner, mais notre cinéma. Il ne suffit plus que l’engagement soit politique ou social. Les rapports vont devoir être encore plus intenses et les films plus proches, encore, de nos émotions. Y compris les documentaires. 143
On a eu un cinéma sociologique tant qu’il a fallu définir le pays. Et tant qu’il a été intimement relié à la cause nationale, on a beaucoup écrit sur notre cinéma. Jusqu’à s’en plaindre, de tant d’écritures. On en parle moins maintenant qu’on parle moins de la cause nationale. D’autant plus qu’on a surtout parlé du cinéma qu’on n’arrivait pas à faire, faute d’une « industrie nationale », et que malgré tout, aujourd’hui, il s’en produit un peu plus. Mais le fait est qu’on a remarquablement peu parlé de cinéma, même pendant cette période. La spécificité de la pensée cinématographique n’a jamais été définie, encore moins imposée. On n’a jamais suffisamment questionné l’assujettissement du cinéma à la pensée littéraire. La pensée cinématographique agissante est un mode de pensée tout aussi spécifique que la pensée du musicien qui élabore une mélodie. D’ailleurs, c’est une pensée proche de la musique, faite d’images en rythme et de sons, loin des mots immuables qui s’alignent sur le papier, loin aussi de la peinture et de la photographie. L’équipe française a constitué depuis toujours, même quand on tournait des films « malgré l’onf », un bon cadre où poursuivre le travail suivant cette idée du cinéma. On a pu ausculter le cinématographe sans être assiégé par l’Économie. Et c’est certainement une obligation qui l’attend si cette idée du cinéma tient à se tracer un avenir. À penser à l’avenir, j’aime mieux penser que la face cachée du documentaire, c’est la poésie. C’est-àdire un lieu cinématographique privilégié où il est 144
possible de développer au cinéma le regard cubiste, comme il fut fait en peinture, et selon lequel la réalité est globale, comme nous le disions, et qu’il est possible de la représenter comme ayant plusieurs facettes. La face cachée du documentaire, c’est quand l’approche du sujet se substitue au sujet lui-même et que les découvertes que l’on fait parfois en documentaire s’effectuent aussi sur le plan formel. Le documentaire reste un très large espace cinématographique. L’on y retrouve une foule de films fort dissemblables, mais qui partagent deux particularités, suivant les deux sens du mot montrer, à savoir enseigner et faire voir, faire découvrir. Le documentaire est un mode d’exploration, et à la différence du film fictionnel, ses personnages ne lui sont jamais acquis ni tenus pour acquis. Cela ne me surprendrait donc pas que le documentaire soit d’abord une tournure d’esprit, une façon particulière de voir les choses qui favorise au cinéma l’esprit de découverte. Le sujet reste à découvrir et fait toujours l’objet d’une recherche, d’une enquête. C’est une façon de voir qui accorde une large part à la liberté et à l’improvisation. Le documentariste est un musicien de jazz égaré dans le cinéma. Le documentaire passe par des accidents. Et puisqu’en cinéma de fiction, les accidents finissent inévitablement sur le plancher de la salle de montage, on peut en conclure que les chutes de la fiction, eh bien, c’est le documentaire ! Hermaphrodite, le documentaire ? Pas étonnant que dans un pays qui est la colonie cinématographique des usa, le cinéma qui s’y développe 145
soit comme les chutes de leurs films et pas étonnant que l’accès au marché passe par la copie du modèle étranger. Dans un petit pays de petits producteurs, le documentaire est la façon la plus économique de faire de la fiction. Faudrait-il cesser d’utiliser le vocable documentaire et appeler nos films tout simplement des films ? « La production française à l’onf », Les dossiers de la Cinémathèque, Montréal, Cinémathèque québécoise, no 14, juillet 1984
2. Jacques Leduc, caméraman 1964 Sire, le Roy n’a plus rien dit, Georges Rouquier : assistant-caméraman Nobody Waved Good-bye, Don Owen : assistant-caméraman 1965 La vie heureuse de Léopold Z, Gilles Carle : assistant-caméraman La neige a fondu sur la Manicouagan, Arthur Lamothe : assistant-caméraman Geneviève, Michel Brault : assistant-caméraman Les Montréalistes, Denys Arcand : assistant caméraman Élément 3, Jacques Giraldeau : assistant caméraman Le festin des morts, Fernand Dansereau : assistant-caméraman 1967 Il ne faut pas mourir pour ça, Jean Pierre Lefebvre : directeur photo Teréleur, André Théberge : directeur photo 1968 Mon amie Pierrette, Jean Pierre Lefebvre : directeur photo Ce soir-là, Gilles Vigneault, Arthur Lamothe : caméraman
147
1973 1982 1983
Ultimatum, Jean Pierre Lefebvre : directeur photo Du grand large aux Grands Lacs, Jean-Yves Cousteau, Jacques Gagné : co-caméraman Madame, vous avez rien, Dagmar Teufel : directeur photo Beyrouth ! « À défaut d’être mort », Tahani Rached : directeur photo Debout sur leur terre, Maurice Bulbulian : co-caméraman 1984 Étienne et Sara, Pierre Hébert : co-caméraman Torngat, Marc Blais, Micheline Blais : co-caméraman 1985 Haïti (Québec), Tahani Rached : co-caméraman 1986 Bam Pay A ! – Rends-moi mon pays !, Tahani Rached : directeur photo 1987 Haïti, Nous là ! Nou la !, Tahani Rached : directeur photo Où serez-vous le 31 décembre 1999 ?, Marie Décary : directeur photo Les polissons, Dagmar Teufel : directeur photo Voyage en Amérique avec un cheval emprunté, Jean Chabot : directeur photo 1988 Lee Konitz. Portrait de l’artiste en saxophoniste, Robert Daudelin : directeur photo La peau et les os, Johanne Prégent : directeur photo 1989 Au Chic Resto Pop, Tahani Rached : directeur photo 148
Le visiteur d’un soir, Jean-Daniel Lafond : directeur photo 1990 Creative Process : Norman McLaren, Donald McWilliams : co-caméraman 1993 De retour pour de bon, Bettie Arsenault : directeur photo Gaston Miron. Les outils du poète, André Gladu : directeur photo 1994 J’aime j’aime pas, Sylvie Groulx : directeur photo Tu as crié LET ME GO, Anne Claire Poirier : directeur photo 1995 Petit meublé, Paul Thinel : directeur photo 1996 Remue-ménage, Paul Thinel : directeur photo Pendant que tombent les arbres, Sylvain L’Espérance : directeur photo The Education of Little Tree, Richard Friedenberg : caméraman (second unit) 1997 Le temps qu’il fait, Sylvain L’Espérance : directeur photo Les désoccupés, Raymonde Létourneau : co-caméraman Quatre femmes d’Égypte, Tahani Rached : directeur photo Le mégalographe, Paul Thinel : directeur photo 1998 L’erreur boréale, Richard Desjardins, Robert Monderie : caméraman vidéo
149
Le territoire du comédien, Jean-Claude Coulbois : caméra additionnelle Rupture, Najwa Tlili : co-caméraman 1999 Urgence ! Deuxième souffle, Tahani Rached : directeur photo The Dragonfly of Chicoutimi, Jean-Claude Coulbois : directeur photo Stardom, Denys Arcand : caméraman (deuxième équipe) Les oubliés du xxie siècle ou La fin du travail, Jean-Claude Bürger : caméraman vidéo Une famille comme les autres, Paule Baillargeon : caméraman vidéo La vérité est un mensonge, Pierre Goupil : directeur photo Le reel du mégaphone, Serge Giguère : co-caméraman 2000 Bad Girl, Marielle Nitoslawska : caméraman vidéo À travers chants, Tahani Rached : directeur photo 2001 La main invisible, Sylvain L’Espérance : directeur photo La loi de l’eau, Robert Monderie : directeur photo Un jeu d’enfants, Johanne Prégent : directeur photo 2002 100 % bio, Claude Fortin : directeur photo
150
Les chercheurs d’or, Bruno Baillargeon : co-caméraman 2003 Soraida, une femme de Palestine, Tahani Rached : directeur photo La beauté du geste, Jeanne Crépeau : co-caméraman The Body Architect, Paule Baillargeon : directeur photo Entretien avec Anne Claire Poirier, Nicole Giguère : directeur photo 2004 L’Arbre aux branches coupées, Pascale Ferland : co-caméraman Bienvenue au conseil d’administration, Serge Cardinal : directeur photo Les Élias et les Petrov… pendant 7 ans, Yves Dion : directeur photo Le petit Jean-Pierre, le grand Perreault, Paule Baillargeon : directeur photo 2007 Un cri au bonheur, collectif : co-caméraman
3. Jacques Leduc, photographe : expositions et publications 1991 « Ligne de temps », Montréal, Galerie du Service des activités culturelles de l’Université de Montréal, dans le cadre du Mois de la photo (octobre). 1992 Montréal, Galerie Espace Global (février). 1993 « Traces », Montréal, Théâtre La Licorne (mars). « Masques », expo collective, Montréal, Galerie Espace Global (août). « L’Amérique colonise la France », expo collective, Montréal, Centre interculturel Strathearn, dans le cadre du Mois de la photo (octobre). 1995 « Contact quotidien », Montréal, Maison de la culture Frontenac, dans le cadre des Rendez vous du cinéma québécois (février). 1996 « Contact quotidien », Québec, Musée de la civilisation, dans le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois (février). « Parti à la recherche du soleil », Montréal, restaurant Le Petit Alep (juin). « Parti à la recherche du soleil », Lisbonne, centre culturel Malaposta (novembre). 2003 « Espace d’un moment », Montréal, Cinémathèque québécoise (janvier). 152
2004 « Cœurs des souvenirs trempés », Montréal, Casa Obscura (mars). Cœurs des souvenirs trempés, album de photos et de textes, inédit. 2005 La vie du temps, album (photos et textes) inédit. 2006 « La vie du temps », Montréal, Casa Obscura (janvier). La vie du temps, album de photos, inédit. Nos traces, album de photos et de textes, inédit. 2007 « Quelques photos de Jacques Leduc & Pierre Letarte », Montréal, Casa Obscura (janvier). Toujours recommencer, album de photos prises à Beyrouth en octobre 1982 durant le tournage de Beyrouth ! À défaut d’être mort de Tahani Rached, inédit. 2008 « Troisième temps / Les travaux en cours de Jacques Leduc & Pierre Letarte », Montréal, Casa Obscura (février). « Autour des cinémathèques du monde », Paris, Centre national du cinéma et de l’image animée (avril). 2009 « Le temps photographique », 24 images, Montréal, no 141, mars-avril. 2011 « Espace gaspésien », Montréal, Casa Obscura (avril). 2012 « Ces années-là », expo Leduc & Letarte, Montréal, Casa Obscura (avril). 2013 « Work in progress », expo Leduc & Letarte, Montréal, Casa Obscura (mai).
4. Jacques Leduc, écrivain Critiques dans Objectif (1961-1967) Concrete Jungle, Joseph Losey, no 11, décembre 1961. Seul ou avec d’autres, Héroux, Venne, Arcand, no 14, juillet 1962. Hatari, Howard Hawks, no 15-16, août 1962. « Un cinéma de la libération » (Karel Zeman) ; Cuba si, Chris Marker ; Lonely Are the Brave, David Miller ; Underworld U.S.A., Samuel Fuller, no 18, novembre 1962. Toronto Jazz, Don Owen ; A Child Is Waiting, John Cassavetes, no 20, mai 1963. Thérèse Desqueyroux, Georges Franju, no 21, juinjuillet 1963. Elektra, Michael Cacoyannis ; Irma la douce, Billy Wilder ; Arsène Lupin contre Arsène Lupin, Édouard Molinaro, no 25, décembre 1963-janvier 1964. L’amour à vingt ans, François Truffaut, Andrzej Wajda, no 26, février-mars 1964. « Hitchcock, féminin pluriel », no 27, avril-mai 1964. Man’s Favorite Sport ?, Howard Hawks, no 28, aoûtseptembre 1964.
154
Le silence, Ingmar Bergman, no 29-30, octobrenovembre 1964. The Disorderly Orderly, Frank Tashlin, no 32, avrilmai 1965. L’amour avec des si, Claude Lelouch, no 34, janvier 1966. « De la télévision considérée comme un divertissement » ; How to Succeed in Business Without Really Trying, David Swift ; Opus 3, Pierre Hébert, no 39, aoûtseptembre 1967. Éditoriaux et textes de présentation dans Format Cinéma (1981-1986) Texte de présentation, no 1, 1er juin 1981. Texte de présentation et entrevue avec Jean-Jacques Fortier, directeur général de l’Institut québécois du cinéma, no 2, 15 juin 1981. Texte de présentation, no 3, 29 juin 1981. Éditorial, no 5, 5 octobre 1981. Rencontre avec Michel Choin, chef machiniste, no 5, 5 octobre 1981. « Comment va ton char, ’stie ? », no 7, 2 novembre 1981. Lettre datée du 9 novembre, pendant le tournage d’Albédo, no 8, 30 novembre 1981. Carte postale des îles Turks et Caïques, no 10, 15 janvier 1982. 155
« On me cache quelque chose » (dénonciation du gros plan), no 11, 30 janvier 1982. Éditorial, no 12, 15 février 1982. Article sur Le confort et l’indifférence et lettre de Denys Arcand à Leduc, no 12, 15 février 1982. Mots croisés, no 13, 1er mars 1982. « Temps dur pour la semaine » avec Michel Houle, no 14, 15 mars 1982. Éditorial et À propos d’une note de service de François Macerola, no 15, 1er avril 1982. « L’émotion de la pizza » (réflexion sur la salle de montage), no 16, 15 avril 1982. Texte de présentation, no 18, 15 juin 1982. « Au hasard Labrador » (sur le tournage d’Albédo), no 19, 15 septembre 1982. « Journal de Beyrouth » (tournage de Beyrouth ! « À défaut d’être mort » de Tahani Rached), no 23, 20 décembre 1982. « Et celui-là, que vient-il faire dans nos pages… ? » (tournage de Le dernier glacier), no 28, 1er juillet 1983. Éditorial, no 29, 20 septembre 1983. « Journal d’un jour » (projection du Dernier glacier pour Louis Marcorelles), no 35, 20 octobre 1984. « Pourquoi j’écris, pourquoi je filme… » (enquête sur le scénario), no 39, 20 février 1985. « Journal d’un jour » (retour du Flaherty Film Seminar), no 44, 15 septembre 1985. « Il n’y a pas de crise » (situation de l’onf après le rapport Appelbaum-Hébert), no 46, 15 décembre 1985. 156
« Journal d’un jour » (les road movies et le cinéma documentaire), no 48, 15 avril 1986.
Publications dans 24 images (2001-2006) Chronique « Barreau de chaise (mémoires) » (15 chroniques numérotées) : 1 – Chronique de la vie quotidienne, no 105, hiver 2001. 2 – Sur la cinéphilie, no 106, printemps 2001. 3 – Sire, le Roy n’a plus rien dit de Georges Rouquier, no 107-108, automne 2001. 4 – Le monde va nous prendre pour des sauvages de Jacques Godbout et François Bujold, no 109, hiver 2002. 5 – Tournage de Beyrouth ! « À défaut d’être mort » de Tahani Rached, no 110, printemps 2002. 6 – Première de On est loin du soleil, no 112-113, automne 2002. 7 – 100 % bio de Claude Fortin et L’enfant sur le lac, no 114, hiver 2003. 8 – Haïti, Nous là ! Nou la ! de Tahani Rached, no 115, été 2003. 9 – L’âge de braise, La vie fantôme, no 116-117, été 2004. 10 – Villes visitées, no 118, septembre 2004. 11 – Cap d’espoir, no 121, février 2005. 12 – Voyage en Amérique avec un cheval emprunté de Jean Chabot, no 122, été 2005. 13 – Soraida, une femme de Palestine de Tahani Rached, no 123, septembre 2005. 157
14 – Robert Frank, no 125, décembre 2005-janvier 2006. 15 – Pierre Bernier, no 126, mars-avril 2006. « Lettre à Fernand Bélanger », no 129, octobre-novembre 2006.
Bibliographie sélective 1. Ouvrages sur Jacques Leduc BASTIEN, Jean-Pierre et VÉRONNEAU, Pierre, Jacques Leduc, Montréal, Conseil québécois pour la diffusion du cinéma, « Cinéastes du Québec 12 », 1974. PRIVET, Georges, Chroniqueur de la vie quotidienne ou La petite musique de Jacques Leduc, Montréal, Coop Vidéo, 2013. 2. Articles sur Jacques Leduc JULIEN, Alain et HOULE, Michel, Dictionnaire du cinéma québécois, Montréal, Fides, 1978. MOFFAT, Alain-N., « Histoire et contrepoint dans les œuvres récentes de Jacques Leduc », Copie Zéro, Montréal, no 37, juillet 1988. BELLEMARE, Denis, « Le corps ordinaire », La mélancolie et le banal. Essai sur le cinéma québécois (thèse de doctorat), Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1992. COULOMBE, Michel, Les cinémas du Canada, Paris, Centre Georges Pompidou, 1992.
159
EUVRARD, Michel, « Faire rendre gorge au réel », Les cinémas du Canada, Paris, Centre Georges Pompidou, 1992. COULOMBE, Michel et EUVRARD, Michel, Le dictionnaire du cinéma québécois, Montréal, Boréal, 1999. ARCAND, Denys, « Jacques Leduc et les bienfaits de la pige », Hors champ, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2005. BAILLARGEON, Paule, « Une actrice, une amie… », 24 images, Montréal, no 141, mars-avril 2009. DAUDELIN, Robert, « Jacques Leduc cinéaste-artisan », 24 images, Montréal, no 141, mars-avril 2009. RACHED, Tahani, « La découverte au bout du chemin », 24 images, Montréal, no 141, mars-avril 2009. 3. Entretiens avec Jacques Leduc LA ROCHELLE, Réal, « Entretien avec Jacques Leduc », inédit, septembre 1971. CAMERLAIN, Jacques, Séquences, Montréal, no 73, juillet 1973. EVANCHUCK, Peter, Motion, Toronto, vol. 4, 1974. ROUSSEAU, Yves, « Entretien avec Jacques Leduc », Ciné-Bulles, Montréal, vol. 8, no 3, avril-mai 1989. ROSE, Hubert-Yves, « Les temps changent », Lumières, Montréal, no 19, été 1989. LOISELLE, Marie-Claude et RACINE, Claude, « Entretien », 24 images, no 59, hiver 1992. 160
LOISELLE, Marie-Claude et ROY, André, « Jacques Leduc / La vie fantôme », 24 images, Montréal, no 62-63, septembre-octobre 1992. LAVOIE, André, Ciné-Bulles, Montréal, vol. 12, no 1, octobre-décembre 1992. CHABOT, Jean, « À propos des images », 24 images, Montréal, no 92, été 1998. PERREAULT, Mathieu, « L’obsession du temps », Séquences, Montréal, no 258, janvier-février 2009. LOISELLE, Marie-Claude, 24 images, Montréal, no 141, mars-avril 2009. 4. Films Chantal : en vrac SAINT-PIERRE, Jacqueline, Office national du film du Canada, août 1967. PÂQUET, André, Le Soleil, Québec, 19 août 1967. PERREAULT, Luc, La Presse, Montréal, 19 août 1967. HÉBERT, Pierre, Objectif, Montréal, no 39, aoûtseptembre 1967. DUHAIME, Colette, « Chantal Renaud fait le point », La Patrie, Montréal, 17 septembre 1967. MARSOLAIS, Gilles, Le cinéma canadien, Montréal, Éditions du Jour, 1968. LEDUC, Jacques, « Barreau de chaise 6 », 24 images, Montréal, no 112-113, automne 2002.
161
Nominingue… depuis qu’il existe PERREAULT, Luc, La Presse, Montréal, 27 septembre 1968. Là ou ailleurs Fiche descriptive, Office national du film du Canada, février 1969. NOGUEZ, Dominique, Essais sur le cinéma québécois, Montréal, Éditions du Jour, 1970. Cap d’espoir LAROSE, Paul, « La censure et la tradition du documentaire international » (document interne), Office national du film du Canada, 10 mars 1973. LEDUC, Jacques, « Barreau de chaise 11 », 24 images, Montréal, no 121, printemps 2005. JEAN, Marcel, Dictionnaire des films québécois, Montréal, Somme toute, 2014. On est loin du soleil BÉGIN, Jean-Yves, « Entrevue avec Pierre Maheu », Office national du film du Canada, 18 mai 1971. LEFEBVRE, Jean Pierre, Cinéma/Québec, Montréal, vol. 1, no 3, septembre 1971. CHAREST, Ginette, Point de mire, Montréal, vol. 2, no 33, 17 septembre 1971. BERTHIAUME, René, La Tribune, Sherbrooke, 20 septembre 1971. 162
FAUCHER, Carol, Québec-Presse, Montréal, 21 novembre 1971. LÉVESQUE, Robert, Québec-Presse, Montréal, 26 décembre 1971. BONNEVILLE, Léo, Séquences, Montréal, no 68, février 1972. LEFEBVRE, Jean Pierre, Format Cinéma, Montréal, no 20, 14 octobre 1982. LEDUC, Jacques, « Barreau de chaise 6 », 24 images, Montréal, no 112-113, automne 2002. MARSOLAIS, Gilles, 24 images, Montréal, no 141, mars-avril 2009. Tendresse ordinaire RHEAULT, Ghislaine, Le Soleil, Québec, 10 juin 1972. BERTHIAUME, René, La Tribune, Sherbrooke, 4 avril 1973. KERMOYAN, Mireille, Office national du film du Canada, 5 avril 1973. LÉVESQUE, Robert, Québec-Presse, Montréal, 8 avril 1973. BÉRUBÉ, Robert-Claude, Séquences, Montréal, no 73, juillet 1973. CANBY, Vincent, Variety, New York, 6 avril 1974. CURTIS FOX, Terry, « The New European Cinema Is Canadian », Village Voice, New York, 26 juin 1978. JEAN, Marcel, Dictionnaire des films québécois, Montréal, Somme toute, 2014. 163
Alegria Fiche descriptive, Office national du film du Canada, mars 1973. Chronique de la vie quotidienne JUNEAU, Normande, Châtelaine, Montréal, septembre 1976. TADROS, Jean-Pierre, Le Devoir, Montréal, 15 avril 1978. SAMSON, Hélène, « L’effet hypnotique dans Le ventre de la nuit », Copie Zéro, Montréal, no 14, octobre 1982. McWILLIAMS, Donald, « The Sixth Grierson Film Seminar », A Newsletter called Fred, Toronto, vol. 9, no 5, janvier 1991. LEDUC, Jacques, El cazette, no 10, Montréal, Casa Obscura, 12 mars 1999. LETARTE, Pierre, « Pour situer le contexte », 24 images, Montréal, no 141, mars-avril 2009. JEAN, Marcel, Dictionnaire des films québécois, Montréal, Somme toute, 2014. Albédo Fiche descriptive, Office national du film du Canada, février 1982. LEDUC, Jacques, « Au hasard Labrador », Format Cinéma, Montréal, no 19, septembre 1982. FAUCHER, Carol, Format Cinéma, Montréal, no 21, 22 novembre 1982. GAY, Richard, Le Devoir, Montréal, 4 décembre 1982. 164
EUVRARD, Michel, « Le regard du sourd », Format Cinéma, Montréal, no 24, 15 février 1983. BELLEMARE, Denis, « Le dernier objet », Copie Zéro, Montréal, no 30, octobre 1986. GINGRAS, Nicole, « L’ombre de la photographie dans le cinéma québécois », Ciné-Bulles, Montréal, vol. 8, no 3, avril-mai 1989. JEAN, Marcel, Dictionnaire des films québécois, Montréal, Somme toute, 2014. Le dernier glacier Fiche descriptive, Office national du film du Canada, février 1984. FRAPPIER, Roger, « Le dernier glacier », Format Cinéma, Montréal, no 34, 3 mars 1984. GAY, Richard, Le Devoir, Montréal, 17 novembre 1984. PERREAULT, Luc, La Presse, Montréal, 17 novembre 1984. LEMIEUX, Louis-Guy, Le Soleil, Québec, 24 novembre 1984. JEAN, Marcel, Dictionnaire des films québécois, Montréal, Somme toute, 2014. Charade chinoise BERTHIAUME, René, communiqué, Office national du film du Canada, Montréal, 12 janvier 1988. LAURENDEAU, Francine, Le Devoir, Montréal, 16 janvier 1988. DUSSAULT, Serge, La Presse, Montréal, 23 janvier 1988. 165
Trois pommes à côté du sommeil LÉVESQUE, Robert, Le Devoir, Montréal, 3 février 1989. NUOVO, Franco, Le Journal de Montréal, Montréal, 3 février 1989. PERREAULT, Luc, La Presse, Montréal, 3 février 1989. PETROWSKI, Nathalie, Le Devoir, Montréal, 4 février 1989. GAUDREAULT, Léonce, Le Soleil, Québec, 5 février 1989. THÉRIAULT, Robert, Continuum, Montréal, 10 avril 1989. BOULANGER, Luc, Montréal Campus, Montréal, 12 avril 1989. BOULAD, Bernard, Voir, Montréal, 13 avril 1989. DUSSAULT, Serge, La Presse, Montréal, 22 avril 1989. GAUDREAULT, Léonce, Le Soleil, Québec, 13 mai 1989. GARNEAU, Michèle, Ciné-Bulles, Montréal, vol 8, no 4, juin-août 1989. MARCEL, Jean, « Épître ostensiblement déclaratoire à Jacques Leduc à l’occasion de ses Trois pommes à côté du sommeil », Pensées, passions et proses, Montréal, Éditions de l’Hexagone, 1992. GRUGEAU, Gérard, 24 images, Montréal, no 156, mars-avril 2012. JEAN, Marcel, Dictionnaire des films québécois, Montréal, Somme toute, 2014.
166
Montréal vu par… PERREAULT, Luc, La Presse, Montréal, 22 juin 1991. DUSSAULT, Serge, La Presse, Montréal, 2 novembre 1991. KOKKER, Steve, Mirror, Montréal, 7 novembre 1991. KURSK, Harold von, The Globe and Mail, Toronto, 8 novembre 1991. BROWNSTEIN, Bill, The Gazette, Montréal, 9 novembre 1991. PERREAULT, Luc, La Presse, Montréal, 9 novembre 1991. PETROWSKI, Nathalie, Le Devoir, Montréal, 9 novembre 1991. GAUDREAULT, Léonce, Le Soleil, Québec, 14 décembre 1991. ROUSSEAU, Yves, 24 images, Montréal, no 59, hiver 1992. GERVAIS, Richard, Fugues, Montréal, janvier 1992. JEAN, Marcel, Dictionnaire des films québécois, Montréal, Somme toute, 2014. L’enfant sur le lac LÉGER, Hugo, Le Devoir, Montréal, 18 janvier 1992. LEDUC, Jacques, « Barreau de chaise 7 », 24 images, Montréal, no 114, hiver 2003.
167
La vie fantôme DUSSAULT, Serge, « Jacques Leduc tourne La vie fantôme », La Presse, Montréal, 23 novembre 1991. JALBERT, L., « Un triangle amoureux moderne », Échos Vedettes, Montréal, 30 novembre 1991. PERREAULT, Luc, La Presse, Montréal, 22 août 1992. PERREAULT, Luc, La Presse, Montréal, 30 août 1992. LÉVESQUE, Robert, Le Devoir, Montréal, 31 août 1992. F.B., Le Soir, Namur, 30 septembre 1992. ROY, André, 24 images, Montréal, no 62-63, septembreoctobre 1992. FOURLANTY, Éric, Voir, Montréal, 21 janvier 1993. ROBERGE, Huguette, La Presse, Montréal, 23 janvier 1993. TREMBLAY, Odile, Le Devoir, Montréal, 23 janvier 1993. KOKKER, Steve, Mirror, Montréal, 28 janvier 1993. ROY, Pierrette, La Tribune, Sherbrooke, 30 janvier 1993. L’âge de braise LAPOINTE, Josée, Le Droit, Ottawa, 14 juin 1997. LUSSIER, Marc-André, La Presse, Montréal, 14 juin 1997. BILODEAU, Martin, Le Devoir, Montréal, 16 juin 1997. FOURLANTY, Éric, Voir, Montréal, 23 avril 1998. BILODEAU, Martin, Le Devoir, Montréal, 25 avril 1998. BRASSARD, Jean-François, Échos Vedettes, Montréal, 25 avril 1998. 168
PERREAULT, Luc, La Presse, Montréal, 25 avril 1998. TREMBLAY, Odile, Le Devoir, Montréal, 25 avril 1998. CASTIEL, Élie, Séquences, Montréal, no 196, mai-juin 1998. PROVENCHER, Normand, Le Soleil, Québec, 13 juin 1998. GRUGEAU, Gérard, 24 images, Montréal, no 92, été 1998. THERRIEN, Denyse, Ciné-Bulles, Montréal, vol. 17, no 2, été 1998. ROY, Pierrette, La Tribune, Sherbrooke, 12 septembre 1998.
Remerciements Je tiens à remercier Carol Faucher, Pierre Jutras, Pierre Letarte et André Roy qui, à un titre ou un autre, ont été amicalement associés à la genèse de ce livre. Sont aussi remerciées Julienne Boudreau, Sylvie Brouillette et Lorraine LeBlanc, documentalistes à la Médiathèque Guy-L.-Coté de la Cinémathèque québécoise, dont l’appui a été déterminant dans mes travaux de recherche. Enfin, Simon Chénier et Claude Lord, de l’Office national du film du Canada, ont collaboré à l’iconographie.
Table
1.
Une vie en cinéma La découverte du cinéma Les métiers du cinéma La réalisation
2. Filmographie commentée Chantal : en vrac Nominingue… depuis qu’il existe Là ou ailleurs / No Matter Where Ça marche / A Total Service Cap d’espoir On est loin du soleil Je chante à cheval avec Willie Lamothe Tendresse ordinaire Alegria Chronique de la vie quotidienne Albédo Le dernier glacier Notes de l’arrière-saison Le temps des cigales Charade chinoise Trois pommes à côté du sommeil Bande-annonce du Festival international de cinéma en Abitibi-Témiscamingue Montréal vu par… Six variations sur un thème : « La toile du temps » L’enfant sur le lac La vie fantôme L’âge de braise
11 14 18 91 94 96 97 98 100 102 103 105 106 113 116 118 120 121 122 126 126 127 128 130
ANNEXES 1. Deux textes de Jacques Leduc sur le cinéma 1. documentaire 137 2. Jacques Leduc, caméraman 147 3. Jacques Leduc, photographe : expositions 3. et publications 152 4. Jacques Leduc, écrivain 154
Bibliographie sélective
159
ESSAIS
André Beaudet Littérature l’imposture Normand de Bellefeuille À double sens. Échanges sur quelques (Hugues Corriveau) pratiques modernes Claude Bertrand L’invention de soi (Michel Morin) Le territoire imaginaire de la culture 1 Pierre Bertrand La ligne de création Logique de l’excès François Charron Littérature et nationalisme suivi de Une décomposition tranquille L’obsession du mal. De Saint-Denys Garneau et la crise identitaire au Canada français La part incertaine. Poésie et expérience intérieure chez de Saint-Denys Garneau La passion d’autonomie. Peinture automatiste précédée de Qui parle dans la théorie ? Hugues Corriveau À double sens. Échanges sur quelques (Normand de Bellefeuille) pratiques modernes Écrire un roman. À propos de Chevaux de Malaparte Jean-Simon DesRochers Processus agora. Approche bioculturelle des théories de la création littéraire Claude Lagadec Les fondements biologiques de la morale René Lapierre L’atelier vide Écrire l’Amérique L’entretien du désespoir
Figures de l’abandon Renversements Marie-Claude Loiselle La communauté indomptable d’André Forcier Alain Bernard Marchand Genet le joueur impénitent Tintin au pays de la ferveur Michel Morin L’Amérique du Nord et la culture (Le territoire imaginaire de la culture 2) Désert De vive voix Dieu et Désir L’étrangeté de la raison Être et ne pas être L’identité fuyante Le murmure signifiant Souveraineté de l’individu (Claude Bertrand) Le territoire imaginaire de la culture 1 Vertige ! et autres essais a-politiques Simon Nadeau Le philosophe contrebandier. Introduction à l’œuvre de Michel Morin Dominique Robert La constellation de l’Idiot André Roy Le rayon rose La vie parallèle Voyage au pays du cinéma Patrick Straram One + one Cinémarx & Rolling Stones le bison ravi France Théoret Entre raison et déraison Laurent-Michel Vacher L’empire du moderne. Actualité de la philosophie américaine Pour un matérialisme vulgaire
Éditions Les Herbes rouges C. P. 48880, succ. Outremont Montréal (Québec) H2V 4V3 514 279-4546 lesherbesrouges.com en couverture Paule Baillargeon et Normand Chouinard dans Trois pommes à côté du sommeil, 1989. photographies de plateau Geneviève, Chantal : en vrac, Alegria et Albédo – photos : ONF On est loin du soleil – photo : Bruno Massenet Tendresse ordinaire et L’âge de braise – photos : Attila Dory (Collection Cinémathèque québécoise) Distribution Diffusion Dimedia 514 336-3941 dimedia.com
Diffusion en Europe Librairie du Québec +33 1 43 54 49 02 librairieduquebec.fr
Jacques Leduc fait son entrée au cinéma en 1964. Le cinéma direct vient de brouiller définitivement les frontières entre documentaire et fiction ; Leduc saura en faire bon usage. Réalisateur de vingt films et caméraman pour des dizaines d’autres, Jacques Leduc a défendu au sein d’une époque déterminante de notre cinéma une liberté créatrice hors du commun. « Rattrapant quelques signes des temps qui courent », Trois pommes à côté du sommeil tout comme les huit chapitres formant la Chronique de la vie quotidienne radiographient la vie d’une génération de Québécois. Cet essai entrecoupé de passages d’entretiens avec le cinéaste retrace son parcours, du ciné-club jusqu’à L’âge de braise. Robert Daudelin propose une lecture critique de chaque film et répertorie l’activité de Jacques Leduc caméraman, photographe et écrivain. Robert Daudelin est membre du comité de rédaction des revues 24 images et Journal of Film Preservation. Il a été directeur général et conservateur de la Cinémathèque québécoise de 1972 à 2002.
![Le vocabulaire du cinma [5 ed.]
9782200626778, 9782200625405](https://ebin.pub/img/200x200/le-vocabulaire-du-cinma-5nbsped-9782200626778-9782200625405.jpg)

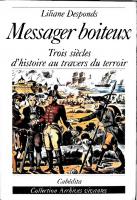

![La grammaire du cinma - 2e d. - [2 ed.]
9782200626266, 9782200622510](https://ebin.pub/img/200x200/la-grammaire-du-cinma-2e-d-2nbsped-9782200626266-9782200622510.jpg)




