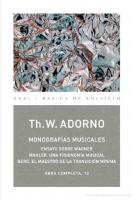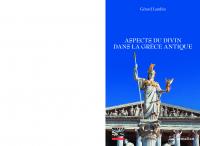Ouvertures a la francaise Migrations musicales dans l'espace germanique 1660-1730 (Epitome Musical) (French Edition) 9782503588582, 2503588581
206 18 11MB
French Pages [352]
Recommend Papers

File loading please wait...
Citation preview
Louis Delpech Ouvertures à la française Migrations musicales dans l’espace germanique 1660 – 1730
•
Centre d’études supérieures de la Renaissance Université de Tours, UMR 7323 du CNRS Collection « Épitome musical » directed by Philippe Vendrix & Philippe Canguilhem Editorial Committee: Hyacinthe Belliot, Vincent Besson, Camilla Cavicchi, David Fiala, Daniel Saulnier, Solveig Serre, Vasco Zara Advisory board: Andrew Kirkman (University of Birmingham), Yolanda Plumley (University of Exeter), Jesse Rodin (Stanford University), Richard Freedman (Haverford College), Massimo Privitera (Università di Palermo), Kate van Orden (Harvard University), Emilio Ros-Fabregas (CSIC-Barcelona), Thomas Schmidt (University of Huddersfield), Giuseppe Gerbino (Columbia University), Vincenzo Borghetti (Università di Verona), Marie-Alexis Colin (Université Libre de Bruxelles), Laurenz Lütteken (Universität Zürich), Katelijne Schiltz (Universität Regensburg), Pedro Memelsdorff (Chercheur associé, Centre d'études supérieures de la Renaissance–Tours) Editing: Vincent Besson
Cover illustration: Maison de plaisir d’Herrenhausen, D-Hv, Mappe 18 XIX C Nr. 178
© 2020, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission of the publisher. ISBN: 978-2-503-58858-2 E-ISBN: 978-2-503-58859-9 DOI 10.1484/M.EM-EB.5.119588 ISSN: 2565-8166 E-ISSN: 2565-9510 Printed in the EU on acid-free paper. D/2020/0095/211
Louis Delpech Ouvertures à la française Migrations musicales dans l’espace germanique 1660 – 1730
•
F
On croit toucher des orgues ordinaires en touchant l’homme. Ce sont des orgues à la vérité, mais bizarres, changeantes, variables. Ceux qui ne savent toucher que les ordinaires ne feraient pas d’accords sur celles-là. Il faut savoir où sont les […] Pascal, Pensées, Fragment Misère 3/24
Introduction •
« Un pays dont la musique est indéchiffrable pour toute autre nation.1 » La célèbre charge prononcée par Rousseau contre une musique française jugée grandiloquente, biscornue, incompréhensible, et par-là même inexportable sur le marché européen, n’est pas seulement l’hyperbole d’un musicien aux abois se débattant avec la figure écrasante de Rameau, ni même l’ultime et aventureuse conséquence d’une réflexion philosophique aux prises avec le problème de l’origine du langage et l’élaboration théorique d’une dichotomie rigoureuse entre deux modèles musicaux opposés terme à terme – le modèle italien, posé par le philosophe comme source et avenir de la musique, et le modèle français, prototype de la dégénerescence d’un art musical coupé du sentiment et peu à peu asphyxié par une vaine ratiocination. Au-delà des enjeux sociaux et intellectuels immédiats d’une telle prise de position, la détestation exprimée par Rousseau envers la musique de son pays d’adoption témoigne d’un fait tenace : dès le milieu du xviiie siècle, la musique française se trouvait attaquée sur plusieurs fronts, ramenée à une prolongation sénile et fatiguée de la musique du Grand Siècle, et du même coup exclue a priori des productions culturelles qui, à la même époque, faisaient de la France l’un des cœurs battants de la vie intellectuelle dans l’Europe des Lumières. Les fulminations de Rousseau contre la musique française résonnent encore d’un écho singulier dans l’historiographie contemporaine. Si l’opposition développée par l’Essai sur l’origine des langues entre musique italienne et française n’est que l’expression tardive et amplifiée d’un antagonisme déjà largement à l’œuvre dans le discours théorique dès 1700, qui culmine en France avec la Querelle des Bouffons et se voit réactivé par le philosophe pour les besoins de son propre système théorique, le jugement de valeur qu’elle recouvre – élément à la fois propre à Rousseau et central dans l’économie de sa pensée – a bénéficié d’une grande postérité dans l’histoire des idées. Aujourd’hui encore, le caractère irréductible et idiosyncrasique de la musique française d’Ancien Régime, la forte charge identitaire des productions musicales les plus hauts placées dans la hiérarchie des genres comme la tragédie en musique ou le motet à grand chœur, leur isolement superbe vis-à-vis d’une Europe baroque tout acquise à la musique italienne, sont autant de lieux communs qui viennent mettre au jour le rousseauisme latent de notre tradition musicologique. La forte cohérence interne de la vie musicale dans le royaume de France, très centralisée d’un point de vue institutionnel mais aussi stylistique et générique, aurait eu pour corollaire l’incapacité des productions musicales françaises à s’inscrire dans d’autres paysages institutionnels, confessionnels, culturels et sonores. À la longue liste des différences entre musique française et italienne dressée par les théoriciens de la première moitié du xviiie siècle, la musicologie a donc progressivement pris l’habitude d’ajouter celle-ci : alors que la musique italienne voyage, circule, se transmet, la musique française reste à la maison.
1
Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des langues, in : Œuvres Complètes, vol. 5, éd. Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris 1995, p. 412. L’Essai sur l’origine des langues, publié de façon posthume en 1786, fut commencé par Rousseau dès 1755, au sortir de la Querelle des Bouffons.
–7–
Introduction
Un angle mort au cœur de l’Europe Cet ensemble de préjugés a longtemps découragé toute vélléité de constituer la circulation de la musique française en objet de recherche : devant les kilomètres de musique italienne conservés dans les bibliothèques au Nord des Alpes, se mettre en tête d’y dénicher des productions françaises aurait été vouloir trouver une aiguille dans une botte de foin. Pour une musicologie allemande très tôt marquée par le protestantisme culturel de ses représentants les plus prestigieux, la musique française a également pâti de son association avec la danse et le théâtre, par opposition avec une musique italienne qui avait été très tôt acclimatée au culte luthérien et pouvait donc être érigée en objet de recherche respectable. De ce point de vue, la fortune historiographique de l’anecdote rapportant la fuite de Louis Marchand, quittant Dresde avec armes et bagages en 1717 pour ne pas risquer de perdre la face devant Johann Sebastian Bach, peut être lue comme le symptôme le plus emblématique de la difficulté à appréhender la musique française du premier xviiie siècle dans un contexte européen. Exactement un siècle après cet épisode, Carl Zelter opposait toujours dans une lettre à Goethe « l’écume française » à « l’élément fondamental allemand » dans la musique de Bach, reconduisant une figure centrale du discours musicologique depuis la nécrologie de 1754 et la première biographie publiée par Forkel en 1802, mais qui avait gagné une actualité nouvelle à la suite des guerres napoléoniennes.2 Le déficit d’attention accordée à la circulation européenne de la musique et des musiciens français ne fit que se renforcer au cours du xxe siècle : les développements dramatiques de la relation franco-allemande à partir de 1870, la faiblesse structurelle du Saint Empire dans les études historiques francophones, le privilège accordé aux traditions musicales nationales des deux côtés du Rhin et la complexité des relations musicologiques franco-allemandes laissèrent dans la cartographie musicale de l’Europe moderne un trou béant que l’amitié franco-allemande ne put immédiatement combler.3 Alors que les pérégrinations des troupes de comédiens français firent très tôt l’objet de recherches approfondies, leurs collègues musiciens restèrent paradoxalement les parents pauvres d’une historiographie pourtant tout disposée à célébrer les splendeurs passées de l’Europe française. Il fallut attendre les années 1980 pour voir les études musicologiques se saisir de cet objet, notamment sous l’impulsion d’Herbert Schneider.4 Depuis 2010, une nouvelle génération de chercheurs s’est emparé de la question et a entamé une réévaluation décisive du destin européen de la musique française autour de 1700.5 Migration, dissémination, invention : décrire la mobilité L’intensification des circulations musicales entre la France et les États impériaux prend en effet une ampleur spectaculaire à partir de 1660 : l’embauche de musiciens dans plusieurs cours allemandes, la dissémination du répertoire, l’exécution d’œuvres françaises dans les grands centres 2 3 4
5
Lettre de Carl Friedrich Zelter à Johann Wolfgang von Goethe, Berlin, 5-14 avr. 1827. Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1799 bis 1832, éd. Edith Zehm et Sabine Schäfer, vol. 1, Munich 1998, p. 992. Toutes les traductions sont de l’auteur. Christophe Duhamelle, « Das Alte Reich im toten Winkel der französischen Historiographie », in : Imperium Romanum – irregulare corpus – Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie, dir. Matthias Schnettger, Mayence 2002, p. 207-219. Herbert Schneider, « Opern Lullys in deutschsprachigen Bearbeitungen », Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 5, 1981, p. 69-80. « Mattheson und die französische Musik », in : New Mattheson Studies, dir. George J. Buelow et Hans Joachim Marx, Cambridge 1983, p. 425-442. « Unbekannte Handschriften der Hofkapelle in Hannover. Zum Repertoire französischer Hofkapellen in Deutschland », in : Aufklärungen. Studien zur deutsch-französischen Musikgeschichte im 18. Jahrhundert. Einflüsse und Wirkungen, dir. Wolfgang Birtel et Christoph Hellmut Mahling, Heidelberg 1986, p. 180-194. « The Amsterdam editions of Lully’s orchestral suites », in : Jean Baptiste Lully and the Music of the French Baroque. Essays in Honour of James R. Anthony, dir. John Hajdu Heyer, Cambridge 1989, p. 113-130. Rebekah Ahrendt, A Second Refuge. French Opera and the Huguenot Migration c. 1680 – c. 1710, PhD Dissertation, University of California Berkeley, 2011. Margret Scharrer, Zur Rezeption des französischen Musiktheaters an deutschen Residenzen, Sinzig 2014.
–8–
Introduction
musicaux de l’espace germanique ainsi que l’émergence d’un discours théorique de langue allemande sur la musique française constituent autant de modalités essentielles de la circulation des hommes, des œuvres, des pratiques et des savoirs dans l’Europe moderne. Ce qui fait de ces circulations musicales un objet d’étude fascinant et absolument unique, c’est qu’elles nouent étroitement ensemble des mouvements migratoires humains, une dissémination des sources musicales à l’échelle continentale, et un transfert de valeurs et de représentations culturelles. C’est en approchant conjointement ces différents phénomènes que l’on peut toucher du doigt – ou peut-être même goûter – ce que Marc Bloch aurait appelé la « chair humaine » de transferts culturels qui sont loin de se résumer à de purs transferts de papier.6 La prise de conscience de cette pluralité fut un moment décisif dans la genèse de ce livre, et m’a conduit à mener de front une enquête sur la migration des musiciens français et une étude sur les circulations musicales. Pour arriver à cette étape, il fallait opérer une sorte de renversement copernicien : au lieu de partir du sommet que constitue la réception allemande du style français pour redescendre vers l’histoire des circulations, il fallait accomplir le trajet inverse – s’enraciner dans les sources, s’enfoncer dans la vallée des archives, quitte à remettre à plus tard l’exploration des sommets. C’est à ce prix seulement qu’il était possible de mettre à distance les monumentales histoires nationalistes du xixe siècle, les biographies des compositeurs canoniques, les grands récits traditionnels de l’Europe française et de l’exode des huguenots. C’est aussi à partir de ces considérations que la question des échelles spatiales s’est posée avec une acuité renouvelée et qu’une méthode s’inspirant de la prosopographie a permis de traquer les circulations humaines et culturelles au plus près du terrain. La conjonction de ces trois types de circulations – humaines, matérielles, culturelles – ne doit cependant pas faire oublier leurs spécificités respectives et la difficulté à les nommer. En effet, si la « circulation » semble un terme commode et quasiment neutre pour décrire toutes les formes de mobilité, si les « transferts » mettent l’accent sur les transformations que subissent les textes et les objets culturels en se déplaçant dans l’espace, aucun de ces lexiques n’est employé à l’époque moderne : la mobilité semble bien souvent rester une réalité inarticulée et silencieuse. Une certaine latitude était donc possible dans le choix lexical des termes utilisés pour décrire et penser ces différentes formes de circulation. Nous avons finalement opté pour une triade de notions dont la déclinaison reflète la cohérence entre ces différents types de mobilité, mais aussi leurs spécificités : les mouvements humains sont appréhendés à travers la catégorie de la migration, la circulation des sources musicales à travers le temps et l’espace est comprise comme une dissémination, le transfert d’œuvres, de techniques et de représentations culturelles est décrit comme une invention de plein droit. Chacune de ces notions éclaire d’une manière différente l’histoire des circulations musicales dans l’Europe moderne. Une contribution à l’histoire des circulations Dans le contexte de la fascination contemporaine pour les formes historiques de mobilité et à la suite des profonds renouvellements qui ont bouleversé l’histoire des circulations au cours des dernières décennies, ce travail enraciné dans un cadre franco-allemand a d’abord très naturellement été pensé sous le régime des transferts culturels. Forgée en 1987 dans un article programmatique de Michel Espagne et de Michael Werner, la notion de transferts culturels visait à fournir un 6
Marc Bloch, Apologie pour l’ histoire ou métier d’ historien, Paris 1952, p. 4: « Il y a longtemps, en effet, que nos grands aînés, un Michelet, un Fustel de Coulanges nous avaient appris à le reconnaître : l’objet de l’histoire est par nature l’homme. Disons mieux : les hommes. Plutôt que le singulier, favorable à l’abstraction, le pluriel, qui est le mode grammatical de la relativité, convient à une science du divers. Derrière les traits sensibles du paysage, les outils ou les machines, derrière les écrits en apparence les plus glacés et les institutions en apparence les plus complètement détachées de ceux qui les ont établies, ce sont les hommes que l’histoire veut saisir. Qui n’y parvient pas, ne sera jamais, au mieux, qu’un manœuvre de l’érudition. Le bon historien, lui, ressemble à l’ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. »
–9–
Introduction
cadre théorique à l’étude des échanges culturels franco-allemands en mettant l’accent sur les modifications subies par un objet culturel lorsqu’il se déplace dans l’espace, quitte son système culturel d’origine et se trouve réinterprété par un système culturel concurrent.7 Il s’agissait d’enterrer définitivement « l’histoire des influences » qui avait longtemps dominé le discours sur les échanges culturels européens, charriait bon nombre d’implicites sur la hiérarchie des cultures et sous-estimait systématiquement l’ampleur des déplacements opérés par la culture d’accueil, les effets déformants et les obstacles qui marquent les échanges culturels.8 Ainsi la réception française de Kant n’est-elle pas d’abord envisagée par les deux historiens comme la découverte neutre d’un texte, mais comme une série d’appropriations gouvernées par des lignes de fracture et des enjeux extra-philosophiques spécifiquement français : le « Kant des jacobins », celui des émigrés, des Idéologues ou de Madame de Staël ne se recouvrent pas complètement et correspondent à autant de lectures signifiantes. L’étude des « véhicules institutionnels du transfert franco-allemand » était enfin arrimée à une « sociologie des médiateurs ». Il s’agissait de mettre l’accent sur les cadres institutionnels, les conditions sociales et les réseaux qui déterminent dans la culture d’accueil le processus d’acculturation. Les transferts firent rapidement l’objet d’appropriations diverses par des disciplines voisines de l’histoire culturelle, en particulier l’histoire de l’art et la littérature comparée.9 Dans le cadre de la musicologie, les travaux d’Arne Spohr sur les musiciens anglais en Allemagne du Nord autour de 1600 fournissent un exemple précoce et particulièrement fructueux d’appropriation de cet arsenal méthodologique.10 Depuis le début des années 2000, sous la double influence de l’histoire croisée et de l’histoire mondiale, l’étude des circulations est pourtant rapidement sortie du champ de l’histoire culturelle : l’extension des échelles, la pluralisation des objets et la multiplication des méthodes a ouvert la voie à une approche pragmatique, intuitive et éclatée des différents types de circulations, désormais étendue à quasiment tous les domaines et les objets de l’histoire. Dans cette perspective, ce livre ne se limite pas seulement à l’étude de circulations culturelles : il cherche également à élucider les conditions et les modalités de la migration des musiciens français autour de 1700 à travers une enquête de type prosopographique. Peut-être davantage assimilable à un « style de recherche » qu’à un corpus méthodologique très articulé, la prosopographie cherche à élucider les constantes et l’évolution d’un groupe social par le biais des trajectoires individuelles et des biographies singulières des membres qui le constituent.11 Ici, on a choisi de mettre au centre du récit un groupe qui n’est pas habituellement considéré pour lui-même et dont la cohérence n’est pas immédiatement évidente : celui des musiciens français actifs dans l’espace germanique entre 1660 et 1730. Cette enquête s’inspire donc du rapprochement entre histoire sociale et musicologie dans lequel Mélanie Traversier repérait dès 2010 un « tournant historiographique ».12 Deux projets collectifs ont parfaitement mis en lumière toute la richesse que pouvait offrir un métissage entre l’histoire des migrations, la prosopographie et l’histoire de la musique. Sous la direction d’Anne-Madeleine Goulet et de Gesa zur Nieden, le projet « Musici » a permis de rassembler dans une base de données tous les musiciens étrangers actifs à Rome, Naples 7 8
9 10 11 12
Michel Espagne et Michael Werner, « La construction d’une référence culturelle allemande en France : genèse et histoire (1750-1914) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 42/4, 1987, p. 969-992. D’abord élaborée dans le champ de l’astrologie, la notion d’influence fait l’objet d’une belle et étrange définition en 1693 dans le Dictionnaire universel de Furetière : « Influence s. f. Qualité qu’on dit s’escouler du corps des astres, ou l’effet de leur chaleur & de leur lumiere, à qui les astrologues attribuent tous les évenements qui arrivent sur la terre. L’homme sage vaincra toutes les influences des astres. » Béatrice Joyeux, « Les transferts culturels. Un discours de la méthode », Hypothèses, 1, 2002, p. 149-162. Arne Spohr, « How chances it they travel ? » Englische Musiker in Dänemark und Norddeutschland 1579-1630, Wiesbaden 2009, notamment p. 92 sq. Pierre-Marie Delpu, « La prosopographie, une ressource pour l’histoire sociale », Hypothèses, 18/1, 2015, p. 263-274. Mélanie Traversier, « Histoire sociale et musicologie : un tournant historiographique », Revue d’ histoire moderne et contemporaine, 57/2, 2010, p. 190-201.
– 10 –
Introduction
et Venise entre 1650 et 1750.13 De son côté, le projet « Musefrem » dirigé par Bernard Dompnier a développé une base de données sur les musiciens d’église actifs en France au lendemain de la Révolution.14 À la différence de ces deux projets, la démarche adoptée ici n’est cependant pas prosopographique au sens strict du terme mais ressemble davantage à une biographie collective, nous le verrons au début du Chapitre 3. L’essentiel est dans la recherche d’un équilibre entre l’individu et le groupe. En effet, aucune des biographies n’est intéressante seulement pour elle-même, même enrichie par le croisement de divers fonds d’archives. C'est bien plutôt leur « mise en série » qui permet de faire surgir les musiciens français comme un groupe cohérent, dont les trajectoires individuelles et l’expérience collective de la migration s’éclairent réciproquement et se trouvent donc au cœur de l’enquête. Cette mobilité artistique est largement conditionnée par des logiques de marché qui gouvernent l’Europe des arts du spectacle autour de 1700, et conserve un lien essentiel avec la mobilité des troupes de théâtre : pour tous ces aspects, les travaux de Rahul Markovits ont constitué une source d’inspiration essentielle.15 De l’Europe à la Basse-Saxe et la Saxe : les cadres de l’enquête Aussi bien pour l’étude des circulations que pour l’histoire des migrations, la question des échelles est décisive, car elle détermine non seulement le cadre de travail et la définition de l’objet, mais aussi les résultats de l’enquête.16 Si cette notion était restée à l’arrière-plan des premières recherches sur les transferts culturels, qui se référaient d’autant plus naturellement au cadre national qu’elles se développaient dans le champ des études franco-allemandes, Michael Werner a très tôt mis en évidence les enjeux méthodologiques décisifs liés à cette question.17 Tout en prenant acte des travaux qui, dans la lignée des transferts culturels, faisaient éclater le cadre national et introduisaient des variations d’échelle dans leurs objets, Werner mettait en garde contre le danger de « projeter sur une échelle locale ou régionale des questions ou des objets intellectuels toujours constitués dans un cadre de référence dominée [sic] par le modèle de la culture nationale ». Il insistait sur l’inévitable dissymétrie des échelles régionales entre deux cultures étrangères (un Land allemand et une région française sont sur bien des points radicalement différents l’un de l’autre) et invitait à croiser délibérément les angles d’approche en faisant varier les échelles pour aborder un même objet. Cette ambition figurait également au cœur de l’histoire croisée.18 Un de ses objectifs est ainsi de « sonder, par un biais particulier, des questions générales telles que celle des échelles ». Il s’agissait de remédier à un problème qui affecte aussi bien le comparatisme – aucun « niveau de comparaison » ne saurait être rigoureusement transposable d’un espace à un autre, mais est au contraire toujours le fruit d’une construction historique dont la particularité est gommée par la comparaison – que les transferts culturels – les « cadres de référence » sont pensés comme des unités stables et connues d’avance, pôles d’un transfert linéaire simple, ce qui ferme la porte à des approches plus complexes portant sur des échelles multiples. À partir de cette analyse, le « croi13 14
15 16 17 18
Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (1650-1750). Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples (1650-1750), dir. Anne-Madeleine Goulet et Gesa zur Nieden, Kassel 2015. Bernard Dompnier, Sylvie Granger et Isabelle Langlois, « Deux mille musiciens et musiciennes d’Église en 1790 », in : Histoires individuelles, histoires collectives. Sources et approches nouvelles, dir. Christiane Demeulenaere-Douyère et Armelle Le Goff, Paris 2012, p. 221-236. La Circulation de la musique et des musiciens d’église, France xvie – xviiie siècle, dir. Xavier Bisaro, Gisèle Clément, Fañch Thoraval, Paris 2017. Rahul Markovits, Civiliser l’Europe. Politiques du théâtre français au xviiie siècle, Paris 2014. Bernard Lepetit, « Architecture, géographie, histoire : usages de l’échelle », Genèses. Sciences sociales et histoire, 13, 1993, p. 118-138. Michael Werner, « Les usages de l’échelle dans la recherche sur les transferts culturels », Cahiers d’études germaniques, 28, 1995, p. 39-53. Michael Werner et Bénédicte Zimmermann, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 58/1, 2003, p. 7-36.
– 11 –
Introduction
Illustration 0.1. Emplacement des villes et des cours citées au cours de l’ouvrage sur la carte actuelle de l’Allemagne. En rouge figurent les cours qui se trouvent au cœur de l’enquête.
sement des échelles spatiales et temporelles » était présenté par Werner et Zimmermann comme l’un des axes centraux de l’histoire croisée, permettant à la fois de privilégier une « démarche inductive et pragmatique » à rebours des échelles toutes prêtes léguées par l’historiographie, et d’inciter le chercheur à justifier ses choix de façon réflexive.19 Le choix d’échelles spatiales adaptées, le croisement de différents angles d’approche et l’introduction d’une variable d’ajustement dans la focale sont au cœur de ce travail. Ces enjeux méthodologiques sont particulièrement cruciaux pour un travail portant sur les migrations dans le Saint Empire, puisqu’il s’agit d’un espace politique immense, morcelé et complexe dont les frontières internes et externes ont beaucoup varié au cours de l’histoire et ne sont pas reflétées dans la géographie actuelle de l’Europe.20 S’il était évident dès le départ que l’Empire formait 19 20
Werner et Zimmermann, « Penser l’histoire croisée », p. 21-26. Louis Delpech, « Les musiciens français en Allemagne du nord (1660-1730). Questions de méthode », Diasporas. Circulations, migrations, histoire, 26, 2015, p. 57-73.
– 12 –
Introduction
un espace beaucoup trop vaste pour pouvoir être embrassé d’un seul regard, il m’est cependant apparu de plus en plus clairement au fil du temps que le cadre de référence franco-allemand choisi à l’origine de mon travail explosait sans cesse au fil de l’enquête, les trajectoires des musiciens français ne se limitant généralement pas à quelques régions mais parcourant l’Europe en tous sens. De nombreuses variations d’échelles sont donc introduites à partir du cœur de l’enquête, formé par deux Länder de l’actuelle République fédérale d’Allemagne : la Basse-Saxe, qui rassemble les différentes cours princières de l’ancien duché de Braunschweig-Lüneburg mais inclut aussi Osnabrück tout en offrant un cadre de référence immédiatement identifiable pour le lecteur d’aujourd’hui, et la Saxe qui est peut-être plus familière au lecteur français (Illustration 0.1). Par le biais des cours de Celle, d’Osnabrück, de Hanovre et de Dresde, ces deux régions ont abrité les principaux contingents de musiciens français actifs dans l’Empire : un échantillon représentatif de 144 musiciens français a ainsi pu être constitué, indépendamment de la durée de leur séjour dans l’une de ces deux régions.21 C’est à partir de cet échantillon que sont étudiées les migrations musicales françaises dans l’espace germanique, tout en faisant ponctuellement appel à d’autres espaces et à d’autres cas d’étude. Un phénomène aux facettes multiples Bien que formant un tout cohérent, les différentes facettes des circulations musicales entre la France et l’espace germanique sont nécessairement abordées de manière successive au fil de l’ouvrage. Les trois premiers chapitres se concentrent avant tout sur les migrations humaines, tandis que les deux derniers abordent leur dimension spécifiquement musicale et esthétique. Même si ces deux ensembles de chapitres pourraient à la limite faire l’objet d’une lecture indépendante, c’est précisément leur coexistence et leurs points de convergence qui font à mes yeux l’intérêt de ce livre et mettent en évidence la solidarité profonde entre la migration des musiciens, la dissémination de la musique et l’invention allemande du style français. Les cinq chapitres sont ainsi conçus comme cinq points de vue différents sur une même réalité, cinq variations sur un thème commun : le fonctionnement global d’un marché du travail, les procédures de patronage et d’administration de la musique française mises au point par les mécènes, l’expérience de la migration et les conditions de travail des musiciens, la dissémination des sources et du répertoire musical français, l’invention allemande du style français. Le livre s’ouvre par une enquête sur l’Europe galante comme marché du travail : il s’agit de faire apparaître les logiques économiques, les pôles d’activité et la pluralité des réseaux qui structurent l’espace européen du point de vue des musiciens français. Depuis l’émergence d’un marché international de la musique au lendemain de la guerre de Trente Ans jusqu’à l’apparition des premiers phénomènes de célébrité musicale dans les métropoles européennes du premier xviiie siècle, l’élargissement progressif et l’intégration croissante de l’espace musical pour les artistes français est mis en évidence à travers trois parcours successifs. Le premier prend pour point de départ la tournée d’Anne de La Barre en Europe du Nord au milieu des années 1650 : à travers un tour d’horizon préliminaire des différentes cours qui accueillent des artistes français, il s’agit de montrer la cohérence de l’espace nord-européen du point de vue des migrations musiciennes. Ce premier aperçu est complété par une investigation en profondeur des différents réseaux aristocratiques, diplomatiques et artistiques qui participent à l’élargissement considérable de ce marché du travail dans les décennies suivantes, jusqu'en 1700. Un autre parcours arpente l’Europe en compagnie des troupes de théâtre. L’établissement de troupes de comédiens français dans les cours de Celle, Hanovre, Osnabrück et Dresde permet d’apercevoir la mobilité des acteurs depuis la France et la Hollande, d’esquisser les contours du modèle social et artistique bien particulier de la troupe, et de mettre en lumière le rôle joué par les musiciens au sein de ces structures. Les aventures de l’opéra de Pologne permettent cependant aussi de mesurer les difficultés auxquelles 21
Le répertoire bibliographique des musiciens peut être consulté en ligne à l’adresse suivante : https://tiny.uzh. ch/13G.
– 13 –
Introduction
se heurte une transposition trop littérale du modèle de la troupe au monde de la musique. Sortant de l’espace de la cour, le troisième parcours lève le voile sur l’Europe des métropoles et retrace les mutations de l’espace musical européen provoquées par le passage d’un modèle de mécénat aristocratique à un modèle de célébrité urbaine et publique. À partir des productions françaises sur la scène de l’opéra de Hambourg dans les années 1690, il met en lumière un processus d’adaptation du répertoire et du personnel musical français et permet d’appréhender plusieurs carrières situées au point de jonction de ces deux univers. Le deuxième chapitre procède à un changement de décor complet et à un rétrécissement radical de la focale spatiale et chronologique. Il s’agit d’adopter le point de vue des mécènes et de dresser un état des lieux sur le patronage de musique française. L’enquête porte désormais sur les pratiques de mécénat et d’administration de la musique française. Elle est conduite de façon beaucoup plus intensive sur une échelle géographique très resserrée, limitée aux régions de Basse-Saxe et de Saxe. En s’interrogeant sur les motivations qui ont conduit plusieurs cours de ces régions à engager des artistes français dès les années 1660, plusieurs aspects sont passés en revue : leur politique française est d’abord examinée pour déterminer la nature de leurs liens respectifs avec la France sur le plan diplomatique et militaire. Mais au-delà de ces considérations stratégiques, le point décisif est l’articulation et la négociation de nouvelles identités aristocratiques parmi la noblesse d’Empire dans les dernières décennies du xviie siècle. À partir de l’exemple de Sophie de Hanovre et d’Auguste le Fort, on examinera comment les codes et les valeurs de la galanterie sont adoptées et négociées par ces nouveaux patrons de musique française et façonnent leur amour du théâtre et de la musique. Ici, la correspondance de Sophie de Hanovre et le positionnement confessionnel d’Auguste le Fort seront appréhendés à travers leurs implications musicales, révélant une corrélation étroite entre le mécénat de musique française et l’émergence de nouvelles conceptions de l’individu, de la société et du monde. Une fois ce cadre culturel et anthropologique posé, les pratiques d’administration de la musique française sont placées au centre de l’attention pendant toute la fin du chapitre : il s’agit de s’interroger sur les ressorts bureaucratiques, comptables et institutionnels qui transforment les catégories de « musique française » et de « musiciens français » en réalités stables dans le monde des cours allemandes. À travers un examen du corpus documentaire légué par l’administration, ce chapitre met en évidence l’aspect contingent de telles dénominations, montrant en particulier la grande diversité d’origines parmi les « musiciens français ». Mais il examine surtout l’autonomisation progressive des musiciens par rapport au théâtre et s’interroge sur la construction administrative d’une telle autonomie : arrivés dans le sillage des troupes, les musiciens français sont rapidement intégrés dans les différentes chapelles ducales ou princières (Hofkapellen) et rejoignent de ce fait des institutions anciennes, stables, très intégrées au monde de la cour, acquérant par ce biais un statut indépendant du monde des troupes. Enfin, il s’agira de mettre en lumière les différentes stratégies déployées par l’administration pour gérer l’économie matérielle de la musique française, et négocier la coexistence parfois difficile des musiciens français, allemands et italiens au sein d’un même ensemble. Le troisième chapitre se concentre sur les conditions d’existence, de migration et de travail des musiciens français dont il dresse une biographie collective à l’aide d’un arsenal théorique largement issu de l’histoire des migrations. Il fait d’abord apparaître les différents facteurs sociaux, économiques et professionnels qui les ont conduits à quitter leur lieu d’origine et à sortir hors du royaume de France pour rejoindre une destination allemande. Le poids très important des réseaux socio-professionnels et familiaux ainsi que l’importance des considérations financières liées aux différences de salaires bien réelles et à la contraction du marché du travail en France constituent deux aspects essentiels du récit. Mais il s’agit aussi de prendre en considération l’aspect vécu et humain de cette migration en reconstruisant l’expérience que les musiciens euxmêmes ont pu en faire : les modalités du voyage et l’installation dans leur pays d’accueil, leurs conditions d’existence et le choix de s’installer définitivement dans l’Empire ou de rentrer en France après quelques temps sont autant d’aspects éclairés au fil de ces développements. Dans un deuxième temps, le récit se focalise plus spécifiquement sur l’exercice du métier de musicien
– 14 –
Introduction
français : un parcours à travers les différents espaces de la musique française et le passage en revue de plusieurs sous-groupes professionnels à l’identité spécifique – chefs de bande, hautbois et chanteuses – permettent de mettre en évidence la diversité des tâches échues aux musiciens français et d’aborder leur polyvalence professionnelle, leurs pratiques d’enseignement et leurs activités de copie de musique. C’est précisément ce dernier aspect qui traverse le quatrième chapitre de part en part. L’étude de la dissémination de la musique française suppose en effet de faire un aller-retour permanent entre la diffusion des imprimés musicaux, dont la production et la distribution accélérée par le biais des réseaux d’imprimeurs et de libraires participe à partir de 1660 à la formation de bibliothèques musicales institutionnelles et privées, et la copie manuscrite du répertoire français. Celui-ci sera envisagé selon une très grande variété : répertoire instrumental et vocal, répertoire de chambre, de théâtre et d’église. La diffusion de musique imprimée est d’abord envisagée au prisme de trois cas d’étude exemplaires : la place de la musique française dans les bibliothèques royales, ducales et princières, mais aussi aristocratiques et privées ; la diffusion des sources imprimées du motet français dans l’espace germanique ; et la dissémination des livres d’orgue français dans l’entourage de Bach en Allemagne centrale. Dans un deuxième temps sont scrutées les principales collections manuscrites de musique française : la grande collection de parties séparées de la chapelle royale de Dresde forme un immense gisement de sources permettant de reconstruire dans le détail l’élaboration, l’exécution et les usages d’un répertoire d’ouvertures et de suites françaises dans le cadre de la vie de cour. À l’inverse, les collections musicales de la cour de Hanovre sont plus maigres et éparpillées dans plusieurs endroits : à Darmstadt, dans les collections royales de Londres ainsi qu’à Berlin dans la collection Bokemeyer. La reconstruction de cet ensemble de sources permet d’entrevoir la diversité de répertoire et d’usages auxquels pouvait se plier la musique française dans l’entourage de Sophie et Ernst August de Hanovre. Enfin, un dernier développement sera consacré à la place de la musique française dans les livres de musique personnels de quelques grands aristocrates allemands, les collections de Wolfenbüttel offrant ici un complexe de sources particulièrement riche : entre recueil de lieux communs et objet de mémoire, le livre de musique porte la trace d’une relation personnelle et intime avec la musique française, qui s’y trouve très naturellement intégrée à un répertoire de provenance et de nature très diverse. Le dernier chapitre de ce livre examine enfin l’invention allemande du style français. Cette invention est double : pratique et compositionnelle d’une part, théorique et discursive de l’autre. Ici, le genre de l’ouverture sera constamment sollicité et placé sur le devant de la scène : l’ouverture à la française forme en effet le support et le catalyseur de l’appréhension allemande du style français, tant sur le plan pratique que sur le plan théorique, et reste pendant toute la première moitié du xviiie siècle la pierre de touche d’un art de composer à la française. Se mettant à la recherche d’une « méthode française », l’enquête porte d’abord sur les techniques de copie, de mémorisation et d’invention qui sont à l’œuvre dans la composition d’ouvertures à la française. C’est notamment à travers l’exemple de Johann Sigismund Cousser que ces procédures d’assimilation et d’imitation du style français seront mises en évidence et interrogées. Il s’agira alors d’examiner l’adaptation et l’hybridation du genre de l’ouverture dans le cadre de la musique d’église luthérienne à travers l’exemple de la cantate. Ici, les compositions de Georg Philipp Telemann et de Johann Sebastian Bach fourniront la base de l’enquête. Celle-ci portera sur trois moments emblématiques absolument cruciaux pour comprendre le développement d’un art de l’ouverture chez ces deux compositeurs : séparées par une dizaine d’années, ces trois phases de travail atteignent leur point culminant en 1714, en 1723-1724 puis en 1733-1734 et correspondent à autant d’étapes dans l’appropriation de l’ouverture. Enfin, on se mettra à la recherche des marqueurs du style français en-deçà de l’ouverture, en s’enfonçant dans la chair de la musique : l’usage des doublures de violon et la prédominance de certaines modulations harmoniques montrent que le style français peut étendre des racines sous-terraines et parfois insoupçonnées sur l’art des musiciens allemands. La dernière partie du livre porte sur l’invention théorique du style français, en examinant les différentes controverses sur la musique française qui émaillent la vie musicale allemande entre 1710 et
– 15 –
Introduction
1750. L’association de la musique française avec les valeurs de la galanterie et de la modernité au seuil des années 1710 laisse bientôt place à une réalité plus contrastée, marquée par l’apparition des premières Lumières dans l’espace public et l’émergence d’une critique éclairée de la galanterie, parfaitement visibles à Hambourg au milieu des années 1720 à travers la presse et sur la scène de l’opéra. Dès lors, le répertoire français et l’artiste de cour sont perçus comme des reliques d’un monde galant frivole, vain et dépassé. Face à ces critiques, de nouveaux modes de consommation de la musique française voient le jour, notamment par le biais de l’opéra comique. Mais ceux-ci ne peuvent enrayer une évolution qui se poursuit jusqu’à la fin des années 1730 : l’amour de la musique française change définitivement de camp et se range du côté de la critique des Lumières, du conservatisme esthétique et d’un scepticisme radical face à la modernité musicale. Puisque chaque chapitre adopte une perspective différente sur une réalité complexe et polymorphe, chacun d’entre eux parcourt à nouveaux frais l’ensemble de la chronologie, de 1660 à 1730, avec quelques incursions ponctuelles au-delà de ce cadre. Plusieurs fils rouges traversent cependant l’ensemble du livre de manière sous-jacente et lui confèrent une forte unité thématique sans pourtant faire l’objet de développements séparés. Les liens entre la circulation des musiciens et celle des troupes de comédiens français constituent ainsi un premier leitmotiv présent du début à la fin du livre : beaucoup de musiciens français se déplacent en effet dans le sillage de la comédie ou sont engagés pour venir en renfort à des troupes de théâtre françaises. Les trois premiers chapitres cultivent d’ailleurs un certain flou sur la dénomination des artistes français dont il est question : musiciens, danseurs, maîtres à danser ou comédiens. Les mêmes personnes apparaissent bien souvent sous différents rôles, et même si le récit se concentre avant tout sur les musiciens, il doit envisager la polyvalence de leurs activités et leurs liens étroits avec le monde du théâtre et de la danse. Le destin allemand de la musique et des musiciens français a donc partie liée avec la réception de la danse et du théâtre français dans l’espace germanique. Ceci a un effet décisif sur la dissémination de la musique ainsi que sur l’invention allemande du style français, dans la mesure où c’est d’abord le répertoire instrumental en usage sur les théâtres de cour qui va orienter l’ensemble de la production musicale et théorique, notamment à travers le genre de l’ouverture. La question de la galanterie forme le deuxième fil rouge de l’ouvrage : si le patronage de musique française est lié à l’émergence de nouvelles identités aristocratiques parmi la noblesse d’Empire et par ce biais à une éthique ou un art de vivre galant, la galanterie est également une catégorie éthique et littéraire présente dans les débats théoriques, et constitue un ferment puissant dans l’invention allemande du style français. Dans ce contexte, l’opéra du Gänsemarkt à Hambourg fait deux apparitions éloignées mais décisives : au premier chapitre, cette institution sert à montrer l’urbanisation de l’opéra français dès les années 1690, tandis qu’au dernier chapitre, elle est mobilisée comme le lieu où se nouent de manière privilégiée une critique éclairée de la galanterie, un refus du modèle de l’artiste de cour et une mise en crise des genres lyriques français. Le corpus de textes allemands qui proposent une réflexion littéraire et éthique sur la galanterie apparaît également de façon ponctuelle. Si le travail de l’historien consiste selon la définition fameuse de Roger Chartier à « écouter les morts avec les yeux », il implique aussi parfois de prêter une oreille attentive aux vivants.22 Ce livre est issu d’une thèse de doctorat soutenue à l’Université de Poitiers le 11 décembre 2015. Rédigé sous la direction de Thierry Favier et de Michael Heinemann, il a bénéficié de leur audace scientifique, de leur hauteur de vue et de leur bienveillance. Il a aussi pu profiter de la lecture et des remarques pénétrantes formulées par les membres du jury de thèse : Rebekah Ahrendt, Xavier Bisaro (†), Laurence Dreyfus et Rahul Markovits. Qu'ils en soient ici individuellement et collectivement remerciés. 22
Roger Chartier, Écouter les morts avec les yeux, Paris 2008.
– 16 –
Chapitre 1. L’Europe galante comme marché du travail •
Au début du printemps 1666, une semaine après Pâques, sept instrumentistes originaires de Paris arrivèrent à la cour de Celle, une petite ville du Nord de l’Allemagne perdue dans la lande de Lüneburg, au milieu de marécages couverts de bruyère et parsemés de bois de pins courts battus par le vent. Au centre du bourg se dressait un gigantesque château qui subsiste encore aujourd’hui : la résidence du duc Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg et de sa jeune épouse Éléonore Desmiers d’Olbreuse, une huguenotte française alors enceinte de son premier enfant. La sonorité de leurs patronymes trahissait immédiatement l’origine française des musiciens : Philippe La Vigne, Claude Pécour, Thomas de La Selle, François Robeau, Jean-Jacques Favier, Guillaume Josse et René des Vignes. D’âge jeune, entre dix-sept et vingt-sept ans, ils avaient sans doute pu franchir sans encombre, juste après la fin de l’hiver, les quelques huit cents kilomètres qui séparaient Paris de Celle par la route de Hollande. Rien ne permettait alors de deviner que cette petite bande de violons, d’abord logée à l’auberge puis chez l’habitant avant de s’installer définitivement à Celle, allait devenir au fil des années la première chapelle musicale française permanente de l’Empire, celle-là même qui allait faire découvrir, une trentaine d’années plus tard, le son de la musique française au jeune Johann Sebastian Bach. L’arrivée de ces sept hommes dans l’un des principaux duchés de l’Empire peut être lue comme l’indice d’une réalité nouvelle : l’émergence d’un marché européen des arts du spectacle, apparu au lendemain de la guerre de Trente Ans et au sein duquel les artistes, surtout lorsqu’ils étaient originaires de France ou d’Italie, se mettent de plus en plus souvent en quête de travail audelà des frontières de leur pays d’origine. À partir de la fin des années 1650, non seulement pour les musiciens mais aussi pour les acteurs et les danseurs, le départ à l’étranger change progressivement de statut, dépassant le cadre traditionnel, exceptionnel et temporaire du voyage d’études pour devenir une étape professionnelle assez courante, souvent longue et parfois définitive. Ce phénomène, qui se développe jusqu’au milieu du xviiie siècle, constitue l’un des facteurs décisifs de l’homogénéisation culturelle de l’Europe, un levier essentiel dans l’émergence de la célébrité artistique, et peut être interprété comme la conséquence d’une nouvelle « culture de la mobilité » décrite par Daniel Roche pour la seconde moitié du xviiie siècle, mais déjà considérée par Paul Hazard comme l’un des premiers indices de la « crise de la conscience européenne » qui aurait secoué le Grand Siècle finissant.1 Ce nouveau marché du travail fut pourtant bientôt l’objet d’interprétations divergentes. C’est aussi en 1666 que le polygraphe Samuel Chappuzeau, huguenot français exilé à Genève, entamait la publication de son Europe vivante dédiée aux « puissances souveraines de la Chrétienté », dont la première partie consistait en une description des principaux États de l’Europe – un vaste panorama géopolitique couvrant tout l’espace compris entre les îles Britanniques et la Turquie, en
1
Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne 1680-1715, Paris 1961 [1935], en particulier le premier chapitre « De la stabilité au mouvement », p. 9-25. Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Paris 2003.
– 17 –
Chapitre 1
passant par l’Allemagne, la Pologne ou la Moscovie. Cette Europe vivante, Chappuzeau en situait significativement le centre de gravité non pas en France, mais dans un espace germanique situé entre les Alpes et la Mer du Nord, entre Genève et Königsberg, et qualifié en raison de sa complexité politique de « Labyrinthe où se perdent les plus intelligens ».2 Il promettait par ailleurs d’en livrer une description plus complète dans un prochain ouvrage, et de réaliser ainsi l’objectif premier de L’Europe vivante.3 Cette seconde partie, la Suite de l’Europe vivante, parue cinq ans plus tard en 1671 sous la forme d’un journal de voyage en Allemagne, rédigé d’avril à août 1669 et dédié aux « princes de l’Empire », fournit une « relation fidele & particuliere de l’estat present de plusieurs Cours de l’Empire » qui prend parfois les allures d’un bottin mondain visant à « désabuser ceux qui croyent que toute la politesse & la galanterie du siecle sont renfermées entre Calais & Marseille.4 » Là encore, l’objectif de Chappuzeau est clair : il s’agit de situer le cœur battant de l’Europe dans l’Empire plutôt que dans le royaume de France, et de montrer que les puissances impériales participaient tout autant – sinon mieux – à la vie civilisée de l’Europe que l’aristocratie française avec laquelle il entretenait visiblement un rapport compliqué.5 De ce point de vue, il est significatif que les deux volumes de L’Europe vivante aient été traduits en allemand aussitôt après leur sortie, et que le second volume porte parfois le titre L’Allemagne protestante.6 Aux yeux de notre courtisan huguenot, « l’Europe vivante » et « l’Allemagne protestante » semblent bien faire une seule et même chose. Fin connaisseur de l’espace germanique, Samuel Chappuzeau était avant tout spécialiste de théâtre. Sa production dramatique inclut une douzaine de pièces, rééditées de nombreuses fois sous des titres différents, ainsi qu’un ouvrage sur le théâtre français publié après son exil, et qui demeure aujourd’hui une mine d’informations pour les historiens du théâtre.7 Au cours de son voyage en Allemagne, l’écrivain avait fait halte aux environs de Hanovre, aux eaux de Pirmont où toutes les branches de la famille ducale de Braunschweig-Lüneburg se trouvaient rassemblées pour une pause estivale. Il avait pu y faire la connaissance des princes de Hanovre, Wolfenbüttel, Osnabrück et Celle, et surtout entendre leurs musiciens et leur troupe de comédiens français, lesquels avaient joué une pièce de circonstance composée par lui.8 Leurs contacts se prolongèrent et eurent un résultat très concret plus de dix ans plus tard : Chappuzeau fut employé par la cour de Celle à partir de 1682 comme gouverneur des pages.9 Si l’ouvrage de Chappuzeau témoigne d’une forte conscience de l’Europe comme entité culturelle homogène, il constitue donc surtout une étape cruciale dans une stratégie de carrière, dont le couronnement est atteint au début des
2
3
4 5 6 7 8 9
Samuel Chappuzeau, L’Europe vivante ou relation nouvelle historique & politique de tous ses Etats, Genève 1667, p. 339. Notons que si l’ouvrage est publié en 1667, son titre affiche l’ambition de dresser un portrait des États européens « selon la face qu’ils ont sur la fin de l’année [1666] », et que la gravure figurant sur la page de titre illustrée est datée de 1666. Chappuzeau, L’Europe vivante, p. 334-335 : « Avant que de passer outre, il faut que j’avertisse le Lecteur, que n’ayant pû recevoir de toutes les Provinces d’Allemagne les instructions necessaires pour mon projet, non plus que de la Suisse ny des Pays-Bas, je ne donnerai icy que le plan des choses, dont je reserve le detail à une seconde impression. […] Je me contenteray donc de donner icy la Description Generale de l’Empire, & de la Suisse, & des Pays-Bas, avec les Portraits des Princes régnans, ce qui est mon but principal, & ce que j’appelle proprement L’Europe vivante. » Samuel Chappuzeau, Suite de l’Europe vivante contenant la relation d’un voyage fait en Allemagne, Genève 1671, p. 3. Sur la biographie de Chappuzeau, voir Friedrich Meinel, Samuel Chappuzeau 1625-1701, Leipzig 1908. Neil Jennings et Margaret Jones, A Biography of Samuel Chappuzeau, a Seventeenth-Century French Huguenot Playwright, Scholar, Traveller, and Preacher. An Encyclopedic Life, Lewiston 2012. Samuel Chappuzeau, L’Allemagne protestante, ou Relation nouvelle d’un voyage fait aux cours des électeurs et des princes protestants de l’Empire, Genève 1671. Samuel Chappuzeau, Jetztlebendes Europa, Francfort 1670. Samuel Chappuzeau, Jetztlebenden Europae anderer Theil, Francfort 1670. Samuel Chappuzeau, Le Théâtre françois, éd. Christopher J. Gossip, Tübingen 2009 [Lyon 1674]. La liste des pièces de Chappuzeau est donnée par Jennings et Jones, A Biography of Samuel Chappuzeau, p. 197-202. Chappuzeau, Suite de l’Europe vivante, p. 348. Jennings et Jones, A Biography of Samuel Chappuzeau, p. 55-63.
– 18 –
L’Europe galante comme marché du travail
années 1680, et le modèle européen qu’il élabore ne peut pas être séparé de ses visées professionnelles ni de ses projets artistiques. Par bien des aspects, l’Europe vivante de Chappuzeau, issue d’une pratique de l’Europe qui trouve son origine dans l’exil religieux, mais aussi le théâtre français et la vie de cour, coïncide donc avec l’Europe de nos musiciens français. En somme, « l’Europe vivante » qu’il décrit n’est pas autre chose qu’un marché du travail aux frontières définies de façon pragmatique par le hasard des rencontres, dont les centres de gravité sont déterminés par les différentes cours où il était susceptible de trouver un emploi. Ce modèle européen est diamétralement opposé à celui de L’Europe galante représenté sur la scène de l’Académie royale de musique dans un opéra-ballet donné le 24 octobre 1697, plus de trente ans après la publication du premier ouvrage de Chappuzeau. Cette œuvre, qui connut un succès retentissant dès sa création et une diffusion très large au-delà même des frontières du royaume jusque dans les années 1730, était le premier grand succès d’André Campra et du librettiste André Houdar de la Motte, qui écrivit de nombreux livrets avant d’être reçu à l’Académie française en 1710 et de renoncer à un genre perçu comme inférieur. Protégé de Fontenelle et proche de Fénelon, ses options intellectuelles étaient clairement favorables au camp des Modernes comme en témoigne notamment sa traduction de l’Iliade en 1714, qui marqua un nouveau départ de la Querelle.10 De façon plus radicale encore que les tragédies en musique de Lully et Quinault vingt-cinq ans auparavant, l’Europe galante était donc l’œuvre de Modernes, qui brisaient le cadre séculaire de la tragédie en introduisant un genre par fragments.11 Dans une lettre à la traductrice d’Homère Madame Dacier, Saint-Hyacinthe ne manque d’ailleurs pas, pour prendre la défense de Houdar de la Motte, de citer un long passage de l’Iphigénie en Tauride, une tragédie en musique de Campra, comme exemple de la « fleur de l’esprit » contemporain.12 Bien sûr, l’Europe galante du ballet est un décor de carton-pâte pittoresque et n’est pas à prendre trop au sérieux : Europe méditerranéenne de pacotille où se succèdent les stéréotypes amoureux, elle joue avec les préjugés et ne se comprend pas sans une certaine dose d’ironie.13 Mais cette œuvre, donnée quelques semaines seulement après la signature du traité de Ryswick, est aussi en un sens littéral un ballet des nations, dont Alain Viala a bien mis en évidence les enjeux politiques en insistant sur une triple particularité : le message délibérément optimiste d’une France soumettant l’Europe aux « doux liens » de la galanterie, la présence incontournable de l’Empire ottoman – le meilleur allié de la France face aux Habsbourg une fois entériné l’échec de la diplomatie impériale française – dans le dernier acte, et enfin l’association entre gloire et galanterie opérée par le livret.14 De cette Europe galante, les grands pays du Nord sont complètement absents – conséquence du contexte géopolitique et du substrat diplomatique de l’œuvre, mais aussi indice de la distance culturelle profonde qui sépare ce modèle de celui esquissé trente ans auparavant par Chappuzeau au moment du traité d’Aix-la-Chapelle. L’opposition qui peut être creusée terme à terme entre ces deux modèles francophones de l’Europe – une « Europe vivante » d’imprégnation huguenotte, centrée sur le Saint Empire, façonnée par la circulation des comédiens français et déployée de façon érudite par Chappuzeau pour un public germanophile d’une part, contre une « Europe galante » d’inspiration moderne
10 11 12
13 14
Marc Fumaroli, La Querelle des Anciens et des Modernes, Paris 2001, p. 450-493. Sur les liens entre tragédie lyrique et les Modernes, cf. Fumaroli, La Querelle, p. 163-178. Hyacinthe Cordonnier, dit Thémiseul de Saint-Hyacinthe, « Seconde lettre à Madame Dacier », in : Fumaroli, La Querelle, p. 543-544. Tragédie en musique créée à l’Académie royale de musique le 6 mai 1704, Iphigénie en Tauride avait été composée par Henry Desmarest et André Campra sur un livret de Joseph-François Duché de Vancy et Antoine Danchet. Voir la remarque insérée après le Prologue dans la partition générale : « On a choisi des Nations de l’Europe, celles dont les caractères se contrastent davantage, & promettent plus de jeu pour le Théatre […] : On a suivy les idées ordinaires qu’on a du génie de leurs Peuples. » André Campra, L’Europe galante, Paris 1714, p. 68. Alain Viala, La France galante. Essai historique sur une catégorie culturelle, de ses origines jusqu’ à la Révolution, Paris 2008, p. 318-319.
– 19 –
Chapitre 1
et gallicano-parisienne, centrée sur l’espace méditerranéen, polarisée par la galanterie entendue comme technique amoureuse déclinée en plusieurs styles nationaux mais dominée de façon naturelle par les Français, et représentée de façon comique par Campra et La Motte sur la scène de l’Académie royale de musique – reflète l’ampleur et la centralité des interrogations sur le modèle culturel européen dans le débat intellectuel de la fin du siècle. Ce contraste n’est peut-être nulle part plus visible que dans l’Europe écrite par Chappuzeau en 1689 pour la cour de Celle (Illustration 1.1).15 Cette « pastorale héroïque ornée de Musique, de Dances, de Machines, & de Changemens de Théâtre » prend pour sujet l’enlèvement d’Europe par Jupiter, à laquelle Chappuzeau ajoute l’histoire de sa délivrance par son frère Cadmus, symbole à peine voilé de la sauvegarde de l’Europe par les princes de Braunschweig qui, défenseurs de sa liberté face aux tentatives de domination sans partage d’un « grand Roy » Illustration 1.1. Samuel Chappuzeau, Europe, page de titre du livret. sous lequel on reconnaît Louis XIV, sont D-W, Textb. 180. explicitement assimilés à de nouveaux Cadmus.16 Ce livret remarquablement élaboré subvertit donc le modèle lullyste de deux manières : d’une part, en faisant référence par sa thématique à la première tragédie en musique écrite par Quinault et Lully en 1673, Cadmus et Hermione ; d’autre part, en convoquant le genre tout nouveau de la « pastorale héroïque » inventé trois ans auparavant par Lully et Campistron avec Acis et Galatée, première pastorale héroïque. L’année même où Chappuzeau créait son Europe à Celle, l’œuvre de Lully était d’ailleurs produite sur la scène toute proche du Gänsemarkt de Hambourg – et comme l’œuvre de Chappuzeau, le livret de Hambourg portait également, sur la page de titre, le sous-titre de « pastorale héroïque ». Pour imaginer son Europe, Chappuzeau s’est donc inspiré du modèle lullyste, tout en inversant sa charge politique afin d’en faire un éloge passionné de l’Europe vivante, alors même que venait de commencer la guerre de la Ligue d’Augsburg. De quelle Europe parle-t-on, lorsque l’on étudie les circulations des musiciens français entre 1660 et 1730 ? Notre hypothèse est que « l’Europe vivante » de Chappuzeau, labyrinthe centré sur l’Empire, avec ses dénivelés, ses impasses et ses plateaux, ses travailleurs et ses migrants, forme le soubassement, la base matérielle ou – pour parler en termes marxistes – l’infrastructure d’une « Europe galante » souvent idéalisée, uniformisée, et ramenée à une aire culturelle 15 16
Samuel Chappuzeau, Europe, pastorale héroïque, Celle 1689. Chappuzeau, Europe, p. 19-20 : « [L’oracle dit] que Cadmus son frere feroit tous ses efforts pour la tirer d’esclavage ; Qu’il entreroit dans les terres d’un puissant Roy, où il auroit d’abord un furieux dragon à combatre, & dont il seroit victorieux ; Que des dents de ce dragon semées en terre, il sortiroit des hommes armez, qui s’egorgeroient aussi tôt les uns les autres […]. Enfin que dans les siecles futurs il se trouveroit des Princes, qui charmez de même de la beauté de l’Europe entreprendroient de s’en rendre maîtres, & voudroient la posseder toute entiere, mais qu’il se trouveroit aussi de nouveaux Cadmus pour defendre sa liberté. »
– 20 –
L’Europe galante comme marché du travail
où l’influence française rayonnerait sans effort, sans écran et sans partage. Pour faire surgir les rouages de l’Europe galante, il faut donc descendre de la scène, détacher ses yeux du spectacle et aller regarder l’envers du décor, pour parcourir à la suite de Chappuzeau un espace dont la cohérence est véritablement produite par la circulation des artistes. Espace de circulations culturelles où se rejoignent musiciens, comédiens et danseurs, l’Europe vivante est avant tout un marché du travail gouverné par des logiques économiques d’offre et de demande. L’expression de marché du travail, déjà utilisée par Rahul Markovits pour décrire les carrières européennes d’acteurs français au xviiie siècle, n’est pas la projection sur l’époque moderne d’une catégorie économique formulée seulement à partir de la fin du xixe siècle.17 Elle est plutôt le moyen de mettre à distance un type de discours souvent idyllique sur les échanges culturels, habituellement crédités d’une valeur intrinsèque positive, en mettant en avant leur dimension économique et concurrentielle, de même que leurs aspects les plus concrets et les conditions de travail des musiciens.
L’émergence d’un marché international Depuis les années 1650 et jusqu’à la fin de la Grande guerre du Nord en 1721, le littoral de la Mer Baltique et de la Mer du Nord émerge comme entité économique, diplomatique et géopolitique de premier plan, grâce à l’expansion territoriale de la Suède après la guerre de Trente Ans, au développement continu des échanges commerciaux entre les grandes villes portuaires de la Hanse, et à la position stratégique des puissances du Nord comme arbitres potentiels des conflits qui opposaient la France et l’Empire.18 Au même moment, cet espace devient également une destination privilégiée pour les artistes français. À partir du milieu du xviie siècle, juste après la fin de la guerre de Trente Ans (1618-1648), plusieurs cours luthériennes du Nord de l’Europe commencèrent à embaucher des musiciens français pour produire opéras, divertissements et ballets, ainsi qu’un vaste répertoire musical en provenance de la France, créant progressivement un large bassin d’emplois dans la région. Christine de Suède (1626-1689) fut l’une des premières personnalités à mener cette politique musicale, en faisant venir plusieurs musiciens français à Stockholm, notamment Anne et Joseph Chabanceau de La Barre. Une dizaine d’années plus tard, vers 1660, l’option musicale française gagna plusieurs autres cours luthériennes de l’Europe du Nord – la cour royale de Danemark à Copenhague, mais aussi plusieurs cours moyennes situées au Nord de l’Allemagne : Celle, Osnabrück, Hanovre, Wolfenbüttel, Schwerin, Güstrow ou Berlin. Entre 1660 et 1730, plus d’une centaine de musiciens quittèrent donc la France et se mirent en route vers le Nord, traversant les frontières politiques, confessionnelles et linguistiques pour servir ces nouveaux maîtres et leur goût croissant pour la musique française. La tournée d’Anne de La Barre, chanteuse française qui fut invitée à Anvers, La Haye, puis dans les cours de Stockholm, Copenhague et Kassel, avant de retourner à Paris d’où elle était partie, fournit à la fois un bon exemple de telles migrations et un excellent fil directeur pour s’orienter dans cet espace complexe tout en faisant le point sur la présence de musiciens français.19 Anne de La Barre et l’Europe du Nord « La difficulté d’un si grand voyage septentrional » – c’est ainsi que Constantijn Huygens caractérise en juillet 1648 les projets de départ en Suède d’Anne Chabanceau de La Barre, l’une des chanteuses les plus célèbres de son époque.20 Rejeton d’une lignée musicale prestigieuse, Anne 17 18 19 20
Markovits, Civiliser l’Europe. Politiques du théâtre français au xviiie siècle, notamment le chapitre 2 « Un marché du travail européen », p. 43-92. Notre propre usage de cette notion doit beaucoup aux conseils de Rahul Markovits. Éric Schnakenbourg, La France, le Nord et l’Europe au début du xviiie siècle, Paris 2008. Sur la carrière d’Anne de La Barre et son voyage en Europe du Nord, cf. Lisandro Abadie, « Anne de La Barre (1628-1688). Biographie d’une chanteuse de cour », Revue de Musicologie, 94/1, 2008, p. 5-44. Lettre de Constantijn Huygens à Anne de La Barre, 21 juil. 1648. Jacob Adolf Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 4, Gravenhage 1915, p. 486-487. Voir la citation complète ci-dessous.
– 21 –
Chapitre 1
était la fille de Pierre III Chabanceau de La Barre, organiste de la Chapelle du roi Louis XIII et claveciniste de la reine Anne d’Autriche. Elle commence sa carrière dès son plus jeune âge, lorsque son père, à l’exemple de Jacques Champion de Chambonnières, ouvre sa maison au public en y accueillant des « concerts spirituels » de musique instrumentale et vocale vers 1650. Dans sa préface aux Airs à quatre parties, Jacques de Gouy évoque cette « Mademoiselle de La Barre, que Dieu semble avoir choisie pour inviter à son imitation toutes celles de son sexe, à chanter les grandeurs de leur Createur, au lieu des vanitez des ses Creatures21 » ainsi que les talents de son frère Joseph, qui jouait du luth dans ces mêmes concerts. Leur séjour relativement bref en Europe du Nord, dont les préparatifs s’étendent sur six ans mais qui ne dura qu’un peu moins de deux ans, est représentatif à trois égards : il illustre l’intérêt des cours d’Europe du Nord pour la musique française dès le milieu du xviie siècle, ainsi que la cohérence d’un espace septentrional au sein duquel les musiciens d’élite franchissent les frontières politiques ; les différentes étapes du parcours entrecroisent en un écheveau complexe tout un ensemble de relations artistiques, scientifiques, diplomatiques et dynastiques, où les mécanismes de célébrité, les services rendus et les rapports de concurrence entre les différents patrons déterminent les carrières individuelles des musiciens ; enfin, ce voyage illustre le caractère central des Pays-Bas, qui commencent à s’affirmer comme véritable plaque tournante du marché du travail européen des arts vivants, rôle qu’ils continueront à jouer jusqu’à la fin de notre période. Les préparatifs d’un voyage C’est ce dernier point qu’avait d’ailleurs parfaitement compris le grand humaniste Constantijn Huygens, musicien et poète accompli, secrétaire du prince d’Orange et ami de Descartes. Dans une lettre envoyée à Anne de La Barre, il invite la chanteuse et son frère Joseph à faire étape à La Haye sur leur route vers Stockholm, ayant eu vent de leurs projets par l’intermédiaire d’un certain Verpré, sans doute le maître à danser François de Verpré.22 Huygens invite donc Anne de La Barre à demeurer quelques semaines en Hollande avant de rejoindre la Scandinavie : [Verpré] nous faict esperer, Mad[emoisel]le, que vous auriez dessein de passer par nos païs en Suede. C’est de quoy je vien m’informer chez vous mesme, pour vous dire que, si ny la difficulté d’un si grand voyage septentrional, ny les tendresses de ce digne pere qui vous a mis au monde, ne vous destournent, je vous guetteray au passage, et en vous faisant un peu reculer pour mieux saulter, vous prieray de reposer quelques sepmaines dans mon logis, qui peut estre n’est pas des plus incommodes de la Haye, et dans lequel au moins vous trouverez luths, tiorbes, violes, espinettes, clavecins et orgues à vous divertir, quasi autant que toute la Suede vous en pourra fournir.23
Constantijn Huygens était loin d’être un novice en matière de musique française, et cette lettre révèle un flair musical aiguisé. Correspondant régulier de Marin Mersenne, Thomas Gobert ou Henry Du Mont, il jouait du luth et composait lui-même de la musique : un volume (Pathodia sacra et profana) avait été imprimé par Ballard en 1647, et plusieurs manuscrits semblent avoir circulé dans les cercles musicaux parisiens, comme en témoigne notamment une passionnante lettre à Du Mont, dans laquelle le savant se plaint doucement de l’altération que le compositeur a fait subir à l’une de ses allemandes en détruisant l’équilibre entre les deux parties, ou encore une lettre du 2 juin 1655 à Jacques Champion de Chambonnières où il évoque la circulation de ses manuscrits.24 21 22
23 24
Cité d’après Abadie, « Anne de La Barre », p. 8. François de Verpré avait été maître à danser de Louis XIII : F-Pn, Rés. F 494, contient une « Courante de M. de Verpré. Favorite de Mr. le Marquis de Qualin en 1639. Les parties en sont faites par Mr. de Lazarin. » Huygens le connaissait bien, puisqu’il avait composé une épigramme satyrique sur le maître de danse : « Dans ce braue Verpré tout est fort estimable, | La main, le mouvement, l’air et le contrepoint : | Ha! qu’il seroit louäble, | S’il ne se louöit point. » Jacob Adolf Worp, De Gedichten van Constantijn Huygens, vol. 4, Groningen 1894, p. 208. Lettre de Constantijn Huygens à Anne de La Barre, 21 juil. 1648. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 4, p. 486-487. Lettres de Constantjin Huygens à Henry Du Mont, 16 mars 1655, et à Jacques Champion de Chambonnières, 2 juin 1655. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 5, Gravenhage 1916, p. 232 et 239.
– 22 –
L’Europe galante comme marché du travail
Huygens avait aussi envoyé à Pierre III de La Barre certaines de ses compositions pour le luth en tablature. Ce dernier travaillait d’ailleurs à transcrire une allemande « fort propre et agreable pour l’Espinette » lorsqu’il reçut l’invitation adressée à ses enfants. Quelques jours plus tard, il répond au savant hollandais en expliquant le retard pris par le projet de voyage de ses enfants, et sonde Huygens sur la possibilité de les employer au service des princes d’Orange : Nous avons recogneu la bonne volonté que vous nous tesmoignez dans l’offre que vous nous faittes de vostre maison en passant pour aller en Suede, mais ce voyage a esté remis accause du Coronnement [sic] de la Reine de Suede qui ne se fera pas si tost. Or, puisque vous nous faittes l’honneur de nous aymer, je ne feindray point de vous dire que si par vostre prudence vous recognoissez que le prince et la princesse [d’Orange] vouleussent avoir aupres d’eux une personne comme ma fille pour l’entendre chanter et mes autres enfans qui touchent des instruments pour accompagner la voix, vous me ferez la faveur de m’en advertir […]. Je vous ay fait cette priere parceque, comme mes enfans ont tasché d’acquerir de la Science, il ne reste si non [sic] a trouver quelque prince auquel ils puissent plaire et donner du contentement qui recognoisse leur peine, ne trouvant pas la vertu assez cogneue en nostre propre pays.25
Pierre de La Barre, visiblement impatient du retard que prenait le voyage en Suède, semblait donc désireux d’envoyer rapidement ses enfants à La Haye au service du couple d’Orange, le prince Friedrich Heinrich, qui était lui-même le fils d’une huguenotte française Louise de Coligny, et la princesse Amalie d’Orange. Huygens évoque cette demande quelques semaines plus tard dans une lettre à Mersenne, mais se refuse provisoirement – sans doute par égard pour Christine de Suède – à favoriser un tel revirement.26 Quelques mois plus tard, Joseph de La Barre prospectait pour Huygens un luth de Bologne d’occasion parmi les vendeurs parisiens, toujours en lien avec François de Verpré.27 Il est très étonnant que La Barre, très introduit dans les cercles royaux, se plaigne en termes assez forts de ne pas trouver « la vertu assez connue en notre propre pays ». Allusion aux désordres politiques de la Fronde qu’il oppose à la paix qui règne en Hollande, cette sortie stigmatise aussi le manque d’opportunités professionnelles qui en résulte, la « vertu » étant ici à comprendre en son sens étymologique de capacité. L’invitation à Stockholm pour Anne et Joseph était arrivée en 1647 ou au début de l’année 1648, probablement par l’intermédiaire de Magnus de La Gardie, favori de Christine qui avait mené une ambassade doublée d’une campagne de recrutement pour le compte de sa maîtresse au cours de l’automne 1646 à Paris.28 Après plusieurs années d’hésitation, ils se décidèrent enfin à partir. Huygens s’était refusé à griller la politesse à la reine Christine en faisant embaucher les enfants de La Barre au service de la maison d’Orange, mais il organisa pour Anne une tournée à Anvers chez les ducs de Lorraine. Le 10 novembre 1652, la duchesse Béatrix de Cusance écrivait en effet à Huygens qu’elle jouissait à Anvers « des merveilles de l’aimable La Barre29 » avant d’annoncer deux mois plus tard le départ de cette « divine Amarante30 ». L’étape suivante était La Haye, où Huygens 25 26
27 28
29 30
Lettre de Pierre III Chabanceau de La Barre à Constantijn Huygens, 31 juil. 1648. Julien Tiersot, « Une famille de musiciens français au xviie siècle : les de La Barre », Revue de Musicologie, 9/25, 1928, p. 1-11, ici p. 7-8. Lettre de Constantijn Huygens à Marin Mersenne, 14 août 1648. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 4, p. 490 : « Le S.r de la Barre me tesmoigne de l’inclination à dedier le service de sa fille et fils à nos Altesses. Si une consideration ne me retenoit, je travailleroy à ce marché, et verray pourtant ce qu’il y aura moyen d’y faire à la Haye […]. » Lettre de Constantijn Huygens à Joseph de La Barre, 15 oct. 1648. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 4, p. 501-502. Cette hypothèse est avancée par Abadie. D’après Michel Le Moël, le voyage des La Barre aurait été négocié par Pierre Chanut, diplomate à Stockholm et ami de Descartes, qui comptait aussi parmi les correspondants de Huygens : Michel Le Moël, « L’entrée des femmes à la Musique du Roi : Anne de La Barre et les autres », in : Études sur l’ancienne France offertes en hommage à Michel Antoine, dir. Bernard Barbiche, Paris 2003, p. 227-234, ici p. 232. Lettre de Beatrix de Cusance à Constantijn Huygens, 10 nov. 1652. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 5, p. 156. Lettre de Beatrix de Cusance à Constantijn Huygens, 12 janv. 1653. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 5, p. 164 : « De goddelijke Amarante gaat ons verlaten. »
– 23 –
Chapitre 1
l’attendait et la fit loger près de chez lui dans le Plein, ainsi qu’il l’écrit à Beatrix. Anne de La Barre y fait la connaissance d’Élisabeth Stuart, reine de Bohême et mère de Sophie de Hanovre, où elle « réussit à merveille », tout comme dans d’autres cercles aristocratiques.31 Elle resta environ six mois chez Huygens à La Haye, attendant la fin de l’hiver pour poursuivre son voyage. Son départ, que Huygens avait cherché plusieurs fois à retarder, fut bientôt inéluctable, et Anne de La Barre arriva à Stockholm autour de juillet 1653. Huygens écrit alors à Pierre Chanut « qu’il n’y aurait point de mal que ceste merveilleuse Reine […] fust informée de la valeur de la belle marchandise qui luy vient de Paris ».32 La chanteuse comme marchandise de valeur : voilà une belle expression du marché européen de la musique sur lequel se mouvaient désormais les musiciens français. Juste après le départ des La Barre, Chambonnières se mettait lui aussi en quête d’un emploi en Europe du Nord. Huygens lui dressa cependant un tableau assez désabusé de la cour d’Orange à La Haye : « Mais ces grands Princes ne sont plus, pour l’amour desquels il valoit la peine de faire le voyage, et à peine l’ombre nous en reste.33 » Pourtant, Chambonnières cherchait toujours à quitter la France sept ans plus tard. Dans une lettre adressée à Otto von Schwerin, haut fonctionnaire berlinois également mélomane, Huygens s’enquiert des possibilités d’emploi à la cour de Brandebourg et recommande le claveciniste : Si vous avez la bonte de souffrir que par ceste occasion je puisse vous entretenir d’un mot de la musique, nostre commune maistresse, je vous advertiray, Monsieur, que le tres illustre Sieur de Chamboniere, qu’homme du monde n’esgale sur le clavecin, soit que vous consideriez la composition ou le beau toucher, se trouve icy si degousté de se veoir ostée par le bas et mauvais menage qui regne en ceste cour, une pension d’environ mil escus par an, qu’il auroit moyen d’en chevir, s’il trouvoit un prince digne amateur de sa science, et capable de le faire vivre avec un peu d’honneur, comme il a toujours faict icy.34
On voit donc qu’au-delà du destin individuel des musiciens, un mouvement collectif vers le Nord se dessine au milieu des années 1650, auxquels plusieurs professionnels de grande réputation voulaient visiblement prendre part. Les cours royales de Suède et Danemark Pendant qu’Anne de La Barre séjournait à La Haye puis Anvers, Joseph de La Barre s’était rendu directement à Stockholm où il apparaît dans les états de la chapelle royale dès 1650.35 Là, il put rencontrer d’autres musiciens français moins connus qui avaient été recrutés dans le cadre d’une politique de spectacles largement inspirée de la France.36 Chronologiquement parlant, la cour de Suède était ainsi en avance d’une bonne quinzaine d’années sur les autres cours de la région, puisque des musiciens français y étaient présents dès le milieu des années 1640 sous l’impulsion de la reine Christine de Suède (r. 1644-1654). Les premiers musiciens furent en effet engagés en 1646, lors de
31
32 33 34 35 36
Lettre de Constantijn Huygens à Beatrix de Cusance, 30 janv. 1653. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 5, p. 166 : « J’use du mieux que je puis de celle qu’il a pleu à V. A. me faire naistre en nous envoyant la divine Amaranthe qui est admirée et cherie icy selon son merite. La Reine de Boheme et sa royale niepce ne se peuvent saouler de sa presence, et pour la premiere fois Madame la Princesse Mere en a eu sa part chez la Reine, ou ceste illustre fille eut une audience fort solemnelle, et ou veritablement elle reuscit à merveille. Elle loge aussi proche de ma maison qu’elle fut à Anvers de l’hotel de V. A., de sorte que nous avons moyen de la veoir souvent, pour aultant que mes occupations me le permettent. » Abadie, « Anne de La Barre », p. 19. Lettre de Constantijn Huygens à Jacques Champion de Chambonnières, 2 juin 1655. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 5, p. 238. Lettre de Constantijn Huygens à Otto von Schwerin, 31 août 1662. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 5, p. 471. Erik Kjellberg, Kungliga musiker i Sverige under stormaktstiden. Studier kring deras organisation, verksamheter och status ca. 1620 – ca. 1720, thèse de doctorat, Université d’Uppsala, 1979, vol. 2. Pour le ballet, voir Stefano Fogelberg, The Queen Danced Alone. Court Ballet in Sweden during the Reign of Queen Christina (1638-1654), Turnhout 2018. Pour le théâtre, cf. Marvin Carlson, « Scandinavia’s International Baroque Theatre », Educational Theatre Journal, 28/1, 1976, p. 5-34.
– 24 –
L’Europe galante comme marché du travail
l’ambassade de Magnus de La Gardie : Pierre Verdier (1672-1706), Pierre Guilleroy (†1666), Pierre Garset (né en 1618), Nicolas Bigot (†1653), Nicolas Picart et Alexandre Voullon. Ils rejoignirent à Stockholm le violoniste Cuny Aubry (†1665) et le luthiste Béchon, déjà présents en Suède avant l’ambassade de La Gardie (Tableau 1.1).37 Dans la mesure où la musique française était liée de près à l’univers du ballet, les maîtres à danser étaient également des figures éminentes dans la diffusion de la musique française : si Antoine de Beaulieu, qui avait été engagé comme maître à danser par la mère de Christine dès 1636, resta le principal créateur de spectacles à Stockholm jusqu’en 1663, il devait parfois céder la place à des concurrents recrutés à l’extérieur, comme en 1646 à un certain Daniel, maître à danser en provenance de Kassel.38 Nom
Date de séjour
Nom
Date de séjour
Cuny Aubry
1640-1665
Joseph Chabanceau de la Barre
1650-1653
Philippe de Beaumont
1649-1653
Adrien et François de La Croix
1650-1653
Bechon
1644-1647
Munier
1650-1651
Béthune
1649-1651
Nicolas Picart
1646-1650
Nicolas Bigot
1646-1653
Picquet
1651-1652
Jacques Feugre
1650-1653
Jean-Baptiste Preudhomme
1650-1651
Pierre Garset
1646-1650
Paul Prevost
1663-1669
Pierre Guilleroy
1646-1666
Pierre Verdier
1646-1706
Anne Chabanceau de la Barre
1652-1654
Alexandre Voullon
1646-1653
Tableau 1.1. Musiciens français engagés à la cour de Suède sous Christine de Suède.
Plusieurs documents conservés aux Archives Nationales permettent de retrouver à Paris la trace de ces musiciens avant ou après leur séjour en Suède. C’est le cas de Nicolas Bigot, qui épousa en 1637, dix ans avant son départ, la fille d’un marchand fripier à Paris, avant de s’associer en 1639 à deux autres instrumentistes puis à trois autres en 1644.39 Pour d’autres, le séjour en Suède semble avoir fonctionné comme une sorte de capital professionnel assez efficace et comme point de départ de réseaux durables : Adrien de La Croix achète ainsi en février 1656, trois ans après son retour à Paris, la charge de violon ordinaire de la Chambre du roi à Louis Bruslard, et conclut en 1660 un contrat d’association avec Jacques Desannez, maître à danser de la reine Christine de Suède, témoignant ainsi du fait que les relations tissées à Stockholm survivent dans l’espace parisien et constituent un vrai capital relationnel et professionnel pour nos musiciens.40 Quelques années après son retour de Suède, Philippe Le Roy de Beaumont est ordinaire de la musique de la Chambre du roi en qualité de chantre.41 Cette mobilité musicienne allait aussi de pair avec une circulation des sources musicales françaises, majoritairement perdues pour les années 1650-
37 38 39
40
41
Kjellberg, Kungliga musiker i Sverige. Fogelberg, The Queen Danced Alone, p. 89. Stefano Fogelberg et Maria Schildt, « L’Amour constant et Le Ballet de Stockholm. Livret et musique pour la représentation d’un ballet de cour durant le règne de la reine Christine », Dix-septième siècle, 261/4, 2013, p. 723-751. AN, Minutier Central, XVI-75, 10 sept. 1637 : Contrat de mariage entre Nicolas Bigot, maître joueur d’instruments, demeurant rue Aubri-le-Boucher, et Anne Hénault, fille de défunt Jean Hénault, marchand fripier, et de Madeleine Chambelan, demeurant rue des Gravilliers. AN, Minutier Central, IX-385, 10 déc. 1639 : Association de trois joueurs d’instruments, dont Nicolas Bigot. AN, Minutier Central, IX-399, 19 août 1644 : Association de quatre joueurs d’instruments, dont Nicolas Bigot. AN, Minutier Central, C-242, 20 fév. 1656 : Vente par Louis Bruslard, l’un des vingt-quatre joueurs de violon ordinaires de la Chambre du roi, à Adrien Delacroix, joueur d’instruments, de la charge de violon ordinaire de la Chambre du roi, dont il est pourvu, moyennant 2400 livres tournois. AN, Minutier Central, XCII-169, 29 oct. 1660 : Association de Jacques Desannez, maître de danse de Christine de Suède, et d’Adrien Delacroix, l’un des 24 joueurs de violon ordinaire de la Chambre du roi pour enseigner la danse et le violon pendant 3 ans. AN, O1 7, fol. 159. AN, Minutier central, XLV-208, 5 juil. 1660.
– 25 –
Chapitre 1
1690, mais dont la collection d’Uppsala conserve la trace pour la période autour de 1700. Ce phénomène n’engage donc pas seulement des carrières, des réseaux et des biographies, mais aussi la circulation de textes, de partitions et d’œuvres – et c’est là une grande partie de son intérêt.42 Pour les enfants de La Barre, le séjour suédois se déroula sous des auspices bien étranges, puisque la peste éclata à Stockholm pendant l’hiver 1653, forçant la cour à quitter la ville. La reine Christine abdiqua en outre quelques mois plus tard, le 6 juin 1654, en faveur de son cousin Charles X, avant de quitter le pays et de se convertir au catholicisme. La veille de son abdication, le 5 juin 1654, elle écrivait encore une lettre à son « Cousin » Louis XIV pour lui demander une pension en faveur de Joseph de La Barre.43 Arrivée beaucoup plus tard que son frère, Anne de La Barre ne semble pas avoir joui de la même faveur auprès de Christine de Suède, si l’on en croit le témoignage de l’ambassadeur du Danemark à Stockholm.44 La plupart des musiciens français durent quitter la Suède au début du règne de Charles X (r. 1654-1660), cousin et successeur de Christine, à l’exception de quelques individus isolés qui demeurent en Suède après 1660 : outre Pierre Guilleroy et Pierre Verdier qui meurent respectivement en 1666 et 1706 à Stockholm, le chanteur Paul Prevost y est engagé de 1663 à 1669.45 Ce dernier avait séjourné à Berlin de 1650 à 1659 puis à Dresde, où l’électeur de Brandebourg l’avait recommandé en soulignant son style très personnel dans la musique vocale.46 D’autres musiciens français sont engagés par Charles XII (r. 1697-1718) mais n’apparaissent pas sur les listes de personnel des archives de la Hovkapellet, sans doute parce qu’ils se déplacent avec des troupes de comédiens. La troupe de Rosidor, engagée par la cour de Suède entre 1699 et 1706 et placée sous la direction de Claude-Ferdinand Guillemay du Chesnay, dit Rosidor, comprenait par exemple quatre chanteurs et sept musiciens, dont les noms sont fournis par Tobias Norlind.47 La troupe de Rosidor père avait déjà joué en 1669 à la cour de Danemark où elle donna des représentations en allemand et en français jusqu’à la mort de Frederik III en 1670, puis sous la direction de Rosidor fils, entre 1682 et 1721. Ce fut aussi le cas d’Anne de La Barre, qui se rendit à Copenhague immédiatement après son départ de Suède en 1654, où elle se produisit auprès de la reine Sophia Amalia. Ces deux étapes ont été durablement marquantes, puisqu’une quinzaine d’années plus tard, dans son contrat de mariage rédigé à Paris en 1668, Anne de La Barre est toujours désignée comme « damoiselle d’honneur des Reines de Suède et de Danemark.48 » À la cour du Danemark, la présence de musiciens français, si elle est attestée par la littérature secondaire, est moins bien documentée qu’en Suède. La musique française semble avoir bénéficié d’une première période de faveur sous le règne de Christian IV, qui avait engagé le violoniste Jacques Faucart comme maître des concerts 42 43 44 45 46
47
48
Voir notamment Mary Terey-Smith, « French Baroque Partbooks in the Uppsala University Library », Canadian Association of University Schools of Music Journal, 9/1, 1979, p. 29-47. Kjellberg, Kungliga musiker i Sverige, p. 828. Fogelberg, The Queen Danced Alone, p. 100. Lettre de Peder Juul à Charisius, Stockholm, 16 juil. 1653. Abadie, « Anne de La Barre », p. 21 : « Mademoiselle La Barre est ici, mais elle ne vieillira pas ici, et elle est beaucoup moins estimée qu’elle ne l’aurait été si elle n’avait pas mis autant d’années pour arriver ici. » Kjellberg, Kungliga musiker i Sverige, p. 471. Curt Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, Berlin 1910, p. 164. Paul Prévost est engagé comme soprano en février 1650 avec un salaire annuel de 400 Thaler, augmenté à 600 Thaler en mai 1654. Il est renvoyé en 1659. La lettre de recommandation, datée du 9 novembre 1660, atteste que Paul Prevost « sich wegen seiner sonderlichen manier, Zumahll in der Vocal Music sehr beliebt gemacht [hat].» Tobias Norlind, « Die Musikgeschichte Schwedens in den Jahren 1630-1730 », Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft, 1/2, 1900, p. 165-212, ici p. 169-170. Marie Aubert (dessus), Despas (haute-contre), Mariau (ténor), Chantreau (basse), Mademoiselle Renaud (femme du premier violon et chanteuse de petits rôles), Renaud ou Rénot (violon), Robert Lemoine de Lafrance (basse de viole et hautbois), Jean Baptiste De Grouset Le Petit Clerc (violons et hautbois), Bernard Montain et Caillard (musiciens). Caillard peut être identifié à Guillaume Caillat, actif à Celle puis à Schwerin. AN, Registre des Insinuations du Châtelet de Paris, Y 214, fol. 248, 28 avril 1668 : Contrat de mariage entre Antoine de Cocquerel, conseiller du Roi aux conseils et lieutenant ordinaire en la prévôté de l’hôtel et grande prévôté de France demeurant à Paris, rue du Sentier, paroisse Saint-Eustache, et Anne Chabanceau de La Barre, damoiselle d’honneur des Reines de Suède et de Danemarck.
– 26 –
L’Europe galante comme marché du travail
dès 1626. Le « Hintze-Manuskript », impressionnante collection de pièces pour le clavier de style français copiée par Matthias Weckmann aux alentours de 1650, pourrait également avoir été commencée à Copenhague lorsque celui-ci était au service de Christian IV.49 Le successeur de ce dernier, Frederik III, avait séjourné à Paris pendant son Grand tour et engagea en 1665 le violoniste Pascal Bence pour diriger une bande de sept violonistes français. Cette présence d’artistes français, qui collaboraient pour produire des opéras et des ballets de cour, était surtout liée au mécénat de la reine Sophia Amalia von Braunschweig-Lüneburg (1628-1685) qui était en compétition permanente avec Christine de Suède et engagea une troupe de comédiens français en 1669.50 Entre 1661 et 1667, le maître de chapelle de la cour Kaspar Förster avait composé plusieurs œuvres dont le style suggère l’influence de la musique française, en particulier un opéra Cadmus.51 En dehors de ces quelques données fragmentaires, un opuscule imprimé, intitulé Relation du voiage de Breme et publié à Leiden en 1676, permet d’entrevoir la mobilité des musiciens français de part et d’autre de la frontière danoise.52 Il s’agit d’un récit grotesque en « vers burlesques », composé par un musicien nommé Clément et dédié à un certain Besson, chef des violons du roi de Danemark. Les trois « chants » retracent le périple d’une troupe d’instrumentistes passant par Copenhague, Rentzbourg, Hambourg, pour arriver enfin à Brême à l’occasion d’une fête où leurs services sont requis. Christine de Suède donnait parfois des fêtes importantes dans les villes de la région pour lesquelles elle faisait venir les instrumentistes des chapelles princières avoisinantes : c’est peut-être pour une telle occasion que les musiciens danois furent appelés à Brême.53 Cette odyssée en vers de mirliton paraît avoir connu un certain succès, puisqu’elle fit l’objet de plusieurs réimpressions.54 Son auteur, un certain Clément, est recensé comme « Premier violon du roi » dans les registres de l’église réformée de Copenhague entre 1685 et 1700.55 Il aurait donc pu succéder dans cette fonction au dédicataire de son opuscule Besson. Au cours de son voyage, Clément rencontre deux troupes de comédiens français. La première accompagne le comte d’Oxenstiern, grand rival de Magnus de la Gardie à la cour de Suède. La seconde n’est autre que la troupe de comédiens de la cour de Hanovre, que Clément rencontre à Hambourg en compagnie de Thomas de La Selle, musicien à la cour de Celle entre 1666 et 1705, qui jouait de la « poche » (petit violon aisément transportable que les maîtres à danser pouvaient sortir de leur poche pour les leçons de danse) lors d’un dîner donné pour l’anniversaire d’une dame de la compagnie.56 Le texte fait aussi allusion au musicien Jacques de Loges.57 Vingt ans plus tard, celui-ci est employé à la chapelle
49 50 51 52 53 54
55 56
57
Siegbert Rampe, « Das “Hintze-Manuskript”. Ein Dokument zu Biographie und Werk von Matthias Weckmann und Johann Jakob Froberger », Schütz-Jahrbuch, 19, 1997, p. 71-111. Jan Fransen, Les Comédiens français en Hollande aux xvii e et xviiie siècles, Paris 1925, p. 125-126. Berthold Warnecke, Kaspar Förster der Jüngere (1616-1674) und die europäische Stilvielfalt im 17. Jahrhundert, Schneverdingen 2004, p. 217-262. Clément, Relation du voiage de Breme, en vers burlesques dediee à Monsieur Besson, chef de la Troupe de Musiciens, et de Violons de sa Majesté le roi de Danemarc, de Norvegue, &c., Leiden 1676. Laure Gauthier, L’Opéra à Hamburg 1648-1728. Naissance d’un genre, essor d’une ville, Paris 2010, p. 33. Première édition à Leyde en 1676 chez « la veuve Boxe ». Seconde édition à Leiden chez « Pecker » en 1677. Troisième édition à Brême chez « Claude Lejeune » en 1705. En réalité, ces trois éditions peuvent être attribuées à la veuve de Jean Elzévir, comme le suggère Charles Nodier dans une note manuscrite placée en tête de l’exemplaire de la Bibliothèque nationale (F-Pn, Res. P ye 2259) : « Il faudroit n’avoir jamais vu d’édition elzévirienne pour méconnaître ici les types qui avoient servi en 1666 pour la Description d’Amsterdam de Lejolle, et depuis en 1676 même pour les nombreux et misérables ouvrages de Blessebois. » Daniel Louis Clément, Notice sur l’église réformée française de Copenhague, Copenhague 1870, p. 9. Clément, Relation du voiage de Breme, p. 30-32 : « A la santé du Sieur le Roi, | Fort-bien, dis-je, portés-là moi. | Puis, m’adressant au sieur la selle, | Je lui portais justement celle | D’un nommé Monsieur des Marets | Dont la femme beaucoup me plaît | Pour son humeur escarbellarde, | Bien qu’elle ait la mine paillarde | Je l’estime de tout mon cœur. […] Et la selle par cas fortuit, | Avoit sa poche | en son étuit | Qu’il tira d’une autre pochette, | Et nous joua landerirette. » Clément, Relation du voiage de Breme, p. 13-14 : « Et dés que le jour fut venu | Falut faire jacques déloge | Et sortir chacun de sa Loge. »
– 27 –
Chapitre 1
de Hanovre.58 Originaire d’Anjou, le musicien est marié à une danoise, comme le montre un acte de baptême.59 La même année, Jacques de Loges est aussi témoin lors du mariage entre un Parisien et une habitante de Hanovre, pour lequel le maître de danse François Desnoyers se porte aussi témoin.60 De son côté, Clément avait séjourné en Allemagne avant de venir au Danemark, puisqu’il avait été violoniste à la cour de Schwerin entre 1664 et 1669. Les cours allemandes Lorsque la guerre éclata entre la Suède et le Danemark en 1655, la chapelle royale danoise fut dissoute et Kaspar Förster retourna à Gdansk. Anne de La Barre quitta alors la cour de Copenhague pour celle de Hessen-Kassel, où elle avait apparemment été recommandée par Ernst August von Braunschweig-Lüneburg, frère de la reine du Danemark et proche de Wilhelm VI von HessenKassel. Elle y fut accueillie par Wilhelm VI, dit Le Juste, qui avait visité la France entre 1644 et 1649 et l’avait déjà entendue lors d’un concert à Fontainebleau.61 Si la cour de Kassel tient une place éminente dans notre Europe galante, c’est moins à cause de la migration de musiciens français, qui ne peut plus guère être reconstruite suite à la destruction de la plupart des archives pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’à cause des fameux manuscrits de Kassel, copiés autour de 1660 et qui illustrent très bien la diffusion du répertoire français dans l’espace germanique.62 Rédigés par un copiste anonyme, qui pourrait être identifié à Christoph Thomas, membre de la Hofkapelle jusqu’à 1660 au moins, ils sont l’un des rares témoignages de la dissémination de la suite d’orchestre française dans les territoires germaniques vers le milieu du xviie siècle.63 Mais c’est surtout en Allemagne du Nord que l’on trouve la trace de nombreux musiciens français. L’étude de Clemens Meyer sur la Hofkapelle de Schwerin montre par exemple que dixhuit d’entre eux ont été actifs à la cour de Mecklenburg-Schwerin entre 1664 et 1710, sous le règne de Christian Louis I qui entretenait des relations étroites avec la France. Un premier groupe de musiciens français appelé les « 6 Violons » fut engagé entre 1664 et 1669.64 Entre 1671 et 1673, un autre groupe de huit « Violons » fut également présent à Schwerin.65 Plusieurs autres musiciens au patronyme français furent engagés à titre individuel : le « Petit Jean » est subventionné par la cour pour apprendre la trompette, puis engagé comme Hoftrompeter en 1679, avant d’obtenir le 4 octobre 1680 un passeport pour l’étranger.66 Philibert Morwald ou Moureval, peut-être Français, fut timbalier dans l’armée à partir d’août 1677 puis engagé à la cour entre 1678 et 1713.67 Le Français Charles Guarnier est engagé entre 1695 et 1699, mais sa fonction n’est pas précisée.68 Enfin, en 1709-1710, Jean Baptiste est engagé comme directeur et maître des concerts.69 La pré58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
NLAH, Hann. 76c A Nr. 118, p. 314 : « dem Musicanten Jacque de Loges von Ostern biß den 21 July 1698 von 10 Wochen à jährlich 115 Thlr. womit derselben gleichfalß abgehet: 35 Thlr. 15 gr. » BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, 7 mai 1696, p. 189 : « baptizavi infantem natum ex Jacobo des Loges Andegavensi et Anna Helena Gilmer Haffniensi. » Dès 1691, on trouve également dans les registres catholiques de Hanovre une Marie de Loges, qui parraine l’enfant du musicien Gilles Héroux. BAHild, KB Nr. 778, Hannover St. Clemens, Traubuch 1667-1711, 28 avr. 1696, p. 132. Abadie, « Anne de La Barre », p. 24. Jules Écorcheville, Vingt Suites d’orchestre du xviie siècle français, Berlin 1906. Michael Robertson, The Courtly Consort Suite in German-Speaking Europe, 1650-1706, Farnham 2009, p. 66-67. Clemens Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, Schwerin 1913, p. 30. Le groupe comprend : Clément, Delilie (altération probable de Delisle), Lamontange (Lamontagne), Fontenge, Dumain (Dumaine) et Lesperanz (L’Espérance). Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, p. 30-31. Ce groupe comprend : Claude de Lisle (probablement identique à celui du premier groupe), Nicolaus Dumesnil, Jean Barisot (Parisot), François Galoche, Pierre Janary, Anthoine Mutan, Michel Begne et Caillat. Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, p. 33. Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, p. 33-34. Le passage par l’armée de ce musicien à partir d’août 1677 est précisé par une note manuscrite sur l’exemplaire de la bibliothèque de l’Université de Leipzig. Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, p. 34. Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, p. 38.
– 28 –
L’Europe galante comme marché du travail
sence de musiciens français ou francophones à Schwerin, même discontinue, est donc un élément important dans la vie musicale de la cour qui coïncide exactement, sur le plan chronologique, avec des phénomènes similaires dans les cours de Basse-Saxe. À la cour de Güstrow, sous le règne du duc Gustav Adolph (r. 1654-1695), plusieurs musiciens dits « français » sont également présents dans la Hofkapelle. Le plus connu d’entre eux est Daniel Danielis, natif de Visé près de Liège et engagé comme chanteur (« Bassist ») par la cour de Güstrow le 20 juin 1658.70 Il est élevé en février 1661 au rang de Kapellmeister, poste dont il démissionne une première fois en 1664-1665 à la suite d’un violent conflit avec ses musiciens, puis définitivement en 1681, après s’être absenté entre 1674 et 1678.71 En 1683, il se présente au concours organisé pour remplacer Henry Du Mont et Pierre Robert à la chapelle royale de Versailles, sans succès.72 Il est nommé l’année suivante maître de musique à la cathédrale de Vannes.73 Dans les mêmes années, on repère également le violoniste Bernard Gérard, engagé entre 1665 et 168374, et d’autres chanteurs originaires du Brabant : Nicolas Chauveau, le Diskantist Johannes Anthonius Ravissart et Leonhard von der Houte, engagés en 166975, ainsi que Servais Le Roy, qui fit un bref séjour comme Kapellknabe en 1679.76 La cour de Brandebourg à Berlin n’était pas en reste : outre le chanteur Paul Prevost déjà mentionné plus haut, plusieurs noms de musiciens français peuvent être repérés dans les dernières décennies du xviie siècle, sous le règne de Friedrich I (r. 1688-1713). Le nombre et la régularité des engagements de hautboïstes est très frappante et constitue une spécificité berlinoise : entre 1681 et 1708, pas moins de quatre hautboïstes sont engagés de façon continue. Déjà, sous le règne de Friedrich Wilhelm, les hautboïstes Pierre Potot et François Adam Beauregard avaient été engagés le 22 décembre 1681 pour un salaire annuel de 300 Thaler.77 En 1693, Labuissière est engagé comme successeur de Beauregard et demeure à Berlin jusqu’en 1700.78 On trouve la mention d’un trompettiste réformé du nom de Piquard (1688) et d’un chanteur Baron (1694).79 En 1692, Volumier est engagé comme maître de danse.80 Enfin, en 1708, les deux derniers Français arrivent : le hautboïste Louis Rose et le violoniste Jourdain sont intégrés au personnel de la Hofkapelle berlinoise.81 Après la mort de Friedrich I en 1713, celle-ci fut dissoute et certains de ses membres, dont Rose, furent alors recrutés par la cour de Köthen, où le duc Leopold von Anhalt-Köthen fonda une nouvelle Hofkapelle en 1717, avec à sa tête Johann Sebastian Bach. Ces différentes trajectoires illustrent le formidable élargissement d’un marché du spectacle qui conduit les musiciens français à investir l’ensemble des territoires d’Empire, allant parfois même jusqu’aux confins de l’Europe.
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Clemens Meyer, « Geschichte der Güstrower Hofkapelle : Darstellung der Musikverhältnisse am Güstrower Fürstenhofe im 16. und 17. Jahrhundert », Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, 83, 1919, p. 1-46, ici p. 25. Meyer, « Geschichte der Güstrower Hofkapelle », p. 25-26 et 166. Voir Chapitre 3, p. 155 et 186. Pour une description détaillée de ce concours, voir Marcelle Benoît, Versailles et les musiciens du roi 1661-1733. Étude institutionnelle et sociale, Paris 1971, p. 102-108. Guy Bourligueux, « Le mystérieux Daniel Daniélis (1635-1696) », Recherches sur la musique française classique, 4, 1964, p. 146-178. Catherine Cessac, L’Œuvre de Daniel Daniélis (1635-1696). Catalogue thématique, Paris 2003. Ce musicien est désigné comme français par Friedrich Chrysander, « Englische, französische und deutsche Musicanten im siebenzehnten Jahrhundert am Hofe des Herzogs zu Mecklenburg-Güstrow », Niederrheinische Musik-Zeitung, 3/46, 1855, p. 364-367, ici p. 367. Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, p. 31. Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, p. 33. Voir aussi Chapitre 3, p. 160-161. Sur les fonctions des Kapellknaben, voir le contrat de nomination de Johann Christoph Schmidt à Dresde vers 1687 : Moritz Fürstenau, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden, vol. 1, Dresde 1861, p. 264-265. Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 172. Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 182. Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 187 et 178. Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 68 et 182. Voir ci-dessous, p. 155-156. Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 185.
– 29 –
Chapitre 1
Un marché en expansion Dès 1660, l’Europe du Nord est donc devenue un pôle d’activité privilégié pour les musiciens français. Cet espace, que les artistes semblent parcourir sans trop s’arrêter aux frontières politiques, est largement polarisé par les cours : au-delà des cours royales de Suède et du Danemark, il englobe toute une myriade de résidences de taille intermédiaire situées dans la moitié Nord de l’Allemagne, depuis la frontière avec les Provinces-Unies jusqu’aux régions orientales de l’Empire. Entre Osnabrück et Berlin, en passant par Schwerin et Güstrow, se dessine peu à peu une aire culturelle dans laquelle la musique française a le vent en poupe. Au cours des décennies suivantes et jusqu’en 1700, cet espace s’élargit progressivement jusqu’à prendre une amplitude continentale, témoignant d’une expansion progressive du marché du travail européen pour les musiciens, et plus largement pour les arts du spectacle. On peut identifier trois leviers principaux qui contribuent à cette extension : la généralisation de la pratique du Grand tour, la professionnalisation croissante et la diversification du personnel diplomatique français, ainsi que la porosité accrue des frontières confessionnelles. L’Europe des Grands tours Objet d’un intérêt historiographique renouvelé dans les dernières décennies, le Grand tour est un paramètre décisif des circulations musicales dans l’Europe moderne.82 Le gouverneur des fils du comte de Waldeck-Pyrmont, Joachim Christoph Nemeitz, était rompu à la préparation et la planification de tels voyages. Après de nombreuses années de déplacements à travers toute l’Europe, il rassembla le fruit de son expérience dans un Séjour de Paris, sorte de guide à l’usage des jeunes Allemands de bonne condition qui faisaient halte dans la capitale française. Nemeitz témoigne d’une conscience aiguë des opportunités musicales offertes par un séjour parisien, soulignant que « l’on peut perfectionner sa Musique à Paris, où on en a l’occasion & du profit.83 » Il donne quelques renseignements très concrets sur la vie musicale, évoquant bien sûr l’Académie royale de musique et le collège des Jésuites, mais éclairant aussi des rouages moins connus de la vie musicale parisienne comme les séries de concerts privés, le choix d’un maître de musique, ou même les dangers qui guettent ceux qui se risquent à fréquenter les chanteuses d’opéra.84 C’est seulement quatre ans avant la sortie de ce guide que le prince Friedrich August II, le fils aîné du prince électeur de Saxe et roi de Pologne Auguste le Fort, arriva à Paris pour inaugurer la partie française de son Grand tour. Tout comme Nemeitz, l’entourage du prince était tout à fait conscient de l’importance du volet musical du séjour parisien, puisqu’ils s’étaient fait accompagner par quelques-uns des meilleurs musiciens de la Hofkapelle : le Kapellmeister Johann Christoph Schmidt, le Konzertmeister Volumier, le violoniste Johann Christian Richter et l’organiste Christian Pezold. Le Grand tour de Friedrich August fut exceptionnel sur bien des plans : il s’étendit sur une durée de huit ans (1711-1718) et fut marqué par un séjour de plus d’un an en Italie, notamment à Venise (1716-1717). La musicologie a surtout retenu la partie italienne de ce Grand tour, au cours de laquelle furent recrutés des musiciens d’exception – Antonio Lotti qui avait déjà servi le duc de Hanovre Johann Friedrich, et Johann David Heinichen qui résidait en Italie depuis 1713. 82
83
84
Voir en particulier Grand Tour. Adeliges Reisen und Europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, dir. Rainer Babel et Werner Paravicini, Ostfildern 2005. Mathis Leibetseder, Die Kavalierstour. Adlige Erziehungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Cologne 2004. Eva Bender, Die Prinzenreise. Bildungsaufenthalt und Kavalierstour im höfischen Kontext gegen Ende des 17. Jahrhunderts, Berlin 2011. Joachim Christoph Nemeitz, Séjour de Paris, c’est-à-dire, Instructions fidèles, pour les Voiageurs de Condition, Leiden 1727, p. 69. La première édition allemande paraît en 1718. Sur l’environnement musical de Nemeitz, voir Friedhelm Brusniak, « ‘Von Besuchung der publiquen und privat-Bibliothequen’. Die Empfehlungen des Fürstlich Waldeckischen Hofmeisters Joachim Christoph Nemeitz (1679-1753) an ‘Reisende von Condition’. Ein Beitrag aus musiksoziologischer Perspektive », in : Frühneuzeitliche Bibliotheken als Zentren des europäischen Kulturtransfers, dir. Claudia Brinker von der Heyde, Stuttgart 2014, p. 105-112. Nemeitz, Séjour de Paris, p. 70-71 et 99-105.
– 30 –
L’Europe galante comme marché du travail
Mais la musique et le recrutement de musiciens avaient occupé une place éminente dès la partie française du Grand tour : les dépêches envoyées chaque semaine à Dresde révèlent que le prince était souvent invité à des dîners, des bals et des concerts donnés à Paris, à Versailles ou à Sceaux.85 Les musiciens de la Hofkapelle n’avaient pas pour seule mission d’agrémenter le voyage du prince, mais également de nouer des contacts avec le monde musical parisien et peut-être même de recruter d’autres musiciens. Ils n’apparaissent qu’une seule fois dans la correspondance officielle, lorsque que le prince reçoit Maximilian Emanuel de Bavière le 14 décembre 1714 : ils sont alors chargés de le « divertir après le repas par une petite musique de chambre ».86 Ce sont sans doute eux qui, au cours de leur séjour parisien, avaient établi le contact avec le flûtiste de l’ambassadeur de Turquie Pierre-Gabriel Buffardin. Cinq ans avant son engagement à Dresde, Buffardin se trouvait en effet à Constantinople dans la suite de l’ambassadeur français à la Grande Porte. La correspondance diplomatique du marquis des Alleurs depuis la Turquie ne contient malheureusement pas de renseignements sur le personnel qui l’accompagnait, et sa correspondance privée n’a pas pu être localisée.87 La source de cette information est Carl Philipp Emanuel Bach, qui assure vers 1774, dans une lettre à Forkel contenant plusieurs additions au document manuscrit intitulé Ursprung der musicalischBachischen Familie, que Johann Jacob Bach (1682-1722), le frère aîné de Johann Sebastian, avait pris des cours de flûte avec Buffardin alors qu’il se trouvait à Constantinople comme hautboïste de l’armée suédoise – celle-ci s’étant réfugiée avec le roi Charles XII de Suède dans la ville toute proche de Bender, après sa défaite face à l’armée russe à Poltawa en Ukraine à l’été 1709, dans le cadre des affrontements de la Grande guerre du Nord (1700-1721) : Depuis Bender, [Johann Jacob Bach] se rendit à Constantinople où il prit des leçons de flûte auprès du célèbre flûtiste Buffardin, qui était arrivé à Constantinople avec un diplomate français. Je tiens cette information de Buffardin lui-même, alors qu’il était autrefois chez J. S. Bach à Leipzig.88
Buffardin transportait sans doute avec lui des partitions de musique française : Raschid Pegah émet ainsi l’hypothèse que la copie manuscrite du premier livre de pièces de viole de Marin Marais réalisée par Sven Agrell, le prédicateur de la délégation suédoise à Constantinople en 1710, pourrait avoir été faite sur un exemplaire de Buffardin.89 Sans doute né à Avignon le 29 juin 1689, le musicien reçut à Marseille une formation musicale sur laquelle nous n’avons aucun renseignement.90 Buffardin rédigea lui-même une notice autobiographique dans une liste de personnel où tous les musiciens de la Hofkapelle en poste à Dresde en 1718 indiquèrent leur nom, leur âge, leur origine et la date de leur engagement, probablement pour des raisons administratives de calcul d’âge et d’ancienneté : Pierre Gabriel Buffardin né en provence Elevé a Marseille agé d’environ vingt et sept ans Musicien du Roy depuis la foire d. St. Michel 1716.91
85
86 87 88 89 90 91
Pour une présentation détaillée de ce voyage, voir Louis Delpech « ‘Abends zu einem Concert de musique eingeladen.’ Aspects musicaux du séjour parisien de Friedrich August II de Saxe (1714-1715) », in : Les foyers artistiques à la fin du règne de Louis XIV (1682-1715). Musique et spectacles, dir. Anne-Madeleine Goulet, Rémy Campos, Mathieu Da Vinha et Jean Duron, Turnhout 2019, p. 277-295. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 758/4, fol. 196. AAE, Turquie 50-56. BD III, Dok. 802, p. 287 : « Von Bendern ist er nach Constantinopel gereiset u. hat da von dem berühmten Flötenisten Buffardin, welcher mit einem Französischen Gesannten nach Constantinopel gereist war, Lektion auf der Flöte genommen. Diese Nachricht gab Buffardin selbst, wie er einstens bey J. S. Bach in Leipzig war. » Rashid Sascha Pegah, « Begegnungen in Konstantinopel und Leipzig. Pierre Gabriel Buffardin und Johann Jacob Bach », Bach Jahrbuch, 97, 2011, p. 287-292. L’acte de naissance est retrouvé par Ingrid Kollpacher-Haas, « Pierre-Gabriel Buffardin. Sein Leben, sein Werk », Studien zur Musikwissenschaft, 25, 1962, p. 298-306. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 92. Sur ce document, voir Kai Köpp, « Ein Musikerverzeichnis aus dem Jahr 1718 als Referenzquelle für die Dresdner Kapellgeschichte », in : Johann Georg Pisendel. Studien zu Leben und Werk, dir. Ortrun Landmann et Hans Günter Ottenberg, Hildesheim 2010, p. 353-382.
– 31 –
Chapitre 1
C’est probablement par l’intermédiaire de la famille des Alleurs qu’il fut engagé pour le compte de la cour de Dresde à la fin de l’année 1715. En effet, le journal de Kos, accompagnateur du prince, garde la trace de nombreuses visites échangées entre le prince de Saxe et Madame des Alleurs – « femme de Mr. Desalleurs ambassadeur à Constantinople », ainsi que le note Kos le 25 novembre 1714, date où le prince l’invite pour la première fois – jusqu’au départ du premier en juin 1715. Ces visites mutuelles étaient fréquemment accompagnées de jeux de cartes, de collations, mais aussi de concerts de musique, ainsi que le note par exemple Kos à la même date : Le soir, il y eut des dames chez le prince électoral, Madame Villafranche [sic] née de Frisen en Saxe, avec ses deux filles, Mademoiselles [sic] Villefranche et Montbrun, Madame Desalleurs, femme de Mr. Desalleurs ambassadeur à Constantinople, née Lützebourg, Mr. le marquis de Gèvres, Mrs. Lubomirscy, Mr. Kospott, Mr. Suhm, Mr. Montbrun, Mr. Minquitz, Mr. Michałowski. Tous étaient assemblés, et avant le jeu de l’ombre il y eut un concert de musique. Après la collation, on joua au basset, concert de musique également.92
Les 17 et 21 mars 1715, c’est l’ambassadeur lui-même (« le comte Desalleurs ») qui rend respectivement visite au prince et à Kos, avec à chaque fois des concerts de musique privés.93 Il est donc tout à fait probable que le prince et certains de ses accompagnateurs purent entendre Buffardin lors d’un de ces concerts et arrangèrent ensuite son transfert à la cour de Dresde. Ceci suggère que Buffardin se trouvait donc à Paris au printemps 1715 au service de l’ambassadeur, avant d’être recruté, sans doute directement par le prince ou les musiciens qui l’accompagnaient. Il arriva à Dresde le 1er novembre 1715, ainsi que le mentionne l’ordre pour le versement de son premier salaire de 500 Thaler par an.94 Dans les Hofbücher, Buffardin est toujours qualifié de « Flûte allemande », avec quelques variantes orthographiques.95 C’est également le cas dans les listes de personnel rédigées vers 1717-1718 puis en 1733.96 Un autre musicien parisien fut aussi démarché pendant le Grand tour de Friedrich August : François Godefroy Beauregard, le fils du hautboïste François Adam Beauregard qui avait séjourné quelques mois à Celle avant d’être engagé à Berlin en décembre 1681. Né à Berlin en 168497, l’enfant dut rentrer à Paris peu après la mort de son père, puisque sa mère Marie Letellier se remarie à Saint-Germain l’Auxerrois le 2 mars 1692.98 En 1711, un certain « Sieur Beauregard » est mentionné par le Mercure galant comme « Maître de la Musique de la Chapelle » de Joseph Clemens, évêque de Cologne, lors d’une messe célébrée au Val-de-Grâce pour son jubilé sacerdotal.99 Il s’agit sans aucun doute de François Godefroy, que le prince de Saxe pourrait avoir rencontré chez l’évêque de Cologne où il se rendait régulièrement. Là encore, le contact avait sans doute été établi par les musiciens. François Godefroy Beauregard est employé comme chanteur haute-contre par la cour de Dresde dès décembre 1714, sur le même document que d’autres musiciens engagés pendant le séjour du prince en France.100
92 93 94 95 96 97 98 99 100
Aleksander Kraushar, Podróże królewicza polskiego, póżniejszego Augusta III [Voyages du Prince royal polonais, futur Auguste III], vol. 2, Lwów 1911, p. 19-20. Aleksander Kraushar, Podróże królewicza polskiego, p. 43-44. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 143. Buffardin est engagé en même temps que d’autres comédiens, musiciens et danseurs recrutés par le prince durant la suite de son voyage. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 89 : Flute Allemand. K II Nr. 6, fol. 4 : Fleute Allemant. K II Nr. 6, fol. 75r : Fleute Allemande. K II Nr. 7, non folié, K II Nr. 8, non folié : Fleute Allemante. HStA Dresden, 10006 OHMA, Loc. 383/2, fol. 121 et 138. Loc. 907/4, fol. 1. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 91 : « François Godfroid Beauregard né a berlin le 30 octobre 1684 et Elevé à paris, entré au service de Sa majesté le roy de pologne et Electeur de Saxe l’an 1715. » F-Pn, Fichier Laborde, NAF 12046, fiche 3276 : « Du lundy deuxiesme mars 1692, Pierre Creholet, aagé de trente-cinq ans, cuisinier, et Marie Letellier, aagé [sic] de trente ans passés, veuve de François Adam Beauregard, vivant musicien de Monsieur l’électeur de Brandebourg […] ». Mercure galant, mars 1711, p. 133-137 : l’évêque « celebra la Messe chantée par la Musique sous la conduite du Sieur Beauregard, Maistre de la Musique de la Chapelle de ce Prince. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, 14 nov. 1715, fol. 37.
– 32 –
L’Europe galante comme marché du travail
C’est seulement après avoir passé son deuxième hiver à Paris, en juin 1715, que le prince quitta la capitale, rejoignant d’abord Lille pour redescendre le littoral jusqu’à Rouen, Saint-Malo et Brest, avant de gagner Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Grenoble. Il s’arrête à Lyon avant de passer en Italie, attendant qu’on lui donne la permission de se rendre à Venise afin d’y passer le carnaval. Après plusieurs refus, l’autorisation lui fut accordée de guerre lasse.101 Pendant cette étape lyonnaise de deux mois, on note la visite régulière de l’opéra de Lyon, où deux nouveaux intendants venaient de prendre leurs fonctions : Antoine Michel et un certain Debargues, membre d’une famille de musiciens et de maîtres à danser lyonnais.102 Un Debargues avait été engagé comme « maître des ballets » à la cour de Dresde en juin 1709, avant d’être renvoyé avec sa femme en juin 1714.103 C’est seulement un an et demi plus tard, pendant le séjour du prince à Lyon, que le couple de danseurs fut réintégré dans les effectifs de Dresde.104 Il s’agit bien des mêmes personnes, puisque le mandat de Debargues à la tête de l’opéra de Lyon fut de courte durée : en février 1716, plusieurs créanciers engagèrent des poursuites contre les deux anciens directeurs de l’opéra devant la Sénéchaussée de Lyon.105 Parmi les signataires de l’acte de poursuite figurait Jean David Drot, qui fit baptiser un fils à Sainte-Croix lès Lyon en mars 1716. Ce musicien arriva à Dresde dès le mois de janvier 1716, en compagnie de sa femme et de sa fille, la danseuse Mademoiselle Clément.106 Le prince avait donc profité de son séjour à Lyon pour prendre contact avec des musiciens de l’opéra et les engager pour la cour. Il avait même avancé sur ses deniers personnels leur salaire pour le mois de janvier 1716, puisqu’il demande plus tard qu’on le rembourse par l’intermédiaire de son valet de chambre Hoffmann.107 Le danseur Cherrier a également été engagé à Lyon en compagnie de sa femme. Ces différents exemples mettent parfaitement en lumière le rôle central du Grand tour dans la formation de l’Europe galante, non seulement dans la perspective d’une histoire des élites aristocratiques, mais plus encore comme facteur de mobilité des musiciens. Diplomaties de la musique française « Du temps de M. de Louvois, tous les maîtres de danse et d’escrime étaient salariés, afin d’espionner ce qui se passait dans les cours d’Allemagne.108 » Cette affirmation de Madame 101
102 103
104 105 106 107
108
HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 785/5, fol. 175-187. Auguste le Fort interdit d’abord formellement à Friedrich August d’aller passer le carnaval à Venise : « Au sujet de la permission que S. M. lui donne, de retourner en Italie et de passer le Carnaval à telle Cour qu’il voudra, excepté Venise » (fol. 175). Cinq jours plus tard, il lui enjoint « de ne point aller à Turin » (Dresde 25 nov. 1715, fol. 176). Finalement, dans une lettre adressée à Kos (Guber, 20 déc. 1715) il l’autorise finalement à se rendre à Venise. Léon Vallas, Un siècle de musique et de théâtre à Lyon (1688-1789), Lyon 1932, p. 18-19. Auguste le Fort avait fait la connaissance de la danseuse Debargues à Bruxelles, lors de la campagne militaire de 1709, juste après avoir embauché la troupe de Villedieu : Fürstenau, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe der Churfürsten von Sachsen und Könige von Polen, vol. 2, Dresde 1862, p. 7-49. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, 28 juin 1709, fol. 92 et Loc. 383/2, fol. 41 : « Der Tanzm. de Barques und seiner Frau, haben mit ult. Juny 1714 ihre dimission erhalten. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, 12 nov. 1715, fol. 39 : « Monsieur Debarques, als Maître des ballets, seine Frau und Monsieur Cherrier, seynd zu Johannis d.c. wiederum in Dienste gekommen. » Vallas, Un siècle de musique, p. 140-142. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4 fol. 150-153. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 151 : « Specification Waß Ihro Hoheit d. Königl. Chur Prinz vor die auf Ihro Königl. Mayt. genädigsten Befehl aufgenommenen dreÿ Personen in Lyon, zu d. franc: Comedie der Zeit an Besoldung avansiren lassen. […] Umb welchen Vorschus Ihro Hoheyt d. Prin: Ihro Königl. May. bittet, alhier wie an mich restituiren zu laßen, die weilen ich ordre hab, daß quantum von der Meße, nacher Frankreich zu remitiren. » Lettre d’Elisabeth Charlotte von der Pfalz, duchesse d’Orléans, à la comtesse Palatine Louise, Paris, 19 mars 1716. Pierre Brunet, Correspondance complète de Madame Duchesse d'Orléans née Princesse Palatine, vol. 1, Paris 1855, p. 222. Voir aussi la lettre du 26 juin 1716, p. 248 : « M. de Louvois seul était bien servi par ses espions, mais il n’épargnait pas l’argent : tous les Français qui étaient en Allemagne ou en Hollande étaient des espions à ses gages ; maîtres de danse ou d’escrime, écuyers, serviteurs, dans toutes les cours. Après sa mort on n’a pas continué ce système ; voilà pourquoi les ministres d’aujourd'hui sont si ignorants. »
– 33 –
Chapitre 1
Palatine comporte sans doute une part de fantasme, en supposant l’existence de services secrets au service de l’ancien ministre de la guerre. Mais il est vrai que trois ans après la mort de Louvois, le nœud postal de Celle commençait à jouer le rôle d’un véritable « filtre » dans la correspondance entre la France et ses représentants diplomatiques en Europe du Nord, à travers la collecte et la diffusion d’informations contenues dans les lettres qui étaient systématiquement ouvertes et déchiffrées. Les alliés de Georg Wilhelm étaient ainsi parfois plus rapidement avertis des décisions de Versailles que les ambassadeurs français dans les pays nordiques.109 La remarque de Madame Palatine n’est ainsi peut-être pas tout à fait dénuée de fondement. Elle-même avait bien connu le maître à danser Élie Jemme, qu’elle appelle affectueusement « mon maître110 » et qui semble avoir rempli des missions diplomatiques officieuses entre Paris et Osnabrück. C’est en tout cas ce que suggèrent quelques quittances conservées dans les papiers d’un certain Fuzelier, officier (« Hofjunker ») à la cour d’Osnabrück et qui servait d’agent diplomatique.111 On trouve ainsi un « Memoire des depenses que Mr Jemme a fait pour Mr Le Fuselier par son ordre » signé par Jemme le 14 mars 1676, qui contient de menues dépenses courantes faites à Paris et en Hollande.112 Dans une lettre jointe à ce document, on découvre que Jemme avait remboursé de la part de Fuzelier une dette de 1000 Thaler à Jean Hérault de Gourville, l’une des figures d’élite de la diplomatie française.113 Les comptes de Jacques de Rozemont, représentant du duc Ernst August à Paris, montrent également que Jemme envoyait entre trois et cinq paquets par mois à Paris en 1676.114 Si le contenu des lettres et des paquets évoqués demeure inconnu, le volume de la correspondance suggère un échange très intense entre le maître de danse et les milieux diplomatiques. L’appartenance de musiciens à des réseaux informels d’information est aussi illustrée par le « Fragment d’une lettre d’un des Violons du Duc de Zelle à un de ses amis sur le Mercure hebdomadaire du Sieur Chappuzeau le Père » conservé à la bibliothèque de Wolfenbüttel. Texte au caractère hybride, semi-diplomatique et semi-privé, cette lettre en forme de gazette ne relate pas de nouvelles personnelles, mais seulement (à la manière d’une dépêche d’ambassadeur) des épisodes très variés de la vie politique et mondaine locale, rédigés clairement et parfois plaisamment par un violoniste de la cour qui ne peut malheureusement pas être identifié : la fondation d’un nouveau journal à Celle par Chappuzeau ou encore les démêlés d’une jeune française avec un ambassadeur et les princes de Wolfenbüttel.115 Mais plus que d’hypothétiques réseaux d’espions au service du ministère de la guerre, ce sont surtout les réseaux diplomatiques classiques qui forment le support décisif d’une circulation des artistes élargie à l’ensemble de l’Europe. Les mutations profondes du métier d’ambassadeur sous les ministères de Croissy et Torcy contribuent à accroître ce rôle traditionnel : la professionnali109
110 111 112 113 114
115
Stewart P. Oakley, « The Interception of Posts in Celle, 1694-1700 », in : William III and Louis XIV. Essays 16801720 by and for Mark A. Thomson, dir. Ragnhild Hatton et John Selwyn Bromley, Liverpool 1968, p. 95-116. Ce phénomène est appelé « filtre hanovrien » par Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990, p. 140-142. Lettre d’Elisabeth Charlotte von der Pfalz à Sophie von der Pfalz, Saint-Cloud, 5 août 1673. Eduard Bodemann, Aus den Briefen an die Kurfürstin Sophie von Hannover, Hanovre 1891, p. 2-3. NLAO, Rep. 110 I Nr. 259. Sur la mort de Fuzelier, voir aussi Rep. 110 I Nr. 19. NLAO, Rep. I Nr. 259, fol. 7. NLAO, Rep. I Nr. 259, fol. 26. NLAH, Cal. Br. 23 Nr. 140, fol. 95-118 (« Compte que Jacques de Rozemont Rezident a la Cour de France pour son altesse Serenissime Monsieur le Duc Ernest Auguste de Brunswik et Lunebourg Prince et Evesque d’Osnabruck &c. a l’honneur de luy rendre pour l’année 1676 »). Quelques exemples : « Le 3e de janvier [1676] il fut payé un Escu pour un paquet de lettres recü de la poste dont le dessus est de la main de M. Jemme. […] Le mesme jour [17 fév.1676] quarente quatre sols pr deux pacquets un de la main de Mr de Genebar du 8 de vingt six sols et l’autre de dix-huit de Mr Jemme, marqués sur le dessus de sa lettre envoyée à Melle Jemme. […] Le 15 [août 1676] pour une lettre de Sr Angeau musicien de S.A.R. 8 s. » D-W, Cod. Guelph. 383 n°5, Celle 27 fév. 1685. Sur la fondation de Mercures en Europe du Nord, voir Marion Brétéché, Les Compagnons de Mercure. Journalisme et politique dans l’Europe de Louis XIV, Paris 2015. Pour une réflexion sur le statut de la lettre diplomatique, voir Sébastien Schick, Les Liaisons avantageuses. Ministres, liens de dépendance et diplomatie dans le Saint-Empire romain germanique (1720-1760), Paris 2018, p. 237-270.
– 34 –
L’Europe galante comme marché du travail
sation et la diversification du corps diplomatique, désormais composé non seulement de grands ambassadeurs mais aussi d’une phalange de négociateurs et de ministres plénipotentiaires aux fonctions très variées, multipliaient les possibilités d’emploi pour les musiciens. Les négociations d’Utrecht en 1712 sont un exemple fameux d’imbrication étroite entre cérémonial diplomatique, divertissement et patronage musical.116 Cette coexistence ne se limitait toutefois pas aux grandmesses internationales ou aux évènements extraordinaires. Le journal du duc de Wolfenbüttel Ludwig Rudolf fournit un aperçu sur une réalité beaucoup plus quotidienne en évoquant la présence de musiciens français dans la suite du marquis de Bonnac.117 Le 24 janvier 1701, deux musiciens français jouent pendant un dîner chez l’ambassadeur de France à Wolfenbüttel : un père et son jeune fils, qui semble ne pas avoir plus de dix ans mais joue à la perfection de la flûte et du hautbois.118 Le 24 décembre de la même année, une musicienne française nommée Marianne chante et se fait entendre sur la viole d’amour à trois reprises lors de dîners au château.119 Les jours suivants, cette musicienne se fait à nouveau entendre à table chez l’ambassadeur lui-même.120 Enfin, il faut noter que certains musiciens participent à la diplomatie de manière très directe en devenant eux-mêmes diplomates accrédités : Jean-Baptiste Farinel, maître de chapelle à Hanovre, est nommé ambassadeur à Venise de la principauté allemande à partir de 1713, mettant ses pas dans ceux d’Agostino Steffani, abbé compositeur doublé d’un diplomate de haute volée.121 Un dernier exemple montre enfin que les musiciens pouvait parfois servir de monnaie d’échange dans les relations diplomatiques. Le maître à danser Georges Desnoyers, après un court séjour à Londres en 1721-1722, fut engagé à Hanovre pour enseigner la danse au prince de Galles, Friedrich Ludwig.122 Il représente à trois reprises son nouvel élève princier comme parrain lors du baptême de musiciens dans les registres paroissiaux de Hanovre.123 En 1733, il est engagé comme Tanzmeister à la cour de Dresde. Deux ans plus tard, l’ambassadeur de Pologne en Angleterre Johann Adolph von Loss envoie une demande un peu particulière au roi de Pologne et électeur de Saxe August III : Le lever fini le Prince s’étant rétiré [sic], il me fit apeler dans son Cabinet, et me dit qu’il avoit encore à me parler confidemment sur certain point qui regardoit le Maitre de danse Denoyer. Sur cela Son Altesse Royale me donna à connoitre, qu’Elle devoit m’avouer, que malgré les réprésentations que celui Lui avoit faites, et malgré le désespoir qu’il Lui avoit marqué d’encourir la disgrace de Vôtre Majesté, en surpassant le terme qui Lui avoit été prescrit pour Son retour, Elle avoit rétenu le dit Denoyer pour enseigner les Princesses Ses Sœurs, et l’avoit obligé par un ordre absolu de rester ici trois mois au delà de sa permission. Le Prince ajouta à cela qu’enhardi par l’étroite amitié qui regnoit entre le Roi Son Pere et Vôtre Majesté, et se flattant qu’Elle ne le prendroit pas mauvait [sic], il s’étoit permis cette liberté, et il me chargea non seulement de Lui en faire des excuses, mais aussi de la suplier de sa part, d’agréer que Denoyer passât dans Son service, Son Altesse Royale ne pouvant me dissumiler [sic] qu’Elle avoit pris depuis longtems beaucoup d’affection pour cet homme. La dessus le Prince m’ayant fait sentir qu’il seroit fort obligé à Vôtre Majesté si Elle vouloit bien le Lui ceder, ce qu’Il ne Lui demandoit néantmoins pas qu’à condition de le Lui renvoyer, en cas qu’Elle voulût le ravoir dans la suite, il me protesta encore qu’en tous temps il s’empresseroit de trouver des occasions pour marquer le désir sincère qu’Il avoit d’obliger à Son Tour Vôtre Majesté. Il conclut par me dire, qu’il ne sauroit se dispenser de rendre justice à Denoyer, en ce qu’il n’avoit point pris, ni jamais voulu prendre aucun engagement chés Lui, à moins que Vôtre Majesté ne daignât gracieusement y consentir. De mon côté je répondis au Prince par des Complimens reciproques, en l’asseurant en termes généraux du désir
116 117 118 119 120 121 122 123
Quelques éléments dans Bély, Espions et ambassadeurs, p. 391-402. D-W, Cod. Guelf. 28 Blankenburg : Diarium Ser[enissi]mi Princip[is] Ludovici Rudolphi Brunsvicensium ac Luneburg, 1701. Sur le marquis de Bonnac, voir Bély, Espions et ambassadeurs, p. 709-713. D-W, Cod. Guelf. 28 Blankenburg, 24 janv. 1701, p. 2. Voir la transcription du journal Chapitre 4, p. 236-238. D-W, Col. Guelf. 28 Blankenburg, 24 déc. 1701, p. 129. D-W, Cod. Guelf. 28 Blankenburg, 25 déc. 1701, p. 129-130. Sur Steffani, voir Claudia Kaufold, Ein Musiker als Diplomat : Abbé Agostino Steffani in hannoverschen Diensten (1688-1703), Bielefeld 1997. Sur Jean-Baptiste Farinel, voir Chapitre 3, p.184-185. Moira Goff, « Desnoyers, Charmer of the Georgian Age », Historical Dance Volume, 4/2, 2012, p. 3-10. BAHild, KB Nr. 780, Taufbuch 1711-1777, 5 fév. 1724, 16 avr. 1725, 28 oct. 1728, p. 157-158, 161, 172.
– 35 –
Chapitre 1
de Vôtre Majesté à faire plaisir à Son Altesse Royale, et que je ne manquerai point de faire incessamment mon tres humble rapport à Vôtre Majesté de la commission dont il s’agissoit. En attendant en toute soumission les gracieux ordres de Vôtre Majesté, touchant la réponse dont Elle voudra bien me charger pour le Prince, je prens la liberté de Lui faire remarquer encore que je sais de science certaine que l’afaire en question tient fortement à cœur au Prince, et que Denoyer ayant été élevé avec Luy, ainsi qu’il est devenu une espère de favori, Son Altesse Royale verroit avec beaucoup de plaisir qu’il entrât dans Son service.124
Dans cette lettre, Georges Desnoyers apparaît d’abord comme un objectif diplomatique, puisque la demande de son engagement à Londres passe par l’ambassadeur, mais aussi un moyen de monnayer de futurs services diplomatiques : le prince de Galle promet ainsi tout à fait explicitement de « trouver des occasions » pour payer en retour August III si celui-ci voulait bien lui céder son maître de danse. La proposition londonienne fut acceptée, et la cour de Dresde envoya Desnoyers au service du prince en y voyant très explicitement une marque de proximité politique.125 Une fois à Londres, Georges Desnoyers devint rapidement une figure clé de la scène londonienne, se produisant dans les théâtres de Drury Lane et de Covent Garden qu’il avait déjà fréquentés pendant son premier séjour, où sa présence fut médiatisée sur une longue période de dix ans (1732-1742) à grand renfort de publicité et d’annonces de presse.126 Ce passage d’un milieu de cour à un milieu urbain est aussi celui d’une gloire et d’une valeur individuelles, nées de l’attachement personnel à un patron, à une forme plus collective et publique de célébrité : il ne représente nullement une exception, mais allait peu à peu devenir la règle commune. Marginalité religieuse et itinéraires d’un blasphémateur À Dresde, la présence de musiciens italiens catholiques à la chapelle luthérienne de la cour avait provoqué d’importantes tensions confessionnelles dans la première moitié du xviie siècle.127 Mais la conversion d’Auguste le Fort ouvrit une période de tolérance plus grande vis-à-vis des catholiques. L’arrivée de Jean-Baptiste Volumier à Berlin puis à Dresde est un excellent exemple de la porosité accrue des frontières confessionnelles dans l’espace germanique et de l’acceptation sociale croissante d’individus situés en marge de l’orthodoxie religieuse. De confession catholique, Volumier est surtout connu pour avoir organisé une célèbre joute musicale qui devait opposer en 1717 l’organiste du roi Louis Marchand à Johann Sebastian Bach.128 On ignorait tout, en revanche, des raisons qui l’avaient conduit à la Hofkapelle de Dresde, où son arrivée en 1709 marqua pourtant un tournant décisif pour l’institution puisqu’il introduisit un répertoire nouveau et des pratiques d’exécution françaises comme Konzertmeister. Le musicien résume lui-même son parcours sur la liste de 1718 (Illustration 1.2). Le maître des concerts écrit son nom sous la variante « Woulmyer », qui apparaît souvent dans les sources, indiquant sans doute une origine flamande. Volumier se décrit comme « natif espagnol » et pourrait donc venir des Pays-Bas espagnols : J. Baptiste Woulmyer maître de Concert et Entré au service de sa Majesté l’année 1709. Natif Espagnol Elevé a la Cour de france agé de 40 ans passé.129
124 125
126 127 128 129
Lettre de Johann Adolph von Loss à August III, Londres, 15 nov. 1735. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/4, fol. 37. Lettre d’August III à Johann Adolph von Loss, Varsovie, 6 déc. 1735. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/4, fol. 40 : « je consens même à ce que le Prince le prenne à Son Service, puisque Je suis bien aise d’avoir par là occasion de donner à ce Prince Royal quelque marque de Mon penchant et empressement pour l’obliger et de pouvoir contribuer à Ses plaisirs et divertissements. » Goff, « Desnoyers, Charmer of the Georgian Age ». Mary E. Frandsen, Crossing Confessional Boundaries. The Patronage of Italian Sacred Music in Seventeenth-Century Dresden, Oxford 2006, p. 76-100. BD III, Dok. 666, p. 83-84. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 91.
– 36 –
L’Europe galante comme marché du travail
Illustration 1.2. Notice autobiographique de Jean-Baptiste Volumier. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 91.
Né dans les années 1670, Volumier affirme avoir été élevé à la cour de France. Aucune source ne confirme sa présence en France, mais un extrait des registres d’insinuations du Châtelet de Paris fait mention de deux Volumier demeurant au Palais Royal en 1672 : il s’agit de Jean-Jacques et de Jonas Volumier, deux frères qui avaient appartenu à la domesticité de la maison, respectivement comme garde suisse de Mademoiselle (Anne Marie Louise d’Orléans) et grand valet de pied de Madame (Marguerite de Lorraine).130 La même année, et jusqu’en 1687, un certain Pierre Habert, sieur de Volumier, est mentionné parmi les « Huit Fouriers » de la maison d’Orléans dans l’État de la France.131 Il est donc probable que Jean-Baptiste avait des origines dans la domesticité de la maison d’Orléans. En effet, le Palais Royal semble avoir été une sorte de pont musical entre la France et l’Empire dès la fin des années 1660, sous l’impulsion d’Henriette d’Angleterre, puis à partir de 1671 sous celle de Madame Palatine.132 Le 22 novembre 1692, Volumier est engagé à la cour de Brandebourg comme maître à danser (« Hoftanzmeister »). Ses fonctions incluaient la supervision de la musique pour la danse et les ballets, et l’enseignement de la danse aux jeunes nobles de la Ritterakademie à Berlin.133 Les circonstances tumultueuses de son départ après quinze ans de service en 1708 donnèrent lieu à une production importante d’actes administratifs et judiciaires, puisque l’enjeu n’était rien moins que la tenue d’un procès et la condamnation du maître à danser, accusé de blasphème par plusieurs collègues de la Hofkapelle. Ces actes, qui ont émergé parmi les archives judiciaires et ne sont pas référencés dans les archives de la Hofkapelle, étaient jusqu’à présent inconnus.134 La première plainte fut déposée le 4 septembre 1706 par quatre musiciens de la chambre dont les noms ne sont d’abord pas précisés : il s’agit de Christian Lehmann, Gottlieb August Petzold, Just Bernhard Gottfried Wiedemann et Heinrich Gottfried Pepusch, qui étaient tous à cette époque Kammer- und Reisemusikanten (musiciens de la chambre et du voyage) à la cour de Berlin et qui peuvent être identifiés dans d’autres documents ayant rapport au procès. Ce premier témoignage porte sur des faits situés « quelques années » auparavant : les quatre musiciens, ayant dû se rendre à Magdeburg par ordre du prince, se mirent « selon l’habitude chrétienne » à entonner des chants religieux de bon matin dans la voiture qui les y emmenait, et commencèrent à parler de religion.135
130
131 132 133 134
135
AN, Registres des insinuations du Châtelet de Paris, Y 225, fol. 196 : Jean-Jacques Volumier, suisse ordinaire de la garde de Mademoiselle d’Orléans, Souveraine de Dombes, et Jonas Volumier, grand valet de pied de feue la duchesse douairière d’Orléans, frères, demeurant ensemble au Palais d’Orléans, à Saint-Germain des Prés lez Paris : donation mutuelle. Le document indique qu’aucun des deux n’avait femme ni enfant. État de la France, Paris : Besongne, 1672, p. 432. Pierre Habert apparaît de nouveau comme fourier au Palais Royal dans les États de la France en 1674 (p. 444), en 1677 (p. 431), en 1678 (p. 462), en 1682 (p. 522), en 1683 (p. 546), en 1684 (p. 503), en 1686 (p. 603), en 1687 (p. 704). Dans l’édition suivante de 1692, il n’apparaît plus. Voir Chapitre 2, p. 90-93. Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 68 et 182. Je remercie Rebekah Ahrendt et Lionel Laborie d’avoir attiré mon attention sur ces documents qui lèvent le voile sur un épisode mystérieux de la chapelle berlinoise. Voir par exemple Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 180-181, à propos du renvoi de Christian Lehmann à la suite de son implication dans l’affaire Volumier : « Dann ließ er sich in Umtriebe ein, deren nähere Natur wir nicht kennen, und wurde infolgedessen seines Amtes enthoben. » GStA PK, Rep. 47 Nr. 20a, fol. 5 : « Als vor einigen Jahren, auff Seyner Königlicher Maÿestät allergnädigste Hohe Ordre, wir Endes unterschriebene, nach Magdeburg allerunterthänigst folgen müßten, haben wir der Christlichen Gewohnheit nach, in unserer Kutschen frühe morgens, Gott zu Ehren, einige Morgen und andere Lieder
– 37 –
Chapitre 1
Volumier, qui était assis avec eux, leur aurait alors demandé s’ils étaient vraiment assez stupides pour croire de telles fariboles, et penser que Dieu serait descendu du ciel pour se laisser crucifier. Lui ayant demandé s’il n’avait jamais lu les Écritures, ou s’il ne pensait pas que la Bible était la parole de Dieu, ils se virent répondre par Volumier qu’il « emmerdait la Bible et les Apôtres ». Un second témoignage, daté du 6 septembre 1706, est signé par deux autres musiciens de la chambre, Otto Gerhard Verdion et Franz Forstmeyer. Il porte sur un fait beaucoup plus récent, situé la même année, et implique non seulement les deux musiciens de la Hofkapelle berlinoise, mais encore le très célèbre et très catholique maître de chapelle de l’Empereur à Vienne, Johann Joseph Fux : chez le pâtissier de la cour Goldschmidt et en leur présence à tous, à l’occasion d’une conversation roulant sur la religion et la nécessité de travailler à l’unité des différentes confessions chrétiennes, Volumier aurait dit qu’il « chiait sur toutes les religions », qu’il y avait « plus de réconfort dans un seul verre de vin que dans le baptême et tous les autres sacrements », et que toutes les Églises chrétiennes (catholique, luthérienne et réformée) étaient de véritables maisons de prostitution, et – après avoir répété que « foutre », il emmerdait toutes les religions – il aurait même ajouté qu’il ne « connaissait pas d’autre dieu que sa viole de gambe ».136 Les témoins se déclarent prêt à renouveler ce témoignage sous serment. D’autres documents du même fonds d’archive mentionnent un mystérieux « Patron » haut placé dans la hiérarchie curiale, le Hofrat Christian Rabe, qui aurait cherché à protéger Volumier et à l’exonérer de ces accusations par tous les moyens.137 Mais même muni de cette protection, Volumier ne pouvait désormais plus échapper à la tenue d’un procès et à une probable condamnation. Il demanda au prince un sauf-conduit, qui lui fut accordé en mai 1707.138 Ce n’est que deux ans plus tard que Volumier refit surface. En mars 1709, une copie d’une lettre de Christian Duden (secrétaire à la cour de Dresde) à son frère Johann Caspar Duden (maître de danse à Berlin), indique que Volumier se trouve à Dresde, où il dirige l’orchestre et gagne plus de 1000 Thaler par an.139 Dès le mois de mai 1709, le prince électeur de
136
137
138
angestimmet und gesungen, dann nach Vollbrachtem Gesange, eine und andere Christlichen Discurse geführet, unter anderen auch die sonderbahre Gnade Gottes und Seines geliebten Sohnes Jesu Christi gebührende gepreÿset und gerühret; Worauf der Franzose Voulmier, welcher nebst uns in der Kutschen gesessen, öffentlich und ungescheuet, uns in faciem gesaget: Ob wir denn so albern wären, und gläubten solche Narrheiten, (absit Blasphemia!) daß Gott vom Himmel gekommen seÿ und hätte sich sollen Kreuzigen laßen? Über welche Gottes=lästerliche Worte wir insgesambt solche erschrocken und ihm darauf geantworttet: Ob er denn niemahls die Heÿl. Schrifft gelesen, od[er] die Heÿl. Biebel nicht vor Gottes=Wort hielte? Worauf er abermahls seine Gottes-lästerliche und höchststraffbahre Antwort gab: (S[alva] V[enia]) er schiße was in die Biebel und alle Apostel; daß dieses nun leÿder Gott erbarm es! in der That würklich passiret, können wir auff begehren, mit einem Juramente bekräfftigen, weshalb wir uns auch eigenhändig unterschrieben und unsere gewöhnliche Petschaffte darunter gedrucket; So geschehen berlin den 4:ten 7br: 1706. Vier damahlige Königl: Cammer Musici. » GStA PK, I HA Rep. 47 Nr. 20a, Document 1, fol. 5-6 : « Wir Endes unterschriebene attestiren und bezeugen hierdurch auff unser Gewißen, wie daß vor einiger Zeit und zwar in diesem ietztlauffenden 1706.ten Jahre, In Ihro Königl. Hoheit, des durchlauchtigsten Ehren-Printzens, bestalten Hoff:Conditors Hn: Goldschmids Logiamente, der Franzose Voulmier sich in Gegenwarth Sey: Römischen=Kaÿserl: Maytt: Compositoris, Hn: Fux, Hn: Friedels, und unserer zu Ende unterschriebenen, öffentl. und ungescheuet, mit diesem Höchststraffbahren Gottes=lästerl. Worten heraus gelaßen, sagend: (S[alva] V[enia]) er schiße was in alle Religionen, in einem einzigen Gläßlein Wein, seÿ mehr Krafft, als in der Heÿligen Tauffe und andern Sacramenten, und dieses sagte er, als Hr: Goldschmidt mit Hr: Fux redete, wie daß es erfreul. und gut seÿn würde, wenn die Christenheit vereiniget wäre, in allen Puncten, in dem Sie doch in denen Hauptpuncten einig seÿe und wir alle an einen Gott gläubten, eine Tauffe und einen Seelig=Macher Christum hätten; der Gottes=läster sagte auch: die Reformirte, Luthersche und Catholische Kirchen, waren lauter Huhren=Haüser, mit der nachmahligen Wiederhohlung: foutre, er schiße was in alle Religionen; Ja er hat auch zum öfftern gesagt: er wiße von keinem andern Gott, als von seiner Viole, dieselbe seÿ sein Gott […]. » Voir par exemple le rapport rédigé en 1711 par Gottlieb August Petzold, GStA PK, Rep. 47 Nr. 20a, Document 1, fol. 6-7 : « ermeldeter Gottes=läster Patron Grabow [Grabe] aber, welchem alles Sonnen=Klahr bekannt, hat sich doch davon nicht gekehret, sondern des in alle Ewigkeit (Krafft Göttl. Rechts) verfluchten Gottes=läster partie, wie ex informatione zuersehen, auff beständigste gehalten, und andere Ehrl. Leute dadurch höchststraffbare und unverantworttliche weÿße totaliter leÿder! ruiniret. » GStA PK, I HA Rep. 47 Nr. 20a, Document 6 : « Salvus Conductus für Voulmier », 28 mai 1707.
– 38 –
L’Europe galante comme marché du travail
Saxe Auguste le Fort écrivait à Friedrich I de Prusse pour demander l’abandon des poursuites contre Volumier, au motif que celui-ci venait d’être engagé à Dresde.140 Cet engagement dans la Hofkapelle de Dresde, gravé dans le marbre en juin 1709, s’inscrivait dans une politique de recrutement de musiciens pour renforcer la troupe de comédiens français. Plusieurs personnes furent engagées à cette occasion : le musicien Jean-Baptiste Ducé et les deux maîtres à danser Jean-Baptiste Volumier et Charles Debargues.141 Dès son arrivée, Volumier avait donc été intégré à la comédie et la Hofkapelle de Dresde. Même s’il est qualifié de Tanzmeister dans son décret d’installation, et que sa nomination comme Konzertmeister ne date officiellement que de 1720,142 une liste de personnel de l’orchestre datée du 13 août 1709 le désigne déjà comme « Concertmeister Volumnier ».143 Volumier demeura à Dresde jusqu’à sa mort le 7 octobre 1728.144 Sa biographie rocambolesque, qui fait se succéder une naissance en Hollande, une enfance parisienne, une première phase d’activité à la cour de Berlin où il fut en contact pendant une quinzaine d’années avec les musiciens de la Hofkapelle, mais ausi Friedrich I, Sophie-Charlotte et les élites aristocratiques de la cour, et une dernière partie à Dresde, où il exerça pendant vingt ans un rôle décisif au sein de l’orchestre, est un excellent exemple des répercussions individuelles de l’expansion du marché du travail européen.
L’Europe des troupes Mais revenons un peu en arrière, quelques décennies avant ce grand élargissement : les musiciens français qui ont mené des carrières internationales extraordinairement diversifiées, dans lesquelles les cours allemandes jouent à la fois le rôle de matrice et de tremplin, offrant d’excellents débouchés professionnels sur place mais aussi une capacité de projection dans l’espace européen, sont le produit d’une lente évolution. Au début de notre période, vers 1660, la mobilité est loin de constituer un aspect essentiel des carrières musiciennes. Au contraire, elle demeure très largement l’apanage des troupes de comédiens itinérantes, qui se produisent non seulement dans les cours mais également dans les villes sans se fixer durablement à un endroit. Cette mobilité théâtrale constitue alors l’un des principaux vecteurs d’une migration musicale plus obscure, bien loin des réseaux dynastiques et diplomatiques. Pour appréhender ce phénomène, et éprouver les limites du modèle de la troupe lorsqu’il est transposé au domaine de l’opéra, il est essentiel d’examiner la circulation des comédiens français qui sillonnent l’Empire à la même époque. Ils dessinent la carte d’une autre Europe, plus urbaine, moins liée au monde des cours mais très centrée sur la Hollande, plaque tournante d’où partent de nombreuses troupes francophones vers l’Angleterre, la Scandinavie et le Saint Empire. Des comédiens entre la Hollande et l’Empire La circulation des troupes et la diffusion européenne du théâtre français est un phénomène bien connu, dont l’étude peut s’appuyer sur un important corpus scientifique de grande qualité constitué depuis le début du xxe siècle.145 Parmi les travaux les plus récents, la monographie de Rahul 139 140 141 142 143 144 145
GStA PK, I HA Rep. 47 Nr. 20a, Document 4. Lettre de Christian Duden à Johann Caspar Duden, Dresde, 3 mars 1709 : « Monsieur Volumier befindet sich allhier, dirigiret das orgestre beÿ denen Comoedien und Operen, hat auch 1000 Thlr. Salarium bekommen, Er hat heute wollen zu mir kommen, ist aber außengeblieben. » GStA PK, I HA Rep. 47 Nr. 20a, Document 19. Lettre d’Auguste le Fort à Friedrich I de Prusse, Dresde, 15 mai 1709. Volumier est désigné comme violiste : « wir [haben] einen gewißen Violisten Nahmens Voulmyer beÿ Unserer Hoff-Music auf und angenommen ». HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 92. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/1, fol. 19-20. HStA Dresden, Loc. 383/4, fol. 108-110. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 7, non folié. Fransen, Les Comédiens français en Hollande. Georges Mongrédien, La Vie quotidienne des comédiens au temps de Molière, Paris 1970, p. 211-231, où la distinction entre « troupes libres » et « troupes protégées » demanderait
– 39 –
Chapitre 1
Markovits sur les politiques du théâtre français au xviiie siècle constitue une mise au point et une source d’inspiration essentielle.146 Construire le théâtre français Dès la fin de la guerre de Trente Ans, d’importantes campagnes de construction et de rénovation architecturale furent financées par les cours allemandes. Les anciens châteaux, couvents ou églises médiévales furent ainsi remis au goût du jour et adaptés aux normes du confort moderne à travers un phénomène parfois désigné sous le terme de Barockisierung.147 La construction de nouvelles résidences situées en marge des grandes villes, équipées de salles de spectacle modernes et entourées de vastes jardins, participèrent aussi à l’émergence de nouvelles pratiques culturelles, marquant une étape décisive dans l’adaptation de répertoires scéniques et de pratiques théâtrales venues de France ou d’Italie. Les cours de Basse-Saxe se trouvaient aux avant-postes d’un tel mouvement : à Celle, la modernisation du château lancée par Georg Wilhelm dès son installation en 1665 comprenait la construction d’un petit théâtre baroque situé sous les combles de l’aile Nord. Cette salle de théâtre conçue par l’architecte italien Giuseppe Arighini et achevée en 1675 est encore visible aujourd’hui, dans un état modifié.148 Les cours de Wolfenbüttel et Hanovre n’étaient pas en reste : Johann Friedrich fit ériger un petit théâtre au premier étage du Leineschloß de Hanovre en 1677, mais sa jauge de 408 places fut bientôt jugée insuffisante pour les besoins de la cour. Les conseillers de son successeur Ernst August proposèrent à celui-ci de faire construire une nouvelle salle de 1300 places, dans le double objectif de pouvoir rivaliser avec le nouvel opéra de la cour de Wolfenbüttel et de diminuer les coûts des déplacements à Venise, où les ducs de BraunschweigLüneburg se rendaient régulièrement pour le carnaval. Cette nouvelle salle impressionnante fut inaugurée un an plus tard, en 1689, avec la création de l’opéra dynastique Henrico Leone d’Agostino Steffani (Illustration 1.3).149 Parallèlement, le « pavillon de plaisir » de Herrenhausen et son immense jardin à la française, situés à quelques kilomètres de la ville de Hanovre et dont on peut voir une gravure sur la couverture de ce livre, étaient dotés d’une scène de théâtre construite entre 1689 et 1692.150 La construction de ces deux scènes distinctes reflétait l’ambition des ducs de Braunschweig-Lüneburg d’acclimater sur place des cultures théâtrales étrangères. L’érection de nouveaux théâtres de cour allait en effet de pair avec l’engagement de troupes d’acteurs susceptibles de s’y produire. Ce n’est donc pas un hasard si la première troupe permanente de comédiens français en activité hors de France fut engagée précisément à Celle. Elle était financée conjointement par les trois frères qui régnaient sur la région : Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg à Celle, Johann Friedrich à Hanovre et Ernst August à Osnabrück. C’est évidemment sous la plume de Sophie de Hanovre, femme d’Ernst August toujours très sensible aux vibrations de la vie culturelle de son temps, que l’on trouve la première mention de cette nouvelle troupe de comédiens français, dans une lettre du mois d’août 1667 : Le Duc G[eorges] G[uillaume] a esté 3 jours icy, il a presentement une bande de comediens François avec luy à Celle, toute la maison de Brunswic ensamble les veulent entretenir.151
146 147 148
149 150
sans doute à être nuancée pour le contexte germanique. Roche, Humeurs vagabondes, chapitre 13 « Le théâtre et l’aventure », p. 859-922. Markovits, Civiliser l’Europe. Voir aussi le récent collectif : Moving scenes. The Circulation of Music and Theatre in Europe, 1700-1815, dir. Pierre-Yves Beaurepaire, Philippe Bourdin et Charlotta Wolff, Oxford 2018. Pour une approche à partir de l’architecture religieuse, cf. Bridget Heal, A Magnificent Faith. Art and Identity in Lutheran Germany, Oxford 2017. Gerhard Vorkamp, « Das französische Hoftheater in Hannover (1668-1758) », Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 29, 1957, p. 121-185, ici p. 131. Hedda Saemann, Dachwerke über den welfischen Residenzbauten der Barockzeit im Kontext des höfischen Bauwesens. Untersuchungen in den ehemaligen Residenzstädten Hannover, Celle, Osnabrück, Wolfenbüttel und Braunschweig, Petersberg 2014, p. 416-418. Saemann, Dachwerke über den welfischen Rezidenzbauten, p. 288-290. Sur Herrenhausen, cf. Horst Bredekamp, Leibniz und die Revolution der Gartenkunst. Herrenhausen, Versailles und die Philosophie der Blätter, Berlin 2012.
– 40 –
L’Europe galante comme marché du travail
Illust ration 1.3. Johann Friedrich Jungen, Durchschnit des Hanover ischen Schlos=Oper n=Hauses der Quer nach, 1746, Hist orisches Museum Hannover.
La cour de Celle était donc porteuse du projet, et c’est à l’occasion du carnaval 1668 que l’on voit apparaître dans les registres de comptabilité la première trace du montage financier nécessité par cette opération – le coût annuel de 5000 Thaler étant supporté à égalité par les trois cours.152 Dès 1671 cependant, Ernst August se retire de l’affaire, sans doute parce que ne possédant pas de théâtre à Osnabrück, il n’avait pas l’usage de cette troupe qui se produisait exclusivement sur les scènes de Hanovre et de Celle. À partir de cette date, Georg Wilhelm et Johann Friedrich assurent chacun la moitié de l’entretien annuel de la troupe. La douzaine de comédiens qui composaient cette troupe n’est pas nommée de façon détaillée dans les livres de comptes avant 1698. 151 152
Lettre de Sophie de Hanovre à Karl Ludwig von der Pfalz, Iburg, 17 août 1667. Eduard Bodemann, Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder, dem Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz, Leipzig 1885, p. 123. Vorkamp, « Das französische Hoftheater », p. 139. L’entretien de la troupe revenait à 1666 Thaler et 24 Groschen par partie. Le registre de Celle pour l’année 1668-1669 fait apparaître la mention suivante : « Dan so derselbe den Frantzösischen Comoedianten Bezahlt gehabt zu Sermi Celsmi 1/3 Weil Sereniss. Celsiss. nebst Ihr Fürstl. Dhlt. Dhlt. Herrn Herzog Johann Friedrich und Herrn Hertzog Ernst August denselben alle drey Zusammen Zugleichen Theilen des Jahrs 5000 Thlr. zu geben Versprochen an Zurechnen von Fastnacht 1668 und davon das erste Jahr Verfloßen ist Fastnacht 1669…1666 [Thlr] 24 [Gr]. »
– 41 –
Chapitre 1
Le premier état complet est donné en 1674 par Samuel Chappuzeau dans son Théâtre françois, à la suite d’une description fort louangeuse : Les Ducs de Brunswic & Lunebourg de la branche de Cell entretiennent aussi une Troupe, que le grand nombre & le merite des personnes qui la composent, rendent tres acomplie, & en estat de pouvoir parêtre avec gloire en quelque lieu que ce fust. Elle execute parfaitement bien toutes les pieces les plus difficiles, soit dans le Serieux, soit dans le Comique, & elle a aussi à faire à des esprits éclairez & délicats, dont les Maisons de ces Princes sont remplies.153
Cette troupe de onze personnes reste plus ou moins identique jusqu’à la mort du duc de Hanovre Johann Friedrich en 1679. L’arrivée d’Ernst August à Hanovre en 1680 mit un terme au contrat de partage des comédiens qui liait Georg Wilhelm et son frère Johann Friedrich. Ernst August engagea dès 1680 une nouvelle troupe de comédiens français au seul service de la cour de Hanovre, tandis que Georg Wilhelm reprenait l’ancienne troupe pour son propre compte. Cet arrangement dura toutefois peu de temps, puisque sept comédiens de la troupe de Celle furent renvoyés dès 1683, tandis que les autres furent agrégés à la nouvelle troupe de Hanovre. Celle-ci est de nouveau partagée entre Celle et Hanovre, avant que Georg Wilhelm ne se retire définitivement en 1685.154 À partir de cette date, seule la cour de Hanovre entretient les comédiens. La nouvelle troupe engagée en 1680 par Ernst August, en même temps qu’une bande de violonistes français, est dirigée par Auguste Pierre Pâtissier de Châteauneuf et compte dix acteurs.155 Ces comédiens se produisent sur les scènes de Hanovre et Herrenhausen, mais voyagent aussi fréquemment aux Pays-Bas : dès 1680, les « Comédiens de Son Altesse le Duc d’Hanovre » louent la salle du Gracht à Bruxelles.156 En 1682, ils obtiennent la permission de jouer dans la salle du Théâtre National d’Amsterdam.157 Les acteurs se déplacent ensuite sous le titre de « Comédiens du duc de Parme » à Ath, Lille et Valenciennes, avant de rentrer au début du mois de mars à Hanovre, probablement pour le carnaval. On les retrouve aussi à l’été 1695 dans la résidence du prince-évêque de Cologne Joseph Clemens.158 Le succès du modèle de la troupe de Hanovre ne passa donc pas inaperçu parmi les princes de l’Empire et fonctionna dès les années 1690 comme une sorte d’archétype, servant de modèle à plusieurs autres cours allemandes. La première troupe de comédiens français que l’on peut repérer en Saxe n’est autre que celle du duc de Hanovre, qui se produisit à Dresde pour le carnaval 1696, après avoir obtenu un congé de son employeur principal.159 La troupe, qui se produisit pour la première fois le 27 janvier sur l’opéra avant de donner ses représentations sur une scène éphémère spécialement construite dans la Riesensaal, joua quatorze fois en tout. Le théâtre était bien entendu accompagné de musique : un « Opera Ballet » fut donné le 16 février 1696 sous le titre de Musenfest pour célébrer le retour d’Auguste le Fort de la campagne hongroise.160 Le 153 154 155 156
157 158 159
160
Chappuzeau, Le Théâtre françois, p. 221-224. Chappuzeau donne la liste des acteurs (« Les Sieurs Benard. de Boncourt. de Bruneval. le Coq. de Lavoys. de Nanteuil. ») et des actrices (« Les Demoiselles Benard. de Boncourt. le Coq. de Lavoys. de la Meterie »). Vorkamp, « Das französische Hofheater », p. 145-146. Carl Ernst von Malortie, Beiträge zur Geschichte des Braunschweig-Lüneburgischen Hauses und Hofes, Hanovre 1864, p. 118-121. Les Relations véritables se font l’écho de cet arrangement : « S. A. le Prince de Parme fit l’honneur, mardi dernier, à la troupe de comédiens du Duc d’Hannovre, d’aller avec toute la Cour voir, à leur théâtre, la représentation de la pièce à machines intitulée la Toyson d’Or, qui réussit fort bien à la satisfaction de ce prince. » Cité par Vorkamp, « Das französische Theater », p. 148. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 164-165. Scharrer, Zur Rezeption, p. 164. Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 9-11. Cette affirmation s’appuie sur une correspondance perdue entre Ernst August et Auguste le Fort. Fürstenau indique que cette troupe resta deux mois (du 1er janv. au 2 mars) et fut payée 673 Thaler pour son entretien, 5000 Thaler pour ses honoraires, à quoi venaient s’ajouter 600 Thaler pour le voyage aller et 310 Thaler pour le voyage retour. Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 11. La désignation d’opéra-ballet se trouve dans le journal de la cour, HStA Dresden, 10006 OHMA, G Nr. 13, fol. 95 par exemple.
– 42 –
L’Europe galante comme marché du travail
journal de la cour permet de reconstruire la planification de la fête et les nombreuses répétitions nécessitées par ce ballet, donné dans l’opéra de la cour et auquel participaient les membres de l’aristocratie.161 Il comprend un exemplaire du livret et montre plus généralement que les comédies françaises furent particulièrement à l’honneur au cours du carnaval.162 Avant de rejoindre Dresde, les comédiens de Hanovre avaient fait halte à Leipzig : peut-être en ont-ils profité pour jouer dans la toute nouvelle salle d’opéra inaugurée en 1693 par Nicolaus Adam Strungk sur le terrain Brühl.163 Le contrat d’engagement de la troupe de Villedieu en 1709 prévoyait aussi que les comédiens puissent se produire à Leipzig pendant les deux foires annuelles.164 De la Hollande à la Saxe : les troupes du Roi de Pologne Sans doute la troupe de Hanovre fut-elle un modèle convaincant, puisque trois ans après l’avoir hébergée, Auguste le Fort se décidait à son tour à engager une troupe permanente de comédiens pour la cour de Dresde. Il la fit recruter à La Haye par l’intermédiaire de son résident auprès du roi de Grande-Bretagne et des États généraux des Provinces-Unies, Abraham Wolfgang von Gersdorf. Cette troupe, appelée « Troupe de Comediens françois de Sa Majesté le Roÿ de Pologne » dans l’unique acte conservé aux archives de Dresde, était constituée en grande partie d’anciens acteurs de la troupe du prince d’Orange, également connue sous le nom de troupe de Romainville.165 Parmi les signataires, on retrouve en effet Charles de La Haye dit Romainville, Jean Barrié dit Fonpré avec sa femme et son fils, ainsi que Jean de Surlis qui faisaient partie depuis au moins 1683 des comédiens français de Guillaume III, Stathouder et prince d’Orange, puis roi de Grande-Bretagne à partir de 1689.166 Jean de Fonpré était également en contact avec les comédiens de Hanovre, puisqu’il se trouve en leur compagnie à Amsterdam en 1683.167 On perçoit bien à travers ces quelques exemples l’importance des Provinces-Unies comme espace où se nouent les différentes troupes de comédiens français en partance vers les territoires germaniques. Ainsi les comédiens recrutés à La Haye en 1699 travaillaient-ils ensemble depuis de longues années, avaient une expérience commune de l’étranger et possédaient des contacts avec les musiciens et les comédiens de Hanovre. Ils restèrent au service d’Auguste le Fort, dans ses deux résidences à Dresde et à Varsovie, jusqu’au déclenchement de la Grande guerre du Nord (1700-1721) qui le força à se rendre sur les théâtres d’opération militaire et à se séparer de sa troupe.168 La nécessité de financer des actions militaires prit bientôt le pas sur le mécenat artistique : à partir de 1705 s’accumulent les lettres de musiciens priant qu’on leur verse leurs salaires impayés.169 L’ensemble des
161
162 163 164
165 166 167 168 169
HStA Dresden, 10006 OHMA, G Nr. 13, fol. 75-94. Le jeudi 13 février, une première répétition a lieu à l’opéra dans l’après-midi, suivie par une seconde répétition le lendemain. Le samedi 15 février a lieu la répétition générale en costumes suivie d’une première représentation le lundi 16, et d’une seconde représentation le lendemain, apparemment plus modeste et dans les appartements. HStA Dresden, 10006 OHMA, G Nr. 13, fol. 1-74. HStA Dresden 10006 OHMA, G Nr. 13 : « Montag den 27. [Jan: 1696] Abends haben die französischen Comoedianten, so von Leipzig anhero kommen, in Opern Hauß zum ersten mahl agiret, weile das Theatrum aufn Riesensaal noch nicht fertig. » Sur l’opéra de Leipzig, cf. Michael Maul, Barockoper in Leipzig, Freiburg, 2009. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 72 : « Le Roy permets [sic] de representer aux Foires de Leipzig a leur profit, en cas que Sa Majesté n’en eût pas même besoin. Mais qu’alors la troupe aura elle même soin du theatre, des logemens et des chandelles à ses depens, et qu’elle soit neantmoins obligée de donner toûjours gratis Cinquante bilets pour la Cour, si au contraire ils vont à ces foires par ordre de la Cour, ils auront quartiers et chandelles. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 13 : reçu d’une somme de 3000 écus de Hollande signé à La Haye le 9 sept. 1699 par « Romainville, De Ponteuil, Delapesnieres, De fonprée, De fonpré le fils, Defonpré le père, Desurlis fils. » Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 152. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 164. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 201. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 516/4 (« Supplikation um Gehalt von Hofmusikanten ») et 10036 Finanzarchiv, Loc. 32623, Rep. LII Gen. Nr. 221.
– 43 –
Chapitre 1
musiciens fut finalement renvoyé à Pâques 1707. Même si le Kapellmeister Schmidt et presque tous les instrumentistes furent réengagés aussitôt, la chapelle se trouvait sans chanteurs.170 C’est à partir de 1708 que le rétablissement des finances permit d’engager à nouveau des artistes, musiciens et comédiens. Le 14 novembre 1708, juste après le siège de Lille et la mise en déroute des armées françaises par une coalition impériale, Auguste le Fort signe à l’Abbaye de Loos (« au Camp auprès de Lille ») une série de documents pour l’engagement d’une nouvelle troupe de comédiens français placée sous la direction de Michel de Villedieu. L’arrivée de cette troupe est documentée par divers contrats, actes notariés et ordonnances conservés dans les archives.171 Le premier document, intitulé « Conventions d’une troupe de comediens françois pour avoir l’honneur d’estre au service de sa Majesté », présente le « Détail de la Troupe qui s’offre à Sa Majesté » où apparaît de manière très frappante la triple compétence de plusieurs membres, qui jouent, chantent et dansent.172 Nous retrouvons ici deux comédiens déjà rencontrés en 1699 : Charles de La Haye dit Romainville et Jean de Surlis. Mais cette troupe offre surtout un cas d’étude passionnant sur l’interaction entre mobilités théâtrales et musicales. Les musiciens dans les troupes Les troupes françaises comprenaient souvent un ou plusieurs musiciens parmi leurs membres, dans la mesure où le théâtre français inclut encore, au xviie siècle, presque toujours de la musique. Sept ans après son départ de Hanovre, le bassoniste Charles Babel appartient toujours à la troupe des comédiens du Prince d’Orange à La Haye.173 Avant d’être embauchée à Lille pour la cour de Dresde en 1708, la troupe de comédiens dirigée par Villedieu s’était formée dans les Pays-Bas. Le 7 février 1707, treize comédiens s’associaient à Mons devant le notaire Pierre-André Henrichant afin de jouer la comédie dans la ville pour une durée d’un an.174 Les trois maîtres d’œuvre de cette entreprise étaient à nouveau Jean de Surlis, Michel de Villedieu et Romainville. Plusieurs passages du contrat évoquent la musique et la danse. Il est ainsi stipulé que « Le Sr Dery s’engage aussy de chanter dans touttes les pieces où il en sera requist par la trouppe175 » et que « les demoiselles de Romainville, la demoiselle Louisette Prevost, le Sr Prevost le fils et autres quy sauront danser danseront sans aucune retribution par tout où le Sr Riboy le jugera a propos comme maistre des ballets.176 » Un autre passage un peu plus développé et concerne les services d’un maître de musique, un certain Valois : De plus on est convenu que nul ne pourra augmenter la trouppe de part ny de gagiste sans le consentement general de tous les camarades a la reserve du Sr de Valois quy pourra y estre incorporé en qualité de maistre de musique a sa part egalle auxdits associez en se fournissant par luy toutes les musiques necessaires aux pieces que la trouppe jugera a propos de representer, mesme les fera escrire a ses deppens et se fournira d’un larbin [?] et d’un copiste sy besoin est.177
170 171
172 173 174
175 176 177
Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 33. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 64-70 (« Conventions d’une troupe de comediens françois pour avoir l’honneur d’estre au service de sa Majesté »), fol. 71-72 (« Conditions auxquelles Sa majesté le Roy a resolue [sic] de prendre à son service une troupe de Comediens François »), fol. 82-84 (lettre d’Auguste le Fort à August Ferdinand von Pflugk et copie d’un passeport pour les comédiens, Lille 14 nov. 1708, reçu signé par Villedieu, Lille 17 nov. 1708, ordre de paiement, Dresde 26 fév. 1709). HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 66 : « Hommes : Belle Tour – chante. Desurlis. devilledieu. Romainville – danse. Derval – danse. Chalons Comique. derozanges. La Martinierre – chante. Femmes : La Devilledieu. Danse. La desurlis. La Romainville. ses deux filles – dansent. la de Rozanges – chante. » Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 177. Mons, Archives de l’État, E 903, Minutes du notaire Philippe André Henrichant, fol. 183-185. Ce contrat associe de Villedieu et sa femme, de Surlis et sa femme, Prevost avec sa femme Louisette et son fils, Romainville mère et fille, une demoiselle Babet, ainsi que les sieurs Dery, Lefebvre et Riboy. À chacune de ces personnes est attribué un type de rôles, mais le contrat n’est signé que par « Romainville pour moi et mes deux filles », Prévost fils et Dery. Mons, Archives de l’État, E 903, fol. 184-185. Mons, Archives de l’État, E 903, fol. 185. Mons, Archives de l’État, E 903, fol. 184.
– 44 –
L’Europe galante comme marché du travail
Les comédiens restèrent moins longtemps que prévu à Mons, puisqu’ils furent engagés par Auguste le Fort avant que le contrat d’association n’arrive à son terme. Les « Conditions auxquelles Sa Majesté le Roy a resolue [sic] de prendre à son service une troupe de Comediens François » stipulent également, à propos des six actrices : « la plupart sçauront chanter ou danser pour les pieces d’agrémens. » Elles signalent également que la troupe comprend quatre violons, un décorateur et un souffleur.178 Il est donc à parier que certains musiciens se trouvaient déjà dans la troupe de Mons avant d’être engagés à Dresde. Le mystérieux « maître de musique » nommé dans le contrat de Mons en 1707 est sans doute Stéphane Valoy, musicien et copiste à la cour de Hanovre entre 1680 et 1698.179 Romainville et Surlis ayant fait partie de la troupe de comédiens de Hanovre, il les connaissait déjà depuis longtemps. Stéphane Valoy apparaît fréquemment dans les registres paroissiaux de Hanovre, en qualité de témoin pour des musiciens ou des comédiens. Originaire de Paris, il prit la direction de la musique de la cour en 1691, juste après le départ de Jean-Baptiste Farinel.180 Il ne suivit apparemment pas la troupe de Villedieu à Dresde, mais il fut en contact avec d’autres troupes de comédiens, puisqu’il occupa les fonctions de Kapellmeister au sein d’une troupe française engagées à la cour de Darmstadt entre 1712 et 1715, date de sa mort.181 Là, il put certainement rencontrer le Kapellmeister Christoph Graupner ainsi que les autres musiciens en activité dans la chapelle ducale.182 Stéphane Valoy n’a pas seulement fourni, copié ou joué de la musique pour les troupes de théâtre. Il fut également un compositeur assez prolifique pour la cour de Hanovre. À sa mort, il légua à la bibliothèque de Darmstadt une collection de manuscrits musicaux rédigés à la fin des années 1680 à Hanovre : douze suites copiées par Guillaume Barré à Hanovre en 1689, douze Grands concerts en partition copiés à Hanovre en 1690, douze suites copiées par Charles Babel à Hanovre en 1689, et huit Concerts à chanter mis en partition à Hanovre en 1690. Un livret de 1685 mentionne encore sa participation à l’exécution d’un prologue donné en 1685 pour la naissance de Friedrich August de Brandebourg : « Monsieur du Cormier a fait les machines, Monsieur Valois toute la Musique & Monsieur Le Comte, Maître à danser de la cour, les Entrées de ballet.183 » Deux sources manuscrites viennent en outre révéler que Valoy composait de la musique d’église pour la chapelle luthérienne de Hanovre. Celle-ci fut bientôt diffusée bien au-delà des cercles de la cour : une Messe brève conservée à Berlin et un Magnificat conservé à Londres montrent que la production de Valoy continuait d’être copiée et jouée après sa mort.184 Ce dernier n’était pas le seul de sa famille à avoir émigré vers le Nord. Un certain François de Valoy apparaît dans les registres paroissiaux de Hanovre, dans un milieu de musiciens et comédiens très proche de celui de Stéphane : il se marie avec Antoinette Bénédicte Pâtissier, fille du chef des comédiens Pierre Pâtissier de Châteauneuf, et on trouve plusieurs musiciens fran178 179 180
181 182
183 184
HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 72. La dernière mention de Valoy dans la comptabilité de Hanovre fait mention de son départ sans en préciser la raison. NLAH, Hann. 76c A Nr. 117, p. 320 : « Valoix von Ostern 1697 biß Ostern 1698 womit er abgehet. » BA Hild, KB Nr. 778. On trouve comme témoins : « Domin[us] N. de Valois Music[us] » lors du mariage de Louis Le Conte et Anne d’Achet en 1684 ; « Stéphan[us] Valoy Parisin[us] » lors du mariage de Pierre Vezin et Charlotte de Châteauneuf en 1689 ; « M. Stephan[us] Valois praefect[us] Musicorum aulic[us] » au mariage de Jean Maillard et Anne Éléonore La Fleur en 1691 ; « Valoy » lors du mariage de Guillaume Barré et de Henriette Charlotte Venturini en 1693 ; « Valois » lors du mariage de Malo de Châteauneuf et Marie Jeanne Agnes Landini en 1695. Elisabeth Noack, Musikgeschichte Darmstadts vom Mittelalter bis zur Goetheszeit, Mayence 1967, p. 187. Ursula Kramer, « The Court of Hesse-Darmstadt », in : Music at German courts, 1715-1760. Changing Artistic Priorities, dir. Samantha Owens, Barbara M. Reul et Janice B. Stockigt, Woodbridge 2011, p. 342. Entre 1710 et 1718, on repère parmi les membres de la Hofkapelle un certain Jean-Baptiste Tayault comme violoniste et maître à danser : Joanna Cobb Biermann, « Die Darmstädter Hofkapelle unter Christoph Graupner 1709-1760 », in : Christoph Graupner. Hofkapellmeister in Darmstadt 1709-1760, dir. Oswald Bill, Mayence 1987, p. 27-72, ici p. 62. Prologue sur l’ heureuse naissance du jeune prince Frédéric Auguste, Hanovre 1685. Voir Chapitre 4, p. 226-231.
– 45 –
Chapitre 1
çais parmi ses témoins.185 Quelques années plus tard, en 1700-1701, François apparaît à La Haye dans la troupe de comédiens de Guillaume III d’Orange-Nassau.186 On trouve également une Bérénice Valoy dans les registres paroissiaux catholiques de Hanovre, mais son degré de parenté avec Stéphane demeure inconnu.187 La migration familiale n’était pas un phénomène rare, et bien souvent les musiciens se déplaçaient par familles entières avec les troupes de théâtre. La troupe de Dresde comprenait ainsi une autre famille de musiciens, que Michel de Villedieu avait probablement engagée lors de son séjour à Mons. Plusieurs indices laissent penser que le bassiste Robert du Hautlondel, dit La France le père, qui exerça dans la Hofkapelle à partir de 1707, travaillait pour cette troupe avec laquelle il arriva à Dresde. En 1718, le musicien rédige sa notice autobiographique de cette façon : Robert du Haulondel surnommé la France natif de Caen. Elevé a paris agé de quarante-trois ans passé engagé à lille en Flandre par Sa Majesté Nottre Roy en mil sept cents sept 1707.188
Né vers 1675 à Caen, élevé à Paris, le musicien est passé par Lille avant de rejoindre la Saxe : son engagement à Lille coïncide donc avec celui de la troupe de Villedieu en 1708. Néanmoins, sans doute Robert du Hautondel était-il arrivé à Dresde quelques mois avant le reste de la troupe, puisqu’il affirme avoir été engagé en 1707. Jusqu’à la mort de Villedieu en 1718, Robert du Hautlondel est payé sur l’enveloppe de la troupe, une somme globale allouée chaque année par la cour à la comédie française.189 Après la mort de Michel de Villedieu, une ordonnance datée du 6 mai 1718 rappelle que « le violon La France le Père touchait 200 Thaler, qui lui étaient jusqu’ici accordés sur les 10.000 Thaler que touchait le directeur Villedieu contre quittance.190 » Robert du Hautlondel obtient désormais son salaire directement de la caisse générale, comme tous les autres musiciens de la Hofkapelle. Robert du Hautlondel n’était pas arrivé seul en Saxe. Son fils Jean Baptiste Joseph, dit La France le fils, est également membre de la Hofkapelle dans le pupitre des basses de violon. En 1718, ce dernier rédige sa notice biographique de la manière suivante : Jean Baptiste Joseph Du haulondel, autrement dit La France le fils, est natif de Bruxelle en brabant entré au service Sa Mt. le Roy de Pologne et Electeur de Saxe en 1709. Né en 1688 agé de 29 ans passé.191
Cette notice est intéressante à plus d’un titre : on peut voir que la famille du Hautlondel était à Bruxelles dès 1688 pour la naissance de Jean Baptiste Joseph, soit environ vingt ans avant que Robert ne soit engagé. Dès sa quinzième année environ, Robert était donc aux Pays-Bas où il aurait eu son premier enfant. La notice fait également apparaître le jeune âge de Jean Baptiste Joseph lors de son engagement dans la Hofkapelle, seulement un an après l’arrivée de la troupe, à l’âge de dix-neuf ans. À la différence de son père, il ne semble jamais avoir dépendu directement de la troupe de Villedieu, puisque son salaire est toujours versé par la cour. Si son acte d’engagement n’est pas conservé, on peut observer qu’il apparaît dès août 1709 comme « violoncell » sur
185
186 187 188 189 190
191
BA Hild, KB Nr. 778, 24 avr. 1693, p. 109 : « ego Bonaventura Nardini conjunxi matrimonio Franciscum de Valoy et Antoniam Benedictam Patissier Gallos, praesentibus testibus Dionysio Le Tourneur, Bertrano Cardinal, Petro Vezin, Gallio, alliisque. » Denis Le Tourneur et Pierre Vezin sont deux musiciens au service des cours de Celle et Hanovre. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 178-179. BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, 6 oct. 1698, p. 213. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 91. Voir par exemple HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 4, fol. 261 : « La France le Pere. Bassiste. Wird von dem Quanto der Commoedie bezahlt. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 201 : « der Violon La France le Pere, hat gehabt 200 Thlr, so ihm von den 10000 Thlr, welche der verstorbene Directeur Villedieu gegen seine Quittung erhaben bißher vergnüget werden, erhält nunmehr vom 1. April Ao 1718 an solche 200 Thlr jährl. immediate aus der General Accis-Casse gegen seine eigene Quittung, quartaliter anticipando. » HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 92.
– 46 –
L’Europe galante comme marché du travail
une liste des membres de la Hofkapelle.192 Payé comme son père 200 Thaler par an, il touche en août 1738 une augmentation de 50 Thaler, accordée à plusieurs musiciens chargés de famille.193 Toute sa vie, Jean Baptiste Joseph du Hautlondel conserva des liens étroits avec les comédiens français de Hanovre. Il ne se marie pas à Dresde, mais à Hanovre, avec une certaine Jeanne Sophie en 1722. Ses témoins sont Pierre de Châteauneuf, chef de la troupe de comédiens de Hanovre, et Louis Le Sage.194 Notons aussi qu’un comédien nommé Dulondel, actif entre 1714 et 1721 à la foire Saint-Laurent de Paris avant de quitter la capitale sans laisser de traces, est évoqué par les frères Parfaict.195 D’autre part, la femme de Jean Baptiste Joseph est nommée Jeanne Chateauneuf dans le lexique des comédiens de Max Fuchs. Il indique qu’elle joua à La Haye dans la troupe de Nicolas Huaut entre 1738 et 1740, dont faisaient également partie Jean Nicolas Prévost et Louise Dimanche.196 Le reste de la famille du Hautlondel apparaît – de manière plus atypique, mais beaucoup plus romanesque – dans les actes d’un procès instruit en 1719 contre une autre fille de Robert du Hautlondel, Anne Henriette. Celle-ci avait épousé un membre de la troupe d’opéra italienne engagée en 1717 par le prince Friedrich August : Antonio Maria Peruzzi. Ce dernier n’était pas chanteur, mais servait de souffleur et de librettiste.197 Les deux jeunes gens se marièrent le 30 mai 1718 à la chapelle royale de Dresde, avec comme témoins Angelo Costantini et Mauro, un architecte et machiniste italien.198 Quelques mois plus tard, Antonio Peruzzi fut emprisonné pour dettes impayées. Il tenta de s’échapper en endormant ses gardes à l’aide d’un narcotique fourni par sa jeune épouse. Malheureusement, l’opium fourni par Anne Henriette devait être plus puissant que prévu, puisque l’un des deux gardes mourut aussitôt après avoir été drogué. Les jeunes mariés se trouvaient donc embarqués dans une affaire d’homicide, et furent traduits devant la justice avec d’être finalement expulsés de Saxe. Les actes d’instruction du procès se répartissent en quatre gros volumes qui contiennent, outre une quantité de documents, les minutes des interrogatoires.199 Les procès-verbaux sont rédigés en allemand, ce qui laisse penser qu’Anne Henriette Peruzzi pouvait s’exprimer dans cette langue. Les premières questions qui lui furent posées, le lundi 2 octobre 1719, donnent un aperçu absolument fascinant sur son enfance et son environnement : Art. 1. Comment se nomme l’accusée ? – Elle se nomme Anna Henriette, ou encore, comme on a l’habitude de l’appeler, Ariette Peruzzi.
192 193 194
195 196 197
198 199
HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 110. Dans les Hofbücher, Jean Baptiste Joseph est toujours désigné comme « Violoncellist », une fois comme « Violon ». HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/4, fol. 143 et 147. BAHild, KB Nr. 781, Hannover St. Clemens, Traubuch 1711-1843, p. 33 : « 1722 11 octobris Ego infra scriptus testo matrimonio junxisse joannem baptistam josephum du Haulondel Regio majestatis polonica Musicum Camerae et D. Joanam Sophiam Drufin Hannoveram cujus rei testes fuerunt D. Petrus de Chateauneuf et D. Ludovicus Le Sage. Joannes de Marteau Missionarius Apostolicus. » Louis Le Sage épouse Jeanne du Hautlondel – la sœur de Jean Baptiste Joseph – en 1710 à la chapelle royale de Dresde, avec pour témoins Simon Le Gros et Franz Tauber. DA Bautzen, Traubuch der Hofkirche, 1708-1759, fol. 2, 4 juil. 1710 : « Copulans Mathias Heimbach. Copulati Ludovicus Le Sage et Virgo Joanna Dni. Ruberti du Londel legiti. Filia. Testes Simon de Gross Francisc: Tauber. » François et Claude Parfaict, Mémoires pour servir à l’ histoire des spectacles de la Foire, Paris 1743, p. 138-139. Max Fuchs, Lexique des troupes de comédiens au xviiie siècle, Genève 1944, p. 79. Antonio Peruzzi est qualifié de « premier souffleur » dans une liste datée d’août 1718 : HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/3, fol. 60. En mars 1718, il compose un ballet avec Alessandro Mauro, architecte et machiniste de l’opéra italien : HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/3, fol. 50. Dans les actes du procès, il est décrit comme Opernschreiber. DA Bautzen, Traubuch der Hofkirche 1708-1759, fol. 4, 30 mai 1718 : « Copulati: Anto. Peruzzi Venetus, Virgo Henrica du haulondel. Testes: Angelus Constantin et D. Mauro. » HStA Dresden, 10024 Geheimes Rat, Loc. 9117/28, Loc. 11400/8-10. Seuls les volumes 1 et 3 des minutes sont conservés. Le deuxième volume, où figurait l’interrogatoire de Robert du Hautlondel, est perdu.
– 47 –
Chapitre 1
Art. 2. Quel est son âge et son état ? – Elle a eu vingt-deux ans à la Saint-Jean dernière, et elle est la fille du musicien La France de la chapelle royale. Art. 3. Où est-elle née et a-t-elle été élevée ? – Elle est née à Mons, en Flandres, et n’a été élevée nulle part durablement, ses parents ayant toujours voyagé à cause de leur profession, mais elle est arrivée ici, à Dresde, dans sa onzième année. Art. 4. Qui furent ou qui sont ses parents, et comment s’appellent-ils ? – Son père, La France, est musicien à la chapelle royale ici, mais sa mère, Marie Gabrielle, est morte depuis 6 ans déjà. Art. 5. De quelle religion est l’accusée ? – Elle est née et a été élevée dans la foi catholique romaine.200
Ces réponses forment une mine de renseignements sur la famille du Hautlondel, mais permettent de manière plus fondamentale d’accéder à la manière dont Anne Henriette articulait elle-même sa biographie. Née à Mons vers 1697, elle place apparemment sa jeunesse sous le signe de la mobilité à cause du métier de ses parents (elle n’a « été élevée nulle part durablement, ses parents ayant toujours voyagé à cause de leur profession »). Alors qu’on aurait pu penser que Robert La France était resté à Mons entre la naissance de sa fille en 1697 et le contrat d’association de la troupe de Villedieu en 1707, où il n’apparaît pas mais auquel il a déjà pu être associé, la réponse à la troisième question nous permet de voir que cela ne fut pas le cas. Enfin, Anne Henriette dit avoir été élevée dans la religion catholique : pas d’arrière-plan confessionnel, donc, dans la décision de quitter la France. Dans les questions suivantes, les juges essayent d’évaluer l’attachement d’Anne Henriette à son mari et les raisons pour lesquelles elle l’avait épousé contre l’avis de son père.201 On voit que Robert s’était dans un premier temps opposé à l’union de sa fille avec le musicien italien, avant de se laisser convaincre par son entourage. Ces deux cas d’étude illustrent de manière exemplaire le rôle crucial joué par les troupes de théâtre dans la circulation des musiciens. Les troupes de Romainville et de Villedieu représentent de ce point de vue un nœud particulièrement important, à l’intersection de nombreux réseaux français, hollandais, anglais et allemands, sur lesquels se sont greffées, à différentes échelles, les circulations de musiciens et de sources musicales. Paradoxalement, ces réseaux demeurent aujourd’hui encore un point aveugle pour les historiens, tant à cause de la rareté des traces laissées par les troupes itinérantes dans les archives que parce qu’elles ne peuvent être étudiées qu’en croisant des archives éparpillées dans toute l’Europe. Le modèle de la troupe, qui semble s’imposer comme une donnée fondamentale de l’histoire des migrations, n’était cependant ni le seul 200
201
HStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 11400/8, fol. 261-262 : « Art. 1. Wie Inquisitin mit Nahmen heiße ? Sie Heiße Anna Henriette oder, wie sie es kurtz auszusprechen pflegeten, Ariette Peruzzi. Art. 2. Wie alt und wes Standes sie seÿ ? Sie seÿ an Johannis letzhin 22. Jahr alt gewesen und des Königl. Capell-Musici la France Tochter. Art. 3. Wo sie gebohren und erzogen worden ? Sie seÿ in Flandern in Mons gebohren, und an keinem beständigen Orth erzogen worden, weil ihre Eltern hie und wieder ihrer Profession nach gereÿset, im 11ter Jahre ihres Alters aber mit anhero, nacher Dreßden gekommen. Art. 4. Wer ihr Eltern gewesen, oder noch seÿnd, und wie sie heißen? Ihr Vater, la France, seÿ Königl. Capell-Musicus alhier, ihre Mutter, Maria Gabriel aber seÿ von 6. Jahren bereits verstorben. Art. 5. Welcher religion inquisitin zugethan seÿ ? Sie seÿ Römischkatolisch gebohren und erzogen. » HStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 11400/08, fol. 262-265 : « Art: 9. Ob nicht Inquisitin mit demselben wieder Ihres Vaters Willen und ohne deßen zufriedenheit sich ehelich verbunden ? Ihr Vater habe freÿl. anfängl: nicht darin willigen wollen; Sie, inquisitin, seÿ aber mit ihrem Manne zu ihrem Beichtvater und zu anderen guten Freuden deshalber gegangen, welche denselben endl: persuadiret, daß er seinen Consens darzu gegeben, wie denn selbiger auch sie noch selbst in die Kirche geführet hätte. Art: 10. Warum sie dieses also gethan ? Weil sie einander geliebet, und versprochen gehabt, daß sie einander nicht laßen wolten. Art: 11. Ob sie nicht nach der mit ermelten Peruzzi erlangten bekannschafft, noch für ihre erfolgte Eheberedung sich verschiedene mahle in deßen Geselschafft und Conversation befunden ? Ja, es seÿ Peruzzi [mot coupé] 6. Monathe beÿ ihrem Vater aus= und eingegangen ehe sie nach gewust, daß er sie heÿrathen wollte; oder ob er sich in solchem Ende beÿ ihr oder ihrer Schwester engagiren würde, wie sie sich dem auch binnen solcher Zeit in ihres Bruders, des jüngeren la France, Logis in Gesellschafft mit ihm befunden, da mit selbigem Peruzzi vom Anfange her bekandt gewesen. [...] Art: 25. Ob nicht auch selbiger inquisitin währenden ihres Ehestandes hart und übel tractiret ? Sie könne von besonderem üblen Tractement nichts sagen, und weder über böse Worte, noch Schläge deshalber klagen, als daß derselbe nur bisweilen aufgefahren. »
– 48 –
L’Europe galante comme marché du travail
modèle existant, ni nécessairement le plus adapté à la circulation des musiciens, de leurs partitions et de leurs instruments. Les limites d’un tel modèle, et dans une certaine mesure son échec, sont mises en lumière dès 1699 par la troupe d’opéra français de Pologne, seule troupe française exclusivement musicale ayant jamais franchi les frontières de l’Empire. La troupe de l’opéra de Pologne : les limites d’un modèle La dernière scène du Départ des Comédiens, comédie de Jean-François Regnard donnée à l’Hôtel de Bourgogne en 1694, dépeint le désœuvrement des acteurs italiens après le départ du public parisien au début de l’été. On y voit Mézétin partant à la campagne avec Pasquariel « jouer l’opéra en vendanges.202 » Cette réplique était prémonitoire : cinq ans plus tard, en 1699, le prince électeur de Saxe et roi de Pologne Auguste le Fort l’envoyait à Paris pour y recruter une troupe d’opéra français complète et prête à l’emploi, en mesure de produire dès son arrivée à Varsovie des opéras et divertissements français. Cette entreprise, concomitante avec l’engagement de la troupe de comédiens français de La Haye, n’était pas une mince affaire, puisqu’il fallait engager non seulement des chanteurs et des musiciens, mais aussi des danseurs, des costumiers, des décorateurs, des machinistes, un perruquier et un cuisinier. La tentative de transposer au monde de l’opéra le modèle économique très particulier de la troupe théâtrale se solda par un échec qui peut être interprété comme la conséquence d’une erreur d’analyse initiale. En effet, la présence habituelle de musiciens parmi les troupes de comédiens ne signifiait pas qu’une troupe d’opéra soit un modèle viable. Les troupes théâtrales étaient adossées à des structures bien particulières, très anciennes et propres au monde du théâtre : la foire de Pâques où les employeurs venaient démarcher les troupes de comédiens, les solidarités familiales et une longue expérience collective de la mobilité étaient autant de piliers indispensables qui n’avaient pas leur équivalent parmi les musiciens. La pratique de l’opéra s’accommodait en outre assez mal du fonctionnement de troupe pour des raisons de taille. En général, les troupes de théâtre engagées par les cours allemandes reposaient sur la polyvalence des acteurs qui pouvaient occuper plusieurs types de rôles, et comprenaient une vingtaine de personnes tout au plus : la troupe de Villedieu comprenait ainsi treize acteurs, auxquels s’ajoutaient quatre « joueurs de violons », un décorateur également chargé de la confection des habits et un souffleur.203 Les exigences propres à l’opéra faisaient littéralement exploser les effectifs : avec les chanteurs, l’orchestre, les danseurs, un copiste de musique, un machiniste, un tailleur, une coiffeuse et un perruquier, le plan initial présenté à la cour par Mézétin prévoyait 46 membres.204 Finalement, ce sont 93 personnes qui se mirent en route pour Varsovie, parcourant plus de 1500 kilomètres en près de trois mois avec leurs effets personnels, leurs costumes, leurs instruments et leurs partitions, sans compter les décors pour le théâtre. Plus encore que les individus et les familles de musiciens embarqués dans une telle entreprise, les impresarios jouaient gros. La mission impossible de Constantin Le maître d’œuvre de cette entreprise était Angelo Costantini (1653-1729), un ancien acteur du Théâtre Italien, plus connu à Paris sous le nom de Constantin ou encore de Mézétin, le rôle « moitier aventurier, moitié valet » qu’il avait inventé pour la scène de l’Hôtel de Bourgogne.205 Il était le fils de Costantino Costantini, dit Gradelin, qui semble avoir été spécialement chargé de 202
203 204 205
Jean-François Regnard, « Le Départ des comédiens », in : Le Théâtre italien de Gherardi, ou le recueil général de toutes les Comédies & Scènes françoises jouées par les Comédiens italiens du roi, vol. 5, Amsterdam 1721, p. 258 : « Arlequin à Pasquariel : Et vous, Monsieur qu’allez-vous faire ? – Parsquariel : Je m’en vais avec ma sœur jouer l’Opera en vendanges. – Arlequin : Comment donc ? – Mézétin : Ouy, Monsieur. Voyant qu’il n’y a plus rien à faire à la Comédie, nous nous en allons jouer un Opera à la Campagne. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 64-70 et 71-72. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 57-58 (« Mémoire pour l’opéra »). François Parfaict, Histoire de l’ancien théâtre italien, Paris 1767, p. 83-93. Voir aussi Antoine d’Originy, Annales du théâtre italien depuis son origine jusqu’ à ce jour, Paris 1788, p. 20-21.
– 49 –
Chapitre 1
la musique pour les représentations du Théâtre Italien dans les années 1680.206 Plusieurs œuvres de Watteau dépeignent Mézétin chantant avec sa guitare (Illustration 1.4). Voici la notice biographique que lui consacre Maupoint : Mezetin Comédien de l’ancien Théâtre Italien se nommoit Angelo Constantini de la Ville de Verone, il étoit frere d’Octave tous deux enfans de Gradelin ; Mezetin fut reçû dans l’ancienne Troupe des Comédiens Italiens en l’année 1680. Il y joüa d’abord sous le masque d’Arlequin du tems même de l’ancien Dominique : depuis il inventa le personnage de Mezetin qu’il a toûjours joüé à visage découvert jusqu’au mois de May 1697 que le Théâtre Italien fut fermé, après quoi ces Comédiens s’étant dispersés, Mezetin alla à Brunsvick, où ayant trouvé une Troupe Italienne, il y joüa le même rolle de Mezetin. Le Roy de Pologne qui avoit entendu parler de ses talens l’en retira en 1699 pour l’attacher à son service & lui accorda le titre de Noble avec les charges de son Camerier Intime, Trésorier de ses menus plaisirs & Garde des bijoux de sa Chambre, lesquelles Mezetin exerça pendant près de trente ans : tout Paris qui le croyoit mort, fut surpris de le voir reparoître sur le nouveau Théâtre Italien le 5. Fevrier 1729. Le sieur Lelio fils composa un Prologue pour le produire au Public qui courut en foule le voir pendant le peu de tems qu’il joüa sur ce Théâtre.207
Maupoint fait remonter le départ de Constantin vers les territoires de Braunschweig à la fermeture du Théâtre Italien en 1697. La comptabilité de la cour de Celle montre cependant qu’il était actif à Celle dès le mois de juillet 1690, avec sa femme et une troupe de comédiens italiens.208 Entre 1690 et 1697, Constantin était donc actif à la fois à Celle et à Paris avec deux troupes différentes, puisque lui seul appartenait aux deux troupes à la fois. La troupe italienne de Celle, forte de dix à treize personnes, demeura au service de la cour jusqu’en 1699.209 En 1699, les comédiens du duc de Celle ayant joué pour le carnaval à Varsovie, Constantin se fit remarquer par Auguste le Fort qui l’employa à son service. Le passage au service de la cour de Dresde s’accompagna en outre pour Constantin d’une ascension sociale remarquable, puisqu’il se vit conférer le titre de Camérier privé d’Auguste le Fort et annoblir, touchant une confortable pension annuelle de 700 Thaler.210 Immédiatement après son recrutement, Constantin fut dépêché à Paris afin d’y engager une troupe d’opéra, ce qui peut expliquer la rapidité de son engagement : si l’on en croit une lettre conservée aux archives de Dresde, la décision paraît avoir été prise assez soudainement et sans le consentement préalable du duc de Celle.211 La suite de la carrière de Constantin à Dresde ne ressemble guère au long fleuve tranquille suggéré par Maupoint : tombé en disgrâce à cause d’une histoire d’amour ou d’une fausse facture, Constantin fut emprisonné en février 1702 dans la forteresse de Königstein, d’où il fut libéré en 1708 à la suite d’une maladie. Il semble alors avoir 206 207 208
209
210 211
Émile Campardon, Les Comédiens du roi de la troupe italienne pendant les deux derniers siècles, Paris 1880, p. 136-138. Maupoint, Bibliothèque des théâtres, Paris 1733, p. 208. NLAH, Hann. 76c A Nr. 216, p. 430 : « Vermöge Ser.mi durchl. gnäd. befehls de dato den 1. July 1690 sind denen in Ser.mi Durchl: diensten angenommenen Zehn Italiänischen Comoedianten an Vermochten Tractament Geldern und zwar quartaliter anticipando gezahlet: Diana della Tereza Costantini, Angelo Costantini, Giovanni Gaggi, Francesco Mattarazzi, Anthonio Torri, Anthonio Stivorio, Anthonio Benozzi für sich und dessen Frau, Alberto Vannozzi, Gio Battista Trezzi. » La troupe est mentionnée pour la dernière fois à Celle dans le registre de 1698-1699. NLAH, Hann. 76c A Nr. 223, p. 451 : « Besoldung denen Italiänischen Comoedianten vom 12. Augusti 1698 bis 13 Augusti 1699: Sigra Tereza Costantini dta Diana, Antonio Stivorio detto Oratorio, dem selben beÿ seinem Abtritt vom 1 9br: biß 1 9br 1699 und über dem zu Reisen Geldt, besage Sermi Durchl. Gnad. Ordre den 14t Octobr: 1698 und Quitung, Francesco Mattarazzi detto Dottore, Giovanni Gaggi detto Pantaloni, Gennaro Sacchi detto Cocciello, Guido Richinara detto Celio für sich undt seiner Frauen, De costantini detto Mezetin ordinaire, Noch demselben Extraordinaire, Gio Battista detto Arlechino, Gio Battista Costantini detto Octave, Sebastiano di Scio, Jean Roviere. » Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 22-24. Le Reskript du 8 mars 1699 n’est plus conservé. Lettre d’Angelo Costantini à Wolf Dietrich von Beichlingen, Paris, 31 août 1699. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 9 : « il ne me reste que dire un petit mot touchant Son Altesse Sere.me Duc de Cell, Lorsque je suis parti de Warsovie pour venir a Paris executer Les Comendements du Roy je passé par Cell, Son Altesse Sereniss.me ny estoit pas, j’escrivis au Grand Marechal Mons. Bulo que n’estant point engagé a rester un tems fixe dans Cell, que je Le supplié tres humb. meⁿt de m’octroyer mon congé auprès de Son Altesse Sere[nissi]me ».
– 50 –
L’Europe galante comme marché du travail
Illustration 1.4. Jean-Antoine Watteau : Mezzetin, huile sur toile, 55,2x43,2 cm. New York, Metropolitan Museum of Art.
joui d’un regain de faveur, puisqu’il assure à partir de cette date plusieurs missions pour la cour de Dresde, notamment en Italie où il recrute en 1715 la troupe italienne de Tommaso Ristori.212 Il se vit toutefois retirer sa pension en 1724, si bien qu’il dut à nouveau monter sur les planches à Paris et Londres. Ayant quitté Paris criblé de dettes, il meurt à la fin de l’année 1729 à Vérone.213 212 213
HStA Dresden, Loc. 383/1, fol. 28, Mémoire de Thomaso Ristori [après 1733]. Katy Schlegel, « Costantini (Mezzettino, Mézétin), Angelo », in : Sächsische Biografie online.
– 51 –
Chapitre 1
En 1699, Constantin se trouvait donc à Paris avec pour mission de mettre sur pied un opéra français pour le compte de la cour de Dresde et la couronne de Pologne. Parallèlement au recrutement de la musique et de la danse pour l’opéra, Constantin était également chargé de se procurer divers objets de valeur pour la cour : la gravure d’un portrait d’Auguste le Fort, une médaille, un exemplaire des Aventures de Télémaque qui venait tout juste de paraître clandestinement, des robes pour une comtesse. Entre août et octobre 1699, il entretint une correspondance régulière avec Auguste le Fort et le maréchal de la cour Wolf Dietrich von Beichlingen (« Oberhofmarschall »). Cet ensemble de treize lettres où Constantin relate ses progrès et ses difficultés, réclame des lettres de change afin de pouvoir payer des avances aux musiciens et échaffaude des listes provisoires de personnel, permet de mesurer les risques et les difficultés liés à une telle entreprise, et de suivre pas à pas la mise sur pied d’un tel ensemble.214 Les délais de la correspondance, les négociations parallèles engagées par les deux parties avec d’autres interlocuteurs, les reculades et revirements de part et d’autre sont des difficultés classiques pour les recruteurs, pour qui la réussite des négociations représente souvent un enjeu crucial. Un mémoire envoyé en août 1699 illustre bien ces difficultés : Vostre Majesté aura reçeu un memoire dont je prend la liberté de luy faire voire ou j’en suis pour l’Opera de Vostre Majesté. Les abits sont achetés machines, decorat[io]ns et autre aussy, et même je croy qu’a l’heure qu’il est le tout est parti de Donquerque pour Danzich, j’ay avancé de l’argent aux musiciens[,] j’ay empeché la fortune de plusieurs qui estoyent apelé au service du Roy de Suede, et presentement que je suis engagé de douze mile livres je reçois un ordre de Son Exel. Beichlingen de ne rien faire, et cependant il ne me manque plus rien de l’Opera ayant le nombre parfait de bons Musiciens et Musicienes, dançeurs et dançeuses, et entr’autres de tres jolyes femmes, je suspenderay Sire de congedier ces gens la jusques aux nouveaux ordres de Vostre Majesté, pour l’amour de Dieu Vostre Majesté aye La bonté de faire reflection a la parole que j’ay doné a ces gens, ayant engagé celle de Vostre Majesté et par son ordre a la depense desja faite, a la renomée […] Sire sy je done conges a tout un Opera cela faira un grand bruit a la Ville et a La Cour, quoy qu’il en soit je m’aprete a prendre La fuite de ce pais de crainte di estre lapidé par la Musique et par la Dance.215
On voit ici que Constantin a débauché plusieurs acteurs de la troupe de Rosidor, qui menait au même moment des négociations parallèles avec Daniel Cronström. De son point de vue, la fiabilité des ordres reçus semble être un problème majeur, la cour hésitant souvent à avancer ou promettre de l’argent. La question du crédit personnel est aussi un enjeu important : pour engager ses musiciens, Constantin doit conserver sa réputation auprès de ses réseaux parisiens et la confiance de ses interlocuteurs.216 En effet, les artistes qui acceptaient le marché prenaient aussi des risques importants, d’où la nécessité de leur offrir des garanties. Constantin rappelle à plusieurs reprises que « bien de[s] musiciens et dançeurs hommes et femmes ont quité leur etablissem[en]t de paris, vendu leur[s] meubles, don[n]é conges à leurs maisons.217 » Le caractère herculéen de sa tâche, et dans une certaine mesure son impossibilité, sont bien illustrés par la liste du personnel de l’opéra et la comptabilité du voyage (Tableau 1.2). Les impresarios : Louis Deseschaliers et Catherine Dudard Pour constituer la troupe de l’opéra de Pologne, Constantin pouvait cependant se reposer sur des collaborateurs expérimentés, les anciens directeurs de l’opéra de Lille. Originaires de Rouen, où ils travaillaient tous deux à l’opéra, Louis Deseschaliers et sa femme Catherine Dudard avaient 214 215 216
217
HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 1-30. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 3-6. Lettre d’Angelo Costantini à Wolf Dietrich von Beichlingen, Paris, 11 sept. 1699. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 14-15 : « j’ai continué a former cet’Opera, et j’ay reussy apres cela Vostre Eccelance m’escris de n’en rien faire, coment me puis-je degager Monseigneur puisqu’ j’ay trouvé du credit pour me faire prester de l’argent avec lequel j’ay acheté pour six mil escus d’habits, j’ay avance de l’argent aux Musiciens qui se monte environ huit mil livres […] sy cette affaire manque je pranderay la fuite de Paris tout come sy j’estoit un voleur du Grand chemin. La Cour en rira, les Parisiens railleront, ceux que j’ay engagées me meaudiront, et je seray en état de ne plus revoir Paris ». HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 14.
– 52 –
L’Europe galante comme marché du travail
Damoiselles 2. Baudoin et Sa Mère 1. Barbier & Son fils 1. Charpentier 3. Camois Pere Mere & Soeur 1. Cheurot & fils 1. Chanlay 1. St. Romain 1. Corail 1. Paillet 1. Grand fille 2. Riche ainée, Mere & frere 1. Riche Cadette 2. Vernart et Mere 2. Volié congedié à Ulme Messieurs 1. Coraill 1. Fouvenelle & frere 2. Guiard et femme 2. Daniel femme et fille 1. Bodot 1. Choiseau 1. Colasse 1. Camot ainé 2. Camot cadet 2. Duclou 1. Coqueret 1. Grueau Pere 1. Grueau fils 2. Le Feure et sa femme 1. Paillet 1. Renault 1. Racine 1. Verny 1. Volié et femme congédiés à Ulme 2. Mercier et femme
Danseuses 1. Noisy 1. Blin 1. Grand mariée 2. Rognon 1. La Valle 1. Barbié Cadette 1. Dubeau 2. Prudent et Pere Danseurs 1. Lavalle 2. Protin… Mort femme 1. Desmarais 1. Serancourt 1. Blin 1. Dubuisson 1. Couturier 1. Prache [Non classés] 3. Directeur Deschalliers Frere, Nourrice & fille 1. Tailleur Causan pour hommes 1. Tailleur Dejardin pour femmes 1. Violon Ode 2. Violon Legros & femme 1. Joueur de Viole Langlé 1. Perrusquier Belanger 2. Machiniste Blain le pere & femme 1. Sous machiniste Pay Valet a Deschalliers 1. Deschalliers pour avoir soin des habits 1. Menard Coifeuse 1. Dejardin Couturier sans gages Le Jeune Cuisinier Bequet Garenier Jean son Domestique 1. Legrand Comedien 1. Lagrand sa mère En tout 93 personnes
Tableau 1.2. Composition de la troupe de Deseschaliers. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 1 : « Nom des personnes de l’opéra ».
pris la tête de l’entreprise lilloise en 1695 avec l'appui du maréchal de Boufflers.218 Ayant dû quitter la ville en discrédit, ils séjournèrent à Mons et à Tournai avant de rentrer à Paris, où ils firent affaire avec Constantin. Après l’échec de l’opéra de Pologne, le couple se lança aussitôt dans un autre projet : la création d’un opéra à La Haye. Ils s’associèrent alors à Jean-Jacques Quesnot de la Chesnée, marchand huguenot originaire de Genève résidant au Danemark : emprisonné en France en 1687 à la suite de la Révocation de l’Édit de Nantes – il était allé chercher les biens de sa femme décédée à Grenoble et fut accusé de chercher à faire sortir des protestants du royaume – il émigra à Berlin, puis en Suède avant d’aller s’installer durablement au Danemark.219 Après 218 219
Fransen, Les Comédiens français, p. 196-197. Léon Lefebvre, Histoire du théâtre de Lille de ses origines à nos jours, Lille 1907, p. 154-155. Ahrendt, A Second Refuge, p. 66-67.
– 53 –
Chapitre 1
avoir mis fin à sa collaboration avec les Deseschaliers, qui dura de 1701 à 1705, Quesnot ne fut pas tendre avec ses anciens associés : il fit le récit de son expérience dans un brûlot satyrique, une « Histoire instructive et galante » destinée à publier les méfaits commis par Louis Deseschaliers – qui était rebaptisé Louis le Timbalier – et sa diabolique épouse.220 Quesnot retrace en détail la biographie des deux directeurs d’opéra, tout en relatant l’histoire de l’opéra de La Haye, qui prit place dans la biographie des Deseschaliers juste après l’épisode de Pologne. Le recrutement des acteurs pour l’opéra de Pologne est documenté par un « Mémoire pour l’Opera » probablement rédigé par Constantin, qui propose une première ébauche de troupe.221 Les noms des acteurs sont répartis en quatre catégories (« Damoiselles qui chantent », « Filles pour la dance », « Hommes qui chantent » et « Danseurs ») et semblent avoir été recrutés pour des motifs bien variés : on y trouve un mélange de critères physiques (« belle fille, belle et jeune, joly garçon, brune picante, bien fait, passable, grosse dondon »), théâtraux (« jolie et buffone, brune picante, tres alerte ») et musicaux (« bone musiciene, bon pour les cœurs [chœurs], bon à chanter, esquis musicien, tres bon musicien »). Le document se conclut par une rodomontade : « il manque encore deux ou trois personnes pour le chant et l’opera est aussi grand et aussi parfait que celui de paris, qui coute a francini 31 mil escus par an, cependant Mezettin a trouvé moyens pour le composer a 17 ou 18 mil escus par an. » La comptabilité permet de reconstruire l’itinéraire emprunté par la troupe entre Paris et Varsovie.222 Passant par la voie continentale au cours d’un voyage de trois mois, la troupe demeura douze jours à Strasbourg, huit jours à Ulm, douze jours à Vienne et huit jours à Cracovie. Elle arriva à Varsovie avec une composition un peu modifiée, certains membres lui ayant faussé compagnie en cours de route, d’autres ayant été congédiés, d’autres enfin ayant été nouvellement recrutés.223 La comptabilité nous apprend aussi que les décors et costumes sont ceux de l’opéra de Lille.224 La troupe semble avoir répété à Paris avant son départ.225 Outre les nombreuses dépenses engagées pour divers tissus, gallons, franges, dentelles, perruques et autres fausses pierreries, on relève la présence de quelques livres de musique dont le titre n’est pas précisé.226 Le séjour de l’opéra à la cour de Pologne fut mouvementé. Certains membres de l’opéra (dont Catherine Dudard, qui selon Jean-Jacques Quesnot se retournait fréquemment contre ses associés) signèrent une pétition contre la comptabilité établie par Constantin, accusé d’avoir gonflé les factures aux dépens du roi, de n’avoir pas honoré tous les paiements contractés au nom de la cour, et de s’être octroyé une marge conséquente sur la plupart des dépenses engagées pour l’opéra. Le document présente une comptabilité concurrente, censée rectifier la première. En marge de la pétition figurent des annotations manuscrites de Constantin, qui proteste qu’il possède les reçus correspondant aux dépenses indiquées. Cette contestation oblige Constantin à préciser la provenance et la date d’arrivée de certains des membres. Plusieurs d’entre eux n’ont
220 221 222 223
224 225 226
Jean-Jacques Quesnot de La Chesnée, L’Opéra de La Haye. Histoire instructive et galante, Cologne 1706. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 57. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3 : « Estat de touttes les depenses faittes par ordre de sa Majesté le Roy de Pologne et l’Electeur de Saxe tant a Paris qu’ailleurs par le sieur Constantini son Camerier. » Voir Illustration 3.2, p. 149. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 4 : « Pour ce que le S. de Constantini a donné a Paris, a l’Isle, a Ulme, a Vienne aux musiciens et danseurs qui luy ont fait banqueroute et autres qu’il a congediez — 3703 [livres]. A deux musiciens qu’il a fait venir de Bordeaux, dont l’un est Camot & l’autre qui a pris la fuite — 30 [livres]. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 2 : « Pour dix sept grands ballots d’habits et bardes de l’Opera, pour les envoyer de l’Isle a Dunkerque & de la a Paris, toujours par terre, il y a le receu — 800 [livres]. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 2 : « Pour despenses faites a Paris pour des repetitions, Chandelles, louage d’instruments, bancs, tables, chambres, simphonistes & carosses pendant huit mois il y a les receus — 896 [livres]. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 3 : « Pour quelques opera acheptez par l’ordre du S. Deschalliers et livres en partitions il y a les receus — 510 [livres]. »
– 54 –
L’Europe galante comme marché du travail
été engagés qu’à Strasbourg, d’où ils sont venus de Flandres.227 Il précise aussi le nom des acteurs qui ont été actifs à l’opéra de Lille.228 De Dresde à La Haye : un changement de modèle Les ennuis ne faisaient pourtant que commencer, puisque le frère de Catherine Dudard fut bientôt tué dans un duel avec le maître à danser de la cour, le Français Potier, ce qui valut aux Deseschaliers d’être exclus des États d’Auguste le Fort.229 Le maître de danse Potier avait été engagé à Paris en 1699 par l’intermédiaire du résident saxon en France, le lieutenant Karl Gustav von Jordan.230 Contrairement aux Deseschaliers, Potier fut maintenu à son poste après le duel, par un ordre du 17 décembre 1704 qui le confirmait comme maître de danse auprès des jeunes princes.231 Le départ des directeurs ne signifiait pas le renvoi de la troupe dans son ensemble, puisqu’Alina Żórawska-Witkowska indique que la troupe de Deseschaliers reste à Varsovie jusqu’en 1703 ou 1704.232 Jan Fransen mentionne plusieurs missives diplomatiques laissant entendre que les musiciens français ont pu donner au moins quelques représentations à Varsovie.233 Moritz Fürstenau indique quant à lui que le début de la guerre du Nord en 1700 fit que le souverain resta principalement en Pologne pendant les années suivantes, et que la troupe n’alla de ce fait jamais à Dresde avant 1705. Les irrégularités dans le paiement des salaires décidèrent les membres de l’opéra à demander leur renvoi en 1701. Ils ne l’obtinrent pas, mais reçurent le 29 novembre 1703 la permission d’aller se produire dans d’autres villes ou d’autres cours, en particulier à Leipzig où ils pouvaient jouer pendant les foires. La troupe avait l’interdiction d’échanger ses membres ou de se dissoudre sans la permission du roi sous peine de ne pas recevoir de traitement. Ce n’est qu’en 1705 que les membres de la troupe furent définitivement renvoyés.234 Au-delà des aventures rocambolesques qui provoquèrent le renvoi de l’opéra de Pologne, pardelà l’accusation de rouerie formulée par Quesnot à l’encontre des Deseschaliers, il convient de s’interroger sur les raisons profondes qui provoquèrent l’échec de l’expérience. Nous avons vu que 227
228 229
230 231 232 233 234
HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 11 : Corail et sa femme, les deux Legrand, Mercier et sa femme, Laval et sa femme. Constantin précise qu’ils « ont fait leur sejour en Flandres et se sont rendus ponctuellement la veille du jour de mon arrivée à Strasbourg les ayant rencontrés en chemin et leur ayant donné cent livres pour achever leur voyage. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 16 : « Ce qui prouve la fausseté de cet article est que de tous les faux témoins qui ont signe cet article il ny avoit que la Dechalliers, Lefevre Touvenel qui fussent a Lille et tous les autres estoient dispersés dans tout le Royaume. » Quesnot de La Chesnée, L’Opéra de La Haye, p. 238-240 : « Durant cet intervale le fameux Mezetin arriva à Paris pour assembler des sujets pour l’Opera de Pologne ; il fit connoissance avec Deseschaliers, & après avoir contracté ensemble, ils jouerent a qui voleroit mieux l’Auguste Monarque, qui leur faisoit fournir l’argent pour conduire les sujets à Varsovie. Le mari ni la femme ne firent pas grand sejour à la Cour de ce grand Prince sans faire de leurs tours accoutumez : Deseschaliers faisoit tous les jours de nouvelles friponneries, & sa femme mettoit tout en desordre, animoit les uns contre les autres, jusqu’au point de faire battre son propre Frere contre le Sr. Potier, qui est un jeune homme fort sage, & d’un très-parfait merite. Il en couta la vie à ce Frere malheureux, pour avoir trop écouté cette détestable Sœur. Le Sr. Potier en agit le mieux du monde ; car après avoir desarmé son ennemi, il lui offrit de laisser toute rancune à part & de vivre avec lui, comme avec un parfait ami ; mais cet homme qui cherchoit sa mort, poussé & animé par sa Sœur ou pour mieux dire par une furie affreuse ; ne fut pas content de toutes ces honnêtetez, & voulut se battre encore une fois : il lui donna l’heure pour cela ; le Sr. Potier se trouva au rendez-vous, ils mirent l’épée à la main, la bonne cause triompha, & le Sr. Potier fit mordre la poussiere à un ennemi obstiné à chercher la mort. L’action étoit bonne & le Roi trop juste pour perdre le Sr. Potier, qui eut sa grace, toute l’indignation de ce Monarque tomba sur les causes criminelles de la mort de cet homme : Deseschaliers & Catherine Dudar pour ce crime joint à bien d’autres, furent bannis de Pologne & eurent ordre de sortir incessamment des Etats de sa Majesté. » HStA Dresden, 10026, Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 7. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 60. Alina Żórawska-Witkowska, « The Saxon Court of the Kingdom of Poland », in : Music at German Courts 17151760. Changing Artistic Priorities, dir. Samantha Owens, Barbara M. Reul et Janice B. Stockigt, Woodbridge 2011, p. 51-77, ici p. 53. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 200-201. Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 30-31.
– 55 –
Chapitre 1
le modèle de la troupe était au fondement même du projet. Le maître d’œuvre Constantin avait d’ailleurs une longue expérience de la vie de troupe à la suite de nombreuses années de pratique comme comédien italien dans la troupe de l’hôtel de Bourgogne et comme directeur dans la troupe de Celle. D’autre part, l’engagement au même moment d’une troupe de comédiens à La Haye a sans doute conduit l’administration à traiter les deux projets comme deux volets d’une même entreprise. Or, la mise sur pied d’une troupe d’opéra calquée sur le modèle d’une troupe de comédiens relevait de la gageure : l’opéra français représente en effet une forme spectaculaire particulièrement dispendieuse en moyens et en personnel. La spécialisation poussée des chanteurs, non seulement par type de rôles mais aussi par tessitures vocales, la présence d’instrumentistes et de danseurs, et l’esthétique du merveilleux qui sont au cœur de l’opéra français le rendent très mal adapté à une structure de troupe – contrairement aux comédiens français ou aux ensembles d’opéra italien qui peuvent adopter sans difficulté ce fonctionnement étant donné leur structure beaucoup plus légère. Deseschaliers ne s’y trompa pas lorsqu’il développa, dès son arrivée à La Haye, un dispositif commercial beaucoup plus léger : tout en faisant un usage intensif des ressources locales à travers la location d’une salle et son association avec Quesnot et Schott, il réduisit sa contribution au personnel à l’engagement de quelques bons chanteurs français.235 Le contrat qu’il signe le 31 mai 1701 à La Haye avec Jean-Jacques Quesnot de la Chesnée et Gerhard Schott est très révélateur de ce point de vue.236 Deseschaliers avait repris quelques chanteurs de l’opéra de Pologne : MarieThérèse Charpentier et la chanteuse Diard, sans doute apparentée au musicien Pierre Diard qui était également arrivé avec l’opéra de Pologne.237 De nouveaux musiciens sont aussi recrutés, mais on privilégie désormais la qualité par rapport à la quantité : le 2 août 1701, Marie Rochois, nièce de la célèbre soprano de l’Académie royale de musique, est engagée à La Haye.238 Même si le négociant hambourgeois Gerhard Schott – qui était aussi l’un des fondateurs de l’opéra de Hambourg et, à partir de 1685, son seul directeur – se retira rapidement de l’affaire, l’opéra de La Haye perdura jusqu’en 1713, date à laquelle les Deseschaliers se rendirent à Utrecht pour y fonder une nouvelle entreprise.239 Le modèle de la troupe d’opéra itinérante ne se poursuivit donc pas au-delà de la courte expérience polonaise, et se sédentarisa bientôt en milieu urbain sous une forme transformée. Pour continuer à accueillir des musiciens français sans faire appel au modèle de la troupe, les cours d’Empire devaient donc inventer des modèles alternatifs de recrutement et de financement, en développant de nouvelles pratiques d’administration de la musique française.
Du mécène au public : l’invention de la célébrité musicale L’Europe musicale qui émerge dans la seconde moitié du xviie siècle resta longtemps une Europe des cours. L’espace parcouru par les musiciens est en effet polarisé par les résidences ducales ou princières du Nord de l’Europe, beaucoup plus que par les principales métropoles européennes ou les grands centres d’activité économique. En finançant le recrutement, le voyage et l’installation permanente d’ensembles français, les cours semblent avoir bénéficié d’une sorte de monopole sur 235 236 237
238
239
Ahrendt, A Second Refuge, p. 126-135. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 202. Le contrat prévoit que Schott et Quesnot fourniront les décors et les costumes du théâtre de Kiel pour l’exécution d’Armide, ainsi que les habits pour les trois opéras suivants : Thésée, L’Europe galante et un autre opéra de Lully. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 201. Quesnot, L’Opéra de La Haye, p. 85-86 (« Madamoiselle [sic] Diar personne d’un grand merite, & l’ornement de notre Théatre, n’est venuë à la Haye que par cet odieux stratagême ») et p. 116 (« Comme j’ai donné quelques louanges à Mademoiselle Guyart qui se distingue beaucoup, l’on prend pié là-dessus pour supposer que je suis son Amant »). Pierre Diard est souvent appelé Guiard dans les archives de Dresde. Jérôme de La Gorce, « Contribution des Opéras de Paris et de Hambourg à l’interprétation des ouvrages lyriques donnés à La Haye au début du xviiie siècle », in : Aufklärungen. Studien zur deutsch-französischen Musikgeschichte im 18. Jahrhundert. Einflüsse und Wirkungen, dir. Wolfgang Birtel et Christoph Hellmut Mahling, Heidelberg 1986, p. 90-103, ici p. 92-95. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 193-250. Ahrendt, A Second Refuge, p. 113-181.
– 56 –
L’Europe galante comme marché du travail
la musique française jusque dans les années 1700. Si l’on admet que la circulation de la musique française est d’abord liée au théâtre, ce constat n’est pas surprenant, puisque c’est surtout dans les cours que se trouvait un public francophone. Ce modèle évolue cependant de façon spectaculaire dès les premières années du xviiie siècle : les musiciens se produisent de plus en plus souvent en dehors du monde de la cour, dans le cadre d’institutions publiques et devant un public urbain. Les cours ne représentent plus pour eux l’unique vivier d’opportunités professionnelles. En Europe du Nord, cette évolution est encouragée par la migration des huguenots qui forment un nouveau public francophone parmi les élites urbaines en Hollande ou dans l’Empire.240 Mais plus largement, c’est aussi l’apparition d’un nouvel espace public musical tout au long du xviiie siècle qui favorisait cette évolution. L’Europe des métropoles et la célébrité L’apparition au xviiie siècle d’une nouvelle « économie de la célébrité » liée à l’urbanisation de l’Europe, aux mutations de la sphère publique, à la commercialisation des divertissements et au développement d’une société du spectacle a été bien mise en évidence par les travaux d’Antoine Lilti. Cette forme moderne de notoriété, née dans les milieux du théâtre avant de gagner d’autres secteurs de la vie sociale et symbolisée par l’apparition de vedettes, se distingue par bien des aspects de la « réputation » ou de la « gloire ». Dans notre perspective, il faut surtout retenir le rôle central joué par les musiciens dans cette nouvelle économie du divertissement, analysée par Lilti à partir de la figure des castrats ou de Liszt.241 Mais aux racines de cette évolution profonde se trouve aussi un autre phénomène : le passage d’un modèle de mécénat aristocratique ou curial à un modèle de financement public. Urbaniser l’opéra français La production d’Acis et Galatée sur la scène de l’opéra de Hambourg en 1689 représente une étape décisive dans ce processus. Cette entreprise était téméraire sur bien des plans. Première exécution d'une œuvre lyrique étrangère sur une scène publique allemande, elle arrachait à son environnement naturel un sous-produit de l’opéra français en le transplantant dans un contexte urbain pour lequel il n’avait pas été conçu, tout en conservant le texte en version originale devant un public majoritairement germanophone. Première « pastorale héroïque » composée par Lully pour le château d’Anet où elle fut créée le 6 septembre 1686, Acis et Galatée avait d’ailleurs déjà été produite l’année suivante à la cour de Darmstadt pour le mariage d’Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt avec Dorothea Charlotte, la sœur de Johann Friedrich von Brandenburg-Ansbach. Cette première adaptation pour un évènement dynastique montre qu’il ne faut pas voir dans la pastorale un genre par nature « moins ambitieux et moins sophistiqué » que la tragédie en musique et qui serait de ce fait mieux adapté à un contexte d’exécution « bourgeois » par opposition au public aristocratique de la cour, ni supposer que le public hambourgeois était particulièrement sensible aux éléments ruraux et burlesques, par opposition au grand goût de la cour.242 Au contraire, cette œuvre est le 240 241 242
Sur Amsterdam et Rotterdam, cf. Ahrendt, A Second Refuge, p. 182-220. Antoine Lilti, The Invention of Celebrity, Cambridge 2017, p. 24-49 et 233-241. Cf. Hellmuth Christian Wolff, Die Barockoper in Hamburg (1678-1738), Wolfenbüttel 1957, vol. 1, p. 109 : Acis et Galatée serait « von einer feinen Komik, eine regelrechte musikalische Komödie. Der polternde Polyphem, die ländlichen Feste, die burlesken Märschen mit Piccolo-Flöte u.a. dürften den Hamburgern besonders zugesagt haben. » Voir aussi Herbert Schneider, « Opern Lullys in deutschprachigen Bearbeitungen », p. 72 : « Das weniger strenge und anspruchsvolle Genre der Pastorale eignete sich für Aufführungen in einem bürgerlichen Rahmen besser als die Tragédie en musique, deren Darstellung des Menschen zu sehr an der Wirklichkeit des bürgerlichen Lebens vorbeiging. » Rebekah Ahrendt a déjà contesté cette vision, proposant plutôt de voir dans la production hambourgeoise de 1689 un geste en direction de la communauté huguenotte, enjeu crucial dans les négociations d’Altona et qui venait de bénéficier de l’ordonnance du 12 mars 1689 « portant que les sujets de Sa Majesté qui sont sortis du Royaume à l’occasion de la révocation de l’Édit de Nantes, lesquels iront servir dans les troupes du Roy de Danemark, ou se retireront à Hambourg, jouiront de la moitié des revenus des biens qu’ils ont dans les Estats de Sa Majesté. » Ahrendt, A Second Refuge, p. 76-86.
– 57 –
Chapitre 1
premier épisode d’un lent processus qu’on pourrait appeler d’urbanisation de l’opéra français, sans solution de continuité avec le monde de la cour, mais qui se greffe au contraire sur un personnel et des pratiques musicales développées dans le cadre du mécénat aristocratique. Plusieurs indices suggèrent d’ailleurs un continuité très forte entre les deux productions de Darmstadt (1687) et Hambourg (1689). Même si le livret de Darsmtadt n’est plus conservé et qu’aucune liste de personnel ne figure dans celui de Hambourg, plusieurs musiciens semblent avoir participé aux deux productions : outre la possible présence de Georg Österreich et des sœurs Kellner à Hambourg,243 le chanteur Dumont apparaît dans le personnel de l’opéra de Hambourg en 1694. Le nom de ce chanteur émerge dans un procès qui opposa les deux directeurs musicaux de l’opéra, Johann Sigismund Cousser et Jakob Kremberg, dans lequel ce dernier accuse Cousser de pratiquer une concurrence déloyale en débauchant les meilleurs chanteurs de l’opéra pour ses représentations dans la salle du Remter.244 Dumont était en même temps au service d’Ernst Ludwig à Darmstadt, puisque celui-ci se plaint dans lettre à Auguste le Fort que le comédien ait été engagé à Dresde sans son consentement, ce qui trouble le bon fonctionnement de sa troupe de comédiens.245 Il a donc probablement participé successivement à trois représentations de l’œuvre, en 1686 à Darmstadt, puis à Hambourg en 1689 et 1695. Parmi le personnel musical de la Hofkapelle de Darmstadt en 1687, on note également la présence, sous la direction du Kapellmeister Wofgang Carl Briegel, de deux violonistes français, Claude Caillart et Baptiste de Grot, ainsi que d’un hautboïste Farinet et d’un bassoniste Maillard.246 En dépit de ces liens avec la production de Darmstadt, deux éléments suggèrent que les producteurs hambourgeois avaient parfaitement conscience des défis spécifiques posés par l’exécution de cette œuvre en contexte urbain. La réécriture du prologue, pratique d’adaptation extrêmement courante, fait le choix audacieux de camper celui-ci dans un lieu familier (« Le Théâtre Represente les Environs de la ville d’Hambourg »).247 La référence au contexte hambourgeois est également présente dès les premiers mots du Prologue, où Diane fait allusion à la paix d’Altona qui venait d’être signée, le 20 juin 1689, par le roi du Danemark Christian V, qui avait participé au financement de l’opéra de Hambourg lors de sa fondation en 1677. Plus loin, le long monologue d’Apollon qui fourmille d’allusions à la monarchie française dans la version originale est tout bonnement coupé et réduit à l’apostrophe finale (Tableau 1.3). Mais au-delà de ces reformulations subtiles, l’adaptation à un nouveau contexte urbain et républicain exigeait des mesures encore plus radicales : trois ans plus tard, lorsque l’œuvre fut reprise, la direction de l’opéra ressentit le besoin de faire traduire l’intégralité du livret. C’est un avocat et ami proche de Gerhard Schott, l’un des fondateurs de l’opéra de Hambourg et son directeur à partir de 1685, qui assura la traduction : Christian Heinrich Postel.248 Luimême auteur de plusieurs livrets pour l’opéra de Hambourg, Postel avait déjà traduit quelques années auparavant le livret d’un autre opéra de Lully représenté à Hambourg sous le titre Die unglückliche Liebe des Achilles Und der Polixena.249 Il avait fait précéder cette traduction d’une courte préface sur les enjeux d’une « Verdeutschung » de l’opéra français. Postel reconnaît d’abord que « les vers et les tournures » de cette « œuvre singulière » pourront sembler « étrangères »
243 244
245 246 247 248 249
Ahrendt, A Second Refuge, p. 76. Walter Schulze, Die Quellen der Hamburger Oper (1678-1738): eine bibliographisch-statistische Studie zur Geschichte der ersten stehenden deutschen Oper, Hamburg 1938, p. 149. Sur le conflit qui opposa Kremberg et Cousser, cf. Werner Braun, Vom Remter zum Gänsemarkt. Aus der Frühgeschichte der alten Gansemarkt-Oper (1677-1697), Saarbrücken 1987, p. 128-129. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 133-134. Lettre de Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt à Auguste le Fort, Darmstadt, 8 sept. 1714. Dumont et sa femme sont à Dresde à partir de 1714. Hermann Kaiser, Barocktheater in Darmstadt. Geschichte des Theaters einer deutschen Residenz im 17. und 18. Jahrhundert, Darmstadt 1951, p. 81. Acis et Galatée, Hambourg 1689. Solveig Olsen, Christian Heinrich Postels Beitrag zur deutschen Literatur. Versuch einer Darstellung, Amsterdam 1973, p. 11-12. Achille et Polixene, Hambourg 1692.
– 58 –
L’Europe galante comme marché du travail
Campistron, Anet 1686
Anonyme, Hambourg 1689
Le Theatre represente le Château d’Anet.
Le Theatre Represente les Environs de la ville d’Hambourg
Diane. Qu’avec plaisir je reviens en ces lieux Que jadis mon sejour rendit si glorieux, Ou regnoient la splendeur & la magnificence ! Le Fils du plus puissant, du plus juste des Rois Leur redonne aujoud’hui par sa seule présence Encore plus d’éclat qu’ils n’eurent autrefois
Diane. Qu’avec plaisir je reviens en ces lieux Pour avoir un sejour charmant & glorieux, Ou la tranquille paix regne en magnificence ! Le plus aimable don des Cieux & de leur Roy Qui leur donne aujourd’huy par sa seule presence Encore plus d’eclat qu’ils n’eurent autre fois.
[…] Apollon. Apollon en ce jour aprouve vôtre zele Pour un Prince charmant, Et vient joindre aux plaisirs d’une fête si belle D’un Spectacle nouveau le doux amusement. Au plus grand des Heros j’ai toûjours soin de plaire, […] Vous, habitans de ce sejour aimable, Redoublez vôtre empressement, Gardez-vous de perdre un moment D’un temps si favorable.
[…] Apollon. Vous, habitans de ce sejour aimable, Redoublez vôtre empressement, Gardez-vous de perdre un moment D’un temps si favorable.
Tableau 1.3. Comparaison du prologue de Acis et Galatée dans la version originale et la version hambourgeoise.
au public de Hambourg, confirmant ainsi que même pour des élites urbaines, cultivées et cosmopolites, la compréhension culturelle et peut-être linguistique d’une œuvre française demeurait une gageure. En effet, si l’œuvre avait été composée « d’après les coutumes d’ici », l’auteur aurait fait usage de vers réguliers pour les récitatifs, les aurait régulièrement entrecoupés de « vraies arias » et n’aurait pas employé les expressions un peu fortes que l’on peut y découvrir.250 Postel justifie aussi l’étrangeté de sa traduction en insistant sur le fait qu’elle n’est pas une simple « Verdeutschung », mais qu’elle suit la musique originale de la pièce sur laquelle elle peut être chantée, et que sa traduction doit donc respecter la structure métrique du texte français.251 La présentation du texte en version bilingue sur deux pages suggère pourtant que l’opéra avait été traduit en allemand à l’intention du public mais chanté en français sur scène, comme le confirme Mattheson.252 En revanche, trois ans plus tard, lorsque Acis et Galatée fut rejouée à Hambourg dans une nouvelle production en 1695, toute référence au texte original français avait disparu du livret, et la préface suggère que l’œuvre fut donnée entièrement en allemand pour mieux répondre aux attentes du public.253 Cette succession de trois productions marque donc une adaptation progressive de l’opéra français aux attentes d’un public urbain et un éloignement progressif du modèle de la cour, dans lequel les œuvres françaises étaient toujours exécutées en langue originale – c’était même la caractéristique première des divertissements français. Mais cette urbanisation n’était pas une rupture complète, puisque l’opéra continuait de s’appuyer sur le personnel français des cours avoi250
251 252 253
Achille et Polixene, Hambourg 1692, préface non paginée : « Geneigter Leser. Es wird dir gegenwärtig auff unserm Opern=Theatro ein sonderbahres Stück vorgestellet, dessen Verse und Redens-Ahrten manchem frembd werden vorkommen, der, ohn diesen Vorbericht zu lesen, dieselbe ansiehet. Dann wann man es nach hiesigem Gebrauch hätte wollen einrichten, müsten beyderley auf ganz andere Manier herauskommen, nemlich die Verse recht regulier mit ordentlichen Arien dazwischen, und die Redens-Arten nicht so hart, wie sie bisweilen seyn ; hätte man aber nichts anders als eine Verdeutschung intendiret. » Deux exemples d'adaptation de la traduction de Postel à la musique de Lully et Collasse sont donnés par Ahrendt, A Second Refuge, p. 96 et 100. Mattheson, Der Musicalische Patriot, Hambourg 1728, p. 181. Acis et Galatée, Hambourg 1695, préface non paginée : « Geneigter Leser. Weil dieses Schau=Spiel vor einiger Zeit, ob schon in frembder Sprache, jedoch aber mit grosser Satisfaction der Herrn Zuschauer auffgeführet worden : Als zweiffelt man umb so viel desto weniger, das es anitzo, nach dem es in unsere Teutsche Sprache übersetzt, unangenehm fallen würde ».
– 59 –
Chapitre 1
sinantes. Un simple regard sur la liste des acteurs et des danseurs donnée par Marx et Schröder suffit pour le constater.254 Parmi les Ballettmeister français actifs en 1694, on note (outre Du Bois, Du Bros et Thiboust) la présence de Jean-Jacques Favier, maître à danser à Celle. On remarque également la présence en 1709 d’un certain La Vigne : il s’agit probablement de Philippe La Vigne, Kapellmeister de la cour de Celle, puisque son fils, également maître à danser, meurt en 1707. Dès les années 1690, la musique et des musiciens français sortaient donc de leur lieu d’acclimatation premier dans l’Empire, les cours, pour aller conquérir de nouveaux espaces et de nouveaux publics sur la scène de Hambourg. Laboratoires de célébrité Le rôle de l’Italie comme laboratoire de la célébrité musicale dans les premières décennies du xviiie siècle a été très bien montré par Mélanie Traversier, qui a relevé à travers l’exemple de Naples le caractère central que revêtait pour de nombreux musiciens le passage en Italie dans la construction d’une réputation musicale.255 Si des compositeurs allemands comme Händel, Quantz ou Hasse mirent à profit cette stratégie pour acquérir une célébrité internationale, il en allait de même pour des musiciens aujourd’hui moins connus. En 1738, un témoignage anonyme relatant une représentation à l’opéra de Milan mentionne « le premier Hautbois de l’Europe » François Desnoyers, qui aurait « brillé dans toute l’Italie » et imposé la pratique de l’air avec accompagnement obligé de hautbois : On n’avoit point de Hautbois dans les Concerts ; Le Prince [Charles-Henri de Lorraine-Vaudémont] a été le premier qui les y a introduits, & ils y ont si fort plû que toute l’Italie l’a imité effectivement, il avoit à son service le premier Hautbois de l’Europe, nommé des Noyers, François, élevé en Allemagne dans la Musique de l’Electeur de Hannover. Son habileté est cause qu’on a composé des airs expres pour être récitez dans l’Opera avec le seul Hautbois & une seule voix de femme qui charmoit. La voix & le son de cet Instrument étoient si bien mêlez ensemble qu’on auroit crû que ce n’étoit qu’une seule voix. Ce des Noyers a brillé dans toute l’Italie ; & on a voulu avoir des Hautbois dans tous les Operas & même dans les Musiques d’Eglise.256
François Desnoyers, alors au service du gouverneur de Milan, avait d’abord servi à la cour de Hanovre : d’après Denis Nolhac, l’auteur de ce texte, Desnoyers y aurait aussi été formé, sans doute sous l’égide des trois hautbois engagés en 1688. Il est en tout cas présent pami les « Frantzösische Musicanten » de la cour en 1698.257 Desnoyers semble ensuite avoir fait carrière dans toute l’Italie, passant d’un modèle de mécénat lié au monde de la cour à un modèle de notoriété typique des métropoles musicales italiennes et beaucoup plus proche du vedettariat. D’autres musiciens suivirent une trajectoire similaire. Nicolas Delvaux, un flûtiste qui appartenait à la troupe de hautboïstes engagée en 1696 à Dresde, se trouve à Rome entre 1710 et sa mort autour de 1745 : flûtiste membre de la congrégation Saint-Cécile en 1710, il apparaît ensuite comme violoniste lors de l’exécution d’une cantate au palais apostolique en 1733, puis comme contrebassiste au Theatro Alibert à Rome en 1739, avant d’être mentionné dans les listes de morts pour les messes de suffrage.258 C’est sans
254 255
256
257 258
Hans Joachim Marx et Dorothea Schröder, Die Hamburger Gänsemarkt-Oper. Katalog der Textbücher, Laaber 1995, p. 439-457. Mélanie Traversier, « Costruire la fama musicale. La diplomazia napoletana al servizio della musica durante il regno di Carlo di Borbone », in : Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (1650-1750). Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples (1650-1750), dir. Anne-Madeleine Goulet et Gesa zur Nieden, Kassel 2015, p. 171-189. Denis Nolhac, Voiage historique et politique de Suisse, d’Italie et d’Allemagne, Francfort 1736, p. 166-167. Cet imprimé est publié de façon anonyme, mais l’auteur est identifié par Jean Daniel Candaux, « Un anonyme identifié. Les souvenirs de voyage de Denis Nolhac, réfugié, marchand et manufacturier huguenot », Revue française d’ histoire du livre, 53/45, 1984, p. 691-711. NLAH, Hann. 76c A Nr. 118, p. 314 : « Francois Denoyes von Ostern biß den 21. July 1698 von 10 Wochen à jährlich 115 Thlr. womit derselben abgehet 35 Thlr. 15 gr. » Base « Musici europeisti a Venezia, Roma e Napoli (1650-1750) » (http://www.musici.eu) : fiche en ligne.
– 60 –
L’Europe galante comme marché du travail
doute en Italie que le comte Rudolf Franz Erwein von Schönborn-Wiesentheid put se procurer un de ses manuscrits, puisqu’une sonate pour violoncelle de « Nicolo Delaux » se trouve dans sa collection musicale.259 La biographie de Händel montre bien le caractère stratégique d’un passage par l’Italie dans la construction d’une célébrité légendaire, puisque c'est depuis Rome, Florence et Venise qu'il se fit recommander à Hanovre par Ferdinand de Médicis. Il se dirigea ensuite à Londres où il devint l’un des premiers exemples de compositeur vedette. La trajectoire de la chanteuse Madeleine de Salvay, qui appartenait à la troupe de Tommaso Ristori avec qui elle se rendit à Dresde avant de rejoindre Londres, est très similaire. L’Italie était donc une destination attractive, mais le passage par Londres fut aussi un tremplin vers la célébrité pour de nombreux musiciens et danseurs français grâce à l’union personnelle entre Hanovre et l’Angleterre à partir de 1714. Le danseur Georges Desnoyers et le musicien Johann Ernst Galliard passent sans difficulté du service de membres de la famille royale basés à Londres à celui de ceux qui sont restés à Hanovre, ou inversement. Pour les deux hommes, le passage à Londres marque aussi la prise de contact avec un marché de la musique florissant (voir ci-dessous). La trajectoire de William Babel, fils du hautboïste et bassoniste français de Celle Charles Babel, est très similaire : il fit également une carrière musicale en Angleterre comme violoniste, claveciniste et copiste de musique. À partir de 1711, son nom apparaît dans les annonces publiques de concert de Londres, habituellement en combinaison avec ceux de William Corbett, James Paisible et M. Dubourg. Il publia plusieurs anthologies de musique, dont certaines au titre évocateur qui devaient les rendre attractives sur le marché particulièrement concurrentiel de l’édition musicale londonnienne. En particulier, The Modern Musick-Master or The Universal Musician en 1731, qui contient des instructions sur le jeu de tous les instruments « With a Brief History of Musick », semble avoir été une entreprise prometteuse, puisqu’elle se poursuivit dans une série d’additions, comme The Harpsichord Illustrated and Improv’d en 1734, ou encore The Musical Pocket-Book Containing an Extraordinary Collection of the Newest & Best Lessons of English & Italian Aires, en 1735.260 Parallèlement à cette activité éditoriale frénétique, William copiait aussi de la musique : une source conservée à la British Library documente son activité de copiste à Celle. Il s’agit d’une compilation d’une centaine de pièces françaises pour le clavecin faite en 1702 qui pourrait avoir été transmise par son père, Charles Babel, lui aussi un copiste prolifique.261 La Hollande « au centre des affaires » « En Hollande il a de quoy rendre plus de service puisqu’on y est au centre des affaires.262 » Cette remarque, formulée au détour d’une lettre par un ambassadeur saxon désireux d’obtenir sa mutation en 1709, peut être reprise littéralement pour le théâtre et la musique. En dépit du rôle joué par Londres ou les villes italiennes, la Hollande demeure une véritable plaque tournante pour les artistes français, le carrefour des Provinces-Unies occupant une position centrale non seulement dans l’espace physique, comme lieu de passage vers les régions septentrionales de l’Empire, l’Angleterre ou la Scandinavie, mais aussi dans la géographie mentale des comédiens, des danseurs et des musiciens français. Dès 1652, la longue étape hollandaise d’Anne de La Barre sur la route de Stockholm met en évidence la centralité de cet espace, porte d’entrée vers l’Europe du Nord. Plus tard dans le siècle, le passage des troupes de comédiens par La Haye, Bruxelles, Mons ou Tournai montre le caractère incontournable de la route de Hollande, ainsi que l’inscription de cet axe dans 259 260 261 262
Fritz Zobeley, Die Musikalien der Grafen von Schönborn-Wiesentheid, vol. 2, Tutzing 1982, n° 555. Gerald Gifford, « Babel, William » in : MGG online. Bruce Gustafson, « The legacy in instrumental music of Charles Babel, prolific transcriber of Lully’s music », in : Quellenstudien zu Jean-Baptiste Lully. L’œuvre de Lully: étude des sources. Hommage à Lionel Sawkins, dir. Jérôme de La Gorce et Herbert Schneider, Laaber 1990, p. 495-516. Lettre de Burchard von Suhm à Jakob Heinrich von Flemming, Venise, 16 fév. 1709. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 708/2, fol. 15-16.
– 61 –
Chapitre 1
la durée : même si les artistes recrutés en Hollande n’avaient sans doute pas prévu de se rendre plus à l’Est, ils devaient avoir conscience de la position centrale des Provinces-Unies dans le marché de l’emploi du spectacle vivant, comme un réservoir d’employeurs potentiels et d’opportunités aussi bien locales (dans les villes ou les cours hollandaises francophones) que plus lointaines. La prolongation de ce rôle jusque dans les premières décennies du xviiie siècle est bien mise en évidence par quelques listes de passeports. Celles-ci ne forment qu’une série très lacunaire, étant donné que les passeports sont surtout délivrés en temps de guerre et que leur usage se systématise seulement au cours des dernières guerres de Louis XIV. Le mémoire de 1712, document récapitulatif exceptionnellement complet de tous les passeports délivrés par Torcy au cours de l’année, est l’un des premiers exemples du genre et marque une étape décisive dans la systématisation du passeport comme outil administratif et l’établissement de telles listes.263 Si Lucien Bély avait déjà noté que les passeports distribués aux artistes représentaient moins d’un pour cent de l’ensemble, les dépouillements beaucoup plus précis entrepris par Mélanie Traversier permettent d’entrevoir le passage par la Hollande de certains individus et de formuler quelques hypothèses sur leur mobilité.264 Mélanie Traversier note que plusieurs danseurs, comédiens et musiciens apparaissent dans la liste de 1712. On aperçoit d’abord des acteurs travaillant pour les deux opéras fondés par Deseschaliers à La Haye et Utrecht : un passeport d’un mois est délivré pour « S[ieur] Prin acteur de l’opéra de La Haye, la nommée Lisse, les nommez Robinson, Vidor, Reverand Rinelon, et Remez, danseurs de corde avec leurs enfants, le tous au nombre de 11 personnes retournant en Hollande, v[aut] p[our] 1 m[ois] ».265 Deux mois plus tard, on trouve la délivrance d’un passeport « aux nommez Pierre des Echalliers et Louis Galloin acteurs de l’opera d’Utrecht revenant a Paris v[aut] p[our] 6 m[ois] ».266 Ce passeport est remis à « Du Pont Musicien du Roy », sans doute le haute-contre Guillaume Dupont.267 Le compositeur Jean-Baptiste Loeillet, dit de Gand, se voit aussi délibrer un passeport valable trois mois, « allant a Gand pour ses affaires pour revenir ensuite a Paris ».268 Mais on aperçoit aussi des individus évoluant dans l’entourage de la troupe de Jean de Fonpré, apparemment alors en activité en Hollande : un passeport d’un mois est donné à un certain « De Valois comédien francais allant a Tournay269 », « aux D. Fonpré et Dannillier comediennes et retournant a Tournay avec un domestique et leurs hardes270 ». Ces deux derniers repassent trois mois plus tard, puisque deux passeports sont à nouveau délivrés en septembre pour aller rejoindre leur troupe à Gand.271 C’est donc un spectaculaire brassage culturel, linguistique et artistique que reflète la circulation des artistes en Hollande : qu’ils aient été ou non au service d’une cour, ils se trouvent désormais sur un marché beaucoup plus large.
263 264
265 266 267 268 269 270 271
AAE, MD France 309, fol. 149-252. Ce mémoire de 1712, qui comprend le nom, le prénom et la destination de plus de 2000 voyageurs, est l’un des premiers exemples de liste complète de passeports. Cf. Bély, Espions et ambassadeurs, p. 610-653. Je remercie Mélanie Traversier de m’avoir généreusement communiqué les résultats de son enquête, qui ne se limite pas à la liste de 1712. Voir en particulier Mélanie Traversier, « Like a Rolling Musician », Diasporas. Circulations, migrations, histoire, 26, « Musiques nomades : objets, réseaux, itinéraires », dir. Mélanie Traversier, 2015, p. 9-15. AAE, MD France 309, fol. 168, 21 mars 1712. AAE, MD France, fol. 186, 11 mai 1712. Marcelle Benoît, Musiques de Cour. Chapelle, Chambre, Écurie 1661-1733, Paris 1971, p. 289. Benoît, Versailles et les musiciens du Roi, p. 133. AAE, MD France, fol. 250, 11 déc. 1712. AAE, MD France, fol. 209, 24 juil. 1712. AAE, MD France, fol. 219, 24 août 1712. AAE, MD France, fol. 232, 28 sept. 1712 : « la Dlle De Fontpré comedienne francoise allant rejoindre sa trouppe a Gand v[aut] p[our] 1 m[ois] » et « M. Dannilliers comedien avec sa femme, allant rejoindre leur trouppe a Gand, v[aut] p[our] 1 m[ois] ». Le passeport pour Dannilliers est renouvelé le 16 novembre, fol. 244.
– 62 –
L’Europe galante comme marché du travail
De Dresde à l’Europe des Lumières Les musiciens français actifs dans les cours allemandes illustrent particulièrement bien ce changement de paradigme décisif. En effet, attachés à un système de mécénat et à un public de cour de façon plus exclusive que les opéristes italiens ou les comédiens français qui se produisent régulièrement dans les villes depuis le début du xviie siècle, ils sont également moins touchés par les formes extrêmes de célébrité. Membres d’une classe moyenne de musiciens, ils font carrière à l’étranger sans être des vedettes. Leur exposition à des formes atténuées de célébrité permet donc paradoxalement de mettre en évidence le caractère universel de ce phénomène, qui touche même des instrumentistes éloignés de leur milieu d’origine et dont l’activité musicale est traditionnellement moins valorisée que celle des grands chanteurs. De ce fait, leurs carrières forment un observatoire privilégié pour suivre cette transition du monde clos de la cour vers l’univers infini de la célébrité. De la cour aux métropoles Dans le cadre du mécénat, la sélection et le recrutement des musiciens s’opèrent souvent au cas par cas, au hasard de rencontres personnelles, au sein de réseaux dynastiques, diplomatiques ou administratifs, ou encore collectivement, dans le cadre d’un marché passé « en gros » avec une troupe de comédiens incluant des musiciens. À partir des années 1710, la pluralisation des carrières musicales solidaire de l’émergence d’un espace public européen fait que les artistes ne doivent plus nécessairement rentrer en contact avec leurs employeurs potentiels pour trouver un emploi, mais peuvent se produire dans des institutions urbaines et parfois compter sur une notoriété allant au-delà de leurs propres réseaux socio-professionnels. La carrière de Buffardin illustre bien un tel changement de paradigme. Dans la première partie de sa carrière, sa mobilité suit des réseaux individuels, dynastiques ou diplomatiques. Au contraire, à partir de 1726, ses apparitions publiques ou semi-publiques reposent avant tout sur sa notoriété, qu’elles nourrissent en retour. Bien qu’employé à Dresde, Buffardin était fréquemment en déplacement. L’évocation par Carl Philipp Emanuel Bach d’une conversation entre son père et Buffardin indique que ce dernier devait se rendre régulièrement à Leipzig. Mais il se rendait surtout très régulièrement à Berlin jusqu’à son retour en France, pour donner des cours de flûte à Friedrich Wilhelm qu’il avait rencontré à Dresde en 1728.272 En outre, pendant son séjour de trente-cinq ans à Dresde, Buffardin continuait à entretenir des contacts réguliers avec la France, puisqu’il se produisit deux fois comme soliste au Concert spirituel, en 1726 et 1737.273 En 1748, il demande l’autorisation de prendre sa retraite pour s’installer en France, sous un climat plus doux à sa « santé délabrée », avec une pension de 700 Thaler par an. Il recommande pour sa succession deux de ses élèves : le « jeune Goezel » ou bien « le fils de Florio Grassi ageé de 10 ans ».274 Le musicien prit finalement sa retraite vers 1750, date à laquelle il retourna dans la capitale française. Le duc de Luynes l’entendit peu après dans un concert donné chez la Dauphine, en compagnie de Hasse et de sa femme.275 Buffardin cultivait aussi un intérêt poussé pour la facture instrumentale 272 273 274 275
Kollpacher-Haas, « Pierre-Gabriel Buffardin », p. 301. Voir aussi la lettre de Frédéric le Grand à Friderique Wilhelmine zu Brandenburg-Culmbach-Bayreuth, Remusberg, 15 mars 1737 : « j’atans tout les jours Grauen qui amenera bufardein avec lui. » Cité par Pegah, « Begegnungen in Konstantinopel und Leipzig », p. 292. Constant Pierre, Histoire du concert spirituel 1725-1790, Paris 1975, programmes 17 et 227. Lettre de Pierre-Gabriel Buffardin à August III, Dresde, 9 mars 1748. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/5, fol. 178. Duc de Luynes, Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XV (1735-1758), vol. 10, éd. Louis Dussieux et Eudore Soulié, Paris 1862, p. 298, 24 juil. 1750 : « J’ai parlé ci-devant de la Faustine, femme du Sr Hasse ; ils sont l’un et l’autre attachés au roi de Pologne électeur de Saxe en qualité de musiciens. Je n’avois pas encore entendu chanter la Faustine, je l’entendis hier ; il me paroît qu’elle a eu une belle voix, mais qui se sent actuellement de son âge. Son mari accompagne très-bien du clavecin, mais à la manière italienne. C’est chez Mme la Dauphine que j’ai entendu l’un et l’autre. J’entendis en même temps le nommé Buffardin, qui joue parfaitement bien de la flûte allemande ; il est de Provence et étoit aussi de la musique du roi de Pologne depuis trente-huit ans. Il vient d’obtenir la permission de se retirer, et ce prince lui fait une pension de 1,000 écus. »
– 63 –
Chapitre 1
et la composition, qui participèrent grandement à sa célébrité : une flûte signée « Buffardin Fils » a été retrouvée, et le Mercure de France publie en 1764 une de ses lettres contre l’usage des quarts de ton à la flûte traversière, qui constituait sans doute une riposte aux propositions publiées en 1760 par Charles de Lusse dans son Art de la flûte.276 Le passage à un milieu plus ouvert et largement urbain avait pour corollaire l’adoption d’un nouveau style musical. Quelques sources musicales documentent l’activité compositionnelle du musicien. Deux concertos pour flûte, copiés par Quantz et aujourd’hui conservés à Schwerin, témoignent à la fois d’un métier très sûr et de l’influence profonde exercés par les modèles italiens, en premier lieu Vivaldi dont les concertos furent copiés et exécutés très régulièrement à la cour de Dresde.277 Le concerto en mi mineur, en trois mouvements (Allegro, Andante, Vivace) se distingue surtout par la ritournelle très marquante et virtuose du premier mouvement. Un recueil de sonates en trio, également manuscrit et possiblement autographe, montre également un fort tropisme italien.278 Signe supplémentaire de sa célébrité internationale, dépassant largement le monde de la cour et les frontières de la Saxe, Buffardin fut le dédicataire de deux recueils de sonates en trio publiés par Antoine Mahaut, ancien musicien de l’électeur de Bavière établi à Amsterdam, avec lequel il ne semble pas avoir été en contact direct.279 Buffardin mourut en 1768 dans un relatif dénuement, comme l’indique son inventaire après décès.280 Ainsi se terminait une carrière située au croisement des réseaux diplomatiques et du monde de la cour, mais déjà en contact avec un nouveau marché de la musique en pleine expansion, solidaire de plusieurs phénomènes : la croissance urbaine sans précédent des métropoles européennes (Berlin, Paris), le développement d’une presse généraliste (le Mercure) et de l’imprimerie musicale (Mahaut), ainsi que l’apparition d’institutions de concert public (le Concert spirituel). C’est la conjonction de ces différents phénomènes qui rend possible l’émergence d’une célébrité musicale, bien différente de la notoriété traditionnelle du musicien de cour : alors que celle-ci se limitait en général à ses réseaux personnels et à ceux de ses patrons, on voit que Buffardin est connu et mentionné dans l’espace public, y compris par des gens qu’il ne connaissait pas personnellement (le duc de Luynes). Une manifestation très sensible de cette célébrité est la confection d’images et de portraits : on connaît deux portraits de lui qui permettent de se faire une idée de son apparence physique. Le plus connu fut dessiné à la pierre noire par Johann Sebastian Bach le jeune, fils de Carl Philipp Emanuel Bach qui était dessinateur et peintre et laissa plusieurs représentations de musiciens (Illustration 1.5).281 Cette trajectoire fut aussi celle d’Antonio Peruzzi et de sa femme Anne Henriette née du Hautlondel. Quelques années après leur expulsion des États d’Auguste le Fort en 1719, ils se trouvent à Prague en compagnie d’une nouvelle troupe d’opéra italien, placée sous le patronage du comte Franz Anton von Sporck. C’est là que la nouvelle gouvernante des Pays-Bas, Marie-Élisabeth d’Autriche, entendit la troupe pour la première fois. Elle les fit ensuite venir à Bruxelles : le 9 janvier 1727, Antonio Maria Peruzzi signe un contrat de location du théâtre de la Monnaie prenant effet le 276 277
278 279 280 281
Mercure de France, sept. 1764, p. 186 sq. Voir Edward R. Reilly et John Solum, « De Lusse, Buffardin, and an Eighteenth-Century Quarter-Tone Piece », Historical Performance. The Journal of Early Music America, 5/1, 1992, p. 19-23. D-SWl, Mus. 1253 : « Concerto | à 5. | Flauto traverso | Violino I, Violino II | Viola | col Baso continuo del Sign. Bifardin. » Sur les sources de Vivaldi à Dresde, voir Manfred Fechner, « Bemerkungen zu einigen Dresden Vivaldi-Manuskripten : Frage der Vivaldi-Pflege unter Pisendel, zur Datierung und Schreiberproblematik », in : Nuovi studi vivaldiani, dir. Antonio Fanna et Giovanni Morelli, Florence 1988, p. 775-784. F-Pn, Rés. F. 443. Antoine Mahaut, VI Sonate da camera a tre, Amsterdam 1751. Antoine Mahaut, VI Sonate Da Camera a tre, Augsburg sans date. Cf. Die Triosonate. Catalogue Raisonné der gedruckten Quellen, éd. Ludwig Finscher, Laurenz Lütteken, Inga Mai Groote, vol. 2, Munich 2016, p. 670-672. AN, Minutier central, LXXVIII-758, 28 janv. 1768. Annette Richards, Carl Philipp Emanuel Bach Portrait Collection I : Catalogue, Los Altos 2012 (= The Complete Works VIII/4.1), p. 54. Kristina Funk-Kunath, « Spurensuche – Ein unbekanntes Porträt von Pierre Gabriel Buffardin », Bach-Jahrbuch, 104, 2018, p. 225-234.
– 64 –
L’Europe galante comme marché du travail
Illustration 1.5. Johann Sebastian Bach le jeune : Pierre-Gabriel Buffardin, dessin à la pierre noire, 43x30.5 cm. D-B Mus. P. Buffardin III, 1.
– 65 –
Chapitre 1
lundi de Pâques de la même année et courant jusqu’au Carnaval suivant.282 Marie Cornaz indique en outre que les ducs d’Arenberg payaient à une certaine « Dlle Peronzi » l’abonnement d’une loge à Bruxelles en 1727.283 Il s’agit donc de la fille de Robert du Hautlondel, Anna Henriette Peruzzi. Notons qu’en 1724, le duc Léopold-Philippe d’Arenberg avait déjà payé à deux reprises « le loyer de la loge » et « labonnement de la Comedie » dans la ville de Mons à un certain « S. Dulondel Comedien ».284 Il paraît donc que la famille du Hautlondel a conservé des liens avec la ville de Mons et plus généralement l’espace des Pays-Bas. Mais à Bruxelles, Antonio Maria Peruzzi fit faillite et se vit contraint comme à Dresde de quitter la ville pour cause de dettes impayées. L’apparition d’une figure publique François Le Riche fut sans conteste l’un des musiciens les plus célèbres de la cour de Dresde, même si les archives sont assez avares de renseignements sur sa biographie. Contrairement à des musiciens comme François Desnoyers ou Peruzzi, il ne quitta jamais le système du mécénat aristocratique et resta au service de la cour de Dresde jusqu’à la fin de sa vie. D’après la notice autobiographique qu’il rédige en 1718, il serait né à Tournai aux environs de 1663.285 Embauché en Angleterre en 1685 comme « bass » parmi les musiciens de Jacques II jusqu’à la fuite du monarque en 1688, il ne fut pas reconduit dans ses fonctions par Guillaume II, mais continua de vivre à Londres comme musicien indépendant jusqu’en 1697.286 Il n’arriva donc pas à Dresde pour des raisons confessionnelles, comme on le supposait jusqu’à présent.287 En fait, la liste des personnes de l’opéra de Pologne dirigée par Deseschaliers fait apparaître parmi les « Damoiselles » : « Riche aînée, Mere & frere » ainsi que « Riche cadette » (voir Tableau 1.6). Le « frère » est certainement François Le Riche, qui n’avait apparemment pas encore de fonction définie dans la troupe, puisqu’il n’est pas compté dans la colonne de gauche et figure dans une section réservée aux femmes. À l’appui de cette hypothèse vient la datation extrêmement précise du musicien dans sa notice de 1718, où il affirme être entré au service le 11 décembre 1699, soit en même temps que le reste de la troupe d’opéra. Ceci est très logique : en janvier 1696, le maréchal de Boufflers autorisa l’opéra de Lille à permuter avec celui de Tournai, où une garnison payait un abonnement régulier à l’opéra qui devait lui permettre d’accumuler des recettes dont le tiers servirait à rembourser les dettes accumulées à Lille.288 C’est donc à Tournai que les Deseschaliers purent nouer contact avec la famille de François Le Riche. Celui-ci ne serait donc pas passé directement d’Angleterre en Saxe, mais serait retourné dans son pays natal après son départ d’Angleterre. Une fois arrivé à Varsovie avec la troupe de Deseschaliers, François Le Riche resta sur place quelques mois avant de retourner à Londres pour un concert d’adieu le 25 septembre 1700.289 La même année, il participe aux festivités pour le mariage de la princesse de Brandebourg, Luise Dorothea, avec le prince Friedrich von Hessen-Kassel à Berlin.290 Les autobiographies publiées par Telemann et Quantz mentionnent sa présence. Il semble être assez régulièrement à Berlin au 282 283 284 285 286 287 288 289
290
Marie Cornaz, Les Ducs d’Arenberg et la musique au xviiie siècle. Histoire d’une collection musicale, Turnhout 2010, p. 61. Je remercie Marie Cornaz d’avoir attiré mon attention sur ce recoupement. Cornaz, Les Ducs d’Arenberg, p. 63. Cornaz, Les Ducs d’Arenberg, p. 59. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 90 : « François le Riche Musicien de la chambre, entré au Service lan 1699 le 11 decembre, agé de 55 ans et né a Tournay. » L’année de sa naissance est confirmée dans une liste de personnel : HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 8, non folié. Andrew Ashbee et al., A Biographical Dictionary of English Court Musicians 1485-1714, Aldershot 1998, vol. 2, p. 699-701. Bruce Haynes, The Eloquent Oboe. A History of the Hautboy 1640-1760, Oxford 2001, p. 149. Lefebvre, Histoire du théâtre de Lille, p. 155. Ashbee, A Biographical Dictionary, p. 700 : « On 25 Sep. 1700 an interval entertainment at the Lincoln’s Inn Fields Theatre was advertised: ‘by the famous Mons. Li Rich, lately arrived from the Court of Poland: being the only and last time of performing the said entertainment, or any other, by reason of his sudden return to the said kingdom’. » Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 99.
– 66 –
L’Europe galante comme marché du travail
début des années 1700, car Telemann, qui se rappelle avoir visité la ville au même moment, évoque le hautboïste dans sa seconde autobiographie publiée en 1740 : Depuis Leipzig, j’ai vu Berlin deux fois ; je suis allé entendre l’opéra Polyphemo, de Giovanni Bononcini, et un autre (toutefois en cachette de mes amis, car l’entrée n’était permise qu’à un petit nombre de gens) où chantaient surtout des personnes bien nées, entre autres une margrave qui s’est ensuite mariée à Kassel, accompagnée par la reine Sophie Charlotte elle-même au clavier, et l’orchestre était en grande partie composé de maîtres de chapelle ou de maîtres des concerts, comme par exemple : Padre Attilio Ariosti ; les frères Antonio et Giovanni Bononcini ; l’Oberkapellmeister Rieck ; Rugiero Fedelo ; Volumier ; Conti ; La Riche ; Forstmeier, etc.291
François Le Riche figure d’ailleurs en première position dans la dédicace de la Kleine Cammermusic de Telemann publiée à Francfort en 1716, ce qui laisse supposer que Le Riche s’y trouvait pour l’exécution de plusieurs cantates festives en l’honneur de la naissance d’un fils de l’Empereur.292 Ce n’est donc pas une coïncidence si l’année suivante, en 1717, fut fondé au sein de la Hofkapelle de Dresde un nouvel ensemble qui portait pour nom la Kleine Cammer-Musique et comprenait entre autres instrumentistes Le Riche.293 À partir des années 1720, celui-ci remplit à Londres des fonctions situées à l’intersection de la diplomatie et du commerce de luxe, pour lesquelles il perçoit un salaire sans commune mesure avec celui des autres musiciens. Sa carrière est donc un très bel exemple de l’apparition progressive, pour un musicien relativement obscur qui avait toujours évolué dans un milieu de cour, d’une célébrité qui dépasse largement son milieu d’origine et son entourage direct et se trouve médiatisée par un dispositif complexe, incluant la presse, les dédicaces, et les récits autobiographiques de tierces personnes. Johann Ernst Galliard et l’Angleterre Le dernier cas d’étude que nous abordons, Johann Ernst Galliard (ca. 1680-1747) se distingue des deux précédents par le fait qu’il n’est pas né en France, mais à Celle comme en témoigne son prénom germanisé. Né de parents français (son père était perruquier à la cour), Galliard est donc un immigré de seconde génération. Ce n’est pas un cas isolé : William Babel est le fils de Charles Babel, né à Évreux et bassoniste à la cour de Celle. La carrière de William n’est d’ailleurs pas sans similarité avec celle de Galliard, puisqu'il passa la majeure partie de son existence en Hollande et en Angleterre. François Godefroy Beauregard, haute-contre employé par la cour de Dresde à partir de 1715, était né à Berlin de parents français : son père François Adam Beauregard était hautboïste à la Hofkapelle de Berlin. Enfin, Ernst August Jayme (ou Jemme) était le fils du maître à danser Élie Jemme, actif à Osnabrück dans les années 1660, et devint maître à danser à la cour de Wolfenbüttel où il rédigea un recueil de contredanses en 1717.294 Ces musiciens de deuxième génération effectuent souvent une carrière beaucoup plus internationale que celle de leurs parents, et leurs activités musicales se déployent généralement dans un environnement urbain cosmopolite, plus du tout dans les milieux de cour. De ce point de vue, l’union personnelle avec l’Angleterre en 1714 a joué en faveur des musiciens de la cour de Hanovre, puisque nombre d’entre eux sont
291
292 293 294
La seconde autobiographie de Georg Philipp Telemann est publiée par Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, Hambourg 1740, p. 359 : « Von Leipzig aus habe Berlin zweimahl gesehen; die Oper Polyphemo, von Giov. Bononcini, und eine andre (jedoch von meinen Freunden versteckt, weil nur wenigen der Eingang erlaubet war) angehöret, worin meistens hohe Personen, unter andern eine, hernach nach Cassel verheiratete Marckgräfinn, sangen, die Königin Sophia Charlotte aber selbst auf dem Clavier accompagnirten, und das Orchester grossen Theils mit Capell= und Concert=Meistern besetzet war, als nehmlich: Padre Attilio Ariosti; die Gebrüder Antonio und Giovanni Bononcini; der Oberkapellmeister Rieck; Rugiero Fedelo; Volümier; Conti; La Riche; Forstmeier etc. » Haynes, The Eloquent Oboe, p. 332-334. Ashbee, A Biographical Dictionary, p. 700. Pour la création en 1717 d’une chapelle polonaise, qui a pour fonction d’accompagner le prince en Pologne et s’appelle également Kleine Cammermusik pour la distinguer de l’ancienne Grosse Cammermusik, cf. Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 120. D-W, Cod. Guelf. 244.
– 67 –
Chapitre 1
partis à Londres où ils ont été mis au contact d’un marché musical particulièrement actif. Sur le plan musical, ils poursuivent l’évolution entamée par Buffardin : ils cultivent généralement un répertoire et un style très proches de la lingua franca musicale européenne qu’était alors en train de devenir le style galant. Ces différentes caractéristiques sont très bien illustrées par la biographie de Johann Ernst Galliard. Elle est documentée par deux textes contemporains : l’article que Johann Gottfried Walther lui consacre dans son Musicalisches Lexicon en 1732, et les remarques très fouillées que lui consacre quarante-cinq ans plus tard John Hawkins dans son histoire générale de la musique. D’après le lexique de Walther, Galliard aurait reçu sa formation musicale à Celle auprès de Pierre Maréchal, hautboïste à la cour entre 1683 et 1696 : Gaillard, le fils d’un perruquier français, né à Celle où il fut l’élève de Monsieur Marschall [Maréchal], alla en Angleterre comme musicien de chambre du prince Georges de Danemark, sur le hautbois, en qualité de quoi il resta au service de la reine Anne. De son œuvre ont été gravées il y a peu de temps 6 Sonates à 1 flûte et basse chez Roger.295
Ce point est confirmé par Hawkins.296 On peut penser que l’étude de la musique représentait une ascension sociale pour le fils d’un perruquier. Les registres paroissiaux précisent que Johann Ernst Galliard avait des origines bourguignonnes et qu’il épousa Gabrielle Pavie, originaire d’Artois, en 1696.297 Deux ans plus tard, Galliard est embauché à la cour de Celle avec un salaire identique à celui des autres musiciens.298 Il y reste jusqu’en 1705, au moment où la mort du duc de Celle Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg entraîne la dissolution de la Hofkapelle et le départ de la plupart des musiciens français. Galliard entre alors au service de Georges de Danemark (1653-1708) et de la reine Anne (1665-1714). Les réseaux dynastiques ont sûrement joué un rôle dans son départ pour l’Angleterre, car Georges de Danemark, prince consort de la reine Anne, était le neveu du duc de Celle par l’intermédiaire de sa mère, Sophie Amalie von Braunschweig-Calenberg. Galliard reçut en 1710 la nationalité britannique ainsi qu’un emploi fictif d’organiste à la Somerset House à Londres, inoccupée depuis le départ de la veuve de Charles II en 1685, et qui servait depuis comme résidence pour des artistes et musiciens au service de la couronne d’Angleterre.299 Galliard n’était pas seulement un hautboïste reconnu : d’après John Hawkins, il avait aussi étudié la composition auprès de Jean-Baptiste Farinel et d’Agostino Steffani à la cour Hanovre. Cette affirmation se fonde sur le catalogue imprimé de la « petite mais très-curieuse » collection de musique de Galliard, vendue aux enchères quelques mois après la mort du musicien : dans ce catalogue, le lot 65 rassemble comme les « premières leçons de composition de Monsieur Galliard sous la direction du Sig. Farinelli et de l’abbé Steffani, à l’âge de quinze ou seize ans, en 1702 ». Hawkins affirme en outre qu’un recueil manuscrit contenant de nombreuses compositions de Galliard transmet une sonate pour hautbois et deux bassons accompagnée d’une note autographe : « Jaÿ fait cet Air a Hannover, que Jaÿ Joué a la Serenade de Monsieur Farinelli ce 22me Juin, 1704.300 » 295
296
297
298 299
Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 270 : « Gaillard, eines Frantzösischen Perruquirers Sohn, aus Zelle gebürtig, und Scholar des Hrn. Marschalls daselbst, war in England beym Printz Georg von Dännemarck Cammer Musicus auf der Hautbois, in welcher qualité er auch bey der Königin Anna verblieben. Von seiner Arbeit sind vor weniger Zeit 6 Sonates à 1. Flûte & Basse bey Roger gravirt worden. » Sir John Hawkins, A General History of the Science and Practice of Music, Londres 1776, vol. 5, p. 187 : « John Ernst Galliard was the son of a perruquier, and a native of Zell; he was born in or about the year 1687, and received his instructions in the practice of musical composition from Farinelli, the director of the concerts at Hanover, and of Steffani, who was resident there in another capacity. » BAHild, KB Nr. 778, Traubuch 1667-1711, p. 132, 3 mai 1696 : « Ego idem conjunxi Matrimonio Joannem Galliard Burgundionem et Gabrielem Pavie Atrebatensem praesentibus Christiano Muly Candensi et Michaële Roger Andegavensi. » Cet acte de mariage suggère que Galliard pourrait être né en Bourgogne, car les registres mentionnent généralement le lieu de naissance des individus. NLAH, Hann. 76c A Nr. 223, p. 563. Roger Fiske et Richard G. King, « Galliard, John Ernst », in : Grove online. Ines Burde, « Galliard, John Ernst », in : MGG online.
– 68 –
L’Europe galante comme marché du travail
Le musicien français semble avoir rapidement maîtrisé la langue anglaise et devint bientôt une figure importante de la vie musicale londonienne. Il travailla comme hautboïste pour le Queen’s Theatre – où Händel composa pour lui des parties obligées particulièrement remarquables dans Teseo (1713) – ainsi qu’au Lincoln’s Inn Fields (1717-1730) et à Covent Garden (17321761) où il composa des opéras anglais et des pantomimes. Son œuvre prolifique, qui touche tous les genres de la musique instrumentale et de l’opéra en passant par la cantate, est conservée dans plusieurs sources musicales. Tout en écrivant beaucoup pour le théâtre et les divertissements de la famille royale, Galliard semble avoir eu une inclination particulière pour la théorie de la musique et le contrepoint savant. Il figure également parmi les membres fondateurs de l’Academy of Ancient Music en 1726 ainsi que de la Royal Society of Musicians en 1738. Son excellente maîtrise du français, de l’italien et de l’anglais est notée par Hawkins, qui repère cependant des impropriétés de langage lui permettant d’attribuer plusieurs ouvrages à Galliard.301 Ainsi est-ce certainement Galliard qui traduisit en anglais le traité sur le chant de Pier Francesco Tosi (ca. 1653-1732) paru à Bologne en 1723, le Parallèle des Italiens et des Français en ce qui regarde la musique et les opéras de François Raguenet, auquel il ajouta un essai sur l’opéra en Angleterre.302 Hawkins mentionne une collection d’énigmes canoniques de Byrd, copiées et résolues par Galliard dans un manuscrit provenant de la bibliothèque de Pepusch, et alors en sa possession.303 Même s’il porte un jugement pour le moins réservé sur les compositions de Galliard, Charles Burney souligne pour sa part que l’Hymne d’Adam et Eve, composé sur un texte de Milton et publié en 1728, est « extrêmement bien écrit dans le style grave et savant de son maître Steffani.304 » Observons enfin pour compléter ces 300
301
302
303 304
Sir John Hawkins, A General History, vol. 5, p. 187 : « See the printed catalogue of his music, in which, lot 65 of the manuscripts, is thus described : ‘Mr. Galliard’s first lessons for composition under the tuition of Sig. Farinelli and Abbate Steffani, at the age of 15 or 16, in 1702’ ; and in a manuscript collection of many of his compositions is a Sonata for a hautboy and two bassoons, with this note in his own hand-writing, ‘Jaÿ fait cet Air a Hannover, que Jaÿ Joué a la Serenade de Monsieur Farinelli ce 22me Juin, 1704’. » Le catalogue imprimé auquel il est fait référence ici est sans doute le catalogue de vente aux enchères de la bibliothèque musicale de Galliard chez Prestage en 1749, cf. p. 190: « Mr. Galliard died in the beginning of the year 1749, leaving behind him a small but very curious collection of music, containing, among other things, a great number of scores of valuable compositions in his own hand-writing, which has been inspected for the purpose of compiling this article [...]. This collection, together with his instruments, was sold by auction at Mr. Prestage’s, a few months after his decease. » Hawkins, A General History, vol. 5, p. 189: « Mr. Galliard led a retired and studious life, and had little intercourse with the musical world. » Sur la même page, en note: « Mr. Galliard, though a foreigner, had attained to such a degree of proficiency in the English language, as to be able to write it correctly ; but he was not enough acquainted with the niceties of it to know that we have no term that answers to the appellative Canto figurato, and consequently that that of the florid song could convey to an Englishman scarce any other idea than of the song of a bird, the nightingale for instance, and it happened accordingly that upon the publication of his translation men wondered what was meant by the term. Mr. Galliard has illustrated his author by notes of his own, which are curious and entertaining; and it is upon the use of certain phrases and peculiar modes of expression, common to the translation of the Abbé Raguenet’s Parallel, published in 1709, with the title of ‘A comparison between the French and Italian Musick and Operas, with Remarks’, and this of Tosi’s book, that we found a conjecture that Mr. Galliard was the translator of both, and also the author of ‘A Critical Discourse upon Operas in England, and a means proposed for their improvement’, printed at the end of the translation of the Parallel. » Pietro Francesco Tosi, Observations on the Florid Song. Or, sentiments on the Ancient and Modern Singers, trad. Johann Ernst Galliard, Londres 1743. Johann Ernst Galliard, A Comparison Between the French and Italian Musick and Opera’s. Translated from the French. To which is added A Critical Discourse upon Opera’s in England, and a Means proposed for their Improvement, Londres 1709. Sur cet ouvrage, cf. Stoddard Lincoln, « J. E. Galliard and ‘A Critical Discourse’ », The Musical Quarterly, 53/3, 1967, p. 347-364. Hawkins, A General History, vol. 2, p. 371 et 383. Charles Burney, A General History of Music, from the Earliest Ages to the Present Period, Londres 1789, vol. 4, p. 639 : « In 1728, he published, by subscription, his Music to the Hymn of Adam and Eve from Milton. This is extremely well set in the grave and learned style of his master Steffani. The recitative is still in the more ancient style of Italy, in which there are formal closes, terminated with a shake, instead of the more colloquial cadence of modern recitation. » Burney ajoute toutefois plus loin, p. 640 : « This worthy musician, who died in 1749, was certainly an excellent contrapuntist; but with respect to his compositions in general, I must say, that I never saw more correctness or less originality in any author that I have examined, of the present century, Dr. Pepusch always excepted. »
– 69 –
Chapitre 1
remarques que Galliard discute de façon très savante un motet de Steffani donné à l’Academy of Ancient Music dans une lettre de juillet 1727 adressée depuis Londres à Giuseppe Riva, ambassadeur de Modène à Londres entre 1715 et 1729.305 Comme dans le cas de Buffardin, Galliard est donc l’objet d’une célébrité émergente. Au-delà du milieu de la cour dans lequel il commença sa carrière, il devient rapidement une figure importante de la vie musicale londonienne, s’engageant et se produisant dans des institutions publiques, publiant des ouvrages théorique et devenant luimême l’objet d’un discours public.
305
Colin Timms, « Music and Musicians in the Letters of Giuseppe Riva to Agostino Steffani (1720-1727) », Music and Letters, 79/1, 1998, p. 43-45.
– 70 –
Chapitre 2. Administrer la musique française •
En 1739, le roi Friedrich II de Prusse donna une explication restée célèbre sur la faiblesse structurelle des principautés d’Empire, et sur le peu de ressources qu’elles étaient en mesure de consacrer aux dépenses militaires : En voici les raisons : la plupart des petits princes, et nommément ceux d’Allemagne, se ruinent par la dépense, excessive à proportion de leurs revenus, que leur fait faire l’ivresse de leur vaine grandeur ; ils s’abîment pour soutenir l’honneur de leur maison, et ils prennent par vanité le chemin de la misère et de l’hôpital ; il n’y a pas jusqu’au cadet du cadet d’une ligne apanagée qui ne s’imagine d’être quelque chose de semblable à Louis XIV : il bâtit son Versailles, il baise sa Maintenon, il entretient ses armées.1
Ce portrait à charge – manifestement écrit sous l’influence de Voltaire qui venait pour sa part de publier les deux premiers chapitres de son Siècle de Louis XIV dans lesquels il exposait sous la forme d’un ballon d’essai son manifeste historiographique – fournit l’expression peut-être la plus condensée de ce que certains historiens ont baptisé « l’Europe française » : une foule de principautés liliputiennes, au premier rang desquelles les États impériaux, voulant imiter dans leurs territoires le style de gouvernement hautement centralisé et personnalisé élaboré dans la France du xviie siècle et exemplifié par Louis XIV, s’appropriant dans le même mouvement la culture française pour étancher leur soif démesurée de grandeur symbolique. Au-delà de sa portée polémique initiale, ou précisément à cause d’elle, cette vision souffre de deux déficits majeurs : une conception grossière et anachronique de l’absolutisme conduisant à une focalisation excessive sur la personnalité de Louis XIV, et une perception simpliste des mécanismes d’échanges culturels, ramenés à un simple rayonnement en cascade dont la France serait le centre et le sommet. Dès les années 1990, Volker Bauer formulait le souhait de dépasser « le préjugé commun selon lequel les princes allemands auraient imité la cour et le style de vie de Louis XIV, méritant ainsi d’être considérés comme autant d’éditions miniatures, plus ou moins ridicules, du Roi Soleil.2 » Le mythe historiographique de « l’Europe française », échaffaudé à la fin des années 1730 par un Voltaire volontiers fasciné par le Grand Siècle, est fondé sur l’idée d’une hégémonie culturelle française à laquelle l’Europe aurait servi de simple caisse de résonance.3 Il a été largement 1 2
3
Friedrich II, Réfutation du prince de Machiavel, in : Œuvres de Frédéric le Grand, éd. Johann Preuss, vol. 8, Berlin 1848, p. 234. Volker Bauer, Die höfische Gesellschaft in Deutschland von der Mitte des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Versuch einer Typologie, Tübingen 1993, p. 39 : « Es erscheint damit angezeigt, die weitverbreitete Vorstellung zu überprüfen, die deutschen Fürsten hätten Hof und Lebensstil Ludwigs XIV. imitiert und seien damit als mehr oder minder lächerliche Miniaturausgaben des Sonnenkönigs einzuschätzen. » Voltaire, Siècle de Louis XIV, vol. 3, éd. Diego Venturino, in : Les Œuvres complètes de Voltaire, vol. 13a, Oxford 2015, p. 3-4 : « il est vrai de dire, qu’à commencer depuis les dernières années du cardinal de Richelieu, jusqu’à celles qui ont suivi la mort de Louis XIV, il s’est fait dans nos arts, dans nos esprits, dans nos mœurs, comme dans notre gouvernement, une révolution générale qui doit servir de marque éternelle à la véritable gloire de notre patrie. Cette heureuse influence ne s’est pas même arrêtée en France ; elle s’est étendue en Angleterre ; elle a excité l’émulation dont avait alors besoin cette nation spirituelle et hardie ; elle a porté le goût en Alle-
– 71 –
Chapitre 2
remis en question au cours des vingt dernières années par une abondante production historiographique, qui critiquait en particulier sa résurgence sous la plume de Marc Fumaroli.4 Pierre-Yves Beaurepaire affirme ainsi que la « problématique dépassée des “influences françaises”, régulièrement entretenue par les nostalgiques européens du goût et des mœurs – qui dénoncent d’une même voix le déclin intellectuel et moral de la France contemporaine – dont Paris aurait été la capitale incontestée, cache mal la pluralité des circulations et des échanges.5 » Rahul Markovits, dans ses travaux sur la circulation du théâtre français dans l’Europe du xviiie siècle, fait apparaître la notion même d’Europe française comme un « objet historiographique piégé.6 » Parallèlement au modèle de l’Europe française, focalisé sur la pratique de la langue et de la littérature française dans l’Europe des Lumières, le paradigme de l’absolutisme exerce toujours une grande influence sur notre vision de la circulation de la musique et des musiciens français dans les territoires germaniques. Souvent décrit comme la manifestation d’un Zeitgeist absolutiste et d’un désir irrépressible d’imiter la cour de France, le patronage de musique française est parfois compris – à l’instar de la construction de palais et de jardins empruntant leur grammaire stylistique à des réalisations françaises – comme une volonté de s’inscrire dans l’Europe absolutiste, variante politique de l’Europe française. L’histoire politique a cependant soumis le concept même d’absolutisme à un profond examen critique, à travers la mise en lumière du rôle joué par les institutions d’Ancien Régime dans la préservation d’un équilibre des pouvoirs, dans la limitation des prérogatives royales, ainsi que la négociation permanente entre le pouvoir royal central et des pouvoirs concurrents ou locaux.7 Les aspects les plus caricaturaux de la notion d’absolutisme ont ainsi été fortement nuancés, et l’usage de cette notion comme étiquette commode désignant la pensée et la pratique politique d’une époque a finalement été « déconstruit de manière non-reconstructible ».8 Dans le champ de l’histoire des cours, Jeroen Duindam a très bien montré, à partir d’une discussion fouillée de l’héritage historiographique de Norbert Elias, les dangers du paradigme absolutiste pour les disciplines voisines de l’histoire culturelle : une focalisation excessive sur l’étude de rituels, de cérémonies et de manifestations d’un pouvoir plus souvent postulé de manière abstraite que clairement défini ou envisagé dans ses rouages concrets et ses routines quotidiennes.9 La musicologie
4 5 6 7
8 9
magne, les sciences en Russie ; elle a même ranimé l’Italie qui languissait, et l’Europe a dû sa politesse et l’esprit de société à la cour de Louis XIV. » Sur les enjeux politiques et les ambiguïtés de l’écriture de l’histoire chez Voltaire, cf. Olivier Ferret, « D’une politique de Voltaire à une pensée du politique », in : Les Lumières radicales et le politique. Études critiques sur les travaux de Jonathan Israel, dir. Marta Garcià-Alonso, Paris 2017, p. 195-228. Marc Fumaroli, Quand l’Europe parlait français, Paris 2001. Pierre-Yves Beaurepaire, Le Mythe de l’Europe française au xviiie siècle. Diplomatie, culture et sociabilités au temps des Lumières, Paris 2007, p. 7. Markovits, Civiliser l’Europe, p. 18. Voir notamment Fanny Cosandey et Robert Descimon, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris 2002 ; Lothar Schilling, « Vom Nutzen und Nachteil eines Mythos », in : Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept ? Eine deutsch-französische Bilanz, dir. Lothar Schilling, Munich 2008, p. 13-31. Sur la genèse de l’absolutisme, voir Arlette Jouanna, Le Pouvoir absolu : naissance de l’imaginaire politique de la royauté, Paris 2013. Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, Munich 1999, p. 42. Jeroen Duindam, Vienna and Versailles. The courts of Europe’s dynastic rivals 1550-1780, Cambridge 2003, p. 9-10 : « Elias’ perplexing melange of grand theory, lucidly formulated analysis, and rather limited research gave rise to a tradition of aulic history with a strong partiality for conceptual ornament and eclectic discourse. The ‘role’ of the court in ‘absolutism’ and the ‘meaning’ of ceremony were deemed more worthy of scholarly attention than the concrete forms of ceremony or the daily routines of the court. Anthropological perspectives, of great relevance for the reassessment of courts in the European past, added emphasis to the notion of ‘ritual’ and, in an unfortunate conjunction with the post-modern stress on ‘deconstruction’ and rhetoric, strengthened the inclination to wrestle with concepts rather than with concrete data. Moreover, aulic history emerged as a specialised domain with a strong cultural bias, demonstrated by the presence of authors from related disciplines such as the history of art, music, theatre, architecture, and language. While the impetus from these disciplines was and remains indispensable, the dominant cultural bias complicated the communication with the field of political history. »
– 72 –
Administrer la musique française
a aussi beaucoup à gagner à abandonner l’idée d’une « propagande royale » – la musique étant peu ou prou ramenée à la poursuite de la guerre par d’autres moyens – qui repose en dernière instance sur l’hypothèse d’une « manipulation de la culture10 » par le pouvoir. Pour échapper à ce double écueil de « l’Europe française » et de « l’âge de l’absolutisme », sans pour autant renoncer à rendre compte des significations politiques et culturelles attachées au patronage de musique française, nous optons dans ce chapitre pour une stratégie en deux temps. Il s’agira d’abord d’interroger les identités aristocratiques des mécènes allemands de musique française au prisme de leurs options politiques, intellectuelles et culturelles, en faisant apparaître l’association étroite entre le patronage de musique française et la négociation de nouvelles identités aristocratiques parmi la noblesse d’Empire vers 1660. Ce faisant, nous nous concentrons sur la dimension culturelle et anthropologique du phénomène en nous inspirant librement (sans méconnaître les débats auxquels ils ont donné lieu) des travaux de Jonathan Israel sur les Lumières radicales et des travaux d’Alain Viala sur la galanterie.11 Les principaux patrons de musique française se distinguent en effet par quelques options singulières : un éloignement vis-à-vis de l’orthodoxie luthérienne confinant parfois à l’athéisme, un habitus aristocratique rationaliste et galant, et une attitude libérale sur le plan des mœurs. L’embauche de musiciens français et plus généralement le goût pour le théâtre et la musique française apparaissent dans cette perspective comme une manière de marquer sa proximité avec une culture française nullement réduite aux fastes de Versailles, mais bien davantage vécue à l’aune de la galanterie, du cartésianisme, du bon goût et de la liberté des mœurs. Dès le milieu des années 1720 cependant, ces valeurs sont profondément remises en question, et l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle génération de mécènes provoque un fort déclin du patronage de musique française qui confirme rétrospectivement son association avec les valeurs de la galanterie. Nous examinerons ensuite, à partir du labeur quotidien de l’administration, les logiques institutionnelles et comptables qui ont encadré l’installation de musiciens français dans les Hofkapellen allemandes. Prenant ici pour source d’inspiration les travaux de Pauline LemaigreGaffier sur l’administration des Menus Plaisirs12, une déambulation à travers le corpus documentaire produit par les administrations curiales permettra de montrer que la musique française émerge d’abord comme réalité administrative avant de devenir une catégorie stylistique : la gouvernance et l’administration des « musiciens français » précède et accompagne la formulation d’une théorie de la musique française tout en contribuant de manière décisive à l’élaboration d’une dichotomie entre musique italienne et musique française ainsi qu’à l’apparition des goûts réunis. Des phénomènes en apparence très triviaux mais décisifs seront au centre de l’attention : le prix de la musique française, les négociations entre les souverains et leur administration, les procédures de recrutement des musiciens français, les cadres institutionnels dans lesquels ils évoluent et les procédures d’administration de la musique française. C’est donc un véritable art de gouverner la musique qui apparaîtra peu à peu au fil de ces pages.
Mécénat musical et identités aristocratiques Après avoir parcouru l’Europe musicale dans toute son extension entre 1650 et 1750 en déroulant le fil de réseaux dynastiques, diplomatiques et artistiques, nous allons à présent nous arrêter sur 10 11
12
Pauline Lemaigre-Gaffier, Administrer les Menus Plaisirs du Roi. La Cour, l’État et les spectacles dans la France des Lumières, Ceyzérieu 2016, p. 11. Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford 2001. Jonathan I. Israel, Les Lumières radicales. La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité, 1650-1750, Paris 2010. Pour une lecture critique des thèses d’Israel, voir Antoine Lilti, « Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des Lumières ? », Annales. Histoire, sciences sociales, 64, 2009, p. 171-206. Pour une perspective centrée sur l’Allemagne, voir The Radical Enlightenment in Germany. A Cultural Perspective, dir. Carl Niekerk, Leiden 2018. Viala, La France galante. Lemaigre-Gaffier, Administrer les Menus Plaisirs du Roi.
– 73 –
Chapitre 2
Illustration 2.1. Carte politique simplifiée de l'Allemagne du Nord vers 1660.
les deux principales régions qui accueillirent des ensembles musicaux français permanents entre 1660 et 1730 : la Basse-Saxe et la Saxe. L’ancien cercle de Basse-Saxe, réunion informelle de plusieurs duchés et principautés d’Empire, englobait alors tout le Nord de l’Allemagne actuelle. Au sein de ce vaste ensemble administratif et géographique se trouvait le duché de BraunschweigLüneburg dont les frontières internes fluctuèrent beaucoup au gré des conflits armés et des règlements de succession tout au long du xviie siècle.13 En effet, la dynastie des Guelfes ne suivait pas le principe de primogéniture mais répartissait les possessions territoriales entre ses différents héritiers mâles. À partir de 1665, le duché de Braunschweig-Lüneburg était donc divisé en trois sous-principautés, chacune habituellement désignée par le nom de sa résidence : la principauté de Braunschweig-Calenberg (qui avait son siège à Hanovre) était communément appelée le duché de Hanovre, celle de Braunschweig-Lüneburg le duché de Celle, celle de BraunschweigWolfenbüttel le duché de Wolfenbüttel. Dans notre perspective, les frontières de l’actuel Land de Basse-Saxe délimitent un territoire commode de taille intermédiaire, qui englobe non seulement les trois principautés tout juste évoquées mais également le duché d’Osnabrück (Illustration 2.1). Aucun des ducs de Braunschweig n’avait la dignité électorale, contrairement au prince-électeur de Saxe qui participait à l’élection de l’Empereur et possèdait depuis 1356 l’une des dignités impériales les plus élevées, puisqu’il était Erzmarschall de l’Empire. Territoire politique unifié depuis la fin du xive siècle dont la ville de Dresde formait l’unique résidence et capitale, la Saxe n’était pas seulement un poids lourd politique, mais elle était aussi dotée d’atouts économiques importants, dont les principaux moteurs étaient les mines d’argent situées dans le massif des Erzgebirge près de Freiberg, et la vitalité commerciale de Leipzig. Très différentes par leur histoire, leurs frontières et leur poids politique, ces deux régions accueillirent cependant des musiciens français en nombre important. Elles partageaient également un destin politique commun, puisqu’elles faisaient partie des principaux territoires de l’Empire à la fin du xviie siècle. Les États impériaux entre le Roi et l’Empereur Les États impériaux jouissent historiquement d’un haut degré d’autonomie politique et institutionnelle par rapport à l’Empereur, qu’ils élisent formellement mais auxquels ils sont soumis 13
Wilhelm Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, vol. 3, Göttingen 1857, p. 200-283.
– 74 –
Administrer la musique française
constitutionnellement.14 C’est cette ambiguïté fondamentale qui était traditionnellement exploitée par la politique impériale de la France depuis la paix de Westphalie : en contractant des traités bilatéraux avec les États impériaux (Reichsstände), la France se posait comme garante de leur indépendance face aux tentations hégémoniques de Vienne, tout en se donnant les moyens d’influencer par ce biais les équilibres politiques internes de l’Empire. En réalité, cette politique tendait à surestimer l’antagonisme entre Reich et Reichsstände, autrement dit à sous-estimer la loyauté des États impériaux vis-à-vis de l’Empereur, et produisit de ce fait des résultats très limités.15 Cependant, quelques princes menèrent une politique résolument pro-française et basculèrent de façon très nette dans l’orbite de la France. Le prototype du prince allemand francophile est représenté par le duc Christian Louis I de Mecklengurg-Schwerin (1623-1692). Après avoir hérité de la principauté de Schwerin en 1658, il se convertit au catholicisme en 1663, reçut Louis XIV comme parrain, et épousa en secondes noces la Française Élisabeth Angélique de Montmorency. Il mit en place une politique militaire et diplomatique entièrement favorable à la France qui affaiblit considérablement sa position dans l’Empire.16 Il passait en outre le plus clair de son temps en France, en Italie ou en Angleterre, ne séjournant que six ans dans sa résidence sur trente-quatre années de règne.17 Dans ce contexte, l’engagement de deux bandes de violons français à Schwerin peut être lu comme le résultat d’une grande proximité politique et culturelle avec la France.18 Mais cette explication ne saurait valoir pour son cousin Gustav Adolph de Mecklenburg-Güstrow (1633-1695), qui régnait sur le territoire voisin et engagea également de nombreux musiciens français au sein de la Hofkapelle de Güstrow. Celui-ci se distinguait en effet par sa diplomatie plutôt hostile à la France, motivée par un luthéranisme strict et un engagement résolu aux côtés des grandes puissance protestantes, notamment la Suède et le Danemark.19 Gustav Adolph cultivait en revanche des intérêts intellectuels très éclectiques : il avait étudié la théologie et la philosophie à Leiden et Strasbourg et était membre de la Fruchtbringende Gesellschaft, une société de lettres au sein de laquelle il déploya une activité d’écrivain. Il incarne un type de souverain éclairé et réformateur, qui introduisit dans son territoire un système scolaire de pointe et une administration renforcée, mais combattit aussi avec vigueur la sorcellerie et des pratiques religieuses jugées superstitieuses.20 Ces deux exemples montrent très bien la complexité des enjeux soulevés par le mécénat de musique française. Si l’adoption par les princes allemands d’éléments français dans le cérémonial, l’architecture ou la musique peut venir souligner leur ambition d’émancipation symbolique par rapport à l’Empereur, voire leur proximité diplomatique avec la France, elle peut tout aussi bien être le résultat d’une culture strictement personnelle. Le modèle musical français a de ce fait – et de façon paradoxale – été d’abord cultivé par des cours luthériennes de taille intermédiaire, surtout marquées par la culture de la littérature et des sciences, souhaitant mettre à distance le modèle catholique de Vienne : c’est ce que Volker Bauer nomme le type de la cour des muses (« Musenhof »).21 14 15 16 17 18 19 20 21
Pour un aperçu général sur la constitution du Saint Empire, voir Barbara Stollberg-Rilinger, Das Heilige römische Reich deutscher Nation vom Ende des Mittelalters bis 1806, Munich 2009. Sur la politique allemande de la France sous Louis XIV, voir Guido Braun, Von der politischen zur kulturellen Hegemonie Frankreichs 1648-1789, Darmstadt 2008, p. 33-35. Sebastian Joost, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht. Auswärtige Politik als Mittel zur Durchsetzung landesherrlicher Macht in Mecklenburg (1648-1695), Berlin 2009, p. 106-125. Joost, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, p. 57-75. Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, p. 30-31. Joost, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, p. 127-140. Steffen Stuth, Höfe und Residenzen. Untersuchungen zu den Höfen der Herzöge von Mecklenburg im 16. und 17. Jahrhundert, Brême 2001, p. 230-267. Katrin Moeller, Dass Willkür über Recht ginge. Hexenverfolgung in Mecklenburg im 16. und 17. Jahrhundert, Bielefeld 2007, p. 134-159. Bauer, Die höfische Gesellschaft in Deutschland, p. 76-77 : « Die auffällige Tatsache, daß auch dieser Typ [Musenhof] fast ausschließlich in lutherischen Territorien zu finden ist, mag – folgt man Trevor-Roper – darauf zurückzuführen sein, daß die katholischen Höfe des Barockzeitalters eher zur Förderung der ‘sinnlicheren’ bildenden Künste tendierten, während die protestantischen eher wissenschaftlich-literarische Ziele verfolgten. »
– 75 –
Chapitre 2
Cette volonté d’émancipation par rapport à Vienne produisit d’ailleurs des résultats spectaculaires sur le plan politique : deux centres de musique française dans l’Empire, la cour de Dresde et la cour de Hanovre, formèrent à vingt ans d’intervalle des unions personnelles avec la Pologne et l’Angleterre, acquérant de fait une place parmi les premières puissances européennes et un poids politique qui allait bien au-delà de celui normalement échu aux États impériaux. Auguste le Fort et Sophie de Hanovre, les deux mécènes les plus marquants et les plus engagés de musique française, devenaient ainsi des personnalités politiques de premier plan, le premier accédant au trône de Pologne et la seconde négociant l’accession de son fils au trône d’Angleterre.22 Musique et équilibres géopolitiques en Basse-Saxe La concentration de mécènes de musique française fut particulièrement importante dans le duché de Braunschweig-Lüneburg : par un effet de génération remarquable, trois des cinq enfants du duc Georg von Braunschweig-Lüneburg (1582-1641) financèrent des ensembles de théâtre ou de musique française (Tableau 2.1). Mais ils entretenaient entre eux et avec la France des relations fluctuantes et complexes. Pour pouvoir rompre ses fiançailles avec Sophie von der Pfalz sans provoquer d’éclat diplomatique, Georg Wilhelm avait renoncé en 1656 à son héritage au profit de son petit frère Ernst August, qui avait accepté en échange d’épouser cette dernière : Georg Wilhelm ne devait ni se marier ni avoir d’enfant, et ses territoires devaient revenir à Ernst August ou aux héritiers de ce dernier. Exclu de cet arrangement, Johann Friedrich voyait ses propres espérances se réduire comme peau de chagrin. Pour faire bonne mesure, il obtint le duché de Hanovre lorsque Georg Wilhelm succéda à son frère Christian Ludwig comme duc de Celle en 1665. Mais ce fragile équilibre fut rompu lorsque Georg Wilhelm, en dépit de ses engagements, prit chez lui à Celle sa maîtresse Éléonore Desmiers d’Olbreuse, qu’il n’épousa qu’en août 1676 après que l’Empereur eut conféré à celle-ci le titre de comtesse d’Harbourg. Ce n’est que trois ans plus tard, à la mort sans héritier de Johann Friedrich en 1679, qu’Ernst August, jusqu’alors simple évêque d’Osnabrück, prit possession du duché de Hanovre qui connut une ascension spectaculaire. Son fils épousa en 1682 la fille unique de Georg Wilhelm, assurant ainsi la réunion future des deux duchés de Celle et de Hanovre. En 1692, Ernst August obtint la dignité électorale, et le duché de Hanovre devint une principauté d’Empire de plein droit (« Kurfürstentum ») au même titre que la Saxe. En 1714, le fils d’Ernst August devint roi d’Angleterre sous le nom de George Ier et incarna l’union entre le duché de Hanovre et la couronne d’Angleterre qui devait durer jusqu’à la reine Victoria. Les différents territoires de Basse-Saxe entretenaient des relations contrastées avec la France. Johann Friedrich, duc de Hanovre de 1666 à 1679, mena une politique extérieure délibérément pro-française qui le mit parfois en difficulté vis-à-vis de l’Empereur. Il avait épousé en 1668 Benedicta Henriette von der Pfalz (1652-1730), fille du prince Eduard von der Pfalz et d’Anne de Gonzague. Benedicta Henriette avait donc été élevée à Paris, où elle se retira quelques mois après la mort de Johann Friedrich. Ce mariage contribua à renforcer considérablement les liens politiques de Hanovre avec la couronne de France, ainsi que l’affirmation de son indépendance vis-à-vis de l’Empereur.23 L’armée de quinze mille hommes mise sur pied par Johann Friedrich était financée en grande partie par des subsides militaires versés par la France, en vertu d’un accord passé entre Johann Friedrich et Louis XIV le 10 décembre 1672, au début de la guerre de Hollande. L’armée de Hanovre devait tenir ses hommes à la disposition du Roi Très Chrétien et bien sûr ne pas prendre part à des actions militaires hostiles à la France. Le chef d’État-major Heinrich von Podewils avait fait un séjour en France et introduisit plusieurs pratiques françaises dans la gestion de l’armée de Hanovre.24 Jusqu’à sa mort en 1679, la politique étrangère de Johann Friedrich resta donc toujours très proche des intérêts de la France. 22 23 24
Pour une pespective comparative sur ces deux unions, cf. Die Personalunionen von Sachsen-Polen 1697-1763 und Hannover-England 1714-1837. Ein Vergleich, dir. Rex Rexheuser, Wiesbaden 2005. Georg Schnath, Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und der englischen Sukzession, vol. 1, Leipzig 1938, p. 22. Schnath, Geschichte Hannovers, vol. 1, p. 43.
– 76 –
Administrer la musique française
Tableau 2.1 : Descendants de Georg von Calenberg. En rouge figurent les mécènes de musique française. Georg von Calenberg (1582-1641) Herzog von Braunschweig und Lüneburg Christian Ludwig (1622-1665) 1641-1648 à Hanovre dès 1648 à Celle Benedicta Henriette von der Pfalz (1652-1730) Sophie von der Pfalz (1630-1714)
Johann Friedrich (1625-1679) dès 1665 Duc de Hanovre Ernst August (1629-1698) dès 1662 Évêque Osnabrück dès 1679 Duc de Hanovre
Georg Wilhelm (1624-1705) 1648-1665 Duc de Hanovre dès 1665 Duc de Celle
Éléonore Desmiers d’Olbreuse (1639-1722)
Sophia Amalia (1628-1685) dès 1643 Reine de Danemark
Frederik III de Danemark (1609-1670)
Contrairement à Hanovre, le duché de Celle et l’évêché d’Osnabrück entretinrent avec la France une relation assez contrastée, non dénuée de contradictions, reposant sur une grande proximité culturelle mais une certaine ambivalence géopolitique.25 La présence de nombreux Français huguenots occupant de hautes fonctions administatives et militaires faisait du duché de Celle une cible diplomatique de premier choix pour la France.26 Réciproquement, une bonne intelligence avec la France pouvait être pour Georg Wilhelm un moyen de monnayer ses services militaires à l’Empereur, et un puissant levier pour maximiser leurs rendements sur le plan politique en faisant jouer la concurrence. Cependant, le tournant expansionniste pris en 1667 par la politique étrangère de Louis XIV avec la guerre de Dévolution ébranla de façon durable la confiance des Reichsstände dans la protection de la France. C’est pour cette raison que la Ligue du Rhin, qui rassemblait entre autres alliés traditionnels de la France les ducs de Brauschweig, fut dissoute en 1668. Ce qu’on appelle parfois la « seconde guerre de Trente Ans » – et qui est en fait la succession de trois guerres : la guerre de Dévolution (1667-1668), la guerre de Hollande (1672-1678) et la guerre de la Ligue d’Augsburg (1688-1697) – continua de marquer un déclin progressif de l’influence politique française dans les affaires de l’Empire : les deux ravages du Palatinat sont un excellent exemple du scandale européen causé par la politique d’expansion territoriale de Louis XIV.27 Dès 1665, au début de la guerre de Dévolution, Georg Wilhelm et Ernst August mirent leurs armées au service de la Hollande contre la France.28 Entre 1667 et 1668, Louis XIV dut donc accréditer plusieurs envoyés pour négocier avec eux le traité d’Aix-la-Chapelle : Raymond Balthazar Phélypeaux puis Jean Hérault de Gourville furent envoyés à Celle, Louis de Verjus à Osnabrück.29 Cet engagement militaire contre la France fut réactivé pendant la guerre de Hollande, où les deux 25
26
27 28 29
Mercure galant, mars 1679, p. 160-161 : « Vous sçavez sans doute que Mr le Duc d’Hanover [Johann Friedrich] est un Prince de la Maison de Brunswich & Lunebourg, & qu’il a toûjours esté dans les intérests de Sa Majesté pendant nos dernieres guerres, malgré les engagemens contraires des autres Princes de Sa Maison, c’est-à-dire de Mr le Duc de Zell [Georg Wilhelm] son Frere aisné, & de Mr l’Evesque d’Osnabruch [Ernst August] son cadet, qui ont fait depuis peu leur accommodement avec le Roy. Ce sont des Princes d’un fort grand mérite, & qui soûtiennent la dignité de leur rang avec tout l’éclat que demande leur naissance. » Andreas Flick, « ‘Der Celler Hof, so sagt man, ist ganz französisch.’ Hugenotten am Hof und beim Militär Herzog Georg Wilhelms von Braunschweig-Lüneburg », Celler Chronik, 12, 2005, p. 65-98. « ‘Der Celler Hof ist ganz verfranzt.’ Hugenotten und französische Katholiken am Hof und beim Militär Herzog Georg Wilhelms von Braunschweig-Lüneburg », Hugenotten, 72/3, 2008, p. 87-120. Émilie Dosquet, « ‘Tout est permis dans la Guerre, mais tout ce qui est permis ne se doit pas faire’ : la ‘désolation du Palatinat’ à l’épreuve du droit de la guerre », in : Les dernières guerres de Louis XIV, 1688-1715, dir. Hervé Drévillon, Bertrand Fonck et Jean-Philippe Cénat, Rennes 2017, p. 229-252. Charles-Prosper-Mérimée Horric de Beaucaire, Une mésalliance dans la maison de Brunswick (1665-1725). Éléonore Desmier d’Olbreuse duchesse de Zell, Paris 1884, p. 59-76. Charles Frostin, Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseaux d' influence sous l'Ancien Régime, Rennes 2006, p. 15-67. Beaucaire, Une mésalliance, p. 59-60. Les négociations de Verjus donnèrent lieu à la
– 77 –
Chapitre 2
frères furent des acteurs militaires de premier plan aux côtés de l’Empereur. En 1675, ils remportèrent une victoire à Consarbrück contre le maréchal de Créquy, et le duc de Celle mit son armée au service du prince de Brandebourg contre la Suède, alliée de la France. Ceci posait la question de la loyauté des officiers huguenots, nombreux parmi les cadres supérieurs de l’armée de Celle. La prise de Stralsund par le Brandebourg fut accomplie avec le soutien de 8000 hommes des contingents de Celle, sous le commandement du général Chauvet, d’origine française.30 Entre 1668 et 1679, les ducs de Braunschweig furent des interlocteurs incontournables dans les négociations et les affrontements armés qui précédèrent la paix de Nimègues.31 En 1679, au moment des négociations de la paix de Nimègues, les duchés de Celle et de Hanovre signèrent une paix séparée avec la France et la Suède, inaugurant un réchauffement diplomatique. C’est à la suite d’un conflit avec l’Empereur, qui lui reprochait la prise de Brême, que Georg Wilhelm conclut ce traité de paix séparé. Le maréchal d’Estrades, ambassadeur au congrès de Nimègues et parent d’Éléonore d’Olbreuse, fut dépêché à Celle pour y négocier un traité favorable aux intérêts de la France. Ernst August se joignit à ce traité et toucha aussi de substantiels subsides du roi de France. Ce traité ouvrit une période de relations diplomatiques intenses avec la France : le maréchal von der Thanne, un des plus hauts dignitaires de la cour de Celle, vint demander à Louis XIV que les représentants en France de la maison de Braunschweig obtiennent le rang d’ambassadeurs.32 Réciproquement, des envoyés français furent présents à la cour de Celle de façon continue : le marquis d’Arcy de 1680 à 1685, puis de Bourgeauville entre 1685 et 1689. Jean Hérault de Gourville se rendit lui-même à Celle en 1681 pour conserver à la France le soutien des deux ducs de Braunschweig.33 La Révocation de l’Édit de Nantes en 1685 vint porter un premier coup à cet équilibre géopolitique. Comme toutes les autres puissances protestantes, les ducs de Braunschweig voyaient d’un mauvais œil la politique confessionnelle du roi français. Le duc de Celle, qui avait épousé une huguenotte, fut d’ailleurs le premier dignitaire de l’Empire à publier un édit en faveur des huguenots, signé à Celle le 9 août 1684, soit plus d’un an avant la Révocation et la publication du fameux Édit de Postdam.34 La crise s’intensifia lorsque la France refusa à l’ambassadeur de Celle, le huguenot Jacques Rozemont de Boucœur, l’autorisation de sortir de France avec sa famille après avoir vendu tous ses biens. L’intervention personnelle de Georg Wilhelm ne put empêcher l’embastillement de Boucœur en 1686.35 Cette détorioration des relations avec la France fut complétée par le déclenchement de la guerre de la Ligue d’Augsburg (1688-1697). À partir des années 1690, la loyauté militaire des ducs de Celle et Hanovre vis-à-vis de l’Empereur fut sans faille, et les deux duchés s’éloignèrent progressivement mais sûrement du giron de la France. Il fallut attendre la paix de Ryswick en octobre 1697 pour que Louis XIV renoue des relations diplomatiques stables avec Celle, par l’intermédiaire du ministre Du Héron, puis du marquis de Bonnac à partir de 1700.36 Du point de vue de l’histoire de la musique, le rappel de ces développements politiques produit donc un paradoxe apparent. Les trois cours de Celle, Hanovre et Osnabrück avaient négocié dès 1667 l’entretien commun d’une troupe de comédiens français. En revanche, même s’il était impliqué dans le financement de cette troupe et qu’il avait aussi épousé une demi-française, le duc de Hanovre Johann Friedrich avait uniquement des musiciens italiens dans sa Hofkapelle : celui des trois frères qui était le plus favorable aux intérêts de la France et le plus proche de
30 31 32 33 34 35 36
publication d’un pamphlet intitulé La Sauce au Verjus, dans la meilleure tradition pamphlétaire anti-louis-quatorzienne, publié en 1674 à Strasbourg et à Amsterdam en traduction néérlandaise. Georg Linnemann, Celler Musikgeschichte bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, Celle 1935, p. 58. Beaucaire, Une mésalliance, p. 60. Beaucaire, Une mésalliance, p. 74. Beaucaire, Une mésalliance, p. 114. Thomas Klingebiel, Die Hugenotten in den welfischen Landen. Eine Privilegiensammlung, Bad Karlshafen 1994, p. 7-14 et 44-52. Beaucaire, Une mésalliance, p. 97. AAE, Correspondance diplomatique, Série Brunswick et Hanovre.
– 78 –
Administrer la musique française
Louis XIV sur le plan diplomatique fut donc précisément celui qui n’entretint pas de musiciens français.37 À l’inverse, les deux ducs qui menèrent une politique ambiguë vis-à-vis de l’Empereur mais globalement hostile aux intérêts de la France furent les principaux mécènes de musique française dans la région (Tableaux 2.2 et 2.3). On voit donc qu’il ne faut pas surestimer le poids des relations diplomatiques et militaires dans les transferts musicaux franco-allemands : lorsque Georg Wilhelm accueille ses premiers musiciens français en 1666, il a déjà mis ses armées au service de la Hollande, et il ne peut donc être question d’un alignement sur les intérêts de la France. Par la suite, les multiples revirements de ses relations diplomatiques avec la France ne semblent pas affecter le moins du monde le statut des musiciens français, qui demeurent à Celle pendant toute la période. Il faudra donc plutôt s’interroger sur les motivations individuelles, les réseaux personnels et le contexte culturel qui ont favorisé l’embauche des musiciens français à Celle, à Osnabrück et à Hanovre. Tableau 2.2. Musiciens français à la cour de Celle, 1666-1706. Nom
Dates de séjour
François Adam Beauregard Guillaume Caillat
Nom
Dates de séjour
1681
Nicolas Griffon
1680-1683
1673-1673
Guillaume Josse
1666-1690
Philippe de Courbesastre
1681-1706
N. La Garenne
1681-1706
Henri des Hays
1692-1706
Thomas de la Selle
1666-1706
René des Vignes
1666-1677
Philippe La Vigne
1666-1706
Pierre du Vivier
1689-1706
Denis Le Tourneur
1670-1697
Jean Jacques Favier
1666-1677
Pierre Maréchal
1683-1696
Étienne Forlot
1681-1695
Jean Mignier
1684-1706
Johann Ernst Galliard
1698-1706
Guillaume Pécour
1666-1708
Louis Gaudon
1677-1706
Pierre Potot
1681 –
Charles Gaudon
avt 1699 –
François Robeau
1666-1692
Bernard Graep
1696-1706
Claude Saint-Amour
1676-1716
Jean François Graep
1705-1706
Tableau 2.3. Musiciens français à la cour de Hanovre, 1680-1714. Nom
Dates de séjour
Charles Babel N. Bande
1688-1690
Dates de séjour 1680-1694
Nicolas Jourdain
1713-1715
Guillaume Barré
1688-1717
N. La Croix
1680-1688
N. Bertrand
1680-1707
Louis Le Conte
Anne Sophie Bonne
1668-1677
N. Bouli
1689
Nom Élie Jemme
– 1690
Jacques de Loges Jean Maillard
avt 1674 – 1693 1698 – 1698-1702
François Desnoyers
1696-1698
Jean Mignier
1698-1701
Jean Baptiste Farinel
1680-1713
Stéphane Valoy
1680-1698
François Venturini
1698-1726
Pierre Vezin
1680-1727
N. Goury Gilles Heroux
37
– 1687 1688-1690
Seule la chanteuse Anne-Sophie Bonne apparaît comme « frantzösische Sängerin » entre 1668 et 1677.
– 79 –
Chapitre 2
Tableau 2.4. Musiciens français à la cour de Dresde 1694-1733. Nom
Dates de séjour
Nom
Louis André
1720 – ap. 1731
Jean Baptiste Henrion
1696 –
1715-1733
Robert du Hautlondel
1707-1740
Jean Baptiste Joseph du Hautlondel
1709-1745
François Adam Beauregard Pierre Belletour
1712
Dates de séjour
François Biotteau
– 1731
Pauline Le Borgne
1697 –
N. Brunet
– 1733
N. Le Conte le père
1709 –
1715-1749
N. Le Conte le fils
1709 –
Pierre-Gabriel Buffardin Jean Cadet
1711 –
N. Clavel
1720-1733
François Le Riche
1699 – ap. 1733
1696 –
Nicolas Delvaux
Simon Le Gros
1700-1749
Antoine Mutant
1679-1695
Pierre Diard
1699-1727
Jean Prache du Tilloy
1699-1733
Louise Dimanche
1726-1732
Marguerite Prache du Tilloy
David Drot Jean Baptiste Ducé
1718 – ap. 1727 1709-1714
N. du Masis
1728 –
Charles Henrion
1696 –
Christian Roche
– 1733 – 1709
Madeleine de Salvay
1719-1720
Jean Baptiste Volumier
1709-1728
Politiques françaises d’Auguste le Fort À partir de l’arrivée d’Auguste le Fort sur le trône de prince électeur de Saxe en 1694 et jusqu’à sa mort en 1733, Dresde compte parmi les principaux centres de musique française dans l’Empire. Cet intérêt pour les productions musicales françaises prend plusieurs formes : l’achat de partitions imprimées transmettant les grandes œuvres du répertoire français contemporain, la réalisation de copies et d’arrangements d’œuvres françaises pour répondre aux besoins musicaux de la cour, et enfin l’engagement de nombreux musiciens français au sein des institutions musicales. De façon cumulée sur l’ensemble du règne, et indépendamment de la durée de leur séjour, ce sont près de soixante-quinze Français qui furent embauchés dans des fonctions musicales, dont une trentaine durablement (Tableau 2.4). Cette politique de mécénat musical est à replacer dans un contexte plus général où la France constitue une référence culturelle de premier plan dans la Saxe augustéenne – phénomène mis en évidence par Michel Espagne sous le terme de « creuset interculturel » de la Saxe.38 Des artistes et artisans français réputés étaient entretenus par la cour, comme le peintre Louis de Silvestre ou les architectes Zacharias Longuelune et Raymond Leplat. Les collections de la Grüne Gewölbe de Dresde sont riches d’objets précieux directement importés de France, et de nombreuses effigies d’Auguste le Fort sont modelées sur le modèle louis-quatorzien. L’érection d’une galerie de peinture jointe à une Académie des Beaux-Arts est inspirée du modèle français, et de nombreuses gravures du Kupferstichkabinett ont été commandées auprès d’artistes parisiens.39 Cette orientation artistique était le corollaire d’une politique européenne ambitieuse, manifestée par l’élection d’Auguste le Fort sur le trône polonais en 1697 : par son union à la Pologne, la Saxe devenait une puissance européenne de plein exercice, puisque le roi de Pologne était complètement indépendant de l’Empereur sur le plan constitutionnel. Cette tentative de sortir du giron impérial fut d’ailleurs suivie d’autres initiatives du même ordre dans les années suivantes : l’élec38
39
Michel Espagne, Le Creuset allemand. Histoire interculturelle de la Saxe, xviiie-xixe siècles, Paris 2000. Voir aussi Hans-Peter Lühr, Frankreich und Sachsen. Spurensuche in Dresden, Dresde 2010. Michael Märker, « Französische Musiker am Hofe Augusts des Starken », in : Von der Elbe bis an die Seine. Kulturtransfer zwischen Sachsen und Frankreich im 18. und 19. Jahrhundert, dir. Michel Espagne et Matthias Middell, Leipzig 1993, p. 67-74. Voir par exemple Virginie Spenlé, Die Dresdner Gemäldegalerie und Frankreich. Der « bon goût » im Sachsen des 18. Jahrhunderts, Beucha 2008.
rr – 80 –
Administrer la musique française
teur Friedrich de Brandebourg se proclama roi de Prusse en 1701, et l’électeur de Hanovre devint roi d’Angleterre à partir de 1714. Pour pouvoir être élu sur le trône de Pologne, Auguste le Fort s’était converti au catholicisme rapidement après la mort du roi de Pologne Jean III Sobieski en juin 1696. Sa conversion, condition nécessaire mais non suffisante pour pouvoir être élu sur le trône de Pologne, eut lieu à Baden en juin 1697.40 De nombreux candidats soutenus par diverses fractions de la noblesse polonaise ou puissances étrangères s’étaient déclarés : Jakob Sobiesky, Maximilian Emanuel de Bavière, Karl Philipp von Pfalz-Neuburg, ainsi que François Louis de Conti soutenu par la France. Face à ce dernier candidat, le prince-électeur de Saxe ne put remporter une victoire suffisamment claire pour décider l’issue de l’élection. Mais ses troupes étaient prêtes à intervenir et il se trouvait donc en position de force. Il remporta la partie et fut couronné roi de Pologne le 15 septembre 1697 à Cracovie, devenant ainsi Auguste II.41 Auguste le Fort conserva ce titre jusqu’à sa mort en 1733, excepté entre 1706 et 1709 lors d’une courte destitution causée par les rebondissements de la Grande guerre du Nord en Europe centrale, où il joua un rôle de premier plan contre la France au sein de l’alliance anti-suédoise. On voit ici que l’intérêt pour les productions culturelles françaises n’est en aucun cas l’expression d’un rapport de force politique, d’une proximité diplomatique, ou la poursuite de la guerre par d’autres moyens. Le patronage de musique française ne saurait davantage être vu comme la simple manifestation du « goût du prince ». Il convient en effet de souligner la dimension collective de ce phénomène : nombre de ministres les plus importants d’Auguste le Fort étaient aussi de grands mécènes de musique et jouèrent un rôle décisif dans l’accueil des musiciens français à la cour de Dresde. Loin de ressembler à ces « Grands Seigneurs en diminutif » ridiculisés par Mattheson, ces grands commis de l’État étaient aussi des patrons d’envergure.42 Le comte Christoph August von Wackerbarth (1662-1734), diplomate de haut vol et directeur du cabinet privé du roi, entretenait son propre ensemble musical dans lequel semble avoir figuré l’organiste français François de Tilly.43 Le « directeur des plaisirs », le comte Christoph Heinrich von Watzdorf (1670-1729) était aussi un amateur de musique française, comme en témoigne un inventaire de 1736 : la bibliothèque familiale comprenait plusieurs partitions de musique française.44 Watzdorf était lui-même soumis à l’autorité du Kabinettsdirektor, fonction successivement exercée par deux personnalités proches : le comte Jakob Heinrich von Flemming, un militaire influent qui exerça cette fonction entre 1712 et 1728, puis son client Ernst Christoph von Manteuffel.45 Le comte von Flemming était un amateur de musique distingué, qui avait son propre ensemble musical et jouait de la basse de viole. Enfin, le comte Heinrich von Brühl, ministre de Saxe, possédait sa propre chapelle musicale, placée sous la direction de Gottlob Harrer et au sein de laquelle se trouvait un flûtiste français, François Delerablée, entre 1746 et 1763.46 De nombreux imprimés de Lully figuraient dans sa bibliothèque 40 41 42
43 44 45 46
Johannes Ziekursch, « August der Starke und die katholische Kirche in den Jahren 1697-1720 », Zeitschrift für Kirchengeschichte, 24, 1903, p. 86-135. Paul Haake, « Die Wahl Augusts des Starken zum König von Polen », Historische Vierteljahrschrift, 9/1, 1906, p. 31-84. Johann Mattheson, Critica Musica, vol. 2, Hambourg 1725, p. 169-170 : « fast jeder Grand Seigneur en diminutif, und jeder Dorff-Herrscher gleich ein Paar Violons, Hautbois, Cors de chasse &c. zur Aufwartung um sich haben will, doch so, daß sie zugleich eine voll-jährige Lieverey tragen, Schuputzen, Perüken pudern, hinter der Kutsche stehen, und Laquaien Besoldung so wohl, als Bewirthung, geniessen; aber dabey beßere Musicanten agiren sollen, als alle Kunst-Pfeiffer. » Szymon Paczkowski, « Christoph August von Wackerbarth (1662-1734) and His “Cammer-Musique” », in : Music Migration in the Early Modern Age. Centres and Peripheries. People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence, dir. Jolanta Guzy-Pasiak et Aneta Markuszewska, Varsovie 2016, p. 109-126. Sur le mécénat du fils de Christoph Heinrich von Watzdorf, Christian Heinrich (1698-1747), cf. Nicola Schneider, « Christian Heinrich von Watzdorf als Musikmäzen. Neue Erkenntnisse über Albinoni und eine sächsische Notenbibliothek des 18. Jahrhunderts », Die Musikforschung, 63/1, 2010, p. 20-34. Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 43-45. Ulrike Kollmar, Gottlob Harrer (1703-1755), Kapellmeister des Grafen Heinrich von Brühl am sächsisch-polnischen Hof und Thomaskantor in Leipzig, Olms 2006, p. 352-353.
– 81 –
Chapitre 2
personnelle.47 Mais surtout, le comte semble avoir organisé des divertissements français dans sa résidence : une partition manuscrite vraisemblablement composée pour une occasion de ce genre, « Les Festes d’Apollon. Ballet pastoral », provient de sa bibliothèque personnelle.48 Il s’agit d’un opéra-ballet français en deux actes pour orchestre et chanteurs, dont la copie s’étend de près de 300 pages, et dont le compositeur ainsi que le librettiste demeurent inconnus. Des divertissements entre politique et galanterie Les « Festes d’Apollon » ne sont qu’un exemple parmi d’autres du rôle joué par la musique française dans l’organisation de fêtes de cour. Dans une lettre écrite aussitôt après le renvoi des musiciens français en 1733, le compositeur de musique française de la cour de Dresde Louis André défend son bilan en implorant le nouveau souverain de « bien se rappeler le peu de Talens [qu’il a] pour la composition de la musique », mais il tente surtout de négocier le maintien de musiciens français au sein de la Hofkapelle de Dresde, « la musique françoise étant plus convenable qu’aucun[e] autre pour les Ballets.49 » Fruit d’une collaboration étroite entre musiciens, danseurs et comédiens, l’organisation de ballets et de divertissements ponctue donc non seulement les grands évènements de la vie de cour mais représente aussi un moment privilégié dans l’activité du personnel français. À Dresde, la pastorale Mirtil, représentée en 1721 « par les Pensionnaires dans les Plaisirs du Roy », était le fruit d’une collaboration entre le comédien Poisson, le maître des ballets Debargues et le compositeur Louis André.50 Le Triomphe de l’Amour, donné pour le carnaval 1725, était sous-titré « Divertissement en musique orné de Ballets » et réunissait Louis André (« Maître de musique de la chapelle du Roy »), le sieur Poisson (« Poëte & Comédien du Roy »), et le sieur Favier (« Maître de Ballets du Roy »).51 L’adoption par les cours allemandes d’une grammaire française du divertissement et de la fête galante pour servir leurs propres fins constitue incontestablement un point névralgique dans l’articulation entre mécénat de musique française, enjeux politiques et identités aristocratiques. Pendant une cinquantaine d’années, entre 1675 et 1725, toutes les cours qui employaient des musiciens français donnèrent des divertissements français de grande ampleur. Mêlant musique, théâtre, danse et machines au sein de formes spectaculaires composites, ces divertissements s’inscrivaient dans le contexte de fêtes de cour qui pouvaient durer plusieurs jours et comportaient de nombreux autres évènements (Tableau 2.5). Le compte-rendu du Mercure galant sur les festivités données à Hanovre en 1684 pour le mariage de Sophie Charlotte avec le prince électeur de Brandebourg illustre bien cet emboîtement en gigogne : Le lendemain la plus grande partie de la journée s’estant passée en divertissemens, on prit celuy de la Comedie. L’Inconnu fut representé, avec un Balet entre les Actes, composé de vingt Entrées. Les Recits qui estoient à la loüange des Mariez, en furent chantez par les Musiciens de Mr le Duc de Hanover.52
Immédiatement identifiables par leurs livrets en français, ces divertissements empruntaient leur modèle au ballet de cour, à la fête galante, à la pastorale ou à la comédie-ballet. Parfois joués en plein-air, comme dans le cas des ballets champêtres donnés à Hanovre en 1681 (« Balet Champestre Dansé sous une grande feuillée au grand jardin du Leiné »), ils étaient cependant le plus souvent 47 48 49 50
51 52
Voir Chapitre 4, p. 194-197. D-Dl, Mus.2-F-503 : « I.M. Cte de Brühl » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/1, fol. 243. Lettre de Louis André à August III [ca. 1733]. Mirtil, Dresde 1721, avant-propos non paginé : « Les Vers & la Musique de cette petite Pastorale ont été composez en moins d’une Semaine : ainsi on peut dire, que c’est un Impromptu de Poësie & de Musique. La promptitude, sur tout, du Maitre de Musique, n’est pas ordinaire ; car quoi qu’il y ait dans ce Divertissement, plus de travail que dans deux Actes d’un Opera françois, il n’a employe que quatre jours à le mettre en Musique. » Le Triomphe de l’Amour, Dresde 1725, avertissement non paginé : « Ceci n’est point un ouvrage Dramatique, qui renferme un sujet intrigué, suivi, & denoüé ; Ce n’est à proprement parler que ce qu’on nomme un Ballet : On y trouvera cependant tous les spectacles, & tous les agrémens de nos grands Opera François. » Mercure galant, décembre 1684, p. 163.
– 82 –
Administrer la musique française
Tableau 2.5. Liste des divertissements français donnés à Celle, Hanovre et Dresde. Année Lieu
Titre normalisé
1674
Celle
Ballet des amours de Mars et de Vénus ou le Vulcan jaloux
1681
Hanovre La Chasse de Diane, Ballet champêtre dansé sous une grande feuillée
1681
Hanovre Le Charme de l’Amour, Mascarade mise en ballet
1682
Celle
La Discorde foudroyée, représentée dans un Ballet entremêlé de récits, voix et symphonies
1682
Hanovre Prologue en réjouissance du mariage de leurs Altesses Sérénissimes
1684
Hanovre Prologue mêlé de récits, de machines, de musique et de ballets
1685
Celle
1685
Hanovre Prologue sur l’heureuse naissance du jeune prince
1685
Hanovre Le Triomphe de la Paix, Ballet
1688
Celle
Le Triomphe germanique, Ballet
1689
Celle
Europe, Pastorale héroïque ornée de musique, de danses, de machines et de changements de théâtre
1709
Dresde
Le Théâtre des plaisirs
1719
Dresde
Les Quatre saisons, Divertissement de musique et de danse
Prologue et Argument de la Comédie du Cavalier duppé, entremêlée de chants et de danses
1721
Dresde
Mirtil, Pastorale en musique ornée de Ballets
1725
Dresde
Le Triomphe de l’Amour, divertissement en musique orné de ballets
représentés à l’intérieur, sur les théâtres des différentes cours, en particulier pendant les mois d’hiver lors du carnaval. La principale trace de ces fêtes se trouve dans les livrets imprimés.53 Ceux-ci constituent un objet fascinant, mais leur caractère littéral doit être relativisé dans la mesure où ils visent explicitement à produire une mémoire idéalisée et parfois rétrospective de la fête.54 Leur production matérielle faisait d’ailleurs l’objet d’une attention toute particulière : à Celle, la confection des livrets « pour les ballets » était confiée à l’imprimeur de la cour Andreas Holwein, tandis que leur tirage pouvait atteindre 300 exemplaires à Hanovre.55 Le substrat politique de ces œuvres est souvent transparent. Le Ballet des amours de Mars et de Venus ou le Vulcan jaloux, premier ballet français donné à Celle le 9 février 1674, est à mettre en relation avec l’anoblissement d’Éléonore Desmier d’Olbreuse par l’Empereur, en remerciement du soutien militaire de Georg Wilhelm. L’attribution du titre de comtesse à la compagne du duc ouvrait la voie à une officialisation de son union avec Georg Wilhelm – le Vulcan jaloux personnifiant alors Ernst August, hostile à toute reconnaissance de la relation matrimoniale entre les souverains de Celle, représentés par Mars et Vénus, puisque celle-ci menaçait de contrecarrer ses projets d’hériter du duché de Celle après la mort de son frère. La patente impériale conférant à Éléonore Desmier d’Olbreuse le titre de « Comtesse de Harburg-Wilhelmsburg » est datée du 22 juillet 1674, soit quelques mois après la représentation de ce ballet.56 Le personnage de Mars, « arbitre souverain des guerrieres allarmes lassé des perilleux combats », dépeint assez bien les activités de Georg Wilhelm en ce début de guerre de Hollande. De même, la peinture d’un Vulcan « piqué de jalousie pour leurs impudiques amours », qui « veut en interrompre le cours » et 53 54 55
56
Pour une enquête sur Stuttgart et Wolfenbüttel, voir Samantha Owens, « “Eine Liebliche/ Von Vielen Violen Bestehende Music”. Ballet Instrumentation at German Protestant Courts, 1650-1700. A Study of Libretti in Wolfenbüttel and Stuttgart Libraries », Royal Musical Association Research Chronicle, 41, 2008, p. 25-67. Sur les enjeux des descriptions imprimées de fêtes de cour, cf. Thomas Rahn, Festbeschreibung. Funktion und Topik einer Textsorte am Beispiel der Beschreibung höfischer Hochzeiten (1568-1794), Tübingen 2006. Voir par exemple pour le livret de La Discorde foudroyée donné à Celle le 23 nov. 1682 : NLAH, Hann. 76c A Nr. 208, p. 418 : « Die Ballets zu drucken, dem Buchdrucker Holwein 12 Thlr. » Pour le livret du Charme de l’amour donné à Hanovre en 1681, NLAH, Hann. 76c A Nr. 100, p. 251 : « Dem Buchdrucker Schwendiman vor drückung 300 Exemplarien der frantzösischen Balletten : 19 Thlr. 18 gr. Vor dieselben Einzubinden 26 Thlr. 16 gr. » Beaucaire, Une mésalliance, p. 60.
– 83 –
Chapitre 2
« fabrique avec art un filet merveilleux pour garoter nos amoureux », semble tout à fait refléter les manœuvres d’Ernst August et Sophie de Hanovre pour empêcher la légitimation de cette union. Le ballet fait d’ailleurs ouvertement allusion au concubinage de Georg Wilhelm en notant que « jusques icy secretement Mars & Venus ont pris leur divertissement ; mais leur faute estant manifeste ils se joindront publiquement mesme devant la cour celeste. » C’est avec la même absence d’ambiguïté que le ballet La Discorde foudroyée – représenté à Celle le 23 novembre 1682 pour le mariage de Georg Ludwig avec Sophia Dorothea – reflète le développement des relations politiques entre les deux familles ducales de Celle et de Hanovre. La portée symbolique est évidente dès le titre du ballet, puisqu’il s’agit de mettre en scène la fin de la discorde et l’harmonie retrouvée. Composé d’un prologue et de 16 entrées, ce ballet est beaucoup plus ample que le précédent. Là où le Balet des amours nommait douze acteurs, celui-ci permet d’en dénombrer trente-trois. Il associe des musiciens de la cour de Celle (Courbesastre, Gaudon, Josse, La Vigne et Pécour) avec des comédiens de la cour de Hanovre parfois également accompagnés de membres de leurs familles (Boncourt, Floridor, Lavoy, La Rivière et Soulas). On peut noter que la représentation sollicite également du personnel français qui n’est pas attaché au théâtre ou à la musique : Daniel Caulier et sa femme sont respectivement listés comme Cammerdiener et Cammerdienerin (serviteurs de la chambre) dans la liste de personnel de 1681.57 La représentation repose donc sur une collaboration entre le personnel français des deux cours qui dépasse largement le cercle des musiciens. Le Triomphe germanique, troisième ballet représenté à Celle en janvier 1688, comporte également un substrat politique donné par le sous-titre : « Sur le glorieux succès des armes de l’Empire contre les Turcs et à la memoire du jour heureux de la naissance de S.A.S. Monsgr le Duc ». À la cour de Hanovre, les divertissements français donnés entre 1681 et 1685 adoptaient des formes plus variées : parmi les six livrets conservés figurent trois prologues, deux ballets et une « mascarade mise en balet ». Le texte des divertissements était toujours écrit par Pierre de Châteauneuf, chef de la troupe de comédiens, avec la collaboration d’autres artistes : en 1684, « Monsieur des Brosses a fait toutes les Entrées de Ballet de ce spectacle. Monsieur Farinelly en a composé la Musique ». L’année suivante, « Monsieur du Cormier a fait les machines, Monsieur Valois toute la Musique & Monsieur Le Comte, Maître à danser de la cour, les Entrées de ballet ». Les prologues étaient donnés pour des évènements dynastiques toujours indiqués dans le titre : en 1682, pour le mariage de Georg Ludwig de Hanovre et de Sophie Dorothea de Celle ; en 1684, pour le mariage de Sophie Charlotte de Hanovre avec le prince électeur de Brandebourg ; en 1685, pour la naissance du prince Friedrich August, fils du couple marié en 1682. En 1682, le prologue précèdait la « piece des amours de Diane & d’Endimion », dans laquelle on peut sans doute reconnaître la tragédie en machine de Gabriel Gilbert.58 En 1685, le prologue précède la pièce de Corneille La Toison d’Or. Ces prologues commencent toujours par une ouverture, et sont chantés de bout en bout, avant d’être conclus par « une ou deux ouvertures59 » et d’être enchaînés à la pièce de théâtre. Celle-ci peut à son tour comporter des entractes assez développés, comme le montre la liste des divertissements dansés entre les actes des Amours de Diane et d’Endimion. Notons l’usage régulier des travestissements vestimentaires et vocaux à effet comique : dans la huitième entrée du Ballet des Amours, on voit « Mars & Vénus sur un lit ensemble. Représenté Par les Sieurs Favier & Pecour ». En 1682, Courbesastre et Frelot (Forlot) jouent deux paysannes ; en 1688, Caulier et Rochebrune joue deux « vieilles ridicules avec des flûtes » ; en 1689, Pompierin et Tilly jouent « deux vieilles ridicules ». Quelques indications musicales apparaissent en outre dans les didasca57 58 59
NLAH, Celle Br. 4 Nr. 74, p. 77 et 233. Gabriel Gilbert, Les Amours de Diane et d'Endimion, Paris 1657. Prologue en réjouissance du mariage de leurs altesses sérénissimes, Hanovre 1682, p. 19 : « Toutes ces Divinités estant disparües & retournées au Ciel, on joüe une ou 2. ouverture [sic], aprés quoi l’on commence la piece des amours de Diane et d’Endimion, que l’on a ornée, par ordre exprès de Son Altesse Serenissime, de tous les agrééments qui peuvent estre capables d’attacher la curiosité des personnes les plus difficiles. »
– 84 –
Administrer la musique française
lies de différents livrets. Après la cinquième entrée du Ballet des amours de Mars et de Venus, on note l’indication : « Les violons jouent une Ritournelle au lieu d’un Recit que l’on devroit chanter ». Après la dixième entrée, « On fait un concert de plusieurs sortes d’instrument [sic] ». L’organisation de ces fêtes reflète incontestablement l’adoption d’un idéal culturel galant associé aux divertissements modernes : en France, la fête galante était devenue la nouvelle norme du divertissement de cour, depuis le Ballet de la galanterie (1656) et les Plaisirs de l’île enchantée (1664).60 Mais en traversant le Rhin, ces formes spectaculaires d’origine française étaient parfois soumises à une profonde réinterprétation, voire à une forme de subversion. Le cas le plus spectaculaire est fourni par la « pastorale héroïque » donnée à Celle en 1689, l’Europe de Chappuzeau, que nous avons déjà évoquée (voir Chapitre 1) et qui constitue sous la plume du dramaturge huguenot un détournement du modèle lullyste et une critique radicale de la politique européenne louis-quatorzienne. Alors que la galanterie et son art du divertissement de cour sont souvent interprétés comme un élément stratégique décisif dans l’exercice d’une puissance douce par la France, voire comme la traduction d’un rêve français de translatio imperii, l’arme pouvait très bien se retourner contre ses promoteurs.61 Dans les années qui suivirent immédiatement l’arrivée au pouvoir d’Ernst August à Hanovre en 1680, le Mercure Galant se fit à plusieurs reprises l’écho des somptueuses fêtes de cours données dans la résidence ducale. Ces descriptions opulentes, rédigées pour un lectorat avide de récits féériques, assumaient explicitement une fonction mémorielle et enchomiastique.62 Le compte-rendu du ballet Le Charme de l’Amour s’étale ainsi sur soixante-dix pages, mentionnant des instruments, ou le « Sieur Jemmes, Maistre du Balet ». Le compte-rendu de la fête se conclut en notant que celle-ci « n’eut pas moins de quoy satisfaire par la beauté de la Symphonie & de la Musique.63 » De tels divertissements formaient la pierre de touche d’une identité galante : c’est à propos des ballets et autres formes spectaculaires que le périodique louait le nouveau souffle d’inspiration « galant » de la cour de Hanovre, dans lequel il voyait une imitation de la cour de France.64 Ce qualificatif n’était pas décerné au hasard : l’année précédente, le Mercure s’était abstenu de l’employer dans la nécrologie de l’ancien duc de Hanovre Johann Friedrich, et – tout en soulignant le rayonnement du théâtre français par le biais de la troupe de comédiens – préférait alors parler d’une cour « aussi modérée que grande, civile, & magnifique.65 » Les nouveaux souverains de Hanovre, le duc Ernst August von Braunschweig-Lüneburg et sa femme Sophie von der Pfalz, ont donc apporté avec leurs musiciens français ce « je ne sais quoi » typique de la galanterie, faisant souffler sur la cour de Hanovre un air décontracté, libre et vif qui se manifestait de façon privilégiée lors des ballets et des fêtes de cour.
60 61 62
63 64
65
Viala, La France galante, p. 84-110. Voir aussi Anne-Madeleine Goulet, « Les variations de la fête », in : Regards sur la musique au temps de Louis XIV, dir. Jean Duron, Wavre 2007, p. 91-112. Sur galanterie et hégémonie française, cf. Viala, La France galante, p. 384-391. Marie-Thérèse Mourey, « Le Mercure galant et l’espace germanique », in : Le Mercure galant, témoin et acteur de la vie musicale, dir. Anne Piéjus, p. 13-21, ici p. 16 : « Ces commentaires peuvent être interprétés comme une manière de conforter, auprès des lecteurs distingués du Mercure galant, le sentiment éminent de supériorité de la France en matière de plaisirs, amusements et spectacles. » Mercure Galant, avril 1681, p. 133-202. Mercure Galant, avril 1681, p. 133-134 : « Pendant que Monseigneur le Dauphin faisoit préparer le magnifique Ballet du Triomphe de l’Amour, qui a servy de divertissement à Leurs Majestez tout le Carnaval, la Cour de Hanover qui imite si galamment toutes les manieres de celle de France, se disposoit a faire paroistre une Mascarade mise en Balet, presque sous le mesme titre. » Mercure Galant, mars 1683, p. 35-36 : « il est difficile de pousser plus loin la magnificence & la galanterie, si l’on excepte ce qui se fait à la Cour de France […]. On peut dire que […] la Cour de Hanover suivoit de bien près ce qu’on voit icy de surprenant pour les Ballets, & pour les Feux d’artifice. » Mercure Galant, janv. 1680, p. 195-196 : « [Johann Friedrich] a toûjours entretenu une Troupe de Comédiens François avec Mr le Duc de Zell son aîné ; & sur ses dernieres années, il a fait faire des Opéra en Italien, qu’on a trouvez admirables, sur tout pour les Voix & les Décoration. […] Sa cour estoit aussi moderée que grande, civile, & magnifique. Il avoit etably toutes les manieres Françoises qu’on suivoit en tout, jusque dans les Familles mesme de la Ville. Il avoit dans sa Cour & dans ses Troupes beaucoup d’Officiers François […]. »
– 85 –
Chapitre 2
Identités galantes et patronage de musique française La mise en évidence d’une galanterie allemande n’était pas seulement la projection d’un Mercure galant avide de flatter son lectorat français, mais elle était devenue dans l’espace germanique une catégorie centrale, tant sur le plan littéraire que sur le plan éthique.66 Le cours tenu en 1687 à l’Université de Leipzig par Christian Thomasius sur « l’imitation des Français » accordait ainsi une grande place à l’examen des propositions contenues dans les Conversations de Madeleine de Scudéry, notamment « De l’air galant » et « De la politesse ».67 Même si Thomasius n’aborde pas la musique, il ne fait pas de doute que le patronage de musique française doit être replacé dans ce contexte bien particulier pour pouvoir être compris : celui de l’apparition, entre 1660 et 1700, d’une nouvelle manière de nouer identité individuelle, identité de genre et identité aristocratique, science, religion et érudition et qui se manifestait en premier lieu parmi la haute noblesse d’Empire, où l’on voit émerger dès 1660 un nouveau type d’identité collective façonnée par la galanterie. D’abord incarnée par des aristocrates nés vers 1630 et qui arrivent au pouvoir une dizaine d’années après la paix de Westphalie, elle se manifeste en général par la combinaison d’au moins deux des cinq caractéristiques suivantes : une culture confessionnelle marquée par le calvinisme ou l’indifférence religieuse, un intérêt pour les thèses rationalistes du cartésianisme ou la philosophie, un style de gouvernement éclairé, une morale sexuelle libérale, et une sensibilité marquée par la galanterie littéraire. Sophie de Hanovre entre galanterie et Lumières radicales La correspondance de Sophie de Hanovre fournit un excellent observatoire pour comprendre la manière dont est négociée et articulée cette identité galante. Plusieurs fois par semaine, Sophie échangeait des lettres avec deux personnes dont elle était très proche : son frère Karl Ludwig, prince électeur du Palatinat qui vivait dans son château à Heidelberg, et la fille de celui-ci, Elisabeth Charlotte dite Liselotte von der Pfalz, devenue duchesse d’Orléans et souvent désignée en France sous le nom de Madame Palatine. Si ces lettres constituent une mine d’informations permettant de reconstruire des réseaux de musiciens se déployant entre Paris et Osnabrück, elles sont également le lieu privilégié où se forme et se donne à lire une nouvelle identité formée par les valeurs de la galanterie. Sophie maîtrise à la perfection les codes du langage galant : à travers un art épistolaire très subtil et conduit exclusivement en français, elle rejoint le modèle de la lettre galante, transcrivant de manière résolument personnelle et intime une sorte conversation idéale qui s’épanouit dans l’emploi d’un style moyen défendu par Mademoiselle de Scudéry.68 Ses correspondants étaient d’ailleurs tout à fait conscients de la haute valeur littéraire des lettres qu’ils recevaient, comme le montre la remarque formulée par Madame Palatine en 1699 à sa tante : « J’assure Votre Dilection que, si ses écrits pouvaient être imprimés, ils se vendraient comme des petits pains, car rien n’est plus aimable ni écrit avec plus d’esprit.69 » Ce style exceptionnel est aussi celui des Mémoires que la duchesse écrivit en 1680. Lorsqu’il recopie le manuscrit de Sophie, Leibniz relève en tête de sa copie le caractère « sublime » du texte, terme qui désigne pour lui cette qualité propre à un style qui cultive une certaine nonchalance, mais touche sans en avoir l’air des sujets profonds : Le style paraît simple, mais il a une force merveilleuse et je le trouve fort du caractère que Longin appelle sublime, malgré cette négligence apparente. Lors même qu’il semble qu’on ne dit que des choses ordinaires, elles se trouvent relevées par un certain tour admirable qui donne occasion à faire des réflexions solides sur les choses humaines.70
66 67 68 69
Jörn Steigerwald, Galanterie. Die Fabrikation einer natürlichen Ethik der höfischen Gesellschaft (1650-1710), Heidelberg 2011. Christian Thomasius, « Diskurs von der Nachahmung der Franzosen » [1687], in : Kleine Teutsche Schriften, Hildesheim 1994, p. 3-69. Viala, La France galante, p. 49-55. Lettre de Madame Palatine à Sophie de Hanovre, 25 juin 1699. Sophie de Hanovre, Mémoires et lettres de voyage, éd. Dirk van der Crusse, Paris 1990, p. 7.
– 86 –
Administrer la musique française
Le terme « sublime » n’était pas choisi au hasard par le philosophe, mais il résultait d’une double lecture : celle de la traduction par Boileau du traité sur le sublime du pseudo-Longin, et celle de La manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit où Bouhours tentait de faire une synthèse entre le « je ne sais quoi » du sublime et celui de la galanterie à travers la notion de « noble simplicité ».71 Élevée en Hollande dans un environnement calviniste et une atmosphère intellectuelle libérale très marquée par le cartésianisme – sa sœur Elisabeth était une correspondante régulière et une amie de Descartes –, Sophie développa très tôt un intérêt marqué pour la philosophie et manifestait une émancipation religieuse, morale et intellectuelle exceptionnelle pour une femme de son temps. Son mariage avec Ernst August en 1658 renforça son aversion envers un clergé luthérien jugé obscurantiste et rétrograde. Plusieurs de ses lettres, écrites à l’église pendant des cérémonies interminables, laissent transpirer un mépris corrosif pour les pasteurs ridicules et leurs dogmes incompréhensibles – par exemple lorsque Sophie se vante de lire de la littérature profane pendant l’office.72 Elle va même jusqu’à développer en filigrane une critique de la musique d’église, décrite comme un moyen d’abrutissement collectif : À l’esglise le 6. Fevrier 1659. Je devrois avoir l’esprit plus illuminé icy qu’à l’ordinaire, si le spirituel n’y consistoit à qui criera le plus fort, pour ce qu’on chante trois foys plus que l’on praiche et le bruit de cela estourdit plus les sens que l’autre ne touche les oreilles, car nous avons cette benediction icy comme à Heydelberg, qu’on entant rien du tout au lieu, où nous sommes assis, si bien qu’il faut que les bonnes meditations proviennent de nous mesmes […].73
C’est à partir de cette critique radicale qu’on peut lire le contraste programmatique établit entre la musique vocale des deux chanteurs de Sophie, la Française Nanon et l’Italien Antonio, et le vacarme qu’elle avait entendu plus tôt à l’église, le pasteur ayant fait venir timbales et trompettes pour ponctuer ses vœux de bonne année à la famille ducale : Il n’y a que la belle voix de M[ademoise]lle Nanon et de Sig[no]r Antonio qui me remestent comme la harpe de Davit faisoit à Saul, et nostre abbé a fait venir des trompettes et tinballes dans l’esglise le jour du nouvel an et les a fait sonner entre chaque souhait qu’il fit vor die fürstliche personnen.74
L’insertion d’une citation en allemand dans une lettre en français, outre sa pointe ironique, souligne que les aspects linguistiques de la musique française ou italienne étaient une composante essentielle de leur valorisation dans l’entourage de Sophie. On remarque ainsi que l’apprentissage de la langue française aux enfants passe aussi bien par la conversation que par le chant, puisque la chanteuse française Nanon « chante et montre » aux enfants de Sophie, tout en soulageant la solitude de sa patronne dont le mari était parti pour le carnaval de Venise : Je me promaine le soir au clair de la lune aupres des orangers d’Heydelberg qui ont l’odeur fort agréable, où Nanon la borniesse chante et montre à mes enfants. J[ean] F[rederic] me l’a prettée pendant ma solitude, car on me plaint et je ne me plains pas […].75
Mais Sophie ne se contente pas de moquer le clergé en affichant sa supériorité intellectuelle et musicale : elle développe un intérêt pour des courants philosophiques dont la radicalité allait bien au-delà du carténianisme qui avait marqué sa jeunesse. En 1676, elle entama une amitié durable avec Leibniz, qui venait d’être nommé bibliothécaire de la cour de Hanovre après avoir séjourné quatre ans à Paris, où il avait pu avoir accès à des manuscrits clandestins et approfondir son intérêt pour Spinoza.76 En mars 1679, Sophie confiait à son frère qu’elle était en train de lire l’édition 70 71 72 73 74 75 76
Gottfried Wilhelm Leibniz, « Réflexions sur les Mémoires de M[adame] l[a] d[uchesse] ». Sophie de Hanovre, Mémoires et lettres de voyage, p. 19. Voir en particulier Sophie Hache, La langue du ciel. Le sublime en France au xviie siècle, Paris 2000, p. 89-95. Bodemann, Briefwechsel, p. 26, 34. Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Hanovre, 6 fév. 1659. Bodemann, Briefwechsel, p. 9 Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Iburg, 3 janv. 1670. Bodemann, Briefwechsel, p. 147. Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Osnabrück, 1 août 1675. Bodemann, Briefwechsel, p. 242. Sur Leibniz et les Lumières radicales, voir la synthèse de Israel, Radical Enlightenment, p. 502-514.
– 87 –
Chapitre 2
française du Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza, tout juste parue de façon clandestine, et qu’elle le trouvait « bien rare et tout à fait selon la raison » : si Spinoza était vraiment mort comme on le racontait, c’était certainement qu’il avait été empoisonné par des prêtres sans scrupules, ennemis de la raison.77 Elle se plaignait également que le livre de Spinoza fût interdit et vantait les progrès de son fils en mathématiques et en lecture, en mentionnant au passage qu’il savait Descartes et Spinoza presque par cœur, bien qu’il fût encore incapable de bien le dissimuler.78 Le programme d’éducation de ses enfants comprenait donc apparemment, outre l’apprentissage du français, la lecture de deux philosophes radicaux. Cette soif pour la philosophie s’accompagne également, sous la plume de Sophie, d’une attitude décontractée face aux questions physiques, de sexualité ou de mœurs. Il lui arrive ainsi fréquemment d’évoquer ouvertement son corps vieillissant, l’homosexualité masculine dans son entourage, ou les déviances de ses contemporains.79 En revanche, on ne peut guère parler d’une fascination pour la cour française, comparée par Sophie à une « Arche de Noé80 ». Même Louis XIV est dépeint comme un homme sans esprit et imbus de lui-même, tenant des props indifférents, posant de sottes questions et exagérant son pouvoir : Effectivement S.M. n’oublia rien pour me le faire connaître et me dit tout ce qu’on peut dire d’agréable pour plaire, jusqu’à me faire souvenir de la bataille que Messieurs les ducs [de Braunschweig] avaient gagnée contre lui, et dit qu’il s’était bien aperçu qu’il les avait eus pour ennemis. Je répliquai, comme ils n’avaient pas été assez heureux d’avoir ses bonnes grâces, qu’ils avaient tâché de s’acquérir au moins son estime. Le Roi répondit qu’il y avait eu des temps où il n’avait osé demander leur amitié. Je répliquai que j’étais bien aise que ce temps était passé, et [que] je lui avais vu jurer la paix. Il dit qu’il y avait toujours cette clause ; qu’elle durerait tant que cela serait pour le bien de son Etat. Je dis que j’espérais que ce serait pour longtemps. Il répondit en haussant la tête : « Je crois que les princes d’Allemagne ne me feront plus la guerre. » Ensuite, il parla de toutes ses troupes, de la quantité qu’il avait cassée, et de la grande puissance qui lui restait encore. Monsieur aida beaucoup à exagérer tout cela. Il voulut aussi louer ma fille qu’il disait trouver belle, et qu’il avait ouï dire qu’elle avait beaucoup d’esprit. Il me demanda s’il fallait l’appeler Madame ou Mademoiselle ; qu’il croyait que Madame était la mode en Allemagne. Après quelques discours indifférents il s’en alla.81
Cet ensemble de valeurs s’étendait aussi à la compréhension de la musique, et la préférence de Sophie pour la musique française s’éclaire alors d’un jour nouveau. Lorsque Karl Ludwig lui demande de s’informer sur le coût des musiciens italiens engagés dans la chapelle de son beau-frère catholique Johann Friedrich, Sophie se moque de la piété de son frère, associant ironiquement la musique italienne avec une religiosité excessive et une obsession prématurée pour la mort : J’admire vostre pitié de songer si tost à la mort et de vouloir vous y preparer par des mottets Italiens pourtant le plus tost que cela se pourra, c’est pourquoi je ne me suis pas trop pressée pour sçavoir particulierement, combien chaque musicien coute ; on les paie selon qu’ils sont bons ; on dit, que ceux du Duc
77
78
79
80
81
Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Osnabrück, 9 mars 1679. Bodemann, Briefwechsel, p. 353 : « Le pouvoir fait tout dans le monde, et Spinoza dit dans son livre, que toutes les republiques, qui se maintienent, sont selon la volonté de Dieu. Son livre est effectivement bien rare et tout à fait selon la raison ; si l’autheur est mort, comme on le dit, je pense, que les amateurs de la foy sans raison l’ont enpoisoné, car la pluspart du genre humain vit du mensonge. » Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Osnabrück, 19 mars 1679. Bodemann, Briefwechsel, p. 353 : « On dit, que son livre est defendu : la verité se trouve tousjour persécutée… » Osnabrück, 6 juil. 1679. Bodemann, Briefwechsel, p. 367-368 : « Auguste [Friedrich August] n’est pas de mesme ; vous ne croiries pas, que celuy cy aime la lecture et les mathematiques ; il sçait Descartes et Spinoza casi par cœur, mais tout cela n’est pas bien deguisé encore. » Voir par exemple Bodemann, Briefwechsel, p. 83, 402. La même chose peut se dire de Madame Palatine, par exemple : Brunet, Correspondance complète, vol. 2, p. 15, 21. En revanche, Saint-Simon passe sur ce genre de sujet comme « chat sur braise » : Damien Crelier, « Saint Simon et le “goût italien” : l’homosexualité dans les Mémoires », Cahiers Saint-Simon, 42, 2014, p. 47-60. Sophie de Hanovre, Mémoires et lettres de voyage, p. 144 : « J’avais eu quelque appréhension de me montrer à une cour française ; mais comme je vis la maréchale du Plessis, Mme de Fiennes, Mme Gordon et la gouvernante des filles de Madame, qui étaient les seules qui se montrèrent ce jour-là, je pris courage et j’y vis bien qu’il y avait de toutes sortes d’espèces aussi bien dans cette cour comme dans l’Arche de Noé. » Le bestiaire de la cour est aussi un trope récurrent sous la plume de Madame Palatine et Saint-Simon. Sophie de Hanovre, Mémoires et lettres de voyage, p. 150.
– 88 –
Administrer la musique française
J[ohann] F[riedrich] luy coutent m/9 escus par an ; il y a 2 basses, 2 tenors, 2 contrealtos, 2 soupranos et 6 qui jouent de la tuorbe, de violons, d’instrumants et de viol de jambe [gambe], et outre cela un maitre de chapelle. Ils concertent tout à fait bien ensemble.82
Plutôt que des musiciens italiens qui font trop songer à la mort avec leurs motets, Sophie voit dans les comédiens français le remède le plus efficace contre la mélancolie, et elle tance son frère d’avoir décommandé les siens.83 Une dizaine d’années plus tard, alors que son frère envisage à nouveau d’engager des castrats italiens pour sa propre chapelle à Heidelberg, Sophie continue dans la même veine ironique en associant le patronage de musique italienne avec l’orthodoxie religieuse en imaginant une sorte d’invraisembable alliance entre les obscurantistes et religieux de tous bords en faveur de la musique italienne – le pape, le prince électeur calviniste de Heidelberg et les princes électeurs luthériens de Dresde. Même le pape ne verrait sûrement pas d’un mauvais œil qu’un électeur calviniste engage des musiciens italiens, puisque qu’il y en avait déjà toute une chapelle à Dresde, bastion de l’orthodoxie luthérienne : Le Duc d’Hanover paie ses musiciens qui chantent tres cher ; il leur donne à chaqu’un 50 escus par mois, mais Montalban m’a dit qu’on en peut bien avoir à meilleur marché, mais peutestre ne seroient pas si bon. Vous en avez eu vous mesmes qui n’ont couté que la moitié. Le St. Père de Rome ne trouvera rien à redire de les voir en vostre chapelle, car il y a tout une musique à Dresden.84
Ici, le contraste implicite entre musique italienne et musique française est bien sûr d’abord économique – la musique italienne coûte cher –, mais aussi idéologique. La musique italienne est financée par des puissances favorables à la religion, quelle que soit leur confession. Le pape à Rome, le prince électeur luthérien de Dresde, voire même un électeur calviniste à Heidelberg, s’ils financent à grands frais des chapelles italiennes somptueuses, sont du côté de l’orthodoxie religieuse dénigrée et combattue par Sophie. Les obsèques de Johann Friedrich, célébrées en grande pompe par le clergé catholique et les musiciens italiens de sa chapelle plus de cinq mois après sa mort (car il fallait préparer le catafalque) confirmèrent sûrement Sophie dans son aversion pour la musique italienne.85 Elle déconseilla à son frère d’engager ces derniers pour sa propre chapelle, tout en faisant allusion à la nécessité de mettre bon ordre dans les finances de Johann Friedrich.86 C’est donc pour un double motif économique et religieux que dès leur installation à Hanovre, Ernst August et Sophie remplacèrent les douze Italiens de l’ancienne chapelle par douze Français. Le changement de visage de la Hofkapelle est spectaculaire : à Pâques 1680, tous les musiciens italiens furent renvoyés, en même temps que le clergé catholique qui desservait jusqu’alors la chapelle du château. Parmi les nouveaux musiciens, certains étaient déjà en service à Osnabrück comme Jemme, mais arrivent également Farinel et six autres musiciens français (« Frantzösische Musicanten ») qui ne sont pas nommés individuellement.87 Parmi les dix-neufs musiciens de Johann Friedrich, seul le Cammer Musicus Clamor Heinrich Abel reste en place. 82 83
84 85
86
87
Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Iburg, 1er avr. 1669. Bodemann, Briefwechsel, p. 137. Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Osnabrück, 1er fév. 1680. Bodemann, Briefwechsel, p. 405 : « Je suis fachee, que vous avez contremendé les comediens François, car on en a plus besoin dans un temps d’affliction qu’autrement. G[eorge] G[uillaume] a tousjour fait jouer les siens, en disant, qu’il ne vouloit pas perdre du temps pour se divertir du peu qui luy restoit peutestre encore à vivre. » Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Osnabrück, 23 févr. 1679. Bodemann, Briefwechsel, p. 348. Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Hanovre, 2 mai 1680. Bodemann, Briefwechsel, p. 415-416 : « Le ceremonie de l’enterrement se fit mardi passé en procession, le lendemain on l’enterra apres que les catholiques eurent fait toutes leur ceremonies à l’entour de la chapelle ardante. […] Tout s’est fini à boire et à manger. Aujourduy nous mangerons avec les 5 mitres qui ont fait la comedie aupres de la chapelle ardante. » Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Osnabrück, 25 janv. 1680. Bodemann, Briefwechsel, p. 403 : « À propos des musiciens que Montalban vous creut recommander : les bons sont tres chers ; la musique a fort couté à J[ean] F[réderic] et je crois, que E[rneste] A[uguste] voudra premierement mettre ses affaires en ordre avant que de faire des depenses extraordinaires ». NLAH, Hann. 67c A Nr. 100, p. 198. Les musiciens français sont simplement désignés par « denen 6 übrigen frantzösischen Musicanten. »
– 89 –
Chapitre 2
Alors que sous Johann Friedrich, le salaire des musiciens était enregistré avec celui du clergé catholique dans une rubrique appelée « Bey der Hoff Capelle », le salaire des musiciens est au contraire reporté dès 1680 dans une section indépendante, appelée « Denen Musicanten » et dans laquelle ne figure pas le personnel ecclésiastique. Tout se passe donc comme si le changement de paradigme national allait de pair avec une laïcisation des fonctions de la Hofkapelle : les Français sont les musiciens de patrons qui se définissent avant tout par leur galanterie, et non par leur religion. Grand et galant prince, Ernst August se refusa pourtant à promulguer une interdiction pure et simple du culte catholique à Hanovre malgré les pressions en ce sens exercées par les Reichsstände et les autorités luthériennes en octobre 1680 puis en 1685.88 Il laissa aussi sa bellesœur catholique, Benedicta Henriette von der Pfalz, utiliser la chapelle du château jusqu’à son départ pour la France en février 1680. Enfin, le clergé catholique et les musiciens italiens continuèrent à percevoir leur solde jusqu’à Pâques 1680, avant d’être invités à quitter la ville. Cette tolérance à l’égard des catholiques est traditionnellement expliquée par la proximité politique d’Ernst August avec la France à la suite du traité de paix de 1679, dans lequel les Français lui assuraient d’énormes subsides pour l’entretien de son armée.89 Elle pourrait aussi être interprétée comme le geste d’un souverain assez indifférent en matière de religion qui était aussi le mari d’une femme philosophe. Entre Osnabrück et le Palais Royal : connections féminines Ernst August et Sophie n’en étaient pas à leur coup d’essai en matière de musique française. Dès son arrivée dans la résidence épiscopale en 1662, le nouvel évêque d’Osnabrück avait fait souffler sur la vieille forteresse d’Iburg un nouvel esprit musical. Celui-ci se manifesta notamment par l’engagement de musiciens français, d’abord dans l’ancienne résidence épiscopale d’Iburg située à une quinzaine de kilomètres de la ville d’Osnabrück, puis à partir de 1673 dans le petit château baroque qu’Ernst August avait fait construire à la lisière de la ville.90 On peut repérer la présence de deux bandes de violons français, d’un maître à danser Élie Jemme, ainsi que de quelques figures individuelles moins connues, parfois venues avec leur famille. Trois ans avant l’engagement de la première bande permanente de violons français à Celle, la cour d’Osnabrück faisait donc déjà venir, sur une base saisonnière, des musiciens français pour assurer ses propres besoins musicaux. La première mention de musiciens français à Iburg se trouve en 1663, dans une lettre de Sophie von der Pfalz à son frère Karl Ludwig : Cependant pour m’esgaier un peu, nostre maitre de dance est revenu de Paris avec une tres bonne bande de violons, un, qui joue de la tuorbe et du lut, et un autre, qui chante la bas[s]e, pour accompagner Nanon et Sigr Antonio ; enfin il y a musique par toute la maison juqu’aux garsons de mes enfans qui joue[nt] du Hackelbret et de la poche. Cela est bon en Allemagne, où l’on ne parle gaire d’entendre toujours du bruit.91
Notons au passage l’association renouvelée entre la musique française et les affects joyeux, ce qui est bon « en Allemagne où l’on ne parle guère ». Si la composition de cette bande de violons reste inconnue, plusieurs noms peuvent être repérés dans un ensemble de quittances signées par des habitants de la ville d’Osnabrück ayant logé du personnel de la cour.92 Mais c’est surtout le couple formé par le maître à danser Élie Jemme et sa femme Marguerite Robeau qui permet d’entrevoir les liens étroits entre la cour d’Osnabrück et le Palais Royal où la nièce de Sophie, Madame Palatine, 88 89 90
91 92
Franz Wilhelm Woker, Geschichte der katholischen Kirche und Gemeinde in Hannover und Celle. Ein weiterer Beitrag zur Kirchengeschichte Norddeutschlands nach der Reformation, Münster 1889, p. 42-43. Woker, Geschichte der katholischen Kirche, p. 40. Franz Bösken, Musikgeschichte der Stadt Osnabrück. Die geistliche und weltliche Musik bis zum Beginne des 19. Jahrhunderts, Ratisbonne 1937. Martin Siemens, « Musik, Tanz und Theater am Hof des Osnabrücker Fürstbischofs Ernst August I. Eine Skizze », in : Das Osnabrücker Schloss : Stadtresidenz, Villa, Verwaltungssitz, dir. Franz Joachim Verspohl, Bramsche 1991, p. 183-192. Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Iburg, 11 juil. 1663. Bodemann, Briefwechsel, p. 58. Voir Chapitre 3, p. 148-150.
– 90 –
Administrer la musique française
résidait depuis son mariage avec Philippe II d’Orléans en 1671. Marguerite Robeau apparaît pour la première fois en 1666 dans la correspondance de Sophie, comme femme d’Élie Jemme : Il se passe si peu de choses icy qui meritent de vous estre mendées, que je ne scay pour le present remplir ma gazette que d’une dame considerable, qui vient d’arriver icy de Paris, espouse de Jeme, maitre de dans. Elle excelle en compliments et en bonmots et pourra servir d’une Hermide pour seduire les trouppes de Munster ou bien gagner de l’argent pour les paier, car on n’entend que des plaintes de ses gens, qu’on ne les paie pas ; aussi n’ont ils point presté de serment de fidelité.93
Même si Marguerite Robeau n’est pas nommée explicitement ici, ses talents rhétoriques en « bons mots » et « compliments » sont soulignés par Sophie à travers une allusion à la Jérusalem délivrée du Tasse : elle est comparée à une Armide capable de soumettre les armées ennemies. Marguerite est la fille d’Hilaire Robeau, maître joueur d’instruments à Paris et hauboïste du roi : elle fut baptisée à Saint-Séverin en 1639.94 Elle est donc également la sœur de François Robeau, un musicien en activité à la cour de Celle. Le couple Jemme fait baptister un premier enfant à Osnabrück en 166795, puis un deuxième à Iburg en 1670, choisissant alors comme marraine Éléonore Desmier d’Olbreuse, la compagne française et huguenotte du duc de Celle comme marraine.96 Plusieurs années plus tard, le 5 août 1673, c’est la duchesse d’Orléans qui annonce que Jemme est en chemin pour Osnabrück avec des nouvelles personnelles toutes fraîches et son « contrefait », c’est-à-dire son portrait : D’ailleurs, mon maistre vous apporte mon visage d’ours, de chat et de singe ; tout le monde dit ici que mon petit me ressemble, vous pouvez donc imaginer qu’il n’est pas exactement un très beau bébé. […] Je ne vous écrirai rien d’autre puisque mon maistre vous rapportera cela mieux oralement, et il vous racontera comme je suis contente d’apprendre à monter à cheval, car cela se prête parfaitement à la tête en passoire à vent de Liselotte.97
La réponse de Sophie enregistre l’arrivée de Jemme à Osnabrück, et souligne son éloquence.98 À la lecture de cet échange épistolaire, on peut donc se demander qui était l’employeur de Jemme : il est appelé « mon maître » par la duchesse d’Orléans, sans doute à cause de sa fonction de maître de danse, mais travaillait apparemment également pour Osnabrück. Était-il au service de la maison d’Orléans au Palais Royal à Paris, ou bien appartenait-il à la domesticité d’Ernst August et Sophie à Osnabrück ? Il est tout à fait possible que Jemme ait enseigné la danse à la jeune Liselotte von der Pfalz lors du long séjour qu’elle fit chez Sophie entre 1659 et 1663, avant son départ pour la France et son mariage avec Philippe d’Orléans. À partir de l’installation d’Ernst August et Sophie à Hanovre en 1680, Jemme apparaît toujours dans la comptabilité de la cour comme maître à danser.99
93 94 95 96 97
98
99
Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Osnabrück, 7 fév. 1666. Bodemann, Briefwechsel, p. 99. F-Pn, Fichier Laborde, NAF 12180, fiche 58352 : « Le jeudi quatorzieme jour d’avril 1639 fut baptisée Marguerite fille de Hilaire Robeau maître joueur d’instruments, et de Marie Maillaume, sa femme. » BA Osnabrück, St. Johann, Taufen 1657-1694, 14 juin 1667, p. 52 : « Sophia parentes Elias Scheme Choragus Ser[enissi]mi Margareta Rabbow uxor Patrini Sophia Uxor Ser[enissi]mi Principis et Fransk Petrus Fischer. » Wilhelm Beuleke, Die Hugenotten in Niedersachsen, Hildesheim 1960, p. 147. Lettre Madame Palatine à Sophie de Hanovre, Saint-Cloud, 5 août 1673. Eduard Bodemann, Aus den Briefen an die Kurfürstin Sophie von Hannover, Hannover 1891, p. 2-3 : « Unterdeßen bringt mon maistre E[uer] L[iebden] mein berenkatzenaffengesischt mitt ; alle leütte hir sagen, daß mein kleiner bub mir gleicht, also können [Sie] woll dencken, daß es eben nicht so ein gar schön bürschen ist. […] Neues werde ich [Ihnen] nichts schreiben, weillen mon maistre [Ihnen] alles beßer mündtlich vorbringen wirdt undt [Ihnen] erzehlen, wie fro ich bin, nun reitten zu lernen, denn es sich trefflich woll zu liselotts rauschenbeüttelichen kopff schickt […]. » Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Diepholz, 19 sept. 1673. Bodemann, Briefwechsel, p. 167 : « Cependant un home de consequance arrive icy hier avec un flus d’esloquence, c’est le Sr. Geme [Jemme], qui m’entretient de Madame et m’a aporté son pourtrait avec celuy de Monsieur, dont j’ay eu bien de la joye, car je trouve, qu’il resemble, quoiqu’il n’y a pas cest air de jeunesse qu’elle avoit à Strasburg. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 100, p. 198.
– 91 –
Chapitre 2
Quelques indices suggèrent que la famille Jemme demeurait à la fois à Osnabrück et au Palais Royal. En effet, entre 1682 et 1702, Marguerite Robeau apparaît dans les États de la France en qualité de « Femme de Chambre de Madame » au Palais Royal.100 Un extrait des registres du Châtelet montre que la fille d’Élie Jemme et Marguerite Robeau, Élizabeth Jemme, fut placée sous la tutelle de Gabriel Gault, imprimeur à Paris, pour qu’il accepte en son nom une donation faite par Thomier, ordinaire de la musique du roi. Dans cet acte daté du 1er novembre 1685, Jemme est désigné comme « chef de la musique de Messieurs les princes de Brunswick ».101 Les cosignataires qui se portent garants de la tutelle sont « tous amis de la mineure cy apres nommée », mais aussi tous issus de la domesticité du Palais Royal. La famille Jemme semble donc travailler en même temps dans les deux résidences, à Paris et à Osnabrück. Lorsqu’il quitta Osnabrück en 1680 pour être installé comme duc de Hanovre, l’une des premières actions d’Ernst August fut de faire venir une nouvelle bande de violons français : E[rnst] A[ugust] se va recreer un peu par des violons qu’il a fait venir [de Paris], que son fils luy a choisi, qui ne coutent pas tant que la musique Italienne.102
Ces « violons » furent donc embauchés par l’intermédiaire de Georg Ludwig, le fils aîné de Sophie qui se trouvait à Paris, où il voyait très souvent sa tante Madame Palatine.103 Or Jean-Baptiste Farinel, chef de cette bande de violons, était probablement au service de la maison d’Orléans avant son arrivée à Hanovre. Son frère Michel Farinel rapporte en effet dans la préface de ses Concerts choisis : L’an 1667. je fus presenté a Madame Henriette Duchesse d’Orleans par Monsr. Le Comte de Maugiron Gendre de Mons[ieu]r le Mareschal Duc du Plessisprâlin. S[on] A[ltesse] R[oyale] me recommanda a Mons[ieu]r le Chevalier de Bouillon qui me fit faire sur mer la Campagne de l’An 1668. Nous fûmes a Lisbonne, ou je fis entendre mes premiers Conçerts a la Reine de Portugal. Quelque temps apres nôtre retour Madame mourut. Mons. le Chevallier fut tué par Monsr le Marquis de Laroche Courbon, & je vins a Grenoble, où les illustres Dames du Royal Monastere de Montfleury me donnerent la direction de leur Conçert.104
César de Choiseul, comte du Plessis-Praslin, avait séjourné chez le comte de Maugiron, à Vienne dans le Dauphiné, sur la route d’Italie en 1664.105 C’est probablement là que ce proche de la maison d’Orléans – qui avait été entre autres ancien gouverneur de Monsieur, qui accompagna Henriette d’Angleterre en Grande-Bretagne en 1670 et fut le procurateur du duc d’Orléans pour épouser la princesse Palatine à Metz – rencontra les frères Farinel, originaires de Grenoble situé à une centaine de kilomètres. On peut donc se demander si Jean-Baptiste Farinel n’a pas aussi transité par le Palais Royal, et plus largement si les six violons français qui arrivèrent à Hanovre en août 1680 n’étaient pas les violonistes de l’ancienne troupe de comédiens du Palais Royal, diri100 101
102 103 104
105
Voir L’État de la France, Paris 1682, p. 550 ; 1683, p. 575 ; 1692, p. 764 ; 1702, p. 101. Marguerite Robeau y est désignée de façon univoque comme « La Demoiselle Marguerite Robeau, femme de M. Gemme. » AN, Registres de tutelles, Y 4004 C, 1er nov. 1685 : « [il est disposé] que ledit Sieur Gabriel Gault soit eleu tuteur a dam[oise]lle Elizabeth Jemme fille mineure du Sieur Elye Jemme chef de la musique de Messieurs les princes de Brunswick et de Damoiselle Marguerite Robeau son epouze a l’effet d’accepter pour elle et signer la donnation entre vifs qui sera faite a lad[ite] dam[oise]lle mineure par Thomier ord[inai]re de la musique du Roy. » Thomier n’a pas pu être identifié. Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Hanovre, 5 août 1680. Bodemann, Briefwechsel, p. 432. HStA Hannover, Cal. Br. 22 Nr. 955. Voir aussi Antje Stannek, Telemachs Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts, Francfort 2001, p. 131-136. F-Pn, Rés. Vma Ms. 1219 : Michel Farinel, Les Concerts choisis de M. Farinelly de Cambert, Conseiller du Roy, recueillis par l’auteur, 1707, non paginé. Nous remercions Thierry Favier d’avoir attiré notre attention sur cette source et d’avoir mis à notre disposition sa transcription. Catherine Massip, « Itinéraires d’un musicien européen : l’autobiographie de Michel Farinel (1649-1726) », in : Musik – Raum – Akkord – Bild. Festschrift zum 65. Geburtstag von Dorothea Baumann, dir. Antonio Baldassarre et al., Berne 2012, p. 131-148. François-Alexandre Aubert de la Chesnaye Des Bois, Dictionnaire de la noblesse : contenant les généalogies, l’ histoire et la chronologie des familles nobles de France, vol. 3, Paris [1770-1778], p. 684.
– 92 –
Administrer la musique française
gée par Molière et officieusement protégée par le duc d’Orléans. C’est précisément en août 1680 que cette troupe fut réunie à la troupe royale de l’Hôtel de Bourgogne pour former la Comédie française, engendrant probablement du même coup une restructuration de leur personnel musical.106 De plus, le directeur de la troupe de comédiens français engagée par Ernst August en 1681, Auguste Pierre Pâtissier de Châteauneuf, avait été membre de cette troupe jusqu’en 1672. Un témoignage montre que Jean-Baptiste était arrivé dans l’Empire au plus tard le 8 mai 1680. L’auteur, qui se trouve à la ville thermale de Wiesbaden en compagnie de Jean Hérault de Gourville, décrit ainsi une musique entendue : On se promena pendant que les Trompettes & les Timballes redoublerent leurs fanfares, qui continuérent jusques à ce qu’on eut servi le repas. Il y eut une agréable Symphonie. Farinel la conduisoit. Depuis quelques mois il s’étoit donné au Duc, après avoir quitté le Service du Roy de France, ne pouvant durer longtemps dans un lieu. On fit grand’chère, & la coutume d’Allemagne étant de tenir longue table, on ne s’en leva que sur les quatre heures.107
L’affirmation selon laquelle Farinel était au service de Louis XIV pourrait renvoyer à une activité dans une troupe de théâtre royale, puisqu’il n’apparaît nulle part dans le personnel musical de la cour. L’auteur de ce témoignage estime que Farinel est arrivé « depuis quelques mois », soit dès le début de l’année 1680. Il pourrait donc avoir anticipé de six mois la réunion des deux troupes et être allé chercher un emploi ailleurs. Quoiqu’il en soit, on voit que l’engagement d’une bande de musiciens français en 1680, précédant de quelques mois celui d’une troupe de comédiens français, se fait dans des milieux proches du Palais Royal. Le patronage de théâtre et de musique française est donc lié aux réseaux personnels et familiaux de Sophie, mais également à l’identité résolument galante du nouveau couple régnant de Hanovre. Tolérance confessionnelle et indifférence religieuse Si Sophie de Hanovre forme un cas exceptionnel, elle n’est pas la seule personne de son entourage à cultiver une identité aristocratique résolument galante et rationaliste. Son mari Ernst August, avec qui elle cultivait une complicité remarquable accompagnée d’une relative indifférence en matière de fidélité conjugale, était aussi un prince « galant » non seulement dans le sens courant du terme puisqu’il accumulait les conquêtes, mais aussi en matière de lectures et de religion. Quant au duc de Celle Georg Wilhelm, il avait marqué son mépris des conventions sociales, des obligations du rang et des frontières confessionnelles en se mettant en concubinage avec la huguenotte Éléonore Desmiers d’Olbreuse, qu’il ne put pas épouser avant 1676, après avoir donné naissance à un enfant hors mariage. Lorsqu’il monte sur le trône de Saxe une vingtaine d’années plus tard en 1694, Auguste le Fort est aussi le représentant de cette nouvelle classe d’aristocrates marquée par un intérêt pour les productions culturelles françaises, des mœurs plutôt libérales (ou « galantes ») et une aversion pour l’orthodoxie religieuse. À Dresde comme à Osnabrück, Celle ou Hanovre, cette attitude se reflétait entre autres dans le patronage de musique française. La conversion au catholicisme du jeune prince électeur, entérinée le 2 juin 1697 à Baden, était la première rupture opérée avec ses prédécesseurs, et sans doute la plus profonde. Bastion de l’orthodoxie luthérienne et tête du Corpus Evangelicorum, la Saxe se concevait comme le berceau de la Réforme, Friedrich III dit Le Sage ayant été l’un des premiers soutiens de Martin Luther. De ce fait, les princes-électeurs de Saxe étaient toujours vus comme les garants des droits des princes protestants dans l’Empire, et les défenseurs de leurs intérêts. Signe du caractère sensible de ce sujet, la conversion d’Auguste le Fort ne fut d’abord pas rendue publique alors qu’elle était un prérequis pour pouvoir être élu sur le trône de Pologne.108 Une fois parvenu à ses fins, le roi 106 107 108
Mongrédien, La vie quotidienne des comédiens, p. 121. Anonyme, Voyages faits en divers temps en Espagne, en Portugal, en Allemagne, en France, et ailleurs, Amsterdam 1699, p. 245. Augustin Theiner, Geschichte der Zurückkehr der regierenden Häuser von Braunschweig und Sachsen in den Schoss der Katholischen Kirche im achtzehnten Jahrhundert, und der Wiederherstellung der Katholischen Religion in diesen Staaten, Einsiedeln 1843, vol. 1, p. 103-149.
– 93 –
Chapitre 2
fraîchement converti se garda pourtant bien – en dépit des promesses faites à Rome – de toucher à l’équilibre confessionnel de la Saxe et d’y introduire le catholicisme. Au contraire, il renforça à plusieurs reprises le statu quo en matière religieuse : l’édit de Lobskowa, signé le 6 août 1697 et régulièrement confirmé jusqu’en 1712, accordait aux seuls luthériens le droit d’exercer leur religion en Saxe.109 Pour assister à la messe, les fidèles catholiques pouvaient se rendre en Bohême ou en Haute-Lusace, ou bien à l’ambassade impériale où une messe était célébrée porte close selon une dérogation déjà ancienne.110 Cet habile panel de mesures permit à Auguste le Fort de résister pendant quelques années aux pressions du Saint-Siège, désireux de voir établir des lieux de culte catholiques en Saxe. Il ne se montra pas non plus disposé, comme l’espérait la Curie romaine, à démissionner du Corpus Evangelicorum dont il était membre statutaire et doyen de droit, mais se contenta de déléguer les affaires courantes au duc Friedrich II von Sachsen-Weissenfels.111 Les premiers épisodes de la Grande guerre du Nord (1700-1721) firent voler en éclat cet équilibre précaire : défait par Karl XII de Suède à la bataille de Kliszów (19 juillet 1702), Auguste le Fort dut renoncer au trône de Pologne en faveur de Stanisław Leszcyński et signer le traité d’Altranstädt (24 septembre 1706). Entre autres clauses humiliantes comme l’obligation de renoncer à toutes les alliances antérieures ou d’accorder le quartier aux troupes suédoises de passage, l’article 19 interdisait à Auguste le Fort et à ses descendants de modifier le statu quo religieux garanti par les traités de Westphalie – et donc, de construire ou d’accorder aux catholiques des églises, des écoles, des académies ou des abbayes.112 Pour pouvoir envisager de reprendre un jour possession de la Pologne, Auguste le Fort devait empêcher la reconnaissance par le Saint-Siège du nouveau roi imposé par les Suédois, et devait donc donner des gages renouvelés à l’Église catholique, d’autant qu’une série de rumeurs prétendait qu’il s’était de nouveau converti au luthéranisme. En mars 1708, Auguste le Fort écrivit au pape, par l’intermédiaire de son ambassadeur à Rome le baron von Schenck, qu’il envisageait toujours de récupérer la couronne polonaise et qu’il allait faire consacrer une chapelle catholique dans la ville de Dresde, comme preuve qu’il était demeuré fidèle à la foi catholique.113 C’est dans cette perspective qu’il fit aménager, au mépris du traité d’Altranstädt, l’ancien opéra de la cour, érigé par Johann Georg II entre 1664 et 1667, en chapelle catholique et lui conféra le titre de Capella Regia.114 Consacrée le 7 avril 1708 par le jésuite Karl Moritz Vota, la première chapelle catholique de Dresde répond donc à la volonté d’Auguste le Fort d’affirmer son statut de souverain catholique (Illustration 2.2). Les Règlements du roi pour l’Eglise et Chapelle royale, ouverte aux catholiques, rédigés en français par Vota en 1708 et signés de la main d’Auguste le Fort, s’inscrivent parfaitement dans ce contexte politique : l’insistance mise sur les termes de « roi » et de « chapelle royale » tout au long du document fait apparaître celui-ci comme un véritable manifeste politico-religieux visant à doter la cour de Dresde d’un organe liturgique digne d’un souverain indépendant. Les principales dispositions concernent la liturgie, l’entretien du personnel et l’attitude à adopter par rapport aux protestants, mais la référence très frappante à la « splendeur accoutumée des Roix et Souverains Catholiques » dans l’article sur la musique trahit aussi la présence de modèle musicaux étrangers : § 8. Les Predications se feront touts les Dimanches et Festes commandées et ces jours la on chantera une Messe solemnelle avec la Musique à voix et Instruments du Roi et avec la splendeur accoutumée des Roix et Souverains Catholiques et meme dans les Messes privées des jours ouvriers toutes les fois que le Roi s’y trouvera les Musiciens de la Chapelle doivent s’y trouver. § 9. Les Dimanches et Festes commandées il y aura Vespres chantées en Musique, quand meme le Roi ne pourroit pas s’y trouver, Apres les Vespres un Chapelain fera le Catechisme aux enfants.115
109 110 111 112 113 114
Ziekursch « August der Starke und die katholische Kirche », p. 105. Frandsen, Crossing confessional boundaries, p. 76-100. Ziekursch, « August der Starke und die katholische Kirche », p. 108-109. Wolfgang Horn, Die Dresdner Hofkirchenmusik 1720-1745. Studien zu ihren Voraussetzungen und ihrem Repertoire, Kassel 1987, p. 19. Ziekursch, « August der Starke und die katholische Kirche », p. 122-127. Friedrich August Forwerk, Geschichte und Beschreibung der königlichen katholischen Hof- und Pfarrkirche zu Dresden, Dresde 1851, p. 11.
– 94 –
Administrer la musique française
La littérature secondaire évoque la plupart du temps la prégnance du modèle viennois116, mais d’autres éléments rendent plus probable la référence au modèle versaillais, moyen classique pour les princes allemands de prendre leur autonomie symbolique par rapport à l’Empereur.117 De ce point de vue, l’iconographie de la nouvelle chapelle est particulièrement intéressante. Dans un recueil de gravures sur les festivités qui accompagnèrent le mariage du prince Friedrich August II avec la princesse d’Autriche, Maria Josepha von Oesterreich en 1719, deux gravures montrent la chapelle : une première gravure de Raymond Leplat (1664-1742), architecte et décorateur huguenot actif à Dresde comme Ordonnateur du cabinet et inspecteur général des collections royales, montre l’intérieur de la chapelle. La seconde est réalisée par Antoine Aveline (1691-1743), graveur parisien ayant notamment produit deux représentations de l’intérieur de la chapelle royale de Versailles.118 La participation du personnel musical français dans la production de musique d’église catholique est documentée par le journal de la communauté de jésuites qui desservaient la chapelle.119 Cette source, qui retrace jour après jour la vie quotidienne de la chapelle et de la communauté de prêtres, mentionne à plusieurs reprises la participation des musiciens français à la production de musique liturgique : le 22 novembre 1711, les « musiciens français du Roi » (« Galli Musici Regii ») exécutent à l’occasion de la Sainte-Cécile une messe de Zelenka.120 Le 30 novembre 1712, le journal mentionne à nouveau la participation des Galli Regii Musici à l’office de la Saint-André.121 Le journal mentionne également le 4 novembre 1712 une invitation de deux comédiens français chez les jésuites, et le 22 avril 1715, deux prêtres vont déjeuner chez François Le Riche.122 À partir de 1720, le journal ne précise plus si les musiciens du roi qui participent aux offices sont français ou italiens, sauf dans de rares cas où la présence d’Italiens est spécifiée. Le 14 juin 1722, un certain Français – Reich émet l’hypothèse qu’il s’agit de Louis André – compose et dirige une messe avec les musiciens de la Hofkapelle.123 Les musiciens français ont donc certainement eu, au moins entre 1708 et 1720, un rôle privilégié dans l’élaboration de la musique à la chapelle royale de Dresde. Avant cette date, la messe n’était célébrée qu’à titre privé au château de Moritzburg, à quelques kilomètres de Dresde, et les musiciens n’étaient requis que de façon très exceptionnelle.124 Gerhard Poppe, constatant les différences importantes qui distinguent les compositions pour la chapelle royale de Ristori, Heinichen et Zelenka, émet l’hypothèse tout à fait convaincante que les trois compositeurs écrivaient pour des ensembles musicaux différents : Heinichen semble écrire pour 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Theiner, Geschichte der Zurückkehr, vol.2, p. 75-78. Janice B. Stockigt, Jan Dismas Zelenka. A Bohemian Musician at the Court of Dresden, Oxford 2000, p. 70. Pour plus de détails, voir Louis Delpech, « Les Motets pour la chapelle du roy à la cour de Saxe. Contours et enjeux d’un transfert musical (1697-1721) », in : La Circulation de la musique et des musiciens d’église, France xvie xviiie siècles, dir. Xavier Bisaro, Gisèle Clément, Fañch Thoraval, Paris 2017, p. 147-166. Alexandre Maral, La Chapelle royale de Versailles sous Louis : cérémonial, liturgie et musique, Sprimont 2002, Fig. 24 et 25. Wolfgang Reich, « Das Diarium Missionis Societatis Jesu Dresdae als Quelle für die kirchenmusikalische Praxis », in : Zelenka-Studien II, p. 29-41, transcription des extraits qui concernent la musique p. 315-379. Le journal ne couvre pas les années 1708-1710. Reich, « Das Diarium », p. 323 : « Musicam pro Sacro cantato fecerunt Galii Regii Musici in honorem Sanctae Caeciliae Virginis et Martyrae quod recenter composuit Dominus Zelenka, pariter Musicus Regius. » La Missa Sanctae Caeciliae de Zelenka (Z1a) est encore conservée sous forme manuscrite : D-Dl, Mus. 2358-D-8. Reich, « Das Diarium », p. 325 : « Festum S. Andreae Apostoli. […] Sub Sacro cantato musicam solennem fecerunt Galli Musici Regii et diu ante probaverunt. Interfuit invitatus ab illis Seren. Princeps Gubernator. » Reich, « Das Diarium », p. 325 : « In prandio adfuerunt duo Domini Galli comoedi, D. Carolus [Caprano] Italus. » Reich, « Das Diarium », p. 327 : « Pater Colendall et P. Hartman pransi sunt apud Le Riche, domi nostrae duo Itali. » Reich, « Das Diarium », p. 336 : « Hora 11. Sacrum cantatum, composuit aliquis Gallus [André ?] hoc Sacrum et cum Regiis Musicis illud produxit. » Gerhard Poppe, « Kontinuität der Institution oder Kontinuität des Repertoires ? Einige Bemerkungen zur Kirchenmusik am Dresdner Hof zwischen 1697 und 1717 », in : Micellaneorum de musica concentus. Karl Heller zum 65. Geburtstag am 10. Dezember 2000, dir. Alexander Walpurga, Joachim Stange-Elbe et Andreas Waczkat, Rostock 2000, p. 49-81, ici p. 63.
– 95 –
Illustration 2.2. Raymond Leplat : Vue interieure de la Chapelle Roïale au Chateau de Dresde ou l’on a chanté le Te Deum, en actions de graces de l’Arrivée de Leurs Altesses Roïales, gravure suir cuivre, après 1719, 65,5x92 cm. Dresde, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett, C 6691.
Chapitre 2
– 96 –
Administrer la musique française
un orchestre complet qui regroupe l’ensemble des forces instrumentales de la Hofkapelle ainsi que des chanteurs italiens, Ristori compose pour un petit ensemble italien, et Zelenka semble plutôt écrire pour des instrumentistes et chanteurs formés au style français, comme l’indiquent l’absence de cors, la présence de flûtes et de chalumeaux, une écriture particulièrement virtuose pour les hautbois ainsi que la présence occasionnelle d’un orchestre à cordes à cinq parties avec deux parties d’alto.125 On note également une écriture soliste très développée pour voix de basse qui n’apparaît jamais dans les œuvres de Heinichen et Ristori, et une écriture pour soprano qui se meut dans un ambitus restreint tout en se voyant confier très peu d’interventions solistes.126 L’utilisation par Auguste le Fort d’un modèle musical français est parfaitement logique. Pendant tout le xviie siècle, la cour Dresde avait utilisé la musique italienne comme pendant sonore à la baroquisation visuelle et architecturale qui présida à la même période aux destinées de l’art luthérien en Saxe.127 Le Kapellmeister Heinrich Schütz (1585-1672) constitue l’un des exemples les plus célèbres de cette orientation stylistique résolument tournée vers Rome et vers Venise où il avait séjourné à plusieurs reprises. L’arrivée au pouvoir de Johann Georg II en 1656 confirma cette orientation : parallèlement à la restauration de la chapelle ducale en 1661-1662, de nombreux castrats italiens furent engagés dans la Hofkapelle de Dresde.128 Cette politique musicale orientée vers la splendeur et la magnificence était le reflet du poids politique et du prestige de la Saxe à la fin du xviie siècle, mais aussi de sa tradition luthérienne. Lorsqu’il arriva au pouvoir, l’une des premières décisions prises par Auguste le Fort fut de renvoyer les musiciens italiens qui avaient été engagés en 1685 par Johann Georg III et reconduits par Johann Georg IV.129 Seuls les musiciens allemands et le maître de danse Charles Dusmeniel se voyaient prolongés dans leurs fonctions. Il réactivait donc une stratégie déjà éprouvée à Hanovre, qui coïncide avec un positionnement confessionnel singulier, une rupture avec l’orthodoxie luthérienne de ses précédesseurs, mais également avec une laïcisation des fonctions musicales de la Hofkapelle.
La construction administrative d’une catégorie stylistique En 1663, le violoniste et compositeur Nikolaus Adam Strungk fut chargé par la cour de Celle d’esquisser le projet d’une chapelle idéale, dans le but de réorganiser le personnel musical de la cour après le départ de plusieurs musiciens importants. Le document manuscrit dans lequel il consigne sa proposition sous le titre « Ce qu’il faut pour établir une chapelle », insiste à plusieurs reprises sur l’importance d’avoir des musiciens capables d’exécuter de la « französische Music » (Tableau 2.6).130 Le statut d’une telle catégorie est difficile à cerner : il peut s’agir d’une appellation d’origine recouvrant l’exécution d’un répertoire véritablement français, d’une catégorie stylistique renvoyant à un certain type de pratique musicale ou de composition, voire d’un certain contexte d’exécution comme le théâtre ou la danse. Dans l’ensemble unifié de treize musiciens qu’il propose, Strungk recherche fréquemment une double compétence dans la musique dite normale (« rechte Musik ») et la musique française : les trois chanteurs adultes doivent pouvoir aussi jouer du violon dans la musique française (« welche zugleich in französischer Music eine Violin gebrauchen könnten »), les deux violonistes (ou violistes) doivent être versés aussi bien dans la musique française que dans la 125
126 127 128 129 130
Gerhard Poppe, « Dresdner Hofkirchenmusik von 1717 bis 1725 : Über das Verhältnis von Repertoirebetrieb, Besetzung und musikalischer Faktur in einer Situation des Neuaufbaus », in : Mitteldeutschland im musikalischen Glanz seiner Residenzen. Sachsen, Böhmen und Schlesien als Musiklandschaften im 16. und 17. Jahrhundert, dir. Peter Wollny, Beeskow 2005, 301-342, ici p. 330-331. Poppe, « Dresdner Hofkirchenmusik », p. 333-336. Sur les aspects visuels de la chapelle, voir Heal, A Magnificent Faith, p. 207-217. Voir entre autres Mary E. Frandsen, « Allies in the Cause of Italian Music : Schütz, Prince Johann Georg II and Musical Politics in Dresden », Journal of the Royal Musical Association, 125/1, 2000, p. 1-40. Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 8. NLAH, Celle Br. 34 Nr. 47, fol. 67 : « Was zu einer bestellenden Capellen von nothen 1663 ». Transcription donnée en Tableau 2.6. Fritz Berend, Nicolaus Adam Strungk (1640-1700). Sein Leben und seine Werke mit Beiträge zur Geschichte der Musik und des Theaters in Celle, Hannover, Leipzig, Hanovre 1913, p. 29.
– 97 –
Chapitre 2
Tableau 2.6. Deux projets de chapelle par Nicolaus Adam Strungk. 1.
Nikolaus Adam Strungk : Projet de chapelle pour Celle, 1663. NLAH, Celle 44 Nr. 47, fol. 67
Was zu einer bestellenden Capellen von nohten. 1663. Auff Ew. Hochlbl. Magnif. Hochgönstiges Begehren habe unter dienstgehorsamer Schuldigkeit nach entwerffen wollen, was zu einer zum Theil bestellten rechten Capell gehörig, und welche personen zu derselben dienlich seyn würden. als. 1
Ein Director Musices
2
Ein Altist
3
Ein Tenorist
4
Ein Bassist
5
Zwo sowohl in rechter alß in französischer Musik bestelte Violisten, so bereits hier seyn.
6
Ein Viola da Gambist, welcher auch schon hie ist.
7
Ein Organist, der ebenmäßig alhie ist.
8
Ein Trombonist od. Fagottist so zugleich eine Stimme singet und in französischer und rechter Music ein Violin gebraucht.
ß Í
welche zugleich in französisch. Music eine Viol. gebrauchen könnten
9
Ein Cornetist der in frantzösischer Musik ein Violin gebraucht.
10
Zwo Capellknaben.
11
Ein Calcante.
Summa 13 personen. 2.
Nikolaus Adam Strungk : Projet de chapelle pour Dresde, 1694. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 4, fol. 209-210
Verzeichnüß derer Persohnen und Besoldung der Churfürstl. Deütschen Capell Music 1694 Zu Einrichtung einer wolbestalten Capell werden folgende Persohnen nothwendig erfordert. Ein CapellMeister der Vice CapellMeister od ein ConcertMeister Zweÿ Chöre Vocal Stimmen alß Ein Bassist ein Tenorist ein Altista auch Discant ist zum Ersten Chor Ein Bassist, Ein Tenorist, ein Altist und Discant ist zum anderen Chor 2 Chöre Instrumentisten zum ersten Chor 2 Violinisten, 2 mit Tenor und Alt Geigen nebst dem Fagottisten wiederum 2 Cornettisten und 3 Trombonisten ferner zween organisten alß 1. beÿ der Concertierenden Parteÿ und 1 beÿ den großen orgell Ein Violonist Ein Notist od Copiist Zween Musicalische Trompeter Ein Musicalischen Pauker Item benötigte tüchtige Capellknaben 6 an der Zahl Ein Hofcantor Ein Orgel od Instrumentemacher zween Calcanten Welches hiermit begehrter maßen pflichtmaßig und geshorsamlich hinterschrieben und an beÿ erinerrn sollen, daß beÿ ietziger Verenderung auff ein und anderer Adiuctum zugedencken, hochstnötig. Nicolaus Adam Strungk ChurSächs: Capellmeister Dresden am 10 Augusti ao 1694:
– 98 –
Administrer la musique française
vraie musique (« Zwo sowohl in rechter alß in französischer Musik bestelte Violisten »), le tromboniste ou bassoniste doit pouvoir en même temps chanter et jouer du violon aussi bien dans la musique française que dans la vraie musique, et le cornettiste doit enfin pouvoir jouer du violon dans la musique française. L’opposition mystérieuse formulée entre ces deux catégories montre d’abord qu’il s’agissait de dénominations suffisamment explicites à Celle au début des années 1660 pour pouvoir être employées sans explication et comme allant de soi dans un document de nature administrative – mais cette dichotomie ne se retrouve nulle part ailleurs. Notons que les chanteurs prévus dans la chapelle doivent se convertir en violonistes pour la musique française, tout comme les instrumentistes à vent : cette musique ne semble donc pas requérir de voix ni de vents, mais seulement des cordes. Si l’on peut formuler l’hypothèse que la musique dite « française » renvoie ici à la musique dansée, puisque Christian Ludwig n’avait pas de théâtre ni de comédiens, ce document montre bien l’entrecroisement, dans les documents produits par l’administration curiale, de deux logiques distinctes : une logique administrative, de contrôle et d’archivage des dépenses, de gestion du personnel, et une logique musicale, centrée sur la question du répertoire, du contexte d’exécution et des compétences des musiciens. Le violoniste Nikolaus Adam Strungk avait été nommé musicien de la cour de Celle en juin 1660. Le projet de chapelle qu’il esquissa en 1663 resta lettre morte, puisque Christian Ludwig mourut dès 1665. Strungk entra alors au service de Johann Friedrich à Hanovre, qui lui offrit en 1673 un canonicat au chapitre Beatae Mariae Virginis à Einbeck. Il fut nommé en janvier 1688 Vizekapellmeister de la cour de Dresde, avant d’accéder au poste de Kapellmeister à la mort de Christoph Bernhard en 1692. Lors de l’accession au pouvoir d’Auguste le Fort en 1694, il se trouvait donc dans une position similaire à celle qu’il avait connue à Celle, se trouvant à la tête d’une chapelle en sursis, qui devait se réinventer à la suite d’un changement politique.131 Dès l’arrivée d’Auguste le Fort, Strungk dut rédiger le 10 août 1694 un second projet de chapelle, qui faisait le point sur les « personnes absolument nécessaires pour l’établissement d’une chapelle bien fournie ».132 Le nouveau projet esquissé par Strungk adopte la division vénitienne en deux chœurs, introduite à la Hofkapelle de Dresde depuis le début du xviie siècle par Heinrich Schütz. S’adaptant au contexte local et aux moyens financiers bien plus importants de la cour de Dresde, Strungk décrit ici un ensemble composé de trente-sept musiciens : un Kapellmeister, un vice-Kapellmeister ou Concertmeister, deux chœurs de quatre chanteurs chacun, deux chœurs de cinq instrumentistes chacun, deux organistes, un violoniste, un copiste, deux trompettes, une timballe, six Kapellknaben, un Cantor, un facteur d’instruments et deux Calcanten. Mais Strungk ne fait ici aucune mention de musique française – absence paradoxale, puisque plusieurs musiciens français allaient être engagés par Auguste le Fort. Il semblerait que Strungk, habitué à la présence de musiciens italiens à Dresde, n’a pas su anticiper le tournant français pris à partir de 1694, ce qui n’a sans doute pas été sans conséquence sur sa marginalisation au sein de la Hofkapelle de Dresde et sur les réductions importantes de personnel qui lui furent imposées entre mars et mai 1695.133 La comparaison de ces deux listes de personnel rédigées par la même personne à trente ans d’intervalle dans des contextes très différents, montre bien le statut problématique de la musique française et invite à interroger la production d’actes administratifs qui la sollicitent comme catégorie constituée, mais au statut incertain. Entre dénomination stylistique, appellation d’origine et rubrique administrative, l’expression même de musique française est le plus souvent polysémique, non explicitée, et peut recouvrir des réalités très différentes. Faire l’archéologie de cette dénomination conduit donc nécessairement à s’interroger sur les ressorts comptables et administratifs qui président à son utilisation dans la production bureaucratique d’État, avant qu’elle n’émerge comme catégorie stylistique de premier plan dans l’espace germanophone autour de 1700. 131 132 133
Michael Maul, Art. « Strungk, Nikolaus Adam » in : MGG online. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 4, fol. 209-210. Voir en particulier la liste de 1695 intitulée Dispositio der reducirten Capell in Dresden ao 1695 : HStA Dresden, 10006 OHMA, K III Nr. 8, fol. 156.
– 99 –
Chapitre 2
Pensée sauvage et bricolage administratif L’identification des musiciens français (« Frantzösische Musicanten ») en tant que groupe spécifique au sein du personnel musical de la cour repose sur une double ségrégation opérée de manière plus ou moins consciente et explicite par les différentes administrations : séparation d’avec les musiciens allemands et italiens d’une part, séparation d’avec les comédiens et danseurs français d’autre part. Aucune de ces distinctions ne va de soi, aucune n’est purement logique, et aucune ne génère de typologie parfaitement étanche : ces catégories, qui semblent toujours improvisées, précaires et poreuses, ne font jamais l’objet d’une définition ni même d’une tentative d’explication. Leur usage est en outre très variable : ici, les « Frantzösische Musicanten » sont un groupe d’instrumentistes français au sein de l’orchestre de la Hofkapelle ; là, ce sont des chanteurs français par opposition aux opéristes italiens ; autre part, cette catégorie regroupe tous les musiciens non allemands. En fait, cette partition du personnel musical ne repose pas sur une pensée systématique, ne renvoie à aucune essence et ne postule aucune identité – elle est bien plutôt le résultat de ce que LéviStrauss aurait appelé un « bricolage » conceptuel typique de la « pensée sauvage », c’est-à-dire l’inventorisation, avec les moyens du bord, d’un ensemble fini d’objets hétéroclites – ici, les musiciens.134 Autrement dit, la rubrique « Frantzösische Musicanten » est un produit de la pensée sauvage des administrations, le résultat de son axiome fondamental (« Tout classement est préférable au chaos135 ») ainsi que l’effet de pratiques contingentes et locales, qui ne sont pas gouvernées par un projet de connaissance ou de description du réel, mais dont la sédimentation finit néanmoins par produire des dénominations relativement stables pour l’organisation, la gestion, mais aussi la compréhension de la musique dans le monde de la cour. Dans cette perspective, le style français ne préexiste pas à la migration des musiciens, mais il est au contraire partiellement son résultat, par le biais de son inventorisation au sein de rubriques créées par les pratiques administratives curiales. Désignation, origine, identité La dénomination « Frantzösische Musicanten » n’est pourtant pas complètement arbitraire : elle coïncide la plupart du temps avec une origine sinon française, du moins francophone. Cependant, elle conserve toujours un caractère fluide et partiel, puisqu’elle intègre souvent des musiciens originaires de territoires frontaliers ou extérieurs au royaume de France. Il serait d’ailleurs étonnant qu’il en aille autrement à une époque où les identités nationales sont fluctuantes et où l’étranger se décline selon toute une palette de nuances allant du plus proche (la ville ou la région voisine) au plus lointain (le pays ou le continent). Plusieurs musiciens français engagés à la cour de Güstrow sont ainsi originaires des Pays-Bas espagnols, région francophone sous la tutelle des Habsbourg : Servais Le Roy (alias Servaas von der König) est ainsi natif du Brabant, tandis que Daniel Danielis est natif de Visé, près de Liège. Dans la comptabilité de Hanovre, une distinction entre musiciens français (« Französische Musicanten ») et allemands (« Teutsche Musicanten ») apparaît à partir de 1698, mais cette ligne de partage ne recoupe pas nécessairement l’origine géographique des individus : Clemente Monari, violoniste italien né à Bologne vers 1660 et qui commença sa carrière dans la chapelle du duc de Modène, figure ainsi parmi les « Frantzösische Musicanten ».136 À l’inverse, Charles Ennuyé est listé parmi les musiciens allemands alors qu’il est probablement le fils d’Antoine Ennuyé, employé comme « cuisinier français » à la cour de Hanovre, et de Jeanne Ravielle.137 Ce couple est dit « luxembourgeois » dans les registres paroissiaux catholiques138, avant qu’Antoine Ennuyé ne soit décrit comme « premier cuisinier d’Ernst August » et « citoyen 134 135 136 137 138
Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris 1962, p. 26-33. Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, p. 24. Eldivio Surian, « Monari, Clemente » in : Grove Music online. Voir par exemple NLAH, Hann. 76c A Nr. 100, p. 206 : « Dem frantzösischen Mundkoch Mr. Anthon Ennuÿ besoldung 312 Thlr. » BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, p. 102 (« ex parentibus Antonio Ennÿ et Johanna Raviello Luxenburgensi, legitimis coniugibus. ») et 117 (« ex dno Antonio Enuy et Joanna Baniello Luxemburgensi, legitimis conjugibus »).
– 100 –
Administrer la musique française
d’Anvers » dans son acte de décès.139 Georges-Louis Ennuyé, le frère de Charles, sera aussi intégré parmi les « Teutsche Musikanten » en 1701 pour remplacer Friedrich Lotti, qui appartenait aussi à cette catégorie en dépit de ses origines italiennes.140 Enfin, toujours à Hanovre, François Venturini représente un autre cas intéressant : son patronyme sonne italien, il rédige la dédicace de ses Concerti di camera (1714) en italien, mais les registres paroissiaux le désignent constamment comme « Gallus », même s’ils divergent sur son origine exacte, mentionnant Bruxelles ou Valenciennes.141 Entre 1698 et 1714, Venturini est d’ailleurs systématiquement classé parmi les « Frantzösiche Musicanten », et ses réseaux de sociabilité sont largement français : en janvier 1697, quelques mois avant d’être embauché, il épouse Marie Ennuyé, probablement la sœur de Charles et Georges-Louis142 ; Henrietta Venturini, probablement sa sœur, épouse en 1699 le musicien français Guillaume Barré143 ; enfin, il est en 1713 le parrain de l’enfant de Jean-François Graep, musicien français de la cour de Celle.144 Les Hofkapellen font ainsi souvent coexister des individus d’origines multiples, et on peut repérer une pluralisation parfois très marquée de la provenance du personnel. Si la Hofkapelle de Celle est exclusivement composée de musiciens français pendant les trente premières années du règne de Georg Wilhelm, elle intègre à partir de 1696 un musicien italien, Pietro Agostino Bonadei, qui ne jouit cependant d’aucun statut spécifique puisqu’il touche le même salaire et remplit les mêmes fonctions que les autres musiciens.145 Ce mouvement se poursuit l’année suivante, avec l’embauche de Hans Jurgen Vogt et Ernst Heinrich Grimm.146 Notons que, contrairement à l’administration de Hanovre, la comptabilité de la cour de Celle n’explicite jamais la nationalité de ses musiciens, sauf au tout début de l’existence de la nouvelle Hofkapelle. Les derniers musiciens engagés avant la mort de Georg Wilhelm sont de nouveau français : Bernard et Jean-François Graep, originaires de Bourgogne.147 Jean-François Graep, engagé en 1705, sera le dernier musicien à entrer en service, quelques mois seulement avant la mort de Georg Wilhelm, le rattachement de facto de la principauté de Lüneburg à celle de Hanovre et la dissolution de la Hofkapelle de Celle. Beaucoup plus tard, en 1719, la chanteuse française Madeleine de Salvay se trouve parmi les musiciens italiens de la troupe de Ristori en dépit de ses origines françaises. Embauchée à Dresde comme chanteuse (« Sängerin »), elle touche un salaire annuel remarquablement élevé de 2000 Thaler, aligné sur le paiement des musiciens italiens et non sur celui des français.148 Un billet en français de Madeleine de Salvay, qui demande un supplément pour son « quartier » est joint à cet acte.149 Lorsque la chanteuse et son mari, François de Salvay, font baptiser une enfant 139
140 141
142 143 144 145 146 147 148 149
BAHild, KB Nr. 782, Hannover St. Clemens, Beerdigungen 1711-1833, p. 28 : « 30. 7bris [1720] Dominus Antonius Enuis Civis Antverpiensis et Celsissimi Ducis Ernesti et S. R. I. Electorais Brunsvico-luneburgensis Coquus primarius 95. aetatis suae annis. Pie in dno obicit et sepultus est ad portam S. Aegidii in Coemeterio Catholicorum. Ita testo Joannes de Marteau. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 121, p. 305 : « George Louis Ennÿe so an deßen Stelle [= Friedrich Lotti] wiederkommen von Mich. 1701 biß Ostern 1702 halbjährig, 50 Thlr. » L’acte de mariage de Venturini précise « Franciscum Venturini gallum ». L’acte de baptême de son second enfant le nomme « D. Francisco Venturini Pruxellensi Musico ». En revanche, lorsqu’il représente le comte de Platen lors du baptême de l’enfant de Jean François Graep, musicien de Celle en 1713, on lit : « Francisco Venturini ex Valentien ». Maria Ennuyé, née à Hanovre, est sans doute la fille du cuisinier Antoine Ennuyé, qui apparaît comme témoin lors de son mariage, et la sœur des musiciens Charles et Georges-Louis Ennuyé : BAHild, KB Nr. 778, Hannover St. Clemens, Traubuch 1667-1711, p. 138. BA Hildesheim, KB Nr. 778, Hannover St. Clemens, Traubuch, 1667-1711, p. 111. BA Hildesheim, KB Nr. 780, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1711-1717, p. 20. NLAH, Hann. 76c A Nr. 222, p. 514. NLAH, Hann. 76c A Nr. 223, p. 563. L‘origine de Jean-François Graep apparaît dans un registre paroissial de Hanovre : « Joanne Francisco Grap ex Valerien in Gallia. » BAHild, KB Nr. 780, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1711-1777, 13 avr. 1713, p. 20. Il pourrait s’agir du Mont-Valérien, ou plus probablement de la commune bouguignone Saint-Valérien. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/3, fol. 177. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/3, fol. 178 : « Le premier d’octobre 1719 iaÿ eu l’honneur d’avoÿr esté arrettée au service actuel de Sa Maiesté Polonoise e mes gages sont este fixée à deux mille ecus par
– 101 –
Chapitre 2
à la chapelle catholique du château le 24 décembre 1719, le parrain est Giovanni Alberto Ristori, musicien italien.150 Elle est renvoyée en février 1720, en même temps que tous les autres musiciens et chanteurs de l’opéra italien, dont la plupart vont alors rejoindre Händel à Londres.151 Quelques années plus tôt, la liste du personnel de l’opéra de 1689 conservée à Hanovre liste parmi les « six musiciens italiens » des patronmyes allemands et le fils du Français Élie Jemme, Georg Ludwig.152 On perçoit bien, au milieu de ce melting-pot, que la catégorie « Frantzösische Musicanten » créée par l’administration n’a pas à voir en premier lieu avec l’origine des musiciens, mais relève d’une commodité administrative désignant un groupe avec des fonctions bien définies. À la cour de Stuttgart, tous les violonistes sont priés en 1684 de rejoindre la « Bande françoise », alors même que seuls trois Français sont présents à la cour à cette époque : 4. Et de plus que pas un des violons ne soit exemt de jouer en cas de besoin dans la Bande Françoise [all : dem frantzösischen Bande von dero Violisten], mais qu’ils s’y trouvent sans contradiction sous peine de cassation ; S[on] A[ltesse] S[érénissime] cependant pretend que l’on tire de la bande entiere une bande separée, pour servir à la Danse françoise, et aux exercices ordinaires de Monseigneur le jeune Prince et les Princesses.153
Placée sous la direction de Johann Sigismund Cousser, cette bande « française » de violonistes, composée en majorité de musiciens allemands, était caractérisée par un ensemble de pratiques orchestrales à la française et par la nature spécifique de ses obligations, devant probablement jouer pour le théâtre en grand groupe, et pour la danse en petit groupe. De la comédie à la Hofkapelle Plus que de leur origine, les musiciens français semblent donc tirer leur identité d’un ensemble de fonctions musicales précises. Plusieurs documents administratifs suggèrent une double appartenance, les musiciens dépendant à la fois d’une troupe de comédiens et de la Hofkapelle. À Dresde, beaucoup d’entre eux furent d’abord engagés pour servir à la comédie française. Notons qu’à la différence des cours de Basse-Saxe, la production administrative de Dresde n’emploie jamais la catégorie « Frantzösische Musicanten » et ne précise pas la nationalité de ses musiciens. Dans un ordre comptable (« Resckript ») envoyé en février 1709, l’engagement de plusieurs musiciens vise explicitement à « augmenter la bande de comédiens » et apparaît au milieu d’une foule de dispositions concernant le théâtre : sont engagés une danseuse, Mademoiselle Le Conte, et deux musiciens, Pierre Diard et Simon Le Gros.154 Le chanteur Pierre Diard, qui figurait déjà en 1699 parmi les « Messieurs de l’opéra » recrutés par Constantin, apparaît dans les listes de personnel en qualité de Bassiste et de Sänger Bassiste.155 Mademoiselle Le Conte, dont le prénom n’est jamais mentionné, est apparentée à deux musiciens qui apparaissent dans une liste de personnel de la Hofkapelle datant de 1709 : Le Conte le père (« flute allemande ») et Le Conte le fils (« Basson »).156 Quatre mois plus tard, en juin 1709, la troupe est de nouveau renforcée avec la nomination de trois personnes supplémentaires : le musicien Jean-Baptiste Ducé et les deux maîtres à danser Jean-Baptiste Volumier et
150 151 152 153 154 155 156
année e come ie avois demande le quartier franc è que cella nest pas en usage pour les domestiques actuels ie supplie tres humblement Sa Maieste de vouloÿr a cette consideration aiouter quelque chose au deux mille ecus. La plus humble plus soumise Servante Madelene De Salvay. » DA Bautzen, Taufbuch der Hofkirche, 1709-1759, fol. 10. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 257 : « Il doit être inséré dans le même ordre que le Roy veut qu’on paye à la Chanteuse Salvay qui a aussi son congé, une année entiere de ses appointements. » NLAH, Dep. 103 IV Nr. 300, fol. 9. Samantha Owens, The Württemberg Hofkapelle c.1680-1721, PhD Diss., Victoria University of Wellington, 1995, p. 15. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 85-88, 26 fév. 1709 : « Wir haben von einigen Zeit eine Bande französische Comoedianten in Unsere Dienste genommen […] Und weil Wir besagte Bande annoch mit derg. Personen, benamentlich Diar, le Gros und Motte la Comte augmentiret […]. » HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 4, fol. 261, Nr. 5, fol. 89, Nr. 6, fol. 4 et 78, Nr. 7, non folié. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 110.
– 102 –
Administrer la musique française
Charles Debargues.157 En 1714, le prince réclame le remboursement des salaires pour les musiciens qu’il avait engagés à Lyon « pour la comédie française ».158 Six ans après, en septembre 1720, le compositeur Louis André est engagé pour composer la musique française nécessaire à la comédie.159 De même, Prache affirme qu’il a été recruté « pour escrire la musique françoise pour les divertissements de la comedie.160 » Deux volumes d’archives de la cour de Dresde portent d’ailleurs le titre « Comédiens français et Orchestre ».161 Certains musiciens sont même payés directement par la troupe de comédiens et non par la cour : Robert du Hautlondel est payé sur l’enveloppe de la comédie jusqu’à la mort du directeur de la troupe Villedieu, avant que son salaire ne soit assumé par la cour.162 Mais dès le début, il est membre de plein droit de la Hofkapelle où il figure en qualité de « bassiste » sur toutes les listes de personnel ainsi que dans les Hofbücher depuis son arrivée jusqu’à sa mort en 1740 : il jouait donc dans le pupitre des cordes graves. Il a d’ailleurs reporté luimême son nom sur plusieurs parties séparées de la cour (Illustrations 2.3 et 2.4).
Illustration 2.3. Partie séparée ayant appartenu à Robert du Hautlondel, dit La France le Père. D-Dl, Mus. 1829-F-32.
Illustration 2.4. Partie séparée ayant appartenu à Robert du Hautlondel, dit La France le Père. D-Dl, Mus. 2124-F-6.
157 158 159 160 161 162
HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 92 : « Wir haben Unsere Bande frantzösischer Comoedianten mit einigen Personen, benamentlich mit dem Musico Ducé, dem Tantzmeister Volumier, und dem Tantzmeister Deparc nebst seiner Frauen vermehret […]. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 151 : « Specification Waß Ihro Hoheit d. Königl. Chur Prinz vor die auf Ihro Königl. Mayt. genädigsten Befehl aufgenommene dreÿ Personen in Lyon, zu d. franc: Comedie der Zeit an Besoldung avansiren lassen. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 166 : « Ordres à expédier. Varsovie le 8 Septembre 1720. 1. Pour la Pension d’André, que le Roy a engagé pour Compositeur de Musique, Machiniste et autres besoins de la Comedie. La Pension est de 1200 Ecus, et commence à Pâques de cette année. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 174. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/1 (Acta, die Engagements einiger zum Theater gehörige Personen u.s.w. betreffen), Loc. 383/4 (Die Bande Französischer Comödianten und Orchester I) ou Loc. 383/5 (Französische Comoedianten und Orchestra betr. II). Voir Chapitre 1 p. 46.
– 103 –
Chapitre 2
D’abord embauchés pour assurer la musique du théâtre français, voire comme membres de troupes de comédiens constituées, les musiciens français rejoignent donc rapidement les rangs des chapelles princières et royales, ce qui leur confère une certaine autonomie par rapport à la comédie. La construction administrative de cette autonomie se donne à voir de façon particulièrement frappante dans la production bureaucratique de la cour de Dresde. Ceci s’explique facilement par les spécificités de l’institution : lorsqu’ils arrivent dans la Hofkapelle de Dresde, les musiciens français intègrent une institution séculaire qui a traversé la guerre de Trente Ans, sur laquelle plane encore l’ombre de Heinrich Schütz, et dont le statut éminent sur le plan administratif, musical et religieux est garanti par une puissante tradition de patronage musical. Lorsque Samuel Chappuzeau sort de l’office de la Pentecôte entendu à la chapelle de Dresde en 1669, il relève le déploiement de splendeur visuelle, liturgique et cérémonielle, et écrit : « La musique de Saxe passe avec raison pour la meilleure & la plus accomplie d’Allemagne, & coûte bon aussi à l’Électeur.163 » Cette situation place les musiciens français à la jonction de deux univers : celui du théâtre et celui de la Hofkapelle. Cette double qualité leur permet d’intégrer les structures administratives de la cour, par le biais de leur intégration à la Hofkapelle, alors que les comédiens restent souvent des employés au second degré puisqu’ils dépendent du directeur de la troupe, ne sont pas engagés à titre personnel et ne signent pas de contrat individuel. Ainsi, l’arrivée de Volumier à la cour de Dresde ne concerne pas seulement la musique et la danse pour le théâtre français, mais marque le début d’une évolution profonde de la Hofkapelle, qui assiste alors à une institutionnalisation accrue du répertoire français, à un transfert de pratiques musicales depuis la France et à l’augmentation du nombre de musiciens français dans ses rangs. Une liste de personnel de 1709, dressée juste après l’arrivée de Volumier, illustre cette évolution de manière très nette, puisqu’elle fait apparaître une nouvelle organisation de l’orchestre. Celui-ci est réparti en plusieurs pupitres à la française : les cordes sont divisées en pupitres de « Violino », « Haute-contre » et « Taille ». Cette liste est en outre contenue dans un ensemble d’actes qui concernent le personnel de la comédie française, la chapelle catholique et l’administration des bâtiments. La formulation utilisée dans ce document mérite d’être relevée : il est dit que cette liste établie par le baron von Mordaxt dénombre « les comédiens français, y compris les danseurs et l’orchestre.164 » Seule la liste de l’orchestre est conservée, mais elle montre bien que celui-ci est avant tout constitué pour jouer dans la comédie française. Les musiciens jouissent cependant d’un statut très différent de celui des comédiens : contrairement à ces derniers, ils sont placés sous l’autorité directe du maréchal de la cour et se trouvent donc intégrés à la chaîne de commandement qui va du souverain jusqu’aux serviteurs les plus modestes. L’acte d’engagement de la Cammer-Sängerin Pauline Le Borgne détaille très bien la chaîne de commandement à laquelle elle promet obéissance dès son engagement : [Elle doit] servir avec obéissance comme chanteuse, aussi bien dans les opéras qu’en tout autre moment, temps ou lieu, et selon la manière qui lui seront gracieusement marqués par Son Altesse Électorale, ou bien par son grand maréchal [Oberhoffmarschall], ou bien par le grand officier de la cour [Hohen HoffOfficier] qui tient le bâton, ou bien encore par l’intendant [Cämmerer]. Elle doit également pourvoir sans réserve, sous la direction du Capellmeister ou bien en son absence du Vice-Capellmeister, à la table et à l’opéra, à la satisfaction de ses employeurs sans aucune autre préoccupation, et remplir fidèlement son devoir de servante, selon toutes ses capacités.165
163 164 165
Chappuzeau, Suite de l’Europe vivante, p. 302. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 103 : « dero Cammerharrens Baron von Mordaxt erhteiltes Attestat nach beÿliegender Abschrifft angeregten Franzöß. Comoedianten inclus. der Tänzer und Orchestra ». Voir la transcription de cette liste ci-dessous, Tableau 4.6, p. 224. HStA Dresden, 10036 Locate Finanzarchiv, Loc. 32691 Rep. L II Gen. Nr. 696, document 168, fol. 287 : « Madamoiselle Paulline le Borgne, zum Cammer Sängerin dergestalt in Dienste zunehmen, daß Dieselbe sowohl beÿ denen Operen, als sonst iederzeit, wann, wo und wie Sr Churfürstl. Durchl. es gnädigst gefällig, und entweder dieselbe selbe befehlen, oder durch Dero Oberhoffmarschall, oder den Hohen Hoff-Officiren, sodem Stab führet, oder auch nach gelegenheit durch den Cämmerer anordnen werden, gehorsamste Aufwartung in singen leisten, sowohl auch nach der Direction des Capellmeisters, oder in deßen Abwesenheit des Vice Capellmeisters, beÿ der Taffel und Operen, sich unweigerlich achten, darneben auf nichts mehr, als der
– 104 –
Administrer la musique française
Il ne faut sans doute pas sous-estimer le poids symbolique que représentait, pour tous les musiciens français engagés dans les Hofkapellen allemandes, la prestation de serment solennelle entre les mains du Hofmarschall, cérémonie dont aucun équivalent ne semble avoir existé pour les comédiens. Souvent engagés en troupe, ces derniers ne signaient pas de contrat individuel et n’étaient donc par directement attachés à la personne du souverain, avec laquelle les musiciens semblent au contraire avoir eu un lien de dépendance fort. Tous les actes d’engagement de musiciens français conservés contiennent en effet un serment de fidélité, de loyauté et d’obéissance à leur nouvel employeur prit devant Dieu : c’est par exemple le cas du maître à danser Dubreuil à Celle en 1660.166 Dans certains endroits, la prestation de serment solennelle pouvait être remplacée par une simple poignée de main.167 Le cérémoniel de nomination du nouveau maréchal de la cour (« Oberhofmarschall ») à Weimar en 1714 prévoyait ainsi que tous les serviteurs se rassemblent dans la cour du château et renouvellent leur serment de fidélité en allant serrer la main à leur nouveau supérieur hiérarchique, un par un, par ordre de dignité. Toute nouvelle arrivée parmi le personnel de la cour donnait lieu à la même cérémonie, et le violoniste français François Biotteau prêta également serment entre les mains du maréchal lorsqu’il fut engagé avec deux autres musiciens à la cour de Weimar, le 13 avril 1714.168 Lorsque Jean-Baptiste Volumier est officiellement nommé Konzertmeister à Dresde, le décret précise que tout le monde devra lui adresser la parole, se comporter avec lui et lui obéir selon son rang, et qu’il jouira de « toutes les prérogatives habituellement attachées à ce titre dans les cours allemandes ».169 Incontestablement, les musiciens français s’insèrent donc sans difficulté dans les structures préexistantes des cours allemandes au sein desquelles ils ont un statut clairement identifiable, à la différence des comédiens qui demeurent souvent dans une position de quasi extra-territorialité. Bien sûr, les musiciens restaient liés à leurs collègues du théâtre par de nombreux liens familiaux. Parmi de nombreux exemples, on peut prendre celui de Louis Le Conte, qui épouse en 1691 Marguerite de Soulas, fille de Josias de Soulas dit Floridor, directeur de la troupe des comédiens de Hanovre, et sœur de Charles de Soulas également dit Floridor et actif comme acteur dans la troupe des ducs de Hanovre.170 La figure de Pierre Vezin illustre aussi très bien cette superposition des milieux musiciens et comédiens. Né en 1654 à Saint-Florentin en Champagne d’un père vigneron171, il se serait enfui de France après avoir accordé sa protection à des huguenots, ce qui lui aurait valu d’être exclu du royaume. Il aurait alors été mis en contact avec la cour de Hanovre par le huguenot Estopey.172 En dépit du caractère romancé de sa biographie écrite par Böger, Pierre Vezin était incontestablement l’une des figures de proue de la Hofkapelle de Hanovre : sans doute présent dès 1680, il y demeure jusqu’à sa mort en 1727. Une partie de sa notoriété vient de son mariage en 1689 avec Marie Charlotte Pâtissier de Châteauneuf, fille du chef de la troupe de comédiens de Hanovre.173 Lorsque leur fille Sophie est baptisée en 1684, une
166 167 168 169
170 171 172 173
gnädigsten Herrschafft vergnügung sehen, und also ihre geshorsamste Schuldigkeit, als ein treüer Dienerin allenthalben, und nach aller möglichkeit, willig erweisen will. » NLAH, Celle Br. 44 Nr. 64, fol. 13-15. Julius Bernhard von Rohr, Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft der Grossen Herren, Berlin 1729, p. 672. HStA Weimar, Kunst- und Wissenschaft-Hofwesen, A 8995, fol. 56 et 79. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/1, fol. 19-20 : « Als declariren Wir denselben hierdurch, und Krafft dieses offenen Decrets zu unsern Maître des Concerts, dergestalt und also, daß er in solchem Caracter von jedermann angesehen, tractiret und geschrieben, auch dieser seiner Verrichtungen sich nach wie vor, gehörig unterziehen, und aller deren dependirenden Praerogation, wie solches durchgehends an den teutschen höfen gebrauchlich ist. » BAHild, KB Nr. 778, Hannover St. Clemens, Traubuch 1671-1699, 10 janv. 1691, p. 88. AD Yonne, 4 E 349/GG22, Saint-Florentin, registres baptismaux 1651-1656, 9 sept. 1654, fol. 36. Sur Pierre de Vezin, voir Richard Böger, Die Geschichte der Familie de Châteauneuf-Vezin. Böger, Die Geschichte der Familie de Châteauneuf-Vezin, p. 5-6. BAHild, KB Nr. 778, Hannover St. Clemens, Traubuch 1667-1711, p. 78 : « Anno eodem [1689] ego Bonaventura Nardini iunxi matrimonio Augusti Petrum Veziem natum in Civitate Sancti Florenti in Gallia et Mariam Carolam de Chateauneuf natam Multini in Gallia, praesentibus testibus, domino Calel Magot Le Choq, Bertrand Cardinal et Stéphano Valoy, Pariginis. »
– 105 –
Chapitre 2
certaine madame Maréchal, probablement la femme du hautboïste français à la cour de Celle Pierre Maréchal, figure parmi les nombreux parrains et marraines.174 Bérénice Valoy, sûrement apparentée à Stéphane et François, est la marraine d’une fille du musicien Pierre Vezin.175 Les liens entre le personnel théâtral et les musiciens ne sont pas seulement nombreux à l’intérieur même de chaque cour, mais aussi entre les différentes cours de Basse-Saxe et la cour de Dresde. Plusieurs indices semblent montrer une circulation régulière entre la capitale de la Saxe et l’espace Nord-Allemand : Pauligne Le Borgne est ainsi témoin d’un baptême à Hanovre pour un enfant de sa famille, tandis que Jean Baptiste Joseph du Hautlondel se marie à Hanovre. Cette proximité du théâtre et de la musique explique aussi l’émergence de nouvelles fonctions administratives : en 1712, le baron von Mordaxt est installé dans ses nouvelles fonctions de « Surintendant de la musique et Directeur général des plaisirs », charge qui regroupe la musique, la danse et le théâtre. Son acte d’installation rédigé en français fait bien apparaître la réunion de deux compétences auparavant distinctes : Ayant donné à Nostre Chambellan et bien aimé le Baron Mordaxt, la sur intendence de la Musique avec la Direction Generale de Nos plaisirs, Nous luy donnons en même temps le pouvoir absolu d’agir dans ces deux Charges, comme il le trouvera à propos, de placer les Musiciens, comme bon luy semblera, et de distribuer les roles, selon la Capacité des Acteurs et Actrices, de faire punir rigoureusement ceux qui pourront contrevenir à ses ordres, et de congedier touttes les personnes, sans exception, qui ne se rangeront pas à ses commendements, ou qui manqueront à leurs devoirs, et d’en prendre d’autres à leur place, sans Nous en faire part. Nous aprouvons generalement tout ce qu’il reglera la dedans, Voulons et ordonnons qu’il soit obey en tout ce qui regarde Nos plaisirs. À Dresde ce 15 de Juin l’An mille sept cents et douze. Auguste Roy.176
La réunion de ces deux charges montre que les musiciens français, loin de rester au service exclusif du théâtre ou de la danse, étaient intégrés dans les cadres de la Hofkapelle. Ils étaient probablement les seuls à passer fluidement entre ces trois ensembles, qui restaient des entités administratives bien distinctes malgré la création du poste de directeur des plaisirs. Ainsi Pierre de Gaultier, successeur de Mordaxt, se plaint-il du désordre provoqué au sein de la musique par la succession rapide de plusieurs décès (Jean-Baptiste Volumier, Johann Christoph Schmidt et Johann David Heinichen) dans une lettre envoyée à Auguste le Fort : Les Plaisirs étant desœuvrez présentement, je leur feray faire de temps en temps des repetitions, afin qu’ils soient en état de s’acquitter mieux de leur devoir au retour de Vôtre Majesté. La Comedie et la Danse ont déjà commencé ; mais jusques icy la Musique ne reconnoissant point de superieur vit dans une espece d’indépendence, et chaqu’un croit être son Maitre. Je supplie donc Vôtre Majesté de vouloir bien faire expedier un ordre par lequel Elle m’enjoigne de faire par rapport à la Musique, aussi bien que par rapport à la Comedie et à la danse, les dispositions que je trouveray convenables ; pour le service de Vôtre Majesté, et par lequel il soit ordonné aux uns et aux autres de me reconnoitre pour leur Directeur, et de m’obéir en cette qualité.177
Le fait que les musiciens aient du mal à reconnaître dans le directeur des plaisirs leur chef légitime peut être lu comme le résultat d’une construction administrative encore assez récente, réunissant sous l’effet du patronage de musique française trois institutions distinctes, innovation contre laquelle jouait une longue tradition. Mais ce phénomène n’était pas entièrement nouveau : l’administration avait déjà été obligée par le passé de négocier divers domaines de compétence dont la distinction traditionnelle se trouvait remise en cause par l’arrivée de musiciens français. 174 175 176 177
BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, 10 août 1684, p. 104. BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, p. 213 : « 6 octobris [1698] Ego Jacobus De Bont baptizavi infantem natam ex Petro Vesin et Maria Chateauneuf conjugibus gallis. Patrinus fuit Dnus Farinelli. Matrina Berenice Valois. Nomen infantis Antonetta Berenice. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 179. Lettre de Pierre de Gaultier à Auguste Le Fort, Dresde 15 juin 1729. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3349/14, fol. 6-7.
– 106 –
Administrer la musique française
Gouverner la musique française En effet, il n’était pas toujours simple pour l’administration de savoir qui avait la haute main sur les musiciens français nouvellement engagés. Les premiers musiciens français arrivent à la cour de Dresde dès les années 1670, au sein d’une atmosphère toujours largement dominée par la musique italienne sous le règne de Johann Georg III. Une bande de « violonistes français ou instrumentistes de table » est mentionnée entre 1675 puis en 1679.178 Dix ans plus tard, entre 1685 et 1687, un petit groupe comparable est à nouveau présent à la cour, sous le nom de Französische Violons, dont la liste est donnée dans le Hofbuch : Französische Violons Jacques Beudan von Sedan in Champagne Jean Sardin von Laon in Picardie, Jacques Guerin und Jean Baptista Guerin von Pariß Antoine Mutant von Guise in Picardie jedem zur jährl. Besoldung 200 Rthl. von 3 December 1685. Sie abgedanckt 1687.179
Outre leur salaire, c’est aussi la solidarité de ce groupe de musiciens, embauchés et renvoyés ensemble, qui indique qu’ils formaient sans doute une bande de violons constituée. Antoine Mutant, qui apparaît dans le groupe de 1679 et dans celui de 1685, séjourne durablement à Dresde puisqu’il apparaît de nouveau en 1695 dans une liste des personnes ayant participé à un divertissement intitulé la Götter Invention.180 Le rôle de cet ensemble dans la vie de la cour pendant les années 1685-1687 peut être éclairé grâce à un ensemble de documents préparatoires à un « Banquet bacchique et course d’anneau » (« Bacchi Wirtschaft und Ring=Rennen ») organisé à Dresde le 8 février 1687 à l’occasion d’un mariage aristocratique. Ces documents sont tout à fait fascinants dans la mesure où ils permettent à l’historien d’entrer dans la machinerie de la préparation d’une fête de cour, de percevoir de l’intérieur les jeux de négociation entre les différentes instances organisatrices qui s’expriment dans le règlement des moindres détails, et parfois d’approcher au plus près les prises de décisions qui concernent la musique et les musiciens. Les Französische Violons se voient ainsi confier de la musique de table et de danse, toujours en conjonction avec deux autres groupes appelés les « 12 Violons » et les « Hautes Bois » : À cette table doivent être présents les 12 violons avec hautbois, ainsi que les violons français. […] Pour la danse doivent être présents les 12 hautbois et les violons français, ainsi que la musique de l’hôte.181
Ces trois groupes de musiciens sont distincts de la Hofkapelle puisqu’ils sont évoqués indépendamment à plusieurs reprises.182 En revanche, la tournure d’une question adressée au Quartiermeister le général Starck, ainsi que la réponse qui y est faite, indique que ces musiciens sont placés sous l’autorité du Kapellmeister : [Question] Si son Excellence, à propos des 12 violons et hautbois, souhaite leur donner l’ordre d’être présents, ou si elle veut en discuter avec le Capellmeister, et si Elle pense vraiment que les violons français doivent malgré tout être présents. [Réponse] C’est ce qui a été fait, et les Français seront aussi présents.183
178 179 180 181 182 183
Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 1, p. 201. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 4, fol. 32. Le « Verzeichnis derer Persohnen, Sr Churfürst. Durchl. zu Sachsen beÿ der Götter Invention auffzuwarten » fait apparaître « H. Gevall mit der Violin: frantzös. Music: » et « H. Mutan frantz. Mus: mit der Violin ». HStA Dresden, 10006 OHMA, G Nr. 12, fol. 407. HStA Dresden, 10006 OHMA, G Nr. 9, fol. 211-212 : « In diesem Tafel warten 12. Violons mit haut bois und die franzoischen [sic] Violons auf. […] Beÿ dem Tanze sollen die 12. Hute Bois und die franzoischen [sic] Violons, wie auch des Wirths Musica auffwarten. » HStA Dresden, 10006 OHMA, G Nr. 9, fol. 216 : « Ob die Churfürstl. Capell Musica beÿ der Tafel der nationen aufwarten solle. Nein, sondern 12. Violons mit Hob. und die Bergsänger sollen auch die Französ: violons aufwarten. » HStA Dresden, 10006 OHMA, G. Nr. 9, fol. 226 : « Ob Sr. Excell. wegen der 12. Violons und Hautes Bois Verordnung thun und mit dem Capelmeister reden wollten und wirt ja beÿ der meinung bleiben, daß dennoch die französischen Violons auch aufwarten sollen. Ist geschehen, und warten die französischen auch auf. »
– 107 –
Chapitre 2
Ce que confirme encore la recommandation suivante, placée quelques folios plus loin dans une sorte d’aide-mémoire du déroulement de la fête, à propos du dîner auquel les invités sont répartis en deux tables, respectivement déguisées en « Nations » et en « Ouvriers »: Dans la salle à manger du prince électeur, à la table du Conseil des Nations et des Ouvriers [tables où les invités sont costumés dans ces thématiques], les hautbois et les violons français seront présents. C’est pourquoi il faudra rappeler en temps utile au Capellmeister que les musiciens doivent solliciter les gardes à temps s’ils veulent avoir un costume, ce qu’ils peuvent aussi bien faire auprès de quelqu’un de leur nationalité.184
Un groupe de musiciens indépendant de la Hofkapelle, mais cependant placé sous l’autorité du Kapellmeister : voilà ce que semble être la réalité administrative de ces musiciens, qui sont probablement joints au corps principal de la chapelle chaque fois que l’on a besoin d’eux. L’arrivée au pouvoir d’Auguste le Fort marque un prolongement et une intensification du recrutement de musiciens français, accompagné d’un renvoi de tous les musiciens italiens qui composaient la chapelle. Trois ans avant l’engagement de la troupe d’opéra de Deseschaliers, l’engagement d’une troupe de hautboïstes à Vienne en 1696 révèle déjà l’agenda musical du nouveau prince électeur de Saxe. Auguste le Fort avait rencontré cette troupe de hautbois lors d’un séjour à Vienne entre juin et décembre 1696.185 Les quelques actes conservés aux archives de Dresde traduisent la perplexité du Kammerpräsident August Christoph von Wackerbarth lorsqu’il vit arriver de Vienne, en plus d’un trompettiste, une troupe de hautboïstes qui devaient être défrayés pour le voyage, logés et payés. Dans une lettre adressée à Auguste le Fort le 24 décembre 1696, il demande la confirmation écrite qu’il doit bien engager ces musiciens, dont le nombre dépassait les quotas qui lui avaient été assignés pour la musique lors de la prise de fonction du nouveau souverain : J’ai donc jugé nécessaire d’en faire rapport par la présente, et d’y ajouter respectueusement que, comme Votre Altesse s’en souviendra encore, elle m’avait non seulement donné la mission, à l’installation de son gouvernement, de limiter autant que possible la chapelle musicale [Capell Music] et de faire régler les salaires selon un certain quota, mais elle avait également ordonné qu’en plus du premier trompettiste Sulzen, pas plus de douze trompettistes et deux timbaliers ne soient gardés en poste, et que les autres, même s’ils étaient des musiciens exercés et de très bon trompettistes, soient remerciés ; sans l’ordre exprès et écrit de Votre Altesse, je ne peux donc engager aucun serviteur au-delà du quota de salaires fixé.186
Le prince électeur lui fait répondre que les hautbois et le trompettiste doivent bien être engagés en dépit de ces provisions.187 Une liste détaille la composition de cette curieuse troupe de hautbois : Tobias Gresle, Hautboist Tobias Hennig, Fagotist Johann Wolffgang Gresle, Hautboist Anton Schweiberger, Hautboist Jean Baptis Henrion, Flutti Charles Steinberg, Flutti Charles Henrion, Flutti
184
185 186
187
HStA Dresden, 10006 OHMA, G Nr. 9, fol. 248 : « Im Churfürstl: Tafelgemach beÿ der Nationen Rath und Handwercker Tafel warten die Hautbois auf und die franzoischen violons. Deßwegen beÿ zeiten beÿdem Capellmeister zu erinnern, daß Sie sich vorhero zu rechter Zeit beÿ den Fouriren anmelden sollen, ob Sie gleich auch viel eher von iemand aus deren Nationen, ihrer beÿm Aufzuge gebrauchen möchten. » Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 11. HStA Dresden, 10006 OHMA, K III Nr. 8, fol. 371-318r : « So habe ich nöthig erachtet, es hierdurch unterthänigst zuberichten, und darbeÿ gehorsamst anzufügen, Maßen auch E. Churf. Durchl. sich annoch in Churf. Gnaden erinnern werden, daß beÿ Ankundung dero Churf. Hochstlöbl. Regierung, dieselbe durch mir davon untergesagte Comission nicht allein die Capell Music möglichst reinziehen und der Besoldung auch ein gewißes quantum reguliren laßen ; sonder auch gnädigst befohlen, daß, neben dem Oberhoff Trompeter Sulzen, mehr nicht, als noch zwölff Trompeter und zweyen Herr Paucker an Diensten behalten werden sollten, die übrigen aber, ungeachtet es geübte Musici und sehr gute Trompeter gewesen, abgedancket werden müßen; daß also ohne E. Churf. Durchl. ausdrücklichen und schrifftlichen Befehl über solche anzahl und eingeschrencktes quantum der ausgesetzen Besoldung von mir kein Diener mehr in Dienst und Pflicht genommen werden kann. » Lettre d’Auguste le Fort à August Christoph von Wackerbarth, Leipzig, 14 janv. 1697. HStA Dresden, 10006 OHMA, K III Nr. 8, fol. 319.
– 108 –
Administrer la musique française
Michael Ange Valzania, fagotist und fluttiste Nicolaus Delvaux, hautboist Ferdinand Gresle, Fagotiste Loran, Flutti Philibert, Flutti welche beÿde noch unter Weges188
Les deux derniers instrumentistes, dont il est dit qu’ils sont encore en chemin, ne figurent pas dans la liste définitive de la troupe de hautbois établie dans l’acte d’engagement. Ils ont donc dû finalement renoncer à venir à Dresde. Les dix autres musiciens sont engagés sur ordre du Kammerpräsident aussitôt après la réception de la lettre du prince, soit le 19 janvier 1697. L’acte d’engagement est rédigé de façon très intéressante, car il détaille les fonctions et obligations des hautboïstes, ainsi que la manière dont ils s’inscrivent dans la hiérarchie musicale : les hautboïstes sont placés sour l’autorité du Oberhofmarschall, ou de « celui qui tient le bâton » en l'absence de ce dernier. Ils doivent, chaque fois qu’ils en reçoivent l’ordre, jouer « sous la direction du Capell=Meister ou, en son absence, du Vice Capell=Meister » dans l’orchestre de la cour [Hof=Capelle] ou à la table, à l’occasion d’opéras, ballets, comédies ou autres. Ils ne sont pas autorisés à passer la nuit hors de la ville sans en avoir demandé l’autorisation au Oberhofmarschall et sans en avoir averti au préalable le Capellmeister. Ils doivent aussi, si on leur demande et sans toucher d’argent supplémentaire, enseigner « fidèlement, avec douceur et selon leur meilleur savoir » la pratique de leurs instruments aux enfants de chœur (Kapellknaben).189 Le prix de la musique Après la guerre de Trente Ans, dans un contexte de rationalisation et de réduction des dépenses curiales, de critique des dépenses somptuaires et de revenus encore fréquemment obérés par le budget militaire, la question financière s’impose comme un paramètre crucial dans l’organisation de la musique au sein des cours allemandes.190 La cherté des Italiens forme alors un argument de poids en faveur de l’engagement de musiciens français, et c’est à bon droit que Sophie de Hanovre, juste après la mort de son beau-frère Johann Friedrich dont elle avait souligné à plusieurs reprises les dépenses exorbitantes pour l’entretien de musiciens italiens, vante le coût modique de ses violons parisiens : E[rnst] A[ugust] se va recreer un peu par des violons qu’il a fait venir [de Paris], que son fils luy a choisi, qui ne coutent pas tant que la musique Italienne.191
En effet, si les trois ducs de Braunschweig s’étaient distingués dès les années 1660 par leur passion commune pour l’opéra vénitien ainsi que par la fréquence de leurs déplacements dans la cité des Doges pour le carnaval192, seul Johann Friedrich fit venir des musiciens italiens dans sa cour de Hanovre. Parmi les douze musiciens italiens qui composaient la chapelle à sa mort en 1679, neuf 188 189
190 191 192
HStA Dresden, 10006 OHMA, K III Nr. 8, fol. 316. HStA Dresden, 10006 OHMA, K III Nr. 8, fol. 323 : « Nachdem […] mein gnädigster Herr, durch schrifftlichen gnädigsten Befehl de dato Leipzig den 14. January nächsthin, sich gnädigst erkläret, die von Wien anhero gekommene Bande Hautbois anzunehmen, und mir befohlen, davon Annehm= und Bestellung halben, gehörige Verordnung zuthun, daß nehmlich selbige schuldig seÿn sollen, nächst dem Befehl des Oberhoffmarschalls, oder deßen, so den Stab führet, unter des Capellmeisters, oder in deßen Abwesenheit, des ViceCapellmeisters Direction zustehen, und in der Hoff=Capelle und für den Taffel, in dergleichen beÿ Operen, Balletten, Comödien und andern Occasionen, mit denen Instrumenten, deren sie kundig, aufzuwarten, ohne vor Oberhoffmarschall erlangtes Erlaubnüs und Vorwissen des Capell=Meister, keine Nacht aus der Churfürstl. Residenz zu bleiben, über dieses die Capell Knaben so beÿ einen oder andern von bedeüteter Bande auf dem Hautbois, und andern ihm kundigen Instrumenten, spielen zulernen belieben tragen möchte, auf Anordnung des Oberhoffmarschalls, selbige ohne mit geld treülich, glipfflich, und nach seiner besten Wissenschafft zu informiren, auch sonst allenthalben erforderte Aufwartung zuleisten. » Pour une étude de la croissance du personnel et des dépenses du personnel de la cour et les ajustements nécessités à travers l’exemple de Vienne et Paris, voir Duindam, Vienna and Versailles, p. 45-89. Lettre de Sophie à Karl Ludwig, Hanovre, 5 août 1680. Bodemann, Briefwechsel, p. 432. Georg Fischer, Musik in Hannover, Hanovre 1903, p. 3-6.
– 109 –
Chapitre 2
d’entre eux étaient payés 600 Thaler par an, un salaire comparativement très élevé. Avec le salaire des autres musiciens et les dépenses annexes, le coût total annuel de la chapelle pour l’année 1679-1680 était de 7.302 Thaler.193 L’année suivante, lorsque Ernst August et Sophie s’installent à Hanovre, ils renvoient l’ensemble des musiciens italiens et divisent ainsi par plus de trois la dépense liée à la musique. Le coût annuel de la chapelle est ramené à 2.059 Thaler, et parmi les sept musiciens français qui prennent la relève, seul leur chef Jean-Baptiste Farinel est payé 500 Thaler par an, tandis que les six autres touchent un salaire annuel de 115 Thaler. Ces observations conduisent à poser la question du financement de la musique française, en particulier par rapport à la musique italienne. Les registres de comptabilité constituent, avec les listes de personnel, une source de première importance pour reconstruire le personnel des chapelles musicales allemandes, et donc pour traquer la circulation des musiciens français. Mais ces sources administratives forment aussi un corpus documentaire cohérent qui peut à la limite être considéré pour lui-même, ou dont les conditions de production et les logiques propres méritent à tout le moins d’être interrogées.194 Les cadres de classement auxquels sont intégrés les musiciens dans les registres de comptes et les listes de personnel sont en effet le reflet de contingences locales, financières et pratiques, mais aussi l’expression d’un savoir acquis, d’une matrice de gouvernement voire d’une certaine représentation de l’univers – les états de dépense oscillant ainsi perpétuellement « entre la cartographie administrative et la cosmogonie195 ». Saisir la place de la musique et des musiciens français dans la toponymie de ces sources administratives, c’est donc aussi du même coup comprendre leur place et leur fonction dans le microcosme de la cour. Musique et typologies comptables En Basse-Saxe, dans les cours de Celle et de Hanovre, le principal ensemble de sources est précisément constitué par les registres de comptabilité.196 Cette série est complète pour notre période, ce qui en fait un ensemble documentaire remarquablement continu et cohérent, exceptionnel dans le paysage des cours allemandes. Elle permet de reconstituer année après année la composition de la chapelle et d’avoir accès, par le biais des différents postes de dépense, à certains détails très concrets de la vie des musiciens. Les registres conservés aujourd’hui sont cependant loin de former la totalité des archives produites autrefois : les dépenses privées des souverains enregistrées dans la Schatullkasse ne sont pas conservées et faisaient sans doute l’objet d’une comptabilité moins méticuleuse.197 Seuls les comptes personnels d’Éléonore d’Olbreuse sont conservés pour
193
194
195 196 197
NLAH, Hann. 76c A Nr. 99, p. 347 : le Kapellmeister Vincenzo de Grandis (50 Thaler par mois), l’organiste Mattheo Trento (32 Thaler), le Violist Pietro Recaldini (30 Thaler), les Discantist Vincenzo Antonini et Gioseppe Constantini, l’altiste Giuliano Giuliani, les ténors Caesare Borginai et Gioseppo Constantini, les basses Francesco Venago, Nicolai Gratiani et Giramolo Navarren touchent chacun entre 300 et 600 Thaler par an. Lemaigre-Gaffier, Administrer les Menus Plaisirs du Roi, p. 107 : « Témoignage exemplaire du “propre de l’État bureaucratique”, c’est-à-dire “d’avoir suscité une inflation documentaire sans précédent, une prolifération archivistique que les historiens ont beaucoup sollicitée sans s’interroger toujours sur les conditions intellectuelles et matérielles de sa production et de sa conservation”, ce corpus donne l’opportunité, comme le suggéraient Pierre Bourdieu, Olivier Christin et Pierre-Étienne Will, de soumettre cette production à une véritable lecture historique, afin de monter en quoi elle a contribué à transformer les représentations de l’État et de ses fonctions. » Lemaigre-Gaffier, Administrer les Menus Plaisirs du Roi, p. 116-117. NLAH, Hann. 76c A Nr. 192-230 : Register der Einnahmen und Ausgaben bei der fürstlichen Lüneburgischen Rentei zu Celle von Trinitatis bis Trinitatis. Ragnhild Hatton, George I, New Haven 2001, p. 94 : « Besides the public exchequer Hanover had a Kammer (literally, chamber), a treasury into which was paid the income from the ducal domains and from the state’s share in those Harz mines which belonged to Hanover, as well a foreign subsidies. This Kammerkasse was also deployed for public expenditure, for the upkeep of the court, the domestic administration, the diplomatic service and for defraying the expenses levied on the duchy in its relationship to the Empire; but the ruler felt fairly free to use it as he thought fit. The private ducal income, derived from personal investment in mining and stocks, was kept in yet another Kasse, the Schatullkasse (from Schatulle, literally bureau-chest), and was
– 110 –
Administrer la musique française
les dix dernières années de son existence, mais ne contiennent pas d’indication intéressante pour la musique.198 À Celle, les registres contiennent l’exercice comptable annuel à compter du dimanche de la Trinité, le premier après la Pentecôte. Chaque registre est divisé en deux grandes parties : les rentrées d’argent (« Einnahmen ») et les dépenses (« Ausgaben »). Celles-ci sont regroupées par matières et décrites de façon très détaillée, comme le montre par exemple le registre pour l’année comptable 1680-1681 (Tableau 2.7). Sont d’abord notées les dépenses liées aux infrastructures de la cour et à l’entretien des domaines : argent pour la famille ducale et ses voyages, logement des visiteurs à la cour, octroi de dons charitables et de bourses, entretien des tribunaux, dépenses pour les cuisines, lavoirs, caves et jardins, entretien des bâtiments et des animaux, achat de médicaments, de linge et de vaisselle. On trouve aussi les sommes d’argent envoyées aux agents diplomatiques en poste à l’étranger, ainsi qu’aux correspondants et fournisseurs étrangers pour l’envoi de lettres ou de biens. Dans un second temps commence la longue énumération des dépenses de personnel, qui apparaissent par ordre de dignité décroissant : les ministres, le clergé, le personnel de la cour puis les autres serviteurs. Le registre de comptes se fait alors le reflet, à l’échelle microscopique, de la hiérarchie sociale qui assigne à chaque individu sa place et son rang au sein d’une totalité. Enfin, en dernière position sont consignées les rémunérations en nature, des dépenses pour les livrées, les voitures et le petit matériel, et enfin l’argent consacré à la chose militaire. La rubrication n’est donc pas neutre : les sept musiciens français arrivés à Celle en 1666 sont attachés au personnel de la cour, au sein duquel ils viennent toujours après les trompettistes, chargés d’une fonction cérémonielle et mieux payés, et avant la troupe de comédiens payée en groupe. Ils sont toujours listés sous la catégorie générale de « Musicanten », mais sont regroupés dans une sous-catégorie « Frantzösische Musicanten » jusqu’en 1671, date à laquelle cette dénomination disparaît définitivement. Les registres de comptabilité de Hanovre, semblables à ceux de Celle, sont également très bien conservés mais recèlent quelques spécificités. Avant 1688, les musiciens français ne sont pas nommés individuellement mais simplement regroupés sous l’étiquette « Frantzösische Musicanten ». Mis à part Farinel, on voit donc seulement apparaître les « six autres musiciens français » (« sechs übrigen Frantzösischen Musicanten »). Ce n’est qu’à la faveur d’un renouvellement de personnel à l’été 1688 que les musiciens français commencent à être dénommés individuellement par leur nom de famille. Après le renvoi de La Croix et l’engagement de trois hautbois français, il devenait en effet nécessaire de distinguer les musiciens de la première heure – Valoy, Vezin, Bertrand, Le Conte – dont l’ancienneté et le salaire n’étaient plus les mêmes et dont l’identité cessait donc d’être évidente. Durant tout le règne d’Ernst August (1680-1698), les musiciens français restent largement majoritaires dans la composition de la Hofkapelle. La section qui comprend le salaire des musiciens est intitulée Denen Musicanten. Elle fait apparaître, en plus des musiciens français, quelques instrumentistes qui viennent de temps en temps s’y ajouter, le plus souvent pour une durée réduite : le musicien de la chambre (« Cammer Musicus ») Clamor Heinrich Abel jusqu’en 1685,199 Nikolaus Adam Strungk, réengagé comme Hoff Cammer Componiste en 1682, après avoir passé quelques mois au Gänsemarktoper de Hambourg,200 ainsi que le personnel en charge de la musique liturgique.201 De 1686 à 1695, les Français restent donc seuls maîtres à bord hormis l’organiste et
198 199 200 201
spent for private purposes. The public Kasse accounts (the Kammerrechnungen) were meticulously kept and have survived; those for the Kammerkasse and the Schatullkasse have not come down to us, though there are references to both in Ernst August’s will. » NLAH, Dep. 84 B Nr. 101 : Rechnungswesen der Herzoginwitwe Eleonore d’Olbreuse (1706-1716). Dernière apparition en 1685 : NLAH, Hann. 76c A Nr. 104, p. 255. NLAH, Hann. 76c A Nr. 102, p. 216. La cour de Hanovre paye ainsi un organiste pour la chapelle de la cour, un Calcant pour actionner les soufflets de l’orgue, un Cantor et un Calcant pour l’église de la ville nouvelle. De 1681 à 1685, Georgio Henrico Bonio est rémunéré comme Hofcantor avec six enfants pour le chant (« Sechs Singknaben in der Schloßkirche ») : NLAH, Hann. 76c A Nr. 101, p. 192. À partir de 1688, on voit apparaître un facteur d’orgue qui prend soin de l’orgue et des autres instruments : NLAH, Hann. 76c A Nr. 108, p. 254.
– 111 –
Chapitre 2
Tableau 2.7. Registre de comptabilité pour l’année 1680-1681 : rubriques de dépense. NLAH, Hann. 76c A Nr. 206. Page 315
Intitulé des rubriques
Traduction approximative
Serenissimi Handtgelder
Argent de poche pour les ducs
316
Zu Sonderbahren Behueff
Dépenses exceptionnelles
318
Außgeliehenes Capital
Emprunts
319
Serenissimi Reise Kosten
Argent pour les voyages des ducs
320
Fürstl. Deputat gelder
Paiements en nature pour les ducs
323
Frembder Außquitirung
Paiements externes
329
Auff Commission und Verschickung
Achats et envois
335
Hochzeit undt Kindt=tauffen Verehrung
Cadeaux de mariage et de baptême
336
Gnaden Verehrung
Gratifications à titre gracieux
339
Armen Beÿsteuer
Contribution pour les pauvres
341
Auff Stipendiaten
Bourses [d’étude etc.]
345
Auff die Schloßkirche
Pour l’église du château
346
Wegen deß großen Calandeß
Pour la grande confrérie des Calandes
347
Auff Reichs- und andere Lehen Empängnüß
Pour les fiefs impériaux et autres
348
Auff Fürstl: Cantzeleÿ, Cammer, undt Hoffgerichte
Pour la chancellerie, la chambre et les tribunaux de la cour ducale
350
Behueff Fürstl: Küche
Pour la cuisine ducale
352
Auff Fürstl: Küche für Victualien, Geschirr, Pracht undt dergleichen
Pour la cuisine ducale, pour les victuailles, vaisselle, apparat etc.
355
Behueff Fürstl: Küche für Provision
Pour la cuisine ducale, pour les provisions
356
Behueff der Conditoreÿ
Pour la pâtisserie
357
Behueff Backhaußes
Pour la boulangerie
358
Behueff Lichte Cammer
Pour le département de l’éclairage
359
Behueff Ablager
Pour les coffres de voyage
364
Auff den Frantzösischen Garten
Pour le jardin français
365
Auff den Italiänischen Garten
Pour le jardin italien
366
Auff den Weingarten
Pour le vignoble
367
Auff den Caninichen Garten
Pour le jardin des lapins
368
Auff den Garten zu Wienhaußen
Pour le jardin de Wienhaußen
369
Auff die Garten Inßgemein
Pour les jardins en général
370
Auff den Weinkeller
Pour la cave à vin
373
Auff den Bierkeller
Pour la cave à bière
375
Auff die Silber Cammer
Pour la chambre d’argenterie
376
Auff den Marstall undt Hoff Schmiede
Pour la forge et le maréchal ferrand de la cour
383
Auff Fürstl: Kornboden
Pour les greniers des ducs
385
Auff den Haarburgischen Festungs Bau
Pour la forteresse de Harburg
386
Auff Fürstl: Zimmer undt dazu gehörige Eingethumb
Pour le logement des ducs et les propriétés afférentes
387
Auff Leinen= und Bettegewandt
Pour les toiles de lin et de literie
388
Auff Weidewerck
Pour la chasse
394
Auff die Fischereÿ
Pour la pêche
395
Auff die Fasanen
Pour les faisans
396
Auff den Perlen Fang
Pour la pêche des perles [section vide]
397
Baukosten beÿ Hoffe
Frais de construction à la cour
– 112 –
Administrer la musique française
(Tableau 2.7. Suite.) Page
Intitulé des rubriques
Traduction approximative
399
Baukosten Inß Gemein
Frais de construction en général
404
Baukosten beÿ den Ämbtern, angerechnet
Frais de construction dans les domaines
407
Baukosten zu Wienhaußen
Frais de construction à Wienhaußen
408
Zu Verbeßerung der Ämbter
Pour l’amélioration des domaines
409
Einlösung Versetzter Ämbter
Encaissement des domaines cédés
410
Capital undt Zinsen Ablegung
Capital et intérêts
411
Auff Speÿersche und andere Proces, undt Gerichts Sachen
Pour les procès à Spire [cour de justice impériale] et autres affaires judiciaires
413
Kaÿserliche Cammer Gerichts Zieler
Pour la chambre de justice impériale
414
Angerechnete Herren-Dienste
Services facturés
415
Angerechnetes Holtz
Bois facturé
416
Auff Medicamente undt Artzlohn
Pour les médicaments et le salaire des médecins
417
Auff Pferde undt andere Schadenstände
Pour les chevaux et autres accidents
419
Dienerbesoldung Current
Salaire courant des serviteurs
419
1. Beÿ Fürstl. Cantzeleÿ undt Cammer
1. Chancellerie et chambre
428
2. Geistliche undt Kirchendiener beÿ Hoffe
2. Clergé et serviteurs de l’église de la cour
429
3. Geistliche undt Kirchendiener beÿ der Stadtkirche
3. Clergé et serviteurs de la paroisse de la ville
430
4. Zur Fürstl. Hoffstadt gehörige
4. Personnel de la cour ducale
430
–– [1.] Principui
–– [1.] Grands commis
434
–– 2. Ihrer Fürstl Durchl Leibdiener
–– 2. Valets de pied ducaux
435
–– 3. Laquayen
–– 3. Laquais
436
–– 4. Trompeter
–– 4. Trompettes
437
–– 5. Musicanten
–– 5. Musiciens
438
–– 6. Comedianten
–– 6. Comédiens
439
–– 7. Ultimi
–– 7. Autres
442
5. Beÿ Fürstl. Küche
5. Cuisine ducale
446
6. In der Silber Cammer
6. Argenterie
447
7. In der Conditoreÿ
7. Pâtisserie
448
8. In Weinkeller
8. Cave à vin
449
9. In Bierkeller
9. Cave à bière
450
10. Am Back- undt Brauhauße
10. Four et brasserie
451
11. In den Gärten
11. Jardins
452
12. Beÿ der Jägerey
12. Chasse
456
13. Im Reisigen Stalle
13. Écuries militaires
464
14. Im Halthauße
14. Tonnellerie
465
15. Gemeine Diener
15. Serviteurs communs
466
16. Den Müllern
16. Meuniers
467
17. Wegen der Hoffkleidung
17. Pour les livrées
468
Repetitio Summarum
Bilan des dépenses
469
Dienerbesoldung Current Der Frau Hertzogin undt Princesse Fürstl. Durchl. Fürstl. Durchl. Leute
Salaire courant pour les gens de la duchesse et de la princesse
470
Dienerbesoldung Current Auß Gnaden
Rémunération courante des serviteurs à titre gracieux
– 113 –
Chapitre 2
(Tableau 2.7. Suite et fin.) Page
Intitulé des rubriques
Traduction approximative
472
Dienerbesoldung Current Beÿ den Ämbtern
Rémunération des serviteurs dans les domaines
476
Repetitio Summarum
Bilan des dépenses
477
Dienerbesoldung Current hinterstellig
Arriéré des rémunérations courantes des serviteurs
478
Dienerbesoldunt Current Laut Special Befehle
Rémunération courante des serviteurs par ordre spécial
479
Repetitio Summarum
Bilan des dépenses
480
Hauß= Stuben= undt Stallmiethe
Loyers pour les maisons, chambres, écuries
481
Für Deputat Holtz
Pour le bois en nature
482
Für Deputat Ochßen
Pour le bœuf en nature
483
Für Deputat Schweine
Pour le porc en nature
489
Für Deputat Hämel
Pour le mouton en nature
490
Für Deputat Bier
Pour la bière en nature
491
Fourage undt Hueffschlag Gelder
Étrennes pour le fourage et le ferrage
493
Bette Gelder
Étrennes pour le lit
494
Lichte Gelder
Étrennes pour la cire
495
Repetition Summarum
Bilan des dépenses
496
Zur Hoffkleidung undt der Livrée
Pour le vêtement de cour et la livrée
500
Post= undt Bottenlohn
Salaires pour la poste et les messagers
502
Fuhrlohn undt Fracht
Pour le transport et le fret
503
Für vorhandene Materialien
Pour des matières négociées
504
In die Kriegs Casse verfloßen zum Ordinari Commiss für angerechnetes Korn
Argent dirigé vers la caisse militaire pour les commissions ordinaires de blé
509
In die Kriegs Casse verfloßen zum Argent des domaines dirigé vers la caisse militaire pour Extraordinari Commiss angerechnet beÿ den les commissions extraordinaires Ambtern
510
Behueff Commiss.
Pour les commissions
511
Lagio, Cambio undt interesse
Pour les agios, le change et les intérêts
512
Zur Contribution
Contributions
513
Auff neue Erfindungen an= und vorschläge
Pour de nouvelles inventions et propositions
514
Extraordinari
Dépenses extraordinaires
516
Summa Summarum aller Außgabe von Trinitatis 1680 biß Trinitatis 1681
Summa summarum de toutes les dépenses de la Trinité 1680 jusqu’à la Trinité 1681
le facteur d’orgue. En 1695 sont embauchés un violiste Gottfried Friedrich Thielke ainsi qu’un musicien au patronyme italien, Giuseppe Pigniatten, dont la fonction n’est pas précisée.202 Les musiciens italiens engagés pour la production d’opéras entre 1687 et 1698 n’apparaissent pas dans la comptabilité, puisqu’ils étaient probablement payés sur la caisse personnelle du souverain. À Dresde, les registres de comptabilité ne sont pas conservés, ce qui implique de légères différences dans la nature des informations récoltées. Les sources administratives de la cour concernant la musique sont produites par deux départements : le Geheimes Kabinett, sorte de conseil du roi où sont regroupés les ordres envoyés par le souverain à l’Accis-Casse, c’est-à-dire l’administration comptable de la cour, à propos des musiciens, comédiens et danseurs.203 Outre ces ordres 202 203
NLAH, Hann. 76c A Nr. 116, p. 294. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, 383/3, 383/4, 383/5.
– 114 –
Administrer la musique française
appelés Reskripten, les cartons contiennent aussi des lettres, suppliques ou correspondances annexes, ainsi que quelques rares actes d’engagement de musiciens. Cet important ensemble documentaire forme la colonne vertébrale de la production administrative de la cour. Dans les archives du Oberhofmarschallamt, c’est-à-dire l’administration centrale de la cour, on trouve des listes du personnel employé par la cour, inscrites dans des volumes appelés Hofbücher et archivés dans la série K. Cette série, malgré sa discontinuité, permet de suivre l’évolution de la composition de la Hofkapelle pendant toute notre période ainsi que d’appréhender la manière dont les différents ensembles musicaux sont définis et structurés les uns par rapport aux autres. L’un des documents les plus fascinants de cette série est la liste de personnel de 1718 déjà évoquée, sur laquelle les musiciens ont tous inscrit, dans leur langue maternelle, leur origine géographique, la durée de leur service à la chapelle et leur âge. Toujours dans les archives du Oberhofmarschallamt, les journaux des divertissements de cour forment une série incomplète mais contiennent des documents relatifs à l’organisation des fêtes ainsi que parfois un journal succint du carnaval (série G). Effectifs et salaires Les registres comptables de Celle permettent de comprendre dans le détail la rémunération des musiciens. Leur salaire est versé deux fois par an, à Pâques et à la Saint-Michel. La rémunération se compose d’un solde fixe (« Besoldung ») accompagné de divers compléments versés en argent ou en nature. Le « Stubenheuer » désigne ainsi l’argent accordé pour le logement.204 Notons que les musiciens commencent à percevoir un « Stubenheuer » au fil de l’automne 1667, soit quelques mois après leur arrivée, puisqu’ils étaient auparavant logés chez l’habitant à qui était directement versé le loyer. La somme est d’abord ajustée au mois près pour chacun, ce qui laisse penser que certains ont mis plus de temps que d’autres à trouver un logement définitif.205 Le « Holzgeld » couvre l’argent pour le bois, tout comme le « Krummholz », petit bois de lande. Seul le chef de la bande Philippe La Vigne reçoit un « Fouragegeld » couvrant les dépenses liées à la possession d’un cheval.206 Le « Lichtgeld » ou « Deputat Lichte » subvient aux dépenses de bougie, tandis que le « Deputat Schwein » désigne vraisemblablement une certaine quantité de viande de porc, spécifiée selon sa valeur monétaire comme les autres avantages en nature. Ces diverses rétributions forment ce qu’on pourrait appeler l’ordinaire des musiciens. En général, elles s’accumulent au fil du temps, venant ainsi augmenter les salaires selon l’ancienneté. La seule augmentation générale du solde de tous les musiciens a lieu en 1682-1683. La grande égalité des rémunérations entre les musiciens est frappante. Elle est caractéristique d’un ensemble où tous les instrumentistes remplissent des fonctions équivalentes et où le salaire a probablement été négocié de façon groupée. En dehors de Philippe La Vigne, tous les musiciens du rang sont tous payés de la même façon, et seuls deux hautboistes, Denis Le Tourneur et François Robeau, sont distingués par des augmentations individuelles toujours reportées après leur solde normal.207 Philippe La Vigne est le mieux payé en sa qualité de Capellmeister. Son solde annuel, de 400 Thaler, reste inchangé de 1666 à 1705. S’y ajoutent au fil du temps de multiples avantages dont il est parfois le seul à bénéficier. Dès 1668, son Stubenheuer est de 36 Thaler, contre 24 pour les autres musiciens. Toujours en 1668, il reçoit rétrospectivement à compter de 1665 douze Thaler annuels pour son cheval, ce dont jamais aucun autre musicien ne bénéficie. Cette somme disparaît ensuite jusqu’en 1674, où elle passe à 14 Thaler par an. En 1682, elle passe à 60 Thaler par an. 204 205 206 207
On trouve parfois aussi « Haußmiethe » ou un autre intitulé approchant comme « Stubenheuer undt Stallmieth für Serenissimi Cellensi eigene Leute um undt wieder in der Stadt bezahlt », qui laisse penser que l’administration payait directement le loyer aux propriétaires : NLAH, Hann. 76c A Nr. 208, p. 467. Nr. 193, p. 479. NLAH, Hann. 76c Nr. 193, p. 479. Cette rubrique est parfois intitulée « Für Feld und Stroh auf eine Pferdt » ou « Wegen eines Pferdes für Hardte und Rauhfutter » : NLAH, Hann. 76c A Nr. 194, p. 483. Nr. 210, p. 458. Denis Le Tourneur reçoit en 1680 une augmentation annuelle de 60 Thaler, en 1683 de 20 Thaler : NLAH, Hann. 76c A Nr. 206, p. 437. Nr. 208, p. 467. François Robeau reçoit une augmentation de 20 Thaler, puis de 30 Thaler en juin 1683 : NLAH, Hann. 76c A Nr. 209, p. 419.
– 115 –
Chapitre 2
Au salaire régulier perçu par les musiciens s’ajoutent parfois des gratifications exceptionnelles, motivées par un service ponctuel qui n’est généralement pas explicité. En mai 1674, Philippe La Vigne reçoit deux chandeliers en argent dont le prix est payé directement au fabricant.208 Il s’agit probablement d’une rétribution pour une représentation exceptionnelle, puisqu’un musicien de Hanovre venu en renfort reçoit le même jour une gratification importante.209 Le 14 juillet 1681, trois hautbois reçoivent une gratification: La Garenne, Beauregard et Potot.210 Le 29 mai 1686, le Musicant und Tantzmeister Claude Pécour reçoit 200 Thaler de gratification.211 Ces considérations ne prennent en compte que ce qui est payé par la Kammerkasse. Les musiciens paraissent toucher, en plus du salaire versé par la Kammerkasse, d’autres compléments substantiels prélevés sur d’autres fonds et qui n’apparaissent donc pas dans les Kammerrechnungen. Une liste de rémunérations du personnel de 1681 fait ainsi apparaître plusieurs rémunérations en plus des sommes versées par la Kammerkasse et distribuées par l’intendant (« Summa vom Hr. Cemmerer » : somme reçue de l’intendant).212 Thomas de La Selle reçoit un supplément de 60 Thaler qui n’apparaît pas dans les comptes, peut-être liée à son activité d’enseignement à la Michaelisschule de Lüneburg. Tous les musiciens reçoivent en outre un Kostgeldt de 2 Thaler par semaine (soit 104 Thaler par an) et de l’argent pour la cire (4 Thaler 21 Groschen par an). Philippe La Vigne touche de l’argent pour un cheval (45 Thaler. 22 Groschen et 4 denarii) ainsi que pour payer un serviteur (52 Thaler). Son salaire total monte donc à 656 Thaler, tandis que celui des musiciens qui gagnent le moins s’élève à 244 Thaler – soit sensiblement plus que ce que laissent apparaître les registres de la Kammerkasse. Compte tenu de ces différentes additions, comment se situent les musiciens dans l’échelle des rémunérations du personnel de la cour de Celle ? Les pensions les plus élevées sont bien sûr réservées aux grands aristocrates qui occupent des postes dans la haute administration : à titre d’exemple, le Hofmarschall undt Oberkammerrath (administrateur de la cour et surintendant des finances) von der Thanne touche 2.130 Thaler, le Geheimbter Rath und Großvoigt (conseiller privé et administrateur des domaines) von Cammerstein 2.352 Thaler, et le Ober=Jägermeister (administrateur de la chasse) de Boiselier 3.693 Thaler. Le salaire de ces hauts fonctionnaires est sans commune mesure avec celui des musiciens : entre trois et six fois le salaire du Kapellmeister, et entre huit et quinze fois le salaire des musiciens du rang. Ce dernier est aussi inférieur à celui des deux aumôniers (733 et 627 Thaler) et du premier médecin (623 Thaler). Philippe La Vigne touche un salaire comparable à celui des Hofräthe (les conseillers de la cour payés entre 642 et 682 Thaler). Avec 244 Thaler, le salaire annuel des musiciens est légèrement supérieur à celui des cuisiniers les mieux payés (Mundtkoch, 231 Thaler), mais légèrement inférieur à celui des trompettistes (Hoff= und Feldttrompeter, 288 Thaler) qui disposent de plus de prérogatives et forment un corps organisé règlementé de manière beaucoup plus stricte.213 L’économie matérielle de la musique Les dépenses engagées pour la musique ne se limitaient cependant pas au salaire des musiciens et pouvaient être présentes dans d’autres rubriques : les dépenses extraordinaires (« Zu Sonderbaren 208 209 210 211 212 213
NLAH, Hann. 76c A Nr. 201, p. 331 : « Behueff des Musicantenmeisters la Vigne für 2 Silberne Leuchter an Nicolaus Konnen 32 Thlr 14 gr 2 d. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 201, p. 331: « Eod. Behueff eines Musicanten von Hannover für eine Silbernes Becken, Kanne und 2 Leuchter an demselben. 86 Thlr, 12 gr. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 207, p. 363: « dem Musicanten La Garenne, 40 Thlr. Dem hautbois Beauregard laut beÿliegenden Befehls d. 14. Jul. 1681, 20 Thlr. Dem hautbois Potot laut beÿliegenden Befehls d. 14 Jul. 1681, 40 Thlr. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 211, p. 337. NLAH, Celle Br. 44 Nr. 74: Verzeichnis der Beamten und der Diener des Herzogs Georg Wilhelm und ihrer Besoldung 1681, p. 89-96. Les trompettistes de l’armée et de la cour (« Feld- et Hoftrompeter ») forment une caste de musiciens dotée de privilèges impériaux, organisée en guilde et jouissant d’un grand prestige. Cf. Friedrich Friese, Ceremoniel und Privilegia derer Trompeter und Paucker, sans lieu, ca. 1720.
– 116 –
Administrer la musique française
behueff ») et certaines années une rubrique spéciale consacrée au théâtre et à la musique (« Auff Comedien und Music »). Bien des objets étaient en effet nécessaires pour faire sonner la musique, et cette économie matérielle laisse aussi une trace dans les archives. C’est d’abord le cas des partitions. Le 17 décembre 1694, Leibniz se plaint au représentant diplomatique des villes hanséatiques à Paris, Christophe Brosseau, du mauvais état dans lequel sont arrivés les ouvrages qu’il avait commandés, révélant le risque du transport maritime pour les partitions : celles-ci pouvaient arriver à une mauvaise adresse, mais aussi être endommagées par l’eau et le sable au cours de leur périple.214 Le philosophe déplore également le prix des copies manuscrites, beaucoup plus élevé que celui des imprimés musicaux : De plus dans le gros paquet, les couvertures des livres paroissoient assez endommagées par l’humidité, et par le sable, qui s’estant mis entre deux, les avoit froissé un peu. […] Les pieces Manuscrites de Musique sont aussi endommagées, en sorte qu’il en faudra faire copier de nouveau, ce qui n’est plus lisible. Je croyois que c’estoient des choses imprimées, si je m’en souviens, et je ne crois pas d’avoir demandé ces choses en Manuscrit. Cependant pourveu que la chose n’aille pas trop loin, il faudra s’en contenter. [passage suivant barré : Lorsqu’il faut aller à des sommes considerables, le meilleur est de se faire expliquer les choses de peur d’equivoque. Car je croy qu’on en peut sçavoir le prix avant l’achat. Pour les livres, c’est autre chose puisque cela ne sçauroit aller fort loin.] Mais j’espere que le prix sera tolerable, qu’on pourra faire restablir ce qui est gasté, et qu’on envoyera même quelque petite instruction là dessus pour sçavoir où s’en peuvent trouver les paroles, car nous autres icy ne sommes pas trop informés de ce qui est connu chez vous. […] Si le prix des pieces de Musique alloit trop loin ce seroit une chose embarassante. Et on auroit pu prevenir cet embarras en donnant quelque avertissement touchant le prix qu’on en demande.215
Christophe Brosseau ne se laisse pourtant pas impressionner par les récriminations du bibliothécaire de Hanovre, et se justifie dans une lettre du 27 décembre 1694 : Je suis toutafait surpris de ce que vous me mandez que ces livres et pieces de Musique ont esté moüillées, veu que les caisses où elles estoient ont esté emballées avec tout le soin, et toute la précaution possible. Celles des habits ne l’ayant point esté, elle ne devoient pas l’estre aussy, et il faut qu’on les ait laissé tomber dans l’eau pour s’estre trouvées gastées de la maniére que vous me marquez qu’elles l’ont esté, car la dépense de ces pieces de Musique non imprimées, et toutes ecrites de la main de Mr. Gridé qui passe pour le Maistre de Paris qui note le mieux, monte seule à 346 łł 10 s. et ça esté pour luy un travail de 4 mois. a l’egard des livres. J’en ay payé 404 łł quelques sols audt Sr. de la Lande suivant son mémoire quittancé qu’on a envoyé il y a trois mois a Monsr. Ballati.216
Christophe Brosseau s’est donc adressé à un copiste, qu’il qualifie comme l’un des meilleurs de Paris, pour faire réaliser la musique commandée depuis Hanovre – aucune information supplémentaire sur ce Gridé n’a pu être trouvée. La cour de Celle se faisait aussi envoyer des imprimés musicaux de manière régulière depuis Paris : elle rémunère entre 1671 et 1686 le musicien Du Matin à hauteur de 71 Thaler par semestre « pour envoyer continuellement les nouveaux airs imprimés ».217 Il fallait aussi acheter des instruments de musique. À Celle, un achat d’instruments à Crémone est indiqué le 16 juin 1669, à peine trois ans après l’arrivée des premiers musiciens.218 Cet achat nous renseigne sur la provenance des instruments à cordes utilisés par les musiciens, qui venaient apparemment de la légendaire cité italienne où étaient produits les Stradivarius. 214 215 216 217 218
Sur Christophe Brosseau, voir Marie-Louise Pelus-Kaplan, « Christophe Brosseau, résident hanséatique à Paris, et son action de 1689 à 1717 » in: Les relations entre la France et les villes hanséatiques de Hambourg, Brême et Lübeck. Moyen Âge – xixe siècle, dir. Isabelle Richefort et Burghart Schmidt, Bruxelles 2006, p. 401-421. Lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz à Christophe Brosseau, Hanovre, 17 déc. 1694. Gottfried Wilhelm Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe I/10, éd. Gerda Utermöhlen, Günter Scheel et Kurt Müller, Berlin 1979, p. 644-645. Lettre de Christophe Brosseau à Gottfried Wilhelm Leibniz, Paris, 27 déc. 1694. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe I/10, p. 657. Voir par exemple Hann. 76c A Nr. 196, p. 354 : « dem Musicanten zu Pariß N. Du Matin wegen continuirlich zu überschickenden neüen gedrückten Aires. 17 Thlr 24 gr. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 195, p. 353 : « Eodem [= 16 juin 1689] demselben [= Stechinelli] wegen Musicalische instrumente von Cremona zubringen, 22 Thlr. »
– 117 –
Chapitre 2
Il s’agissait là visiblement d’une pratique courante y compris pour la musique française : JeanBaptiste Volumier, maître des concerts à la cour de Dresde, se rend lui aussi à Crémone en juillet 1715 pour superviser la fabrication, dans les ateliers de Stradivarius, de douze violons pour la Hofkapelle de Dresde.219 Plus tôt dans le xviie siècle, on trouve l’indication que des musiciens français jouent sur ces instruments : un contrat d’association signé à Paris en 1643, où figure Henri Le Tourneur, le père de Denis Le Tourneur, requiert des musiciens qu’ils jouent sur des instruments de Crémone, alors même que la désignation des instruments se fait selon la tradition française qui divise la famille des cordes en cinq types d’instruments.220 Enfin, d’autres objets plus inhabituels apparaissent au fil de la comptabilité, montrant en pointillé l’émergence d’une culture matérielle spécifique attachée au patronage de musique française : des castagnettes sont achetées à Claude Pécour221, un plat d’argent est offert au comédien Nanteuil222, tandis que le maître de danse des pages fournit du papier pour le ballet, pour un usage qui reste mystérieux.223
Négocier les goûts réunis C’est en 1755, dans son autobiographie, que Quantz lâche à propos de l’orchestre de Dresde une expression destinée à faire fortune : vermischter Geschmack – le goût mêlé, ou encore les goûts réunis : En mai de l’année 1716, je me rendis à Dresde. […] L’orchestre royal était alors déjà particulièrement florissant. Grâce à la manière égale de jouer, introduite par le feu maître des concerts Volumier, il se distinguait déjà de beaucoup d’autres orchestres : si bien que par la suite, sous la direction de son successeur le maître des concerts Monsieur Pisendel, grâce à l’introduction d’un goût mêlé, il fut peu à peu élevé à une telle finesse dans l’exécution que, de tous mes voyages ultérieurs, je n’en ai jamais entendu de meilleur.224
À travers la notion de goûts réunis, cet hommage rétrospectif à la Hofkapelle de Dresde mobilise une notion centrale dans la théorie musicale du xviiie siècle que Quantz avait déjà développée dans son traité de 1752 sur la flûte traversière. Mais la notion développée ici n’est pas purement esthétique. Au contraire, elle possède un soubassement administratif très concret, puisqu’elle provient en droite ligne d’une réalité institutionnelle très tangible et localisée qui réunit, au sein la Hofkapelle de Dresde, des musiciens français avec des musiciens italiens. Reconstruire avec précision cette réalité institutionnelle, les tensions auxquelles elle donna lieu et la manière dont elle fut gérée par l’administration forme donc une étape décisive pour comprendre les enjeux de la notion de goûts réunis. En effet, la vision quelque peu irénique présentée par Quantz ne dit pas la difficulté qu’il y avait, pour l’administration, à faire coexister et souvent collaborer des musiciens d’origines diverses, qui avaient souvent une compréhension différente de leur métier et des pratiques musicales bien distinctes.
219 220 221 222 223 224
Kai Köpp, « Woulmyer, Jean-Baptiste », in : MGG online. Un inventaire non daté de la cour de Weimar porte aussi la trace d’un instrument acheté par Volumier à Crémone. HStA Weimar, Hof- und Haushaltwesen, A 9274, fol. 1 : « 5. Ein Cremoneser von Volumine aus dresden Leib Violino ». Jurgens, Documents du minutier central, vol. 2, p. 403-407 : « Plus est accordé que tous les associez auront tous instrumens de Cremonne. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 214, p. 486 : « für Bücher und 4. paar Castagnettes dem Tantzmeister Pecour. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 200, p. 894 : « Für ein Silbergeschir an dem Comoedianten Nantueille. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 208, p. 356 : « dem Pagen Praeceptor Torneman für Pappier zum Ballet. » L’autobiographie de Johann Joachim Quantz est publiée par Friedrich Wilhelm Marpurg, Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, 1, 1755, p. 206 : « Im März des 1716 Jahres, begab ich mich nach Dresden. […] Das Königliche Orchester war zu der Zeit schon in besonderm Flor. Durch die, von dem damaligen Concertmeister Volümier eingeführte französische egale Art des Vortrags, unterschied es sich bereits von vielen andern Orchestern: so wie es nachgehends, unter der Anführung des folgenden Concertmeisters Herrn Pisendel, durch Einführung eines vermischten Geschmacks, immer nach und nach zu solcher Feinigkeit der Ausführung gebracht worden; daß ich auf allen meinen künftigen Reisen, kein bessers gehört habe. » L’historiographie française utilise plus fréquemment le terme de « goûts réunis » employée dès 1724 par François Couperin dans Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts, Paris 1724.
– 118 –
Administrer la musique française
Pratiques d’hybridation Les goûts réunis devaient donc d’abord être négociés sur le terrain de la vie quotidienne avant que de se voir reflétés ou mis en pratique dans un style d’exécution ou encore dans des œuvres musicales. Si cette négociation s’avéra particulièrement ardue à la cour de Dresde, où la distinction entre musiciens français et italiens était redoublée par une différence de patrons qui rendait délicate leur unification au sein d’un même ensemble, elle fut beaucoup plus pacifique à Hanovre, où tous les musiciens étaient placés sous l’autorité d’un seul protecteur, le duc Ernst August. Horticulture et musique : des structures bicéphales Dès le milieu des années 1690, dans la dédicace de son Florilegium primum, son premier recueil de pièces dans le style français, Georg Muffat avait esquissé le rapprochement suivant : La Musique a cela de commun avec les fleurs, qu’elle craint l’ombre, & le froid : & qu’elle se fomente, & croit par la vertu de la lumiere, & de la chaleur. […] Or comme la variété des plantes & des fleurs est le plus grand charme des Jardins ; & que la perfection des hommes Illustres eclate dans la diversité de plusieurs vertus unies ensembles pour la gloire, & d’une sagesse, & Vertu de diverses formes, & especes, Il ne me falloit pas servir d’un simple style seul, ou d’une même methode ; mais selon les occurrences du plus sçavant mélange que J’aye pû acquerir par la pratique de diverses nations.225
La comparaison entre la musique et l’art des jardins n’était pas seulement une fleur de rhétorique : au contraire, le « savant mélange » des styles est le pendant direct des greffes et des sélections florales entreprises par le botaniste. Le dédicataire du volume, l’évêque de Passau Johann Philipp von Lamberg (1651-1712) qui était aussi le nouvel employeur de Muffat, entamait l’année même de la parution du Florilegium Primum la rénovation des jardins de sa résidence d’été à Hacklberg, les faisant doter d’une orangerie, d’une figuerie, d’une serre pour les ananas, et surtout d’une série de fontaines en cascade dessinées par Thomas Diesel.226 De son côté, Muffat avait déjà publié une collection de pièces italiennes placée sous les auspices de Corelli en 1681, sous le titre Armonico Tributo. Il se proposait donc désormais de compléter sa collection par des essences musicales françaises qu’il voulait acclimater dans son nouveau lieu d’exercice.227 En Basse-Saxe, la distinction entre jardins à la française et jardins à l’italienne était également structurante depuis longtemps : dès 1663, le duc de Wolfenbüttel Anton Ulrich avait fait ériger un jardin italien à Salzdahlum, sous la supervision de Johann Balthasar Lauterbach et de Hermann Korb. Tous les codes du jardin à l’italienne étaient présents : terrasses étagées, motifs géométriques, statues de marbre, superficie moyenne, et même corps de logis construit d’après le modèle des villas italiennes.228 À Hanovre, un projet de jardin à la française vit le jour entre 1687 et 1689 autour du pavillon de plaisir de Herrenhausen : explicitement conçu comme un pendant au jardin de Salzdahlum, il était doté d’une orangerie et d’un théâtre d’extérieur et fut réalisé avec la collaboration du jardinier Martin Charbonnier (Illustration de couverture). À Celle, où un jardin à la française avait été aménagé au sud des murailles de la ville à partir de 1670, la bicéphalie du style français et du style italien s’étendait aussi à bien d’autres domaines de la vie culturelle. Les listes de comptes font apparaître deux jardins : un jardin français, conçu par le jardinier Henri Péronnet, puis placé à partir de 1690 sous la direction de René Dahuron, auteur d’un traité sur la taille et la culture des arbres publié chez l’imprimeur de la cour de Celle André Holwein, qui imprimait aussi
225 226
227 228
Georg Muffat, Florilegium Primum, éd. Heinrich Rietsch, Vienne 1894 [Augsburg 1695], p. 17. Heike Juliane Zech, Kaskaden in der deutschten Gartenkunst des 18. Jahrhunderts. Vom architektonischen Brunnen zum naturimitierenden Wasserfall, Vienne 2010, p. 87-88. Sur le jardin de la résidence principale à Passau, dont la restauration commença l’année suivante en 1696, cf. Edith Schmidmaier, Die fürstbischöflichen Residenzen in Passau, Francfort 1994, p. 170-188. Muffat, Florilegium Primum, p. 17 : « Par cette heureuse transplantation, Monseign. je me suis vû tout aussitôt comblé de tout ce que la douceur de l’air & la fertilité du terrein peuvent contribuer de meilleur aux fleurs » Urs Boeck, « Gartenkunst in Niedersachsen vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts », in : Historische Gärten in Niedersachsen. Katalog der Landesaustellung, Langenhagen 2000, p. 15-29, ici p. 19.
– 119 –
Chapitre 2
les livrets de divertissements français229 ; et un jardin italien, sur lequel fut bâti en 1925 le célèbre quartier « Siedlung Italienischer Garten » par l’architecte Otto Haesler. Mais cette distinction s’appliquait aussi au théâtre, puisque la cour de Celle avait une troupe de comédiens français dirigée par Boncourt, doublée d’une troupe d’Italiens placée sous la direction de Constantin. Les musiciens français et l’ascencion de Steffani Au moment où elle apparaissait dans le domaine de la musique, la dichotomie des styles français et italien avait donc déjà une histoire dans l’art des jardins et dans le théâtre. À Hanovre, les musiciens français restèrent majoritaires dans la Hofkapelle pendant tout le règne d’Ernst August, mais celui-ci n’en conservait pas moins une forte inclination pour l’opéra italien : dès son installation à Hanovre, seulement quelques semaines après avoir reçu l’hommage de la bourgeoisie de la ville, il se rendit à Venise pour y passer le carnaval – et continua à passer plusieurs mois dans la cité des Doges au cours des années suivantes.230 Les musiciens français pouvaient d’ailleurs faire partie de la suite qui accompagnait la famille ducale à Venise : en 1684, Jean-Baptiste Farinel, Pierre Vezin et Stéphane Valoy firent partie du voyage.231 Vingt ans plus tôt, lorsqu’Ernst August n’était encore qu’évêque d’Osnabrück, les « violons François » avait déjà fait partie d’un voyage à Venise.232 Ces fréquents déplacements dans la péninsule italienne n’allaient cependant pas sans poser des problèmes de gouvernance causés par les longues absences des souverains, ainsi que des dépenses considérables. Les dignitaires de la cour de Hanovre offrirent ainsi Ernst August de construire sur place un nouvel opéra : la salle de théâtre construite par Johann Friedrich entre 1676 et 1678, avec une jauge modeste de 408 places, se prêtait en effet très bien au théâtre parlé mais beaucoup moins à l’opéra. Un terrain fut donc acheté en décembre 1687, un compositeur italien recruté en la personne d’Agostino Steffani, et les travaux commencèrent. L’inauguration de ce nouveau complexe architectural eut lieu en janvier 1689, avec la production de l’opéra Henrico Leone, mis en musique par Agostino Steffani sur un livret de Ortensio Mauro, dont l’action située à Lüneburg rappelait les origines glorieuses de la dynastie des Guelfes, sur laquelle Leibniz avait déjà planché lors d’un voyage d'études généalogiques à travers tout l’Empire.233 Agostino Steffani, le compositeur de l’opéra et nouvel homme fort de la cour, avait déjà travaillé comme compositeur à la cour de Bavière et fut recruté par Leibniz alors qu’il effectuait un séjour de dix mois à Paris (1678-1679). Pendant les dix années suivantes, Steffani continua à composer des opéras pour la cour de Hanovre, livrant ainsi un corpus considérable tant par son ampleur que par sa qualité. Tous ces opéras furent repris sur les scènes de l’Empire jusqu’en 1700 – à l’opéra du Gänsemarkt à Hambourg et à l’opéra de Braunschweig, mais également à Augsburg et Stuttgart – et l’Orlando Generoso (1691) donna même lieu à plusieurs publications par extraits, notamment les mouvements instrumentaux publiés en 1705 par Roger à Amsterdam.234 L’identité du personnel musical actif dans la production des opéras de Steffani demeure difficile à déterminer, puisque les chanteurs italiens que l’on faisait venir pour chaque saison n’étaient pas payés directement par la cour, mais sur les deniers personnels d’Ernst August qui réussissait apparemment à couvrir l’intégralité des coûts du nouvel opéra avec les revenus qu’il percevait comme évêque d’Osnabrück. De ce fait, aucune dépense pour l’opéra n’apparaît dans 229 230 231 232
233 234
René Dahuron, Traité de la taille des arbres, et de la manière de les bien élever, Celle 1692. Fischer, Musik in Hannover, p. 8-9. Fischer, Musik in Hannover, p. 9. Lettre de Sophie de Hanovre à Karl Ludwig von der Pfalz, Venise, 29 août 1664. Bodemann, Briefwechsel, p. 7677 : « L’apresdiné toute la companie nous y venoit trouver et nous les fimes danser à l’Engloise apres la musique de nos violons François, qui faisoient un effect admirable dans cette belle salle sur une galerie ballustrée, qui va tout à l’entour. » Colin Timms, Polymath of the Baroque. Agostino Steffani and His Music, Oxford 2003, p. 49-56. Christian Seebald, Libretti vom « Mittelalter ». Entdeckungen von Historie in der (nord)deutschen und europäischen Oper um 1700, Tübingen 2009, p. 73-136. Timms, Polymath of the Baroque, p. 177.
– 120 –
Administrer la musique française
les Kammerrechnungen, et comme les comptes privés ne sont pas conservés, nous ne disposons plus des listes de personnel – à l’exception d’un seul bordereau non daté, qui mentionne parmi le personnel pour l’année 1689 (outre plusieurs chanteurs) six musiciens italiens (« Sechs Italienische Musicanten ») et deux musiciens français (« Frantzösische Musicante »).235 La collaboration entre les chanteurs italiens et les musiciens français en poste dans la Hofkapelle de Hanovre, si elle est très peu documentée dans les archives, peut en revanche être décelée dans les sources musicales elles-mêmes. Plusieurs indices montrent en effet que Agostino Steffani a très vite adapté ses pratiques d’orchestration et de composition à la nomenclature et au style typiquement français de l’ensemble orchestral de Hanovre.236 Certaines particularités sont présentes dès le début de son activité à Hanovre : son écriture remarquable pour le hautbois, ainsi que sa prédilection pour le trio de bois à la française (avec deux hautbois et un basson), ou encore l’insertion d’indications de jeu et de noms d’instruments en français. Son premier opéra Henrico Leone débute ainsi avec un air accompagné par un trio de bois à la française (« Tra le braccia de la morte ») : Steffani exploite donc ce point fort de l’orchestre dès les premières mesures qu’il compose pour Hanovre. D’autres caractéristiques sont plus lentes à venir : les deux premiers opéras composés pour Hanovre en 1689 (Henrico Leone et La lotta d’Hercole con Acheelo) utilisent encore un ensemble de cordes à l’italienne, avec deux parties de violons et une partie d’alto comme il l’avait pratiqué à Munich (sol 1, sol 2, ut 3, fa 4). Mais dans tous ses opéras ultérieurs, Steffani fait usage de clés françaises avec deux parties d’alto.237 Ces différents éléments – ainsi que peut-être, comme le suppose Graham Sadler, l’ornementation et l’usage des sourdines pour le violon – montrent que Steffani travaillait avec un ensemble instrumental largement pétri de pratiques musicales d’origine française. En revanche, son écriture vocale demeure toujours largement italienne, non seulement bien sûr du point de vue linguistique, mais aussi sur le plan du style musical. Cette collaboration inédite entre musiciens français et italiens est l’un des premiers exemples de « goûts réunis » en action sur le territoire de l’Empire. Elle est également visible sur le plan social : en 1688, le chef des violons français du duc de Hanovre, Jean-Baptiste Farinel, épousa la célèbre soprano vénitienne Vittoria Tarquini.238 Parmi les témoins du mariage figurent entre autres un ferrarais, un siennois et un vénitien. Vittoria Tarquini, surnommée « La Bombace », rentre plus tard au service du duc Ferdinand de Médicis à Venise en 1707. Elle doit une partie de sa célébrité au fait d’avoir eu une hypothétique liaison avec Händel lorsque celui-ci était à Venise au service des Médicis.239 Si l’on peut se demander quelle fut la nature exacte des relations matrimoniales entre Farinel, actif à Hanovre, et une soprano qui passait le plus clair de son temps en Italie, ce mariage est intéressant du point de vue social : à la différence des autres musiciens français du rang, Farinel est en lien avec le monde musical italien le plus prestigieux de son époque. Ceci peut expliquer la confusion que fait Mattheson sur son origine, lorsqu’il affirme savoir « de source sûre » que Jean-Baptiste Farinel est l’oncle du castrat italien Carlo Broschi, dit Farinelli.240 Curieusement, Farinel ne fait pas baptiser d’enfants à l’église catholique de Hanovre.
235 236 237 238 239 240
NLAH, Dep. 103 IV Nr. 300, fol. 9. Cf. Helen Coffey, « Opera for the House of Brunswick-Lüneburg : Italian Singers at the Hanover Court », in : Agostino Steffani. Europäischer Komponist, hannoverscher Diplomat und Bischof der Leibniz-Zeit, dir. Claudia Kaufold, Nicole K. Strohmann et Colin Timms, Göttingen 2017, p. 107-122. Voir en particulier Graham Sadler, « Agostino Steffani and the French Style », in : Agostino Steffani. Europäischer Komponist, hannoverscher Diplomat und Bischof der Leibniz-Zeit, dir. Claudia Kaufold, Nicole K. Strohmann et Colin Timms, Göttingen 2017, p. 67-87. Sadler, « Agostino Steffani and the French Style », p. 73. BAHild, KB Nr. 778, Hannover St. Clemens, Traubuch 1667-1711, 8 janv. 1698, p. 75 : « ego idem conjuxi matrimonio dominum Joannem Baptistam Farinelli Toringum et Dominam Vittoriam Tarquini Venetam, praesentibus testibus dominis Carolo Victa Farrariensi, Joseph Guidi Senesi, et Francisco Olinieri Veneto, alÿsque. » Ellen Harris, Handel as Orpheus. Voice and Desire in the Chamber Cantatas, Cambridge 2001, p. 180. Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, Hambourg 1740, p. 483.
– 121 –
Chapitre 2
La culture des goûts réunis à Hanovre trouve une expression particulièrement forte dans les Concerti da camera publiés chez Roger en 1714 par Venturini. Le titre et la dédicace du volume, rédigée en italien, placent d’emblée la production musicale de Venturini sous le signe de l’Italie tout en soulignant l’importance de sa formation à la cour de Hanovre, où il affirme avoir appris son « métier de l’harmonie ».241 Ceci n’est pas étonnant si l’on considère que Venturini a été formé par Farinel, comme l’affirme Walther.242 La composition du recueil trahit dans le détail un mélange très poussé du style français et du style italien. Chaque « Sonate » comprend en effet plusieurs mouvements dont l’intitulé est habituellement rédigé en français (Allemande, Gavotte, Menuet, etc.), et se trouve introduite alternativement par une ouverture à la française ou par mouvement vif concertant, à la manière d’un premier mouvement de concerto italien pour violon. Les Concerti de Venturini sont donc un formidable témoignage musical d’une identité culturelle indissociablement italienne et française, qui reflète les pratiques musicales et les orientations stylistiques de la Hofkapelle de Hanovre. Après la mort de sa première femme en janvier 1730, François Venturini se remarie d’ailleurs avec une certaine Anna Martha Calegari sans doute d’origine italienne.243 La musique française en question L’année 1717 peut être qualifiée sans trop d’exagération d’annus horribilis pour la musique française à Dresde : le prince électoral de Saxe Friedrich August II, dont le séjour à Venise s’éternisait plus que de coutume et de raison, imposa à son père et à toute la cour la présence de musiciens italiens de premier plan, dont l’arrivée à la fin de l’été faisait concurrence aux musiciens français et allemands déjà présents dans la Hofkapelle de Dresde, dont elle venait troubler l’organisation et les membres. Quelques mois plus tard, vers l’automne, Louis Marchand, organiste du roi à la chapelle royale de Versailles et virtuose international, refusa le poste d’organiste de la cour de Dresde avant de s’enfuir de la ville de façon humiliante suite aux intrigues de Jean-Baptiste Volumier, si du moins l’on en croit le récit donné dans la nécrologie de Bach. Ces deux indices marquent de façon différente, mais bien réelle, une remise en question de la place de la musique française à Dresde – fragilisation également lisible à travers les archives de la cour. Musique française, musique italienne : un royal affrontement Le conflit qui se joue entre Auguste le Fort et le prince Friedrich August au début de l’année 1717 autour de l’engagement de musiciens italiens à la cour de Dresde est le premier épisode d’un processus passionnant qui place les musiciens et la question des styles nationaux au cœur d’une lutte de pouvoir. En effet, le prince avait engagé pendant son séjour à Venise plusieurs musiciens italiens de premier plan pour son service personnel, mais qu’il souhaitait voir engagés à Dresde, notamment en vue de son mariage pour lequel les négociations étaient déjà entamées. Parmi eux se trouvaient notamment le compositeur Antonio Lotti avec sa femme Santa Stella, le violoniste Veracini, ainsi que plusieurs chanteurs : la soprano Margherita Catterina Zani (la Maruccini), la contre-alto Lucia Gaggi (la Bavarini), les castrats Francesco Bernardi (Senesino) et Matteo Berselli, ainsi que le ténor Francesco Guicciardi. Le compositeur allemand Johann David Heinichen, qui avait séjourné en Italie de nombreuses années où il avait connu un grand succès et s’était illustré dans la composition de genres italiens comme l’opéra et le concerto, faisait également partie du personnel musical engagé par le prince. On trouvait enfin le poète Luccini et le contrebassiste Geramolo Personelli.244 241 242
243 244
François Venturini, Concerti di camera, vol. 1, Amsterdam, 1714, dédicace non paginée. Walther, Musicalisches Lexicon, p. 629 : « Venturini (Francesco) ein annoch lebender berühmter Violinist, und Concert-Meister beym Churfürsten zu Hannover, Georg Ludwig, (der nachhero König in England geworden) hat ein aus 4 bis 9 Instrumenten gesetztes Concerten-Werck bey Roger zu Amsterdam graviren lassen. Er ist ein Scholar des Hrn. Farinelli. » BAHild, KB Nr. 782, Hannover St. Clemens, Beerdigungen 1711-1833, 13 janv. 1730, p. 85. BAHild, KB Nr. 781, Hannover St. Clemens, Traubuch 1711-1843, 7 déc. 1730, p. 50. Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 105.
– 122 –
Administrer la musique française
La correspondance entre le prince et son père fait clairement apparaître les résistances opposée par Auguste le Fort à l’idée de voir débarquer en Saxe des virtuosi italiens placés sous la protection de son fils, et par là même susceptibles de contester la hiérarchie établie et de semer la confusion parmi les membres de l’orchestre. Mis devant le fait accompli, Auguste le Fort dut pourtant céder de bonne grâce et prendre les devants pour limiter les dégâts. Une lettre adressée à l’accompagnateur du prince témoigne de ses premières tentatives pour devancer, et dans une certaine mesure contenir, les vélléités de mécénat musical de son fils Friedrich August : Monsieur le Palatin de Livonie, Il me souvient que le Prince Royal mon Fils avoit souhaitté cy-devant d’amener des Chanteurs et des Chanteuses Italiens, et qu’il en avoit même deja engagé quelques uns. Comme le Prince se trouve présentement à Venise, Je luy donne la permission, et même la commission d’en engager autant qu’il en faut pour former une Chapelle de voix complette, qui puissent servir à l’Eglise et former un Opera. Pour des Virtuosi d’Instruments, nous n’en avons pas besoin ayant un Orquestre complet. […] il sera necessaire d’engager un machiniste, et un compositeur ; pour ce qui est d’un Maître de Chapelle, nous en avons déjà un.245
Les principaux éléments de la négociation étaient donc posés d’emblée : le roi accepte d’engager un ensemble de chanteurs italiens, mais ils devront être actif à la fois à l’opéra et à l’église. Il décline donc l’idée initiale du prince d’engager des chanteurs uniquement pour l’opéra et refuse l’idée d’avoir des instrumentistes ou d’engager un nouveau maître de chapelle, poste occupé depuis 1697 par Johann Christoph Schmidt. Un mémoire adressé le 28 mars 1717 depuis Venise par le prince à son secrétaire particulier et valet de chambre Peter Hoffmann vient révéler les moyens mobilisés par le prince pour mener à bien la négociation avec son père : il redouble sa propre communication écrite par un plaidoyer « de bouche » dont il charge son secrétaire, intervient directement auprès du Hofmarschall, le plus haut responsable administratif de la cour, pour lui recommander ses musiciens, et s’inquiète de la réception qui leur sera faite à la cour de Dresde.246 Ce mémoire est assorti d’un second document intitulé « Réponses du Prince Royal », dans lequel Friedrich August résume les observations de son père avant d’apporter une réponse détaillée à chacune d’entre elles (Tableau 2.8).247 On voit ici réapparaître les conditions déjà formulées par Auguste le Fort en 1716, explicitées et assorties de nouvelles réserves. Le roi refuse à nouveau l’idée d’employer Heinichen : si Antonio Lotti peut composer les opéras, c’est Schmidt qui continuera à assurer exclusivement les fonctions de Kapellmeister. Il accepte en revanche d’engager Veracini comme instrumentiste, mais à la condition seulement qu’il ne dérange pas l’orchestre. Enfin, il réaffirme son opposition à l’idée d’employer des chanteurs spécialement pour la chapelle. Le ton de ces remarques marque une certaine réticence vis-à-vis des initiatives musicales du prince à Venise. Ce dernier semble d’ailleurs avoir parfaitement cerné leur conflictualité potentielle, puisqu’il apporte à chacune d’elle une réponse à la fois détaillée, respectueuse et pleine de soumission. L’un des enjeux décisifs de la négociation était bien entendu le prix des musiciens italiens. Mais là encore, le prince fait montre de prudence : lorsqu’il envoie Veracini « en Italie pour y engager deux chanteuses et un Contre-Alto pour le Service du Roi » quelques mois plus trad, il fait écrire une lettre à Watzdorf pour le prier de « remettre quelque argent afin que Veracini puisse s’en servir pour fournir aux frais de la depense que l’obtien de ces trois personnes exigera », mais aussi pour lui demander « jusqu’à combien S[a] M[ajesté] pourroit étendre la somme d’argent 245 246
247
Lettre d’Auguste le Fort à Józef Kos, Varsovie, 15 fév. 1716. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/2, fol. 31-32. Lettre de Friedrich August II à Peter Hofmann, Venise, 28 mars 1717. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 48. Voici quelques ordres donnés par le prince à Hoffmann : « 2. Supplier Sa M. de lui permettre d’exposer de bouche [ce] dont je l’ai chargé au sujet de Lotti, Mauro, et autres Musiciens pour l’opera. 3. De les recommender de ma part à M. le grand Marechal, et à ceux à qui ils auront à faire. 4. Demender de ma part l’ordre de Sa M. pour choisir les quarties convenables pour eux à leurs [sic] arrivée. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 49 sq. Le document original est présenté en deux colonnes : celle de gauche est intitulée « Extrait des Observations de Sa Majesté a faittes sur le memoire du Prince Royal », celle de droite « Reponse du Prince Royal sur les dittes observations. »
– 123 –
Chapitre 2
Tableau 2.8. Réponse de Friedrich August II. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 49 sq. Réponse du Prince Royal sur les observations que Sa Majesté le Roy a faittes, et luy a communiquées sur son memoire du 30. janvier 1717. 1.
Sa Majesté demende combien font les 2100. Pistoles accordés à Lotti avec sa Femme Santina, à la monnoye d’Allemagne ? Elle trouve ainsi cette somme bien fort, sur tout les fraix du voyage n’y etant pas compris. Ad 1. Une Pistole vaut autour d’un Louis d’or, c’est à dire 7. florins et demy d’Allemagne. Il a fallu accorder cette somme au dit maitre Antonio Lotti pour un an, parce qu’icy à Venise on offroit à luy et à sa femme qui est la premiere chanteuse d’Italie, 6000. Ducati de Venise pour un seul Carnaval, qui ne dure au plus que 3 mois. Et sans ce maistre et sa Femme qui sont e[n] [ré]putation on n’auroit jamais attiré les autres Chanteurs et Chanteuses de premier [plan].
2.
Sa Majesté veut etre informée, si le machinistre Alessandro Mauro ne pretendra pas, qu’outre sa pension qu’il touchera par an, le travail luy soit payé à part ? Au reste il seroit bon que le dit machinistre arriva en Saxe avant les virtuosi de vois, pour travailler d’avance au Theatre. Ad 2. Le Prince Royal a accordé au dit machiniste 1000. ducats d’or de pension par an, sans qu’on luy paye son travail à part. Mais comme il ne peut travailler seul à touttes les machines et decorations, qu’il a besoin specialement [pour] le commencement des Peintres et Charpantiers qui ont la [pra]tique, Mgr le Prince ne sçachant pas s’il y en a dans le Paÿs a [cr]u pouvoir luy accorder, de [con]duire avec luy deux Peintres et deux Charpantiers d’icy qui ont receu aussi leurs contrats selon la specification rep[roduite] sub litera A. On luy a aussi [promis], de luy fournir d’autres ouvriers, selon la necessité du travail, lorsque ceux cy ne suffiroient pas. Et pour qu’il ayt le tems de travailler d’avance au Theatre selon les ordres de Sa Majesté, Mgr le Prince le fait partir avec les autres Peintres et Charpantiers immediatement apres les Fêtes.
3.
Sa Majesté ordonne de specifier combien le Poette coutera ? Ad 3. Le Poette coutera 200. Pistoles par an, le quartier franc, et les fraix du voyage à part. Il ne partira d’icy que dans le 7bre prochain, et de ce tems là son service commencera. Comme il n’est pas l’homme de la premiere sphere pour faire des Opera nouveaux, ces sortes de gens etants difficiles à trouver et trop Chers, il sera bon pour composer des Oratoires, des Serenades, des Poesies pour la Musique de la Chambre, pour abbreger ou prolonger les Scenes, et pour changer les Airs et les accomoder à la fantaisie du Compositeur et des musiciens. Pour avoir des Opera nouveaux qui n’ont jamais paru, on en peut faire faire par des habils Poettes en payant 100. ducats d’or de regal pour la Composition d’un nouveau livre, et il sera approprié à l’occasion pour laquelle l’opera doit servir, commme pour un grand mariage, pour la naissance de quelque Prince, ou pour le passage de quelque Prince etranger qu’on veut honorer.
4.
Sa Majesté veut, qu’on marque en detail combien chaqu’un des Chanteurs et chanteuses pretendent tant pour leurs pensions que pour les frais du voyage. Et comme Sa Majesté est dans l’incertitude où Elle passera le Carnaval prochain, afin que cette depense ne soit pas inutile, Elle souhaitte qu’on les engage tous pour le moins pour 3. ans. Ad 4. Le Prince Royal envoit dans le papier separé sub litera A la liste des musiciens, et des gens necessaires pour le Theatre qui sont deja actuellement engagés, et de ceux auxquels on a fait faire des propositions, et dont on attend d’un jour à l’autre les reponses. On ne peut pas les arreter pour un tems incertain, par exemple quand on en auroit besoin, parce qu’ils sont ordinairement engagés d’une année à l’autre pour tant de Theatres qui sont en Italie. Si on ne les arrete pas tous ensemble, et pour un tems fixé, on ne peut pas compter sur eux dans le besoin, car ils ne se trouveroient pas pour lors en liberté. La premiere année etant passée on pourra les arreter plus longtems, en les traittant bien, et lorsqu’ils n’auront pas sujet de se plaindre. Mais si on leur proposoit à present, de rester 3. ans, Mgr le Prince croit que celà les intimideroit, specialement ceux qui ne sont jamais sorti d’icy, et qui ont de la peine à quitter leur Paÿs. Pour les fraix du voyage, comme chaqu’un a son valet, et chaque femme sa servante, on peut compter 80 ducats d’or par personne avec son valet pour aller, et autant pour revenir.
5.
Sa Majesté ne souhaitte pas qu’on achette des Clinquans, des Pierreries, et autres etoffes pour les habits de Theatre, jusqu’à nouvel ordre. On pourra cependant luy envoyer la spécification de ce qui sera necessaire. Ad 5. On n’en a rien achetté, Mgr le Prince envoye à Sa Majesté les echantillons, et la specification des etoffes, de la quantité nécessaire, et de leur prix, pour habiller 7. acteurs et Actrices, et 60. personnes pour la suitte appellés Comparse, sub litera B. Il envoye aussi 11. pieces des pierreries enchassées pour les faire voir à Sa Majesté, et la specification sub litera C combien il en faut de chaque espece, avec leur prix pour habiller richement les Acteurs. Comme selon cette specification il en faut 8222 pierres, chaque pierre grande et petitte, l’une avec l’autre pour 10 sols de Venise, ce qui fait 550. Ecus d’Allemagne. S’il y en a dans la garderobbe de Sa Majesté il est aisé de voir s’il n’y en a pas assés, pour pouvoir suppleer au defaut.
– 124 –
Administrer la musique française
Tableau 2.8. (suite et fin). 6.
On ne peut pas si promptement remettre la Somme d’argent requise à Venise. À la foire prochaine de Leipzig Sa Majesté qui sera alors de retour en Saxe pourra envoyer la moitié de la Somme. Ad 6. Il n’est pas necessaire de remettre si tôt toutte la somme. Il suffit que le Banquier Jacques Bensperg, qui a fait sur la parole de Mgr le Prince la caution à tous ceux qui sont engagés, ait presentement pour sa sureté avis du Sr. Deeling, ou de quelque autre banquier de la Saxe, qu’on luy remettra la moitié de la somme avant le mois d’Aout prochain, puisque ces gens là ne doivent partir que dans le 7bre, afin qu’il puisse leur donner une partie des pensions qu’ils voudront laisser icy à leurs familles, et pour les fraix de leur voyage, et qu’il recevra surement l’autre moitié de la somme necessaire avant la fin de cette année, ou au comencement de l’autre. Et puisque le dit Banquier a deboursé sur la parole de S[on] A[ltesse] R[oyale] 843 ducats d’or, pour expedier le machiniste Mauro avec les deux Peintres et les Charpantiers qui partent immediatement après les Fêtes, S[on] A[ltesse] R[oya]le supplie Sa Majesté de luy faire rembourser cet argent promptement.
8.* Si les dits musiciens ne peuvent etre en Saxe que vers la fin du mois d’Octobre, il pourrait arriver qu’on ne pourroit point du tout s’en servir. Ad 8. Mgr le Prince l’a fait sur les ordres qu’il avoit recus de Sa Majesté, qu’Elle souhaittoit les avoir pour la Foire presente de Pâques, et comme il n’a pas eté possible de les unir pour ce tems là, il a taché de les engager et faire aller au plus tôt. Il n’a pû differer non plus de donner sa parole au maitre Antonio Lotti de qui depend tout le reste pour en rendre compte premierement, comme il l’auroit souhaitté, à Sa Majesté, parce qu’avant la fin du Carnaval ces gens s’engagent pour le Carnaval prochain. 9.
A quoy bon le Compositeur Alleman Heinicken, puisqu’il y en a deja un pour l’Opera, et que Schmidt est suffisant pour le reste. Ad 9. Comme le Compositeur Lotti n’est engagé qu’au temps que Sa Majesté aura l’Opera quand Elle voudroit avoir des voix pour la Chapelle, Mgr le Prince croit, qu’un habil compositeur comme Heinichen qui a eté fort approuvé par les Italiens mêmes, y seroit aussi necessaire d’autant plus, qu’il l’a mis à l’epreûve en plusieurs occasions icy, où il a tres bien reussi.
10. Sa Majesté approuve l’engagement du fameux violon Veracini, à condition que celà ne derangera rien dans l’Orquestre. Ad 10. Il a eté pris à cette condition. 11. Il n’est pas besoin des virtuosi des voix expres pour la Chapelle. Ceux de l’Opera doivent s’engager à y chanter quand on le jugera à propos, comme ils font ailleurs, au moins les hommes. Ad 11. Mgr le Prince n’en a point pris, et n’en prendra pas sans ordre exprès de Sa Majesté. Les remarques à part. 1. Comme les pierreries specifiees dans l’article 5.me ne servent que pour garnir les habits des Acteurs et Actrices, et qu’on en a besoin de plus fines pour la tête pour 3 Femmes, Mgr le Prince envoye à Sa Majesté les deßeins de la grandeur requise de ces pierres, avec la specification sub litera D combien il en faudroit pour celà, en cas qu’on n’en ait pas dans la garderobbe de Sa Majesté ? S’il en falloit faire, on les travaille beaucoup mieux à Paris, qu’à Venise. Ce qui est pour la tête est ordinairement enchassé en argent. Pour le prix on ne peut pas le sçavoir icy. 2.
La quantité des etoffes marquées dans la specification sub litera B. dont Mgr le Prince envoit plusieurs echantillons à Sa Majesté, sert pour habiller tous les Personnages pour un Opera, si Sa Majesté souhaitte avoir des Opera differens, quoy que ces mêmes etoffes pourront etre employées en bonne partie pour changer les habits, neanmoins il en faudroit avoir d’avantage pour donner plus de nouveauté. En prenant le double des etoffes marquées on en auroit pour 3. et 4. opera differents.
3.
Constantin a fait sçavoir à Mgr le Prince, que Sa Majesté luy a ordonné de chercher un chanteur pour accompagner sa femme dans les intermedes, et qu’en vertu de cet ordre il a engagé Lucrezio Borsa pour 2000. florins par an. Si Sa Majesté souhaitte l’avoir, il faudra ajouter cette pension à celles des autres musiciens specifiés sub litera A et pour les Fraix de son voyage.
Tout cela Monseigneur le Prince soumet aux ordres et à la disposition de Sa Majesté. A Venise, le 20 Marz 1717.
*
L’auteur a maintenu la numérotation des observations telles qu’elles figurent dans la source. L'observation 7 n’est pas mentionnée.
– 125 –
Chapitre 2
qu’Elle voudroit y employer.248 » À l’issue de ces négociations serrées, Friedrich August pouvait avoir à juste titre le sentiment d’avoir gagné sur toute la ligne : en plus de Lotti et des chanteurs italiens, engagés au prix fort à partir du 1er septembre 1717, il avait également réussi à faire engager Veracini et surtout Heinichen, dont Auguste le Fort avait pourtant refusé à plusieurs reprises la présence à Dresde. Ces musiciens arrivèrent sans doute à Dresde au cours de l’été 1717. Mais les craintes exprimées par Auguste le Fort n’étaient sans doute pas tout à fait infondées, puisque la coexistence entre musiciens de nationalités différentes, qui plus est placés sous deux protecteurs différents, ne manqua pas de provoquer querelles et conflits entre les deux factions. Cette situation aboutit à une fracture importante dans la Hofkapelle, puisque les musiciens italiens, sous la protection de Friedrich August, furent placés directement sous l’autorité de Lotti et de Heinichen, échappant ainsi à la tutelle du Kapellmeister Johann Christoph Schmidt, qui conservait pour sa part la main haute sur les musiciens « historiques » de la Hofkapelle, placés sous la protection naturelle d’Auguste le Fort. L’administration face aux conflits L’organisation de la musique, placée sous la double tutelle du Directeur des plaisirs le baron Johann Sigismund von Mordaxt et du camérier et chef des affaires domestiques Christoph Heinrich von Watzdorf, se trouvait donc soumise à rude épreuve. Watzdorf en particulier était placé dans une situation délicate, car il devait ménager les susceptibilités des deux camps. Dans sa correspondance avec le prince, il le rassure sur le traitement qui sera réservé à ses musiciens italiens et l’assure qu’ils ne seront pas placés sous l’autorité du Kapellmeister Schmidt.249 Cependant, il ne devait pas donner l’impression de trahir Auguste le Fort, mais tenter au contraire de rétablir un minimum de concorde parmi les supérieurs de la Hofkapelle, entre lesquels les querelles de préséance allaient bon train : Je vois par les derniers ordres dont Vôtre Altesse Royale m’a fait la grace de m’honnorer que Schmied doit avoir chicané Heinichen à l’egard d’un concert de sa production : comme c’est la premiere information que j’en ay eu, et que M. Heinichen se trouve presentement absent depuis une quinzaine de jours étant allé voir son pere aux environs de Leipzig je n’ay pas pu encore scavoir en quoi consiste son different avec Schmied, mais j’espère de le voir à Leipzig et j’assure tres humblement V.A.R. que je luy feray rendre toute justice possible. Quant à Volumier : il a contesté qu’il vivoit en tres bonne harmonie avec Heinichen, et qu’il faisoit même beaucoup d’estime et de cas de ses ouvrages. Je me suis déjà donné l’honneur d’informer tres humblement V.A.R. dans celle dont j’ay chargé Mr. Hoffman comme quoi S.M. a aussi donné ses ordres en faveur des gens d’Opera et Musiciens [que] V.A.R. a fait engager. Et j’ose tres humblement assurer V.A.R. que quant à moy, je feray tout mon possible, que ces personnes soyent traités ici avec toute sorte d’egard et de douceur afin qu’ils puissent être contents et se louer de leur bon traitement.250
On voit donc ici que Watzdorf occupe une fonction de médiation entre les différentes factions. Johann Christoph Schmidt, et dans une moindre mesure Volumier, portent le conflit avec Heinichen sur le terrain même de la musique, puisque c’est la qualité musicale même des concertos composés par Heinichen pour la cour de Dresde qui se trouve remise en cause. Ce premier exemple des sérieux conflits entre les anciens musiciens et les nouveaux venus est aussi le seul documenté directement par des sources d’archives. On observe que le conflit entre les musiciens recoupe de façon seulement partielle les lignes de partage nationales puisque Heinichen et Schmidt étaient tous les deux nés en Saxe. Son enjeu décisif réside en fait dans des positionnements institutionnels, 248 249
250
Lettre non signée de la part de Friedrich August II à Christoph Heinrich von Watzdorf, Dresde, 2 janv. 1719. HStA Dresden 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 126. Lettre de Christoph Heinrich von Watzdorf à Friedrich August, Dresde, 11 sept. 1717. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 103 : « Outre cela je dois aussi apprendre à VAR que le Roy donnera de tels ordres que les gens de l’opera n’auront rien à deméler avec Mr. Smit, et qu’il ne luy soit point permis de leur causer aucun chagrin. » Lettre de Christoph Heinrich von Waltzdorf à Friedrich August II, Dresde, 4 oct. 1717. HStA Dresden, Loc. 383/2, fol. 104.
– 126 –
Administrer la musique française
puisque l’attribution du titre de Kapellmeister à Heinichen mettait très directement en danger Schmidt, qui avait bénéficié de ce titre depuis le départ de Nicolaus Adam Strungk en 1697. Mais l’introduction d’un nouveau contigent de musiciens italiens qui n’était pas soumis à la juridiction du Kapellmeister ne remettait pas seulement en cause la place de la musique française, et plus largement celle de l’ensemble des musiciens de la vieille garde. De façon beaucoup plus fondamentale, elle engageait une recomposition profonde des structures mêmes de la musique à la cour de Dresde. Cette modification de l’organisation de la musique produisit un certain affolement administratif bien visible à travers le nombre anormalement élevé de listes de personnel rédigées entre 1717 et 1720.251 Celles-ci viennent révéler une structure tout à fait inédite jusqu’alors, puisque le personnel des plaisirs (musique, danse et théâtre) est désormais réparti en six grandes catégories (Tableau 2.9) : les Französische Sänger und Sängerinnen, un petit ensemble de quatre chanteurs français ; les Italiänische Operisten und Musici qui regroupent le personnel de l’opéra ; les Musici, soit tous les musiciens de l’orchestre ; les Französische Comoedianten, comédiens français ; les Französische Tänzer und Tänzerinnen qui regroupent les danseurs français ; enfin, les Italiänische Comoedianten, comédiens italiens qui apparaissent dans la récapitulation des sommes engagées mais dont la liste n’est pas fournie. Les musiciens de l’orchestre sont donc les seuls qui cohabitent au sein d’une même structure administrative rassemblant plusieurs nationalités différentes. On note les disparités de salaire très importantes entre les Italiens et les autres musiciens. En 1717, le poste de dépense salariale le plus important est encore celui de l’orchestre (16.450 Thaler pour 42 personnes), suivi de l’opéra (12.938 Thaler pour 17 personnes) et des artisans italiens (11.922 Thaler). Viennent ensuite la comédie française (11.250 Thaler pour 26 personnes), la danse (7.400 Thaler pour 14 personnes) et les chanteurs français (1.900 Thaler pour 4 personnes). En 1719, l’équilibre se modifie radicalement à la faveur du mariage princier qui provoque une augmentation drastique des dépenses de personnel : le premier poste est cette fois-ci de très loin l’opéra italien (42.405 Thaler) tandis que l’orchestre arrive en seconde position (19.600 Thaler) et que les autres postes demeurent comparables. En 1720, l’équilibre financier se modifie à nouveau à la faveur de l’orchestre, les opéristes italiens ayant déjà été renvoyés à cette date. Tableau 2.9. Nouvelle structure de la Hofkapelle 1717-1720. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 117-123, 7 août 1718. Specificatio Derer französischen Sänger und Sängerinnen, wie auch Ihres järhl. Tractaments [1.] 600 tl. der Bassist Pierre Guiard [2.] 500 tl. der Sänger David Drot [3.] 400 tl. der Sänger François Godefroy Beauregard, [4.] 400 tl. die Sängerin Marguerite Prache, Summa 1900 rl. Specificatio Derer französischen Tänzer und Tänzerinnn, nebst Ihren jährl. Tractament [1.] 2000 der Maitre des Ballets de Barques und seine Frau [2.] 1000 die Tänzerin Le Conte oder le Gros [3.] 1000 die Tänzerin Clement [4.] 400 der Sous-Maitre des Ballets Corrette [5.] 300 der Tanzmeister Thoma [6.] 300 der Tantm. Mareschall, [7.] 300 der Tanzm. Diechof, [8.] 300 der Tanzm. Cadet, [9.] 300 die Tänzerin Corrette, 251
Il existe au moins trois listes complètes qui adoptent une structure en six grands ensembles : HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 117-123 (7 août 1718) et 137-142 (25 avr. 1719) ; HStA Dresden, 10077 Kollektion Schmidt Amt Dresden, Vol. 9 Nr. 306, fol. 1-10 (29 sept. 1720). D’autres listes partielles viennent compléter cet aperçu : HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 181-183 (« Königl[iche] Pohl[nische] und Churfürst[liche] Sächs[ische] Musik und Orchestra », 1er août 1717) et fol. 203 (« Disposition pour deux Troupes de Comédiens et de Danseurs, en Pologne et en Saxe », 6 mai 1718) ; HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/3, fol. 60 et 119 (deux listes de musiciens italiens).
– 127 –
Chapitre 2
Tableau 2.9. (suite). [10.] 300 die Tänzerin Romainville l’ainée, [11.] 300 die Tänzerin Romainville Cadette, [12.] 300 die Tänzerin Maschenbauderin, [13.] 300 die Tänzerin la Roque, [14.] 300 die Tänzerin la France, Summa 7400 rl. Specificatio derer Italienischen Operisten und Ihres jährl. Tractaments [1.] 9975 Thlr. oder 2100 Louis d’or à 4 [deniers] et 18 [grains] — der CapellMeister Lotti und seine Frau Santa Stella, als erste Sängerin, [2.] 3800 Thlr oder 800 Louis d’or a 4 [deniers] et 18 [grains] die Sangerin Zani [3.] 28500 oder 600 L. d’or –– Bovarini [4.] 6650 1400 der Sänger Senesino [5.] 4275 900 –– Berchelli [6.] 2850 600 –– Berensta [7.] 2850 60 –– Guicciano [?] [8.] 3325 70 –– Baschi [9.] 160 oder 600 Ducat, à 2.16 g die Sängerin Constantin [10.] 1333 8gl 2/m Thlr. der Sänger Borsani [11.] 1700 der Cammer Compos. u Violinist Veracini [12.] 400 der Violinist Gagi [13.] 950 oder 200 Louis d’or à 4 [deniers] et 18 [grains] der Viol: Personelli [14.] 960 oder 360 Ducats à 2.16 g der Poet Luchini [15.] 200 der 1ste Souffleur Antonio Maria Peruzzi [16.] 120 2ten Souffleur Giovanni Antonio Bon Sa. 43338 Thlr 8 gl. Specificatio Derer Königl. Musicorum und Ihres jährlichen Tractament [1.] 1200 Thlr. der Capellm. Joh. Christoph Schmidt, [2.] 1200 Thlr. der Capellm. Joh. David Heinichen, [3.] 1200 Thlr. der Concertmeister Jean Bapt. Woulmÿer. NB. der Cammer Compositeur Veracini stehet mit auf der Specification derer Italienischen Operisten. [4.] 1200 Thlr. der Cammer Music. Pantaleon Hebestreit. [5.] 500 Thlr. der Violoncel Agostino de Rossi [6.] 500 Thlr. der Violinist Joh. George Pisendel, [7.] 500 Thlr. der Flute=Alemande Pierre Buffardin [8.] 500 Thlr. der Violoncell Felice Maria Pienetti [?] ou Felicetti [9.] 500 Thlr. der Violinist Simon le Gros. [10.] 450 Thlr. der Organist Christian Pezold [11.] 480 Thlr. der Hautboist Joh. Christian Richter, [12.] 400 Thlr. der Violdigambist Gottfried Bentleÿ. [13.] 400 Thlr. der Violinist Francesco Hunt. [14.] 400 Thlr. der Bassist Jean Cadet. [15.] 400 Thlr. der Bassist Johann Dismas Zelencka. [16.] 400 Thlr. der Theorbist Francesco Arigoni. [17.] 400 Thlr. der Violinist Joh. Fried. Lotti. [18.] 400 Thlr. der Violon Angelo Gaggi. [19.] 350 Thlr. der Violinist Adam Rÿbizski. [20.] 300 Thlr. der Hautboist Charles Henrion. [21.] 300 Thlr. der Bacciste Joh. George Lehneis. [22.] 300 Thlr. der Violon Jean Bapt. Prache. [23.] 300 Thlr. der Waldhornist Joh. Adelberth Fischer. [24.] 300 Thlr. der Waldhornist Joh. Adam Franz Sam. [25.] 300 Thlr. der Organist Joh. Wolfgang Schmidt, [26.] 280 Thlr. der Hautboist Joh. Martin Blochwitz, [27.] 300 Thlr. der Basson Joh. Gottfried Böhme. [28.] 200 Thlr. der Violon la France le Pere. [29.] 250 Thlr. der Violon la France le Fils, [30.] 280 Thlr. der Braccist Carl Joseph Rhein,
– 128 –
Administrer la musique française
Tableau 2.9. (suite et fin). [31.] 240 Thlr. der Braccist Joh. Nartin Gelde, [32.] 240 Thlr. der Basson Caspar Ernst Quatz, [33.] 220 hlr. der Braccist Michael Petzschmann. [34.] 220 Thlr. der Hautboist Martin Seÿfert. [35.] 200 Thlr. der Braccist David Weigelt. [36.] 200 Thlr. der Braccist Joh. Christoph Reisel [37.] 200 Rthl. der Basson George Friedrich Köstner [38.] 140 Thlr. Georg August Kümmelmann wegen Inspection der Instrument Cammer und reparatur derer Instrumente. [39.] 150 Thlr. der Orgelmacher Joh. Heinrich Gräbner die Clavicimbel zustimmen und in [gutem] Wesen zu erhalten. [40.] 50 Thlr. Joh. Jacob Lindner wegen derer zur Instrument Cammer jährl. zu leistene haben den Musikalischen Copialien. [41.] 100 Thlr. der Instrument Diener Joh. Gottlob Werner Summa 16460 Thlr. Specificatio derer Französischen Comoedianten und dazu gehörigen Persohnen, nebst Ihren Järhl. Tractament. [1.] 533 Thl. 8 gl. der Acteur du Mont. [2.] 533 Thlr. 8 gl. die Actrice du Mont, seine Frau. [3.] 533 Thlr. 8 gl. die Actrice Fulque. [4.] 500 Thlr. der Acteur Clavell. [5.] 500 Thlr. die Actrice Clavell, seine Frau. [6.] 500 Thlr. die Actrice Villedieu, la Veuve. [7.] 500 Thlr. der Acteur Belletour. [8.] 500 Thlr. die Actrice Belletour. [9.] 500 Thlr. der Acteur la Roque [10.] 500 Thlr. die Actrice la Roque seine Frau [11.] 500 Thlr. der Acteur d’Erval. [12.] 500 Thlr. die Actrice d’Erval, seine Frau. [13.] 500 Thlr. der Acteur Poisson [14.] 500 Thlr. der Acteur Tourteville [15.] 500 Thlr. die Actrice Tourteville, seine Tochter [16.] 500 Thlr. die Actrice Drot. [17.] 500 Thlr. die Actrice Beauregard. [18.] 500 Thlr. die Actrice Romainville, la Mere. [19.] 500 Thlr. der Acteur Hermann. [20.] 500 Thlr. der Acteur Prevost. [21.] 500 Thlr. der Acteur Rozanges. [22.] 166 Thlr. 16. der Souffleur Romainville. [23.] 166 Thlr. 16. der Decorateur la Chapelle. [24.] 166 Thlr. 16. der Decorateur Goujont. [25.] 100 Thlr. der Comoedien Schneider Bensun. [26.] 50 Thlr. deßen beygehülffe Reistmann. Summa 11250 Thlr. 16450 Thlr: die Musici. 1900 Thlr. französische Sänger und Sängerinnen, 11250 Thlr. französische Comoedianten, 7400 Thlr. französische Tänzer und Tänzerinnen 3333 Thlr. 8 gl. Italienische Comoedianten 12938 Thlr. Italienische Operisten und Musici. 11922 Thlr 16 Italienischer Bandmeister, Mahler, Zimmerleuthe, Schiffbandleuthe und dollmetzscher [Summa summarum: 55.193 Thaler]
– 129 –
Chapitre 2
Ruptures et reconfigurations Les festivités du mariage de Friedrich August avec Marie Josèphe d’Autriche en 1719 demeurent dans la mémoire collective comme un point culminant de la vie de cour à Dresde pour l’ensemble du xviiie siècle. De nombreuses gravures commandées par la cour eurent pour fonction d’immortaliser les somptueux divertissements donnés par l’électeur de Saxe à cette occasion et de perpétuer leur mémoire.252 La musique occupa bien entendu une large place dans les festivités, non seulement à travers la musique d’église et la production de plusieurs opéras, mais aussi avec un divertissement en français composé par le Kapellmeister Johann Christoph Schmidt – une exception remarquable qui doit sans doute davantage être interprétée comme le résultat de l'intervention personnelle d'Auguste le Fort que comme le reflet des préférences personnelles de son fils. Un divertissement français Étant donné que l’opéra italien se taillait la part du lion dans la programmation, l’un des enjeux pour l’administration était de garantir que tous les salariés aient suffisamment de travail. Dans une lettre probablement adressée à Christoph Heinrich von Watzdorf depuis Venise le 15 mai 1717, l’accompagnateur du prince Józef Kos écrivait : Votre Excellence ne trouvera pas non plus le nom de Lucrezio Borsani dans la liste mentionnée [qui contient le nom des musiciens italiens employés], qui est un chanteur pour les intermedes en musique, S[on] A[ltesse] R[oya]le ayant eté de l’opinion, que les intermedes chantés prolongeoient trop l’Opera, et que Sa Majesté ayant des Danceurs et des Danceuses, le vide entre les Actes pouvoir être rempli plus noblement par les ballets comme en France, et qu’on ne fait pas des intermedes dans les grands Opera même en Italie.253
Le ministre Wackerbarth, dans une lettre qu’il adresse au librettiste italien Stefano Pallavicini depuis Dresde, reprend cette indication en insistant sur le fait que « l’Opera en tout je n’en exempte pas meme les ballets et le Prologue, ne passe gueres les trois heures, et je vous dit pour votre avertissement, que nous avons un grand nombre de danseurs et de danseuses, auxquels il faut trouver moyen de donner de la besogne.254 » L’administration prenait donc en charge le bon fonctionnement de la machine pléthorique que formaient alors les Plaisirs du Roy et leur centaine d’employés, quitte à bousculer les conventions musicales établies et la logique interne des genres sollicités : les opéras italiens donnés en 1719 furent donc accompagnés d’intermèdes dansés, comme c’était l’usage en France. Un autre évènement devait également donner du travail aux chanteurs et danseurs français, tout en assurant la représentation de la musique française : le divertissement des Quatre saisons, dont le comédien Poisson avait écrit le livret en langue française et le maître à danser Debargues composé les ballets sur une musique de Johann Christoph Schmidt, le maître de chapelle en titre. Seul le livret de ce divertissement est conservé.255 L’avant-propos souligne l’intervention personnelle d’Auguste le Fort dans la planification et la conception de cette « espèce d’Opéra françois », qui fut joué et chanté non par des professionnels, mais par des membres de la cour : Entre tous les Divertissemens, que le Roy a lui même ordonnez & reglez, pour le Mariage de Son Altesse Royale de Pologne & Electorale de Saxe, Monseigneur le Prince son fils, Sa Majesté a souhaitté, qu’il y eût un [sic] espece d’Opera françois ; & voulant, qu’il fût varié & magnifique, sans être d’une grande étendüe,
252
253 254 255
Sur le recueil qui rassemble ces gravures, cf. Monika Schlechte, « “Recueils des dessins et gravures représentant les solemnites du mariages”. Das Dresdner Fest von 1719 im Bild », in : Image et Spectacle, dir. Pierre Béhar, Amsterdam 1993, p. 117-167. Sur l’iconographie des fêtes de cour sous Auguste le Fort, cf. Eine gute Figure machen. Kostüm und Fest am Dresdner Hof, dir. Claudia Schnitzer et Petra Hölscher, Dresde 2000. Lettre de Józef Kos à Christoph Heinrich von Watzdorf, Venise, 15 mai 1717. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 79. Lettre d’August Christoph von Wackerbarth à Stefano Pallavicini, Dresde, 24 janv. 1719. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 136. Les Quatre Saisons, Divertissement de Musique & de Dance. D-Hau, Vd 1641.
– 130 –
Administrer la musique française
Elle a choisi pour sujet les quatre Saisons. Ce divertissement, qui selon les Regles Dramatiques, n’est a proprement parler, qu’un Ballet, est singulier à divers égards. Le Roi, après en avoir choisi le sujet, & formé le Plan, en a désigné lui même tous les personnages ; & le Poëte n’a fait que préter la versification, en suivant dans le Prologue & dans tout le reste la judicieuse disposition de Sa Majesté. Un Prince, ayant dicté, pour ainsi dire ce Divertissement, il sembloit, que l’execution n’en devoit être reservée, qu’à des gens de qualité ; aussi, près de soixante personnes, qui y sont employées dans le chant & dans la dance, sont toutes d’une noblesse distinguée : On ne parle ici que des Rôles & des Ballets, car pour les Chœurs & l’Orquestre on s’est servi de tous les Pensionaires dans les Plaisirs du Roy, françois & autres, dont le nombre monte à plus de cent personnes; on peut juger par là de la magnificence de cette représentation.
Avec ce seul divertissement, la présence musicale française – et avec Schmidt la représentation de la faction historique de la Hofkapelle – était assurée au milieu d’une programmation musicale dominée par l’Italie. Les conflits entre musiciens italiens et les autres musiciens semblent avoir émaillé la vie musicale de la cour pendant les années 1717 à 1720. Ainsi Johann Adam Hiller rapporte-t-il un conflit entre Volumier et Senesino, vedette incontestée des chanteurs italiens, sur la question de l’accompagnement : Dès 1719, lors des répétitions pour un opéra de Lotti, une dispute éclata sur la manière d’accompagner un certain air entre le chanteur Senesino et le maître des concerts Volumier. Le premier reprochait au second de jouer de façon trop dure et trop grossière dans cet air, et il se peut bien qu’il y eût du vrai là-dedans. Lors d’une autre répétition, Volumier se retira et Pisendel vint le remplacer à la tête de l’orchestre. Lorsque l’air en question fut terminé, Senesino tendit la main à Monsieur Pisendel depuis la scène et lui exprima sa satisfaction pour cette exécution juste et appropriée. Il dit alors bien fort : « voilà un homme qui s’y connaît pour accompagner ». On voit là que Pisendel savait facilement s’adapter à chaque style de musique, tandis que Volumier ne s’y connaissait que dans la manière française.256
Mais si Hiller profite de cette anecdote pour louer l’adaptabilité et les qualités d’accompagnateur de Pisendel, à rebours de Volumier qui semble ne pas avoir maîtrisé l’art d’accompagner à l'italienne un air d’opéra, tout le monde n’était apparemment pas du même avis. Le violoniste italien Veracini aurait également reproché à Pisendel sa manière d’accompagner un concerto pour violon, disant qu’on ne pouvait rien faire de propre avec des Allemands. Pisendel aurait alors demandé au roi l’autorisation d’exécuter le même concerto avec des musiciens exclusivement allemands, en présence de Veracini, pour démontrer que les Allemands pouvaient jouer aussi bien que les Italiens, non seulement les parties de ripieno, mais également les parties solistes.257 La dispute se porte donc sur le terrain de l’accompagnement dans des genres qui placent le soliste en première ligne – le concerto et l’opéra – et exigent donc de l’orchestre une certaine retenue et une grande flexibilité. Il apparaît que les musiciens de l’orchestre, surtout habitués à des genres collectifs, ne remplissaient pas les attentes de leurs collègues italiens. Après le mariage princier, le contingent italien ne resta que peu de temps à Dresde : Georg Friedrich Händel, qui avait assisté au mariage princier en 1719 et était à la recherche de bons chanteurs pour l’Académie royale de Londres, avait dû les démarcher puisque la Durastanti, Marguerite de Salvay, Senesino, Berselli et Boschi firent leurs débuts dans la capitale anglaise en
256
257
Johann Adam Hiller, Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkünstler, Leipzig 1784, p. 191-192 : « Schon im Jahre 1719 ereignete sich, bey der Probe einer Oper von Lotti, eine Streitigkeit über die Ausführung des Accompagnements einer gewissen Arie, zwischen dem Sänger Senesino und dem Concertmeister Volümier. Der erstere gab dem letztern Schuld, daß er in dieser Arie zu hart und rauh spielte ; es kann auch wohl etwas davon wahr gewesen seyn. Bey einer andern Probe blieb Volümier außen, und Pisendel stand an der Spitze der Instrumentalmusik. Nach Endigung der erwähnten Arie reichte Senesino dem Herrn Pisendel, vom Theater herab, die Hand, bezeigte ihm seine Zufriedenheit über den richtigen und zweckmäßigen Vortrag der Arie, und sagte dabey ganz laut : Dieß ist der Mann, der zu accompagniren versteht. Man siehet daraus, daß Pisendel sich leicht in den Charakter einer jeden Musikart zu schicken wußte ; da Volümier sich nur auf die französische verstand. » Cette anecdote est rapportée en 1785 par Carl Friedrich Cramer dans son Magazin der Musik. Cf. Kai Köpp, Johann Georg Pisendel (1697-1755) und die Anfänge der neuzeitlichen Orchesterleitung, Tutzing 2005, p. 127.
– 131 –
Chapitre 2
octobre 1721, quelques mois seulement après leur départ de la cour de Dresde.258 C’est apparemment une dispute entre Heinichen et les deux étoiles de la compagnie, Senesino et Berselli, qui forma le prétexte au renvoi de tous les chanteurs italiens en février 1720, les Italiens reprochant à l’Allemand d’avoir maltraité la prosodie italienne dans un opéra de sa composition.259 Le départ des musiciens italiens marqua une reprise en main assez musclée de la Hofkapelle par Auguste le Fort, qui promut plusieurs Français à des postes importants, reprit sa politique d’embauche d’artistes français et fit jouer de nouveau un répertoire exclusivement français.260 La signature du décret de nomination de Jean-Baptiste Volumier comme « Maître des concerts » à Varsovie le 9 octobre 1720 est un premier geste institutionnel fort.261 L’engagement en septembre 1720 de Louis André comme « Compositeur de musique » et de la chanteuse française Clavel est un autre indice de cette reprise en main, qui se prolonge avec l’engagement de Louise Dimanche, de la « joueuse de clavecin » Du Masis, et du violoniste François Biotteau.262 Enfin, la nomination de Pierre de Gaultier comme successeur du baron de Mordaxt au poste de Directeur des plaisirs montre également la volonté du souverain de promouvoir des Français aux postes-clés de son administration musicale.263 Le renvoi des Français et le règne d’Auguste III La mort d’Auguste le Fort, le 1er février 1733, signa cependant la fin de la présence musicale française à Dresde : moins de deux mois après les funérailles royales, Friedrich August, devenu prince électeur de Saxe et roi de Pologne sous le nom d’August III, fit établir la liste des musiciens qui devaient quitter le service de la cour. De nombreux musiciens français y figuraient : Louis André, Jean Prache et sa femme, la chanteuse Clavel et ses parents, François Godefroy Beauregard ainsi que de la plupart des acteurs et danseurs français.264 Seule une poignée d’acteurs restait en place. Même si certains musiciens français comme Jean Baptiste Joseph du Hautlondel ou François Biotteau étaient épargnés, le renvoi suscita beaucoup d’inquiétude chez la plupart des musiciens, comme en témoignent les nombreuses suppliques adressées au nouveau souverain. Plusieurs hauts fonctionnaires qui avaient joué un rôle important dans l’organisation des Plaisirs se trouvaient aussi en position délicate après l’avènement du nouveau souverain : Christian Heinrich von Watzdorf, fils de Christoph Heinrich et lui-même mécène de musique, tomba en disgrâce et fut déchargé de toutes les fonctions qu’il occupait à la cour. Dès 1730, l’engagement de Johann Adolf Hasse et de sa femme Faustina Bordoni depuis Venise avait fourni, trois ans avant la mort d’Auguste le Fort, le premier signe d’un véritable pivotement de la politique de patronage musical de la cour de Dresde, qui se détournait de France pour s’orienter presque exclusivement vers la péninsule italienne. 258 259
260 261 262 263 264
Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 150. Marpurg, Historisch-Kritische Beyträge, vol. 1, p. 214-215 : « Nach dem Beylager componirte Heinchen noch eine Oper, welche nach der Zurückkunft des Königs aus Pohlen aufgeführet werden solte. Bey der Probe aber, die auf dem königlichen Schlosse, in Gegenwart des Musikdirectors Baron von Mortax gehalten wurde, machten die beyden Sänger, Senesino und Berselli einen ungeschliffenen Virtuosen=Streich. Sie zankten sich mit dem Capellmeister Heinchen über eine Arie, wo sie ihm, einem Manne von Gelehrtsamkeit, der sieben Jahre sich in Wälschland aufgehalten hatte, Schuld gaben, daß er wider die Worte einen Fehler begangen hätte. Senesino, welcher seine Absichten schon nach England gerichtet haben mochte, zerriß die Rolle des Berselli, und warf sie dem Capellmeister vor die Füße. Dieses wurde nach Pohlen an den König berichtet. Inzwischen hatte zwar der damalige Graf von Wackerbart, der sonst ein großer Gönner der Wälschen war, den Capellmeister und die Castraten zu des Capellmeisters völliger Genugthuung, in Gegenwart einiger der vornehmsten vom königlichen Orchester, als Lotti, Schmidt, Pisendel, Weiß, u. s. w. wieder miteinander verglichen. Es kam aber ein königlicher Befehl zurück, daß alle wälschen Sänger abgedancket seyn solten. Hiermit hatte die Opern für diesmal ein Ende. » Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 156. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/1, fol. 19-20. Sur les sources qui documentent l'engagement de ces musiciens, voir le répertoire biographique. Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 163. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 10, fol. 127 : « Specification dererjehnigen Persohnen so völlig dimittiret worden ».
– 132 –
Administrer la musique française
Le départ des musiciens français marque, sur le plan de l’histoire culturelle et de l’histoire de la musique, une rupture qui n’était pas sans conséquence sur le devenir de la vie musicale allemande. En renvoyant les musiciens engagés par son père, le jeune Friedrich August II – tout juste devenu August III – mettait fin au dernier ensemble permanent de musiciens français sur le sol de l’Empire, et par conséquent à une période exceptionnelle d’échanges musicaux entre la France et l’Allemagne. Retracer l’histoire de ces révolutions de palais n’est pas seulement relater quelques épisodes hauts en couleur de la cohabitation entre musiciens de nationalités et de traditions musicales différentes : c’est aussi mettre en lumière toute la distance qui sépare la culture personnelle d’Auguste le Fort, largement placée sous le signe de la France, et celle de son fils le prince électoral Friedrich August, aux options politiques et intellectuelles très éloignées de celles son père et dont la culture musicale avait été marquée par son séjour vénitien. Si Auguste le Fort avait incarné l’idéal galant, son fils est bien plus proche de l’orthodoxie luthérienne à laquelle sa mère était toujours demeurée fidèle, et imposa à son arrivée au pouvoir un style de gouvernement plus sage, plus respectueux des conventions et beaucoup plus proche de l’Empereur dont il avait épousé la fille, manifestant par exemple un type de dévotion catholique beaucoup plus ultramontaine, profonde et orthodoxe que ne l’avait été celle de son père.
– 133 –
Chapitre 3. Frantzösische Musicanten : une biographie collective • À travers une enquête sur les identités aristocratiques et les pratiques administratives, nous avons exploré la construction de la catégorie des « Frantzösische Musicanten » du point de vue des employeurs, en insistant sur son aspect contingent, bricolé et précaire, sur sa solidarité avec plusieurs autres domaines de la vie culturelle, en premier lieu la galanterie et le théâtre, et sur le déclin du patronage de musique française à partir du milieu des années 1720. À présent, il convient au contraire de prendre cette catégorie au pied de la lettre – de l’absolutiser en quelque sorte – et d’examiner à la loupe la vie des musiciens regroupés sous cette appellation, soit un échantillon d’une centaine d’individus. Cette étape du travail suppose le croisement de sources très diverses, éparpillées dans de nombreux fonds d’archives, ainsi qu’un va-et-vient incessant entre le détail de trajectoires biographiques souvent sinueuses et la généralité du groupe. Reconstituer cette mosaïque de sources et de parcours individuels permet d’apporter un éclairage inédit sur les biographies transnationales de ces musiciens français, sur leur provenance géographique et sociale, sur la teneur de leurs activités dans les cours allemandes, mais aussi de prendre la mesure de leur communauté de destin et de dessiner les contours de leur identité collective. Portrait de groupe ou biographie collective, les pages qui suivent se situeront toujours entre deux niveaux : l’individu et la communauté. L’hétérogénéité des sources consultées ne va pas sans poser quelques problèmes de méthode dans une perspective prosopographique orthodoxe, étant donné leur caractère disparate, souvent lacunaire, et l’irrégularité des renseignements qu’elles donnent.1 Néanmoins, toutes les sources ne remplissent pas le même rôle et n’interviennent pas au même moment. L’ensemble de sources le plus complet et le plus homogène, point de départ de l’enquête et colonne vertébrale de la documentation, est constitué par les archives des cours qui ont employé durablement des ensembles français : Hanovre, Celle et Dresde. Il s’agit des actes administratifs explorés dans le chapitre précédent : registres de comptabilité, actes d’embauche ou de renvoi des musiciens, suppliques adressées par les musiciens, et quelques archives judiciaires qui illustrent les démêlés de certains d’entre eux avec la justice locale. Ces actes permettent de constituer un échantillon tendant à l’exhaustivité de 100 musiciens, à travers la collecte de leurs noms, de leurs fonctions et de leurs salaires. À ce premier ensemble de sources viennent s’ajouter les registres paroissiaux (« Kirchenbücher ») catholiques, luthériens et réformés des différentes villes sur lesquelles porte l’enquête. Ils permettent d’établir la confession des musiciens français et de reconstruire, par le biais des parrainages et des mariages, les réseaux de sociabilité dans lesquels ils viennent s’insérer. Les registres paroissiaux permettent également de sortir de l’espace de la cour et de vérifier, en creux, que l’écrasante majorité des musiciens français actifs en Saxe et en Basse-Saxe étaient effectivement recrutés par les cours ducales ou princières : seule une poignée d’entre eux n’ont pas transité par la cour.
1
Sur les problèmes posés par l’analyse quantitative de bases de données prosopographiques établies à partir d’un corpus de sources hétérogènes, voir Gidon Cohen, « Missing, Biased, and Unrepresentative. The Quantitative Analysis of Multisource Biographical Data », Historical Methods, 35/4, 2002, p. 166-176.
– 135 –
Chapitre 3
Du côté français, nous avons exploité les archives du minutier central de Paris conservées aux Archives nationales de France, qui éclairent de façon décisive le profil de certains musiciens, quelques registres d’insinuation ou de tutelle du Châtelet de Paris, ainsi que les actes d’état-civil des artistes parisiens copiés par le marquis de Laborde, aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale de France.2 De façon ponctuelle, quelques registres paroissiaux en dehors de Paris ont également été mis à contribution, quand nous disposions d’éléments suffisamment précis pour retrouver les actes de baptême des musiciens. Les sondages réalisés dans les archives de la Maison du roi et celles du ministère des Affaires étrangères, où sont rassemblés les correspondances diplomatiques et mémoires des diplomates français en activité en Basse-Saxe et en Saxe, n’ont pas donné de résultats. Inspirée par plusieurs exemples récents d’application de méthodes prosopographiques à l’histoire de la musique3, notre démarche se rapproche de la prosopographie par le rôle central qu’elle accorde au nom propre des musiciens.4 Celui-ci est le plus petit dénominateur commun entre les différents fonds d’archives, mais aussi ce qui en autorise le croisement : cette fragile silhouette de lettres, proie silencieuse que traque pendant de longues heures l’attention du chercheur et qu’il doit bien souvent reconnaître sous ses déformations successives, est en outre un indice fort de l’origine française des individus. Le rôle du nom propre est donc doublement central dans cette investigation : comme identifiant individuel le plus précis à la racine de toute démarche prosopographique, mais plus encore comme marqueur d’identité étrangère. Bien souvent, la reconstruction d’une biographie nécessite le croisement entre plusieurs sources qui font apparaître un nom sous plusieurs formes différentes, souvent germanisé par l’administration et seulement parfois accompagné d’un prénom : il s’agit alors de le normaliser en prenant cependant soin de faire apparaître toutes ses variantes et les sources dans lesquelles elles se trouvent pour garder un bon niveau de traçabilité de l’information. Mais davantage qu’à une prosopographie de grande envergure au sens classique du terme, cette enquête s’apparente davantage à la biographie collective ou au portrait de groupe.5 La perspective demeure délibérément micro-historique, qualitative et inductive, centrée sur les individus plutôt que sur l’analyse quantitative d’un corpus de données. Les spécificités de parcours individuels sont donc exploitées même si elles ne renvoient pas à des constantes ou des déterminismes de groupe, et sont considérées pour elles-mêmes sans être nécessairement ramenées à une norme ou un modèle. 6 Ce chapitre vise donc, dans la lignée des remarques déjà formulées en introduction,
2
3
4 5 6
Les ouvrages suivants nous ont servi de guides indispensables dans les fonds des Archives nationales : Madeleine Jurgens, Documents du minutier central. Benoît, Versailles et les musiciens du roi. Catherine Massip, La Vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin (1643-1661). Essai d’étude sociale, Paris 1976. Les inventaires de la Maison du Roi (série O) et le fonds de la famille d’Orléans (série 1AP), également conservés aux Archives Nationales, n’ont rien donné dans le cadre de nos recherches. Pour l’exploitation du fichier Laborde, désormais disponible en ligne sur le site Gallica, nous remercions Laurence Le Bras, conservatrice au Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Le projet franco-allemand « Musici » (2010-2012, ANR/DFG) dirigé par Anne-Madeleine Goulet et Gesa zur Nieden rassemble les musiciens étrangers à Venise, Rome et Naples (1650-1750) dans une base de données consultable en ligne (http://musici.eu). Le projet « Musefrem » (2009-2013, ANR) dirigé par Bernard Dompnier a conduit à la création d’une base de données prosopographique sur les musiciens d’église de France en 1790, également consultable en ligne (http://philidor.cmbv.fr). Katharine Keats-Rohan, « Biography, Identity and Names : Understanding the Pursuit of the Individual in Prosopography », in : Prosopography, Approaches and Applications. A Handbook, dir. Katharine Keats-Rohan, Oxford 2007, p. 139-181. Les premiers grands exemples dans ce domaine portaient sur les élites de la Rome antique : Prosopographia Imperii Romani (1897-1898) et la Pauly-Wissowa Realencyclopädie (1894-1978). Dans le domaine français, la Prosopographie chrétienne du Bas-Empire est en cours de publication depuis 1982. Cf. Levke Harders et Hannes Schweiger, « Kollektivbiographische Ansätze », in : Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorie, dir. Christian Klein, Stuttgart 2009, p. 194-198. Britta Kägler, « Von ‘Geschücklichkeiten’, Pfauenfedern und einem ‘Phonascus’. Kollektivbiographische Studien zu deutschsprachigen Musikern in den italienischen Musikzentren Venedig und Rom (1650-1750) », in : Europäische Musiker in Venedig,
– 136 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
à restituer la « chair humaine » de transferts musicaux qui sont trop souvent envisagés comme de simples transferts de papier.7 Il s’agit aussi de découpler dans une certaine mesure l’histoire des transferts culturels franco-allemands de l’histoire des élites, en mettant au centre de la recherche un groupe social qui n’est pas habituellement considéré pour lui-même : si les grands aristocrates allemands et leurs réseaux paneuropéens sont un paramètre essentiel pour comprendre la circulation des musiciens français, il en va de même de réseaux familiaux et sociaux beaucoup plus modestes et obscurs.
Musiciens migrants Les Français n’étaient ni les seuls ni les premiers musiciens à quitter leur pays d’origine pour aller pratiquer leur savoir-faire dans les cours et les métropoles d’Europe du Nord. Depuis le début du xviie siècle, les Italiens représentaient une force de travail très recherchée, ainsi qu’en témoigne la remarque formulée en 1726 par le mélomane Joachim Christoph Nemeitz : « L’Italie semble être le magasin qui fournit l’Europe entière en maîtres de chapelle, castrats, cantatrices et autres virtuoses.8 » La circulation de ces musiciens était étroitement liée a l’adoption de la musique d’église italienne (notamment par le biais des genres du concerto sacré et de l’oratorio) au-delà de la péninsule voire du monde catholique, puis à l’immense succès rencontré par l’opéra seria au Nord des Alpes. Plusieurs travaux majeurs ont été consacrés à ce phénomène, dans le sillage de l’ouvrage collectif publié par Reinhard Strohm en 2001 sur la « diaspora » des musiciens italiens au xviiie siècle.9 Ce phénomène migratoire majeur, bien connu des historiens de la musique mais toujours demeuré en toile de fond de l’historiographie et des études sur l’opéra, était appréhendé pour la première fois de manière globale et pour lui-même. Le concept de « diaspora » permettait en outre d’embrasser d’un seul regard un ensemble de phénomènes dispersés dans l’espace germanique, en Autriche, à Londres, en Hollande, en Russie et en France. La migration des musiciens italiens présente néanmoins plusieurs différences fondamentales avec celle des musiciens français. Alors que les premiers sont surtout des compositeurs, des chanteurs ou des librettistes hautement spécialisés, les seconds sont presque toujours des instrumentistes polyvalents, en particulier violonistes et hautboïstes. Alors que les Français entretiennent des relations étroites avec les troupes de théâtre, les Italiens sont issus de structures ecclésiastiques ou du monde de l’opéra. Les Italiens sont souvent recrutés individuellement, bénéficient de rémunérations très élevées et de conditions de travail privilégiées au sein des Hofkapellen, tandis que les musiciens français sont au contraire recrutés en groupe, travaillent de plain pied avec leurs collègues allemands et touchent un salaire beaucoup plus modeste que les Italiens. La destination de ces deux groupes diffère enfin largement : là où les musiciens italiens voyagent vers les principales cours de l’Empire et les grandes métropoles européennes, par exemple Vienne et Londres, les musiciens français restent très étroitement dépendants de cours de taille intermédiaire. À ces différences s’ajoute un décalage chronologique : dès le début du xviie siècle, une première diaspora italienne se produit vers de nombreuses cours du Nord de l’Europe. Strohm voit dans
7 8 9
Rom und Neapel (1650-1750). Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples 1650-1750, dir. Anne-Madeleine Goulet et Gesa zur Nieden, Kassel 2015, p. 236-268. Bloch, Apologie pour l’ histoire, p. 4. Joachim Christoph Nemeitz, Nachlese besondere Nachrichten von Italien, Leipzig 1726, p. 427 : « Es scheinet Italien das Magazin zu seyn, welches ganz Europa mit Capellmeistern, Castraten, Sängerinnen und anderen Virtuosen fourniret. » The Eighteenth-Century Diaspora of Italian Music and Musicians, dir. Reinhard Strohm, Turnhout 2001. Italian Opera in Central Europe 1614-1780, vol. 1 « Institutions and Ceremonies », dir. Melania Bucciarelli, Norbert Dubowy et Reinhard Strohm, Berlin 2006 ; vol. 2 « Italianità : Image and Practice », dir. Corinna Herr, Herbert Seifert, Andrea Sommer-Mathis et Reinhard Strohm, Berlin 2008 ; vol. 3 « Opera Subjects and European Relationships », dir. Norbert Dubowy, Corinna Herr et Alina Żórawska-Witkowska, Berlin 2007.
– 137 –
Chapitre 3
cette première vague migratoire en provenance de l’Italie une phrase préparatoire à la circulation à grande échelle qui caractérise le long xviiie siècle liée aux grands centres économiques et à l’urbanisation de l’Europe.10 Par rapport à ces deux pics migratoires en provenance de l’Italie, la migration des musiciens français occupe une place intermédiaire et se situe autour de 1700 : plus qu’avec la diaspora des musiciens italiens, elle partage donc en définitive de nombreux traits communs avec la migration des comédiens français, un phénomène déjà bien étudié et qui fournira de nombreux points de comparaison au cours de notre enquête (voir aussi Chapitre 1). Les ressorts de la migration Étudier les migrations musiciennes dans l’Europe moderne implique de comprendre les raisons qui la provoquent, une fois acceptée l’idée que les artistes et les humains en général préfèrent par défaut la stabilité au mouvement, mais aussi de reconstruire les réseaux qui la sous-tendent et l'accompagnent. Cette démarche suppose aussi de se défaire d’un certain nombre de préjugés contemporains sur la migration, souvent appréhendée dans nos sociétés sur le mode dramatique de l’exil individuel ou du départ sans retour, alors même que certaines formes modernes de migration se caractérisent justement par leur extrême flexibilité, la fréquence étonnante des déplacements et leur caractère collectif. Réseaux socio-professionnels et facteur familial Les vingt-trois musiciens français qui travaillèrent à la cour de Celle forment un groupe remarquablement homogène sur le plan social, pour la plupart issus de la corporation parisienne des maîtres joueurs d’instruments où beaucoup semblent avoir reçu leur formation musicale. Ceci explique le rôle central joué par les réseaux familiaux et socio-professionnels dans la migration des artistes. Philippe La Vigne, chef de ce petit ensemble et Capellmeister jusqu’à sa mort en 1705, était de son vrai nom Philippe Martin. Né à Châlons-en-Champagne, il était le fils d’Anthoine Martin « dict la Vigne » et de sa femme Marie Failly, et fut baptisé à la cathédrale le 18 février 1639 : il reçut pour parrain Philippe Linage Seigneur de Villers, issu d’une famille de trésoriers de France.11 Pas moins de sept frères et sœurs peuvent être trouvés dans les registres baptismaux de la cathédrale de Châlons. Les différents parrainages choisis par les parents de Philippe La Vigne montrent qu’il devait s’agir d’une famille bien connectée avec la noblesse champenoise, peut-être même une famille d’artistes, puisque ceux-ci avaient le privilège de pouvoir demander à leurs patrons de parrainer leurs enfants.12 Jusqu’à son arrivée à Celle à la tête de la bande de violons français, la biographie de Philippe La Vigne reste dans l’ombre. Comme la Champagne et le Nord-Est de la France forment traditionnellement le bassin de recrutement d’apprentis violonistes pour les maîtres joueurs d’instruments parisiens13, il est probable que La Vigne se rendit à Paris pour faire son apprentissage et y épousa Louise Madeleine Pécour, probablement issue de la même famille parisienne que les maîtres à danser Guillaume-Louis Pécour et Louis-Alexandre Pécour, et que Louis Pécour, maître joueur d’instrument à Paris dans les années 1640 et 1650.14 Un autre Pécour 10 11
12 13 14
Reinhard Strohm, « Italian Operisti North of the Alps, c.1700-c.1750 », in : The Eighteenth-Century Diaspora, p. 1-60 et Norbert Dubowy, « Italienische Instrumentalisten in deutschen Hofkapellen », in : The EighteenthCentury Diaspora, p. 61-120. AD Marne, Registres paroissiaux de Notre-Dame, Châlons-sur-Marne 1580-1667, GG 105, registre non folié : « Le 18e Philippe fils d’Anthoine Martin dict La Vigne et & de Marie Failly sa femme Le parrain Philippe Linage [mot illisible] Seigneur de Villers la marraine Marie Billot. » Voir la notice « Villers le Château » dans : Philippe Seydoux, Gentilhommières et maisons fortes en Champagne, vol. 1, Paris 1997. Dans le même registre, sa sœur Louise baptisée le 27 fév. 1640 reçoit ainsi pour parrain le magistrat PierreIgnace de Braux, marquis d’Anglure, maître des requêtes. Nicolas, baptisté le 6 nov. 1643, reçoit pour parrain Nicolas de Cuissote, Seigneur de Bizancourt. Massip, La Vie des musiciens, p. 73. Louise-Madeleine est dite « parisienne » dans les registres paroissiaux catholique de Hanovre. Cf. par exemple BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, 29 juin 1679, p. 51 : « infantem […] natum
– 138 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
figure d’ailleurs parmi les premiers musiciens de Celle : il s’agit de Claude Pécour, marié à Marie de Courbesastre. Celle-ci est à son tour la sœur d’un musicien engagé à Celle un peu plus tard : Philippe de Courbesastre, engagé comme hautbois en 1680, apparaît dans le minutier central de Paris lors de la vente de la maison de sa mère en juin 1700. Dans cet acte, il est décrit comme « musicien de monsieur le duc de Zelle » et fils de Charles de Courbesastre, marchand drapier de Paris. Ce document nous permet aussi de savoir que Philippe de Courbesastre est le frère de Marie, déjà morte à cette date : ledit sieur de Courbesastre se faisant et se portant fort de Claude Pecourt maître à dancer audit Zelle tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte demoiselle Marie de Courbesastre sa femme, par lequel Sieur Pecour il s’oblige faire ratiffier ces presentes.15
Cet enchevêtrement de relations professionnelles et familiales pourrait être déplié à l’infini, puisque tous les autres musiciens de Celle viennent d’un milieu similaire, et pour certains de véritables dynasties musicales actives à la cour de France vers 1650, et sont reliés entre eux de plusieurs manières. François Robeau est ainsi le fils d’Hilaire Robeau, maître joueur d’instrument, officier de l’Écurie du roi (dessus de cornet et basse de violon) et membre des Vingt-cinq violons de la Chambre.16 Il est donc aussi le frère de Marguerite Robeau, l’épouse d’Élie Jemme, maître à danser français d’Ernst August et de Sophie, que nous avons déjà croisés à Osnabrück et Hanovre.17 JeanJacques Favier est également le rejeton d’une immense dynastie parisienne de musiciens, puisqu’il est le fils de Jacques Favier, maître joueur d’instruments et violoniste de la Chambre du roi, et de sa seconde femme Marguerite Voiture.18 Son grand-père Jehan Favier avait été maître joueur d’instruments, son oncle Jean Favier était aussi violoniste de la Chambre du roi, et son frère Jean Favier était danseur à l’Académie royale de musique. Il connaissait donc très certainement Denis Le Tourneur, musicien engagé à Celle en 1670, puisque celui-ci était le filleul de son père Jacques Favier, et venait également d’une dynastie parisienne de maîtres joueurs d’instruments.19 René des Vignes est maître joueur d’instruments à Paris, demeurant près du pré au Clerc à Saint-Germaindes-Prés. Il s’associe pour quatre ans avec François Chabaron en juillet 1660.20 Thomas de La Selle est également né à Paris dans une famille de joueurs d’instruments.21 Louis Gaudon, arrivé à Celle en 1677, est peut-être apparenté à un certain Louis Godon, maître joueur d’instruments qui apparaît dans deux contrats d’association à Paris en 1644 et 1647, en conjonction avec le nom d’Henri
15 16
17 18 19
20 21
ex Philippo Martin, dicto La Vigne, Gallo, de Chaalons in Campania, et Ludovica Magdalena Pecour dicta La Vigne dalla Parisiensi legitimis conjugibus ». Sur la famille Pécour, voir Jérôme de La Gorce et Margret M. McGowan, « Guillaume-Louis Pecour : A Biographical Essay », Dance Research. The Journal of the Society for Dance Research, 8/2, 1990, p. 3-26. Sur Louis Pécour, voir AN, Minutier central, XIII-78, 3 juin 1643, XVI-89, 28 oct. 1644, XVI-95, 4 sept. 1647, LXXXVII-186, 16 sept. 1656, LXX-158, 17 juin 1658. AN, Minutier central, XXXI-20, 21 juin 1700. La maison mise en vente, située à Sceaux, laisse entrevoir une certaine aisance puisqu’elle est dotée d’un jardin de douze arpents plantés d’arbres fruitiers, et qu’elle est vendue 820 livres tournois à Gilles Caillard, demeurant à Sceaux et chef de fruiterie de la duchesse de Bourgogne. Benoît, Versailles et les musiciens du roi, p. 411. Massip, La Vie des musiciens, p. 159-160. Ernest Thoinan, Les Hotteterre et les Chédeville, célèbres joueurs et facteurs de flûtes, hautbois, bassons et musettes, Paris 1894, p. 20. En 1668, le nom de Robeau figure encore dans une liste des « Grands Violons » : voir le livret de la mascarade Le Carnaval. Il apparaît également dans de nombreux actes du minutier central de Paris. François Robeau est baptisé à Saint-Séverin le 30 oct. 1640 : F-Pn, Fichier Laborde, NAF 12180, fiche 58357. Jean-Jacques Favier est baptisé le 25 avr. 1649 à Saint-Germain l’Auxerrois : F-Pn, Fichier Laborde, NAF 12102, fiche 26340. Marguerite Voiture avait été apprentie couturière chez la première femme de Jacques Favier, Gillette Bourdonné : voir le contrat d’apprentissage dans AN, Minutier central, XV-79, 4 mai 1632. Fils d’Henri Le Tourneur, maître joueur d’instruments demeurant rue Saint-Denis, et de Geneviève Collet, Denis Le Tourneur est baptisé le 28 mars 1645 à Saint-Louis. Son parrain est Jacques Favier, père de JeanJacques, et sa marraine Barbe Roussel, fille de Pierre Legou, maître pâtissier : F-Pn, Fichier Laborde, NAF 12144, fiche 43783. AN, Minutier central, LXX-166, 18 juil. 1660. F-Pn, Fichier Laborde, NAF 12084, fiche n° 18947 : Thomas de la Selle, fils de Hilaire de la Selle joueur d’instrument demeurant rue au Maire, et de Françoise Germain, est baptisé le 29 avril 1645 à Saint-Étienne du Mont.
– 139 –
Chapitre 3
Le Tourneur, le père de Denis, puis avec celui de Louis Pécour.22 Enfin, plusieurs actes notariés montrent que Nicolas Griffon était établi à Paris comme maître joueur d’instruments aussi bien avant son arrivée à Celle en 1679 qu’après son retour dans la capitale française.23 En déployant ces réseaux transnationaux à travers l’espace et le temps, on voit ainsi émerger un écosystème constitué par de multiples liens familiaux et professionnels, largement issu de la corporation des maîtres joueurs d’instruments, et dont la transplantation à 800 kilomètres de Paris n’altère que très peu la structure d’origine. Donnée classique de l’histoire des migrations, le facteur familial provoque d’abord des « migrations en chaîne » où les individus migrent en priorité dans des lieux où sont déjà installés des membres de leur famille ou des proches. Ainsi le violoniste François de Francine déclare-t-il explicitement en 1741 qu’il s’est rendu auprès de sa cousine germaine Catherine André, fille du compositeur de musique française Louis André et danseuse à la cour de Dresde : François de Francine, cousin Germain de Caterine Andre, voyant que sa parante avoit le bonheur d’entrer au service du plus grand et plus digne Prince, s’est fait une gloire de la joindre en ces pays, dans l’esperance davoir l’honneur de sacrifier sa vie au service de Votre Majesté. Le suppliant Sire, ayant eu l’avantage de faire ses études pour la musique, se prosterne aux pieds de Votre Majeste pour La supplier de vouloir, par sa Clemence naturelle, ordonner qu’il puisse entrer dans Sa Chapelle.24
Mais le facteur familial provoque également, au sein d’une même famille, la sélection des migrants par le biais des systèmes d’héritage et des jeux d’alliance : aucun musicien français installé en Allemagne n’est l’aîné dans sa propre fratrie, mais beaucoup possèdent des frères et sœurs qui sont restés en France, ayant racheté les charges de leurs parents ou hérité d’opportunités et de réseaux professionnels qu’ils ont fait fructifier sur place.25 La dynastie Favier offre un excellent exemple de ces logiques familiales centrifuges.26 Jehan Favier, le grand-père de Jean-Jacques mort en 1615, était maître joueur d’instruments à Paris. Ses deux fils Jean (c.1583-1644) et Jacques (c.1605-c.1691) devinrent tous deux violons de la Chambre du roi : le cadet Jacques avait acheté sa charge en 1633 à la veuve de Jean Mazuel et la conserva jusqu’à sa mort en 1691. Vers 1620, Jacques Favier épousa la couturière Gillette Bourdonné. À la mort de cette dernière en 1643, il épousa l’ancienne apprentie de sa femme Marguerite Voiture. Parmi leurs cinq enfants, l’aîné de la fratrie Jean Favier, baptisé le 25 mars 1648, eut un début de carrière fulgurant, apparaissant comme jeune danseur dans l’opéra Xerces de Cavalli lors du mariage de Louis XIV et MarieThérèse d’Autriche en 1660, puis dans plusieurs ballets de cour. C’est à ce fils aîné que Jacques Favier transmit sa charge de violon du roi en 1676. Même s’il revendit la charge de son père immédiatement après la mort de celui-ci en 1691, ne souhaitant sans doute pas exercer le violon, Jean avait bénéficié d’une certaine visibilité et d’une bonne sécurité professionnelle. Ses deux frères puînés ne bénéficièrent pas de perspectives similaires : Jean-Jacques Favier, baptisé le 16 avril 1649 à Paris, émigra à Celle avant de revenir à Paris exercer comme maître de danse à l’Académie royale. Bernard Henri Favier, né en 1651, demeura à Paris où il exerça aussi le métier de danseur sous le nom de Favier le cadet. À la génération suivante, le fils de Jean, né 22 23
24 25 26
AN, Minutier central, XVI-89, 28 oct. 1644 et XVI-95, 4 sept. 1647. Charles Gaudon, décrit comme Hofmusiker dans les actes de l’église réformée de Celle mais dont on ne trouve pas de trace dans les archives de la cour, est originaire de Lyon et peut-être apparenté à Louis : Beuleke, Die Hugenotten in Niedersachsen, p. 133. AN, Insinuations, Y 233, fol. 125 : Donation mutuelle entre « Nicolas Griffon, joueur d’instrument à Paris, et Françoise Chevallier, sa femme, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin », 1677. AN, Minutier Central, XXIII-351, 13 août 1683 : Contrat d’apprentissage entre Nicolas Griffon, « maître joueur d’instruments et à danser » demeurant sur le Pont Saint-Michel, et Claude Collinet. Lettre de François de Francine à August III, Dresde, 17 juil. 1741. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/05, fol. 54. Catherine André est mentionnée dans une liste de personnel de 1733 comme danseuse : HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/4, fol. 2. Jan Kok, « The family factor in migration decisions », in : Migration History in World History. Multidisciplinary Approaches, dir. Jan Lucassen, Leo Lucassen et Patrick Manning, Leiden 2010, p. 215-250. Voir l’excellente synthèse donnée par Rebecca Harris-Warrick et Carol G. Marsh, Musical Theatre at the Court of Louis XIV. Le Mariage de la Grosse Catho, Cambridge 1994, p. 22-26.
– 140 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
en 1694 et également appelé Jean Favier, devint premier danseur d’Auguste le Fort à la cour de Dresde en 1719, après être passé au service de Stanislas Leczinski, ancien roi de Pologne et père de la future reine de France Marie. Il laissa des souvenirs qui retracent sa carrière mouvementée.27 À la frontière de la musique et de la danse, la famille Favier compta donc deux membres qui, à une génération d’écart, tentèrent leur destin en Allemagne. Nul doute que, entre autres motivations, le facteur familial ait joué un rôle décisif. Un autre cas de dynastie centrifuge est la famille Le Gros : Simon Le Gros, violoniste arrivé à Dresde avec la troupe de Deseschaliers en 1699 et marié à une danseuse, est le frère cadet du peintre Jean Le Gros (1671-1745), élève de Hyacinthe Rigaud et membre de l’Académie royale de peinture.28 Son père, Pierre Le Gros l’aîné (1629-1714), était sculpteur membre de l’Académie royale à partir de 1666 et réalisateur de nombreuses commandes pour le château de Versailles.29 Son autre demi-frère de Pierre Le Gros le jeune (1666-1719) fit également carrière à l’étranger, notamment à Rome où il réalisa de nombreuses sculptures dans les églises baroques, entre autres un mausolée pour le pape Grégoire XV.30 Les raisons du départ Pour analyser les facteurs qui motivent le déplacement d’une population ou d’un groupe d’individus, l’histoire des migrations fait souvent appel à un couple de notions anglaises : push et pull. Les facteurs push sont les données répulsives, celles qui chassent les individus de leur lieu d’origine, les facteurs pull sont ceux qui les attirent vers une destination donnée.31 La migration des musiciens français peut être éclairée à l’aide de ce couple de notions, même si elle n’obéit pas mécaniquement à cette polarité et que le poids des différentes variables doit être nuancé au début et à la fin de notre période, l’Europe musicale de 1660 présentant un tout autre visage que celle de 1730. Il convient également de faire une place à l’investissement affectif des espaces vécus, en distinguant la migration de rupture, qui investit le pays d’accueil comme nouveau lieu de vie et tourne le dos à son espace d’origine, et la migration de maintien, où le pays d’origine demeure le cadre de référence, le lieu d’émigration restant un espace neutre.32 La migration des comédiens français, qui a déjà fait l’objet de plusieurs analyses poussées, fournit un point de départ intéressant.33 Rahul Markovits passe ainsi en revue plusieurs facteurs déterminants dans la migration des comédiens français au xviiie siècle : outre le poids des circonstances individuelles, « l’attrait pécunieux » et le coup porté à la vie théâtrale à l’intérieur du royaume par la guerre de Succession d’Espagne (17011714) et la guerre de Sept Ans (1756-1763) poussent les comédiens français à s’exiler à l’étranger. Mais Markovits met aussi en évidence la permanence d’un « esprit de retour », la Comédie française restant pour tous les comédiens « l’horizon indépassable de la réussite professionnelle.34 » À la différence des comédiens, mis au ban de l’Église gallicane à travers une pratique unique en Europe qui les excommuniait d’office, les privant de droits civiques et les conduisant parfois à 27
28 29 30 31 32 33 34
HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 235. Léon Pélissier, « Souvenirs du danseur Favier », Journal de la société d’archéologie lorraine et du musée historique lorrain, 46/11, 1897, p. 243-253. Avant son engagement à Dresde, Favier avait travaillé en France et en Bavière, puis comme maître à danser de la future reine de France Maria Leszczyńska lorsque celle-ci était à Deux-Ponts. AN, Minutier central, LIII-280, 5 septembre 1736. François Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th Centuries. The Reign of Louis XIV : Illustrated Catalogue, Londres 1993. Daniel Büchel, Arne Karsten et Philipp Zitzlsperger, « Mit Kunst aus der Krise? Pierre Legros’ Grabmal für Papst Gregor XV. Ludovisi in der römischen Kirche S. Ignazio », Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 29, 2002, p. 165-197. Ce modèle a été développé pour la première fois par Everett S. Lee, « A Theory of Migration », Demography, 3/1, 1966, p. 47-57. Pour une approche globale, voir The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe from the 17th Century to the Present, dir. Klaus J. Bade et al., Cambridge 2011. Paul-André Rosenthal, « Maintien/rupture : un nouveau couple pour l’analyse des migrations », Annales. Économies, sociétés, civilisations, 45/6, 1990, p. 1403-1431. Voir en particulier Markovits, Civiliser l’Europe, p. 53-65. Roche, Humeurs vagabondes, p. 859-921. Markovits, Civiliser l’Europe, p. 64.
– 141 –
Chapitre 3
chercher un traitement social plus décent à l’étranger, les musiciens jouissent traditionnellement en France d’un statut social tout à fait régulier. Cependant, au début du xviiie siècle, les musiciens d’opéra semblent avoir été contaminés à leur tour par la suspicion qui pesait sur les gens de théâtre. L’indignation exprimée par Joachim Christoph Nemeitz sur la condition des gens d’opéra en France révèle le fossé qui existait sur ce point entre la France et l’espace germanique. Après avoir avoué qu’il pensait que seuls les comédiens étaient soumis à l’excommunication en France, Nemeitz doit faire le constat qu’il n’en n’est rien : il relate ainsi le scandale soulevé en 1736 autour d’une chanteuse d’opéra qui avait reçu la communion des mains d’un capucin, et l’interdiction faite par l’archevêque de Paris au clergé régulier de distribuer la communion aux gens d’opéra. Reprenant les arguments avancés par Bouhours à propos de Molière, et par Voltaire lors de la sépulture d’Adrienne Le Couvreur en 1730, il prend la défense des gens d’opéra et se prononce pour une tolérance sociale plus grande à leur égard en France.35 Même si les instrumentistes n’étaient pas excommuniés, les directeurs et les chanteurs d’opéra demeuraient donc marginaux au même titre que les acteurs : Catherine Dudard et Louis Deseschaliers, les directeurs de l’opéra de Pologne, n’ont pu se marier qu’à la condition de promettre de renoncer au théâtre. Leur acte de mariage, qui figure dans les registres de Saint-Éloi à Rouen à la date du 25 novembre 1689, fait explicitement mention de leur promesse de « renoncer à la profession de quomédien et d’aqueteur de l’Opéra.36 » La précarité de cette condition pouvait faire apparaître désirable une carrière à l’étranger. Un deuxième facteur structurel qui explique le départ à l’étranger d’instrumentistes français est le bouleversement sans précédent, autour de 1660, de structures musicales séculaires, au premier plan desquelles se trouve la corporation des ménétriers. Jusqu’en 1658, la communauté des joueurs d’instruments était régie par des statuts anciens de près de trois siècles, adoptés en 1407. Les nouveaux status, préparés par le nouveau « roi des joueurs d’instruments » Guillaume Dumanoir dès sa prise de fonction en novembre 1657, puis enregistrés en Parlement le 22 août 1659, abaissent notamment de six à quatre ans la durée de l’apprentissage, tout en portant à quatre ans l’interdiction de contracter une association après l’obtention du brevet d’apprentissage.37 Mais c’est surtout le conflit provoqué par ces nouveaux statuts entre Guillaume Dumanoir et la communauté des maîtres à danser qui bouleverse en profondeur les conditions d’exercice du métier de joueur d’instrument et a très certainement provoqué une contraction très sensible du marché du travail et des perspectives de carrière pour les jeunes instrumentistes français : la stricte séparation entre les maîtres à danser et les maîtres joueurs d’instruments, entérinée par la création de l’Académie de danse à travers les lettres patentes de mars 1661, modifie profondément la silhouette du métier. Elle s’accompagne de l’interdiction faite aux maîtres joueurs d’instruments d’enseigner la danse, dont l’enseignement est désormais exclusivement confié à des maîtres privilégiés.38 Les maîtres à danser échappent donc complètement à la tutelle de la corporation des joueurs d’instruments, puisqu’ils peuvent enseigner la danse dans toutes les ville du royaume « sans qu’ils puissent être pour quelque cause ou prétexte que ce soit […] contraints de prendre à cause de ce aucunes Lettres de Maîtrise.39 » À l’inverse, les maîtres joueurs d’instruments qui veulent enseigner la danse sont entièrement soumis au contrôle de l’Académie de danse, dont l’accès était conditionné au versement de droits très importants : 150 livres pour les fils de maîtres et 300 pour les autres.40 Les joueurs d’instruments tenteront de s’opposer par tous les moyens à ce texte largement défavorable à leur égard, mais en vain : le Parlement les débouta de leur opposition en 1662. Ces dispositions ont certainement beaucoup réduit les débouchés des jeunes joueurs d’instruments, 35 36 37 38 39 40
Joachim Christoph Nemeitz, « Von den musicalischen Schauspielen, die man Opern nennet », in : Vernünfftige Gedancken über allerhand historische, critische und moralische Materien, vol. 6, Francfort 1745, p. 162-189. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 196-197. Massip, La Vie des musiciens, p. 70-72. Massip, La Vie des musiciens, p. 74-78. Art. 10, cité par Massip, La Vie des musiciens, p. 76. Art. 6, cité par Massip, La Vie des musiciens, p. 77.
– 142 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
formés aussi bien dans le domaine de la musique que de la danse, qui arrivaient alors sur le marché du travail, conduisant certains d’entre eux à aller tenter leur fortune en Europe du Nord. Ce n’est donc sans doute pas un hasard si les premiers musiciens français arrivent à Osnabrück à la fin de l’année 1661. Beaucoup d’entre eux étaient d’ailleurs en même temps maîtres à danser, fonction qu’ils n’avaient plus le droit d’exercer dans l’espace parisien. Ici encore, Jean-Jacques Favier est un bon exemple d’une telle trajectoire : fils d’un maître joueur d’instruments, il a probablement appris la musique et la danse. Après plus de dix années passées comme musicien et maître à danser dans les cours de Celle et de Hanovre, on retrouve sa trace à Paris en 1691, date à laquelle il assiste à l’enterrement de son père à Saint-André des Arts.41 La même année, un acte notarié le qualifie de « maître de danse des académies royales.42 » Il a donc dû intégrer l’académie de danse, probablement à l’aide du pécule amassé pendant ses années d’activité en Allemagne. En 1719, il apparaît de nouveau comme « maître de danse à Paris » dans la quittance d’une somme de trois cent livres qui lui était due par Joachim de Chatellier, conseiller du roi et président au bureau des finances de Dauphiné « pour avoir montré à dancer à Messieurs ses enfans.43 » Dans ce cas particulier, il apparaît très plausible que l’interdiction d’enseigner la danse ait constitué pour Jean-Jacques Favier un motif supplémentaire de quitter Paris. Les musiciens qui arrivèrent à Celle en 1666 étaient tous en début de carrière, et donc particulièrement touchés par cette évolution : avec ses 27 ans, Philippe La Vigne était certainement le doyen du groupe, tandis que Jean-Jacques Favier est âgé de 17 ans, Denis Le Tourneur de 25 ans, Thomas de La Selle de 21 ans. Outre la fondation de l’Académie de danse, l’année 1661 marqua également le début du règne personnel de Louis XIV et la nomination de Jean-Baptiste Lully au poste de Surintendant de la musique du roi. Une période de concentration sans précédent du marché de la musique commençait en France, marquée notamment par le rachat par Lully en 1670 du privilège royal accordé à Pierre Perrin pour l’établissement d’académies de musique à Paris et en d’autres villes du royaume, la création de l’Académie royale de musique en mars 1672, au moyen de lettres patentes et diverses ordonnances royales qui interdisaient non seulement la création d’académies de musique concurrentes, mais limitaient drastiquement l’usage de musique et la présence de musiciens dans les théâtres.44 De plus, la salle du Palais Royal étant désormais réquisitionnée par l’entreprise de Lully, l’ancienne troupe des comédiens du roi dirigée par Molière jusqu’à sa mort la même année – et qui avait des violonistes à son service – s’en trouve chassée et doit se produire à l’Hôtel Guénédaud.45 Ces développements eurent d’ailleurs pour effet direct l’émigration de plusieurs musiciens de renom en Angleterre : nous avons déjà évoqué le cas de Jacques Champion de Chambonnières, qui manifesta au moins à deux reprises, en 1655 et en 1667, son désir de partir à l’étranger. Robert Cambert, ancien partenaire de Perrin qui avait perdu face à Lully la bataille pour le contrôle de l’opéra de Paris, se rendit à Londres dès 1673 pour y fonder sur le modèle français la Royall Academy of Musick, où il produisit deux comédies en musique, Ariane ou le mariage de Bacchus et Pomone. Cambert poursuivit ensuite une carrière dans les cercles aristocratiques anglais au moins jusqu’en 1676, date à laquelle sa trace se perd.46 Sa fille Marie-Anne Cambert épousa à Londres le musicien Michel Farinel, qui avait été appelé par Charles II en 1675 et dont la 41 42 43 44
45 46
F-Pn, Fichier Laborde, NAF 12102, fiche 26350, 18 janv. 1691. AN, Minutier central, I-193, 4 mai 1691. AN, Minutier central, XVII-119, 24 mars 1719. Les lettres patentes sont reproduites dans Arthur Pougin, Les Vrais créateurs de l’Opéra français : Perrin et Cambert, Paris 1881, p. 193-196. Elles portent défense à toutes personnes « de faire chanter aucune pièce entière en France, soit en vers françois ou autres langues, sans la permission par écrit dudit sieur Lully, à peine de dix mille livres d’amende, et de confiscation des théâtres, machines, décorations, habits… » Voir aussi l’ordonnance royale signée à Saint-Germain le 14 avril 1672, dans laquelle le Roi défend « aux troupes de ses comédiens françois et étrangers qui représentent dans Paris […] de se servir dans leurs représentations, de musiciens au-delà du nombre de six et de violons ou joueurs d’instruments au-delà du nombre de douze […]. » Mongrédien, La Vie quotidienne des comédiens, p. 113-116. Christina Bashford, « Cambert, Robert », in : Grove Music online.
– 143 –
Chapitre 3
biographie révèle également les contraintes qui pesaient sur les jeunes musiciens de cette génération : alors qu’en France, sa carrière musicale est principalement limitée aux fonctions de maître de musique dans des institutions capitulaires et conventuelles du Sud de la France, sa fulgurante carrière à l’étranger lui offre un environnement beaucoup plus favorable et des opportunités beaucoup plus variées.47 Ces exemples montrent que le privilège de 1672 aboutit à une raréfaction dramatique des lieux de musique et des opportunités d’emploi aussi bien à Paris qu’en province, raison pour laquelle certains joueurs d’instruments décidèrent de poursuivre une carrière à l’étranger, dans un environnement plus ouvert à la concurrence, en particulier s’ils étaient d’âge jeune ou bénéficiaient d’un capital social important. La chronologie des migrations musicales dans l’espace germanique corrobore ces différentes hypothèses. L’évolution de la migration des musiciens français par décennies marque un progrès continu en forme de pyramide, dont le sommet se situe dans les années 1680. Pour la décennie 1660, à partir de notre échantillon, le nombre d’entrées de musiciens français dans l’Empire est légèrement supérieur à un par an avec 15 entrées. Il augmente légèrement dans la décennie suivante et culmine dans les années 1680, avant de rescendre de manière continue jusque dans les années 1730 (Illustration 3.1).48 Si l’on considère la présence cumulée des musiciens français, toujours sur la base de notre échantillon, on constate une évolution comparable avec une augmentation continue entre 1660 et 1690, un pic dans les annéees 1690 avec 45 musiciens présents, puis une diminution progressive jusque dans les années 1740. Les années 1680-1690 marquent donc incontestablement le point culminant de la présence musicale française dans les Hofkapellen de l’Empire. Nombre de musiciens par décennies 50 50 40 40
30 30 20 20 10 10 00
1660 1660
1670 1670
1680 1680
1690 1690
Nombre d’entrées
1700 1700
1710 1710
1720 1720
1730 1730
1740 1740
Nombre de musiciens présents
Illustration 3.1. Évolution de la présence musicale française en Basse-Saxe et en Saxe par décennie : nombre d’entrée et nombre de musiciens présents.
L’attrait de l’étranger Examinons à présent les facteurs d’attraction – pull factors – qui ont fait des territoires impériaux une destination apparemment prisée pour les musiciens français, davantage que d’autres régions de l’Europe. Ce que Markovits nomme « l’attrait pécunieux » est assez délicat à mesurer avec précision : la fluctuation des taux de change entre les devises, les différences de prix et de modes de rémunération, sans parler de l’extrême volatilité des salaires des musiciens en fonction de leurs capacités individuelles, des gratifications ponctuelles qu’ils reçoivent et des frais qu’ils ont à supporter font que le coût de la vie de part et d’autre du Rhin n’est pas vraiment comparable.
47 48
F-Pn, Res. Vma Ms. 1219 : Michel Farinel, Les Concerts choisis de M. Farinelly. Voir aussi Massip, « Itinéraires d’un musicien européen ». Ces estimations ne prennent pas en compte les musiciens membres de la troupe d’opéra de Deseschaliers.
– 144 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
La remarque de Michel Farinel sur la « bonne pension49 » de son frère indique cependant que le niveau de vie des musiciens français dans l’Empire était plutôt confortable. Avec une rémunération de 500 Thaler par an, Jean-Baptiste Farinel était particulièrement bien payé comme Kapellmeister. Cette pension, équivalent à environ 1500 livres tournois, est supérieure à celle que touchent dans les mêmes années Charles Maurice Le Tellier, maître de la musique de la Chapelle du roi, ou Michel Lambert, maître de la musique de la Chambre du roi (1200 livres tournois chacun) – mais de telles comparaisons ne prennent pas en compte le cumul des charges, pratique courante chez les musiciens du roi, ni les suppléments à titres divers.50 Avec un tel salaire, c’est d’ailleurs Jean-Baptiste qui peut venir en aide financière à son frère Michel : un procès opposera en 1722 les deux frères Farinel à propos du remboursement d’une somme d’argent que JeanBaptiste avait prêtée à Michel en 1709, pour lui permettre d’acheter un office de contrôleur des gages.51 Il aurait également envoyé de l’argent régulièrement à Berne pour son frère.52 La comparaison des salaires français et allemands est peut-être moins hasardeuse pour les musiciens du rang : lorsque Jean-Jacques Favier et François Robeau sont engagés à Celle en 1666, ils touchent chacun 136 Thaler par an, soit environ 408 livres tournois. Au même moment, leurs pères Jacques Favier et Hilaire Robeau touchent seulement 365 livres par an comme violons de la Chambre du roi.53 Là encore, la prudence est de mise : cette rémunération ne tient pas compte des revenus complémentaires que ces derniers touchaient probablement comme maîtres joueurs d’instruments, et d’autres musiciens de la Chambre du roi sont beaucoup mieux payés (comme les petits violons ou les flûtistes avec 600 livres tournois). Il faut aussi noter que les hautbois reçoivent généralement le même salaire que les violonistes (par exemple à Celle et Hanovre) mais que les chanteurs sont parfois mieux payés : à Hanovre, la chanteuse Anne-Sophie Bonne perçoit un salaire annuel de 250 Thaler entre 1668 et 1677, alors que les autres musiciens sont rémunérés 115 Thaler.54 Avec un salaire annuel de 400 Thaler, François Godefroy Beauregard est aussi mieux payé que ses collègues instrumentistes à Dresde.55 Globalement, on peut donc affirmer que la rémunération des musiciens français dans les cours allemandes est plus élevée qu’en France, puisqu’elle peut dépasser celle des musiciens du roi. Sans compter qu’à Dresde, les salaires distribués aux musiciens français à partir des années 1700 sont encore supérieurs à ceux pratiqués en Allemagne du Nord : en 1709, les musiciens du rang touchent entre 240 et 300 Thaler de pension (720 et 900 livres) tandis que Jean-Baptiste Volumier touche 1200 Thaler (3600 livres).56 En 1720, Louis André touche également 1200 Thaler par an comme compositeur de musique française. Cette inflation générale des salaires a sûrement à voir 49
50
51
52 53 54 55 56
F-Pn, Rés. Vma Ms. 1219 : Michel Farinel, Les Concerts choisis de M. Farinelly, non paginé : « De ce Mariage il ne reste que mon frere qui dépuis environ 28 ans est a la Cour de S[on] A[ltesse] E[lectorale] d’Hannover avec une bonne pension, & moy, qui des l’Age d’Onze a douze ans ay Composé divers ouvrages qui m’ont acquis quelque reputation. » Sur la base de l’édition 1709 du Cambio Mercatorio de Georg Heinrich Paritius, nous adoptons le taux de change suivant : 1 Reichsthaler = 3 livres. Il faut noter que Michel Lambert touche aussi 1980 livres tournois la même année, en qualité de maître des enfants, « pour sa nourriture et celle de trois pages ». Sur les pensions de Le Tellier en 1680 et Cambert en 1683, cf. Benoît, Musiques de Cour, p. 11, 72 et 89-90. F-Pn, Fonds Écorcheville, boîte n° 2. Le fonds Écorcheville conservé à la Bibliothèque nationale de France contient deux copies manuscrites d’actes qui documentent ce procès. La première copie est une sentence du baillage du Grésivaudan datée du 25 avril 1723. La seconde est intitulée « Réponse de Sieur Michel Farinel Conseiller du Roy Controlleur des Gages des Officiers du Parlement aux griefs proposés contre la Sentence rendue par le Vicebailly de Graisivodan ». Je remercie Cédric Segond-Genovesi d’avoir bien voulu me transmettre son article et son inventaire du fonds Écorcheville : Cédric Segond-Genovesi, « Collection patrimoniale, héritage(s) scientifique(s): notes sur le fonds Jules Écorcheville (1872-1915) à la Bibliothèque nationale de France », in : La notion d’ héritage dans l’ histoire de la musique, dir. Cécile Davy-Rigaux, à paraître. Fischer, Musik in Hannover, p. 7. Benoît, Musiques de Cour, p. 11. Par exemple NLAH, Hann. 76c A Nr. 93, p. 437. Par exemple HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 6, fol. 3 et 78. HStA Dresden, Loc. 383/4, fol. 108-110.
– 145 –
Chapitre 3
avec les moyens financiers très importants de la cour de Dresde, qui dépassent de beaucoup ceux des petites cours du Nord de l’Empire, mais également avec le fait que la tendance générale est à la hausse y compris chez les comédiens.57 L’attrait pécunieux a donc sûrement joué un rôle non négligeable dans le départ à l’étranger. Enfin, l’intérêt croissant pour le répertoire musical et les pratiques orchestrales françaises a certainement été un facteur essentiel. Il est d’abord stimulé par l’acclimatation de la danse française dans l’espace germanique, sur la scène ou dans la sphère privée, dans les milieux aristocratiques mais aussi dans les milieux bourgeois et étudiants, documentée notamment par les nombreux manuels de danse en langue allemande imprimés autour de 1700, notamment à Leipzig.58 L’attrait pour le théâtre français a également provoqué la circulation de la musique : en ce sens, il s’agit donc d’un phénomène culturel total. Les instrumentistes français purent bientôt jouir d’une excellente réputation dans l’espace germanique. Le compositeur et écrivain Johann Beer note ainsi à la fin des années 1680 que « tout le monde semble généralement d’accord sur une opinion inébranlable, qu’il n’y a pas de meilleurs chanteurs qu’en Italie, et pas de meilleurs instrumentistes qu’en France.59 » Quelques années plus tard, le maître de danse Samuel Behr recommande aux maisons d’opéra allemandes d’adopter le modèle français pour la musique instrumentale, voire d’engager une bande de musiciens français si elles en ont les moyens – probablement un reflet des pratiques en vigueur à l’opéra de Leipzig où Behr exerçait : Il serait encore bon d’observer, dans un opéra, qu’en ce qui concerne la musique instrumentale, il n’est pas mal de se régler sur les Français, et de faire en sorte que l’opéra soit doté d’une bonne bande de Français, ou au moins de bons Allemands qui auraient des manières françaises, puisque les Français, avec leurs instruments et leurs danses, l’emportent encore sur les Allemands ; en ce qui concerne la voix et le chant, cependant, les Italiens y fleurissent.60
Même si les recommandations de Behr n’ont vraisemblablement pas été appliquées littéralement dans les principales maisons d’opéra de l’Empire – on ne trouve pas de trace d’orchestre français à Hambourg, Braunschweig ou Leipzig – elles trahissent un intérêt pour les musiciens français et une reconnaissance de leur valeur y compris en dehors du monde de la cour. Les opéras publics pouvaient d’ailleurs mettre à profit les ressources du personnel musical français attaché aux cours voisines (voir Chapitre 1). Jean-Jacques Favier apparaît ainsi comme maître des ballets (« Ballettmeister ») dans l’opéra Erindo de Cousser créé en 1694 au Gänsemarktoper de Hambourg.61 Il était alors en poste comme maître à danser à la cour de Hanovre. De même, le tout nouvel opéra de Braunschweig put compter dans son orchestre un musicien français de la cour de Celle en 1690, ce qui valut à celui-ci une gratification spéciale.62 La cour se rendait d’ailleurs régulièrement dans cet opéra, comme le montre la location de douze loges en janvier 1690.63 57 58
59 60
61 62
Markovits, Civiliser l’Europe, p. 55-60. Sur ce corpus, voir en particulier Tilden Russell, Theory and Practice in Eighteenth-Century Dance : The German-French Connection, Newark 2018. Sur les relations entre les maîtres à danser de Leipzig et les musiciens français de Dresde, voir Louis Delpech, « Gottfried Taubert und die Rezeption französischer Musik in Dresden um 1717 », in : Tauberts « Rechtschaffener Tantzmeister » (Leipzig 1717). Kontexte – Lektüren – Praktiken, dir. Hanna Walsdorf, Marie-Thérèse Mourey et Tilden Russel, Berlin 2019, p. 75-99. Johann Beer, Musikalische Diskurse, Nuremberg 1719 [1689], p. 60 : « Die gantze Welt sehr allgemach in der unbeweglichen opinion, es gäbe keine bessere Sänger als in Italien, und keine bessere Instrumentisten als in Frankreich. » Samuel Rudolph Behr, Maître de Danse. Anleitung zu einer wohlgegründeten Tantz=Kunst, Leipzig 1703, Annotatio I, sans page : « Und noch dieses wäre bey einer Opera zu observiren, daß, was darinne die Instrumental Music anbelangete, nicht unbillig wäre, wenn man sich darmit nach denen Herren Frantzosen regulirete, und zusähe, daß entweder die Opera mit einer guten Bande Frantzosen, oder zum wenigsten guten Teutschen, welche darinne auch Französische Manieren an sich hätten, versehen werden könte, indem doch ermeldte Herren Frantzosen mit ihren Instrumenten und Tantzen den Welschen noch den Preiß abgewinnen; Was aber die Stimmen und das Singen anbetrifft, so floriren hierinne die Welschen. » Marx et Schröder, Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, p. 439-457. NLAH, Hann. 76c A Nr. 216, 20 août 1690, p. 364 : « Einem Musicanten welcher beÿ den Operen zu Braunschweigg auffgewartet, zur Verehrung laut ord: bezahlet. »
– 146 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
La diaspora huguenotte semble aussi avoir joué dans cet intérêt un rôle décisif dans les métropoles de Hollande, et moins indirect dans les cours allemandes.64 Le fait que la duchesse de Celle, Éléonore Desmiers d’Olbreuse, ait été une huguenotte semble ainsi avoir largement favorisé l’installation de nombreux militaires et aristocrates huguenots à la cour, créant par la présence d’un public francophone des conditions linguistiques et culturelles particulièrement favorables à l’installation d’une troupe de comédiens français. Les biographies de Samuel Chappuzeau ou Jean-Jacques Quesnot illustrent d’ailleurs parfaitement le voisinage entre migration huguenotte et élargissement du marché du travail pour les comédiens, danseurs et musiciens français (voir Chapitre 1). De même, la présence de hautbois français dans les armées coïncide également avec la migration d’officiers huguenots (voir ci-dessous). Même s’ils évoluent dans un environnement multi-confessionnel et marqué par une tolérance religieuse supérieure à la moyenne, les musiciens français restent cependant très largement catholiques. Mais ils bénéficient d’un intérêt décuplé pour les pratiques de danse et le répertoire théâtral français qui trouve ses racines aussi bien dans l’adaptation de l’idéal galant que dans les migrations religieuses. La vie dans l’Empire Déplacés à des centaines, parfois des milliers de kilomètres de leur lieu d’origine, dans un environnement linguistique, culturel et confessionnel souvent très différent de ce qu’ils avaient pu connaître en France ou dans les Flandres, les musiciens français ou francophones ont certainement dû déployer des facultés d’adaptation remarquablement élevées pour pouvoir s’adapter à l’univers des cours d’Empire. L’adaptation ne portait pourtant pas en premier lieu sur leur style d’exécution ni sur leur culture musicale, mais sur des phénomènes beaucoup plus triviaux, pour la plupart extérieurs à la sphère de leur métier. C’est là encore que le rôle joué par la communauté pouvait se révéler décisif. L’un des premiers obstacles à franchir était la distance géographique. Voyage et installation La planification de l’itinéraire, le voyage des musiciens et leur installation dans leur nouveau lieu de vie sont des aspects essentiels pour saisir au plus près les modalités concrètes de leur migration. À une époque où les déplacements étaient pénibles et coûteux, un voyage de plusieurs centaines de kilomètres à travers de nombreuses frontières requérait une bonne santé et ne pouvait être entrepris en hiver à cause du froid et de la neige.65 L’acheminement de bagages nécessitait quant à lui une préparation logistique soigneuse et engendrait des coûts importants. La plupart des musiciens voyagent par voie terrestre, privilégiant ainsi la rapidité et les axes très empruntés. Pour se rendre en Allemagne du Nord, l’itinéraire habituel passait à travers la Hollande : Nemeitz recommande d’ailleurs que l’on visite la Hollande et l’Angleterre avant de se rendre à Paris.66 À l’inverse, pour rejoindre la Saxe, l’itinéraire le plus courant emprunte la route de Francfort, d’où partaient chaque semaine plusieurs voitures de poste pour Dresde, en traversant la Hesse et la Thuringe. Lorsque les musiciens d’Auguste le Fort reviennent en octobre 1714 de Paris, où ils avaient accompagné le prince Friedrich August pendant son Grand tour, l’organiste Christian Pezold égare sur le trajet une malle entre Erfurt et Weimar, conduisant le cocher de la
63 64 65
66
NLAH, Hann. 76c A Nr. 215, p. 404 : « Behueff neu erbaueten Operen Hauses in Braunschweig. Vermöge Serenissimi Durchl. Gnädigster ordre de dato Zelle den 4. January 1690 für 12 logen in demselben, dem H. Drosten Stechinelli laut Quittung bezahlet 800 Thlr. » Voir par exemple le cas de La Haye avec Rebekah Ahrendt, « Armide, the Huguenots, and The Hague », The Opera Quarterly, 28/3-4, 2012, p. 131-158. Nemeitz insiste sur la bonne constitution physique indispensable pour voyager (« Les Voiages sont sujets à beaucoup d’incommoditez, que même des corps sains & robustes ne supportent qu’avec peine », et le voyageur doit donc avoir une « forte complexion ») ainsi que sur la nécessité d’avoir une « bourse bien garnie » : Nemeitz, Séjour de Paris, p. 12-15. Nemeitz, Séjour de Paris, p. 38-48.
– 147 –
Chapitre 3
diligence à signer une déclaration de perte.67 Pour le trajet aller, le prince était également passé par Francfort, avant de rejoindre Cologne et de passer en France à Metz.68 C’est seulement dans le cas où ils étaient accompagnés d’effets lourds et volumineux difficiles à acheminer par voie terrestre que les musiciens privilégiaient le transport maritime ou fluvial, beaucoup moins coûteux : les dix-sept ballots de décors et costumes de l’ancien opéra de Lille, rachetés par Louis Deseschaliers pour l’opéra de Pologne, sont envoyés par la mer à Dunkerke avant d’être acheminés jusqu’à Paris.69 Pour se rendre à Cracovie, la troupe navigue sur le Danube entre Ulm et Vienne, sur quatre bateaux qui tranportaient une centaine de personnes avec leurs bagages et les décors.70 Les portions terrestres de l’itinéraire, fort coûteuses, sont ainsi réduites au minimum, entre Paris et Ulm puis entre Vienne et Cracovie (Illustration 3.2). Le déplacement en carosse et le transport par charriot coûte six fois plus cher à la troupe que la portion fluviale de leur itinéraire.71 La même année, la troupe de comédiens français engagée à La Haye est accompagnée de quatre-vingt ballots de malles et bagages, comprenant décors et habits, ainsi que le précise la demande de passeport signée par Abraham Wolfgang von Gersdorf, représentant de Saxe auprès des États généraux.72 Les comédiens empruntent donc un itinéraire maritime et fluvial : ils s’embarquent à Amsterdam pour rejoindre Hambourg par la mer, avant probablement de remonter l’Elbe jusqu’à Dresde.73 Les livres, partitions et autres denrées non périssables à destination de l’Allemagne empruntaient également la voie maritime, comme l’explique Christophe Brosseau à Leibniz : Vos lettres des 14. et 24. du mois passé m’ont esté rendues, et j’ay trouvé avec la derniere la liste des livres que S[on] A[ltesse] S[erenissime] desire, Ils seront bientost achetez, mais la peine est de vous les faire tenir par une voye seure, car quant à cele de Monsr Leffman le fils il n’est pas possible de s’en servir acause qu’il s’en retourne par terre, et que le port de ces livres seroit d’un grand coust. Il faut donc se resoudre à prendre celle de quelque vaisseau Anglois qui partira de Rouën pour Hambourg à quoy je veilleray incessament.74
Les livres français acquis par la bibliothèque ducale de Hanovre, qui incluaient des partitions de musique, étaient donc en raison de leur poids d’abord envoyés à Rouen – probablement par voie fluviale en descendant la Seine – où ils étaient chargés sur un bateau à destination de Hambourg. Après ces déplacements pénibles, sitôt arrivés à destination, les musiciens français devaient se mettre à la recherche d’un logement. Dans la petite ville d’Osnabrück, ils n’étaient pas logés directement à la cour, mais on leur fournissait au même titre que d’autres serviteurs le gîte (ou plus exactement le « quartier ») chez l’habitant pour la durée de leur présence, la plupart du temps quelques mois au cours de l’été. Les habitants adressaient ensuite une facture à la cour qui 67 68 69 70 71
72 73 74
Köpp, Johann Georg Pisendel, p. 81-84. Voir Chapitre 5, p. 264-265. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett Loc. 758/04. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 2 : « Pour dix sept grands ballots d’habits et bardes de l’Opera, pour les envoyer de l’Isle a Dunkerque & de la a Paris, toujours par terre, il y a le receu — 800 [livres]. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 2 : « Pour avoir achepté à Ulme quatre bateaux de quatre vingt pieds, piece, matelas, linge, batterie de cuisine et nourry avec du Vin tout l’opera jusques à Vienne – 4394 [livres]. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/3, fol. 2 : « Pour avoir envoyé tout l’Opera en carosse de Paris a Strasbourg, pour sa nourriture et le payement du port des petits paquets il y a le receu — 8587.15 [livres]. […] Pour avoir nourri tout l’Opera a Strasbourg pendant douze jours, plus pour nourriture et carrosses durant sept jours de Strasbourg à Ulme, plus sejourné huit jours à Ulme, plus pour dix sept milliers pesant de Strasbourg à Ulme par terre – 9069 [livres]. […] Pour le port de dix sept milliers de Paris a Strasbourg par terre il y a le receu – 2406.16 [livres]. […] Pour avoir mené tout l’opera en carrosse de Vienne a Cracovie et les ballots par chariots, marché fait par Monseigneur Vakerbak – 6994 [livres]. » Fransen, Les comédiens français, p. 200. Voir la déclation des comédiens signée à Amsterdam, 9 sept. 1699 : HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 13 : « promettant l’un pour tous, è tous pour un de nous embarquer au plus tard m[ardi] prochain qui est le 15. du Courant, a Amsterdam, pour aller a Hambourg et de la au plus vite a Dresde. » Lettre de Christophe Brosseau à Gottfried Wilhelm Leibniz, Paris, 18 juin 1697. Gottfried Wilhelm Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe I/2, éd. Paul Ritter, Darmstadt 1927, p. 275-276.
– 148 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
Illustration 3.2. . Itinéraire de la troupe d’opéra de Deseschaliers.
payait l’hébergement. En 1666, une veuve de la ville enregistre la présence pendant trois mois de Monsieur Jemme et Madame Nanna, ainsi que d’un Monsieur Lafontaine pour neuf mois.75 Si « Monsieur Jemme » renvoie sans aucun doute possible à Élie Jemme, « Madame Nanna » désigne très probablement la chanteuse Nanon qui apparaît régulièrement dans la correspondance de Sophie entre 1663 et 1675.76 Elle peut être identifiée comme la fille illégitime du diplomate huguenot Pierre de Falaiseau77 et se trouve en 1703 à Berlin, à la cour de Sophie Charlotte.78 « Monsieur Lafontaine » a été actif à Osnabrück pendant plusieurs années : le « musicien français de la cour Pierre La Fontaine » se marie en 1673 dans l’église St. Johann et y fait baptister deux de ses enfants en 1674 et en 1676.79 D’autres noms de musiciens sont encore signalés dans d’autres factures en 1667 : Clermont80, Simon, Syntamoir.81 Ces musiciens n’étaient donc pas engagés durablement, mais seulement pendant l’été, avec une obligation de présence flexible. Certains 75
76 77 78
79 80 81
NLAO, Rep. I Nr. 492, fol. 26r : « Rechnung von Anno 1666 waß mir von Ihro Hochfürstl. Dchl. Einquartierten Völckern und Hoffbedienten an quartiergeldt noch in Rückstand ist alß nemblich : Erstlich Monsieur Jemme Undt Madam Nanna vor dreÿ Monat jedes mon[a]t. 2 Thlr. – facit 6 Thlr. Monsieur Lafontaine neun Monat vor jedes mon[a]t 1 Thlr facit – 9 Thlr. Monsieur Lubeck zweÿ Monat vor jedes Mon[a]t 1 Thlr facit – 2 Thlr. […] Diese Rechung ist mir nach Maria Schüters, Wittwe Hawers, bezahlt. » Vgl. Bodemann, Briefwechsel, p. 58, 147, 242. Pierre de Falaiseau fut l’envoyé du Brandebourg en Suède de 1685 à 1690 : Daniel Riches, Protestant Cosmopolitanism and Diplomatic Culture. Brandenburg-Swedish Relations in the Seventeenth Century, Leiden 2013, p. 228-253. Voir par exemple la lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz à Pierre de Falaiseau, Berlin, 17 avr. 1703. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe I/22, p. 243 : « J’ai vu dernièrement M[ademoise]lle Nanon, chez la Reine. Elle se fait à Merveille : la Reine l’y faisant apprendre à danser, chanter, et l’italien. Et se monstrant fort satisfaite de son esprit et du zele qu’elle fait paroistre pour le service de Sa Majesté. » BA Osnabrück, St. Johann, Traubuch 1657-1682, 29 oct. 1673, p. 241 : « Eodem die domi cum dispensatione Petrus Lafonteinne Musicus Principiis Virgo Elisabetha Antonia Beglÿ. Testes Georgius Beglÿ pater sponsae Antonius Bisendübell. » BA Osnabrück, St. Johann, Taufbuch 1657-1694, 8 juin 1674, p. 87, et 12 janv. 1676, p. 94. NLAO, Rep. 110 I Nr. 492, fol. 72 : « Anno 1667 den 2. Maÿ ist bey mihr eingelogirt Monsieur Clermondt Fürstl. Musicus Undt geplieben biß den 3. 9bris seindt 6. Monat ieder monat für Schlaff= Undt Verpflegung 1. Thlr. – F[acit] 6 Thlr. Joibst Höckerp [?]. » NLAO, Rep. 110 I Nr. 492, fol. 75 : « den 8. Aprilis [1667] seindt bey mihr eingelogirt zwey Musicanten alß Monsieur Simon Undt Monsieur Syntamoir mit einem Diener Undt geblieben biß den 11. 9bris, seindt 7. Monat für ieder monatlich 1. Thlr – 14 Thlr. Für den Diener monatlich 10 gr. 6 d. – 3 Thlr 10 gr. 6 d. Vom 11. 9bris 1667 biß den 11. Januarÿ 1668. Monsieur Simon geblieben seindt zwey monat – 2 Thlr. Noch biß den 11 Februarÿ 1. Monat – 1 Thlr. Anna Wedeburgt, Wittwe Blauebeforts. »
– 149 –
Chapitre 3
musiciens des cours voisines pouvaient aussi être occasionnellement logés à Osnabrück lorsqu’ils venaient y travailler de manière exceptionnelle.82 À l’été 1667, deux musiciens du nom de Lübeck et « Lapieur » sont logés chez l’habitant pour six mois.83 Ce dernier se trouvait déjà à Osnabrück l’année précédente : en mars 1666, il se marie à la cathédrale Saint-Pierre, où il est désigné comme « Guillaume Lappier, Français et musicien de Leurs Altesses » (« Aegidium Lappier Gallus et Musicus Serenissimi principi »).84 Tout juste neuf mois après son mariage, le musicien fait baptiser sa fille qui reçoit Sophie de Hanovre pour marraine.85 Lorsqu’il apparaît six mois plus tard dans les quittances pour l’hébergement des musiciens, on a donc l’impression qu’il était déjà installé depuis longtemps dans la ville. C’est toujours le cas douze ans après, puisqu’il fait baptiser en mars 1679, juste avant le déménagement de la cour à Hanovre, son fils Nicolas à Osnabrück, toujours sous le nom de « Egidius Lappier Gallus musicus ».86 Tout juste un mois plus tard, en avril 1679, il apparaît dans les Archives Nationales à Paris, sous le nom de « Guillaume Lapierre » avec une adresse place Maubert : il signe un contrat d’association pour un an avec d’autres musiciens et maîtres à danser parisiens, pour jouer du violon pour les fiançailles, les mariages, les banquets et les sérénades, et donner un concert une fois par semaine.87 Cet exemple montre que les musiciens pouvaient changer très rapidement de lieu de vie : Guillaume Lapierre, quelle que soit la raison de sa non reconduction parmi le personnel de Hanovre lors du déménagement de la cour, est rentré très vite à Paris. Il y était sans doute régulièrement pour entrenir ses contacts. Il semble donc que les musiciens français en activité à la cour d’Osnabrück entre 1661 et 1680 ne résidaient pas de manière durable dans la ville, mais qu’ils étaient plutôt recrutés pour une durée courte, probablement déterminée à l’avance, au terme de laquelle ils retournaient en France. Les déplacements se font exclusivement à la belle saison, quand les routes sont dégagées et les conditions climatiques supportables. À Celle, les premiers musiciens arrivèrent tout au long du printemps 1666, hormis René des Vignes qui arriva au cours de l’hiver 1667 mais touche le même salaire que les autres. Le premier salaire est versé aux musiciens pour une demi-année à partir de la Saint-Michel 1666 jusqu’à Pâques 1667 et fait référence à un décret d’engagement signé du 3 avril 1667.88 Il s’est donc écoulé une année pleine entre l’arrivée des musiciens et leur engagement définitif, probablement signé au terme d’une période d’essai. Philippe La Vigne, le chef de la bande qui restera jusqu’en 1705 Capellmeister de la cour, arrive le premier à Celle avant le 2 mars 1666. Il est d’abord logé dans une auberge pendant trois mois,89 avant d’être envoyé chez l’habitant Christoph Keßelhutt au cours du mois de mai 1666 en compagnie de son petit frère et du musicien François Robeau.90 Il est enfin envoyé chez un Français nommé Laforest, pasteur calviniste de la Duchesse, en même temps chargé de l’intendance et de l’accueil des invités (« Hoffourier »), en compagnie de François Robeau et Jean-Jacques Favier jusqu’en janvier 1667.91 Lorsqu’un nouveau musicien, Guillaume Josse, arrive à Celle en juin 1666, il est également logé 82 83 84 85 86 87
88 89 90 91
En mars 1667, un « maître à danser de Celle » fut logé dix jours : NLA Osnabrück, Rep. 110 I Nr. 493, fol. 28. NLAO, Rep. 110 I Nr. 492, fol. 77 : « Anno 1667. den 7. Martÿ seindt bey mihr eingelogirt zwey Musicanten alß Monsieur La Pieur Undt Mr. Lübeck, Undt geplieben biß den 11. 9bris, seindt 8. Monat, ieder monatlich für Schlaff- Undt Verpflegung ad 1. Thlr – 16 Thlr. Anna Catharina Mehrpoldt Wittibe Kaumers [?]. » BA Osnabrück, St. Petrus, Traubuch 1658-1728, 8 mars 1666, p. 16. BA Osnabrück, St. Petrus, Taufbuch 1653-1711, 10 déc. 1666, fol. 26. BA Osnabrück, St. Johann, Taufbuch 1657-1694, 27 mars 1679, p. 58. AN, Minutier central, XLI-262, 29 avr. 1679 : Association de Pierre Clément, Thomas Duchesne, Louis Picart, Pierre Clerfeuille, Guillaume Lapierre, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, Pierre Picart et Médard-Rose Darcy, tous maîtres joueurs d’instruments et maîtres à danser, pendant un an pour jouer du violon aux fiancailles, noces, soupers, sérénades et faire concert tous les samedis. NLAH, Hann. 76c A Nr. 192, p. 465 : « Frantzösische Musicanten halbjährig alß von Michaelis 1666 biß Ostern 1667 laut befehl dat. des 3. April Ao 1667. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 191, p. 363. NLAH, Hann. 76c A Nr. 192, p. 361 : « Frembde Ausquartierung. 3. den 15. Dito — für den Musicanten Lavigne bis den 20. May, Christoph Keßelhutt. 4. Eodem. Dito — für la Vigne seinen Bruder undt den Musicanten Rabau bis Johannis Baptista demselben Keßelhutt. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 192, p. 364.
– 150 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
chez ce Laforest, de même que René des Vignes qui apparaît juste avant Pâques 1667.92 Claude Pécour et Thomas de La Selle, qui arrivent au début de l’automne, sont logés chez un Allemand, Andreas Vesemann.93 Pendant les quinze premières années de leur activité à Celle, à partir de leur engagement définitif jusqu’en 1680, les musiciens reçoivent chaque semestre une somme d’argent pour le loyer au même titre que tous les autres serviteurs de la cour. La perspective d’une installation définitive semble souvent mettre du temps à s’imposer. Certains des musiciens de Celle se firent construire une maison, indice infaillible qu’ils élisaient leur nouveau pays comme domicile : en 1688, les musiciens Thomas de La Selle et Louis Gaudon reçoivent en même temps que d’autres serviteurs (entre autre le maître des pages Samuel Chappuzeau) une grande quantité de pierres et de tuiles pour construire leurs maisons dans la ville nouvelle (« Neustadt ») qui se trouvait quelques centaines de mètres à l’ouest du château.94 En 1689, Thomas de La Selle et Guillaume Josse reçoivent à nouveau du matériel pour les murs et le toit de leurs maisons.95 Cet emménagement favorisa grandement l’implantation définitive de ces musiciens à Celle, sans « esprit de retour » : aussi bien Thomas de La Selle que Louis Gaudon moururent à Celle, où ils furent enterrés, démontrant ainsi un investissement de leur lieu d’accueil caractéristique d’une migration de rupture. À Dresde, les données sur le déplacement et l’installation des musiciens français sont beaucoup plus rudimentaires. Ils étaient apparemment logés par la cour, ayant leur quartier et partageant parfois leur maison avec d’autres de leurs collègues. À partir de 1724, le personnel français des plaisirs du roi fut apparemment déménagé dans un village qui était connu sous le nom de Französisches Dorf, et qui formait dans la ville de Dresde un véritable quartier français. On avait en fait récupéré les installations créées à l’occasion d’un divertissement pour les convertir en habitations durables.96 Pratique religieuse et identités confessionnelles La question de la pratique religieuse est fondamentale, car elle a des implications non seulement sur la vie quotidienne des musiciens français, mais aussi sur la manière dont nous pouvons comprendre les mobiles de leur migration. Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, la plupart des musiciens français actifs en Allemagne n’étaient pas protestants. Alors que l’exil des huguenots et la formation du Refuge européen occupent une place centrale dans l’historiographie, à la mesure du bouleversement culturel et migratoire européen qu’ils représentent, la plupart des musiciens et comédiens français sont de confession catholique – même à Celle, qui a pourtant été le premier refuge huguenot en terre impériale et a accueilli de nombreux militaires, aristocrates et hommes de lettres réformés grâce à l’action d’Éléonore d’Olbreuse. Parmi la centaine de musiciens que nous avons pu observer, seuls Louis et Charles Gaudon ont abjuré la foi catholique romaine et se sont convertis à la religion réformée, qui était aussi celle de la duchesse Éléonore d’Olbreuse.97 Dans les duchés de Celle et de Hanovre, la cohabitation entre les différentes confessions chrétiennes est excellente, effet de la tolérance religieuse affichée par des souverains éclairés et du pluralisme religieux au sein du personnel de la cour.98 Même si le culte catholique restait interdit 92 93 94
95 96 97 98
NLAH, Hann. 76c A Nr. 192, p. 361-365. NLAH, Hann. 76c A Nr. 192, p. 363-364. NLAH, Hann. 76c A Nr. 213, p. 349 : « May den 17t laut Befehls de dato den 30t Aprilis 1688 dem Hoffbauschreiber Herman Armelung für eine Quantität Mauer- und Tachsteine, so dem Pagen Hoffmeister Chappuzeau, Tappezier La Fontaine, Musicanten Gaudon und la Selle zu Erbauung Ihrer Hauser auf hiesiger Neustadt gnädigst geschenket, bez[ahlet] 646 Thlr, 4 gr, 2 d. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 215, 28 oct. 1689, p. 344 : « für 11000 dach= und 37000 Mauersteine so Ser. Durchl. an den Musicanten de la Selle, Josse, Cammerdiener Caulier, la Perle und Silberdiener Hasen gnädigst verehret laut ord: und quitung bezahlet 300 Thlr. » Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 158. Beuleke, Die Hugenotten in Niedersachsen, p. 133. Gregorio Leti, Abrégé de l’ histoire de la maison sérénissime et électorale de Brandebourg, Amsterdam 1687, p. 346 : « on y fait profession de la Religion du Prince qui est la Luthérienne, mais cependant on ne laisse pas d’y souffrir les Catholiques, & à present aussi les Réformez en considération de Madame la Duchesse ». D’après lui,
– 151 –
Chapitre 3
à Celle, les catholiques pouvaient aller pratiquer leur religion à Hanovre à partir de l’avènement de Johann Friedrich en 1665, puisque la chapelle du nouveau duc converti au catholicisme était desservie par des capucins italiens. La messe était également célébrée quotidiennement dans diverses chapelles privées attachées à des résidences particulières, comme celle de l’ambassadeur impérial à partir de 1678, ou celle du prince Luigi d’Este, colonel au service du duc.99 En toute illégalité, le clergé catholique de la cour de Hanovre venait de temps en temps à Celle pour y célébrer secrètement la messe lors des grandes fêtes, ce qui n’allait pas sans créer des tensions avec la population locale : à Noël 1671, les capucins furent trahis par une chanteuse qui avait assisté à la messe, entraînant une réprimande officielle.100 Confrontés à cette interdiction, les musiciens catholiques faisaient souvent baptiser leurs enfants dans des églises luthériennes, à la chapelle du château ou dans les paroisses de la ville. Les registres baptismaux font ainsi parfois mention d’un baptême pratiqué par un pasteur luthérien et simplement complété, dans ce cas, par le prêtre catholique qui assure les rites complémentaires.101 C’est seulement à partir de 1683 que la messe fut célébrée dans la chapelle privée du résident français, le marquis d’Arcy désormais installé à Celle de manière permanente. Lorsque cette représentation diplomatique prit fin en 1687, les catholiques reçurent l’autorisation de pratiquer à l’extérieur de la ville, dans la maison de Lucas von Buccow, fils illégitime du duc et colonel d’un régiment de dragons, bientôt convertie en chapelle catholique et desservie par un jésuite français installé à Celle.102 Le compositeur, diplomate et évêque italien Agostino Steffani venait régulièrement à Celle pour y assurer les confirmations : il confirme par exemple en 1710 la fille de Thomas de La Selle, déjà âgée de 33 ans.103 Après leur mort, les catholiques étaient enterrés à Hanovre dans un cimetière séparé, situé à l’extérieur de la ville devant la porte Saint-Gilles. Les musiciens français de Hanovre sont tous catholiques à l’exception de Nanon, fille du huguenot Pierre de Falaiseau, ainsi que Pascal Bence, Pinel, La Croix, Bertrand et Maillard sur lesquels nous n’avons pas d’informations. Parmi les vingt-trois musiciens français de la cour de Celle, seuls quatre individus conservent une identité confessionnelle floue : Forlot, Galliard, des Hays et Mignier. Au contraire, certaines familles apparaissent très régulièrement dans les registres paroissiaux catholiques : Philippe La Vigne et Louise Madeleine Pécour, ou encore de Thomas de La Selle et Louise Sinski. D’autres musiciens n’apparaissent que de manière occasionnelle : Jean-François Graep et Philippe de Courbesastre font simplement baptiser un ou deux enfants, le musicien Saint-Amour n’apparaît qu’au moment de sa mort, muni des sacrements de l’Église, tout comme René des Vignes ou Pierre du Vivier. D’autres enfin n’apparaissent que comme parrains ou témoins, ce qui n’est pas un marqueur confessionnel, puisque les parrains peuvent être d’une autre confession que leur filleul.104 La plupart sont néanmoins catholiques : Jean-Jacques Favier, témoin avec René des Vignes et Guillaume Josse du mariage de Thomas La Selle105 et parrain lors d’un baptême à Hanovre en 1679, a été baptisé dans une paroisse catholique à Paris.106 C’est aussi le cas de Denis Le Tourneur, baptisé à Paris dans une paroisse catholique et témoin lors du mariage
99 100 101 102 103 104 105 106
le nombre de réformés à Celle ne dépassait pas 150 et ne nécessitait pas l’érection d’une église particulière, les services se déroulant dans les appartements de la duchesse. Woker, Geschichte der katholischen Kirche, p. 35. Woker, Geschichte der katholischen Kirche, p. 238. Par exemple BAHild, KB Nr. 385, Celle St. Ludwig, Taufbuch 1674-1852, 11 oct. 1715, p. 19 : « NB. In his omnibus a Ministris lutheranis baptizates supplevit ceremonicis ommissas Adm: Rdus Pater Carolus Blanche. » Woker, Geschichte der katholischen Kirche, p. 240-246. BAHild, KB Nr. 388, Celle St. Ludwig, Firmungen 1710-1819, p. 8: « Ludovica La Selle annorum 33 filia Thomae La Selle et Ludovicae Sinski conjugum Matrina fuit Margareta Rousselle dta Marchand ex picardia. » Les parrains de Georg Wilhelm La Vigne, fils de Philippe La Vigne baptisé dans l’église catholique, sont le duc luthérien Georg Wilhelm et sa femme réformée Éléonore d’Olbreuse. Pour d’autres exemples, voir Beuleke, Die Hugenotten in Niedersachsen, p. 146-147. BAHild, KB Nr. 778, Hannover St. Clemens, Traubuch 1667-1711, 24 avr. 1671, p. 4. BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, 3 avr. 1679, p. 76.
– 152 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
de François Valoy et Antoinette Bénédicte de Châteauneuf.107 Guillaume Caillat est témoin lors d’un mariage à Hanovre en 1676 pour lequel l’acte de mariage prend soin de préciser que tous les témoins sont catholiques.108 Comme en France, les musiciens ont le privilège de pouvoir de choisir les parrains de leurs enfants parmi leurs patrons, membres de la haute aristocratie dont l’accès leur resterait autrement impossible. Cependant, ces derniers se font fréquemment représenter par des tiers souvent choisis dans l’entourage direct des parents. Lorsque Philippe La Vigne et sa femme font baptiser leur fils Georges en 1676, ils choisissent ainsi Georg Wilhelm et Éléonore pour parrain et marraine de leur enfant, mais ceux-ci se font représenter respectivement par Jean de Hillaret sieur de Boncourt, membre de la troupe des comédiens français, et Anne Godelet dite La Rivière, également comédienne française. Quand Gilles Héroux fait baptiser son fils Georges, la comtesse de Platen se fait représenter par Marie de Loges, probable parente du musicien Jacques de Loges. Enfin, lorsque Pierre Vezin fait baptiser sa fille Sophie Amélie en 1696, c’est Antoine Desnoyer qui représente le prince Ernst August. La situation confessionnelle est assez similaire en Saxe, où l’immense majorité des musiciens apparaît dans les registres de la chapelle royale catholique. La conversion d’Auguste le Fort ouvrit une période de tolérance plus grande vis-à-vis des catholiques (voir Chapitre 2). Réciproquement, les prédicateurs catholiques de la cour étaient tenus de faire preuve de retenue dans leurs propos et de vivre en bonne intelligence avec les luthériens.109 La cohabitation n’était cependant pas toujours sans difficulté : en 1726, le meurtre du pasteur luthérien Hermann Joachim Hahn par un soldat catholique provoqua un véritable scandale qui mettait au jour la précarité de cet équilibre confessionnel. Du 21 au 29 mai 1726, la ville fut le théâtre d’un violent soulèvement anticatholique durant lequel plusieurs catholiques de la cour furent pris à parti par la population luthérienne de la ville. Le comédien français Poisson raconte dans une lettre à Pierre de Gaultier qu’il fut pris pour un prêtre, et dû subir plusieurs vexations pendant cet épisode (Tableau 3.1). S’il raconte plaisamment l’erreur de ses attaquants, qui crurent reconnaître la tonsure ecclésiastique dans sa calvitie et une soutane dans son costume de Crispin, le choc n’en est pas moins réel : Poisson plaide d’ailleurs pour une bonne entente entre les différentes confessions, et souligne la modération dont ont fait preuve les prédicateurs luthériens en commentant cet évènement. Tableau 3.1. Lettre du comédien Poisson à Pierre de Gaultier, non datée (vers mai 1726). HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3349/1 Monsieur L’honneur que vous me faittes de me plaindre est un adoucissement au mauvais traittement que j’ay receu, et le contentement que j’ay de voir les honestes gens s’interesser a mon avanture, me fait presque oublier tout le mal que j’ay eû. Vous souhaitez, Monsieur, que je vous fasse un petit détail de la chose, je le ferai en honneste homme, et mesme sans passion, et le plus abrégé qu’il me sera possible. Comme vous avez apparemment vû des Relactions exactes de ce Tumulte, je ne vous parlerai que de ce qui me regarde, il est constant que l’insolence de la Canaille a esté à l’excès, les honestes gens n’ont aucune part a cette affaire. La Conduite du Conte Vackerbart a esté admirable, un de ces coquins, ou malins tué ou blessé, auroit causé peut estre la mort de cent honnestes gens ; l’hotel de ville a fait aussi son devoir ; les ministres et les Predicateurs Lutheriens ont parlé dans tous leurs discours publics et particuliers, en chretiens, et ont fulminé contre les violences de cette canaille. C’est une chose que tous les catholiques doivent avoüer et loüer amplement. 107 108 109
BAHild, KB Nr. 778, Hannover St. Clemens, Traubuch 1667-1711, 24 avr. 1693, p. 109. BAHild, KB Nr. 778, Hannover St. Clemens, Traubuch 1667-1711, 11 juin 1676, p. 34-35 : « Guilielmus Gaillat de Saint Fargeau Burgundia », et plus loin « qui testes omnes catholicae sunt religionis. » Voir par exemples le règlement de la chapelle royale dans Theiner, Geschichte der Zurückkehr, vol. 2, p. 75-78 : « Veut et ordonne le Roy que l’exercice de la Religion soit entierement libre aux Catholiques en sorte qu’ils ne soient aucunement troublés et molestés ». Réciproquement, dans la chapelle catholique, « l’on se gardera de ne jamais rien dire contre les Protestants au contraire on priera pour eux et l’on en parler tousjours avec charité leur donnant toutes les marques d’une véritable fraternité. »
– 153 –
Chapitre 3
L’inimitié qui Règne entre les deux partis n’y rend pas de l’honneur tous les droits amortis dit Corneille dans Pertorius, ainsi les differens sentimens De Religion, ne doivent point exclure l’equité et le bon droit, et on doit se souvennir toujours qu’on est chretien. La canaille dans tous les Pays est canaille, ce sont gens sans raison, sans éducation, qui n’ont rien à perdre, et qui saisissant la moindre occasion de trouble, l’augmentent, dans l’esperance d’en tirer quelque avantage apres que la Populace eut cassé les vitres de notre maison jusques au 3.me étage, où est logé Prevot, les magistrats nous envoierent une garde Bourgeoise pour nous conduire a l’hotel de ville. Ma femme nous recommanda a elle de la maniere la plus suppliante, nous sortismes de la maison, au milieu de la garde qui croisait les armes sur nos testes mais malgré cette précaution, un homme par dessus l’epaule d’un garde m’arracha ma Perruque ma teste parut à nud, et comme je suis chauve ils me prirent pour un Prestre, et me donnerent tant de coups de canne sur la teste, et partout, malgré les gardes, qui si javois eû plus loing à aller, j’aurois esté assommé, et n’aurois pas l’honneur de vous écrire aujourd’hui. Prevot qui est petit, à l’abri de ma corpulence esquiva bien des coups, pour moi qui suis gouteux, et assez mal sur mes jambes, je n’en perdis pas un seul. Arrivé a l’hotel de ville, je me trouvai heureux de n’avoir pas esté assommé sur la Place. Ils m’ont pris pour une Prestre, et m’ont Regalé en Evesque, et en homme qui a 300 mille Livres de Rente des bienfaits de l’Eglise Romaine. Je n’ay senti mes maux vivement, que 4 ou 5 jours apres, et je n’ay pas encore bien l’usage de tous mes membres, et mesme quelques coups receus sur la main, et le bras, ne me permettent pas encore d’écrire aisement. Voila ce qui m’est arrivé, et j’ay l’honneur Monsieur, de vous dire la chose, comme elle s’est passée. Dans le temps que nous estions a l’hotel de ville, ces mitins revinrent chez nous chanter pouilles a ma femme, sous pretexte qu’elle avoit caché un Prestre, ils firent ouvrir, ou enfoncerent toutes les portes de la maison depuis la Cave jusques au colombier, briserent une grande armoire a coup de hache, sur ce qu’ils virent un habit de Crispin, ils conjecturerent que cestoit un habit de Prestre, et voulurent absolument qu’on leur en livrat un. Ils vinrent par deux fois à la charge avec la mesme rage. Ma femme a souffert tout ce qu’on peut souffrir d’une canaille insolente, outre le degat de la maison, Prevot a perdu, un habit de theatre brodé en or, et deux Epées d’argent qui vallent l’une portant l’autre 50 écus. L’hotel de ville a pris conoissance de tout cela, et a fait arrester quelques uns de ces coquins, que ma femme connoissoit, et qui estoient aussi connus de ma servante. Cette lettre est fort precipitée, mais dans quelque temps je me donnerait l’honneur décrire a Mgr. Le Nonce. J’ay mesme commencé ma lettre ; mais comme elle est badine (car un homme de Theatre pris pour un Prestre est matiere à badiner) je veux attendre et laisser passer quelques temps. La Plaisanterie sieroit mal à present : Apres tout Monsieur il m’est permis de rire de mes coups de Baton ; quoiquil en soit je ne ferai rien sans votre avis ; et je vous supplie de me le faire sçavoir. Je suis avec le Zele le plus Respectueux Monsieur Votre tres humble et tres obeissant serviteur Poisson
Faveur, cabales, patrons : le monde de la cour Les relations des musiciens français avec l’administration curiale et le monde de la cour n’étaient pas toujours faciles. L’usage du français ne semble pas avoir constitué un obstacle, puisque les Français semblent communiquer exclusivement dans leur langue maternelle avec leurs interlocuteurs allemands, au moins par écrit. Les quelques lettres adressées en allemand sont toujours calligraphiées (et sans doute traduites) par un scribe officiel, jamais par les musiciens eux-mêmes. Aussi, quand Magdalena Sibylla, la duchesse de Württemberg, édicte en 1684 des règles pour le bon fonctionnement de la Hofkapelle, elle promulgue deux versions du même document, en allemand et en français, sans doute par égard pour les musiciens français engagés en 1683.110 Les différences culturelles demeurent pourtant importantes et les conflits ne peuvent pas toujours être évités. La cour est souvent dépeinte par les musiciens comme un milieu sans pitié, dans lequel 110
Owens, The Württemberg Hofkapelle, p. 14.
– 154 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
les querelles vont bon train et ne pardonnent pas toujours. Daniel Danielis donne ainsi une image assez sombre du milieu dans lequel il évoluait, après avoir été privé de son droit de commensal à la table du maréchal de la cour de Güstrow : La table de Mons. le Marchal m’at este donnée, table ordonnée à tous maistres de chapelle, et apres trois quart d’ans l’on me la faict quitter et conséquemment tourner l’honneur que j’en avoit reçeu en mespris ; j’en parle par experience comme d’une affaire qui m’at faict rougir dans des occasions, et at donnes sujet en ville de croire que S.A.S. ne se soucioit plus de mes services. Car vous sçavez vous mesmes que sur la moindre chosse qui se faict a la court il ne manque jamais des chicaneurs.111
Si la dénonciation des intriguants et des chicaneurs constitue un lieu commun inlassablement ressassé par tous les acteurs de la cour pour asseoir leurs demandes, elle trahit aussi la difficulté des musiciens français à évoluer dans un milieu dont ils ne maîtrisaient pas tous les codes. À la tête d’un ensemble composé de Français et d’Allemands, Danielis doit ainsi faire face à une vague de révolte de la part de certains musiciens qui lui reprochent sa grossièreté et le caractère humiliant de ses commentaires. En décembre 1662, l’organiste Albert Schop, le chanteur Hans Christoph Sparmann et le musicien Augustin Pfleger déposent une plainte officielle contre le Kapellmeister en raison de son langage et de son comportement, ce qui amène l’administration à procéder à un interrogatoire contradictoire et à une reprise en main de la chapelle.112 La cabale menée contre Jean-Baptiste Volumier par ses collègues de la Hofkapelle de Berlin offre un superbe exemple d’intrigue de cour, qui mêle en un cocktail explosif accusations de blasphème, différences confessionnelles, lutte pour la faveur du souverain, et concurrence entre réseaux de protecteurs (voir Chapitre 1). Les actes mentionnent à plusieurs un mystérieux « patron » qui aurait cherché à protéger Volumier par tous les moyens et à étouffer les accusations portées contre lui. Il s’agissait d’accusations d’autant plus lourdes qu’elles étaient proférées à l’encontre d’un fonctionnaire haut placé dans la hiérarchie curiale, Christian Grabe, conseiller de la cour (« Hofrat ») et second secrétaire des emprunts (« Lehnssekretär »).113 Volumier ne manqua pas de mettre ces accusations sur le compte des intrigues habituelles de la vie de cour (« Les persécutions que mes Ennemis m’ont faites par leur envie et malice en Inventant contre moy certains discours pour me charger de Blasphème, et produisans des témoins qui sont mes Ennemis jurez, de sorte que par les ménaces qu’ils ont faites de me faire arrêter, j’ay été obligé de m’absenter ») ni de protester de sa ferme intention de rentrer dans le droit chemin (ces déboires lui ayant « fait former le dessein que j’ay de m’instruire des véritez Evangéliques et d’embrasser le Religion Réformée »).114 La faveur royale continua néanmoins de lui être assurée, puisqu’un saufconduit lui fut accordé pour passer en Saxe et échapper aux accusations.115 Même si les mobiles qui poussèrent les collègues de Volumier à porter ces accusations et à insister pour qu’un procès ait lieu sont probablement multiples, il faut noter que l’un d’entre eux, Gottlieb August Petzold, occupait en plus de son emploi de musicien les fonctions d’avocat à la cour, et devait donc être bien renseigné sur les procédures judiciaires et les risques encourus.116 Les conséquences pour les six musiciens qui témoignèrent furent très lourdes, puisqu’ils perdirent tous leur emploi. Une liste de personnel de la Hofkapelle dressée en janvier 1708 par le responsable de la musique de la chambre, le Kammerherr Johann Wilhelm von Tettau, fait suivre les noms de Pepusch, Wiedemann et
111 112 113
114 115 116
LHA Schwerin, 2.12-1/26-14 Hofpersonal Nr. 12. Lettre de Daniel Danielis à Gustav Adolph, non datée. La dernière phrase est soulignée dans l’original. LAH Schwerin 2.12-1/26-14 Hofpersonal Nr. 45. Voir par exemple le rapport rédigé en 1711 par Gottlieb August Petzold, cité Chapitre 1, note 137. Sur Christoph Grabbe, cf. Peter Bahl, « Die Berlin-Postdamer Hofgesellschaft unter dem Großen Kurfürsten und König Friedrich I. Mit einem prosopographischen Anhang für die Jahre 1688-1713 », in : Im Schatten der Krone. Die Mark Brandenburg um 1700, dir. Frank Göse, Postdam 2002, p. 31-98, ici p. 95. GStA PK, I HA Rep. 47 Nr. 20a. Lettre de Jean-Baptiste Volumier à Friedrich I, sans date. GStA PK, I HA Rep. 47 Nr. 20a : « Salvus Conductus für Voulmier », 28 mai 1707. Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 181.
– 155 –
Chapitre 3
Lehmann de la mention : « disgraciés à cause de l’affaire Volumier ».117 Seul Wiedemann fut réintégré dans les rangs de la Hofkapelle peu de temps après son renvoi.118 L’affaire Volumier fait apparaître le rôle crucial des protections intermédiaires et la constitution de réseaux de patronage informels qui traversaient toutes les strates de la cour. Certaines personnalités occupant des fonctions importantes à la cour et appartenant au cercle rapproché du souverain, avec qui elles pouvaient être en contact quotidien, sont en mesure d’offrir une protection efficace et se trouvent donc particulièrement sollicitées. Le comte Jakob Heinrich von Flemming, l’une des personnalités les plus influentes de la cour de Saxe, gouverneur de la résidence de Dresde en 1707 puis gouverneur de Saxe en 1717, était une cible de premier choix. Lorsque le chanteur français Abel apprend qu’Auguste le Fort recrute des musiciens français en 1709, il s’adresse directement au comte dont il avait fait la connaissance lors d’un premier séjour à Dresde. Tout en insistant sur le fait que l’intervention du ministre peut « faire tout reussir », il affirme aussi pouvoir être recommandé par le musicien François Le Riche, déjà en poste à Dresde.119 Flemming lui renvoie une réponse très courtoise et conseille au musicien de se rendre directement sur place pour faciliter ses affaires : Je me ferai un plaisir de vous rendre service, et sur tout dans ce que vous souhaitez de vous établir ici. Ce seroit assûrement une bonne acquisition que nous ferions, que celle d’un homme de votre capacité. Comme je ne fais que de recevoir vôtre lettre, je n’ai pas eu encore occasion de parler en vôtre faveur au Roi ni au Grand Marechal. Je ne manquerai pas de le faire au plutôt. Je vous dirai cependant qu’à mon avis vous feriez bien de venir ici avec Mr. le Riche, parce que les affaires se font toujours beaucoup mieux lorsqu’on est sur les lieux.120
Si cette démarche ne semble pas avoir aboutit, on note cependant que d’autres artistes français entretenaient une correspondance personnelle régulière avec certaines personnalités haut placées de la cour qui étaient aussi leurs supérieurs hiérarchiques, et à qui ils avaient donc affaire pour la gestion des affaires administratives courantes. Le comédien François de Tourteville adresse ainsi une épigramme au comte Flemming depuis Hanovre, pour le féliciter de sa nomination comme gouverneur de Saxe.121 Le maître de langue Charles Henri de La Touche, au service personnel de Flemming, le prie de le recommander auprès du comte Wackerbarth, qui était aussi (nous l’avons vu) une des personnalités importantes de la cour pour obtenir un poste à l’école militaire qui était en train d’être créée.122 Le baron Pierre de Gaultier, directeur des plaisirs à partir de 1727, reçoit 117 118 119
120 121
122
GStA PK, I. HA Rep. 36, Nr. 2432 : « NB. diese beyde sind wegen der volumÿrschen Händeln disgratÿret. » Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 183. Lettre de Jean Abel à Jakob Heinrich von Flemming, La Haye, 10 janv. 1709. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 679/2, fol. 3-4 : « Pardonnez la liberte que je prend de saluer Vostre Exelence de mes tres humbles respects et de remercier vostre exelence de touttes les honneurs et generositees qui la plu me faire a dresde ; Le Roy, Et Monseigneur le Grand Marechall estoit party avant mon Arivée ; C’est ainsy en mon devoir Monseignieur que je retourne la lettre de Vostre Excelence et la supplie de me honnorer de sa protection aux prest du Roy ; je suis informes que Sa Majeste a donne ordre de faire venire des voix a sa cour ; sy mes pettits services pouvoit estre agreable a Sa Majeste je serez heureux, je scay que Vostre Exelence peut tout ; une seulle parolle a Monseignieur le Grand Mareschall et a Madame la Countesse Monseignieur qui a fait l’honneur de mentendre et dont la generosite ma fait un beaux present peut faire tout reussir, Monsieur Le Riche est icy prest a partire ma promis d’escrire en ma faveur, je prie tres humblement l’honneur des ordres de Votre Exelence […]. » Lettre de Jakob Heinrich von Flemming à Jean Abel, Dresde, 29 janv. 1709. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett. Loc. 679/2, fol. 2. Lettre de François de Tourteville à Jakob Heinrich von Flemming, Hanovre, 26 déc. 1717. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 710/8, fol. 152 : « A Son Excellence Monseigneur le Comte de Flemming Stadhouder de Saxe. Epigramme. Le Roy, pour se representer | Vous a nommé son Stadhouder, | Chacun admirant sa justice, | applaudit a ce juste choix ; | a ma Muse soyés Propice, | Souffrés qu’elle y mesle sa voix. » Lettre de Charles de Tourteville à Jakob Heinrich von Flemming, Dresde, 20 mai 1721. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 710/8, fol. 150 : « Ayant en quêque Manière l’honneur d’être au Service de vôtre Excellence, par le choix, qu’elle a fait de moi, pour enseigne Mr le jeune compte de fleming ; je prends la liberté Monseigneur d’êcrire ces lignes à vôtre Excellence, pour la prier tres-humblement, de vouloir avoir la bonté, de me recommander à Mr le Compte de Vackerbard, en ce qui conserne l’emploi de Maître de langue de Mrs les Cadets. »
– 156 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
également la correspondance personnelle d’artistes.123 Le comédien Clavel le charge de sonder le roi sur l’engagement de nouveaux comédiens, tandis que l’actrice Detrez lui présente ses vœux de bonne année et lui souhaite un prompt rétablissement, visiblement dans le but de renouer contact après une réprimande qu’elle avait reçue.124 Les contacts personnels et les relations informelles entre les musiciens et leurs protecteurs pouvaient parfois prendre des formes moins contrôlées : Éléonore-Catherine de Deux-PontsCleebourg, cousine de la reine Christine et sœur du roi Charles X de Suède, entretint une liaison avec un musicien français du nom de Bechon, attaché à la troupe française de théâtre d’Antoine de Beaulieu. Cette liaison se prolongea jusqu’à six semaines avant le mariage de cette dernière avec Frederik von Hesse-Eschwege en 1646, alors qu’elle était déjà enceinte du musicien. Cette histoire d’amour romanesque est documentée entre autres par une série de lettres en français que le musicien envoya à la princesse après leur rupture et son éloignement à Paris, accompagnées de pièces de musique pour le luth.125 Même si aucun témoignage comparable ne survit pour notre période, cela montre bien que la négociation d’une relation de patronage était pour les musiciens un enjeu à la fois crucial et délicat. « L’esprit de retour » Confrontée à une vague sans précédent de départs de comédiens vers les « pays étrangers », la Maison du roi commanda en 1763 un rapport au duc de Praslin, dans lequel il notait que les comédiens « ont ordinairement l’esprit de retour, et qu’en effet nous les voyons presque tous revenir en France avec la petite fortune qu’ils ont faite dans le pays étranger.126 » La prévalence de cet « esprit de retour », ou au contraire son absence – quelqu’un qui part « sans esprit de retour » le fait sans intention de revenir – constitue donc une question essentielle et fait l’objet d’un souci constant de la part des négociateurs et des employeurs. Ainsi Cronström note-t-il à propos des acteurs de la troupe de Rosidor : « L’on ne peut pas oster à ces gens la l’incertitude s’ils se plairont et s’acomoderont en Suede ou non.127 » Lorsque le prince de Saxe Friedrich August cherche à faire venir ses musiciens italiens à la cour de Dresde, il répond à Auguste le Fort qu’on ne peut pas les embaucher tout de suite pour trois ans, car cela risquerait des les effayer. Il faut donc se résoudre à les employer d’abord pour un an, en dépit de l’investissement initial conséquent que représentent le financement du voyage et divers frais de lancement incompressibles. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’on pourra tenter de les retenir plus longtemps en les traitant bien et en leur ôtant tout esprit de retour : La premiere année etant passée on pourra les arreter plus longtems, en les traittant bien, et lorsqu’ils n’auront pas sujet de se plaindre. Mais si on leur proposoit à present, de rester 3. ans, Mgr le Prince croit que celà les intimideroit, specialement ceux qui ne sont jamais sorti d’icy, et qui ont de la peine à quitter leur Paÿs.128
Mais l’esprit de retour n’est pas seulement la pierre de touche d’une migration de maintien par opposition à une migration de rupture.129 En effet, le retour n’est pas toujours volontaire : le décès des principaux mécènes de musique française et l’arrivée de nouveaux souverains signifiait très souvent le renvoi des musiciens en place et l’obligation de quitter incessamment le territoire. La mort du duc de Celle Georg Wilhelm en 1705 eut ainsi pour conséquence la dissolution immédiate de la Hofkapelle et le renvoi de tous les musiciens français, à quelques exceptions près. Il en va de même à la mort d’Auguste le Fort, dont le successeur réorganise profondément la musique 123 124 125 126 127 128 129
Sur la nomination de Gaultier, voir Fürstenau, Zur Geschichte, vol. 2, p. 163. Lettre de N. Destrez à Pierre de Gaultier, sans date. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3349/1. Fogelberg et Schildt, « L’Amour Constant et Le Ballet de Stockholm », p. 725-726. Lettre de M. le duc de Praslin concernant les sujets des spectacles qui veulent passer dans les Pays étrangers, 16 déc. 1763. Cité par Markovits, Civiliser l’Europe, p. 62-63. Cité par Raul Markovits, communication orale, Rome, 30 janv. 2019. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 50. Rosenthal, « Maintien/rupture : un nouveau couple pour l’analyse des migrations ».
– 157 –
Chapitre 3
en fonction de ses propres options musicales, très différentes de celles de son père. Dans ces deux cas, les musiciens doivent bon gré mal gré rentrer en France. En outre, l’esprit de retour n’est pas seulement un horizon lointain et définitif : il constitue bien davantage un trait permanent de la migration des artistes, les musiciens conservant de multiples attaches dans leur pays d’origine, qu’ils décident finalement de rentrer s’y installer ou non. Une mobilité permanente En dépit de son ampleur géographique, la migration des musiciens français n’est pas un départ sans retour mais plutôt une sorte d’état permanent de mobilité. La famille d’Élie Jemme et Marguerite Robeau réside en même temps à Paris et à Osnabrück, impliquant de nombreux allers-retours entre les deux villes. L’absence de regroupement familial semble avoir concerné plusieurs artistes français : en 1729, la comédienne Duclos en poste à Dresde demande un congé de trois mois pour aller rendre visite à son mari qui était à Munich.130 D’autres personnalités comme Guillaume Lapierre apparaissent à seulement quelques semaines d’intervalles dans les archives des deux pays. Charles de La Selle, le fils du musicien et maître à danser Thomas, semble avoir étudié la danse à Paris alors que son père était actif à Celle et Lüneburg.131 La comptabilité de Celle donne un éclairage très intéressant sur ce phénomène de mobilité permanente. En avril 1669, Thomas de La Selle était en déplacement en France au moment d’un versement de salaire à la Saint-Michel, fin septembre : il n’avait pas pu percevoir son argent pour le Stubenheuer qui lui est versé rétrospectivement.132 On constate également de nombreux déplacements entre Celle et Hanovre : des frais sont payés pour transporter les musiciens en diligence133, pour les loger sur place et pour les dédommager de leur déplacement.134 Réciproquement, plusieurs musiciens de Hanovre séjournent à Celle et reçoivent des gratifications équivalentes.135 Cette mobilité pouvait avoir des fins strictement professionnelles. Ainsi le musicien et maître à danser Favier reçoit-il le 6 août 1677 cent Thaler en frais de voyage (« Reisekosten »).136 En fait, il se rendait à Paris pour une raison bien précise, puisqu’il devait participer à la création de la tragédie en musique Isis de Lully à l’Académie royale de musique : le livret original de l’œuvre, donnée le même mois, mentionne « Favier de Zell » à deux reprises parmi le personnel dansant, en compagnie de plusieurs autres membres de sa famille et de collègues de renom.137 En 1679, Denis Le Tourneur, Claude Pécour et Philippe La Vigne reçoivent à leur tour une gratification pour leur voyage à Paris (« behueff Ihrer Reise nach Paris »), probablement pour aller recruter de nouveaux instrumentistes.138 Ce voyage porte ses fruits l’année suivante avec l’arrivée de cinq nouveaux hautbois. En 1683, Pierre Maréchal touche 80 Thaler pour ses voyages.139 En mai 1693,
130 131 132 133 134 135 136 137
138 139
Lettre de Pierre de Gaultier à Auguste le Fort, Dresde, 15 juin 1729. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3349/14, fol. 5-6. Voir ci-dessous note 155. Gustav Fock, Der junge Bach in Lüneburg 1700 bis 1702, Hambourg 1950, p. 47. NLAH, Hann. 76c A Nr. 194, p. 484 : « Thomas la Selle ein gantzen Jahr, weil er eine Zeit lang nach Frankreich gewesen und daher vergangen Michaelis nicht bezahlt worden. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 194, 7 août 1668, p. 495 : « die Musicanten in einer Kutsche nach Hannover zuführen. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 92, p. 204 et 225. NLAH, Hann. 76c A Nr. 214, p. 364 : « Vermöge Serenissimi Durchl. gnädigster ordre de dato 26 Febr: 89 denen fürstl. Hannoverschen Italianischen Musicanten zur Gnaden Verehrung in verschiedenen Gülderman Medaillien nebst Lage sind Müntzkosten bezahlet. 247 Thlr. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 217, 10 mars 1682, p. 370. NLAH, Hann. 76c A Nr. 203, p. 343. Un dénommé « Favier de Zell » apparaît dans la suite des Parques puis parmi quatre Égyptiennes. Avant sa création au Palais Royal en août, la tragédie avait été jouée devant la cour le 5 janv. 1677 à Saint-Germainen-Laye. Un déplacement de Favier à Paris n’est pas documenté pour cette période. Voir Harris-Warrick et Marsh, Musical Theatre at the Court of Louis XIV, p. 22. NLAH, Hann. 76c A Nr. 205, p. 337. Le troisième musicien, nommé « Henry » est identifiable à Le Tourneur, puisqu’un autre document lui donne un surnom similaire. NLAH, Celle Br. 44 Nr. 74, p. 93 : « Musicant Tourneur genandt Harry ». NLAH, Hann. 76c A Nr. 209, p. 313 : « dem Hautbois Marechal zu seinen Reisen 80 Thlr. »
– 158 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
l’agent Stechinelli reçoit de l’argent pour couvrir les frais engagés à Paris, Bruxelles et Anvers à l’occasion du voyage entrepris depuis Paris par le musicien des Hays, qui venait d’être engagé par la cour de Celle.140 Enfin, Philippe de Courbesastre se trouve à Paris le 21 juin 1700 pour signer l’acte de vente d’une maison à Sceaux et représenter ses neveux, les enfants de Claude Pécour, pour leur part d’héritage. L’acte notarié permet de savoir qu’il n’avait pas gardé de résidence permanente à Paris, mais qu’il logeait temporairement chez un particulier, « estant de present a paris logé rue St. Denis paroisse St Sauveur en la maison du sieur Léger maître Ecrivain ».141 La résidence à Celle, Osnabrück et Hanovre était donc assortie pour beaucoup de musiciens d’un retour régulier au pays. Les Français actifs à Dresde, à Berlin ou à Varsovie étaient beaucoup plus éloignés de leur lieu d’origine et de ce fait moins susceptibles de rentrer régulièrement, mais certains conservaient néanmoins des liens soutenus et durables avec Paris. Louis André publie, presque dix ans après avoir quitté la France, deux airs dans les Meslanges de musique latine, françoise et italienne publiés par Jean Baptiste Christophe Ballard.142 Pierre-Gabriel Buffardin se produit au Concert spirituel à deux reprises en 1726 et 1737.143 À partir des années 1740, les « Pensionnaires du Roi de Pologne » se produisent assez régulièrement à Paris : en 1744, la danseuse Catherine André se produit à l’Académie royale de musique sur le Caprice de Jean-Féry Rebel.144 En 1753, le Concert spirituel accueille Florio Grassi, présenté comme un élève de Buffardin.145 Dès 1748, ce dernier mentionnait dans une lettre « le fils de Florio Grassi ageé de 10 ans » comme étant son élève depuis trois ans.146 Plusieurs musiciens passent enfin d’une cour à l’autre, changeant régulièrement d’employeur tout en restant dans l’espace germanique. Jean Maillard, né à Bruxelles, demeure à Hanovre dès 1691 et y épouse Anne Éléonore La Fleur la même année.147 Un certain « Maillart » était déjà présent dans le Ballet des Amours dansé en février 1674 à Celle.148 Un individu du même nom avait été engagé en octobre 1686 comme bassoniste à la Hofkapelle de Darmstadt.149 Il s’agit probablement dans les trois cas du même individu. Un certain Mignier est d’abord actif à Celle en 1684 avant d’apparaître dans les comptes de la cour Hanovre entre 1698 et 1701.150 Il est sans doute identique
140 141 142
143
144 145 146 147 148 149 150
NLAH, Hann. 76c A Nr. 218, p. 444 : « 12. May [1693] den 30. dem H. Dorsten Stechinelli für in Paris, Brüßel und Antwerpp bezahlte Geldern, wegen des Musicanten des Hays seiner anhero Reise aus Paris nebst Lagio und Wechsel hin wieder bezahlet. » AN, Minutier central, XXXI-20, 21 juin 1700. Meslanges de musique latine, françoise et italienne, Paris, Ballard, hiver 1729, p. 10-21. Les deux duos sont classés dans la partie consacrée à la musique française : un « Duo bacchique, de Monsieur André, Maître de Chapelle de l’Electeur de Saxe » (chanson à boire pour dessus et basse) et un « Duo, de Monsieur André, Maître de Chapelle de l’Electeur de Saxe ». Mercure de France, avril 1726, p. 844 : « Le Dimanche des Rameaux & tous les jours de la semaine, excepté le Vendredi-Saint, on chanta differens Motets, entre autres le Miserere de M. Laloüette, Beati omnes de M. Desmarets, & omnes gentes de M. Courbois. Le sieur Buffardin, originaire de Provence, & Musicien du Roi de Pologne, a joüé plusieurs fois des Concerto sur sa Flute Traversiere, avec toute la précision, la vivacité & la justesse imaginable, de même que le sieur Guignon, sur son Violon. » Cf. Pierre, Histoire du concert spirituel, programmes 17 et 227. Mercure de France, nov. 1744, p. 172 : « Mlle André, Pensionnaire du Roi de Pologne, mais Françoise de naissance, a obtenu à Paris autant de suffrages qu’à Dresde & qu’à Varsovie. On a remarqué sa legereté & la science de ses Pas dans les Caractères de la Danse, & dans le fameux Caprice de M. Rebel » Annonces, affiches et faits divers, mercredi 7 févr. 1753, p. 24 : « M. Florio Grassy, de la Musique du Roi de Pologne Electeur de Saxe, joua un Concerto de Flute (M. Florio est Elève de M. Buffardin). » Lettre de Pierre-Gabriel Buffardin à Auguste III, Dresde, 9 mars 1748. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/5, fol. 178. BAHild, KB Nr. 778, Hannover St Clemens, Traubuch 1667-1711, 17 nov. 1691, p. 96. Balet des amours de Mars et de Vénus, Celle, 9 février 1674, non paginé. Noack, Musikgeschichte Darmstadts, p. 157. NLAH, Hann. 76c A Nr. 210, p. 460 : « Mignier Laut Befehlß dat: den 29. 9br: 1684 und 28 Xbr: 1685, 112 Thlr Besoldung, 24 Thlr Haußwirth, 10 Thlr Holtzgeldt, 4 Thlr 21 gr für Deputat Licht. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 118, p. 314 : « Migniè laut gnädigsten Befehls sub dato den 5. jan: 1699 von Mich. 1698 an jährlich 115 Thlr. kommen also biß Ostern 1699 halbjährig anhero, 57 Thlr 18 gr. »
– 159 –
Chapitre 3
au « Johann Minje ou Migne » actif à Schwerin entre 1703 et 1705 comme musicien de la cour et hautboïste.151 François Adam Beauregard ne resta que six mois à Celle comme hautboïste, avant de gagner la cour de Berlin où il occupait, trois mois plus tard, les mêmes fonctions.152 Enfin, Henri des Hays apparaît dans un ballet donné en mars 1671 à la cour de Güstrow, avant d’être engagé en 1692 à la cour de Celle.153 François Biotteau, engagé comme violoniste à Weimar quelques mois après le départ de Johann Sebastian Bach en avril 1718, rejoint également la musique de Saxe en 1731.154 Revenir au pays En dépit de cette mobilité permanente, les musiciens n’étaient pas libres d’aller et venir comme ils le voulaient : ils devaient toujours obtenir une autorisation avant de quitter la cour, certains contrats d’engagement précisant même la nécessité de demander la permission du Kapellmeister avant tout déplacement sous peine d’être renvoyé. Lorsqu’ils souhaitent s’absenter, ils font une demande de congé éventuellement accompagnée de la promesse écrite d’un retour au terme fixé.155 Cette contrainte pouvait devenir particulièrement inconfortable lors de conflits armés ou de retards importants dans les paiements, contraignant certains musiciens à demander qu’on accepte leur démission, voire même à prendre la fuite. La proximité de villes libres, dans lesquelles les forces armées des princes ne pouvaient pas pénétrer et qui échappaient ainsi à leur pouvoir, constituait alors un atout non négligeable. Plusieurs musiciens de la cour de Güstrow prirent ainsi la fuite en disparaissant littéralement dans les métropoles voisines de Lübeck et Hambourg. Les enfants de chœur Leonhard van der Houte, Nicolas Chauveau et Jean Antoine Ravissart, tous les trois originaires du Brabant et engagés à la cour de Güstrow, s’enfuirent en 1674. Le duc Gustav Adolph écrivit aussitôt à la police de Lübeck pour demander de faire rechercher les jeunes chanteurs et de les ramener à Güstrow. Quatre jours plus tard, le conseil de la ville répondit qu’après des recherches, conduites notamment auprès des musiciens, il était apparu que Leonhard van der Houte avait été aperçu à Lübeck quelques jours auparavant, mais qu’il s’était ensuite rendu à Hambourg où il était désormais hors de portée.156 Servais Ferdinand Le Roy, alors âgé de 24 ans, prit aussi la fuite quelques mois après son arrivée en passant par Hambourg. Né à Termonde en 1654, il avait été engagé pour la cour de Güstrow à l’âge de 25 ans par le maître de chapelle Daniel Danielis. Ce musicien, parfois aussi appelé Servatius Ferdinand von der König, avait été formé à Gand comme enfant de chœur avant d’aller étudier à Louvain en 1675.157 Aussitôt après sa disparition, une lettre fut envoyée à un agent de Hambourg pour tenter de retrouver le musicien dans la ville, en le priant
151 152 153 154 155
156
157
Meyer, Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, p. 45. Beauregard quitta Celle en septembre 1681, il fut engagé en décembre 1681 à Berlin : Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 172. Voir aussi NLAH, Hann. 76c A Nr. 207, p. 461 : « Beauregard 68 Thlr [...] Ist vom 1/2 Jahre biß Mich: 1681 aber er weg gezogen. » Die Lust der Music, 1671. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/5, fol. 223. Voir par exemple la lettre de Pierre de Gaultier à Auguste le Fort, Dresde, 15 juin 1729. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3349/14, fol. 5-6 : « Comme dont il n’y aura rien a faire pour les plaisirs pendant quelque temps, la Duclos souhaitteroit profiter de cet intervalle, pour aller voir son mary qui est à Munich, et pour cela elle supplie Vôtre Majesté de luy accorder un congé pour trois mois. Mais afin d’avoir de quoy s’opposer à la volonté de son mary, supposé que la fantaisie luy prit de vouloir la retenir, elle me laisserait un Revers, par lequel elle s’engageroit expressément, et dans les termes les plus forts, de revenir à Dresden au bout des trois mois de congé. » LHA Schwerin, 2.12-1/26-7 Hofkapelle Nr. 7. Lettre du maire et du conseil de Lübeck au duc Gustav Adolph, Lübeck, 14 déc. 1674 : « Nuhne haben wir mit fleiß beÿ dieser Stadt Musicanten und einigen anderen Leibhaberen solcher Kunst laßen erkundigen, ob erwehnter Leonhard von der Hute sich alhir aufgefalten hette, oder auch noch auffhielte, Wir aber vernehmen, das ein solcher Knabe kurtz verwichener Zeitt, zwar alhier gewesen, sich aber nacher Hamburgk Verfüget hette, das Wir also nichts mehrers beÿ der sache Wißen zu thun. » Rudolph Rasch, « Konink, Servatius de », in : MGG online.
– 160 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
de mener ses recherches avec discrétion.158 Dans sa réponse, l’agent éclaire bien les difficultés légales auxquelles pouvait se heurter un tel procédé : s’il arrêtait lui-même le musicien, l’extradition allait être plus difficile à obtenir que si le duc écrivait directement aux autorités de la ville.159 L’affaire s’arrêta là et le jeune musicien ne fut pas retrouvé. Il poursuivi néanmoins une belle carrière musicale à Bruxelles puis à Amsterdam, en publiant notamment de nombreuses œuvres chez Étienne Roger.160 Les fuites restaient cependant un cas exceptionnel. La plupart des musiciens, lorsqu’ils souhaitent rentrer au pays, présentent leur démission en bonne et due forme. Celle-ci n’était cependant pas toujours accordée avec toute la célérité voulue, ce qui plaçait les musiciens dans une situation difficile, car ils ne pouvaient alors quitter la ville ni recevoir de subvention pour leur voyage de retour. Daniel Danielis doit s’y reprendre à trois fois avant d’obtenir sa démission, et sa dernière lettre ne laisse guère planer de doute sur sa profonde exaspération : Apres avoire receu tant des faveures de Vostre Altesse Serenissimme, je suis extremmement marri de me voire forcé de la prier tres humblement pour ma dimission, ne voyant plus de moyen de pouvoir amolir le cœures de ceux qui se sont declaré mes ennemis dès le moment que V.A.S. m’at voulu du bien ; c’est de quoy je la prie infiniment de me faire donner au plustost ce qui luy plêrat pour pouvoire faire mon voyage […].161
Les musiciens avaient tout intérêt à entretenir de bonnes relations avec leur employeur jusqu’au bout, puisqu’ils pouvaient avoir à leur demander une lettre de recommandation, une somme pour le voyage, ou encore une pension de retraite lorsqu’ils atteignaient un âge avancé. Les lettres de recommandation étaient habituellement rédigées en français, comme celle donnée au chanteur Prevost lors de son départ de Berlin, ou encore à Jean Baptiste, maître des concerts à Schwerin : Le Porteur de cellecy, Jean Baptiste, François de nation, Nous a servi pendant le temps de six mois, en qualité de Directeur et Maitre de concerts, de Notre Chambre : Mais ayant resolu de s’en retourner à Paris [barré : pour des affaires pressantes], il Nous a prié tres humblement de luy accorder son congé et de rendre en meme temps un temoignage public de bonne conduite. Ayant donc trouvé sa demande raisonnable, Nous n’avons voulu apporter aucun obstacle à la dite sa resolution, mais luy accorder sa demande, attestant par cellecy, que pendant tout le temps où le dit Jean Baptiste a été en nôtre cour nous n’avons rien trouvé à contredire à sa conduite il a fait le devoir d’un honnete homme. C’est pourquoi Nous prions tous ceux qui verront les presentes et chacun selon ses rangs et dignités, d’ajouter pleine foi au dite notre temoignage et de lui faire jouir de toutes les faveurs et assistences dont il pourroit avoir besoin sur sa route.162
Alors qu’il avait atteint l’âge avancé d’une soixantaine d’années, Pierre-Gabriel Buffardin présente sa démission pour raisons de santé afin de pouvoir rentrer en France, mais il doit attendre plus d’un an avant que celle-ci ne soit acceptée et qu’une pension lui soit enfin accordée. Il avait pourtant pris le soin de préparer sa succession très en avance, puisqu’il avait proposé dès 1741, soit sept ans auparavant, plusieurs candidats pour le remplacer :
158 159
160 161 162
LHA Schwerin, 2.12-1/26-7, Hofkapelle, Nr. 40. Le musicien avait pris la fuite juste après avoir touché son salaire, le 7 août 1679, puisque la lettre de Gustav Adolph est datée de Güstrow, 11 août 1679. LHA Schwerin, 2.12-1/26-7, Hofkapelle, Nr. 40. Lettre de Johann Schlüter à Gustav Adolph, Hambourg, 16 août 1679 : « Will desfallen fideliter ferner mein bestes zuthun nicht unterlassen, und da derselbe könig allhie anzutreffen sein sollte, so viel an mir, es dahin sehen zu richten, das er vor der Hand in arrest genommen werden müge, weil die extraditio schwerlich eher zu erhalten, als wann E. Durchl. solches in einem Schreiben an den Rath dieser Stadt begehren, und wegen der extradition mann gewöhnlichen revers das die ausfolgung unpraejudicierlich, und nicht zur consequenz gezogen werden sollte E. Durchl. es auch, auff des Rahtes ansuchen, in gleichmessigen fällen also halten wollten, ertheilen würden. » Rudolph Rasch, « Athalie entre Saint-Cyr et Amsterdam : Jean Racine, Jean-Baptiste Moreau et Servaas de Konink », in : Noter, annoter, éditer la musique. Mélanges offerts à Catherine Massip, dir. Cécile Reynaud et Herbert Schneider, Genève 2012, p. 139-161. LHA Schwerin, 2.12-1/26-14 Hofpersonal Nr. 12. Lettre de Daniel Danielis à Gustav Adolph, sans date. LHA Schwerin, 2.12-1/26-7 Hofkapelle, Nr. 166, 8 avr. 1710.
– 161 –
Chapitre 3
Pierre Gabriel Buffardin, aïant eû le bonheur de servir l’espace de 33 années Votre Mayesté, se jette profondement â Ses pieds pour Luy representer, que ses indispositions d’Estomac & ses Vertiges le metant depuis quelque tems hors d’etat de vaquer â son devoir, et par consequent peu capable de meriter la continuation de tous Ses Apointemens, suplie tres respectueusement Votre Mayesté qu’il lui soit permis d’en transmettre 300 rl. par an au jeune Goezel, et d’accorder en grace les 700 rl. restans au suplian qui n’a d’autre ressource pour pouvoir subsister avec sa femme & les Enfans qu’elle est en chemin de lui donner, dans un païs qui soit convenable â sa santé délabrée.163
Certains musiciens, comme Jean-Jacques Favier, peuvent compter à leur retour sur des réseaux influents et se lancer dans une bonne carrière : de retour à Paris, il devient « maître de danse des académies royales164 » et enseigne à des enfants des milieux parlementaires.165 François Le Riche, musicien à la carrière fulgurante, semble également être retourné sur son lieu de naissance à la fin de sa vie : Ashbee signale que le testament de Peter Bressan, rédigé à Tournai en 1731, signale parmi les garants « Jean Chmielensky domestique au Sieur LeRich.166 » Ceci indiquerait que Le Riche serait retourné dans sa ville natale à la fin de sa vie, là même où, une quarantaine d’années auparavant, il avait fait la connaissance de Deseschaliers. Le retour au pays n’était pourtant pas toujours synonyme de bonne fortune. Après une carrière dans plusieurs cours allemandes, le comédien du Rocher écrit plusieurs lettres déchirantes à Flemming depuis Rouen, où il était apparemment réduit à un état de très grande pauvreté.167 Moins pathétique, l’inventaire après décès de Pierre-Gabriel Buffardin fait aussi entrevoir un certain dénuement (Tableau 3.2). Il en va de même pour Jean Prache du Tilloy qui, atteint de maladie, doit être soutenu par sa femme. En 1733-1734, Marguerite Prache envoie plusieurs suppliques à August III où elle évoque le « déplorable état auquel est réduit [s]on Mary, qui perdus des bras et des jambes, n’ayant plus maintenant que des notions d’enfance, avec une difficulté inexprimable de s’ennoncer, enfin accablée [sic] de toutes sortes d’infirmités qui le mettent dans l’impossibilité de pouvoir desormais gagner sa vie ».168 Après sa mort, elle demande de l’argent pour pouvoir rentrer en France.169 Quelques mois avant de mourir, le 17 mai 1733, Jean Prache avait fait rédiger un second testament à Berlin dans lequel il confirmait plusieurs dons faits aux pauvres, aux pères dominicains de la ville d’Halberstadt et à « l’Église romaine de cette ville », et établissait d’autre part ses deux neveux comme légataires universels de ses biens.170 Ces dispositions furent annulées par la justice locale, les biens étant trop modestes pour être transportés en France et revenant finalement à Marguerite.171 L’inventaire après décès de Jean Prache (Tableau 3.3) fait figurer les quelques possessions matérielles du musicien, parmi lesquelles des instruments de musique, un convolut de parties séparées et les sermons de Bourdaloue et de Massillon forment sans doute les effets les plus intéressants.172
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
Lettre de Pierre-Gabriel Buffardin à August III, Dresde, 23 mars 1748. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/5, fol. 177-178. L’acceptation de la démission est signée par August III le 23 juin 1749. Voir aussi la lettre du 11 déc. 1741 au même endroit, fol. 38-39. AN, Minutier central, I-193, 4 mai 1691 : acte d’association avec François Dufour. AN, Minutier central, XVII-119, 24 mars 1719. Ashbee, A Biographical Dictionary, p. 701. Lettres de N. du Rocher à Jakob Heinrich von Flemming, Rouen, 25 et 30 fév. 1726. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 702/5, fol. 75-77. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/1, fol. 45. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383.1, fol. 170-171. HStA Dresden, 10084 Appellationsgericht Dresden, Nr. 3819, fol. 2. HStA Dresden, 10084 Appellationsgericht Dresden Nr. 3818. HStA Dresden, 10684 Stadtgericht Dresden, Nr. 1872.
– 162 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
Tableau 3.2. Inventaire après décès de Pierre Gabriel Buffardin, 28 janv. 1768. AN, Minutier central, LXXVIII-758. Dans un petit cabinet pratiqué a coté de la cheminee de la chambre Premierement un petit miroir d’une glace de quinze pouces de haut sur douze de large dans bordure de bois doré prise quatre livres Item douze bouteilles de gros verre dont trois remplies d’une liqueur rouge […] remplies de ferailles et autres chiffons ne meritant description prise trente sols Item plusieurs poteries de terre façonnée et verre de meritant description prise trente sols Item un petit avec sa cloche et ses taquets prisé […] Item un tas de planche de sapin provenant d’une cloison plusieurs bottes de pareils bois partie rempli de corps de flute […] de la profession de luthier et ferailler servant aladite profession, prisé le tout ensemble quarante huit livres Item un tour complet demonte propre a tourner les fluttes prise soixante douze livres Item treize fluttes complettes de different bois partie garnies en yvoire prisé vingt quatre livres Item une table un tabouret […] Item une mauvaise couchette un matelas de bourre couverture de toille et carreaux deux coussins aussy de bourre deux couvertures de laine blanche prisé ensemble vingt quatre livres Item Deux vestes de drap d’or un habit et culotte de valerienne noir une veste de camelot brun un habit de drap noir un habit de velours gris ciselé deux camisolles de toille prisé ensemble quarante huit livres Item une chemise deux paires de […] brodées prisé quatre livres Item une paire de boucles de souliers d’argant chappe et arguiller petite cuilliere d’argent prise ensemble six livres
Tableau 3.3. Inventaire après décès de Jean Prache du Tilloy, 26 août 1734. HStA Dresden, 10684 Stadtgericht Dresden, Nr. 1872. 1
20 Thlr
2. Kleider 1. von braunen Tuch und 1. von Camlot, welche aus so hoch an die Juden auss allertheüerste verkaufft worden,
2
5 Thlr
12. Oberhembden
3
3 Thlr
12. Unterhembden
4
5 Thlr
als von demselben hinerlaßene seiden und wollen Strümpffe
5
–
degen Vacat, weil er solchen vor seinem Tode weggeschenckt
6
1 Thlr
vor alle Kraußen und Schnupftücher
7
1 Rthlr 12 gr
2 Hüthe mit dazy gehörigen Futteral
8
35 Rthl. 12 gr
Etl. alte Paß Geigen 3. Stücke 2 Baß de Violinen
9
10 rhl
1. Laute nebst zugehör
10
–
Ein convolut von Musicalischen Partien
11
–
Ein buch worinnen verschiedene Spiel Activ-Schulden anzutreffen die aber inexigible sind
12
–
Sechs Pfund alten verdorben Paunscher Schnuff-Taback
13
–
Sermon du Pere Pourdalaüe quatre Tome, Frz. in 8vo
14
–
Sermon du même 17me Tome
15
–
Sermon du Pere de la Rue Tome 3me
16
–
12. Tome des Sermons von verschiedenen Autoribus so aber incomplet, indem einige davon verlohren gegangen, Frz. in 8tavo
17
–
8. nach dergl. Sermon du Pere Massillon, incomplet in etwas kleinere format.
18
–
50 Piecen, ohngefehr, an Commedien Calendern und andere dergleichen rohen auch mehrentheils unbrauchbar von, und unnutzern materien
45 Rthl. 12 gr. von stehende sämtl. Sachen, außer die alten Paß Geigen und Violinen auch und die à No: 10 usq. 18 specifiten Bücher, sind wie gedacht an die Juden verkaufft worden, und sind no. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 u. 18. in natura vorhanden hierüber noch. 100 Rthl. an einen Wechsel die Mad. Hulot an meinen Ehemann und mich d. d. 23. Xbre 1730. den 23. April 1732 zahlbar ausgestellt, es kommt aber das Anlehen von meinen Vermögen her ead. 12 rh. 12 gr. amtständigen Interessen. Dreßden den 26 Aug. 1734 145 rh. 12 gr.
– 163 –
Chapitre 3
Tableau 3.3. (suite et fin) Marguerite Genevieve la veuve prache du Tilloy Johann Friedrich Baudius curat. Noie der verwitibten Madame Prache du Tilloy Das Begraben hat über 50. rthl gekostet incl. der Trauer vor 50 rthl. mich und Domestiquen 2000 Rthl. quarta davon ich meines verstorbenen Ehemanns creditrix bin wenn er etwas verlassen hätte –––––––––––––– 2050 Rthl. Marguerite genevieve la veuve prache du tilloy Johann Friedrich Baudius curat. noie. der verwittbte Madame Prache du Tilloy Dreßden den 26 Aug. 1734 Hiervon 145 rthl. 12 gr. abgezogen behalt ich annoch –––––––––––––– 1904 rthl. 12 gr. Je Marguerite Genevieve veuve Prache du Tilloy jure à DIEU tout puissant que tout l’heritage que mon marie Jean Baptiste Prache du Tilloy a quitté en mourant j’ai fait metre dans la specification presentée à la maison de cette Ville le vingt sixieme de ce moïs d’Août. Je jure que je n’ai rien cachée de la dite heritage, que j’ai fidelement mis le tout dans la specification. Je promets aussi si je me ressouviens de quelque chose, qui se puisse trouver dans la dite heritage de l’annoncer et le specifier. Je jure aussi, que les 100. ecus que la defunte d’Hullot me doit à une lettre de change soit de mon propre argent. Aussi vray que Dieu soit mon aide par Jesus Christ notre Seigneur et Sauveur.
Le bonheur en Allemagne ? Installations, reconversions, dynasties Si la plupart des musiciens français semblent avoir choisi ou subi une migration de maintien caractérisée par un retour au pays, certains d’entre eux partirent sans esprit de retour. Après avoir visiblement trouvé « le bonheur en Allemagne173 », selon l’expression de Michel Tournier, ils décidèrent de s’y installer pour de bon, même après la dissolution des institutions auxquelles ils appartenaient. Deux phénomènes différents montrent l’inscription dans la durée de la migration : la reconversion de certains musiciens qui changent de profession après leur renvoi mais restent dans l’Empire, et la constitution à plus long terme de véritables dynasties de Français qui s’installent sur plusieurs générations. Un des cas les plus intéressants de reconversion professionnelle est celui de Pierre du Vivier, musicien engagé à Celle en 1689 et resté au service de la Hofkapelle jusqu’en 1705, année de la mort de Georg Wilhelm et de dissolution de la chapelle ducale. L’année suivante, en mai 1706, l’ancien musicien de la cour ducale (« der ehemalige Fürstl. Zellische Hoff=Musicant ») se fait accorder par le duc Anton Ulrich de Wolfenbüttel un privilège pour s’établir comme négociant de vin dans le duché de Wolfenbüttel.174 Dès 1707 cependant, Pierre du Vivier se met en infraction en important une trop grande quantité de vin et tombe sous le coup d’une plainte de l’un de ses concurrents.175 Notons que le musicien ne semble pas avoir complètement arrêté ses anciennes activités, car il est désigné comme maître à danser (« Tantzmeister ») aussi bien dans sa condamnation que dans son acte de décès rédigé en 1711 à Wolfenbüttel.176 Le négoce de produits importés de France paraît d’ailleurs être une occupation assez naturelle pour l’entourage immédiat des musiciens, puisque le frère de Philippe de Courbesastre est « marchand en Allemagne.177 » Les musiciens congédiés ne devaient cependant pas tous envisager une reconversion, et pouvaient demeurer sur place même après la cessation de leur service. Une retraite est versée à titre gracieux (« Gnaden Verehrung ») à certains musiciens de Celle par la cour de Hanovre, qui assurait 173 174 175 176 177
Michel Tournier, Le Bonheur en Allemagne ?, Paris 2004. NLAW, 4 Alt 5 Nr. 374, fol. 1. NLAW, 4 Alt 5 Nr. 341. NLAW, 4 Alt 5 Nr. 374. BAHild, KB Nr. 1813, Wolfenbüttel St. Petrus, p. 1, 2 mai 1711. AN, Minutier central, XXXI-20, 21 juin 1700.
– 164 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
l’entretien de l’ancien personnel après la réunion des deux territoires. Philippe la Vigne, Claude Pécour, Saint-Amour et Louis Gaudon touchent une pension jusqu’à leur mort. En 1726, Gaudon demande que ses biens soient exemptés du droit d’aubaine pour pouvoir les léguer entièrement à ses héritiers qui habitent en terre de Hanovre : Depuis l’an 1678 que j’ay eü l’honeur d’etre appellé de France pour venir servir S. A. S. Monseigneur le Duc de Zell, de Glorieuse memoire dans sa Musique tant d’année c’étant accumuleez successivement les unes apres les autres, me font pençer que bientôt il me faudra déloger de ce Monde. C’est ce qui me fais prendre la liberté de supplier tres humblement V. E.ces de m’accorder sous l’Authorité Royalle de Sa Mte´, votre Consentement avec la permission, de faire, & de disposer, mon testament, du peu de bien qui ce trouvera apres ma mort, En faveur de mes Heritiers, Qui Sont nés, & qui habitent acctuellement en ce paÿs afin qu’apres mon deçès, ils nen soient point inquiétez, ny vexçés, sous quelque pretexte que ce puisse être, pour les empêcher de joûir paisiblement de mon délaissement.178
Cette demande lui fut accordée immédiatement. Louis Gaudon semble d’ailleurs avoir été assez fortuné, puisqu’il prête dès le mois de février 1692 cent Thaler à Johann Friedrich Stammk, pour monter une petite entreprise.179 Même les musiciens qui ne touchaient pas de retraite pouvaient rester sur place : Thomas de La Selle est enterré en 1727 à Celle à l’âge de quatre-vingt-huit ans. Selon son acte de décès, il avait été « pieux et doux » de son vivant, « sain d’esprit dans le dernier moment de sa vie » et mourut « muni de tous les sacrements selon les rites ».180 Au-delà de ces cas individuels, de véritables dynasties de musiciens français s’implantèrent durablement dans leur nouveau pays d’accueil. La famille du musicien Pierre Vezin et de la comédienne Marie Charlotte Pâtissier de Châteauneuf est un excellent exemple : leurs descendants fournirent de nombreux médecins, avocats et hauts fonctionnaires en Basse-Saxe jusqu’au début du xixe siècle, tandis que certains d’entre eux émigrèrent aux États-Unis et en Angleterre.181 La famille La Vigne est un autre exemple d’intégration réussie : la fille de Philippe La Vigne épousa en 1718 un musicien employé à la cour Wolfenbüttel, Louis de Fri.182 Quant au fils du Kapellmeister, Georg Wilhelm La Vigne, il passa toute sa vie à Celle comme maître à danser ainsi que le confirme son acte de décès.183 Son fils Philippe, né en 1702 et confirmé à Celle en 1710, continua probalement à vivre dans la région.184 Près de cinquante ans plus tard, en 1757, une certaine Marie-Madeleine La Vigne apparaît toujours dans les registres paroissiaux de Celle.185 Le cas de la famille Beauregard est également intéressant : François Adam Beauregard, hautbois à la cour de Berlin à partir de 1681, est le père de François Godefroy Beauregard qui fit une carrière comme chanteur à Dresde. La veuve du premier, Marie Letellier, s’était remariée avec le cuisinier Pierre Creholet à Paris le 2 mars 1692.186 Plusieurs années plus tard, en 1714, un certain « Sieur Beauregard » est mentionné comme maître de chapelle de Joseph Clemens de Bavière lors du séjour de ce dernier à Paris. Il s’agit certainement du chanteur François Godefroy Beauregard, engagé à la Hofkapelle de Dresde en 1714 en qualité de haute-contre, et qui mentionne dans sa biographie qu’il est né à Berlin. Il est probable que le fils a pu bénéficier de réseaux de sociabilité
178 179 180
181 182 183 184 185 186
NLAH, Cal. Br. 15 Nr. 1277. NLAW, 7 Alt G, Nr. 104, fol. 15. Gaudon se retira de l’affaire en novembre 1700. BAHild, KB Nr. 387, Celle St. Ludwig, Beerdigungen 1710-1852, p. 15 : « 1727 18ta Januarÿ hora quarta matutina morituris praerivit pie Dominus Thomas la Selle Gallus olim Curia Cellensis magister Saltuum aetatis 88 annorum omnibus sacramentis rite munitus et ad ultimum vitae momentum sana mentis. In vita fuit pius et lepidus. Sepultus est in suburbiy coemeterio. » Böger, Die Geschichte der Familie Châteauneuf-Vezin. BAHild, KB Nr. 386, Celle St. Ludwig, Traubuch 1706-1852, 20 oct. 1718, p. 33. BAHild, KB Nr. 387, Celle St. Ludwig, Beerdigungen 1710-1852, p. 17 : « 1728 29tia Maÿ pie obyt omnibus Sacramentis rite praemunitus Georgius La Vigne aetatis 54 professione magister saltuum Sepultus est in Coemeterio Suburbano. » BAHild, KB Nr. 388, Celle St. Ludwig, Firmungen 1710-1819, p. 7. BAHild, KB Nr. 385, Celle St. Ludwig, Taufbuch 1674-1852, 27 déc. 1757, p. 45. F-Pn, Fichier Laborde, NAF 12046, fiche 3276.
– 165 –
Chapitre 3
tissés par son père dans l’espace germanique, et peut-être également d’une pratique de la langue allemande qu’il aura eu l’occasion d’apprendre pendant son enfance à Berlin.
Servir un autre maître Lorsque Chambonnières cherchait à sonder Huygens sur les possibilités d’emploi à la cour de La Haye, l’humaniste hollandais lui fit une réponse étonnante, non dénuée de beauté : « Mais ces grands Princes ne sont plus, pour l’amour desquels il valoit la peine de faire le voyage, et à peine l’ombre nous en reste.187 » Même si la plupart des musiciens ne font sans doute pas le voyage par amour pour leurs futurs employeurs, cette citation montre bien le lien personnel fort qui les attache au service de leur nouveau maître, ce que les sources administratives permettent aussi de confirmer. On a vu qu’une expression qui revient souvent sous la plume des musiciens français est le fait d’avoir été appelés ou d’être entrés « au service » de leurs nouveaux maîtres. Louis Gaudon écrit qu’il a « eu l’honneur d’être appelé de France pour venir servir Son Altesse Sérénissime le Duc de Zell ».188 Les formulations similaires abondent, et montrent que le service est une dimension essentielle du métier de musicien de cour. Il importe donc de tenter de cerner les réalités quotidiennes qu’implique une telle fonction. Les espaces de la musique française Pendant tout le xviie siècle, le choix du répertoire musical et la question de la convenance sont guidés par le choix des lieux de musique. La tripartition topographique de la musique, formalisée par exemple sous la plume de Sébastien de Brossard et qui distingue la musique d’église, la musique de théâtre et la musique de chambre, constitue dès lors un fil directeur essentiel pour explorer l’activité des musiciens et les usages de musique française dans les cours allemandes.189 Si celle-ci trouve sa place dans une grande variété de contextes et d’endroits, le lieu privilégié de la musique française demeure à l’évidence le théâtre. Ce privilège du théâtre n’est cependant pas synonyme d’exclusivité, et le caractère polyvalent de l’activité des musiciens français, située au croisement de deux mondes – celui des troupes de comédiens français et celui des Hofkapellen, dont ils doivent remplir les tâches normales et régulières – est une réalité qu’il importe de cerner avec précision, non seulement du point de vue de l’administration comme nous l’avons fait dans le chapitre précédent, mais aussi dans la perspective des musiciens eux-mêmes. Le théâtre L’exécution de musique sur les scènes des théâtres français aux xviie et xviiie siècles, bien loin d’être un simple ornement, jouait un rôle absolument central, à tel point qu’il « ne serait pas exagéré de dire qu’à cette époque, toute représentation de théâtre faisait appel, d’une manière ou d’une autre, à de la musique ».190 Les pièces en machines et les pièces à intermèdes, comme les comédies-ballets ou les tragédies bibliques de Racine, sont les exemples les plus connus d’une telle interaction, mais la présence de la musique ne se limitait nullement à l’insertion musicale dans un texte parlé.191 Plus largement, elle forme une « composante latente du théâtre dramatique au xviie siècle.192 » Matthieu Franchin et Bénédicte Louvat-Mozolay ont très bien mis en évidence le rôle de 187 188 189 190 191 192
Lettre de Constantijn Huygens à Jacques Champion de Chambonnières, 2 juin 1655. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 5, p. 237. NLAH, Cal. Br. 15, Nr. 1277. Sébastien de Brossard, « Stilo », in : Dictionnaire de musique, Paris 1703: « Le Stile des Musiques d’Eglise est bien différent du Stile des Musiques pour le Théatre ou la Chambre. » Matthieu Franchin, « Les entractes musicaux de l’École des femmes : méthodologie pour une restitution archéologique », Arrêt sur scène / Scene Focus, 5, 2017, p. 112-142. Bénédicte Louvat-Molozay, Théâtre et musique. Dramaturgie de l’insertion musicale dans le théâtre français (15501680), Paris 2002. Cf. aussi Johan S. Powell, Music and Theatre in France 1600-1680, Oxford 2000. Bénédicte Louvat-Mozolay, « Le théâtre musical au xviie siècle : élaboration d’un genre nouveau ? », Littératures classiques, 21, 1994, p. 249-264, ici p. 264.
– 166 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
la musique d’entracte dans l’organisation d’une temporalité propre à la représentation théâtrale, où le relâchement de l’attention des spectateurs entre les actes participe d’une esthétique classique du théâtre, en confortant les principes de vraissemblance et d’unité de temps.193 Le journal de la cour de Dresde pour l’année 1729 documente l’adoption d’une telle pratique musicale sur les scènes des cours allemandes. En donnant jour après jour le détail des représentations théâtrales sur l’ensemble de l’année, cette source permet non seulement de se faire une idée de la variété du répertoire théâtral de la troupe de comédiens français de Dresde, mais aussi de s’apercevoir que nombre de comédies sont accompagnées non seulement de musique, mais d’entractes et de divertissements dansés (Tableau 3.4). Les entractes, intermèdes et divertissements ne sont notés que lorsqu’ils incluent de la danse, et probablement considérés comme une pratique normale s’ils ne font intervenir que les musiciens. L’usage qui consiste à faire suivre une tragédie d’une « petite pièce » comique est constant à Dresde, et rejoint les pratiques de la Comédie française. L’architecte Jean-François Blondel note en effet en 1752 que le rôle de l’orchestre de la comédie française est de jouer des pièces de symphonie un peu avant la représentation du spectacle, pendant les intermèdes, et entre les deux pièces ; étant d’usage au Théâtre Français, après la tragédie, de donner une petite pièce comique pour égayer le spectateur.194
On voit donc se dessiner, à travers cet exemple, une très forte cohérence entre le répertoire et les pratiques musicales du théâtre français à Paris et à Dresde. À l’inverse, le théâtre italien n’est jamais accompagné d’une musique signalée dans les journaux de la cour. Il est donc parfaitement logique que les musiciens forment une part essentielle des troupes de comédiens.195 Dès les années 1640, bien avant d’écrire ses première comédies-ballets, Molière avait engagé quatre joueurs d’instruments et un danseur dans sa troupe de l’Illustre Théâtre.196 Le registre de La Grange indique parmi les frais ordinaires de la Troupe de Monsieur le paiement de « violons » : 4 livres et 10 sols pour un nombre inconnu d’instruments au Petit-Bourbon en 1660, 6 livres pour quatre violons au Palais Royal en 1662.197 Lors de la reprise des Fâcheux en 1663, l’orchestre du théâtre incluait six violons, deux hautbois et un clavecin.198 Samuel Chappuzeau compte les violons au nombre des emplois secondaires (« les Bas-Officiers ») d’une troupe de théâtre, et même lorsqu’il raille les « Comédiens de Campagne », il mentionne « deux ou trois Violons.199 » Mais il décrit aussi la composition des ensembles musicaux attachés aux troupes régulières et leurs pratiques musicales : Les Violons sont ordinairement au nombre de six, & on les choisit des plus capables. Cy-devant on les plaçoit, ou derrière le Théâtre, ou sur les aisles, ou dans un retranchement entre le Theâtre & le Parterre, comme en une sorte de Parquet. Depuis peu on les met dans une des Loges du fond, d’où ils font plus de bruit que de tout autre lieu où on les pourroit placer. Il est bon qu’ils sçachent par cœur les deux derniers vers de l’Acte, pour reprendre prontement la Symphonie, sans attendre que l’on leur crie, Jouëz, ce qui arrive souvent.200
Le nombre ordinaire de six violons n’est pas donné au hasard. Mais il correspond aussi très bien aux usages allemands : à Celle, les musiciens qui arrivent en 1666 sont au nombre de sept, six
193
194 195 196 197 198 199 200
Voir en particulier la remarque de Chapelain citée par Bénédicte Louvat-Molozay, Théâtre et musique, p. 123 : « j’estime encore que les distinction des actes, où le théâtre se rend vide d’acteurs et où l’auditoire est entretenu de musique ou d’intermèdes, doivent tenir lieu du temps que l’on se peut imaginer à rabattre sur les vingtquatre heures. » Cité par Franchin, « Les entractes musicaux », p. 112. Voir Chapitre 1, p. 44-49. Franchin, « Les entractes musicaux », p. 113. Charles Valet sieur de La Grange, Registre de La Grange (1658-1683), précédé d’une notice biographique, Paris 1876, p. 18 et 45. Sur les pratiques musicales dans le théâtre de Molière, cf. Powell, Music and Theatre in France, p. 398415. Powell, Music an Theatre in France, p. 400. Chappuzeau, Le Théâtre françois, p. 224. Chappuzeau, Le Théâtre françois, p. 240.
– 167 –
Chapitre 3
Tableau 3.4. Plan des pièces de théâtre données en 1729 à Dresde d’après le journal de la cour. HStA Dresden, 10006 Oberhofmarschallamt, G Nr. 29. Fol.
Date
Texte
3v
7 janv.
« Abends wurde eine franzö. Comoedie La Tragedie de Metridate, Racine, et Grispin bele Esprit. petitte Comoedie d’un acte gehalten. »
4r
10 janv.
« franzöi. Comoedie Les folis amouresses de Regnard et Crispin medecin d’hauteroche »
4v
12 janv.
« franzöi. Comoedie Le joueur de Renard »
4v-5r
14 janv.
« Abends war franzöi. Comoedie, so genannt wurde. Igres de Castre Tragedie de Mons: de la Mote, suivie de la petite Comoedie du Charivary ornez de dances et de Musique »
5r
17 janv.
« eod: die war franzöi. Comoedie, welche bettitelt wurde: L’Ecole des Maris, piece en trois acte, de Mons: de Moliere et La famille extravagante. »
5r
19 janv.
« Beÿ Hoffe war franzöi. Comoedie genannt: L’Etourdi piece Comique en cinq acte de Moliere »
5v
21 janv.
« den 21. nahmen sie das Mittagmahl beÿ dem Herrn General von Baudis ein, so dann aber wohneten sie der franzöi. Comoedie, Iphigenie de Racine et L’esprit de contradiction, un ballet entre les deux pieces. »
6v
24 janv.
« den 24. Jan: Begeben sich Ihro Königl. Hoheit der Prinz, mit Ihro Druchl. dem Prinz von Daßau auf die Jagdt und kamen Abends wieder zurücke, wohneten sodann der franzöi. Comoedie beÿ, so genennet wurde: Le Philosophe Marié, piece en cinq actes, avec un ballet à la fin. »
7r
26 janv.
« Abends war franzöi. Comoedie: La Jalousie desabuse. »
7r
28 janv.
« Abends war franzöi. Comoedie, genannt: Andromaque de Racine, et le françois à londre, avec un Ballet. »
7v-8r
2 fév.
« Abends var franzöi. Comoedie: Le Medicin malgré luy piece en trois actes et Le Cocu imaginaire petite de Moliere. »
8r
4 fév.
« Abends franzöi. Comoedie, genannt Les Amans deguisée [sic] et Colin Malliard accompagné d’un ballet et de Musique. »
8v
7 fév.
« Abends war franzöi. Comoedie, Ariane, piece en cinq actes et Le Retour un preuvüe entre aux piece d’un ballet. »
8v
9 fév.
« Abends war franzöi. Comoedie benannt: La Dame invisible, piece en cinq actes. »
9r
11 fév.
« Abends der franzöi. Comoedie beÿ, welche betittelt wurde Le Philosophie Marie, piece en cinq actes. »
9v
14 fév.
« den 14. war franzöi. Comoedie benannt Le Comte d’Esseck. »
9v-10r
16 fév.
« Abends der franzö. Comoedie beÿ, welche war: le nouveau monde, piece en trois actes, accompagné de trois balets et de musique. »
10r
18 fév.
« den 18. war franzöi. Comoedie, betittelt: Les femme sçavantes piece en cinq actes, welcher Ihro Durchl. der Prinz von Daßau beÿwohnete. »
10v
21 fév.
« den 21. Franzöi. Comoedie genannt Oedipe nouveau piece en cinq actes et Lesté des Coquettes petit piece. »
11r
23 fév.
« Abends war franzöi. Comoedie benahnet Le nouveau monde piece en cinq actes, accompagné de trois balets et de musique. »
11r
25 fév.
« den 25. wurde die Redoute abermahls gehalten, vorhero aber franzöi. Comoedie genannt: Crispin Musicien, piece en cind actes. »
11v
28 fév.
« den 28. Nachmittags wurde die franzöi. Comoedie L’Inconnu agiret, und nach dieser Redoute gehalten. »
12v
4 mars
« den 4. wurde die franzöi. Tragedie Oedipe und die Comoedie La parrisienne agiret. »
13r
7 mars
« Abends war franzöi. Comoedie benannet Le Medisant, piece Comique en cinq actes. »
13r
10 mars
« den 10. war abermahls franzöi. Comoedie betittelt: Tartiffe [sic], Comique en cinq actes »
13v
14 mars
« den 14. war franzöi. Comoedie. Le grondeur de Mr. de Palaprat et d’hevill petite piece. »
14r
17 mars
18r
5 mai
« dem 5. war franzöi. Comoedie welche betittelt: Polieucte Tragedie en cinq actes et l’épreuve reciproque petite piece. »
18v
9 mai
« eod: die war franzöi. Comoedie genannt Le Medisant piece en cinq actes de Mr. Destouche accompagnee d’un balet. »
« den 17. Marty wurde die franzöi. Comoedie Ignès de Castro gehalten. »
– 168 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
Tableau 3.4. (suite et fin) Fol.
Date
Texte
19v
15 mai
Comédie italienne
19 mai
Comédie italienne
20r
26 mai
Comédie italiene
21r
9 juin
Comédie italienne
21v
12 juin
Comédie italienne
22r
19 juin
Comédie italienne Arlequino giardiniere pour la fête-Dieu
23v
30 juin
Comédie italienne à Moritzburg
24r
7 juillet
Comédie italienne
25r
10 juil.
Comédie italienne
14 juil.
Comédie italienne
17 juil.
Comédie italienne
26r
24 juil.
Comédie italienne
26v
28 juil.
Comédie italienne
31 juil.
Comédie italienne
4 août
Comédie italienne à Varsovie
7 août
Comédie italienne à Varsovie
3 juil.
27v 28v
Comédie italienne à Moritzburg
Comédie italienne
37r
18 oct.
« den 18. wurde franzöi. Comoedie gehalten und betittelt: Cinna, piece en cinq actes, et le mariage force, petite piece. »
37v-38r
20 oct.
« Eodem Die war franzöi. Comoedie, genannt Menteur, piece Comique, en cinq actes, de Corneille, dergleichen auch wurde den 23. Octobr: gehalten, und war Le misentrope [sic] piece Comique en cinq actes, de Mr. de Moliere »
38r
27 oct.
« den 27. wurde franzöi. Comoedie, le Malade imaginaire, piece comique de moliere, accompagne de Musique et de Danses. »
38v
30 oct.
« den 30. war franzöi. Aedipe tragedie en cinq actes et les trois freres rivaux petite piece »
39r
30 oct.
« eodem die fanzöi. Comoedie, genannt: L’homme à la fortune, piece Comique en cinq actes avec une petite danse. »
39v
6 nov.
« eodem die war franzöi. Comoedie. Le Chevalier à la mode, piece en cinq actes de Moliere. »
40r
10 nov.
« den 10. franzöi. Britaniquues [sic] Tragedie en cinq actes de Corneil, et la pres Souppé des auberges petite piece. »
40r
13 nov.
« franzöi. Comoedie L’estourdy piece en cinq actes de Moliere accompagne d’un Ballet. »
40v
17 nov.
« Franzöi. Comoedie Le Joueur piece en cinq actes de Renard »
41r
20 nov.
« franzöi. Comoedie L’Ecole des femmes piece Comique en cinq actes avec un balet à la fin. »
41r
22 nov.
« war wieder franzöi. Comoedie Le Bourgois Gentilhomme, piece comique en cinq actes de Moliere, accompagnée de Musique et de Danse. »
41v
24 nov.
« franzöi. Electre Tragedie en cinq actes, Crispin bel esprit petite piece, et un balet entre les deux pieces. »
41v
27 nov.
« franzöi. Comoedie L’avarre piece Comique en cinq actes, avec un balet à la fin. »
42v
6 déc.
« franzöi. Les Maccabes Tragedie en cinq actes de Mr de la Motte et Crispin Precepteur »
43r
9 déc.
« franzöi. Comoedie Le Negligent piece Comique en quatre actes et Collin Malliard, petite piece suive d’argent [agrément] »
43r
13 déc.
« franzö. Comedie, Esope à la Cour, piece Comique en cinq actes avec un balet à la fin. »
43v
16 déc.
« franzöi. Andronique [sic] tragedie en cinq actes et la Cerenade petite piece suivie d’agrement »
– 169 –
Chapitre 3
violonistes et un Kapellmeister. À Hanovre, la composition de l’ensemble français installé par Ernst August en 1680 fait également apparaître le Kapellmeister Jean-Baptiste Farinel et six violons payés en groupe, désignés comme les « 6 übrigen Frantzösischen Musicanten ». À ce noyau originaire viennent s’ajouter au fil du temps d’autres musiciens. Lorsque Zacharias Conrad von Uffenbach se rend à la cour de Hanovre en 1710, il note l’excellence et la richesse de l’orchestre qui joue lors de la comédie Le Menteur de Pierre Corneille : Le soir à six heures, nous allâmes pourtant au château [de Hanovre] pour voir la comédie. Le bâtiment de l’opéra ou de la comédie est joli, mais curieusement l’amphithéâtre est très petit. Les acteurs étaient une bande vraiment bonne de Français ; et on joua Le Menteur. L’orchestre est incomparable et très fourni, et la musique était très belle.201
Plusieurs autres témoignages contemporains relatent la présence des musiciens français au théâtre. Chappuzeau, lorsqu’il se fait l’écho de la troupe de comédiens partagée entre les trois frères de Braunschweig-Lüneburg, mentionne aussitôt les « trois bandes de violons » : L’Evêque d’Osnabruc, & les Ducs de Cell & d’Hannover entretiennent depuis plusieurs années une excellente Troupe de Comediens François riches en habits, & qui executent admirablement leurs rôles ; & lors que leurs trois bandes de violons se trouvent ensemble, on les peut nommer la bande des vingt quatre, la plus part François & des meilleurs maîtres de cette profession.202
Cette dernière citation rassemble dans une même phrase les comédiens et les musiciens français. Chappuzeau suggère ici que les trois cours possédaient chacune une bande de violons qu’elles pouvaient mettre occasionnellement en commun afin de créer une bande similaire à celle des vingtquatre violons du roi. En fait, si des musiciens français ont bien été engagés à Celle par Georg Wilhelm et sa femme Éléonore Desmiers d’Olbreuse, ainsi qu’à Osnabrück par Ernst August et sa femme Sophie von der Pfalz, le duc de Hanovre Johann Friedrich ne possédait pas de violons français, mais des instrumentistes allemands et des chanteurs italiens. Un autre voyageur anonyme évoque les musiciens français de Celle juste après les comédiens en 1681 : « Le Duc de Cell tient une trés-bonne table. Il a sa musique, ses violons & une troupe de bons Comédiens.203 » Le jugement porté sur les comédiens français par Constantijn Huygens junior (le fils de l’admirateur d’Anne de La Barre) à l’occasion du voyage qu’il fit dans la suite du prince Guillaume d’Orange en 1680 est nettement moins flatteur que celui de Chappuzeau et souligne la mauvaise acoustique du théâtre de Celle : Je fus à la comedie avec S[on] A[ltesse] [Guillaume d’Orange] ou fut joué ce jour là le Bajazet de [Racine] mais les acteurs n’estoyent pas bons extraordinairement, et la voute du théatre estant fort haute, l’on avoit de la peine à entendre les comediens.204
La veille, il avait mentionné la présence de musiciens lors du premier repas offert à la suite du prince d’Orange (« Il y ent musique de violons durant le soupper 205 »). Lorsque Leibniz envoie à Anton Ulrich un exemplaire de la comédie française Les Moines qui venait de paraître de façon clandestine à Paris en 1699, il souligne que cette comédie doit être entendue accompagnée de sa musique.206 Le philosophe faisait ici référence à une expérience personnelle très concrète, puisqu’il 201
202 203 204 205 206
Cité par Scharrer, Zur Rezeption, p. 123: « Abends um sechs Uhr aber giengen wir auf das Schloß, die Comödien zu sehen. Das Opern= oder Comödien=Haus ist zierlich, aber sonderlich das Amphitheater sehr klein. Die Acteurs waren eine recht gute Bande von Frantzosen; es wurde la Menteur gespielet. Das Orchester ist unvergleichlich und stark besetzt, und die Musik war sehr schön. » Chappuzeau, Suite de l’Europe vivante, p. 348. Anonyme, Voyages faits en divers temps, p. 223. Constantijn Huygens, Journaal van Constantijn Huygens den zoon, vol. 3, Utrecht 1888, 23 sept. 1680, p. 14. Huygens, Journaal, 22 sept. 1680, p. 13. Lettre de Leibniz à Anton Ulrich, Hanovre, 5 janv. 1699. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe I/16, p. 83 : « Pour les Estreines, damit ich vor einem großen Herrn dießmahl auff orientalisch erscheine, so schicke E. Durchl. eine französische Comoedi, die mir überauß artig vorkomt. Ich habe sie von Paris bekommen, ob sie wohl alda nicht anders als unter dem Mantel wird herumb spaziren dürffen; denn sie ist gegen die Münche. Aber sie wird meines ermessens den ehrlichen München nichts schaden, und kan inzwischen lust machen, zumahl da man sie würcklich mit der Musik begleitet hören solte. »
– 170 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
venait d’entendre cette comédie jouée par les comédiens – et probablement les musiciens – français au théâtre ducal de Hanovre.207 La collaboration entre musiciens et comédiens français constitue donc incontestablement l’une des caractéristiques des ensembles français y compris lorsqu’ils sont engagés dans des cours allemandes. Ces remarques conduisent à revoir à la hausse l’estimation de Gerhard Vorkamp, selon qui vingt pour cent au moins des pièces jouées par la troupe de Hanovre étaient accompagnées de musique.208 Lorsque Johann Sigismund Cousser publie sa collection de musique française à Stuttgart en 1682, il annonce d’ailleurs dans son titre des « ouvertures de théâtre », révélant bien par-là l’affinité entre ce genre et l’univers des comédiens.209 La table et la chambre La musique instrumentale française ne résonnait pas seulement sous la voûte des théâtres : elle était aussi entendue à la table et à la chambre. Cousser devait le savoir mieux que personne, puisque l’année même de la sortie de sa collection, son nouveau patron le duc de Württemberg Eberhard Ludwig se plaignait de la piètre performance de ses musiciens en matière de musique française, « à la table princière ou bien dans les appartements ».210 Johann Beer note que la musique française se prêtait très bien à une exécution pendant les repas, et tout particulièrement les suites d’orchestre qui « sonnent agréablement à la table.211 » À la cour de France, l’utilisation de suites instrumentales pour la musique de table est documentée en particulier par les symphonies de Michel-Richard de Lalande, « qu’il faisoit exécuter tous les 15 jours pendant le Souper de Louis XIV et Louix XV ».212 Mais la remarque de Beer est aussi corroborée par les pratiques musicales à la cour de Hanovre dans les années 1680, à travers plusieurs témoignages du Mercure galant sur ce que le journal appelle les « Violons françois » du duc Ernst August. La première évocation de cet ensemble instrumental se trouve dans la description d’une fête donnée chez le Baron von Platen à la fin de l’année 1680, en l’honneur du prince d’Orange : Le soir Mr le Baron de Platen Grand-Maréchal, & Premier Ministre de cette Cour, traita chez luy Leurs Altesses. La Table estoit longue, & de vingt-quatre Couverts. [...] Les Violons François firent admirer pendant ce Repas les Airs doctes & touchans des Opéra du fameux Lully, ce qui ne fut pas un des moindres divertissemens de cette illustre Assemblée.213
Les violons français sont donc ici présents non pas à la cour, mais dans la maison privée d’un des plus hauts dignitaires de Hanovre. Leur répertoire est explicitement décrit comme étant extrait des opéras de Lully, preuve que le répertoire instrumental issu du répertoire d’opéra ou de ballet pouvait servir de musique de table, probablement sous forme de suite instrumentale. Un an plus tard, lorsque la reine du Danemark Sophie Amalia visite Hanovre, les Français sont à nouveau décrits dans un contexte de musique de table, avec une formulation très similaire : 207 208
209 210
211 212 213
Vorkamp, « Das französische Theater », p 174. Vorkamp, « Das französische Theater », p. 182. Le répertoire des pièces jouées à Hanovre par les comédiens français est minutieusement reconstruit dans la dernière partie de l’article, sur la base d’une grande variété de sources – notamment les exemplaires imprimés des livrets encore conservés et des extraits de la correspondance de Sophie de Hanovre, Madame Palatine et Leibniz. Johann Sigismund Cousser, Composition de musique, suivant la méthode françoise, contenant six ouvertures de théâtre accompagnées de plusieurs airs, Suttgart 1682. Décret princier du 7 oct. 1682. Josef Sittard, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Württembergischen Hofe, vol. 1, Stuttgart 1890, p. 63-64 : « wenn die Hoff Musici bei der Fürstlichen Tafel oder in den Zimmern ihre Aufwarttung haben, und diejenige beliebte Stück, die man gern hört, besonders die französische Entréen, Ouverturen, Courante und dergleichen prästiren sollen, entweder Ihnen, auß Mangel der Übung, solche nicht bekandt, oder aber, weil ihrer etliche bey einem parte und Buche sich behelffen müßen, nicth zurecht kommen können ». Beer, Musikalische Discurse, p. 64 : « Die Frantzösische Music, gleichwie sie einer sonderlichen Art ist, also brauchet sie auch sonderliche Liebhaber. Ihre Suiten klingen brav dey der Taffel, und darff sich derjenige, der sie stricht, den Ofen zum schrepffen nicht heitzen lassen. » Lionel Sawkins, A Thematic Catalogue of the Works of Michel-Richard de Lalande (1657–1726), Oxford 2005, p. 434-435. Mercure Galant, novembre 1680, p. 259-261.
– 171 –
Chapitre 3
Il y eut un magnifique Soupé, pour lequel on avoit dressé sept grandes Tables, outre celle de la Reyne, qui fut seulement de douze Couverts. […] Les Violons François firent des merveilles à leur ordinaire, & pendant tout le Soupé le Sr Farinel fit valoir les Airs du fameux Lully, qui fait admirer par tout les agrémens de sa Symphonie.214
Enfin, une troisième description l’année suivante fait à nouveau mention des violons français en relation avec la musique de table donnée chez le Baron von Platen : On n’oublia rien pour donner de l’éclat à cette Feste. Les Trompetes & les Timbales s’y firent entendre, aussi-bien que les Hautbois, & les Flûtes douces ; & les Violons François acheverent de charmer cette illustre Compagnie, qui prit grand plaisir à les écouter pendant le Repas.215
Ces différentes citations montrent que la musique de table, essentiellement instrumentale, constitue l’une des tâches essentielles pour les musiciens français en fonction à Hanovre. Il en va de même à la cour de Dresde : le document préparatoire pour le « Banquet bacchique » (1687) montre que les « Französische Violons » sont requis avant tout pour jouer à la table.216 La gravure d’un « Temple d’Honneur représenté au Grand Festin » donné le 12 mai 1719 à l’occasion de l’anniversaire d’Auguste le Fort montre d’ailleurs des musiciens sur une ballustrade à l’occasion d’un dîner (Illustration 3.3). Même si la musique de table ne semble pas avoir requis spécifiquement la présence de musiciens français, nul doute que leurs compétences étaient particulièrement appréciées dans ce domaine. Le répertoire joué demeure d’ailleurs identique au théâtre et à la table : non seulement les suites orchestrales de Lully, mais aussi les « Grands Concerts en partition » de Hanovre ou les suites orchestrales de Dresde pouvaient servir indifféremment dans les deux contextes. En 1733, la fameuse collection de Telemann intitulée Musique de Table commence d’ailleurs par une ouverture à la française suivie d’une suite. Le sous-titre des Concerti da camera de François Venturini, publiés à Amsterdam en 1714, semble indiquer que la musique de chambre est le lieu privilégié où s’accomplit une synthèse entre les styles français et italiens, dans un répertoire notamment instrumental. La Cammer-Musique que Telemann fait paraître en 1716, témoigne également de l’alliage de techniques françaises et italiennes pour un répertoire de chambre composé pour le hautbois.217 Mais la musique de chambre n’était pas seulement instrumentale. Même si la présence et les activités des musiciens dans un contexte semi-privé laissent beaucoup moins de traces que dans d’autres occasions plus formelles, il est hors de doute que certains se produisirent dans ce cadre, lors de concerts privés dans les appartements, pour de petites réunions ou simplement de manière informelle. Quelques musiciens de Dresde portent le titre officiel de musiciens de la chambre (« Kammermusiker ») parmi lesquels se trouvent beaucoup de chanteurs. C’est en particulier le cas de la chanteuse Pauline Le Borgne, engagée comme « Cammer-Sängerin » à Dresde en 1697 et du haute-contre François Godefroy Beauregard, aussi nommé « Cammer-Musicant » dans une source.218 François Le Riche est nommé « Cammer-Musicus » dans une source, tandis que lui et Simon Le Gros se voient attribuer le qualificatif de « Musicien de la chambre ».219 Enfin, on notera que la chambre pouvait accueillir les femmes de certains musiciens : Marguerite Prache du Tilloy rappelle qu’elle et son mari « ont eu l’honneur de servir le feu Roy de glorieuse mémoire l’espace de 34 ans l’un en qualité de Musicien de l’Orquêtre [sic] et la femme pour chanter au Theatre et a la Chambre ».220 Cette remarque montre que la musique de chambre était aussi bien instrumentale que vocale. De ce point de vue, la présence de huit grands « Concerts à chanter » dans un manuscrit en 214 215 216 217 218 219 220
Mercure galant, juillet 1681, p. 152-154. Mercure galant, septembre 1682, p. 207. Voir Chapitre 2, p. 107-108. Cf. Steven Zohn, Music for a Mixed Taste. Style, Genre and Meaning in Telemann’s Instrumental Works, Oxford 2008, p. 273-277. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 267. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 90. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/5, fol. 66. Lettre de Marguerite Prache du Tilloy à August III, Dresde, 7 juil. 1733. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/1, fol. 89.
– 172 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
Illustration 3.3. Matthäus Daniel Pöppelmann : Temple d’honneur représenté au grand festin donné aupre le 49e jour de la naissance de Sa Majesté le Roy de Pologne et Électeur de Saxe, Dresde 1718. D-DI, Mscr. Dresden J.3, Deutsche Fotothek, DDZ.
provenance de Hanovre, la diffusion très large des anthologies d’airs de cour français publiés par Ballard, ainsi que la présence de musique française dans les livres de musique compilés par les aristocrates allemands pour leur usage personnel est un témoignage de l’adaptation des genres vocaux profanes français et italiens dans un cadre privé et intime. L’église L’exécution de musique d’église française dans les chapelles ducales et princières est longtemps restée un phénomène inconnu, mais qui illustre très bien la double appartenance des musiciens français évoquée dans le chapitre précédent. En prenant part activement à la composition et l’exécution de musique pour le culte, les musiciens français, même s’ils sont à l’origine engagés pour le théâtre, remplissent par ce biais l’une des principales tâches et une fonction séculaire des Hofkapellen. Certains musiciens composèrent de la musique d’église : Stéphane Valoy compose plusieurs œuvres pour la chapelle luthérienne de Hanovre. Les sources françaises de musique d’église conservées à la cour de Dresde – petits motets français et motets à grand chœur – ainsi que la participation à la musique d’église des musiciens et comédiens français dans la nouvelle chapelle catholique de la cour rendent également plausible l’exécution d’un répertoire français pendant les cérémonies religieuses.221 221
Voir Chapitre 4, p.201-207.
– 173 –
Chapitre 3
La part dévolue à la musique d’église dans l’activité des musiciens français reste cependant difficile à mesurer autrement que par des bribes d’indices. Louis Gaudon, qui remplace Matthias Weßnitzer comme organiste de la cour (« Hoforganist ») à partir de 1698, représente un cas tout à fait exceptionnel.222 Une entrée dans le registre de 1682-1683 pourrait être interprétée dans le sens d’une implication de certains musiciens dans la musique de la chapelle du château : le 1er février 1683, la veille de la Chandeleur, 440 Thaler sont versés sans distinction ni motivation au prédicateur de la cour, aux pauvres, aux pages, au Hofmeister et aux musiciens.223 Ceci pourrait concerner la participation des musiciens français à une cérémonie liturgique extraordinaire, à laquelle auraient également pris part les pages et le prédicateur. Un autre cas d’organiste français est François de Tilly, organiste d’Auguste le Fort dans la « Pohlnische Kapelle » à Varsovie.224 Louis André, engagé comme compositeur de musique française à Dresde en 1720, figure à deux reprises dans un almanach de la cour publié en 1729 : d’abord parmi les « Musiciens vocals François » comme « Compositeur », puis parmi le personnel de la chapelle luthérienne de la cour (« Schloß= und Hof=Capelle ») comme « Capell=Meister » aux côtés de Johann David Heinichen.225 Il aurait donc été chargé de composer la musique pour la chapelle protestante de la cour, au même titre que Heinichen. Outre le répertoire vocal sacré qui était spécifiquement destiné à l’église, il est possible que la musique instrumentale et en particulier les suites d’orchestres avec leurs ouvertures aient également figuré au répertoire exécuté dans les chapelles. Steven Zohn émet ainsi l’hypothèse que plusieurs ouvertures de Telemann aient pu être jouées à la chapelle de Dresde à partir de 1725, dans le cadre d’une pratique dénommée Graduale instrumentaliter où de la musique était jouée par un petit groupe instrumental pendant l’offertoire de la messe.226 Les ouvertures à la française, bien connues pour leur gravitas et leur section centrale contrapunctique – deux qualités essentielles de la musique d’église – auraient pu fournir un choix tout à fait convaincant dans ce cadre. Identités remarquables Parmi les musiciens français en activité dans l’Empire, certains se distinguent par l’exercice de fonctions spécifiques au sein des ensembles musicaux français, voire plus généralement à l’intérieur des Hofkapellen. Trois groupes retiendront ici notre attention : les chefs de bandes de violons, souvent dotés du titre de Konzertmeister ou maître des concerts, les hautboïstes qui se distinguent de la masse de leurs collègues violonistes par la pratique d’instruments à vents parfois récemment inventés ou perfectionnés et dont la carrière se situe bien souvent à l’intersection des chapelles de cour et de la musique militaire, ainsi que les chanteuses et actrices, qui font apparaître l’ampleur d’une présence féminine bien souvent invisible dans les archives institutionnelles des Hofkapellen. Maîtres de chapelle, maîtres de concert La place spécifique des chefs de bandes de musiciens français au sein de la hiérarchie des Hofkapellen se traduit par des compétences élargies et un salaire relativement élevé. Cette fonction est le plus souvent désignée par le titre de maître des concerts ou Konzertmeister, à l’exception de Philippe La Vigne à Celle qui est toujours appelé Kapellmeister dans les registres de comptabilité et les documents administratifs, sans doute parce qu’il s’agit d’un cas unique où les musiciens fran-
222 223 224 225 226
NLAH, Hann. 76c A Nr. 223, p. 518 : « Gaudon Musicant alß Hof Organiste, 183 Thlr : 130 Thlr Besoldung, 50 Thlr Kostgeld, 3 Thlr für ein deputat Schwein. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 208, p. 356 : « Febr. 1 dem hoffprediger, Armen, Pagen Hoffmeister und Musicanten, 440 Thlr. » HStA Dresden, 10036 Finanzarchiv, Loc. 32623 LII Gen. Nr. 221, fol. 10. Das Jetz lebende Königliche Dresden, Dresde, 1729, p. 22 et p. 163. Louis André apparaît dans toutes les livraisons de l’almanach comme compositeur de musique pour la chapelle protestante de 1729 à 1737 : Horn, Die Dresdner Hofkirchenmusik, p. 51. Zohn, Music for a mixed taste, p. 186-189.
– 174 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
çais représentent la (quasi-)totalité de la Hofkapelle. Dans les chapelles ducales et princières allemandes, le grade le plus élevé est celui de Kapellmeister : c’est lui qui a la charge de l’ensemble de la musique, aussi bien instrumentale que vocale.227 Le domaine de compétence du Konzertmeister est plus restreint : bien que les usages varient selon les endroits, ce titre désigne généralement une personne en charge de l’exécution de musique instrumentale et de la direction de l’orchestre, souvent un violoniste qui peut diriger de son pupitre.228 Il apparaît donc comme primus inter pares au sein de l’orchestre : le maître des concerts Heinrich Schulze est ainsi désigné comme « premier de l’orguestre » dans une liste de personnel de la chapelle polonaise d’Auguste le Fort.229 C’est le titre de Konzertmeister que reçoivent Jean-Baptiste Farinel et Stéphane Valoy à Hanovre ainsi que Jean-Baptiste Volumier à Dresde.230 À Osnabrück, la fonction occupée par Élie Jemme est plus floue : il est désigné dans un acte français comme « chef de la musique de Messieurs les princes de Brunswick » mais aucun document allemand ne mentionne de titre équivalent. De nombreux autres Français ont visiblement occupé les fonctions de maître des concerts dans les cours allemandes : Haumale des Essart est Konzertmeister à la cour de Württemberg entre 1724 et 1732231, et Jean-Charles Petit a servi comme « Maître de Musique & Directeur de la Chapelle » à la cour d’Eisenach.232 Ce titre était en usage depuis longtemps dans les cours allemandes : parmi les premières personnes à le porter figurent David Pohle, Konzertmeister à Halle pour le duc de Magdeburg en 1660, et Clemens Thieme, à la cour de Zeitz à partir de 1664.233 À Dresde, le titre de Concertmeister apparaît pour la première fois en 1666 pour Constantin Christian Dedekind, et le poste est pourvu sans interruption jusqu’à Volumier et son successeur Pisendel.234 Telemann commence par assister Hebenstreit comme Konzertmeister à la cour d’Eisenach, avant de prendre sa suite comme Kapellmeister en 1709.235 Outre la direction de l’orchestre et la supervision de la musique instrumentale, les fonctions de maître des concerts pouvaient inclure la préparation des parties séparées pour l’orchestre, l’achat de nouveaux instruments et leur entretien, ainsi que la gestion des réserves de cordes et de colophane. Il pouvait aussi remplacer le Kapellmeister lorsque celui-ci était absent ou en cas de vacance du poste.236 Même si des cas d’indépendance existent, le maître des concerts est généralement soumis à la tutelle hiérarchique du Kapellmeister. L’acte de promotion de Johann Sebastian Bach comme Konzertmeister à la cour de Weimar précise que sa nouvelle fonction lui « assigne le rang après celui du Vice-Capellmeister Drese.237 » Il précise également que Bach
227
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
Vogler envisage même quatre fonctions de direction pour une Hofkapelle bien fournie : un « Musik-Direktor » secondé d’un « Capellmeister » pour la gestion de l’opéra, et un « Instrumentalmusik-Direktor » secondé par un « Concertmeister » pour la musique instrumentale et la gestion de l’orchestre. Georg Joseph Vogler, « Instrumentalmusik-Direktor », in : Deutsche Encyclopädie, oder Allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften, éd. Ludwig Julius Friedrich Höpfner, vol. 17, Francfort 1793, p. 656-657. Pour excellent aperçu sur cette fonction, voir Köpp, Johann Georg Pisendel, p. 217-224. Żórawska-Witkowska, « The Saxon Court of the Kingdom of Poland », p. 57. Si le décret officiel de nomination de Volumier comme « Maitre des Concerts » ne date que du 8 août 1720, une liste de personnel de l’orchestre du 13 août 1709 le qualifie déjà de « Concertmeister Volumnier ». Voir Chapitre 4, p. 224. Owens, « The Württemberg Hofkapelle », p. 232-235. Jean-Charles Petit, Apologie de l’excellence de la musique, Londres 1740. Köpp, Johann Georg Pisendel, p. 218-221. Köpp, Johann Georg Pisendel, p. 225. Laurenz Lütteken, « Telemann, Georg Philipp », in : MGG online. Rüdiger Thomsen-Fürst, « The Court of Baden-Durlach in Karlsruhe », in : Music at German courts, 1715-1760. Changing Artistic Priorities, dir. Samantha Owens, Barbara M. Reul et Janice B. Stockigt, Woodbridge 2011, p. 365-387, ici p. 378. BD II, Dok. 66, p. 53, 2 mars 1714 : « haben des regierenden Herzogs Hochfl. Dhl. dem bisherigen Hof-Organisten Bachen, uf sein unterthstes Ansuchen, das prædicat eines Concert-Meisters mit angezeigtem Rang nach dem Vice-Capellmeister Dreßen, gndst conferiret, dargegen Er Monatlich neüe Stücke ufführen, und zu solchen proben die Capell Musici uf sein Verlangen zu erscheinen schuldig v. gehalten seyn sollen ».
– 175 –
Chapitre 3
devra « faire exécuter chaque mois de nouvelles pièces ». Mais la composition de nouvelles pièces ne faisait pas toujours partie de la fonction : alors que Stéphane Valoy et son successeur François Venturini composent à l’évidence de la musique pour la cour de Hanovre, Jean-Baptiste Farinel et Jean-Baptiste Volumier ne semblent pas avoir beaucoup écrit. Ainsi n’est-ce pas Volumier, mais le Kapellmeister Johann Christoph Schmidt qui compose la musique du divertissement français de 1719. À partir de 1720, la cour emploie Louis André comme « Compositeur de musique française » pour remplir cette tâche, ce qui indique que Volumier ne composait sans doute pas. Jean-Baptiste Farinel fournit un exemple de carrière très typique pour un Konzertmeister.238 Installé dans ses fonctions à l’arrivée de la cour de Hanovre en 1680, il est le seul musicien désigné par son nom et perçoit un salaire cinq fois plus élevé que celui de ses collègues.239 Baptisé le 30 janvier 1655 à la cathédrale de Grenoble, il était le fils d’un musicien de Christine de France à la cour de Savoie.240 En 1649, son père Robert Farinel s’était retiré à Grenoble où il fait baptiser son fils aîné Michel. Celui-ci affirme avoir pris en charge, après la mort de leur père, l’éducation musicale de son petit frère.241 Seules quelques sources musicales éparses témoignent de l’activité compositionnelle de Farinel, sans doute liée à son poste de Konzertmeister. Un « Concert de Farinelli pour le Nouvel An 1706 » se trouve dans un un livre manuscrit pour la flûte qui comporte treize « Concerts pour le Nouvel An » – tous anonymes exceptés le premier attribué à Venturini et le quatrième attribué à Farinelli – ainsi que d’autres pièces notées en clef de sol sans basse continue.242 Un air italien pour soprano et quatuor à cordes, conservé à la bibliothèque de Schwerin, est également attribué à Farinel. Au vu de ce petit nombre de sources, il semblerait que Farinel ait assez peu composé. Comme nous le verrons, il y a beaucoup plus d’indices qui conduisent à penser que Stéphane Valoy puis François Venturini étaient les principaux pourvoyeurs de musique française pour la cour, et que par conséquent Farinel n’a pas véritablement exercé d’activité compositionnelle d’envergure. L’attribution à Farinel d’une cantate intitulée Herr, gedenke mein, wenn du in dein Reich kommst (« Seigneur, souviens-toi de moi quand Tu entreras dans Ton royaume »), qui aurait été composée à l’occasion de la prise de possession du trône d’Angleterre par George Ier et aurait déplu à ce dernier, provoqué la disgrâce du maître des concerts et son exil à Venise, semble reposer sur une erreur de Friedrich Chrysander.243 Le texte de la cantate aurait été adressé obliquement au nouveau souverain en l’engageant à ne pas oublier son maître de chapelle français. Les bandes de hautbois, entre musique militaire et musique de cour Si les ambassadeurs pouvaient avoir des musiciens dans leur suite, c’était aussi le cas de certains officiers français. En novembre 1679, le marquis d’Humières, Louis de Crevant, célèbre maréchal de France et officier militaire qui allait être nommé Grand maître de l’artillerie de France quelques années plus tard, arrive à la cour de Celle accompagné de sa suite, laquelle comprend
238 239 240
241
242 243
Farinel est contamment désigné comme « Musicant », mais il avait la direction de l’ensemble français. Il est appelé « Capellmeister » dans un registre de compte de 1713-1714 : NLAH, Hann. 76c A Nr. 237, p. 549 (« Farinelli, welcher bis Ultimo 1713 als hiesiger Capellmeister jährlich 700 Thlr. »). NLAH, Hann. 76c A Nr. 100, p. 198. AD Isère, AC 185/30, registres de Saint-Hugues et Saint-Jean, 1653-1655: « Le 30me Janvier 1655 jay baptisé Jean Farinel fils de Sieur Robert et de damoisselle [sic] Charlotte Reymon aage de 15 jours a reçu pour parrin noble Jean de Repelin, fils de feu noble Urbain de Repellin et de damoisselle Helene de Nadinet et pour marrene damoisselle Martiane de Bergerant veuve de feu noble François de Cogne sieur de Clesne. » Une lettre des archives de Turin, figurant dans le fonds Écorcheville de la Bibliothèque nationale, indique que Robert Farinel « ditto il piccolo » fut musicien de Christine de France entre 1635 et 1649 : F-Pn, Fonds Écorcheville, boîte n° 2. F-Pn, Fonds Écorcheville, boîte n° 2, « Réponse de Sieur Michel Farinel », fol. 1 : « Ces deux frères ont eu un père qui leur laissa fort peu de bien ce fut sur Michel l’ainé que roula tout le soin de l’éducation de la famille, il éleva son frère et le mit par son application en état de se faire admirer dans son art, ce qui ne se fit poinct sans dépense, c’est un fait connu de tout Grenoble ». D-HVl, Ms. IV 417. Voir Albertyn, « The Hanover orchestral repertory ». Friedrich Chrysander, Georg Friedrich Händel, vol. 1, Leipzig 1858, p. 417.
– 176 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
des musiciens : il faut loger ces gens, et la cour paye leur quartier dans une auberge de la ville.244 L’adoption de pratiques et de modèles français au sein des régiments impériaux, liée entre autres à la présence accrue d’officiers huguenots dans les cadres de l’armée à partir des années 1680, se manifeste aussi dans le domaine de la musique militaire.245 Là, ce sont très souvent les bandes de hautbois régimentaires apparues vers 1700 qui témoignent de l’adoption de modèles français au sein de certains régiments.246 L’appartenance aux corps d’armée semble avoir été pour certains musiciens français un vecteur de mobilité, illustrant le rôle central des pratiques militaires dans les circulations culturelles et humaines.247 La musique militaire, élément constitutif de l’art de la guerre et de l’anthropologie de la violence à l’époque moderne, reste cependant souvent un point aveugle de l’histoire de la musique. Dans son manuel de guerre publié en 1726, l’officier saxon Hans Friedrich von Flemming (officier de Brandebourg qui appartenait à la même famille que Jakob Heinrich) mentionne à plusieurs reprises l’adaptation dans les armées impériales de la pratique française consistant à utiliser les hautbois comme instruments militaires : Les fifres du régiment étaient autrefois aussi appelés Schallmey-Pfeiffer, car alors ces instruments, qui rendaient un son clair, étaient joués en tête du régiment, pour donner du courage aux soldats du rang. Mais comme ils étaient difficiles à jouer et qu’ils remplissaient les oreilles d’une façon très désagréable, à la place des Schallmeyen allemandes sont peu à peu apparus les Hautbois français, qui sont maintenant en usage un peu partout.248
La nouveauté de cette usage est déjà notée en 1690 par le musicien et écrivain Wolfgang Caspar Printz.249 Le nombre de hautbois était généralement plus important que celui des anciennes « Schallmeyen », qui étaient généralement groupées par quatre (deux dessus, un alto et une dulciane) tandis que les hautbois sont généralement six (deux dessus, deux tailles et deux bassons) – « car les hautbois ne sont pas si puissants, mais sonnent beaucoup plus doucement que les Schallmeyen ».250 Les hautboïstes étaient apparemment détenteurs d’une tradition d’excellence, et leurs capacités musicales étaient loin de se résumer aux appels et aux sonneries militaires. Flemming note qu’ils doivent être polyvalents et jouer d’autres instruments de musique : matin et soir, ils jouent devant le quartier du colonel « une marche, une entrée ou quelques menuets, si le colonel en est amateur ». 244 245 246 247 248
249
250
NLAH, Hann. 76c A Nr. 205, p. 327 : « Der Wirthin im Weißen Roß für Bewirthung. Ao. 1679 Nov. 25 des H. Marquis d’Humiers leute 70 Thlr. Nov. 10 deßen Musicanten, Cammerdieners etc. 60 Thlr. ». Voir War, Religion and Service. Huguenot soldiering, 1685-1713, dir. Matthew Glozier et David Onnekink, Aldershot 2007. Pour un aperçu général : Haynes, The Eloquent Oboe, p. 158-164. Les développements qui suivent doivent beaucoup aux échanges que j’ai pu avoir avec Émilie Dosquet, entre autres dans le séminaire « Guerre et altérité à l’époque moderne » qu’elle a organisé avec Arnaud Guinier à l’École Normale Supérieure en 2015. Je la remercie de m’avoir engagé à réfléchir sur cet ensemble de questions. Hans Friedrich Flemming, Der vollkommene Teutsche Soldat welcher die gantze Kriegs-Wissenschafft, insonderheit was bey der Infanterie vorkommt, vorträgt, Leipzig 1726, p. 181 : « Die Regiments-Pfeiffer wurden vor Zeiten auch Schallmey-Pfeiffer geheissen, indem damahls solche Instrumenta, als die einem hellen Laut von sich geben, vor dem Regiment hergeblasen wurden, um die gemeinen Soldaten hiedurch destomehr aufzumuntern. Nachdem sie aber schwer zu blasen, und in der Nähe auf eine gar unangenehme Art die Ohren füllen, so sind an statt der teutschen Schalmeyen nachgehends die Frantzösischen Hautbois aufgekommen, die nunmehro fast allenthalben im Gebrauch sind. » Wolfgang Caspar Printz, Historische Beschreibung der edelen Sing- und Kling-Kunst, Dresde 1690, p. 179: « Zu unserer Zeit noch, hat der fürtreffliche Held, Herr Graf von Sparr, General-Major, den Gebrauch der Schallmeyen und Fagotten in dem Kriege eingeführet. Vor wenigen Jahren seyn die Frantzösis. Schallmeyen, Hautbois genannt, auffkommen, und im Kriege bräuchlich worden. » Sur la diffusion du hautbois en Allemagne, voir notamment Haynes, The Eloquent Oboe, p. 313-340. Flemming, Der vollkommene Teutsche Soldat, p. 181 : « Die Anzahl dieser Regiments-Pfeiffer ist unterschieden. Da die Schalmeyen noch Mode waren, hatte man nur vier Mann, als zwey Discantisten, einen Alt, und einem Dulcian. Nachdem aber die Hautbois and deren Stelle gekommen, so hat man jetzund sechs Hautboisten, weil die Hautbois nicht so starck, sondern viel doucer klingen, als die Schallmeyen. Um die Harmonie desto angenehmer zu completiren, hat man jetzund zwey Discante, zwey la Taillen, und zwey Bassons. »
– 177 –
Chapitre 3
Quand celui-ci reçoit « des hôtes ou convoque des assemblées, les hautboïstes se font entendre sur des Violinen et violons, ainsi que sur des fleutendoucen et d’autres instruments. Le Premier d’entre eux doit maîtriser la composition, pour mieux régler la musique.251 » Une Hautboistenschule est créée en 1724 à Postdam, où les orphelins de militaires tombés au front pouvaient étudier la musique.252 C’est déjà à la cour de Brandebourg qu’avaient été formés sous la direction de Gottfried Pepusch six hautbois engagés en 1706 par la cour de Hanovre.253 En France, l’institution chargée de la formation des musiciens militaires était la Grande Écurie du roi, dont proviennent plusieurs hautboïstes.254 Pierre Maréchal fourni un bel exemple de carrière transnationale : apparemment originaire de Bourgogne, il fut embauché comme hautbois à Celle à partir de la Saint-Michel 1683.255 Il peut être identifié à un tambour du roi nommé Pierre Mareschal, dont certains actes des Archives Nationales documentent la vie à Paris entre 1650 et 1678. Mareschal fait baptiser son fils Jean à Saint-Sulpice le 2 août 1650.256 Il est décrit dans un contrat de novembre 1653 comme « tambour de la compagnie colonelle du régiment des gardes du roi ».257 Il habite alors rue Guisarde avec Jeanne Beauvallet sa femme, et achète la charge de tambour des écuries du roi à Anthoine Auger, marchand perruquier. En 1667, il apparaît parmi les « Fifres et tambours » dans les papiers du Grand Écuyer de France : il habite alors rue des Canettes, près le séminaire, faubourg Saint-Germain.258 En 1673, une insinuation du Châtelet de Paris enregistre une donation mutuelle entre « Pierre Mareschal dit Champagne, tambour ordinaire de la chambre de Sa Majesté » et sa femme, qui demeurent rue du Lude, paroisse Saint-Sulpice.259 Enfin, le 15 juin 1678, le brevet de la charge de tambour de la Grande Écurie du Roi est remis à Thomas Mathieu dit Du Verger, successeur de Pierre Maréchal, démissionnaire.260 Si l’identification que nous proposons est exacte, Maréchal aurait été un homme mûr lors de son arrivée à Celle : ceci est plausible, puisque Pierre Maréchal disparaît des registres de Celle à sa mort en 1696.261 Rappelons que l’intégration de hautboïstes ayant appartenu à des régiments dans les Hofkapellen n’avait rien d’exceptionnel, comme le montre l’engagement en 1697 à Celle de Hans Jürgen Vogt et Ernst Heinrich Grimm, anciens hautbois dans le régiment des Dragons.262 Ces derniers, contrairement à Maréchal, restent toutefois soumis à un régime fiscal spécifique aux militaires, puisque 60 Thaler sont déduits de leur salaire annuel et reversés mensuellement à la Kriegers Cassa. Cinq ans après l’arrivée de Maréchal, Gilles Héroux fut engagé dans la Hofkapelle de Hanovre. Originaire de Vernou en Brie, aujourd’hui Vernou-sur-Seine, il est marié à Gabrielle
251
252 253 254 255
256 257 258 259 260 261 262
Flemming, Der vollkommene Teutsche Soldat, p. 181 : « Es machen die Hautboisten alle Morgen vor des Obristen=Quartier ein Morgen=Liedgen, einem ihm gefälligen March, eine Entree, und ein paar Menuetten, davon der Obriste ein Liebhaber ist ; Und eben dieses wird auch des Abends wiederhohlet, oder wenn der Obriste Gastgebothe oder Assembleen anstellt, so lassen sie sich auf Violinen und Violons, wie auch Fleutendoucen und andern Instrumenten hören ; Der Premier unter ihnen muß das Componiren verstehen, um die Musique desto besser darnach zu reguliren. » Haynes, The Eloquent Oboe, p. 322-323. NLAH, Hann. 76c A Nr. 125, p. 321. Heinrich Sievers, Die Musik in Hannover. Die musikalischen Strömungen in Niedersachsen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Hanovre 1961, p. 58. Voir notamment Michel Brenet [Marie Bobillier], La Musique militaire, Paris 1917. Susan Goertzel Sandman, « The Wind Band at Louis XIV’s Court », Early Music, 5/1, 1977, p. 27-37. NLAH, Hann. 76c A Nr. 210, p. 459 : « Pierre Marechall, gleich vorigen laut Befehlß dat: den 29. Novembr. 1684, 150 Thlr. 21 gr. Noch demselben laut selbiges befehlß, nachstendig von Michaelis 1683 biß Ost: 1684, 75 Thlr. 10 gr. 4 d. » L’origine « de Langer in Borgundia » est donné par BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufen 1671-1699, p. 141. F-Pn, Fichier Laborde, NAF 12150, fiche n° 46033. AN, Minutier cental, LXX-147, 19 nov. 1653. Benoît, Versailles et les musiciens du Roi, p. 411. AN, Insinuations, Y 227, fol. 118. Marcelle Benoît, Les évènements musicaux sous le règne de Louis XIV. Chronologie, Paris 2004, p. 156. NLAH, Hann. 76c A Nr. 233, p. 564 : « Pierre Marechall nachgelaßenen Kindern ». NLAH, Hann. 76c A Nr. 223, p. 563 : Hanß Jürgen Vogt et Ernst Heinrich Grimm, « bey Serenissimi Dragoner Guarde, und zum hoffmusicanten mit angenommenen Hautbois. »
– 178 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
Tissier, originaire de Bourges.263 Il faisait partie de la Grande Écurie comme « joueur de basse de cromorne et trompette marine » depuis au moins 1666.264 Gilles Héroux avait démissionné en 1679 de sa charge, alors accordée à Alexandre Danican dit Philidor.265 Il reste en service à Hanovre pendant un peu plus de deux ans, puisqu’il meurt apparemment vers Pâques 1691.266 La proximité de parcours entre Pierre Maréchal et Gilles Héroux est assez frappante, puisqu’ils appartenaient tous deux à la Grande Écurie qu’ils quittent à un an d’intervalle : juin 1678 pour Maréchal, mai 1679 pour Héroux. On notera la proximité chronologique de ces deux départs avec la signature du traité de paix séparé entre la France et les deux duchés de Celle et Hanovre en janvier 1679. Peut-être les subsides militaires offert dans ce traité par la France à Hanovre ontils été accompagnés d’un transfert de personnel : ils auraient alors fourni à ces deux musiciens, proches de la musique militaire, une occasion de mobilité géographique. Mais les hautbois migrent le plus souvent en goupe. Ainsi Denis Le Tourneur reçoit-il une augmentation de 60 Thaler par an en sa qualité de hautbois à partir du moment où arrivent cinq autres hautboïstes en 1681 – on note que le nombre de six hautbois indiqué comme norme par Flemming est respecté ici. Leurs noms sont les suivants : Beauregard, Saint-Amour, Forlot, La Garenne et Courbesastre.267 Saint-Amour est présent à Celle comme un laquais à partir de septembre 1676 avant d’être embauché comme hautbois en 1680.268 Il a donc sans doute reçu sa formation musicale en tant que laquais, alors qu’il était déjà à la cour Celle. Enfin, à Pâques 1688, trois hautbois ou Pfeiffer sont engagés à Hanovre : Babel, Barré et Héroux.269 Une troupe particulièrement nombreuse de dix hautbois est engagée à Vienne en 1696 pour le compte de la cour de Dresde.270 Parmi les nouveaux venus, on peut repérer trois noms français : Nicolas Delvaux, Charles Henrion et Jean-Baptiste Henrion. En 1704, ces deux derniers musiciens sont listés dans les Cammer=Musici comme hautboïstes, et semblent résider tous les deux en Pologne.271 Charles et Jean-Baptiste Henrion apparaissent ensuite dans une liste de personnel datée d’août 1709, signée par le baron de Mordaxt. Le premier est qualifié de « Hautbois primo » avec un salaire de 300 Thaler, le second apparaît comme « Hautbois secondo » avec le même salaire.272 Ce que les violonistes peuvent vivre avec les troupes de comédiens, les hautbois semblent donc l’expérimenter avec des troupes régimentaires d’instrumentistes qui se constituent et circulent en groupe. Chanteuses et actrices françaises Les structures musicales des Hofkapellen sont très largement composées d’hommes, mais les nombreuses danseuses, actrices et chanteuses françaises que nous avons croisées suffisent à démontrer que les migrations musicales sont loin d’être un phénomène exclusivement masculin. En effet, les listes de personnel font toujours apparaître une parité assez stricte entre hommes et femmes au sein des troupes de comédiens, et à Dresde parmi les danseurs. L’exercice professionnel d’un 263 264 265
266 267 268 269 270 271 272
BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, 24 avr. 1691, p. 144. Benoît, Musiques de Cour, p. 15-18. Benoît, Musiques de Cour, p. 68. Alexandre, fils aîné d’André Danican dit Philidor l’Aîné, était alors âgé de trois ans et mourut dès 1684. Le brevet de la charge de basse de cromorne et trompette marine de la Grande Écurie du Roi est établi le 30 mai 1679 en faveur d’Alexandre Danican dit Philidor, successeur de Gilles Héroux, démissionnaire. Le 15 fév. 1676, le brevet de la charge de cromorne et trompette marine de la Grande Écurie du Roi avait déjà été accordé à François Arthus dit Plumet, successeur de Gilles Héroux, démissionnaire : Benoît, Les évènements musicaux, p. 146. Cependant, en 1677, Héroux apparaît toujours dans l’état des officiers du roi : Benoît, Musiques de cour, p. 56. NLAH, Hann. 76c A Nr. 110, p. 280. NLAH, Hann. 76c A Nr. 216, p. 518-519. NLAH, Hann. 76c A Nr. 206, p. 435 : « St. Amour vom 1/2 Jahr, da er zum Hautbois bestellet ». NLAH, Hann. 76c A Nr. 108, p. 254 : « Ferner noch dreyen Pfeiffern von Mich: 1688 biß Ostern 1689, gleich vorhergehenden alß Babel, Barrex, Herux, 172 Thlr. 18 gr. | 661 Thlr. 9 gr . » Voir Chapitre 2, p. 108-109. HStA Dresden, 10036 Finanzarchiv, Loc. 32623 Rep. LII Gen. Nr. 221, fol. 10-12. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 110.
– 179 –
Chapitre 3
instrument demeure cependant largement l’apanage des hommes. Si une certaine Marianne est dépeinte jouant de la viole d’amour chez le représentant français à Wolfenbüttel, une seule femme occupe des fonctions musicales instrumentales à la cour : une mystérieuse Du Masis, « joueuse de clavecin » à Dresde autour de 1728.273 Cependant, il est tout à fait concevable que les femmes des musiciens français en poste dans les cours de Celle, Hanovre et Dresde, aient joué un rôle important dans la musique sans recevoir de salaire régulier pour leur travail, dans la mesure où leur mari assurait la subsistance du foyer. Les femmes sont particulièrement bien représentées dans la musique vocale. On dénombre dans notre échantillon sept « chanteuses » : Anne-Sophie Bonne à Hanovre, Nanon à Osnabrück, ainsi que Pauline Le Borgne, la Clavel, Louise Dimanche, et Marguerite Prache du Tilloy à Dresde. Par comparaison, le nombre de chanteurs hommes est proportionnellement très restreint puisque seuls les trois chanteurs de la cour de Dresde, Beauregard, Diard et Drot, sont explicitement qualifiés comme tels dans les listes de personnel – ce qui ne signifie naturellement pas que les acteurs, danseurs ou instrumentistes n’étaient pas susceptibles de chanter, comme on peut le voir à l’occasion dans les livrets de divertissement. Tout comme Nanon, qui n’apparaît qu’accidentellement dans la correspondance de Sophie, Anne-Sophie Bonne, qui était apparemment active à Osnabrück, apparaît par hasard dans la comptabilité de Hanovre à la fin de l’année 1668.274 Elle est mentionnée jusqu’en 1677 dans les comptes de la cour comme chanteuse française (« frantzösische Sängerin »). L’acte de sépulture de l’une de ses enfants montre qu’elle est la femme de Michael Jemme, probablement le frère d’Élie Jemme.275 Un acte de baptême où elle remplit le rôle de suppléante de la marraine montre qu’elle est encore dans la région en novembre 1677, mais c’est là le dernier renseignement que nous avons sur elle.276 À la cour de Dresde, plusieurs chanteuses françaises sont embauchées. La première d’entre elles, Pauline Le Borgne, est engagée comme « Cammer-Sängerin » le 28 janvier 1697, quelques jours seulement après l’embauche de la première troupe de hautboïstes par Auguste Le Fort. On a vu que son contrat d’engagement détaille la nature de ses devoirs : elle doit « chanter dans les opéras, ainsi que toutes les fois, dans tous les lieux qu’il plaira à son Altesse Électorale.277 » Son père, Joseph Le Borgne, est engagé en même temps qu’elle comme maître d’hôtel.278 Pauline Le Borgne semble avoir séjourné à Hanovre avant son arrivée à Dresde, puisqu’elle est en 1695 la marraine d’un enfant baptisé dans la paroisse catholique de cette ville : Paul Joseph Le Borgne, originaire de Viviers dans l’Yonne, fait baptiser avec sa femme Elisabeth von der Stärn (ou Van Derstar), originaire de La Haye, quatre enfants.279 Elle pourrait donc avoir fait le déplacement en Saxe avec la troupe de comédiens du duc de Hanovre, que ce dernier avait prêté à la cour de Dresde pour le carnaval de l’année 1696. Le cas de Marguerite Prache est particulièrement intéressant, car elle n’apparaît presque pas dans les listes de personnel : elle ne figure pas dans la liste de personnel de l’opéra de 1699, de sorte qu’on ne peut pas savoir si elle était venue en compagnie de son mari. Elle ne figure pas non plus dans les Hofbücher. Sa première apparition a lieu dans deux listes de personnel de 1718 et 1719, dans le groupe des chanteurs français.280 Un almanach paru en 1729 à Dresde fait également figurer Marguerite Geneviève Prache de Tilloy parmi les « Discantistes » des « Musiciens vocals François » en compagnie de Louise Dimanche et d’une certaine Brunet.281 Elle devait être 273 274 275 276 277 278 279 280 281
Sur Marianne, voir Chapitre 1, p. 35. Sur la Du Masis, le seul document est : HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/5, fol. 175 et 180. NLAH, Hann. 76c A Nr. 88, p. 318 : « der Sangerinnen von Oßnabrüg Annen Sophien Bonnen. » BAHild, KB Nr. 779, Hannover St. Clemens, Beerdigungen 1666-1710, 23 mars 1671, p. 9. Sur les Jemme, voir Chapitre 2, p. 90-93. BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, 17 nov. 1677, p. 66. HStA Dresden, 10006 OHMA, K III Nr. 8, fol. 313. Pour la transcription de ce contrat, voir Chapitre 2, p. 104. HStA Dresden, 10006 OHMA, K III Nr. 8, fol. 313. BAHild, KB Nr. 777, Hannover St. Clemens, Taufbuch 1671-1699, p. 125, 141, 164 et 183. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 117 et 140. Das Jetztlebende Dresden, 1729, p. 22.
– 180 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
rattachée comme son mari à la comédie, puisqu’en 1720, juste après la mort du directeur de la comédie française Villedieu, elle voit comme Robert du Hautlondel son salaire annuel de 300 Thaler payé directement par la General Accis-Casse.282 Louise Dimanche est engagée en janvier 1726 comme chanteuse, et perçoit le salaire d’une actrice qui est renvoyée juste avant son arrivée.283 Elle est renvoyée en février 1732.284 Ses activités musicales ne se limitent pas à Dresde, mais prennent également place à Varsovie, notamment à l’occasion de la première visite du prince Friedrich August entre décembre 1725 et septembre 1726 : Dimanche aurait en particulier chanté des cantates françaises de Campra et Jean-Baptiste Stuck.285 Avant son arrivée à Dresde, Louise Dimanche a derrière elle une belle carrière de danseuse, d’actrice et de productrice dans le Nord de la France et les Pays-Bas. Membre de la troupe de Grimberghs, elle danse au Théâtre de la Monnaie en 1715 dans deux productions : les Nouvelles Fêtes vénitiennes de Danchet et Campra, et l’Omphale d’Houdar de La Motte et Destouches. En 1718, elle est chanteuse et première danseuse à Lille, puis directrice du théâtre de cette ville en 1721, pour quelques semaines seulement, puis en 1722. En octobre 1721, elle dirige le Grand Théâtre de Bruxelles, pour céder ensuite le bail à Thomas-Louis Bourgeois. Elle est encore signalée à La Haye en septembre 1722, avec son mari le chanteur Nicolas Demouchy. À la mort de ce dernier, Louis Dimanche regagne Lille où elle reforme une troupe, avec laquelle elle vient se produire à Bruxelles. Le 23 février 1737, elle y épouse en secondes noces le comédien Jean-Nicolas Prévost.286 Cette carrière entre musique et théâtre met parfaitement en lumière le fait que la Hollande se situe bel et bien « au centre des affaires » pour les artistes français qui sont entre la France et l’Empire. Les tâches du musicien L’un des traits les plus marquants de l’activité des musiciens français est sa polyvalence. Lorsque l’on parcourt les registres de compte, les listes de personnel ou les livrets, on est souvent frappé par la grande homogénéité de fonctions qui caractérise les comédiens, les danseurs ou les musiciens. Ce souvent bien souvent les mêmes personnes qui dansent, chantent, déclament. Contrairement à leurs collègues italiens spécialisés dans le chant, ou à leurs collègues allemands, qui sont plus proches des fonctions traditionnelles des musiciens dans les Hofkapellen, les musiciens français jouent d’un instrument, font trois pas de danse, manient des claquettes, pratiquent l’escrime, déclament sur scène, chantent à l’église. Les registres de comptabilité offrent un aperçu privilégié sur cette activité multiple, par des notations souvent très brèves mais précises. En effet, le travail des musiciens ne consistait pas seulement à jouer, mais pouvait comporter quelques à-côtés, comme l’entretien des instruments : en 1679, Guillaume Josse est payé quelques Thalers pour l’entretien des instruments.287 On note aussi que des castagnettes sont fournies à Claude Pécour.288 Cependant, la plus grande part des activités annexes semble avoir été dévolue à l’enseignement. L’enseignement de la musique et de la danse Les musiciens enseignaient le plus souvent la musique et la danse. Ce dernier enseignement ne se limitait pas forcément à l’apprentissage d’une technique chorégraphique : les maîtres de danse sont fréquemment chargés d’enseigner l’escrime, le français, les bonnes manières, et parfois même l’équitation à leurs élèves. Ainsi Louis Le Conte, musicien originaire de Troyes engagé à
282
283 284 285 286 287 288
HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 202: « Die Sängerin Marguerite Prache hat jährlich erhalten von des Villedieu Geldern 333 Thlr 8 gr, bekommen 66 Thlr 16 gr Zulage, also zusammen 400 Thlr aus der General Accis Casse, die alte besoldung vom 1 April, die Zulage vom 1 Januari dieses Jahres an, quartaliter anticipando. » Sur le paiement de Robert du Hautlondel, voir Chapitre 2, p. 103. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/5, fol. 141. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/5, fol. 24. Żórawska-Witkowska, « The Saxon Court of the Kingdom of Poland », p. 60. Jean-Philippe van Aelbrouck, Dictionnaire des danseurs à Bruxelles de 1600 à 1830, Liège 1994, p. 110. NLAH, Hann. 76c A Nr. 204, p. 505 : « dem Musicanten Josse für Unterhaltung der Instrumenten. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 214, p. 486 : « für Bücher und 4. paar Castagnettes dem Tantzmeister Pecour. »
– 181 –
Chapitre 3
Hanovre à partir de 1674, apparaît-il dans les comptes de Hanovre avec de nombreuses casquettes différentes : musicien, maître à danser, et maître d’armes.289 À l’inverse, vers 1670, le maître à danser de Tübingen vient régulièrement à la cour de Stuttgart, où il enseigne aux violonistes de la Hofkapelle « la maîtrise de la manière et de la danse françaises dans leur plus grande perfection », en compagnie d’un musicien français dont nous ignorons le nom.290 La plupart des musiciens sont aussi maîtres à danser, suivant la double qualification en usage en France jusqu’en 1661. Nous avons vu que Jean-Jacques Favier et Thomas de La Selle sont des bons exemples de cette double qualification. Le successeur de François Robeau à la cour de Celle, Henry des Hays, apparaît juste avant son départ de Paris comme maître à danser, situé « devant la Comédie françoise ».291 Les pages reçevaient souvent des cours de danse dispensés par des musiciens français. À Celle, ces leçons étaient peut-être individuelles, puisque leur coût est calculé en fonction de nombre de participants : le musicien qui les dispense touche autour de 12 Thaler par élève et par semestre.292 À partir de 1698, les pages reçoivent l’enseignement de Claude Pécour, issu d’une grande famille de danseurs parisiens.293 À Dresde, le maître à danser de Leipzig Johann Christoph Thomae enseignait la même discipline aux pages de la cour.294 L’enseignement de la danse pouvait aussi avoir lieu en dehors de la cour, notamment dans les Ritterakademien ou les Fürstenschulen, institutions un peu particulières en charge de la formation des élites aristocratiques et administratives impériales, dont la multiplication au cours du xviie siècle répond d’ailleurs parfois à la volonter d’adapter le modèle français des collèges dans l’espace germanique.295 L’apprentissage du français et de la danse figuraient en bonne place dans ces institutions, qui furent certainement le lieu de transferts culturels privilégiés entre la France et l’Empire – transferts de savoirs, de pratiques et de manuels pédagogiques, mais aussi de compétences linguistiques et de pratiques artistiques.296 Le musicien Thomas de La Selle occupe les fonctions de maître à danser à la Ritterakademie de Lüneburg, reprenant une tradition déjà ancienne : dès 1660, le contrat d’engagement du maître à danser Michel Dubreuil stipule déjà l’obligation d’y enseigner.297 Cette double fonction devait engendrer des déplacements fort longs et incommodes entre les deux villes distantes de 90 kilomètres. À Berlin, les fonctions de Jean-Baptiste Volumier incluaient aussi l’enseignement de la danse aux jeunes nobles de la Ritterakademie à partir de sa fondation en 1705.298 Mais dès cette époque, Volumier enseignait aussi la musique. Il fut notamment le professeur du violoniste Johann Adam Birkenstock (1687-1733), qui suivit également l’enseignement de Rugiero Fedeli à Kassel et de 289 290
291 292 293 294 295
296 297 298
NLAH, Hann. 76c A Nr. 94, p. 437 : « Dem Pagen Fechtmeister Conte jährliche Besoldung 300 Thlr. » Hann. 76c A Nr. 97, p. 349 : « Dem Fechte und Tantzmeister Conta gantzjährig 300 Thlr. » Sittard, Zur Geschichte, p. 59 : le Vice-Kapellmeister Johann Friedrich Magg rappelle aux musiciens « daß zu ergreiffung der französischen manier und Täntz, so offt der Tantzmeister zu Tübingen sich alhier befinden wirdt und der new ankommene französische Musikant derselben begehren würdt, dieselbe mit ihren Instrumenten jedesmahl ohnweigerlich uffwartten, und zu erraichung Ihrer F. D. gdstr. intention in bester perfection und Uebung der französischen Täntz und Manier ihren möglichsten fleiß verwenden sollen. » Abraham du Pradel, Le Livre commode des adresses de Paris, Paris sans date, p. 257. NLAH, Hann. 76c A Nr. 211, p. 401 : « Lehr- und Unterweisungsgeld der Pagen. Im Tantzen. Von Michaelis 1684 biß Ostern 1685 12 Persohnen à 12 Thlr, 144 Thlr. Von Ostern biß Michaelis 1685 8. Persohnen, 96 Thlr. Von Michaelis 1685 biß Ostern 1686 9. Persohnen, 108 Thlr. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 223, p. 452. HStA Dresden, 10006 OHMA, P Nr. 28a. Un document intéressant à ce sujet est conservée dans HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 708/2, fol. 176 : l’ambassadeur de Saxe à Paris Suhm décrit dans une lettre de 1716 au comte de Flemming la maison de Saint-Cyr à Versailles, qu’il propose comme modèle pour un établissement du même type qui devait être fondé en Pologne. Norbert Conrads, Ritterakademien der frühen Neuzeit. Bildung als Standesprivileg im 16. und 17. Jahrhundert, Göttingen 1982. NLAH, Celle Br. 44 Nr. 64, fol. 13 : Dubreuil est « so woll beÿ Unser Hoffstaats, alß auch der in Unser Stadt Lüneburg angeordneten Ritten Schule bestellet und angenommen ». Sachs, Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, p. 68 et 182.
– 182 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
François Duval à Paris avant de de faire une très belle carrière comme Konzertmeister à Kassel en 1725, puis comme Hofkapellmeister à Eisenach à partir de 1730.299 À Dresde, un certain Matthias Lehneis se présente à son tour comme « élève de Volumier ».300 D’autres musiciens sont rétribués pour dispenser des cours de musique. La Garenne reçoit ainsi 25 Thaler par trimestre pour donner, entre septembre 1682 et décembre 1684, des cours à des jeunes élèves apparemment étrangers, puisque successivement surnommés le petit Maure (« der kleine Mohre ») et le petit Polonais (« der kleine Pohlen » ou « der kleine Polacken »).301 L’argent reçu servait aussi pour l’entretien de l’élève (« Kostgeld »), et l’on peut donc supposer que La Garenne était chargé de les loger, nourrir et blanchir. Le musicien Henry – il s’agit sûrement de Denis Le Tourneur – est de son côté rétribué pour donner des cours à un trompettiste, probablement pour lui apprendre le hautbois.302 On a vu que Johann Ernst Galliard, fils d’un perruquier français employé à la cour de Celle, prit des cours de hautbois auprès de Pierre Maréchal, et de composition auprès des musiciens de Hanovre Jean-Baptiste Farinel et Agostino Steffani. Les occupations de Buffardin à la cour de Dresde semblent aussi avoir comporté une bonne part d’enseignement. On sait en effet, grâce à l’autobiographie de Quantz publiée par Marpurg en 1754, que celui-ci prit des cours de flûte auprès du maître français. En 1718, peu après son arrivée à Dresde, Quantz fut d’abord engagé dans l’ensemble polonais (la « Pohlnische Capelle »), où il ne pouvait pas jouer ses instruments habituels (violon et hautbois) car il en était empêché par les autres instrumentistes. Il décida donc de se consacrer à la flûte traversière : Ces déboires me poussèrent à me mettre sérieusement à la flûte traversière que je ne n’avais jusqu’alors travaillé qu’à titre privé, dans la mesure où je n’avais aucune opposition à craindre parmi mes compagnons, d’autant plus que Friese, jusqu’alors flûtiste mais qui avait d’autres penchants plus forts que la musique, me céda volontairement la première place sur cet instrument. Je suivis pendant quatre mois environ l’enseignement du célèbre flûtiste Buffardin, pour me familiariser avec cet instrument. Nous ne jouiions rien que des choses rapides, car c’était là le point fort de mon maître.303
C’est donc notamment par l’intermédiaire de Buffardin que Quantz prit contact avec la musique française, et entra comme flûtiste à la cour de Dresde. En 1728, Quantz obtint l’autorisation de se rendre régulièrement à Berlin pour donner des cours de flûte au prince Friedrich, avant de passer définitivement au service de celui-ci en 1741, date à laquelle il partit s’installer à Berlin. Buffardin se propose alors de former lui-même le successeur de Quantz, monnayant ainsi une augmentation de salaire :
299 300
301
302 303
Stefan Keym, « Birkenstock, Johann Adam », in : MGG online. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/5, fol. 3 : « Euer Hochgraffl. Excel. haben auf unterthäniges Vorsprech des H. Wuolmaÿrs meinen Lehrmäysters mich dergestalten begnädiget, daß Dieselbe würcklich wegen meiner an Ihro Excel: den H: Grafen von Watzdorff nach Warschau haben schreiben lassen damit die von Sr. Königl. Maÿst: in Pohlen, und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen mir allergnädigst beÿgelegter gnade zur behöriger expedition gelang möchte. » Matthias Lehneiß est sans doute le fils de Johann Georg Lehneiß, qui figure dans la liste de personnel de 1709 comme haute-contre de violon. NLAH, Hann. 76c A Nr. 208, p. 418 : « La Garonne [sic] kleinen Pagen zu informiren. » Hann. 76c A Nr. 209 p. 363 : « des Kleinen Mohre La Garonne [sic]. » Hann. 76c A Nr. 210, p. 387 : « In der Music, Item Unterhaltungsgeldt deß kleinen Pohlen, dem Hautbois La Garenne […] deß Kleinen Mohren, dem Sprachmeister Jean Heime ». Hann. 76c A Nr. 211 p. 401 : « des kleinen Polacken, Lehr= und Kost=Geld, vom 1. Marty biß 1. Decembris 1684, alß von 3/4 Jahren ad 25 Thlr, dem Hautbois Lagarenne, 75 Thlr. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 207, p. 412. Marpurg, Historisch-Kritische Beyträge, vol. 1, 1754, p. 209: « Der Verdruß hierüber veranlassete mich, die Flöte traversiere, worauf ich mich bishero für mich selbst geübet hatte, mit Ernst zur Hand zu nehmen: weil ich hierauf, unter der Gesellschaft wo ich war, eben keinen sonderlichen Widerstand zu befürchten hatte: um so viel mehr, da der bisherige Flötenist Friese, dessen größte Neigung eben nicht auf die Musik gieng, mir den ersten Platz bey diesem Instrumente freywillig abtrat. Ich bediente mich, etwan vier Monate lang, der Unterweisung des berühmten Flötenspielers Buffardin; um die rechte Eigenschaften dieses Instruments kennen zu lernen. Wir spielten nichts als geschwinde Sachen: denn hierinn bestund die Stärcke meines Meisters. »
– 183 –
Chapitre 3
Comme j’ose me flatter, que mes services sont agréables à Vôtre Majesté, et que je beni tous les jours le ciel du bonheure que j’ay de la servir, j’ay cru cependant pouvoir hazarder de me jetter a ses pieds, pour la supplier d’augmenter mon bien Etre, selon son bon plaisir, d’une petite somme, ce n’est ni la retraite de mon Camerade, ni la rareté des gens de mon Talent, qui me determine a demander cette grace Sire, mais seulement une Espece de necessité, puisque jusqu’à present il m’a fallut, vivre avec une certaine Economie, sans laquelle je me serois fort derangé ; Si Vôtre Majesté daigne etre favorables a ma tres respectueuse priere, je m’offre pour le bien du service, d’instruire et de donner mes soins a celui quelle choisira pour succeder a Quantz : Un Domestique de vingt et huit ans, Sire, Vous demande cette grace il la demande au Monarque, le plus genereux, et le plus gratieux de toute la terre […].304
On voit ici que l’enseignement constitutait non seulement une obligation traditionnelle des musiciens de cour, mais pouvait aussi fournir un complément de salaire. Du point de vue de l’histoire de la musique, il importe aussi de noter qu’il représente un vecteur majeur dans la transmission et la diffusion de pratiques musicales françaises. Le musicien comme agent d’affaires et diplomate Plusieurs musiciens français, surtout en fin de carrière et figurant parmi les plus célèbres, remplirent des fonctions situées aux frontières de la diplomatie et du commerce international. Ainsi François Le Riche, bien que qualifié de musicien de la chambre (« Cammer Musicus »), ne figure plus parmi le personnel de la Hofkapelle à partir de 1712, mais dans une autre catégorie de personnel appelée les Provisioner. Il touche un salaire exceptionnellement élevé de 3.200 Thaler, qui est versé par une autre caisse que celle des musiciens : c’est la Hof-Cassa qui lui donne son salaire et non l’Accis-Casse comme c’est normalement le cas.305 À partir de 1721, il réintègre la Hofkapelle comme « Violinist », mais son salaire de 2.992 Thaler est toujours payé par la Hof-Cassa.306 En dehors des registres généraux du personnel de la cour (« Hofbücher »), François Le Riche ne figure sur aucun inventaire de la Hofkapelle, ce qui constitue une exception d’autant plus notable qu’il est demeuré une bonne trentaine d’années au service de la cour de Dresde. Une lettre datée du 25 juin 1703, envoyée depuis Londres au comte Carl Gottfried von Bose, éclaire sa position spécifique : elle montre que Le Riche achetait des chevaux en Angleterre pour le compte de cet aristocrate diplomate.307 Il servait donc d’agent étranger de la cour de Dresde en Angleterre et en divers endroits où il poursuivait une carrière musicale. En janvier 1714, Le Riche reçoit aussi un paiement pour la livraison de plusieurs « marchandises » à la cour de Dresde, parmi lesquelles figurent du thé.308 Nous avons déjà évoqué les intersections entre musique et diplomatie à travers l’exemple des musiciens circulant dans la suite du personnel diplomatique, mais certains musiciens de carrière deviennent eux-mêmes des diplomates accrédités. Jean-Baptiste Farinel, à la fin de sa carrière, déménage à Venise comme agent diplomatique de la cour de Hanovre. L’âge avancé du musicien ainsi que l’absence de correspondance diplomatique provenant de sa plume conduisent à penser qu’à la différence de Steffani, le musicien français n’a sans doute pas véritablement mené d’activité politique pour la cour de Hanovre. Le séjour à Venise apparaît plutôt comme le moyen de garantir une retraite confortable à Farinel et sa femme Vittoria Tarquini, originaire de Venise. Les lettres de créance de Farinel, conservées aux archives de Hanovre et datées de mars 1714, mentionnent d’ailleurs au brouillon, dans un passage barré qui a finalement été retiré de la lettre officielle, que celui-ci avait demandé à prendre sa retraite à Venise : 304 305 306 307 308
Lettre de Pierre-Gabriel Buffardin à Auguste III, Dresde, 11 déc. 1741. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 907/5, fol. 39. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 4, fol. 262. K II Nr. 5, fol. 96. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 6, fol. 1 et 74. K II Nr. 7, non folié. K II Nr. 8, non folié. Lettre de François Le Riche à Bose, Londres 25 juin 1703. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 30006/09. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 758/04, fol. 3 : « Le Riche zu Wahren... 216 [Thaler]. Ferner ist geliefert worden den 25. Aug. 1713 von […] Le Riche zu thee … 16 [Thaler].
– 184 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
Nous, Georg Ludwig par la grâce de Dieu Duc de Braunschweig-Lüneburg, électeur et archi-trésorier du Saint Empire Romain Germanique, Jean-Baptiste Farinelli ayant servi pendant de nombreuses années le Sérénissime électeur notre père d’heureuse mémoire, et Nous aussi, avec pleine satisfaction, en qualité de Directeur de Notre Musique, [barré: comme il était sur le point de prendre sa retraite à Venise], et Notre Agent Jean-Baptiste Zanovelli nous ayant fait défaut, nous lui avons proposé de servir notre bureau vacant, et le déclarons notre agent à Venise.309
Comme agent diplomatique, Farinel continue de toucher un salaire confortable de 600 Thaler par an.310 Son successeur au poste de Konzertmeister, François Venturini, reçoit alors un supplément de 100 Thaler par an, prélevé sur le salaire de l’ancien maître de chapelle.311 Au début de son mandat à Venise, Farinel reçoit également des sommes d’argent pour son logement dans un palais loué à la famille de Mocenigo, pour le port des lettres, ainsi que pour la location de loges, probablement à l’opéra.312 Même si un nouvel ambassadeur, probablement un diplomate professionnel, est nommé en 1720, Farinel reste dans la cité des Doges jusqu’à sa mort en 1725.313 Copier la musique française La copie de musique est certainement l’un des aspects les plus obcurs et oubliés du métier de musicien. Pourtant, sa fonction était absolument centrale puisqu’elle servait à produire les nombreuses parties séparées qui servaient aux musiciens de la Hofkapelle à répéter et à jouer correctement leur partie, et devaient donc être soigneusement préparées en fonction du calendrier des obligations, du nombre d’instrumentistes au sein de chaque pupitre et de leurs habitudes de lecture. À une époque où la musique circulait encore fréquemment sous forme manuscrite, la copie de musique était aussi un moyen essentiel pour acquérir et conserver de la nouvelle musique, enjeu crucial pour des ensembles qui étaient sollicités quotidiennement et devaient renouveler leur répertoire régulièrement pour conserver un taux de rotation acceptable. Tâche ingrate et difficile, la copie de musique ne nécessitait pas seulement du papier, denrée fort chère, de l’encre, des plumes et de la bougie. Elle supposait aussi de la part des copistes de bonnes capacités de lecture et de transposition, une connaissance des règles élémentaires de composition pour prévenir, repérer et éventuellement corriger les possibles erreurs dans le texte musical, une bonne connaissance de la langue et de l’orthographe pour la copie du texte parlé ou des indications, et surtout une quantité impressionnante de temps pour régler le papier, écrire la musique, relire et corriger les copies. La plupart du temps, c’était au Kapellmeister d’organiser la copie de musique, seul ou bien à l’aide d’auxiliaires.314 Même si cela faisait partie de ses tâches quotidiennes, Philippe La Vigne était parfois payé spécialement pour assurer la copie de quantités importantes de musique pour la cour de Hanovre, et probablement aussi pour le rembourser le papier qu’il avait acheté.315 En contrepartie de la peine engendrée par un tel travail, le Kapellmeister avait ensuite le droit de conserver les partitions copiées dans sa bibliothèque personnelle au titre de propriété privée : à sa mort, elles revenaient à ses héritiers, et si la cour souhaitait acquérir les manuscrits, elle devait les
309
310 311 312 313 314 315
NLAH, Hann. 92 Nr. 2461, fol. 11 : « Noi Giorgio Ludovico Per la Gratio de Dio Duca di Brunswich e Luneburgo, Elletor et Arci Tresoriero del Sax. Rom. Imperio Havendo Gio: Battista Farinelli per la spazio di molt’Anni servita la felice memoria del Sermo Elettor Nostro Padre, e Noi ancora con pieno sadisfattione in qualità di Direttor della Nostra Musica […] stava per ritirarsi a Venetia et essendo venuto a mancare l’Agente Nostro Gio Batta Zanovelli, per l’Offerta fattaei di servirei nella Carica vacante lo habbiamo […] dichiaratro nostro Agente in Venetia […]. » NLAH, Hann. 76c A Nr. 238, p. 600. NLAH, Hann. 76c A Nr. 237, p. 412. NLAH, Hann. 76c A Nr. 238, p. 600. NLAH, Hann. 76c A Nr. 244, p. 678. NLAH, Hann. 76c A Nr. 249, p. 604. Sur l’organisation de la copie de musique en atelier à la cour de Güstrow sous la direction de Heinrich Bokemeyer, cf. l’introduction de Harald Kümmerling, Katalog der Sammlung Bokemeyer, Kassel 1970. NLAH, Hann. 76c A Nr. 125, 20 fév. 1706, p. 421 : « dem Capellmeister La Vigne von Zelle vor Copÿrung Musicalischer Sachen. 40 Thlr. »
– 185 –
Chapitre 3
leur racheter. Lorsqu’il quittait son emploi, le Kapellmeister pouvait les emmener avec lui, étant entendu qu’il devait laisser son successeur libre de copier ce dont il avait besoin pour subvenir à ses propres besoins lors de sa prise de fonction. Les institutions curiales tentaient cependant fréquemment de contourner cette coutume et de contraindre les maîtres de chapelle à céder leur collection de musique personnelle. Lorsque Daniel Danielis quitte la cour de Güstrow en 1664, il doit se battre bec et ongles pour conserver sa collection musicale, sans doute constituée en grande partie de ses propres compositions. Il souligne qu’il a laissé son successeur Augustin Pfleger copier tout ce qu’il voulait : Ayant entendu que la volonte de V.A.S. est, que je livre mes musiques dans la chambre ; j’ay bien voulu prendre la hardiesse de Luy resmonstrer avec toutte humilité, comme ce seroit me defaire de ce avec quoy il faut que je gaigne ma vie, et me priver du moyen de pouvoyre gouverner une autre Chapelle. Jay donné a mon successeur Pfleger tout ce qu’il at desiré de moy pour descrire ; je luy ay aussi donné touttes les pieces que j’ay composé pour le quaresme lesquelles demeureront pour la Chapelle, et luy ay dict que je voulois luy laisser encor d’autres compositions qui sont propres icy, mais de me deffaire du travaille de 5 ans et demy c’est ce que je ne peut faire quand on me les voudrois payer au double ; et si je n’avoit pas ceu que ce n’est pas la coustumme, comme savent tous ceux qui font profession de la musique je les aurois des longtemps descrittes pour moy. Vostre Altesse Serenissime poudrat faire demander au maistre de Chapelle Pfleger si ceest la coustumme dans nulle Chapelle du monde, et je suis content d’acquiescer a ce qu’il en dirat.316
Plusieurs conflits du même ordre peuvent être évoqués.317 La plupart du temps, les choses se passaient pourtant de manière plus pacifique et le Kapellmeister pouvait disposer à sa guise des partitions élaborées sous sa responsabilité. Stéphane Valoy emporta ainsi avec lui plusieurs manuscrits de musique française lorsqu’il quitta la cour de Hanovre en 1698. Probablement copiés en partie par lui-même, ces recueils avaient aussi été « mis en partition » (c’est-à-dire probablement copiés à partir de parties séparées) par Charles Babel et Guillaume Barré, deux autres musiciens français de la cour de Hanovre. C’est ainsi que ces manuscrits se sont retrouvés transportés à la cour de Darmstadt, où Stéphane Valoy était musicien de la troupe de comédiens français à partir de 1714. Il mourut dans cette ville en 1715 : en l’absence d’héritier, ces recueils de musique durent donc tomber automatiquement dans les collections de la bibliothèque de la cour de Darmstadt, où ils sont toujours conservés aujourd’hui.318 De même, la bibliothèque musicale de Jean-Baptiste Volumier fut rachetée à ses héritiers en bonne et due forme après sa mort en 1728. Le directeur des plaisirs Pierre de Gaultier s’engagea personnellement en faveur de ce rachat, en soulignant la valeur des partitions de l’ancien maître des concerts – qui devait en effet être exceptionnelle, compte tenu de l’immensité des collections musicales de la cour de Dresde : Vôtre Majesté n’aura pas oublié ce que j’eus l’honneur de Luy dire avant son départ touchant la Musique que Woulmier a laissée, parmy laquelle il y a quantité de Pièces morceaux de consequence, et difficiles à trouver, et de la bonne acquisition que Vôtre Majesté feroit, en acheptant cette collection.319
Gaultier recommande le rachat des partitions auprès du gendre de Volumier, un certain Léger.320 Quelques jours plus tard, l’accord d’Auguste le Fort est donné et des dispositions sont immédiatement prises pour le rachat de la bibliothèque de Volumier.321 Aucun document ne vient mal-
316 317 318 319 320 321
LHA Schwerin, 2.12-1/26-14 Hofpersonal Nr. 12, lettre non datée de Daniel Danielis. Sur les cas de Graupner et Pisendel, cf. Köpp, Johann Georg Pisendel, p. 402-405. Voir Chapitre 2, p. 44-46. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3349/14, fol. 6-7. Jean-Baptiste Léger est l’époux de la fille de Volumier, Angélique Louise. Ils font baptiser plusieurs enfants entre 1726 et 1730 : DA Bautzen, Taufbuch der Hofkirche 1709-1759, fol. 23, 28 et 33. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3349/14, fol. 10 : « L’achapt de la musique sera fait avec le Sr. Leger. » Une pension est versée à la veuve de Volumier le 20 oct. 1729, et l’achat de la bibliothèque est fixé à hauteur de 400 Thaler : HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 190.
– 186 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
heureusement détailler la composition de cette bibliothèque, qui semble avoir disparu avec une grande partie de la collection musicale de la cour lors des bombardements de 1760. Certaines cours ne pouvaient cependant pas compter sur le seul maître de chapelle pour produire toute la copie et le matériel d’orchestre nécessaire. À Dresde, la copie de la musique pour la Hofkapelle, institutionnalisée à la fin du xviie siècle, est assurée par un véritable atelier de copistes professionnels, payés spécialement pour accomplir cette tâche. Les partitions et parties séparées pouvaient ainsi aller directement dans la bibliothèque électorale, puisqu’elles n’avaient pas été copiées par le Kapellmeister.322 Pour la musique française, il fallait de préférence un copiste francophone, bien familiarisé avec le répertoire, mais aussi avec les pratiques musicales spécifiques des ensembles français, capable d’anticiper les besoins d’un orchestre placé sous la direction d’un maître des concerts français et largement composé d’instrumentistes français. Jean Prache du Tilloy, arrivé à Varsovie à l’âge de vingt-cinq ans comme « danseur » dans la troupe de Deseschaliers, était aussi violoncelliste dans l’orchestre de la cour.323 Cependant, à partir de 1709, sa tâche principale devint la copie de musique française pour subvenir aux besoins musicaux de la comédie française et de la Hofkapelle. Une lettre adressée à Christoph Heinrich von Watzdorf met en lumière l’ampleur de cette tâche et décrit les conditions matérielles de son exercice : pour faire voir a Vôtre Excellence, le détail de cet Employ, j’en diray seulement icy un article, qui est l’opera que la noblesse repettent actuellement : tant pour les Rolles des personnes qui chantent que pour la musique des Chœurs, Celle de la dance, et pour toute l’orquestre, j’ay escrit jusqu’à present 15560 lignes de musique qui consistent en 843 feuille de grand papier, et sans ce que je dois encore fournir, j’ay payé a mes frais tout le papier ; ancre ; plume ; pâte pour regler [patte à régler] ; bougie ; ainsy que du reste ; il y a pres de six mois que je travaille comme un esclave, colé a une table nuit et jour, dont j’en suis tombé malade d’un heresipel [sic] sur la jambe par deux reprise ce qui me fait courir de grand risque, et ce que Vôtre Excellence peut sçavoir de monsieur le docteur Schmeltz, qui à la bonté de me traiter. Vôtre Excellence peut bien concevoir par ce seul divertissement, combien il m’en coûte pour tous les autres contenus dans mon memoire Car Enfin le papier de musique coûte bien de l’argent.324
Le mémoire auquel Prache fait allusion n’est malheureusement pas conservé. On peut cependant retenir de cette lettre que le copiste devait avancer lui-même l’acquisition de tout le matériel nécessaire : bougie, papier, encre, plume et « patte à régler », une plume à cinq becs qui servait à tracer les portées de musique. Comme l’indiquent les versements de l’année 1720, ces dépenses lui étaient remboursées par la suite, parfois avec un grand retard.325 De ce travail qu’il a fourni pendant plus de quinze ans, seule une petite partie est vraisemblablement conservée aujourd’hui. Les manuscrits copiés par Prache sont aisément identifiables grâce à un monogramme qu’il utilisait pour authentifier ses copies. Un bel exemple est la page de garde de la partie séparée de premier violon, dans une suite orchestrale tirée d’Acis et Galatée de Lully. Sans doute pour pouvoir la reconnaître rapidement parmi le matériel d’orchestre, Jean-Baptiste Volumier y a inscrit son nom (Illustration 3.4). À Stuttgart, Charles Belleroche est également copiste de musique française.326 Un autre copiste apparaît au détour d’une facture signée à Varsovie le 29 juillet 1726, reproduite dans le 322 323 324 325 326
Sur le fonctionnement de cet atelier, voir Ortrun Landmann, Über das Musikerbe der Sächsischen Staatskapelle. Drei Studien zur Geschichte der Dresdner Hofkapelle und Hofoper anhand ihrer Quellenüberlieferung in der SLUB Dresden, Dresde 2010, p. 121-190. HStA Dresden, 10006 OHMA, K II Nr. 5, fol. 90 : « Jean Baptiste prache Du Tilloy ; parisien de Nation : Musicien Engagé au service de Sa Majesté suivant son contract en lannée 1699 : âgé de 45 ans ». Sur son arrivée dans la troupe d’opéra de Desescheliers, voir Chapitre 1, Tableau 1.6. Lettre de Jean Prache du Tilloy à Christoph Heinrich von Watzdorf, ca. 1720. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/2, fol. 174-175. Ponctuation modernisée. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 383/4, fol. 269-270. Ekkehard Krüger, Die Musikaliensammlung des Erbprinzen Friedrich Ludwig von Württemberg-Stuttgart und der Herzogin Luise Friederike von Mecklenburg-Schwerin in der Universitätsbibliothek Rostock, Beeskow 2006, vol. 1, p. 50-55.
– 187 –
Chapitre 3
Illust ration 3.4. Partie séparée de violon ayant appartenu à Jean-Baptist e Volumier [Woulumier], copiée par Jean Prache du Tilloy. D-Dl, Mus. 1827-F-31.
livre d’Alina Żórawska-Witkowska sur la musique à Varsovie sous le règne d’Auguste le Fort.327 Jacques Guénin y détaille l’ensemble des copies pour la Hofkapelle de Saxe et de Pologne au cours des six mois précédents, soit une quantité impressionnante de 56 copies en partition ou parties séparées, comprenant exclusivement du répertoire français, aussi bien instrumental que vocal (Tableau 3.5). Chaque item de cette liste est comptabilisé par feuille de papier, soit un total de 440 pages. Tout comme Prache quelques années auparavant, Jacques Guénin indique aussi l’encre et la patte à régler parmi ses dépenses. Le répertoire décrit dans cette liste reflète une variété fascinante de genres, de compositeurs et de contextes d’exécution. Il est aussi le témoin de la circulation européenne de la musique française, un phénomène essentiel qu’il convient maintenant d’étudier en profondeur.
327
Alina Żórawska-Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Varsovie 1997, p. 93-95.
– 188 –
Frantzösische Musicanten : une biographie collective
Tableau 3.5. Liste des copies réalisées par Jacques Guénin entre novembre 1725 et avril 1726. Cité d’après Alina Żórawska-Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Varsovie : Königsschloss, 1997, p. 93-95. Par ordre de Monsieur le Maître de Concert, le Copiste de l’orchestre de Sa Majesté, a copié ce qui suit. feüilles Un Grand Air, Rigaudon et Gigue toutes les parties
5.
Plusieurs autres ouvrages suivants, toutes les parties
24
Les Caracteres de la dance, de M.r Rebel
9.
Une Cantate où il y a un Recitatif et muzette
4.
Une loüre, bourée et un Trio, toutes les parties
6.
Quel qu’autres ouvrages suivants toutes les parties
3.
Une Passacaille, Rigaudon et un Trio
5.
Une Sarabande et toutes les parties d’un air
7.
Une loüre, Chaconne, Gigue et deux Passepieds
6.
plus pour d’autres airs, toutes les parties
3.
Un air de paÿsant, bourée et un air de polichinel
5.
Une Chaconne de trivelin, bouree et un air
4.
Une loüre et une bourée toutes les Parties
6.
pour le divertissement des Vandanges
8.
Une Sarabande et deux Passepieds
6.
Un Aria et Gigue de polichinel, toutes les parties
2.
Secondement pour le divertissement des Vandanges
4.
Deux Airs de Tambourins, dancer dans les Vandanges de Surêne, toutes les parties
5.
pour Mr du prez une loüre, Chaconne, et passepieds
8.
Une loüre, Gigue, et un air, toutes les parties
6.
Une Passacaille et un Rigaudon
5.
Une Entrée de démonds et deux airs, toutes les parties
5.
Une Entrée de Matelots et deux airs
6.
Un Grand Air et une Gigue, toutes les parties
1.
pour les divertissements des Vandanges,
20.
pour les repetissions de ballet
2.
Somme
165 feüilles
Pour Monsieur St. Denis, Une Chaconne d’Arlequint, toutes les Parties
5. feuilles
Airs des paÿsans et Scaramouche
4.
Une Chaconne de Trivelin et un air de Polichinel
3.
Un Air de paÿsant, toutes les parties
3.
Un air, Passepied, Sarabande et Canaries
5.
Un air, Sarabande, et une Gigue pr. Mr. du Mesnil
4.
Une marche, Rigaudon, pour Mr bruyer
1.
Pour Mlle de Vaurinville, Une muzette et les Caracteres de la dance, toutes les parties
4.
Une marche de Villanelle, un air et trio
3.
Une Entrée de faunes, toutes les parties
3.
deux airs de Muzettes, toutes les parties
6.
Une Chaconne, toutes les parties
1.
Une sarabande et deux passepieds en repetition
5.
– 189 –
Chapitre 3
Tableau 3.5. (suite et fin). Pour les Plaisirs de Sa Majesté, Représenté par Mlle dimanche, Une Cantate, toutes les parties
4.
Une partition de la même Cantate
5.
Une seconde Cantate toutes les parties
4.
Une partition de la même Cantate
4.
La partition d’une Cantate de M.r Campra
8.
Une Cantate, Régné belle Thétis, toutes les parties
5.
Une Seconde Cantate, Trompettes Éclatéz
5.
Une Troisième Cantate, Venez regner
4.
Une quatriême Cantate, Non Sempre
5.
Un livre de Partition des fêtes Vénitiennes, En Grand Papier de Regal, proportionnez a Une Second livre de Partition des Cantates françoise Une troisiême livre de partition des Cantates de Mr Stuck
60 24. 48
Somme
222. feüilles
Plus, pour Mlle dimanche, pour le divertissement de La folie, Toutes les parties pour le divertissement Turc, toutes les parties
13. 16.
le divertissement, pour la Comedie
12.
trois airs pour Mlle dimanche
1.
le divertissement de Paÿsans, toutes les parties
10.
Somme totalle 440. feuilles de copies, qui font 587 timphes a 4. Chostak la feüille, comme l’accord a été fait dy devant. J’ay fournis, tant pour mes ouvrages, qu’à Mr le maître de Concert, et à Mlle dimanche jusqu’a 50 main de papier pattée, ce qui fait 100 timphes, a deux timphes la main, il y a encore pour 8. timphes d’Encre que J’ay fournis, de puis le moys de novembre, 1725: Jusq’au moys d’avril, 1726. Somme totalle 695. Timphes J’ay recu en conformité de l’ordre de Sa Majesté le Roy de Pologne et Electeur de Saxe p. donné à Varsovie le premier Juillet 1726. de la Caisse Generale de pologne, Par Mr le Tresorier Volmar de l’argent destiné pour l’extraordinaire de la Comedie et de la danse, pour des Copies de Musique que J’ay faittes depuis le mois de Novembre 1725, jusqu’au mois d’Avril 1726. Suivant le conte cy contre la somme de cent trente et huit Ecus et 28 gl. à 5 Tinks, dont je donne la presente quitance, fait à Varsovie ce 29. juillet 1726. Jacques Guenin.
– 190 –
Chapitre 4. La dissémination de la musique •
Jusqu’à présent, la question de savoir sous quelle forme le répertoire français était joué dans les cours qui employaient des musiciens français, et plus largement dans les territoires d’Empire, a surtout été abordée à partir des livrets imprimés qui montrent que de grandes œuvres du répertoire de l’Académie royale de musique, surtout celles de Lully, ont été jouées à Ansbach, Regensburg, Wolfenbüttel, Hamburg et Darmstadt.1 Les sources manuscrites de musique française, encore peu étudiées, donnent un aperçu plus intéressant et plus complexe sur ce phénomène. À la différence des livrets, qui documentent les exécutions intégrales d’œuvres de scène comme les tragédies en musique, les ballets ou autres produits dérivés de l’opéra français, souvent données dans le cadre d’évènements dynastiques extraordinaires ou de représentations exceptionnelles, les sources musicales permettent de suivre l’adaptation du répertoire français sous des formes et dans des contextes beaucoup plus variés, et de prendre conscience de la grande diversité des genres français disséminés dans l’Empire. Aux côtés des grands monuments du répertoire lyrique, on voit émerger une myriade de genres dont la dissémination est d’une ampleur demeurée insoupçonnée jusqu’ici. Ainsi la première partie de ce chapitre, en interrogeant la relation entre les imprimés et les manuscrits musicaux, met-elle en évidence la diffusion très large du genre de l’air de cour, de la cantate française, mais aussi du petit motet, du motet à grand chœur et – dans un contexte où les compositeurs sont très souvent aussi des organistes – du livre d’orgue. Elle révèle en particulier que le genre du motet à grand chœur a été diffusé et joué de façon bien plus intensive et bien au-delà de ce qu’on imaginait jusqu’alors. La deuxième partie, tout en faisant le point sur le corpus de suites orchestrales en usage dans les cours et tirées du répertoire de l’opéra de Paris, montre également la diffusion très fragmentaire de ce répertoire sous la forme d’extraits, entre autres par le biais des livres de musique privés en usage dans l’aristocratie d’Empire. Traquer la dissémination de la musique française au plus près des sources et des pratiques permet donc de relativiser le poids des exécutions extraordinaires en les faisant apparaître comme la pointe émergée d’un immense iceberg encore largement inexploré. Il serait cependant naïf de penser que le tableau offert par les sources manuscrites présente un reflet exact des usages de la musique française dans l’espace germanique. En fait, leur conservation introduit à son tour un biais inéluctable, notamment par le poids immense accordé à la musique d’église par rapport aux genres de musique instrumentale pour le théâtre. Cette surreprésentation relative peut s’expliquer en partie par les conditions de conservation et de transmission des manuscrits, puisqu’en dehors des collections manuscrites de Dresde, tout à fait uniques, les bibliothèques des Hofkapellen privilégient mécaniquement la conservation et la transmission de la musique d’église, lieu traditionnel d’activité des chapelles ducales et princières. À l’inverse, les partitions
1
Pour une liste des livrets de Lully conservés en Allemagne, voir Carl B. Schmidt, « The geographical spread of Lully’s operas during the late seventeenth and early eighteenth centuries : new evidence from the livrets », in : Jean-Baptiste Lully and the Music of the French Baroque. Essays in Honour of James R. Anthony, dir. John Hajdu Heyer, Cambridge 1989, p. 183-211.
– 191 –
Chapitre 4
et les matériels d’orchestre utilisés par les troupes de comédiens français ou par les musiciens lors de représentations théâtrales ne sont que rarement conservés. À Dresde par exemple, alors que Louis André est actif pendant plus de quinze ans comme « Compositeur de musique française », aucune de ses compositions n’a survécu. Il s’agit donc à l’évidence d’un répertoire beaucoup plus disparate, compilé ou composé sur mesure, qui ne rejoint les collections institutionnelles que de manière exceptionnelle. La grande polyvalence du répertoire français, qui n’est pas seulement exécuté dans le cadre de représentations théâtrales, mais aussi à la chambre, à la table et dans les chapelles, est donc reflétée seulement de manière fragmentaire. Mais au-delà de cette diversité générique, qui recoupe en grande partie la diversité des lieux de musique, ce chapitre offre aussi une coupe transversale à travers les pratiques de musique française dans la société allemande autour de 1700 : la musique française est présente dans les collections des Hofkapellen, sur les théâtres et dans les chapelles de cour, mais également dans les bibliothèques et les pratiques musicales privées de l’aristocratie et de la bourgeoisie, dans les magasins des libraires français, sur les rayonnages, les clavecins et la table de travail des musiciens et compositeurs allemands. Étudier de manière conjointe la dissémination imprimée et manuscrite de la musique française permet donc de sortir de l’espace de la cour et de mettre en évidence des réseaux de diffusion très différents de ceux que nous avons envisagés jusqu’à présent. À travers ces différentes strates, ce qui frappe est la très grande plasticité des genres musicaux français : quelle que soit leur place dans la hiérarchie des genres en France, presque aucun d’entre eux n’apparaît sous son visage original au-delà du Rhin. Alors que les œuvres du répertoire théâtral parlé sont généralement adaptées en version originale et intégrale dans les cours allemandes, alors que les livres de langue française circulent sous la forme d’unités stables, la musique française fait toujours l’objet d’une sélection, d’une compilation et d’une adaptation. Il s’agit donc d’un objet matériel et culturel particulièrement volatile. En effet, la dissémination de la musique ne véhicule pas d’abord des artefacts culturels ou des œuvres musicales abstraites, mais concerne avant tout la musique comme objet matériel : du papier, des notes, de l’encre, éventuellement des instruments et des pratiques. L’aspect matériel des sources musicales sera donc placé au premier rang : l’identification des copistes, l’élucidation de l’origine du papier ou l’analyse de la présentation du texte musical peut apporter un éclairage décisif sur l’origine de ces sources, les modèles sur lesquels elles ont été copiées, les contextes dans lesquels elles ont été utilisées, ainsi que sur les transformations qu’elles font subir aux modèles originaux. Nous aurons à cœur d’inscrire ces sources dans le contexte culturel et historique qui leur a donné naissance, afin de comprendre les mécanismes qui président à l’appropriation du répertoire français et les logiques qui conduisent à le solliciter. Ceci permet de mettre en lumière les pratiques musicales spécifiques qui distinguent, dans les territoires germaniques, la musique française : la question de la nomenclature et celle des pratiques d’exécution caractéristiques de l’orchestre à cordes français sont de ce point de vue essentielles. La question des sources imprimées est à la fois centrale et délicate, puisqu’à l’inverse de ce qui se passe pour la musique italienne qui circule largement sous forme manuscrite, la dissémination du répertoire français semble étroitement corrélée à celle des éditions parisiennes. Or, les imprimés n’offrent généralement pas la même densité d’informations que les manuscrits, et leur étude porte surtout des fruits lorsqu’elle est menée dans une perpective comparative à partir d’un corpus assez vaste. Ainsi une approche systématique qui recenserait l’ensemble des sources imprimées de musique française dans l’Empire serait-elle une entreprise passionnante, qui pourrait apporter des éléments nouveaux sur la circulation de la musique et offrir une cartographie des réseaux de diffusion des imprimés. Mais une limite demeure toujours : de même que les textes imprimés ne portent la trace des lectures dont ils ont fait l’objet qu’à travers des notes manuscrites marginales ou des détails matériels, de même les volumes de musique imprimée doivent-ils être examinés un par un, page par page, pour être susceptibles de livrer des informations. C’est donc au point exact où la musique imprimée et la musique manuscrite se croisent et se rejoignent, par le biais de la copie, par celui des notes marginales ou de toute autre manière, que se situent beaucoup de réflexions de ce chapitre.
– 192 –
La dissémination de la musique
Les imprimés musicaux : de l’achat à la copie L’achat de partitions musicales constitue un poste de dépense régulier pour les cours qui entretiennent des ensembles musicaux français. Leur coût, généralement moindre que celui des manuscrits, permet non seulement de doter les collections royales ou ducales d’éditions de prestige dans une visée patrimoniale, mais également de fournir aux musiciens du matériel pour la copie de nouvelle musique sur place. On observe donc une corrélation très étroite entre la présence d’imprimés français dans les bibliothèques musicales et la production de manuscrits : les principales collections de partitions imprimées de musique française sont solidaires de grands ensembles de copies manuscrites confectionnés pour l’usage quotidien et immédiat des Hofkapellen. Il paraît donc assez logique à première vue de postuler que les copies manuscrites ont été réalisées à partir d’imprimés achetés par les cours. Un regard plus attentif permet cependant de nuancer cette hypothèse et de mettre en lumière la variété des provenances et des usages. Les collections de cour Certaines vastes collections d’imprimés musicaux français ont aujourd’hui complètement disparu. C’est le cas de l’ancienne bibliothèque de la cour de Kassel, où quelques imprimés ont sans doute servi de modèle à certains manuscrits encore conservés : Martine Roche a mis en évidence l’étroite parenté entre les « Branles de Monsieur Brulard » présents dans les manuscrits de Kassel et un recueil d’airs pour le violon imprimé par Ballard en 1665.2 Les titres, la datation et la partie supérieure des pièces sont identiques dans le manuscrit et dans l’imprimé, mais les voix intermédiaires et la basse sont en revanche très différentes. Roche conclut que seul le dessus a dû faire l’objet d’une copie manuscrite à partir de l’imprimé, les autres voix ayant été arrangées sur place en fonction des pratiques locales. Beaucoup d’autres pièces ont cependant fait l’objet d’une transmission purement manuscrite, n’étant pas accessibles dans le répertoire imprimé de l’époque.3 La bibliothèque musicale de la cour de Darmstadt, complètement détruite pendant la Seconde guerre mondiale, contenait également plus d’une quarantaine de volumes imprimés à Paris ou à Amsterdam entre 1680 et 1730, surtout composés du répertoire de l’Académie royale de musique.4 Mais la constitution de ces collections de cour ne reposait pas seulement sur une politique d’achat institutionnalisée : elles accueillaient aussi les achats effectués à titre personnel par des membres de la cour, des fonds provenant d’anciennes bibliothèques privées des princes, de certains grands aristocrates ou de musiciens, et reflètent donc parfois les goûts musicaux de ces anciens possesseurs. Une mosaïque de provenances Pour les aristocrates mélomanes, le Grand tour pouvait représenter l’occasion d’enrichir les collections musicales de la cour ou leur bibliothèque de musique personnelle par l’achat de nouveaux imprimés. Le prince Johann Ernst von Sachsen-Weimar se procura ainsi de nombreux imprimés de musique française et italienne au cours de son voyage d’études à Utrecht entre 1711 et 1713 — politique d’achat qui ne passa d’ailleurs pas inaperçue parmi les musiciens de la cour. C’est précisément cette raison qu’invoqua un élève de Bach, Philipp David Kräuter, lorsqu’il demanda la permission de prolonger son séjour à Weimar auprès de l’école évangélique de sa ville natale d’Augsburg : 2 3 4
Martine Roche, « Le Manuscrit de Cassel et les “Pièces pour le violon à 4 parties de différents autheurs” (Ballard, 1665) », Recherches sur la musique française classique, 9, 1969, p. 5-20. Robertson, The Courtly Consort Suite, p. 65-91. D-DS, KK-Mus : Friedrich Noack, Katalog der Kriegsverluste der Musikalien. Je remercie Nicola Schneider d’avoir attiré mon attention sur ce catalogue. Sur une tentative de reconstitution des collections manuscrites de Darmstadt, voir Nicola Schneider, « Die Musikhandschriftensammlung Schneider-Genewein in Zürich », Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft, 55/1, 2012, p. 19-34.
– 193 –
Chapitre 4
comme le prince de Weimar, grand amateur de musique qui joue aussi très bien du violon à ce qu’il paraît, rentrera après Pâques de Hollande pour passer l’été ici, je pourrais donc entendre beaucoup de belle musique italienne et française, ce qui me serait très profitable pour composer des concerts et des ouvertures.5
La plupart des partitions rapportées par le prince ont été perdues. Comme le laisse entendre Kräuter, le prince Johann Ernst ne rapportait pas seulement des éditions hollandaises de musique italienne qui lui servirent de modèles ainsi qu’à Bach pour la composition et la transcription pour l’orgue de concertos. Il avait aussi dans ses malles de la musique française, dont presque rien ne reste. Seules deux rééditions assez tardives de Lully sont conservées à l’Amalienbibliothek de Weimar qui contient les anciennes collections de la cour : l’édition de 1716 de Rolland et l’édition de 1720 de Thésée.6 C’est également pendant son séjour à Paris en 1715 que le prince Friedrich Ludwig von Württemberg (1698-1731) put commencer la constitution d’une grande collection de musique française, aujourd’hui conservée à Rostock.7 Ekkehard Krüger relève que 87 volumes de la collection ont été imprimés à Paris, dont 67 figuraient dans la collection personnelle du prince. Les partitions achetées n’étaient pas toutes imprimées, mais pouvaient avoir été réalisées sous forme manuscrite par des ateliers de copistes parisiens. La bibliothèque de Dresde comprend une cinquantaine d’imprimés musicaux en provenance de France (Tableau 4.1, p. 196-197). Nombreux sont ceux qui portent encore la cote et l’ex-libris de l’ancienne collection royale, la « Musica Regia » ou Königliche Privatmusiksammlung (KPMS).8 D’autres sont entrés plus tard dans les collections, à un moment où la bibliothèque royale était déjà publique, et portent donc seulement la cote ou l’ex-libris de Königliche Öffentliche Bibliothek (KÖB). Quelques exemplaires ont rejoint la collection par le biais de musiciens français engagés dans la Hofkapelle qui les ont légués après leur mort ou laissés après leur départ. Un cas spectaculaire de dissémination de musique imprimée est offert par deux exemplaires des Trio des opéras de Monsieur de Lully, publiés à Amsterdam par Blaeu en 1690. Ces parties séparées, présentes en deux exemplaires dans la bibliothèque de Dresde, portent en tête de chacune des parties de basse une marque de possession manuscrite : A Zelenka Music[ien] de Sa Maieste le Roy de Pologne et Electeur de Saxe 1716 a Vienne.9 Illustration 4.1. Insertion manuscrite de Jan Dismas Zelenka sur les Trios de Lully : D-DI, Mus. 1827-F-27, partie de basse.
Le musicien a donc acheté son exemplaire pendant une longue période de voyage, où il s’absenta de Dresde entre 1716 et 1719 pour aller étudier la composition en Italie et à Vienne, où il prit entre autres des cours de composition auprès de Fux.10 Nous avons ici un cas assez complexe de circulation : imprimées en Hollande, les parties séparées ont donc transité par Vienne avant de finir leur trajet à Dresde par l’intermédiaire de Zelenka. Cet exemplaire figure dans le catalogue du 5
6 7 8 9 10
Hans-Joachim Schulze, Studien zur Bach-Überlieferung im 18. Jahrhundert, Leipzig 1984, p. 156-163, ici p. 157 : « der hiesige fürstliche Weimarische Printz, als welcher nicht nur allein ein großer Liebhaber der Music, sondern auch selbst eine unvergleichliche Violin spilen soll, nach Ostern aus Holland nach Weimar kommen u. den Sommer über da verbleiben wird, kunte also noch manche schöne Italienische und Frantzösische Music hören, welches mir absonderlich in Componirung der Concerten und Ouverturen, sehr profitabel seyn würde. » D-WRz, M 8:25 : Jean-Baptiste Lully, Thésée, Paris 1720. D-WRz, M 8:26 : Jean-Baptiste Lully, Rolland, Paris 1716. Ekkehard Krüger, Die Musikaliensammlung des Erbprinzen Friedrich Ludwig von Württemberg-Stuttgart und der Herzogin Luise Friederike von Mecklenburg-Schwerin in der Universitätsbibliothek Rostock, Beeskow 2006, notamment vol. 1, p. 122-124. Ortrun Landmann, Über das Musikerbe der Sächsischen Staatskapelle, Dresde 2010, p. 12-19. D-Dl, Mus. 1827-F-27, partie de basse, couverture intérieure. Stockigt, Jan Dismas Zelenka, p. 43-58.
– 194 –
La dissémination de la musique
fonds musical de l’église catholique rédigé en 1765 et a donc sans doute été versé dans les archives musicales de la chapelle catholique de la cour peu de temps après la mort de Zelenka en 1745. Le fait que Zelenka inscrive son nom sur la partie de basse indique que le musicien, initialement engagé comme contrebassiste à la cour de Dresde avant de prendre en charge la composition de musique pour la chapelle catholique de la cour à partir de 1719, a probablement d’abord fait un usage privé de cette musique, dans un but de pratique musicale ou de composition. D’autres imprimés ont également appartenu à des musiciens de la Hofkapelle : l’exemplaire de l’Amadis de Grèce de Destouches appartenait au chanteur François Godefroy Beauregard, qui a reporté son nom (« François Beauregard ») pas moins de quatre fois sur la page de titre.11 On trouve également une édition d’Atys de Lully ayant appartenu à Louis André, ainsi qu’en témoignent plusieurs marques de possession écrites à l’encre sur la page de couverture.12 D’autres exemplaires imprimés ont transité par les collections privées de grands aristocrates ou d’amateurs de musique : les sept exemplaires de Lully reliés aux armes du comte de Brühl et l’édition Mortier du dictionnaire de Brossard sont probablement issues de la bibliothèque musicale familiale. Un exemplaire de Roland provient de la bibliothèque bavaroise du prince d’Oettingen-Wallerstein, dont elle porte l’ex-libris : elle doit donc avoir rejoint la bibliothèque à une date tardive.13 D’autres enfin proviennent de collections particulières plus obscures. Une édition de la tragédie en musique Issé de Destouches, imprimée en partition générale par JeanBaptiste Christophe Ballard en 1724, porte ainsi une marque de possession de Marguerite Dufour à Leipzig.14 Il a donc appartenu à l’une des membres de la grande dynastie huguenotte originaire de Lyon, qui s’était établie à Leipzig depuis 1708 dans le commerce de soie et autres « denrées françaises ».15 Comme le montre la collette du libraire lyonnais encore présente, cet exemplaire a été acheté dans la ville d’origine de la famille Dufour, d’où il a été emporté ou envoyé à Leipzig pour rejoindre la bibliothèque de la famille, avant d’être finalement intégrée aux collections de la bibliothèque royale de Dresde. Objet de collection ou support de pratiques ? La question de l’utilisation des imprimés musicaux est complexe, puisqu’il est généralement impossible de savoir dans quelle perspective les partitions ont été achetées : dans une visée purement patrimoniale, comme objet de valeur pour orner les collections de bibliothèques prestigieuses, ou bien pour fournir le support de pratiques musicales, à travers leur copie ? Il faut bien dire que les traces d’usage et les insertions manuscrites dans les partitions imprimées sont assez rares, puisqu’il s’agit d’objets précieux qu’on hésite donc à abîmer. Même les exemplaires possédés par des musiciens ne portent généralement pas de trace d’usage, alors que ceux-ci faisaient probablement un maniement intensif de leurs exemplaires imprimés. La troisième édition de L’Europe galante de Campra représente un contre-exemple, puisqu’elle a probablement appartenu à une musicienne sans doute amatrice (on trouve le nom d’une certaine « Judith Thomas » qui ne figure pas dans le personnel musical de la cour) mais contient quelques indications d’exécution : après 11 12 13
14 15
D-Dl, Mus. 2148- F-5 : Destouches, Amadis de Grèce, Paris 1699. D-Dl, Mus. 1827-F-5 : Lully, Atys, Paris 1689. Deuxième de couverture, à l’encre : « Pour Monsieur Dandre. » Page de garde : « Mr Dandre. » L’exemplaire porte un ex-libris orné, peu visible, sans lettres, autrement inconnu dans les collections. Je remercie Karl Wilhelm Geck et Barbara Wiemann pour leur expertise. Grand collectionneur de livres français et amateur de musique, Kraft Ernst von Oettingen-Wallerstein (17481802) arriva au pouvoir en 1773 et fut élevé à la dignité princière en 1774, date après laquelle doit avoir été posé l’ex-libris qui porte une couronne princière. La majeure partie de sa collection se trouve aujourd’hui dans la bibliothèque universitaire d’Augsburg. D-Dl, Mus. 2148-F-1. Les marques de provenance incluent un monogramme manuscrit « MD » et la collette du libraire (p. iii : « A Lyon, chez de Brotonne | Grande ruë Merciere à côté | de la Banniere de France ») ainsi qu’une insertion manuscrite : « Margueritte Dufou [Dufour] de Leipzig », p. v. Katharina Middell, « Hugenotten zwischen Leipzig und Lyon. Die Familie Dufour », in : Übergänge und Verflechtungen. Kulturelle Transfers in Europa, dir. Gregor Kokorz et Helga Mitterbauer, Berne 2004, p. 47-72.
– 195 –
Lully, Jean-Baptiste
Lully, Jean-Baptiste
Lully, Jean-Baptiste
Lully, Jean-Baptiste
Lorenzani, Pietro
Lalande, Michel Richard de
Campra, André
Campra, André
Campra, André
Campra, André
1827-F-27,1
1827-F-27,2
1827-F-28
2021-E-01
2116-Q-01
2124-E-01
2124-F-01
2124-F-03
2124-F-04
Lully, Jean-Baptiste
1827-F-14
1827-F-24
Lully, Jean-Baptiste
1827-F-12
Lully, Jean-Baptiste
Lully, Jean-Baptiste
1827-F-10
1827-F-22
Lully, Jean-Baptiste
1827-F-09
Lully, Jean-Baptiste
Lully, Jean-Baptiste
1827-F-07
1827-F-20a
Lully, Jean-Baptiste
1827-F-05a
Lully, Jean-Baptiste
Lully, Jean-Baptiste
1827-F-05
1827-F-20
Lully, Jean-Baptiste
1827-F-03
Lully, Jean-Baptiste
Lully, Jean-Baptiste
1827-F-01
1827-F-18
Robert, Pierre
1718-E-01
Lully, Jean-Baptiste
—
01-K-532
1827-F-16
Compositeur
Cote : Mus.
– 196 – Tancrède
Hésione
L’Europe galante
Motets à 1, 2 et 3 voix
Motets, Livres II et III
Motets
Achille et Polixène
Trios des opera de Lully
Trios des opera de Lully
Acis et Galatée
Armide
Roland
Roland
Amadis
Phaëton
Persée
Le Triomphe de l’Amour
Proserpine
Bellerophon
Thésée
Atys
Atys
Alceste
Cadmus et Hermione
Motets pour la chapelle du Roy
Brunetes et petits airs tendres
Titre harmonisé
Ballard
Ballard
Ballard
Ballard
Boivin
Ballard
Pointel
Blaeu
Blaeu
Ballard
Ballard
Ballard
Baussen
Baussen
Baussen
Ballard
Ballard
Ballard
Ballard
Baussen
Baussen
Ballard
Baussen
Ballard
Ballard
Ballard
Éditeur
1702
1700
1699
1700
1729
1688
1688
1691
1690
1686
1686
1685
1709
1711
1709
1682
1681
1714
1714
1711
1709
1689
1709
1719
1684
1703-1711
Date
KPMS
Thomas, KPMS
KPMS
KPMS
Zelenka
Zelenka
Wappen 1, KÖB
Wappen 3
Ex. lib. Oettingen-Wallerstein
Brühl
Brühl
Brühl
Wappen 3
Hingant, KPMS
Brühl
Brühl
Brühl
Brühl
Louis André, KPMS
Brühl
KPMS
Hofkirche
Provenance
Tableau 4.1. Liste des imprimés de musique française conservés à la Sächsische Universitäts- und Staatsbibliothek Dresden (1680-1730).
Chapitre 4
Iphigénie Issé Omphale Callirhoé Amadis de Grèce
Rebel, Jean Ferry
Rebel, Jean Ferry
Desmarets, Henri
Destouches, André Cardinal
Destouches, André Cardinal
Destouches, André Cardinal
Destouches, André Cardinal
Bernier, Nicolas
Bernier, Nicolas
Couperin, François
Clérambault, Louis-Nicolas
Clérambault, Louis-Nicolas
Mouret, Jean-Joseph
Mouret, Jean-Joseph
Mouret, Jean-Joseph
Aubert, Jacques
Aubert, Jacques
Aubert, Jacques
Quinault, JBMaurice
Francœur, Louis
Leclair, Jean Marie
Brossard, Sébastien de
Brossard, Sébastien de
2146-M-01,1
2146-M-01,2
2147-F-500
2148-F-01
2148-F-03
2148-F-04
2148-F-05
2151-J-01
2151-L-01
2162-T-01
2352-J-500,1
– 197 –
2352-J-500,2
2394-F-01
2394-F-02
2394-F-04
2430-F-01
2430-R-01
2430-R-02
2445-F-02, 1-2
2472-R-01
2484-R-01
MB 8° 175 Rara
MB 8° 176 Rara
Dictionnaire
Dictionnaire
Sonates à violon seul, Livre III
Sonates à violon seul, Livres I
Divertissements
Sonates à violon seul, Livres I et II
Première Livre de sonates à violon seul, Livre I
La Reine des Péris
Pirithoüs
Pan et Doris
Ariane
Cantates françoises, Livre II
Cantates françoises, Livre I
Pièces de clavecin
Les Nymphes de Diane, cantate françoise
Cantates françoises, Livres I-IV
Caprice
Pièces pour le violon
Cantates françoises, Livre II
Campra, André
2124-J-01
Titre harmonisé
Compositeur
Cote : Mus.
Mortier
Roger
Boivin
Foucault
Ribou
Boivin
Foucault
Boivin
Boivin
Leclerc
Ballard
Foucault
Foucault
Boivin
Foucault
Foucault
Ballard
Ballard
Ballard
Ballard
Ballard
Ballard
Ballard
Ballard
Éditeur
KPMS
Cartier, KPMS
KPMS
KÖB
Chelisey, Berryer, KPMS
KPMS
François Beauregard, KPMS
Wappen
Marguerite Dufour, KPMS
Tonkünstlerverein
KPMS
Provenance
sd
sd
sd
1715
Brühl
Ferdinand Keffer, KPMS
Ferdinand David, KPMS
KPMS
1714-1723 KÖB
sd
1719
1725
1723
1730
1717
1713
1710
1713
sd
sd
1699
1712
1701
1724
1711
1711
1705
1714
Date
La dissémination de la musique
Chapitre 4
la fin d’un mouvement, ou trouve « las une fois lon reprant la marche », ou bien quelques pages plus loin « la 2me fois lon reprend le 2me air si devan ».16 Si l’on compare la liste des imprimés avec celle des parties d’orchestres réalisées par les ateliers de copie de musique de la cour de Dresde, on constate pourtant que beaucoup de suites manuscrites ont un modèle imprimé dans les collections royales, quelle que soit leur provenance. Sur dix-sept suites tirées des opéras de Lully, seules cinq n’ont pas de modèle imprimé dans les collections de cour. Pour d’autres compositeurs, la comparaison est plus aléatoire : manquent ainsi les exemplaires sur lesquels ont été copiées l’ouverture tirée de Thétis et Pelée de Collasse ou celle d’Alcione de Marin Marais. Pourtant, la majeure partie des parties séparées manuscrites reproduisent très exactement le texte de l’édition imprimée. Même les parties intermédiaires sont parfois la copie littérale de la partition générale. C’est le cas pour l’ouverture tirée de l’Europe galante de Campra, où les parties « de remplissage » sont identiques à celles de la partition générale imprimée en 1724 par Ballard, bien qu’aucun exemplaire ne soit conservé dans la bibliothèque – seule la partition réduite de 1699 est présente. C’est aussi le cas pour la plupart des ouvertures de Lully, dont les parties intermédiaires reprennent le texte de la partition générale avec des modifications mineures : omission de la partie de quinte, ajout d’ornements, enrichissement du chiffrage pour les parties de clavecin. De même, l’examen des parties intermédiaires montre que les ouvertures tirées de l’Orphée de Louis Lully, ou de Thétis et Pelée de Pascal Colasse ont sans doute été copiées sur les partitions générales imprimées. Beaucoup d’œuvres n’ont toutefois jamais été imprimées sous forme de partitions générales. La plupart des œuvres de Campra, Destouches et Mouret furent seulement publiées sous forme de partition réduites. Dans ce cas, il faut postuler que les parties intermédiaires étaient composées de nouveau sur place ou bien copiées à partir d’une autre source manuscrite. La copie directe sur l’imprimé n’est donc pas la règle. Un autre cas de figure très intéressant est fourni par les suites qui prennent un net caractère de compilation, comme deux suites dont les mouvements sont tirés de nombreuses œuvres de Lully.17 Outre le fait que certaines de ces œuvres n’ont jamais fait l’objet d’une impression, il serait très malaisé pour un copiste de travailler directement à partir des partitions imprimées pour en extraire les mouvements de sa suite : il n’y a pas moins de six œuvres représentées dans le manuscrit Mus. 1827-F-33, et quatre dans le Mus. 1827-F-35 (Tableau 4.2). Il est donc probable que les copistes avaient à leur disposition d’autres sources manuscrites que les partitions imprimées. Certains musiciens ont également copié leurs propres partitions manuscrites. Les copies réalisées par Pisendel témoignent de la confrontation du violoniste allemand avec le répertoire français à l’occasion de son voyage en France en 1714.18 L’une d’entre elles est la copie des Caractères de la danse de Jean-Féry Rebel : l’exemplaire a été visiblement assez rapidement copié, mais son écriture est indéniablement celle du violoniste saxon.19 Pisendel aurait pu rencontrer personnellement Rebel à Paris, puisque celui-ci était alors âgé de 36 ans et se trouvait au faîte de sa carrière, ou bien avoir eu accès à sa musique par un autre biais. Les Caractères devinrent rapidement une des pièces maîtresses du répertoire français de Dresde : sur la double feuille qui contenait la copie de l’œuvre française, on trouve une musette, dont la ligne mélodique est assise sur une pédale de quinte à vide, ainsi qu’une bourrée, toutes deux écrites pour la même nomenclature instrumentale que les Caractères (sol 2, ut 1, ut 2 et fa 4).20 Delang indique que Pisendel a pu composer ces deux mouvements en guise d’introduction aux Caractères, et que c’est seulement très récemment que ces deux 16 17 18
19 20
D-Dl, Mus. 2124-F-1, p. 255 et 268. D-Dl, Mus. 1827-F-33 et Mus. 1827-F-35. Kerstin Delang, « Betrachtungen zu einigen Werken französischer Komponisten in Abschriften von Johann Georg Pisendel », in : Johann Georg Pisendel. Studien zu Leben und Werk. Bericht über das Internationale Symposium vom 23. bis 25. Mai 2005 in Dresden, dir. Ortrun Landmann et Hans Günter Ottenberg, Hildesheim 2010, p. 77-102. D-Dl, Mus. 2146-N-2. D-Dl, Mus. 2146-N-1.
– 198 –
La dissémination de la musique
Tableau 4.2. Provenance des mouvements dans le jeu de parties séparées. D-Dl, Mus. 1827-F-33. Titre
Provenance
LWV
Ton
Ouverture
Lully, Les Festes de l’Amour et de Bacchus
47/1
sol m
1. Prelude
non identifié
–
do M
2. Sinfonie
Lully, Les Festes de l’Amour et de Bacchus
47/5
do M
3. Entrée
Lully, Les Festes de l’Amour et de Bacchus
47/9
do M
4. La Mariée
Lully, Ballet de Flore
40/18
si bémol M
5. Menuet
Lully, Ballet de Flore
40/14
si bémol M
6. Magissien
Lully, La Pastorale Comique
33/1
si bémol M
7. Rittorn:
Lully, La Pastorale Comique
33/3
si bémol M
8. Air
Lully, Les Amants magnifiques
42/16
sol m
9. Trio
Lully, Les Festes de l’Amour et de Bacchus
47/29
sol m
10. Rondeau
Lully, Le Grand divertissement Royal de Versailles
38/7
sol m
11. La Coure
Lully, Les Festes de l’Amour et de Bacchus
47/40
sol M
12. Menuet
Lully, Le Grand divertissement Royal de Versailles
38/14
sol M
13. Le donneur de livre
Lully, Le Bourgeois gentilhomme
43/23
sol M
14. Canarie
Lully, Le Bourgeois gentilhomme
43/7
sol M
15. Chaconne
Lully, Acis et Galatée
73/32
ré M
16. (sans titre)
non identifié
–
sol m
folios ont été séparés et se sont vus attribuer deux cotes différentes. On voit apparaître, sur le coin gauche de la feuille, le nom de « La petite Drôt » : il s’agit de la belle-fille du chanteur Jean-David Drot, une danseuse aussi connue sous le nom de Clément, qui avait été engagée par le prince en 1716 à Lyon. La liste de copies faites par Jacques Guénin permet de savoir que les Caractères furent sans doute dansés dans les années 1725-1726 à Varsovie par la danseuse Louise de Vaurinville. Ils furent également produits en 1731 à la cour de Dresde par Marianne Clément.21 On trouve aussi, de la main de Pisendel, une copie de la sonate en trio La convalescente de François Couperin, issue du troisième ordre des Nations (1726). Là encore, la disposition extrêmement ramassée et compacte du manuscrit suggère une destination d’abord privée. C’est ce manuscrit qui a pu servir de modèle pour la transcription en trio pour orgue de Bach, l’Aria bwv 587 : Pisendel aurait ainsi rendu visite à Bach sur le chemin du retour, et lui aurait transmis ses impressions toutes fraîches de France, ainsi que de la musique copiée dans la capitale.22 D’autres copies de sa main figurent dans les collections de Dresde : il s’agit d’abord d’une sonate pour violon et basse continue de Leclair, publiée en 1723 dans le Premier livre de sonates à violon seul avec la basse continue (n° 7). Pisendel est également le copiste principal de trois œuvres de Venturini, aussi copiées par Johann Gottfried Grundig (1706-1773).23 Celui-ci n’a officiellement commencé ses activités de copiste pour la cour qu’en 1733, mais il copiait sans doute de la musique à titre privé pour Pisendel ou d’autres commanditaires à partir de 1725.24 Ces sources ont été copiées par Pisendel pendant son activité comme violoniste puis comme Konzertmeister à Dresde, où il prit la succession de Volumier. La copie par Johann Joachim Quantz (aidé par le copiste anonyme S-Dl-052) des deux concertos de Guignon fournit également un cas d’étude intéressant sur la circulation de la musique par le biais des musiciens.25 Cette copie a dû intervenir pendant la période d’activité de 21 22 23 24 25
Delang, « Betrachtungen », p. 89. Kerstin Delang, « Couperin - Pisendel - Bach. Überlegungen zur Echtheit und Datierung des Trios bwv 587 anhand eines Quellenfundes in der Sächsischen Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden », Bach Jahrbuch, 93, 2007, p. 197-204. Voir Chapitre 5, p. 264-265. D-Dl, Mus. 2-O-1,32, Mus. 2142-O-3a et Mus. 2142-O-6. Landmann, Über das Musikerbe der sächsischen Staatskapelle, p. 147. D-Dl, Mus. 2957-O-1 et Mus. 2957-O-2.
– 199 –
Chapitre 4
Quantz à Dresde, soit entre 1716 et 1741. Nous n’avons pas pu retrouver la source de ces concertos, genre dans lequel Guignon n’a jamais publié d’œuvre imprimée. On peut donc penser que Quantz a obtenu une source manuscrite de ces pièces lors de son séjour à Paris en 1726-1727, période qui correspond justement au début de l’activité de Guignon à Paris, où il se produit au Concert Spirituel dès avril 1725.26 Cette hypothèse est renforcée par la graphie italienne du nom de Ghignone utilisée par Quantz, qui pourrait indiquer une date de composition précoce de ces concertos : la graphie française du nom de Guignon s’imposera peu à peu entre 1725 et 1741, date de sa naturalisation française. Le filigrane en forme de grappe de raisin que l’on trouve dans les deux manuscrits pourrait bien indiquer une origine française du papier, même si un travail plus approfondi est encore nécessaire pour le déterminer avec certitude. Notons enfin que le copiste auxiliaire de Quantz (S-Dl-052) n’est présent que dans ces deux jeux de parties séparées, et qu’il est de ce fait fort possible qu’il se soit agit d’un copiste français. Air de cour et cantate Le répertoire vocal soliste est souvent négligé mais a visiblement connu une large diffusion, notamment par le biais des livres d’airs de différents auteurs imprimés par Ballard, dont des exemplaires sont conservés un peu partout en Europe, et par celui des livres de cantates françaises. Le nombre de cantates conservées dans la collection de Friedrich Ludwig von Württemberg-Stuttgart est tout à fait impressionnant : on trouve des œuvres de Stuck, Morin, Clérambault, Bernier, Bourgeois sous forme imprimée. Parmi elles, les cantates de Thomas Louis Bourgeois (1676-1750) montrent bien la solidarité entre diffusion imprimée et copie manuscrite. L’exemplaire imprimé porte, sur la seconde page de couverture, une marque de possession de Johann Nicolaus Nicolai et même l’endroit où il fut acheté, c’est-à-dire au domicile du compositeur.27 L’ancien possesseur est un musicien originaire de Munich et qui se trouvait au service de la cour de Stuttgart depuis au moins 1714 puisque le Kapellmeister Johann Christoph Pez note en janvier de cette année que « Nicolai joue très bien de la flûte [à bec], de la flûte allemande et du hautbois, et il accompagne aussi très bien sur le clavecin, ce pour quoi j’ai souvent besoin de lui.28 » Nicolai avait accompagné le prince Friedrich Ludwig à Paris en 1715. La copie manuscrite qu’il réalise de la cantate « Les Sirènes » sous forme de parties séparées diffère assez sensiblement de la version imprimée : le chiffrage de la basse continue, le titre des mouvements et parfois le texte musical diffèrent, et la partie de basse continue est transposée un ton plus bas.29 Elle adopte donc le Chorton – le diapason d’église, les orgues étant souvent accordés un ton plus haut dans l’espace germanique – ce qui semble indiquer l’usage d’un orgue de chambre pour la réalisation du continuo. Une seconde copie beaucoup plus proche du texte original a été copiée dans les premières années du xviiie siècle par un copiste de la cour, peut-être par Haumale des Essarts, actif comme Konzertmeister à la cour de Stuttgart entre 1724 et 1732.30 Les cantates de Bernier sont particulièrement bien représentées dans les bibliothèques de cour. À Dresde, elles sont présentes à la fois sous forme manuscrite et imprimée : on trouve les quatre premiers livres des Cantates françoises publiés chez Foucault entre 1703 et 1723, reliés par paire. Le premier volume comporte l’ex-libris de la Königliche Musikprivatsammlung tandis que Les Nymphes de Diane, également publiée chez Foucault, ne portent aucune marque de provenance.31 26 27 28 29 30 31
Neal Zaslaw, « Guignon, Jean-Pierre » in : Grove Music online. Sur le séjour de Quantz à Paris, voir son autobiographie publiée par Marpurg, Historisch-Kritische Beyträge, vol. 1, p. 225-227. D-ROu, Musica Saec. XVII 18-5. Cf. Krügger, Die Musikaliensammlung, vol. 2, p. 112 : « Habe Es in Paris selbsten v. Mr. Burgeois gekaufft. gehört Meiner Pro Memoria Nicolai ». Des marques de possession de Nicolai se trouvent également sur les trois livres de trio de Michel de La Barre. Krüger, Die Musikaliensammlung, vol. 1, p. 264. Krüger, Die Musikaliensammlung, vol. 2, p. 113. D-ROu, Mus.Saec. XVII 5-4. Sur Haumale des Essarts, voir Owens, The Württemberg Hofkapelle, p. 232-235. Sur le catalogue (« Memoire des Musique des Son Altesse Serenissime Monseigneur Le Prince Hereditaire de Wirtemberg »), voir Krüger, Die Musikaliensammlung, p. 164-165. D-Dl, Mus. 2151-L-1.
– 200 –
La dissémination de la musique
Les deux premiers livres des Cantates françoises ont aussi fait l’objet d’une copie manuscrite sur place.32 Comme le montre le filigrane, le papier provient d’une fabrique située à quelques kilomètres de Dresde, à Zittau.33 La main du copiste de Bernier peut d’ailleurs être retrouvée dans plusieurs autres manuscrits de Telemann, et il a parfois été suggéré que cette écriture puisse être celle de Johann Quantz.34 De format oblong, les feuilles de papier ne sont pas pas reliées, mais simplement pliées en deux et glissées l’une dans l’autre par groupe de deux. Chaque cahier comprend 8 pages. Une seconde main peut être identifiée sur le manuscrit. Elle apporte des corrections dans une encre plus claire pour les deux premières cantates, essentiellement d’ordre prosodique ou orthographique : placement des syllabes sous les notes, corrections d’erreurs de copie du texte français. L’encre des corrections devient plus foncée à partir de la troisième cantate, et il semblerait qu’une troisième main apporte désormais des corrections. Outre la fidélité du texte musical, un détail supplémentaire permet de confirmer que c’est bien la version imprimée de Foucault qui a servi de modèle pour la copie manuscrite de Mus. 2151-J-1 : à la page 17 du manuscrit le copiste a d’abord copié une clé d’ut 4 qu’il corrige en fa 4. Or, au même endroit, l’édition originale change de clé lors d’un changement de système sans placer de guidon d’avertissement à la fin du système précédent. Dans la collection musicale de Friedrich Ludwig sont présents pas moins de trois exemplaires des cantates de Bernier, sous forme imprimée et manuscrite.35 La liste des copies de musique réalisées par Jacques Guénin en 1720 comprend aussi des cantates profanes de Jean-Baptiste Stuck (dit Batistin) et d’André Campra, copiées en partition ou sous forme de parties séparées (voir Tableau 3.5, p. 189). Plusieurs sont probablement issues de l’édition des Airs nouveaux des Messieurs Campra et Batistin publiée par Christophe Ballard en 1708 : on retrouve dans la liste de Guénin quatre d’entre elles (« Regnez, belle Thétis », « Trompettes, éclatez, redoublez vos concerts », « Venez, régnez, aimables Jeux », « Non semper Guerriero è il son del la tromba »). Si la majeure partie de cette liste est composée de mouvements sans nom d’auteur, d’autres œuvres identifiables se détachent de l’ensemble. Les Caractères de la danse de Jean-Féry Rebel (1666-1747) apparaissent deux fois dans la liste : une première fois copiées en parties séparées sur neuf feuilles, et une seconde fois « pour Mlle de Vaurinville », danseuse à la cour de Dresde, toujours copiées en parties séparées sur quatre feuilles. De fait, cette pièce était visiblement un classique du répertoire de la Hofkapelle de Dresde, depuis que Johann Georg Pisendel en avait rapporté une copie manuscrite de son voyage parisien de 1714. Il est d’ailleurs possible que Guénin ait copié la partition manuscrite de Pisendel plutôt que la partition imprimée parue chez Le Clerc en 1715. Les sources du motet Si la diffusion des principaux genres français – tragédie en musique, ballet, cantate profane et suite instrumentale – est un phénomène assez bien connu, on assiste également à la diffusion plus inattendue d’autres genres qui ne sont habituellement pas considérés comme faisant partie des produits d’exportation de la France. Parmi eux, le motet offre un premier cas d’étude tout à fait intéressant pour comprendre les mécanismes de la diffusion de musique française dans les territoires germaniques. Il connaît en effet une diffusion massive, dont la reconstitution permet de délimiter un corpus cohérent tout en éclairant plus généralement les mécanismes de dissémination de la musique de provenance française.
32 33
34 35
D-Dl, Mus. 2151-J-1a. Le contenu de chacun des livres est intégralement recopié. Steven Zohn, « Music Paper at the Dresden Court and the Chronology of Telemann’s Instrumental Music », in : Puzzle in Paper - Concept in Historical Watermark. Essays from the International Conference on the History, Function and Study of Watermarks, dir. Daniel Wayne Mosser, Michael Saffle et Ernest W. Sullivan, Londres 2000, p. 125-168, Filigrane 13. Ortrun Landmann, Die Telemann-Quellen der Sächsischen Landesbibliothek. Handschriften und zeitgenössische Drucke seiner Werke, Dresde 1983, p. 149. D-ROu, Mus. Saec. XVIII 71-2 et Mus. Saec. XVIII 7.3-7.
– 201 –
Chapitre 4
Un corpus exemplaire Les motets français sont présents dans de nombreuses bibliothèques. Les collections royales de Dresde comprennent plusieurs éditions originales de motets français dont certaines ont servi à la chapelle catholique de la cour (Tableau 4.1). Au-delà des deux éditions de 1684 examinées en détail ci-dessous, des imprimés plus tardifs sont également présents : une édition des motets à grand chœur de Paolo Lorenzani (1688), le premier livre de la seconde édition des petits motets de Campra (1700), les livres 1 et 3 de l’édition des motets de « feu Mr. de La Lande » publiée en 1729 par Boivin.36 Ces trois derniers recueils sont cependant dénués de toute marque de possession et de toute trace d’usage, si bien qu’il est difficile d’évaluer s’ils ont pu faire partie du répertoire de la chapelle catholique de Dresde entre 1708 et 1733.37 En outre, ils ne sont pas reliés dans le papier bleu typique des partitions de la chapelle catholique et ils n’apparaissent dans aucun des trois catalogues qui recensent les fonds musicaux de cette institution. D’autres cours ont également possédé dans leur bibliothèque les partitions imprimées transmettant le répertoire de la Chapelle royale de Versailles par le biais du motet à grand chœur. Une partie de dessus de l’édition 1684 des motets de Lully par Christophe Ballard est ainsi conservée à Wolfenbüttel, indiquant sans doute qu’un jeu complet de parties séparées a été présent autrefois dans les collections ducales.38 Cette partie ne comporte aucune trace d’usage et aucune insertion manuscrite, à l’exception de petits traits obliques, tracés à l’encre au-dessus de quelques mesures. Peut-être a-t-on ici la trace d’une activité de copie : les traits auraient été introduits par un copiste pour marquer la fin de passages copiés. Quelques fragments de motets de Du Mont furent aussi retrouvés près de Hanovre, dotés du sceau de la bibliothèque de la cour. Ils ont donc fait partie du répertoire de la chapelle ducale. Plusieurs pages de ces éditions avaient été arrachées pour colmater les tuyaux d’un orgue, où elles furent retrouvées en 1958 lors de la restauration de l’instrument. Parmi elles figurent le second livre des Meslanges publiés par Ballard en 1657 et les Motets à deux voix d’Henry Du Mont publiés en 1668.39 Enfin, une copie manuscrite du Te Deum lwv 55 de Lully figure dans les collections de Schwerin : il s’agit d’une partition réduite aux parties de trompette et de cordes, sans les parties chantées, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que le duc de Schwerin ne disposait pas de chanteurs dans sa Hofkapelle.40 Mais d’autres collections de taille plus réduite contiennent également ce répertoire. C’est notamment le cas de la collection privée du comte Rudolf Franz Erwein von Schönborn, originaire de Mayence (Tableau 4.3). Cinquième fils d’une grande famille catholique de Mayence, il avait d’abord étudié chez les jésuites au Collegium Germanicum à Rome avant d’aller à l’université de Leiden. Il séjourna ensuite quelques mois à Paris, où il fit l’acquisition de huit partitions imprimées de musique sacrée entre juin et septembre 1699, comme l’indiquent les dates d’achat très précisément reportées sur les exemplaires. Ces achats marquaient le début d’un intérêt durable pour la musique d’église, puisque Schönborn achète à partir de 1697 vingt oratorios, 90 messes, 318 motets, 420 psaumes et hymnes, le nombre total de partitions contenant de la musique religieuse s’élevant à plus de 800 à la fin de sa vie.41 Le motet circulait aussi sous forme manuscrite, comme le montre la copie d’un petit motet de Campra en Saxe. Il se trouve dans un petit livre de musique, de format in-quarto italien, relié dans une épaisse couverture de cuir, copié par plusieurs mains différentes dans les deux sens de lecture 36 37 38 39 40 41
Respectivement D-Dl, Mus. 2021-E-1, Mus. 2124-R-1 et Mus. 2116-Q-1. La partie de Basse-continue de Lorenzani porte l’ancienne cote de la bibliothèque royale A 214. D-W, 123 Musica div. La partie conservée est celle de Dessus du Grand chœur. Reliée dans une couverture en carton avec un papier marbré coloré, elle est intitulée « Dessus du grand Chœur ». Un ajout postérieur, à l’encre bleue, précise en dessous : « J. B. de Lully | Motets a deux chœurs | Dessus du grand Chœur | 1684 ». Sievers, Die Musik in Hannover, p. 48-50. D-SWl, Mus. 3496. Andreas Waczkat, « “Les Violons du Duc”. Französische Musiker an mecklenburgischen Höfen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts », Jahrbuch der Ständigen Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, 4, 2004, p. 252-263, ici p. 255-256. Fritz Zobeley, Die Musikalien der Grafen von Schönborn-Wiesentheid, vol. 1, Tutzing 1967, p. XIII.
– 202 –
La dissémination de la musique
Tableau 4.3. Motets imprimés dans les collections de Rudolf Franz Erwein von Schönborn. Nr Compositeur
Titre harmonisé
Éditeur
Date
Annotations
34
Brossard, Sébastien de
Prodromus Musicalis Seu Cantica Sacra Ballard
1695
Paris 26. Juin 1699
35
Brossard, Sébastien de
Élévations et motets
Ballard
1698
Paris 26. Juiin 1699
39
Campra, André
Motets à voix seule
Ballard
1695
Paris 26. Juiin 1699
40
Campra, André
Motets, Livre III
Ballard
1711
v.S. [von Schönborn]
48
Du Mont, Henry
Motets à 2, 3 et 4
Ballard
1681
Paris 5. Sept. 1699
49
Du Mont, Henry
Récit de l’éternité
Ballard
1699
Paris 7. Sept. 1699
55
Foliot, Edme
Motets à 1, 2 et 3 voix
Auteur
[1710] 1711
76
Lebègue, Nicolas Antoine
Motets pour les principales Festes
Ballard
1687
77
Lebègue, Nicolas Antoine
Motets pour les principales Festes
Ballard
1708
93
Menault, Pierre Richard
Vespres à deux chœurs
Ballard
1693
98
Morin, Jean-Baptiste
Motets à une et deux voix
Ballard
1704
Paris 7.7.1699 1699
du volume.42 Il porte une ancienne cote (B 37) et une marque de la Bibliotheca Musica Regia, et est donc probablement arrivé à une date relativement précoce dans les collections royales de Dresde. Au milieu d’un grand nombre de pièces attribuées à Campra et plusieurs cantates italiennes pour voix de soprano, on trouve une copie très propre du motet Exsurge Domine pour voix de basse et deux dessus de violon, également présent dans le livre I de la seconde édition des Motets à I, II et III voix (Ballard, 1700) conservée à Dresde. La différence la plus notable avec le texte imprimé est le placement de la ligne vocale : elle est renvoyée en bas de chaque système par le copiste du recueil, alors qu’elle figure au-dessus de la portée de basse continue dans l’imprimé original. On observe également que quelques indications textuelles (Lentement, Ritournelle, Gravement) ne sont pas reportées dans la copie manuscrite, et que la basse continue est dénuée de tout chiffrage. Comme le filigrane est systématiquement coupé, on ne peut pas émettre d’hypothèse solide sur l’origine de ce recueil. Nous avons ici un surprenant témoignage du fait que les petits motets français pouvaient circuler dans des livres de musique au contenu hétéroclite, en l’occurence un recueil de danses pour clavier et de cantates italiennes probablement destiné à un usage domestique. L’exécution d’un répertoire d’église français semble d’ailleurs avoir été une tradition qui se pérpétua jusque vers le milieu du xviiie siècle. Un livret provenant de Hildburghausen, une cour luthérienne d’Allemagne centrale, montre que le Miserere de Lully fut joué l’après-midi du Vendredi Saint de l’année 1740 dans la chapelle du château.43 Le duc de Saxe-Hildburghausen Ernst Friedrich II avait voyagé en France pendant sa jeunesse en 1722-1723. Après un séjour de trois mois à Paris et Versailles, où il avait été accueilli avec son frère par Madame Palatine et avait assisté au couronnement de Louis XV, Ernst Friedrich étudia à l’université de Genève et à Utrecht.44 C’est probablement sous son impulsion que le Miserere de Lully fut donné à la cour. La page de titre du livret indique : Musique pour le Vendredi-Saint, composée en vue de la contemplation bienheureuse du Salut apporté par Jésus-Christ à cause de nos péchés par le célèbre Monsieur de Lully, Surintendant de sa Majesté royale de France etc. Exécutée seule, et distribuée le 15 avril 1740, non sans une grande émotion dans les âmes, dans la chapelle princière du château sur le gracieux et haut ordre du très-haut et très-puissant prince et seigneur Ernst Friedrich II, duc de Saxe, Jülich, Cleve, Berg, Engern et Westphalie, etc.45
42 43 44 45
D-Dl, Mus. 1-B-104. Titres : « Pieces de Mr Campra » (p. 3) « Del Sign° Baron d’Astorga. Cantata à Solo Per Camera » (p. 14). D-HAu, Hs.-Abt. Pon We 2494, 4° (Nr. 152). Heinrich Ferdinand Schoeppl, Die Herzoge von Sachsen-Altenburg, ehem. von Hildburghausen, Bozen 1917, p. 49-50. Miserere, Hilburgshausen 1740, traduction de la page de titre.
– 203 –
Chapitre 4
La dénomination de « Char-Freytag Musik » désigne habituellement ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de passions : l’oratorio exécuté dans l’après-midi du Vendredi Saint en contexte luthérien – désignation générique assez large que Wagner parodie dans la « Karfreitagsmusik » de Parsifal. Également frappante est l’expression « zur seeligen Betrachtung », souvent utilisée à la fin du xviie siècle dans les titres et les livrets de passions luthériennes, qui peuvent parfois s’appeler simplement « Die seelige Betrachtung des Leidens Christi », comme en 1672 à Rostock. On voit que la musique de Lully est prise dans un réseau de significations lié à la culture luthérienne allemande, qui dépasse largement le contexte de sa création originale et qui est mis au jour par le livret. La date très tardive de l’exécution, en 1740, montre que Lully demeure connu et joué dans l’espace germanique longtemps après sa mort, tout comme en France.46 Les motets de Lully à Dresde En 1684 et 1686, l’imprimeur du roi pour la musique Christophe Ballard fit sortir une série exceptionnelle de motets « Imprimez par exprès commandement de Sa Majesté » : les Motets à deux chœurs pour la Chapelle du roy de Jean-Baptiste Lully (1684), les Motets pour la chapelle du Roy de Pierre Robert (1684) et les Motets pour la chapelle du Roy de Henry Du Mont (1686). Parues juste après la tenue du concours de 1683, ces trois éditions de luxe en parties séparées rassemblaient donc en une sorte de rétrospective l’œuvre des anciens sous-maîtres de la chapelle royale, dans le but de publier largement le répertoire de la première chapelle de Louis XIV.47 La présence des deux recueils de 1684 dans les collections de la cour de Dresde témoigne de l’écho européen de cette entreprise éditoriale, et suggère que le répertoire de la Chapelle royale a pu faire l’objet d’exécutions dans la chapelle catholique de Dresde entre son inauguration en 1708 et l’engagement de musiciens italiens en 1717.48 Dans un contexte où Auguste le Fort tentait de conserver son titre royal et où la construction de la chapelle catholique visait à obtenir les bonnes grâces du Saint-Siège, il est évident que l’importation d’un répertoire français ad hoc – composé « pour la chapelle du Roy » – pouvait jouer un rôle de première importance.49 Les motets de Lully ne sont pas conservés à la bibliothèque de Dresde sous leur forme originale imprimée. Ils apparaissent dans un catalogue des archives musicales de la chapelle catholique de Dresde rédigé avant 1765 par le compositeur d’église et conservateur de la collection musicale Johann Georg Schürer (c.1720-1786).50 D’après Wolfgang Horn et Thomas Kohlhase, les motets de Lully sont alors présents dans l’édition Ballard de 1684.51 En revanche, les motets de Lully manquent dans un catalogue plus ancien : l’inventaire des fonds musicaux en possession de Zelenka mais utilisés à la chapelle. Ce catalogue, rédigé entre 1726 et 1739 par Zelenka lui46 47 48
49 50 51
William Weber, « La musique ancienne in the Waning of the Ancien Régime », The Journal of Modern History, 56/1, 1984, p. 58-88. Laurent Guillo, « Les Ballard : imprimeurs du roi pour la musique ou imprimeurs de la musique du roi ? », in : Le Prince et la musique. Les Passions musicales de Louis XIV, dir. Jean Duron, Wavre 2009, p. 282. On trouve par ordre chronologique : un jeu complet de parties séparées imprimées pour les Motets pour la chapelle du roy de Robert, édités en 1684 par Christophe Ballard (D-Dl, Mus.1718-E-1) ; une mise en partition manuscrite des Motets à deux chœurs de Lully, également édités sous forme de parties séparées par Christophe Ballard en 1684 (D-Dl, Mus.1827-D-1,2) ; le recueil imprimé des motets de Pietro Lorenzani, édité par Christophe Ballard en 1693 (D-Dl, Mus.2021-E-1) ; le premier livre des petits motets de Campra, dans l’édition Ballard de 1700 (D-Dl, Mus.2124-R-1) ; les 2e et 3e livres de motets de Lalande, dans l’édition Boyvin de 1729 (D-Dl, Mus.2116-Q-1). Voir Chapitre 2, p. 93-97. Les trois volumes de ce catalogue, rédigés après la fin de la guerre de Sept Ans, sont aujourd’hui conservés à Berlin : D-B, Mus. ms. theor. Kat. 186. Voir Wolfgang Horn et Thomas Kohlhase, Zelenka-Dokumentation, Wiesbaden 1989. Wolfgang Horn et Thomas Kohlhase, Zelenka-Dokumentation. Quellen und Materialien, Wiesbaden 1989, vol. 1, p. 44-46. Les deux auteurs affirment que l’exemplaire imprimé des motets de Lully figure encore dans les collections de la bibliothèque de Dresde, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
– 204 –
La dissémination de la musique
même, comprend un ensemble important d’œuvres vocales et instrumentales de compositeurs très variés, que Zelenka fit exécuter à la chapelle catholique de Dresde.52 L’absence de l’édition de 1684 des motets de Lully peut s’expliquer de plusieurs façons : ou bien ils auraient été acquis par la cour de Dresde entre 1739 et 1765, ou bien ils appartenaient à la cour et non à Zelenka. Les motets de Lully subsistent en revanche sous la forme de copies manuscrites tardives, qui ont mis en partition les parties séparées de l’édition originale. Le premier manuscrit est intitulé Motets | a deux Chœurs | mis en Musique | par | Monsieur de Lully.53 De format italien, dans une belle reliure de cuir à tranche rouge et dorée, il est très proprement rédigé et comprend l’ensemble des motets mis en partition dans le même ordre que celui de l’édition originale.54 Cette copie présente toutefois quelques rares divergences textuelles avec les parties séparées, dont il corrige les erreurs manifestes.55 La partition porte encore la cote originale de la bibliothèque royale (A 218) ainsi qu’une marque « Musica Bibliotheca Regia ». Le papier utilisé pour la copie provient de la région de Dresde, puisque son filigrane présente les armes de Saxe. La main semble être celle de Johann Christoph Zucker, actif comme copiste à la cour de Dresde entre 1805 et 1814, mais dont les activités de copiste remontent en fait à 1791.56 Le volume aurait donc été écrit aux alentours de 1800. Le second manuscrit est probablement antérieur au premier.57 Il s’agit du second volume d’un ensemble dont le premier volume a été perdu : de ce fait, on n’y trouve que les motets figurant aux numéros 3 à 6 dans l’édition Ballard de 1684. La première page porte la mention manuscrite : « composé par Lulli a Paris 1694 [sic] | Seconde Partie ». Le titre gravé sur la tranche de la couverture reproduit la même erreur de datation que la page de titre : « Lully | 1694 ». Cette mise en partition est beaucoup moins soignée que la première : d’un format oblong qui fait tenir 20 portées par page, elle est reliée dans une couverture en carton épais. Le filigrane du papier utilisé, peu lisible, n’a pas pu être identifié. Une des caractéristiques les plus frappantes de cette partition est l’absence de texte dans les parties chantées – seuls quelques incipits sont reportés –, l’absence du titre des motets et l’absence de la partie de timbale dans le Te Deum. Le manuscrit semble donc être resté inachevé. La pagination originale, reportée par le copiste, n’est pas continue et suit sans doute l’ordre de sept cahiers qui étaient séparés avant la reliure.58 Mises à part quelques erreurs de copie qui ne sont pas toujours corrigées, le texte musical de ce manuscrit est très fidèle à celui de l’édition originale, dont il reproduit même les erreurs. Le manuscrit porte l’ancienne cote de la bibliothèque royale (A 218b), qui suggère qu’il est entré dans les collections de Dresde après le premier manuscrit. Ortrun Landmann propose une identification du copiste : il s’agit du compositeur et critique musical Carl Borromäus von Miltitz (1781-1845), dont une partie de la bibliothèque a été rachetée en 1845 par la Sächsische Landesbibliothek.59 Sur la seconde page de couverture, on lit cependant une insertion manuscrite mystérieuse sur la provenance des pièces : 52 53 54 55
56 57 58
59
Horn et Kohlhase, Zelenka-Dokumentation, vol. 1, p. 44-46. D-Dl, Mus. 1827-D-1. Le libellé des titres du manuscrit suit également de très près l’édition de 1684, qui sont généralement traduits en latin quand ils figurent en français dans l’édition originale. Pour un premier aperçu de ces corrections à partir de l’exemple du Miserere, voir John Hajdu Heyer, « The sources of Lully’s Te Deum (lwv 55) : Implications for the Collected Works », in : Quellenstudien zu JeanBaptiste Lully. L’œuvre de Lully : étude des sources. Hommage à Lionel Sawkins, dir. Jérôme de La Gorce et Herbert Schneider, Laaber 1990, p. 264-277. Landmann, Über das Musikerbe des sächsischen Staatskapelle, p. 176-177. D-Dl, Mus.1827-D-2. Les pages 1 à 196 sont numérotées par feuillets, en haut à droite, à l’encre noire. Les pages 197 à 258 sont numérotées de 1 à 31 selon le même principe. Les pages 259 et 261 sont pourvue des numéros 2 et 2, par feuillets, en haut à droite, à l’encre noire. Les pages 263 à 294 sont numérotées de 1 à 16 selon le même principe. Les pages 295 à 322 sont numérotée de 1 à 16 par feuillets, en bas à droite, au crayon. La page 323 comprend une collette (paginée de 323 à 328 au crayon par un bibliothécaire), numérotée 1. Les pages 329 à 342 sont numérotées 1 à 8 selon le même principe. Enfin, les pages 343 à 349 sont numérotées 1 à 4 par feuillets, en bas à droite, à l’encre noire. Ortrun Landmann, fiche du catalogue papier des collections musicales de la SLUB. Voir aussi Edward Edwards, Free-Town Libraries. Their formation, managment and history, vol. 4, Cambridge 2010, p. 127.
– 205 –
Chapitre 4
Ist unter August | dem 2.ten König von Pohlen | und Sachsen nach Dresden | von König Ludewig dem 14.ten | von Frankreich an König August | dem 2.ten zugeschickt worden. | Franz Schubert.
Selon cette note, rédigée par un musicien de la cour de Dresde au xixe siècle, les motets de Lully (sans doute l’édition originale imprimée) auraient été envoyés à Auguste le Fort par Louis XIV en personne.60 Si aucune trace de cet envoi ne subsiste dans les archives de la cour ou dans la correspondance diplomatique, on peut cependant noter que l’envoi d’exemplaires reliés des motets de Lully semble être un présent plausible à l’heure où Auguste le Fort voulait réinventer sa chapelle royale. On peut se demander si les deux sources manuscrites ont été copiées directement sur les parties séparées imprimées, ou s’il existe une source intermédiaire à partir de laquelle elles auraient été toutes les deux copiées. Les deux sources procèdent à un profond remaniement de la nomenclature originale de l’œuvre, quasiment identique dans les deux cas (Tableau 4.4). Ajoutons que les deux manuscrits n’ont pas pu être copiés l’un sur l’autre, dans la mesure où le texte n’est pas présent dans le second manuscrit, qui de son côté ne corrige pas les parties séparées à la différence du premier. L’hypothétique source intermédiaire pourrait avoir été une mise en partition manuscrite du jeu de parties séparées, ou bien alors les parties séparées elles-mêmes munies de nouveaux titres. Tableau 4.4. Changements de nomenclature : comparaison entre l’édition originale des motets de Lully et la nomenclature du manuscrit D-Dl, Mus. 1827-D-1. Édition originale
Mus. 1827-D-1
1
Premier dessus de violon
sol 1
Violino I
sol 2
2
Second dessus de violon
sol 1
Violino II
sol 2
3
Haute-contre de violon
ut 1
Violetta
ut 2
4
Taille de violon
ut 2
Viola I
ut 3
5
Quinte de violon
ut 3
Viola II
ut 3
6
Premier dessus du petit chœur
sol 2
Soprano I
ut 1
7
Second dessus du petit chœur
ut 1
Soprano II
ut 1
8
Haute-Contre du petit chœur
ut 2
Alto
ut 3
9
Taille du petit chœur
ut 4
Tenore
ut 4
10
Basse du petit chœur
fa 4
Basso
fa 4
11
Dessus du grand chœur
sol 2
Soprano
ut 1
12
Haute-Contre du grand chœur
ut 3
Alto
ut 3
13
Taille du grand chœur
ut 4
Tenore
ut 4
14
Basse-taille du grand chœur
fa 3
Basso I
fa 4
15
Basse du grand chœur
fa 4
Basso II
fa 4
16
Basse de violon
fa 4
Violono
fa 4
17
Basse-continue
fa 4
Organo
fa 4
Les motets de Robert à Dresde L’édition originale des motets de Robert se trouve aussi à Dresde.61 Cette source présente un intérêt philologique majeur : il s’agit d’un jeu de parties séparées quasiment complet d’une édi60
61
Il peut s’agir de deux personnes différentes. Franz Anton Schubert (1768-1827) est contrebassiste à la Hofkapelle de Dresde à partir de 1786, puis obtient le poste de Musikdirektor de l’opéra italien en 1808. Il est nommé Königlicher Kirchenkomponist en 1814. Franz Xaver Schubert (1808-1878), fils du premier, entre en 1823 comme aspirant à la Hofkapelle, est nommé Konzertmeister en 1861 et prend sa retraite en 1874. Sur ces deux hommes, voir les notices de Robert Eitner dans l’Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 32 (1891), p. 613-614 et 628. Ortrun Landmann, dans le catalogue papier des fonds musicaux de la Sächsische Landesbibliothek, attribue cette note au premier. D-Dl, Mus. 1718-E-1. Voir Delpech, « Les Motets pour la chapelle du roy de Robert à la cour de Saxe ».
– 206 –
La dissémination de la musique
tion dont il ne reste que deux autres exemplaires incomplets à travers le monde.62 Dans le jeu de Dresde, il ne manque que la partie de Second haute-contre de récits. Les parties sont reliées dans une couverture de papier bleu relativement fin, cousue sur le côté gauche par une ficelle nouée en haut et en bas de chaque cahier. Cette reliure est typique des partitions de la chapelle catholique de la cour et indique que l’œuvre appartenait au répertoire de la chapelle. Certaines parties portent encore, sur la page de titre et au crayon, l’ancienne cote de la bibliothèque royale : A 328.63 Sur chaque couverture se trouve reporté à la plume l’intitulé de la partie en français. Cet intitulé est parfois flanqué d’un surtitre en italien, tracé par la même main que l’intitulé français : il s’agit de certaines parties vocales solistes et de basse continue. L’état de conservation est très variable selon les parties : alors que les parties de cordes sont dans un état de conservation parfait et ne comportent aucune trace d’usage, quelques parties vocales et de basse continue ont des pages trouées, des coins déchirés ou abîmés par la tourne, ou encore des taches de cire, notamment la partie de Basse continue pour les instruments et celle de Haut-concordant. Cette variabilité semble indiquer que les parties solistes ont été distribuées directement sous forme imprimée aux musiciens puisqu’un seul exemplaire était requis (voix solistes et basse continue) tandis que les parties exécutées simultanément par plusieurs musiciens ont fait l’objet d’une copie manuscrite en plusieurs exemplaires aujourd’hui perdus (parties instrumentales et chorales) et ne présentent donc presque aucune trace d’usage. Le nombre de corrections manuscrites présentes dans l’exemplaire de Dresde, de l’ordre de trois cents sur l’ensemble du jeu, est un peu plus élevé que dans les deux autres exemplaires parisiens. Ceci s’explique notamment par le plus grand nombre de parties conservées à Dresde. Tout comme dans l’exemplaire de la Bibliothèque nationale de France, les parties instrumentales de Dresde ne comportent presque aucune correction manuscrite, à l’exception des parties de Basse continue pour l’orgue et les instruments. La plupart des corrections sont communes aux deux exemplaires et ont donc été faites dans l’atelier, avant la reliure ou l’envoi des partitions.64 Ces corrections d’atelier sont d’ailleurs toutes très propre : le papier a été gratté avec soin puis les corrections tracées d’une main experte et d’un trait léger à l’encre noire. Quelques collettes, certaines imprimées, ont aussi été insérées avant l’envoi. La partie de Basse continue pour les instruments comporte de nombreuses particularités dans l’exemplaire de Dresde : sur les 30 corrections, seules 7 sont communes avec l’exemplaire de la Bibliothèque nationale, qui comporte de son côté 28 corrections. Dans cette partie, la plupart des corrections ne sont visiblement pas écrites de la même main, ni avec le même soin que les corrections d’atelier : l’encre a souvent bavé, rendant certaines corrections illisibles, et la plume a plusieurs fois troué le papier. Celles-ci ne concernent que les motets placés en début (1 et 2) et en fin de volume (19 à 24), là où l’exemplaire de la Bibliothèque nationale présente des corrections dans les motets intermédiaires. On aurait donc affaire à des corrections insérées sur place, à Dresde, seulement sur les seuls motets exécutés par la Hofkapelle. On trouve notamment des transformations rythmiques (le plus souvent explicitation du surpointage), des ajouts d’incipits textuels sous la portée pour favoriser une meilleure visibilité des sections, l’ajout d’indication d’effectifs sous la portée (« tous » ou « à 3 »), l’ajout d’altérations, la correction de hauteurs ou d’indications de mesures, l’ajout de guidons en fin de portée ainsi que de nombreux ajouts de liaison. Ceci renvoie donc à des pratiques et des effectifs propres à la basse continue de la chapelle catholique de Dresde, les nombreuses notes tenues indiquant une exécution à l’orgue.
62 63 64
Le RISM (Einzeldrucke vor 1800, vol. 7, R 1792) ne mentionne que les deux autres exemplaires déjà connus : F-Pn, Vm1 1030 et F-Psg, Vm 118 Rés. Hélène Charnassé se fonde exclusivement sur ces deux sources pour son édition de 1969 : Pierre Robert, Deux Motets pour la Chapelle du roy, éd. Hélène Charnassé, Paris 1969. C’est le cas des Premier et Second dessus de récits, Premier haute-contre de récits, Haute-taille de récits. Pour un aperçu sur les « stop-press corrections » : Lois Rosow, Lully’s Armide at the Paris Opéra: a performance history, 1686-1766, PhD Dissertation, Brandeis University, 1981, p. 29-42.
– 207 –
Chapitre 4
Du livre d’orgue à l’Orgelbüchlein La dissémination du répertoire pour clavier se caractérise par son ubiquité, sa volatilité et sa rapidité extrême : les œuvres pour clavier en provenance de France sont transmises depuis le début du xviie siècle dans de nombreux manuscrits à travers le monde, sous forme de partition ou en tablature, dans des copies qui sont souvent des compilations où l’origine de la pièce n’est pas indiquée, et qui se situent à la frontière de l’arrangement, le copiste pouvant ajouter des ornements, modifier la mélodie ou procéder à une réécriture complète de la texture instrumentale. L’étude classique de Bruce Gustafson a depuis longtemps attiré l’attention des chercheurs sur ce phénomène et représente encore aujourd’hui la contribution la plus fondamentale sur le sujet.65 Un récent projet d’édition critique des arrangements pour clavier d’œuvres de Lully, en cours de réalisation par David Chung sur le site de la Web Library of Seventeenth-Century Music, vient compléter ces travaux et propose une perspective passionnante sur la dissémination de musique française par le biais des arrangements pour clavier.66 On s’en doute, ce type de dissémination forme un véritable continent dont l’exploration demeure très fragmentaire. Il ne peut être question de l’aborder ici de front, mais plutôt de biais – par l’intermédiaire de la dissémination du répertoire d’orgue dans l’entourage de Bach.67 Dans la nécrologie de Bach, une phrase détaille les œuvres et les figures tutélaires que le compositeur « se choisit pour modèle ». À la suite de plusieurs fabuleux organistes d’Allemagne du Nord comme Bruhns, Reincken et Buxtehude, le texte mentionne aussi « quelques bons organistes français ».68 Cette phrase de la nécrologie a souvent été rapprochée des deux copies du Livre d’orgue de Nicolas de Grigny réalisée par Bach et Walther, ainsi que de la copie des deux livres d’orgue de Jacques Boyvin par Johann Caspar Vogler.69 Ces trois sources sont assurément des témoignages impressionnants de la circulation de musique d’orgue française à Weimar dans les années 1710. Elles doivent d’ailleurs être rapprochées des sources françaises pour clavier qui émanent de l’entourage de Bach, dont l’intérêt pour l’œuvre de Couperin est souligné par plusieurs sources.70 La copie par Bach des suites pour clavecin de Dieupart et de la table d’ornements de d’Anglebert, présentes dans le même volume que le livre d’orgue de Grigny, ou encore celle des Bergeries tirées du sixième ordre du Second Livre de Couperin dans l’un des livres de musique d’Anna Magdalena Bach, ne sont que les témoignages les plus célèbres de cette présence du répertoire français dans les pratiques musicales de la famille Bach.71 Mais ces quelques manuscrits célèbres gagnent à être replacés dans un contexte plus large et à être rapprochés d’autres sources, qui ne sont pas forcément directement liées à Bach et permettent d’éclairer de façon décisive la manière dont la musique d’orgue française a pu se disséminer en Allemagne. Le recensement de toutes les copies allemandes de musique d’orgue (Tableau 4.5) permet de distinguer deux groupes : quatre sources copiées à 65 66 67 68 69
70 71
Bruce Gustafson, French Harpsichord Music of the 17th Century. A Thematic Catalog of the Sources with Commentary, Ann Arbor 1977. David Chung, Keyboard Arrangements of Music by Jean-Baptiste Lully, Monuments of Seventeenth-century Music 1, Web Library of Seventeenth-Century Music, 2015. Voir Louis Delpech, « “Einige Gute Französische Organisten”. The Dissemination of French Organ Music in 18-Century Germany », The Organ Yearbook, 44, 2015, p. 33-46. Je remercie Michael Heinemann, Peter Williams (†) et Peter Wollny pour leurs précieuses remarques à ce sujet. BD III Nr. 666, p. 82 : « In der Orgelkunst nahm er sich Bruhnsens, Reinckens, Buxtehudens und einiger guter französischer Organisten ihre Werke zu Mustern. » Victoria Horn, « French Influence in Bach’s Organ Works », in : J. S. Bach as Organist. His instruments, music, and performance practices, dir. George Stauffer et Ernest May, London 1986, p. 256-273. George B. Stauffer, « Boyvin, Grigny, d’Anglebert and Bach’s assimilation of French classical organ music », Early Music, 21/1, 1993, p. 83-96. Siegbert Rampe, « Bachs Piece d’Orgue G-Dur bwv 572 : Gedanken zu ihrer Konzeption », in : Bachs Musik für Tasteninstrumente, dir. Martin Geck, Dortmund 2003, p. 333-369. Friedrich Wilhelm Marpurg, Johann Adam Hiller et Ernst Ludwig Gerber soulignent tous les trois l’intérêt que Bach portait à l’œuvre de François Couperin. BD III, Dok. 632, p. 4, Dok. 749, p. 199, Dok. 949, p. 471. Peter Wollny, « Zur Rezeption französischer Cembalo-Musik im Hause Bach in den 1730er Jahren: zwei neu aufgefundene Quellen », in : In Organo Pleno. Festschrift für Jean-Claude Zehnder zum 65. Geburtstag, dir. Luigi Collarile et Alexandra Nigito, Berne 2007, 265-276.
– 208 –
La dissémination de la musique
Weimar dans les années 1710, et cinq copiées plus tard à Berlin. Ces deux ensembles ne partagent pas beaucoup de répertoire en commun, puisque seul Boyvin est représenté dans chacun d’eux. En outre, ils semblent relativement distants l’un de l’autre, à la fois dans le temps et dans l’espace : alors que les sources copiées à Weimar l’ont été pendant les années 1710, les sources berlinoises sont beaucoup plus tardives et n’ont guère été copiées que dans les années 1750. Elles documentent de ce fait un intérêt surprenant pour la musique d’orgue française du début du siècle dans les cercles berlinois aux alentours de 1750, puisque cette musique était toujours copiée par Agricola, Harson et Marpurg, ainsi que par le copiste anonyme désigné par le sigle CPE Bach VI.72 Les copies de Weimar Les deux premières sources du tableau ont déjà été soumises à un examen attentif.73 Les études de la calligraphie de Bach menées par Yoshitake Kobayashi sur le manuscrit de Francfort (D-F, Mus. Hs. 1538) ont montré que Bach a dû copier le Livre d’orgue de Grigny à Weimar entre 1709 et 1712, Tableau 4.5. Sources manuscrites de musique d’orgue française conservées en Allemagne. Sigle
Cote
Copiste
Date
Compositeur
D-F
Mus. Hs. 1538
Johann Sebastian Bach
1709-1712
(entre autres) Grigny
D-B
Mus. ms. 8550
Johann Gottfried Walther
1709-1712
Grigny
Johann Caspar Vogler
D-B
Mus. ms. 2329
ca. 1710-1715
Boyvin
D-B
Mus. ms. Bach P 801 Johann Gottfried Walther
après 1712
(entre autres) Nivers
D-B
Am. B. 529
Johann Friedrich Agricola
après 1750?
Lebègue, d’Anglebert, Boyvin, Corrette, Guilain
D-B
Am. B. 571
Friedrich Wilhelm Marpurg ca. 1750-1753
(seulement fugues) d’Anglebert, Boyvin, Lebègue
D-B
Mus. ms. 12680
Johann Samuel Harson
Lebègue
D-B
Mus. ms. 30189
–
(entre autres) Guilain
D-B
SA 4720
Copiste CPE Bach VI
Lebègue, Boyvin, d’Anglebert, Corrette
au même moment que la table d’ornementation issue des Pièces de clavecin de d’Anglebert et que les trois premières suites de Dieupart. Le reste du manuscrit semble au contraire avoir été copié à une date plus tardive, des modifications significatives pouvant être repérées dans la calligraphie musicale de Bach.74 Le manuscrit de Walther (D-B, Mus. ms. 8550) a probablement été copié pendant les mêmes années que celui de Bach. La page de titre du manuscrit reproduit exactement le titre de la copie de Bach, qui est elle-même une copie fidèle du texte et de la disposition de la page de garde de l’édition de 1699, sauf en ce qui concerne la dédicace qui n’est pas copiée, et la date de 1699, qui est mystérieusement transformée en 1700 sur les deux manuscrits allemands alors même qu’elle ne correspond à aucune édition connue.75 72
73 74 75
Eva Renate Blechschmidt, Die Amalien-Bibliothek : Musikbibliothek der Prinzessin Anna Amalia von Preußen (1723-1787). Historische Einordnung und Katalog mit Hinweisen auf die Schreiber der Handschriften, Berlin 1965. Le même copiste est appelé « Anon. 303 » par Paul Kast, Die Bach-Handschriften der Berliner Staatsbibliothek, Trossingen 1958. Kirsten Beißwenger, Johann Sebastian Bachs Notenbibliothek, Kassel 1992, p. 190-202. Ses conclusions sont discutées par Sean Patrick Redrow, The Livre d’Orgue of Nicolas de Grigny and the Livre copies of J.S. Bach and J.G. Walther : a performing edition with critical commentary, DMA Dissertation, Boston University, 2009, p. 47-52. NBA IX/2, éd. Yoshitake Kobayashi, p. 38. Seul un exemplaire de l’édition originale de Grigny est conservé : F-Pn, Rés. Vmb 13. Un tirage plus tardif, publié par Ballard en 1711, reçoit une nouvelle page de titre qui indique la date de 1711 : F-Pn, Vm7 1834. Aucune autre édition n’est connue. Le titre de l’édition originale se présente comme ceci: premier livre d’Orgue | contenant | une messe et les hymnes | des principalles festes de l’année | Composé | par N. de Grigny | organiste de l’eglise | cathedralle de Reims | dédié | a messieurs les Vénérables Prevost, Doyen, Chantre, | Chanoines, et Chapitre de l’Eglise Métropolitaine de Reims. | a Paris | Chez
– 209 –
Chapitre 4
Le manuscrit de Walther présente une autre particularité : la première page, réglée avec la même patte que le reste du manuscrit et en haut de laquelle Walther a reporté le titre « Kyrie en taille » ne fait apparaître que le début de cette pièce, copié par une autre main et laissé incomplet (Illustration 4.2). Les quatre pages suivantes sont réglées mais laissées vides. La main de Walther réapparaît à partir de la page 6 avec le « Trio en dialogue », jusqu’à la fin du recueil. Cet étrange début suggère que le manuscrit a eu une histoire mouvementée. Walther n’a pas copié les cinq pièces qui ouvrent le recueil, mais commence sa copie avec le Trio à la page 6, ce qui correspond à la pagination de Bach. Le copiste du « Kyrie en taille » laisse sa copie inachevée, mais il a tracé ses mesures à l’avance. On observe qu’il reproduit fidèlement la disposition adoptée par Bach, alors même qu’elle ne correspond pas à la mise en page de l’édition originale et surcharge le dernier système de la page avec 11 mesures.76 Ces deux observations très simples corroborent la thèse de Redrow, qui soutient contre Beißwenger que le manuscrit de Walther a été copié sur celui de Bach et non sur une tierce source commune.77
Illustration 4.2. Copie du livre d’orgue de Nicolas de Grigny par Johann Gottfried Walther : première page. D-B, Mus. ms. 8550.
76 77
Pierre-Augustin le Mercier à l’entrée de la Rüe du Foin du côté de la Rüe St. Jacques. | vis-a-vis Saint- Yves. Et à Reims Chez l’Auteur. | avec permission. m. dc. xcic. Gravez par Roussel. Bach place également 7 mesures sur la premier système, 9 sur le deuxième et 11 sur le troisième. L’édition imprimée adopte une répartition plus équilibrée avec 8 mesures sur le premier système, 10 sur le deuxième et 9 sur le dernier. Redrow fait la liste des différences textuelles entre les deux manuscrits et l’édition originale et en conclut que le manuscrit de Walther a été copié sur celui de Bach : The Livre d’Orgue, p. 70, 76 et 112. Beißwenger pense au contraire que les deux manuscrits ont été copiés indépendamment à partir de la même source. Elle se fonde principalement sur une analyse graphologique, qui indiquerait selon elle que Walther n’aurait copié son manuscrit qu’après 1717, date du départ de Bach de Weimar : Beißwenger, Johann Sebastian Bachs Notenbibliothek, p. 198-199.
– 210 –
La dissémination de la musique
Une troisième source qui documente la réception de musique française à Weimar dans les années 1710 est celle de Johann Caspar Vogler, qui a réalisé sa copie très fidèle des deux livres d’orgue de Boyvin sous la supervision de Bach, alors qu’il étudiait avec lui entre 1710 et 1715.78 Cette copie ne présente presque aucune variante par rapport à l’édition originale, de sorte qu’il est fort probable qu’elle ait été copiée directement sur elle. Pour les mêmes raisons, il est en revanche très difficile de savoir si la copie de Vogler a servi de modèle à des manuscrits postérieurs. La copie par Walther de quelques pièces d’orgue de Nivers, publiées à Paris en 1665, est également intéressante : en l’absence de tout filigrane lisible dans la partition, Hermann Zietz date cette copie de 1712 ou plus tard sur une base graphologique.79 L’écriture de Walther est ici identique à celle du manuscrit de Grigny, et l’on peut donc penser que les deux sources ont été copiées dans un laps de temps relativement bref. Mais ici, ni la page de titre ni l’intitulé des pièces ne sont reproduits. La première page du fascicule est simplement titrée : « Prelude 1. E. h. | Mr: Nivers ». En fait, Walther sélectionne neuf pièces sur la centaine que comprend l’édition originale. Il recopie intégralement la « Suite du quatrième ton », mais omet curieusement presque tous les ornements, alors que tous les autres éléments sont copiés fidèlement. Adam Sellius, libraire français Comment expliquer la présence de ces partitions à Weimar ? Le catalogue de vente d’un libraire français installé à Halle, Adam Sellius, que nous avons découvert aux archives de Dresde, permet de proposer une réponse.80 Ce catalogue présente une longue liste d’ouvrages imprimés en français ou en latin parmi lesquels se trouve un petit nombre d’imprimés musicaux. Parmi ceux-ci, on voit apparaître la Messe du huitième ton de Gaspard Corrette.81 Il s’agit là de la seule édition de l’œuvre, publiée chez Foucault en 1703.82 Cette découverte est importante à plusieurs titres. D’abord, elle vient nuancer une idée très répandue selon laquelle les imprimés musicaux parisiens n’auraient pas été vendus à l’étranger ni, en particulier, sur les foires de Francfort et de Leipzig.83 Il est vrai que la grande compilation de Göhler, qui recense tous les imprimés vendus sur les foires de Francfort et Leipzig entre 1564 et 1759, ne fait apparaître aucun imprimé français, puisqu’elle repose exclusivement sur le dépouillement des catalogues publiés par les maisons de librairie allemandes.84 Celles-ci ne vendent que des éditions musicales allemandes, hollandaises ou italiennes. 78
79 80 81
82
83 84
Horn, « French Influence », p. 259. Horn affirme que le papier est identique dans la copie de Bach et dans celle de Vogler sans justification. Beißwenger écrit avec un renvoi à l’article de Horn que les deux manuscrits présentent le même filigrane (p. 52). Stauffer suit l’affirmation de Beißwenger, et franchit un pas de plus en donnant un numéro de filigrane suivant la classification proposée par la NBA avec une référence à l’article de Horn (p. 84). Nous n’avons pas pu identifier de filigrane sur le manuscrit de Vogler. Hermann Zietz, Quellenkritische Untersuchungen an den Bach-Handschriften P 801, P 802 und P 803 aus dem « Krebs’schen Nachlass » unter besonderer Berücksichtigung der Choralbearbeitungen des jungen J. S. Bach, Hambourg 1969, p. 209. HStA Dresden, 10484 Grundherrschaft Polen bei Neustadt, Nr. 316 : XXI. Supplement. | du Catalogue des Livres nouveaux françois & | latins pour la Foire de Pâques 1711, qui se | trouvent a Halle & Leipzig dans le Rot- | haupt hoff chez Adam Christoffle Sellius Li- | braire François. Avant-dernière page, non paginée : « Messe du 8. ton pour l’Orgue pour l’Usage des Dames religieuses & utile à ceux qui touchent l’Orgue, composée par Gaspard Corrette. | XII. Sinphonie da Chiesa a due Violini col Basso per l’Organo & una Viola a beneplacito di Manfredini Opera Seconda | Les Fantaisies Bizarres de la Goutte contenant XII. Sonates pour une Viole de Gambe seule avec la basse par Mr. Schenck opera decima | Six Sonates a un Violon Seul & Basse par Richman opera seconda | IX. Suittes pour le Clavessin par Pierre Bustyn opera prima. | VI. Suittes pour le Clavessin par Van Oevering opera prima. » Messe du 8.e ton pour l’orgue | a L’Usage des Dames Religieuses, et | utile a ceux qui touchent l’orgue. | Composée Par | Gaspard Corrette organiste de l’Eglise Saint | Herbland de Roüen. | Gravé par H. de Baussen. | a paris | Chez H. Foucault marchand rue S.t Honnoré proche la rüe de la lingerie a la | Regle dor | Et a Rouen Chez l’Autheur | avec privilege du roy. Le prix est de 4 ll. La date de publication n’apparaît pas sur la page de titre, mais dans l’extrait de privilège reproduit en début de volume. Voir par exemple Laurent Guillo, Pierre I Ballard et Robert III Ballard, imprimeurs du roi pour la musique (15991673), Sprimont 2003, p. 75. Albert Göhler, Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger Messkatalogen der Jahre 1564 bis 1759 angezeigten Musikalien, Leipzig 1902.
– 211 –
Chapitre 4
En revanche, les libraires français comme Sellius ou son prédécesseur Lefebvre semblent avoir assuré la dissémination des imprimés musicaux produits par les grandes maisons parisiennes sur les foires de Leipzig et Francfort.85 Ensuite, une copie de la Messe du huitième ton de Gaspard Corrette de la main de Johann Friedrich Agricola se trouve à Berlin. Adam Sellius est donc certainement une figure tout à fait centrale pour comprendre comment des imprimés musicaux parisiens ont pu être diffusés à Halle, Weimar et Leipzig. Il semble par ailleurs avoir cultivé des liens assez étroits avec la cour de Weimar à l’époque où Bach y était Konzertmeister. En effet, Sellius figure parmi les vendeurs sur la page de titre de l’édition des Six Concerts du prince Johann Ernst von Sachsen-Weimar, publiés à l’initiative de Telemann après la mort du jeune prince en 1718, et dont Bach tira le concerto pour orgue bwv 592.86 D’autre part, Sellius a aussi vendu dans sa boutique de Halle les Six Sonates à violon seul de Telemann, qui étaient dédiées au prince Johann Ernst.87 Enfin, Adam Sellius est listé comme agent pour l’éditeur d’Amsterdam Étienne Roger dans un catalogue de 1712.88 Le fait que la messe de Corrette apparaisse en 1711 dans le catalogue d’un libraire français lié à la cour de Weimar et qui connaissait personnellement Telemann est donc un élément essentiel pour expliquer la présence de cette œuvre dans un manuscrit réalisé par un autre élève de Bach, Johann Friedrich Agricola. Cela inciterait alors à réviser la datation de ce manuscrit proposée par Alfred Dürr et à faire l’hypothèse que ce manuscrit a été copiée pendant la période où Agricola étudia l’orgue avec Bach à Leipzig entre 1738 et 1741. Ceci éclaire du même coup de façon tout à fait neuve et décisive l’ampleur du répertoire d’orgue présent dans la bibliothèque musicale de Bach à Leipzig. Là encore, une étude diachronique de la calligraphie d’Agricola est l’étape indispensable qui permettrait de valider, ou d’invalider, cet ensemble d’hypothèses. Les copies berlinoises Le second groupe de sources d’orgue, copiées par des musiciens berlinois, est dominé par une grande uniformité dans le choix du répertoire : Nicolas Lebègue, Jacques Boyvin, Gaspard Corrette, Jean-Henry d’Anglebert et Jean-Adam Guilain sont tous représentés dans plusieurs sources, alors même que d’autres grands organistes français contemporains brillent par leur absence, notamment François Couperin, André Raison ou Louis Marchand. Le manuscrit Am. B. 529, copié par Agricola, est sans doute le plus fascinant de tout ce groupe. Il s’agit d’une immense collection de pièces d’orgue françaises, copiées par Agricola dans son écriture caractéristique par sa netteté. Le volume est en format in-folio et semble avoir été copié sur une période relativement courte : les clés et les titres ont la même allure d’un bout à l’autre du manuscrit, tandis que toutes les pages semblent réglées avec la même patte. La reliure du manuscrit rassemble trois ensembles de cahiers, chaque cahier reçevant une numérotation différente selon les ensembles.89 Sur la base de l’écriture et en l’absence de tout filigrane lisible, Alfred Dürr date ce manuscrit de la période tardive d’Agricola, soit après 1750.90 Le contenu du manuscrit Am. B. 529 est tout à fait étonnant, puisqu’il rassemble une grande quantité de pièces pour orgue accompagnées de préfaces sur la registration, le tout étant tiré de plusieurs sources imprimées. Soixante pièces et une préface de Lebègue sont empruntées aux trois livres d’orgue et surmontées d’un titre en français : 85 86 87 88 89 90
David L. Paisey, Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750, Wiesbaden 1988, p. 243. D-WRz, Mus. IV V f: 20 (a). Zohn, Music for a Mixed Taste, p. 145 et 271. Rudolf Rasch, « Publishers and Publishers », in : Music Publishing in Europe 1600-1900. Concepts and Issues, Bibliography, dir. Rudolf Rasch, Berlin 2005, p. 186. Les pièces de Lebègue et d’Anglebert sont copiées sur six cahiers numérotés en chiffres arabes de 2 à 6, Boyvin et Corrette sur cinq cahiers numérotés en chiffres arabes de II à V, et les pièces de Guilain sont copiées sur les trois derniers cahiers. Alfred Dürr, « Zur Chronologie der Handschrift Johann Christoph Altnickols und Johann Friedrich Agricolas », Bach Jahrbuch, 56, 1970, p. 53.
– 212 –
La dissémination de la musique
Pieces d’Orgues [sic], | recueillies | des trois Livres d’Orgue | de | Mr. le Begue | Organiste du Roi, et de St. Mederic. | 167-.
Le fait qu’Agricola insère une date approximative de publication sur sa propre page de titre est tout à fait frappant, puisque les dates n’apparaissent jamais dans les éditions originales de ces livres d’orgue. Seul l’Extrait du privilège du roy, imprimé dans la première édition du premier volume, est daté du 1er avril 1676. Agricola semble donc avoir eu accès à cette première édition, dont il copie également la préface sur la registration et l’erreur typographique dans le titre. Il aurait alors supposé que les trois livres de Lebègue avaient été publiés dans les années 1670, alors même que le troisième livre fut probablement publié seulement après 1685.91 Les trois livres sont inégalement représentés dans le manuscrit d’Agricola : 48 pièces proviennent du premier livre, mais seulement 3 du deuxième et 9 du troisième livre. Ceci peut sans doute s’expliquer par le contenu des livres : dans sa préface au second livre, l’éditeur affirme que le premier était conçu pour les musiciens professionnels, tandis que le second était destiné aux amateurs.92 Le contenu du troisième livre, qui présente une immense collection d’offertoires très longs, de brèves élévations et de noëls, a quant à lui sans doute paru un peu étrange à Agricola. Parmi les pièces du premier livre, Agricola omet généralement les préludes, ainsi que les dialogues et pleins jeux qui concluent chaque suite.93 En revanche, il copie toutes les fugues ainsi que toutes les tierces en taille et tous les cromornes en tailles.94 Le Quatuor sur le Kyrie à trois Sujets tirés du plein chant, extrait des Pièces de clavecin de d’Anglebert, est copié sur la dernière page du premier ensemble de cahiers. On peut supposer qu’Agricola s’est servi de l’édition parisienne de 1689 plutôt que de celle, plus précoce, de Roger, car il copie en tête du quatuor un « Avis de l’Auteur » qui n’est pas reproduit dans l’édition de Roger.95 La copie du premier livre d’orgue de Boyvin s’ouvre avec une page de titre similaire à celle placée en tête des pièces de Lebègue. Là encore, la longue préface sur la registration (« Avis, concernant le mêlange des Jeux de l’Orgue, les mouvements, et le toucher ») est copiée intégralement en français. Deux commentaires sont simplement insérés en allemand. Le premier est une simple traduction du verbe tirer, signifiant dans ce contexte qu’on tire un clavier sur l’autre afin de les coupler : Pour le Plein Jeu dans les Orgues amples, ou il y a Positif, on tire (koppelt) les Claviers ensemble […].96
Le second commentaire est une note insérée en bas de page, qui explicite là encore en allemand le sens d’un terme technique : Cette maniere est plus belle, et plus difficile : a moins qu’on ne soit aidé d’une Tyrasse [renvoi en bas de page: das heißt ein an das Hauptclavier angehängtes, dasselbe mit niederziehendes Pedal] ou Marchepieds (Pedal).97
Agricola ressent sans doute le besoin de noter ce qu’est une tirasse pour la simple et bonne raison que ce dispositif, qui permet de coupler le pédalier avec l’un des claviers de l’orgue, est extrêmement rare dans les instruments de facture allemande. 91 92 93 94 95 96 97
Norbert Dufourcq, Nicolas Lebègue (1631-1702). Étude biographique suivie de nouveaux documents inédits relatifs à l’orgue français au xviie siècle, Paris 1954, p. 94. Nicolas Lebègue, Second livre d’orgue, Paris [c.1676], préface non paginée : « [Lebègue] a travaillé dans le premier particulierement pour les Sçavans, Et dans celuy cy, son dessein a esté de travailler principallement pour ceux qui n’ont qu’une science mediocre. » Les préludes des 4e et 8e suites sont cependant copiés, de même que les dialogues des 1e, 3e et 7e suites, et enfin les pleins jeux des 1e et 8e suites. Lebègue écrit dans sa préface à propos de ce type de pièces : « Cette maniere de Verset est à mon avis la plus belle et la plus considérable de l’Orgue. » Agricola copie cette phrase au fol. 2 de son manuscrit. « Avis de l’Auteur. Cette piece ne peut bien faire son effet que sur un grand Orgue, et même sur quatre Claviers differens, j’entens trois Claviers pour les mains, et le Clavier des Pedales, avec des jeux d’egale force, et de differente harmonie, pour faire distinguer les entrées des parties. l’an 1689 ». D-B, Am. B 529, fol. 35. D-B, Am. B 529, fol. 35.
– 213 –
Chapitre 4
La copie de la Messe du huitième ton de Gaspard Corrette est faite de façon plus sélective, puisque seulement dix pièces sont copiées en plus de la préface. Ceci est peut-être dû à la relative médiocrité musicale de cette messe, qui reste volontairement simple puisqu’elle est destinée aux couvents. Il copie en revanche l’intégralité du livre d’orgue de Guilain, pour autant que nous puissions en juger en l’absence de toute édition originale. Ce n’est pas un mystère, étant donné la profondeur et la beauté du livre d’orgue de Guilain. Le manuscrit d’Agricola a servi de modèle pour deux autres sources berlinoises. La copie de deux suites de Lebègue (D-B, Mus. ms. 12680) fait apparaître au début la même page de titre que celle d’Agricola, qui fait référence aux trois livres d’orgue bien qu’en réalité, ce manuscrit ne copie que des pièces du premier livre. Le copiste reprend les mêmes pièces qu’Agricola, et reproduit la plupart des variantes d’ornementation introduites par Agricola par rapport à l’édition originale. Le nom du copiste est indiqué sur la page de titre : il s’agit de Johann Samuel Harson, élève de Kirnberger qui avait une importante collection de musique et était actif comme organiste de la Marienkirche à Berlin de 1780 jusqu’à sa mort en 1792.98 L’autre copiste qui prend apparemment Agricola pour modèle est CPE Bach VI. Le contenu de son manuscrit (D-B, SA 4720) tire de toute évidence son origine d’Agricola, puisqu’il reproduit dans une fugue de Boyvin l’une des rares variantes rythmiques que l’on peut observer chez Agricola. Le copiste du manuscrit Am. B 571 a récemment été identifié par Peter Wollny comme étant Friedrich Wilhelm Marpurg. Le papier du manuscrit est typiquement prussien, et Marpurg aurait donc copié ces pièces à Berlin, après son retour de Paris en 1749.99 Comme le manuscrit ne comprend que des fugues, il a probablement été pensé comme une sorte d’anthologie française pour fournir les exemples de l’Abhandlung von der Fuge (1753), et doit donc avoir été copié avant la publication du traité.100 Le manuscrit de Marpurg contient six fugues de d’Anglebert, une fugue de Kerll, quatre de Boyvin et quatre de Lebègue. La similitude du répertoire avec Am. B. 529 est frappante. Cependant, Marpurg tire des Pièces de clavecin de d’Anglebert non pas le quatuor comme l’avait fait Agricola, mais les six fugues sur un même sujet. Il s’agit là d’une première preuve que Marpurg avait accès à l’édition originale et pas seulement à la copie d’Agricola. En outre, la variante rythmique introduite par Agricola dans une des fugues de Boyvin et reproduite par CPE Bach VI n’est pas suivie par Marpurg, qui se conforme au texte de l’édition originale. On peut penser que Marpurg a eu accès aux éditions originales pour toutes les fugues qu’il a copiées. Le fait que Marpurg retire tous les ornements montre qu’il était sans doute plus intéressé par les aspects contrapunctiques que par l’exécution de ces pièces. La réponse à la question de savoir si Marpurg aurait pu avoir accès à ces fugues par l’intermédiaire de Johann Sebastian Bach, de sa famille ou d’Agricola est conditionnée à la réponse que nos futures recherches apporteront à l’ensemble d’hypothèses émises plus haut à propos du manuscrit Am. B 529. Contentons-nous pour l’heure de noter la parenté de répertoire entre les deux manuscrits, qui pourraient indiquer que Agricola et Marpurg ont copié à partir des mêmes éditions, bien qu’en poursuivant des objectifs distincts. Le manuscrit Mus. ms. 30189 est le plus mystérieux de toutes les sources berlinoises. D’une main inconnue, il reproduit les Pièces d’orgue de Guilain et présente très peu de divergences avec la copie d’Agricola. Cependant, la page de titre de l’édition originale (aujourd’hui perdue) semble
98 99 100
Tobias Schwinger, Die Musikaliensammlung Thulemeier und die Berliner Musiküberlieferung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Beeskow 2006, p. 153. Peter Wollny, « Anmerkungen zu einigen Berliner Kopisten im Umkreis der Amalien-Bibliothek », Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz, 1998, p. 152-153. La première fugue de d’Anglebert copiée par Marpurg est reproduite comme exemple 1 dans la table xxii. Deux fugues de Boyvin, également présentes dans le manuscrit, sont données comme exemples musicaux dans l’Abhandlung : la fugue grave de la première suite (xxix.1) et celle de la huitième suite (xxvii.7). Le texte des exemples imprimés est le même que celui du manuscrit, c’est-à-dire presque sans ornements. Un autre exemple est attribué par Marpurg à « Le Bègue », mais il ne figure pas parmi les fugues copiées par Marpurg et nous n’avons pas réussi à trouver sa source.
– 214 –
La dissémination de la musique
avoir été copiée plus fidèlement par ce copiste, puisqu’il donne l’adresse parisienne de Guilain et du facteur d’orgue Cliquot où l’édition pouvait être achetée : Pieces d’Orgue | pour | Le Magnificat | Sur les Huit Tons differens de l’Eglise | dediees | A Monsieur Marchand | Organiste | de St. Honoré, des RR. PP. Jesuites et du grand | convent des RR. PP. Cordeliers | Par Mr. Guilain | organiste et maitre de Clavecin à Paris | Suite du 1. Ton | l’an MDCCVI. | Se vend a Paris | chez l’auteur carrefour des Trois Maries au bout du Pont neuf. | le Sr. Cliquot Facteur d’Orgue du Roi, ruë | Philippe au proche le temple
Ce simple détail suffit à prouver que le copiste n’a pas utilisé l’exemplaire personnel d’Agricola pour réaliser sa copie, mais bien plutôt l’édition originale. Sur la même page de titre du Mus. ms. 30189, on trouve une liste de dix titres accompagnés de prix, copiée par le même copiste que le reste du manuscrit. Ces titres ont été identifiés par Philippe Lescat101 comme des œuvres de Telemann, libellées en français exactement comme elles apparaissent dans un catalogue imprimé en 1733 à Amsterdam.102 Les prix, toutefois, n’apparaissent pas dans la devise hollandaise utilisée dans le catalogue, mais en Thaler et Groschen. Ceci pourrait être une bonne raison de supposer que ce manuscrit a été copié en Allemagne après 1733, mais seules de futures recherches pourront permettre de répondre de façon satisfaisante à cette question.
La musique française dans les collections manuscrites Le plus grand ensemble de sources manuscrites de suites pour orchestre est sans doute conservé à la bibliothèque de Dresde, et provient en droite ligne de la Hofkapelle de la cour. Une particularité de ce fonds, qui fait aussi son intérêt pour une histoire des pratiques, est d’être sous la forme de parties séparées manuscrites, qui ont été écrites pour une formation particulière et ont été jouées. Quelques fragments du répertoire français de la cour de Hanovre susbistent également sous forme de partitions manuscrites à la bibliothèque de Darmstadt et dans les collections de Londres : il ne s’agit pas là d’œuvres françaises connues, mais d’un ensemble très varié transmis de façon anonyme, et dont de larges parts ont été composées par les musiciens français de la cour. La compilation de Trios de differents autheurs par Charles Babel, publiée en deux volumes en 1697 et 1698 à Amsterdam chez Étienne Roger, donne également un aperçu tout à fait intéressant sur ce que pouvait être le répertoire de suites orchestrales utilisé par la cour. Il en va de même pour les Concerti da camera de François Venturini, qui peuvent donner un éclairage très précieux sur les pratiques orchestrales de la Hofkapelle de Hanovre, ainsi que sur la place et le statut de productions suivant un modèle français. Les suites françaises dans le répertoire de la Hofkapelle de Dresde Le répertoire orchestral issu de la Schranck No: II, une armoire des archives musicales de l’église catholique de la cour de Dresde, a récemment fait l’objet d’un projet de recherche qui a permis de dresser le catalogue exhaustif des sources ainsi que des copistes et des filigranes, et a abouti à la numérisation de l’ensemble des sources, désormais consultables en ligne.103 Ce travail vient s’ajouter à une importante bibliographie qui avait déjà défriché le terrain et proposé plusieurs avancées importantes sur l’identification des copistes et des filigranes, à l’occasion de recherches portant sur des parties isolées de ce vaste ensemble – notamment les sources de Vivaldi et de Telemann. Le répertoire issu de cette fameuse armoire, où il était conservé depuis 1765 environ, comprend 1700 pièces et est aujourd’hui conservé à la bibliothèque de Dresde (SLUB). En 1760, lors du bombardement de Dresde par les armées prussiennes, les archives musicales de la cour ainsi que la réserve des instruments de musique partirent en flammes. Les partitions qui avaient survécu 101 102 103
Jean-Adam Guilain, Pièces d’orgue pour le Magnificat, facsimile, éd. Philippe Lescat, Paris 2002, p. v. Ce catalogue est édité dans le Telemann Werk-Verzeichnis, vol. 1, éd. Martin Ruhnke, Kassel 1984, p. 233. Schranck No: II – Das erhaltene Instrumentalmusikrepertoire der Dresdner Hofkapelle aus den ersten beiden Dritteln des 18. Jahrhunderts, dir. Gerhard Poppe, Beeskow 2012.
– 215 –
Chapitre 4
à l’incendie furent entreposées vers 1765 aux archives de l’église catholique, dans l’armoire n° 2. Dans l’armoire n° 3 étaient conservées les compositions pour l’église, dont seulement une partie survit encore aujourd’hui, comme on peut le constater en consultant le catalogue de 1765.104 C’est lors de ce transport que les partitions furent soigneusement classées et dotées de couvertures caractéristiques et facilement reconnaissables, encore conservées aujourd’hui. Celle-ci précisent pour chaque ensemble de parties séparées le casier de l’armoire dans lequel elles étaient rangées et leur numéro de classement à l’intérieur de ce casier. Outre ces informations, chaque couverture fait également apparaître une formation instrumentale, le nombre de parties séparées, le cas échéant l’identification du compositeur, et l’incipit musical de la partie de dessus. Le matériel musical offre donc un reflet fidèle, quoiqu’incomplet, du répertoire instrumental de la Hofkapelle sous le règne d’Auguste le Fort. Matériel d’orchestre et répertoire français Parmi les compositeurs français représentés dans les parties séparées en usage à la Hofkapelle de Dresde, on trouve les principaux compositeurs produits par l’Académie royale de musique entre 1670 et 1730 : Jean-Baptiste Lully, Pascal Collasse, Marin Marais, André Campra, Louis Lully, André Cardinal Destouches et Jean Joseph Mouret. Les suites orchestrales sont extraites avant tout d’œuvres lyriques. On trouve également des personnalités musicales actives en Allemagne : Melchior d’Ardespin travaillait pour la cour de Munich entre 1666 et sa mort,105 François Venturini était actif à Hanovre.106 Restent deux compositeurs au patronyme francisant, mais sur lesquels nous ne savons rien : Boste et Cossaque. L’écrasante majorité du répertoire se concentre sur quelques figures canoniques : sur 48 suites, 17 sont de Lully et 5 sont de Campra. Les autres compositeurs français les plus représentés sont Venturini, avec 10 suites, et Dieupart, avec 5 suites. Les suites de Dieupart sont, de leur côté, les seules sources de cette musique et l’attribution à Dieupart ainsi que les circonstances de leur composition et de leur transmission demeurent donc mystérieuses. Les autres compositeurs ne sont représentés que par une seule suite. D’autres compositeurs plus tardifs brillent par leur absence. C’est en particulier le cas de Jean-Philippe Rameau, dont aucune source manuscrite n’est conservée à Dresde alors même que la cour avait en sa possession un grand nombre de partitions imprimées de cet auteur. Les parties séparées des suites d’origine française sont réalisées par cinq copistes principaux. Johann Jacob Lindner (c.1653-1733) est le plus représenté, puisqu’il est le copiste principal de 16 jeux de parties séparées.107 Employé dans la Hofkapelle de Dresde comme ténor en 1677, il cumule ces fonctions avec celles de copiste à partir de 1680. En 1700, il devient Vice-Hofcantor à la chapelle protestante de la cour tout en continuant à exercer comme copiste.108 Son écriture caractéristique, très ornée, qui emploie occasionnellement une encre rouge pour les titres des parties séparées et la clé de la première portée, est très facilement reconnaissable. Il copie aussi de nombreuses parties séparées dans des genres très divers, notamment des œuvres de Telemann, Heinichen, Lotti, Fux et Johann Christoph Schmidt. Le second copiste le plus représenté est Johann Wolfgang Schmidt (1677-1744), avec cinq ensembles de parties séparées transmettant exclusivement des suites de Lully.109 En plus de ses fonctions de copiste, il était actif comme organiste de la cour de 1709 à 1728 environ. Son écriture très nette est bien identifiable. Jean Prache du Tilloy était actif 104 105 106 107 108 109
Horn et Kohlhase, Zelenka-Dokumentation. Quellen und Materialien, vol. 2, p. 225-276. Anton Würz, « d’Ardespin, Melchior », in : MGG online. La date de naissance hypothétique de Venturini est donnée sans justification par Andreas Waczkat dans la notice qu’il consacre au compositeur dans la MGG. Comme rien n’est connu de la vie de François Venturini avant son arrivée à Hanovre, elle est à prendre avec précaution. Mus. 1827-F-15, 15a, 21, 32, 33, 35, 36. Mus. 1859-F-2a. Mus. 2124-F-9. Mus. 2142-O-3, O-5. Mus. 2148-F-2. Mus. 2174-O-1, O-2, Mus. 2231-F-1. Mus. 2394-N-3. Landmann, Über das Musikerbe der sächsischen Staatskapelle, p. 163. Mus. 1827-F-2, 6, 8, 30, 34.
– 216 –
La dissémination de la musique
comme violoncelliste à Dresde depuis 1699, où il meurt en 1734.110 Il est le seul, parmi les copistes de la cour, à être francophone de naissance, et rédige de ce fait les nomenclatures et indications en français, dans une écriture propre et caractéristique. Seuls trois jeux survivent de sa main, tous trois issus du répertoire français de la comédie.111 Prache n’a probablement copié que de la musique française, mais la majeure partie de sa production a brûlé dès 1760 et ne peut plus être reconstruite aujourd’hui. Deux copistes anonymes (désignés par les acronymes S-Dl-001 et u) sont chacun représentés dans quatre jeux de parties séparées transmettant des suites de Lully, Campra, Venturini et d’Ardespin.112 La classification générique qui figure sur les chemises de chaque jeu de parties séparées est très intéressante. Ces chemises, bien que probablement réalisées après la mort de Johann Georg Pisendel, donnent une idée de la manière dont on perçevait dans les années 1760 un répertoire déjà ancien. On peut en outre émettre l’hypothèse qu’elles reprenaient la désignation générique qui se trouvait sur les chemises originales. Sur 48 jeux, 33 portent la désignation « Ouverture ». C’est le cas de toutes les suites de Lully,113 de toutes celles de Campra, et des suites d’Ardespin, de Marais, de Destouches, de Louis Lully, de Collasse, de Boste et de Mouret. Une seconde désignation générique vient qualifier 12 jeux de parties séparées : « Concerto ». C’est le cas pour les suites de Dieupart et de Cossaque. Les suites de Venturini sont tantôt désignées par le terme d’ouvertures, tantôt par celui de concerto, suivant en cela la double désignation proposée par l’auteur lui-même en tête de chacun de ses Concerti di camera (Amsterdam 1714), qui sont tous appelés « Sonata » dans le corps de la partition, mais dont le mouvement initial est tantôt désigné comme une ouverture, tantôt comme un concerto. Deux jeux de parties séparées ne sont pas classés d’un point de vue générique sur leur chemise, et deux autres reçoivent des désignations exceptionnelles.114 On peut donc bien voir que le répertoire tiré des tragédies en musique données à l’Académie royale de musique est largement subsumé sous l’étiquette d’ouverture. À l’inverse, certaines compositions françaises plus modernes – et, d’un point de vue stylistique, beaucoup plus italianisantes – sont regroupées sous l’étiquette de « Concertos », même si certaines d’entre elles, comme les concertos de Venturini, n’adoptent pas la succession de trois mouvements propres au concerto italien (Allegro, Lento ou Adagio, Allegro) mais se rapprochent plutôt d’une courte suite, introduite par un mouvement concertant en lieu et place d’une ouverture. Quelques œuvres sont cependant des concertos au sens traditionnel du terme : c’est le cas des deux concertos de Guignon, du concerto de Cossaque et des cinq concertos de Dieupart. Dans ces derniers cas, la catégorie de suite orchestrale ne peut donc pas du tout être appliquée. Dans les développements suivants, nous nous concentrerons sur la partie du fonds composée des Ouvertures. Nous reviendrons sur les concertos en fin de développement, pour tenter de cerner en quoi les pratiques orchestrales attachées à ce genre pouvaient différer de celles qui présidaient à l’exécution des ouvertures. Pratiques orchestrales et disciplinisation Les parties séparées de Dresde jettent une lumière particulièrement intéressante sur les pratiques d’orchestre. Depuis une vingtaine d’années, la question des pratiques instrumentales françaises et de leur diffusion dans le monde germanique a bénéficié d’une attention renouvelée.115 La dissémi-
110 111 112 113 114 115
Pour les détails biographiques le concernant, ainsi qu’un aperçu concret sur sa pratique de copiste, voir p. 187. Mus. 1827-F-13, 31. Mus. 2111-F-3. S-Dl-001 : D-Dl Mus. 1827-F-17, Mus. 1850-N-1, Mus. 2124-F-2, Mus. 2142-O-2. U : Mus. 2-O-16.1, Mus. 2124-F-5, Mus. 2124-F-6, Mus. 2124-F-10 et Mus. 2174-O-3. À l’exception de Mus. 1827-F-37, qui ne porte aucune désignation générique. Sont sans désignation générique : Mus. 1827-F-37, Mus. 2957-O-1. Une suite de Venturini est désignée comme « Sonata » (D-Dl, Mus. 2142-O-3). Une sonate de Leclair est désignée comme « Solo » (D-Dl, Mus. 2484-R-3). Köpp, Johann Georg Pisendel, p. 273-328. John Spitzer et Neal Zaslaw, The Birth of the Orchestra. History of an Institution 1650-1815, Oxford 2004, p. 216-228. Scharrer, Zur Rezeption, p. 59-68 et 246-257. L’orchestre à cordes sous Louis XIV. Instruments, répertoires, singularités, dir. Jean Duron et Florence Gétreau, Paris 2015. Bernard
– 217 –
Chapitre 4
nation de pratiques d’exécution françaises pour les cordes, documentée par de nombreuses sources germanophones, est illustrée de manière fameuse par la longue préface du Florilegium secundum de Muffat, mais également par des sources moins connues. Spitzer et Zaslaw voient dans ce processus l’une des sources de l’orchestre moderne, l’adoption de pratiques orchestrales françaises ayant entraîné une mutation profonde des ensembles de cour allemands à travers un accroissement sans précédent des effectifs et une standardisation progressive des habitudes de jeu.116 L’acquisition d’une discipline de groupe spécifique était en effet un enjeu particulièrement saillant dans l’adoption d’un style d’exécution français par les ensembles instrumentaux du monde germanique. Deux éléments concentrent l’attention des réformateurs et des observateurs : l’unification des coups d’archet et la pratique du jeu par cœur. Les témoignages à ce propos émanent surtout des cours de Stuttgart et d’Ansbach, dans la mesure où les musiciens français y étaient peu nombreux. Dès 1670, le duc de Württemberg Eberhard III se plaint que « les instrumentistes d’ici ne sont pas même en mesure d’exécuter parfaitement une courante à la manière française117 ». Quinze ans plus tard, les règles rédigées pour la Hofkapelle de Stuttgart par la duchesse et régente Magdalena Sibylla en 1684 font encore apparaître clairement les difficultés liées à l’apprentissage du style français : le répertoire français « exige tout particulièrement un exercice quotidien » et les musiciens ne doivent pas manquer les répétitions.118 Mattheson, qui loue « l’exécution si admirable, si unie et si ferme » des Français, mentionne également leur habitude de répéter leur partie un nombre indéfini de fois, jusqu’à pouvoir la jouer presque de mémoire, ce qui contredit les habitudes allemandes : Mais ils l’apprennent d’abord presque par cœur, et n’ont pas du tout honte, comme les Allemands, de travailler quelque chose et de le répéter une bonne centaine de fois, pour que cela aille bien, ce dont certains parmi nous ne laissent pas de se moquer mal à propos, et pour tout dire par principio pigritiae [principe de paresse].119
La rédaction de « règles » pour la Hofkapelle de Stuttgart semble avoir été le résultat d’une crise interne parmi les musiciens. Le diagnostic assez sévère porté sur les musiciens par le duc Friedrich Carl, qui assurait la régence pour le jeune duc de Württemberg Eberhard Ludwig avec la mère de celui-ci, vaut d’être cité longuement : lorsque les musiciens de la cour font leur service à la table princière ou bien dans les appartements, et qu’ils doivent exécuter des pièces que l’on aime à entendre, notamment les Entrées, Ouvertures, Courantes françaises et autres, ou bien elles leurs sont inconnues par manque d’entraînement, ou bien alors, certains d’entre eux devant s’aider d’une partie séparée ou d’un livre, ils ne peuvent pas s’en sortir correctement et ces pièces perdent leur grâce, et les irrégularités de tempo et les coups d’archets à contresens troublent l’harmonie. Mais si les personnes qui doivent jouer ce répertoire avaient chacun pour soi leur partem ou partie séparée individuelle, s’étant familiarisé avec elle en l’ayant copiée de leur propre main, l’ayant bien travaillée seul à la maison et dans les répétitions communes [exercitiis musicis], ils pourraient en cas de besoin la jouer sans avoir de livre devant soi, l’exécuter par cœur, et par là se prémunir et être en mesure d’exécuter lesdites pièces dans le style qui leur est propre.120
116 117 118 119
Bardet, Les Violons de la musique de la chambre du roi sous Louis XIV, Paris 2016, en particulier p. 25-42. LucCharles Dominique, Les « bandes » de violons en Europe : Cing siècles de transferts culturels des anciens ménétriers au Tsiganes d’Europe, Turnhout 2018, p. 399-572. Spitzer et Zaslaw, The Birth of the Orchestra, p. 221-238. Sittard, Zur Geschichte, vol. 1, p. 59 : « dißmals befindliche Instrumentisten nicht einen Courrant nach französischer manier perfect aufführen könden ». Owens, The Wurttemberg Hofkapelle, p. 14-15. Magdalena Sibylla, Règles de 1684, citées ici dans la version allemande : « Und nachdeme, sehr vihl, an denen Exercitÿs Musicis Gelegen ist, welche eine Zeithero absonderlich in frantzösischen Sachen, welche doch Insonderheit eines Täglichen exercitÿ nöthig haben… » Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchester, p. 226 : « ist die Execution in ihrem Genere, welche die Frantzosen derselbigen geben, so admirable, so unie und so ferme, daß nichts darüber seyn kan. Sie lernen es aber vorhero fast gantz auswendig, und schämen sich gar nicht, wie die Teutschen thun, ein Ding wol hundertmahl zu probiren und zu repetiren, damit es ja sein accurat gehe, worüber sich etliche unter uns (die Wahrheit zu sagen theils aus einem principio pigritiae) ob wol etwas mal à propos, zu mocquiren nicht unterlassen können. »
– 218 –
La dissémination de la musique
Trois symptômes sont identifiés par le régent : le manque de « grâce » qui résulte d’une mauvaise connaissance du texte musical, la difficulté de trouver le bon tempo, et la diversité des coups d’archet qui génèrent une hétérogénéité dommageable. La solution proposée est très simple : il s’agit de prévoir une partie séparée pour chaque instrumentiste, et non – comme c’était probablement le cas jusqu’ici – de se contenter de copier une partie séparée pour deux ou trois instrumentistes. C’est seulement à cette condition que les musiciens pourront emporter le répertoire chez eux pour le copier et le travailler, jusqu’à pouvoir le jouer par cœur en cas de besoin. Cette pratique semble avoir été suivie à Dresde. Une gravure des fêtes du mariage de 1719 montre l’orchestre dans la fosse du théâtre du Zwinger lors d’une représentation de l’opéra Teofane de Pallavicini (Illustration 4.3). Même dans l’espace relativement confiné de la fosse d’orchestre, chaque musicien est représenté avec sa partie séparée devant lui, éclairée par deux bougies. On observe en outre que plusieurs musiciens français notent leur nom sur leur partie séparée, montrant qu’il y avait bien une partie séparée par musicien, et qu’il était important pour eux de la conserver d’une répétition à l’autre. Les noms de Volumier, La France le Père, La France le fils et Adam Rybinski figurent ainsi sur plusieurs parties. Le nombre de parties séparées est toujours beaucoup plus important pour les voix extrêmes que pour les voix intermédiaires, ces dernières ne comportant qu’une seule partie séparée par voix. On observe que les parties présentes en un seul exemplaire (souvent les parties de cordes intermédiaires ou les parties de hautbois) ne sont jamais dotées d’un nom d’interprète, sans doute parce que l’identité de son destinataire était alors évidente et que celui-ci n’avait pas besoin de distinguer sa partie de celle de ses collègues.121 Le nombre d’instruments à vent représentés sur la gravure correspond d’ailleurs au nombre normal de parties séparées : deux hautbois sur le côté gauche dos à la scène, deux flûtes au milieu dos à la scène, et deux bassons – le premier à gauche des flûtes et le second au premier plan, face à nous. On note toutefois la présence de deux théorbes alors que le nombre de parties explicitement destinées à cet instrument est très faible.122 La gravure de la musique de table reproduite dans le chapitre 3 faisait aussi apparaître un théorbe, signalant qu’il s’agissait d’un instrument couramment utilisé dans le pupitre de continuo à Dresde. Rousseau confirme enfin, dans l’article « Parties » de son Dictionnaire de musique, que les « grandes Musiques » fournissent habituellement une partie séparée par instrumentiste.123
120
121
122 123
Décret princier du 7 oct. 1682. Cité d’après Sittard, Zur Geschichte, p. 63-64 : « wenn die Hoff Musici bei der Fürstlichen Tafel oder in den Zimmern ihre Aufwarttung haben, und diejenige beliebte Stück, die man gern hört, besonders die französische Entréen, Ouverturen, Courante und dergleichen prästiren sollen, entweder Ihnen, auß Mangel der Übung, solche nicht bekandt, oder aber, weil ihrer etliche bey einem parte und Buche sich behelffen müßen, nicth zurecht kommen können, daher öfters solche Stücke ihre grace verlieren und durch daß ungleiche tempo oder contra-strich eine wiederwärtige harmonie verusacht wird, so aber, wenn ein jedweder der bey solchen Stücke daß seinige zu prästiren seinen besondern partem oder Stimme Vor sich und Ihm solchen sowohl durch seine eigene Handtabschrifft, als fleißige Übung zu Hause und bey den exercitiis musicis in so weit bekandt gemacht hat, daß im Fall der Noth er solche auch ohn Vor sich habendes Buch und wohl gar außwendig prästiren könne, verhüttet würde, und angeregte Stück auf ihre behörige manier recht dargestellt werden köndte. » Le seule exception est l’ouverture de Marais, Mus. 2111-F-3, que nous discutons plus bas. Ici, les trois parties intermédiaires de cordes sont dotées du nom de leur interprète. Ce nom n’est pas, à l’inverse de ce qu’on observe pour les parties extrêmes, reporté par le musicien lui-même mais par une main étrangère non identifiée. Cela peut s’expliquer par le caractère relativement inhabituel de la division des parties intermédiaires en trois pupitres. Richard Maunder, The Scoring of Baroque concertos, Woodbridge 2004, p. 91-93 et 105-107. Jean-Jacques Rousseau, « Parties », in : Dictionnaire de musique, Paris 1768, p. 369 : « On appelle encore Partie, le papier de Musique sur lequel est écrite la Partie séparée de chaque Musicien ; quelquefois plusieurs chantent ou jouent sur le même papier : mais quand ils ont chacun le leur, comme cela se pratique ordinairement dans les grandes Musiques ; alors, quoiqu’en ce sens chaque Concertant ait sa Partie, ce n’est pas à dire dans l’autre sens qu’il y ait autant de Parties [que] de Concertans, attendu que la même Partie est souvent doublée, triplée & multipliée à proportion du nombre total des exécutans. »
– 219 –
Chapitre 4
Illustration 4.3. L’orchestre de Dresde dans la fosse de l’opéra du Zwinger en 1719 lors d’une représentation de l’opéra Teofane de Pallavicini pour le mariage du prince. Gravure sur cuivre de Carl Heinrich Jacob Fehling (détail). D-Dl, Sax. top. Ca 200-14, Deutsche Fotothek, Hans Loos.
– 220 –
La dissémination de la musique
Un aspect important de cette discipline d’ensemble était aussi la pratique de l’accord en groupe, évoquée par Muffat.124 Là encore, on peut penser que les violonistes allemands s’accordaient chacun de leur côté, sans avoir l’habitude d’un accord de groupe. Mattheson décrit à travers une superbe scène la manière qu’avait Jean-Baptiste Farinel de procéder à l’accord de son ensemble de violons français à la cour de Hanovre : [Farinel] avait la remarquable habitude d’accorder lui-même soigneusement un violon avant le début, disons, d’une ouverture, et ce en frottant les cordes avec l’archet, au lieu de les pincer avec les doigts. Quand il avait fini, il jouait une corde après l’autre à l’intention du premier violon, aussi longtemps qu’il le fallait pour que les deux soient bien accordés. Après cela, le premier violon faisait le tour de chacun en particulier et répétait la même chose. Quand l’un avait fini, il devait aussitôt baisser son violon et le laisser reposer intact jusqu’à ce que les autres, de la même manière, se fussent accordés : sol, ré, la, mi, dans l’ordre. Et tout cela faisait un bel effet. Chez nous, tout le monde s’accorde en même temps, en tenant l’instrument sous le bras. Cela ne produit jamais une justesse parfaite.125
Au-delà des compétences collectives des ensemble, les instrumentistes et chanteurs étaient aussi confrontés à des exigences individuelles spécifiques : la manière de tenir l’archet pour les uns, le phrasé pour les autres, et surtout l’art de bien jouer et d’orner sa partie. Le travail sur le coup d’archet et leur synchronisation au sein de l’orchestre est un aspect important du style français, mais supposait une modification de la technique de jeu qui n’allait pas toujours sans douleur. Le violoniste Johann Andreas Mayer écrit ainsi une longue lettre au duc d’Ansbach, se plaignant des dommages causés sur sa technique soliste par la technique de jeu française et la brièveté des coups d’archet qu’elle exigeait. Durant ses études à Vienne auprès de Johann Heinrich Schmelzer, il avait été entraîné à jouer des pièces virtuoses en soliste à la Biber, mais n’avait pas été familiarisé avec les pratiques d’ensemble françaises : J’ai cru comprendre, avec plusieurs de mes collègues, que le maître de la cour avait intimé au Capellmeister de votre Altesse Sérénissime Johann Georg Conrad l’ordre de prévenir les musiciens (parmi lesquels ma petitesse est comptée) que la répétition dans la manière française que le jeune Cousser de Stuttgart avait proposée doit maintenant vraiment avoir lieu, et même tous les jours. […] Mais après avoir acquis ma maigre science du violon à la cour impériale de Vienne, comme vous savez, auprès d’un maître sans égal et au prix fort, j’espère avoir jusqu’à présent toujours satisfait votre Altesse Sérénisime […]. Au contraire, si j’adopte ce coup d’archet très court, je devrais non seulement renoncer complètement à être en mesure de jouer un solo un peu difficile, mais je ne pourrais plus rien jouer non plus de propre à l’église et dans les autres pièces vocales. […] D’où ma très humble demande que vous daigniez ordonner que je sois exempté de cette bande française (tout comme l’altiste Murrer à Stuttgart, qui a aussi fait son apprentissage à Vienne auprès de mon maître, en a été dispensé) pour pouvoir me spécialiser dans les solos et les autres traits difficiles.126
124 125
126
Muffat, Florilegium secundum, p. 48 : « Il faut tâcher de bien accorder les Instruments s’il se peut avant l’arrivée des Auditeurs. » Mattheson, Der Vollkommene Capellemeister, p. 483 : « [Farinel] hatte die löbliche Gewohnheit, daß er, vor der Anhebung z. E. einer Ouvertür selbst eine Violine rein stimmte, und zwar mit Bogenstrichen, nicht mit Fingerknippen; wenn das geschehen, strich er sie dem ersten Violinisten, eine Saite nach der andern, so lange vor, bis beide gantz richtig zusammenstimmeten. Hernach that der erste Violinist die Runde, bey einem jeden insonderheit, und machte es eben so. Wenn nun einer fertig war, muste er seine Geige alsobald niederlegen, und sie so lange unberühret liegen lassen, bis alle andre, auf eben dieselbe Weise, gestimmet hatten ; G, d’, a’, e” in der Ordnung. Und solches that eine schöne Wirckung. Bey uns stimmen sie alle zugleich, und halten das Instrument unter dem Arm. Das gibt niemahls eine rechte Reinigkeit. » Curt Sachs, « Die Ansbacher Hofkapelle unter Markgraf Johann Friedrich (1672-1686) », Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft, 11, 1909, p. 105-137, ici p. 131. Lettre de Johann Andreas Mayer à Johann Friedrich von Ansbach-Brandenburg sans date : « Von Eu: Hochfürstl: Durchl: Capellmeistern, Johann Georg Cunradi, habe mit mehrerm verstanden, welcher maßen in Hochfürstl: haußhoffmeisterey ihme intimiret worden, Dero Sämbtl: Instrumental Musicanten (worunter auch ich meines wenigen Orts begriffen) anzudeuten, daß das Exercitium wegen der Französischen manier, so der junge Cusser von Suttgart vorgeschlagen, nunmehro würcklich und zwar alltäglich vorgenommen werden solle. […] Nachdeme aber gnädigster Fürst und Herr, ich meine wenige wißenschafft in der violin, bey dem kayßerl: hoff zu Wien, wie bekant, von einem
– 221 –
Chapitre 4
Muffat, dans sa préface au Florilegium secundum, consacre une section à « la manière de conduire l’Archelet ». Il y insiste sur la manière de tenir l’archet à la française, c’est-à-dire en tenant le pouce sous le crin et non directement sur le bois de l’archet, ainsi que sur la nécessité d’harmoniser les coups d’archets à l’échelle de l’ensemble de l’orchestre, préalable indispensable à une bonne hiérarchisation des temps au sein de la mesure : le coup d’archet doit être « long, ferme, egal & doux ». Il doit aussi être harmonisé, tous les instrumentistes devant employer le même coup d’archet (« comme font les François, les Anglois, ceux des Paysbas, & plusieurs autres »), au moins pour les « principales notes de la mesure ».127 Nomenclatures à la française La question des nomenclatures et des effectifs est également cruciale, tant les pratiques françaises en la matière se distinguent de celles du reste de l’Europe. Chappuzeau mentionne le nombre de six violons pour les bandes attachées à des troupes de comédiens. Ce nombre semble avoir été repecté aussi bien à Celle qu’à Hanovre.128 Mais les ensembles orchestraux pouvaient être beaucoup plus importants : le maître de chapelle de Ansbach se plaint de ne pas avoir assez d’instrumentistes à disposition pour le répertoire français, évoquant le nombre de six personnes nécessaires pour jouer la seule partie de dessus ainsi que la nécessité de doubler les parties d’alto, de basse et de basson.129 De fait, l’orchestre de Dresde qui a bénéficié des apports français sous la direction de Volumier devient dès les années 1730 l’un des ensembles musicaux les plus fournis et les plus qualifiés d’Europe jusque dans la seconde moitié du xviiie siècle.130 Dans les parties séparées de Dresde, plusieurs types de nomenclatures apparaissent : elles reflètent tantôt fidèlement la tradition française de l’orchestre à cordes à cinq parties, tantôt elles apportent quelques aménagements à ce modèle – aménagements qui s’observent ailleurs en Europe du Nord.131 Mais le type de nomenclature utilisé pour les ouvertures et leurs suites diffère toujours très sensiblement de celle d’autres genres musicaux italiens ou allemands. Dans les ouvertures, les parties de violon 1 et de violon 2 sont presque toujours à l’unisson et notées en sol 1, ce qui correspond aux habitudes de lecture des violonistes français. Les hautbois 1 et 2 sont toujours à l’unisson avec les violons. Il y a toujours au moins deux parties intermédiaires, désignées par leurs noms français (taille, haute-contre et parfois quinte) ou bien par un nom commun (viola). Pour le reste, les pratiques de rédaction des parties séparées sont d’une grande diversité. Le premier grand type de nomenclature est celui qui conserve les trois parties de cordes intermédiaires caractéristiques de l’orchestre français : haute-contre, taille et quinte, respectivement notés en ut 1, ut 2 et ut 3. C’est le cas de 11 jeux de parties séparées sur 48 : huit ouvertures de Lully, ainsi que les ouvertures de Marin Marais, Louis Lully et Pascal Collasse. Le second type, qui est aussi le plus fréquent avec 16 jeux de parties séparées, omet la partie de quinte et ne conserve
127 128 129 130
131
solchen Meister dergleichen wenig in der welt zufinden, mit ziemlichen spesen, erlernet, auch Eu : Hochfürstl: Durchl: biß dahero mit meiner wenigen persohn, hoffentlich in gnaden zufrieden gewesen […] ; dahingegen so ich diesen ganz kurzen strich annehmen – ich nicht allein ein künstliches solo zuspielen, gänzlich unterlaßen müste, sondern auch zu kirchen- und andern vocal-sachen nichts saubers mehr mitmachen könte […]. Alß gelanget an Eu: Hochfürstl: Durchl: hiermit mein unterthänigstes bitten […], damit ich von solchen Französischen bande (gleich wie der violist Murrer zu Stuttgart, welcher auch zu Wien bey meinem Meister gelernet, exempt gewesen) befreyet bleiben – und mithin mich in solo und andern künstlichen sachen desto qualificirter machen möge ». Muffat, Florilegium secundum, p. 45. Voir Chapitre 3, p. 167-170. Spitzer et Zaslaw, The Birht of the Orchestra, p. 220. Jean-Jacques Rousseau, art. « Orchestre », in : Dictionnaire de musique, Paris 1768 : « Le premier Orchestre de l'Europe pour le nombre & l'intelligence des Symphonistes est celui de Naples : mais celui qui est le mieux distribué & forme l'ensemble le plus parfait est l'Orchestre de l'Opéra du Roi de Pologne à Dresde, dirigé, par l'illustre Hasse. » Pour un aperçu sur la modification de la nomenclature orchestrale dans les éditions de Lully publiées à Amsterdam, voir Schneider, « The Amsterdam editions of Lully’s orchestral suites ».
– 222 –
La dissémination de la musique
donc que deux parties intermédiaires, libellées en ut 1 et en ut 2 : c’est le cas pour 7 ouvertures de Lully,132 les 5 ouvertures de Campra, une ouverture de Venturini, ainsi que les ouvertures de André Cardinal Destouches, Melchior d’Ardespin et Jean Joseph Mouret. Enfin, trois nomenclatures minoritaires peuvent être observées. Trois jeux de parties séparées ne font apparaître que deux parties intermédiaires, rédigées en ut 1 et ut 3 : deux ouvertures de Lully et une ouverture de Venturini. Un seul jeu, de Venturini, fait apparaître deux parties intermédiaires en ut 2 et ut 3. Enfin, deux ouvertures ne comportent qu’une seule partie intermédiaire notée en ut 3 : Boste et Venturini. On observe aussi une très grande fluctuation dans la dénomination des parties séparées. En règle générale, les jeux qui conservent les trois parties intermédiaires (ut 1, ut 2 et ut 3) reflètent aussi la terminologie française : Haute-Contre, Taille et Quinte.133 On observe cependant cinq jeux qui, tout en conservant les trois parties intermédiaires, adoptent une nomenclature alternative qui semble du même coup déplacer leur position au sein de l’orchestre.134 Il s’agit du seul cas de figure où la partie de violon 2 n’est pas à l’unisson avec la partie de violon 1 et n’est pas non plus notée dans la même clé. La nomenclature la plus courante consiste cependant, comme nous l’avons vu, à ne donner que deux parties intermédiaires en ut 1 et ut 2. Cette pratique majoritaire doit être rapprochée d’une liste de personnel de la Hofkapelle, datée du mois d’août 1709. Cette liste, qui est la seule à faire figurer des noms français pour les parties intermédiaires, mentionne simplement l’existence d’un pupitre de « Haute contre » et d’un pupitre de « Taille » (Tableau 4.6). Le pupitre de Quinte semble donc ne pas avoir eu d’existence administrative bien établie, et l’on peut penser que lorsqu’il y a une partie de quinte, les instrumentistes se répartissaient d’une manière différente en trois pupitres au lieu de deux.135 Dans ce dernier cas de figure, toutes les manières de libeller les partitions sont représentées, depuis une dénomination purement française (Haute-contre et Taille) jusqu’à une dénomination italianisée (Viola 1 et Viola 2), avec de nombreux cas intermédiaires de nomenclature hybride. Il en va de même lorsque les deux parties intermédiaires sont copiées en ut 1 et en ut 3, ce qui est un cas rare.136 Un seul cas présente deux parties intermédiaires copiées en ut 2 et ut 3.137 Un autre trait à prendre en compte est la clé dans laquelle sont copiées les parties de dessus de violon, de flûte et de hautbois dans les ouvertures. En règle générale (26 jeux), elles sont copiées en sol 1. Il peut cependant arriver (7 jeux) qu’elles soient libellées en sol 2 : c’est le cas pour les ouvertures de Venturini, dont l’édition imprimée libelle aussi les parties de violon en sol 2, pour l’ouverture de Boste ainsi que, de façon plus surprenante, pour deux ouvertures de Lully.138
132 133 134
135
136 137 138
Nous intégrons à ce décompte le Mus. 1827- F-37, qui ne porte pas d’indication générique mais que nous intégrons tout de même parmi les ouvertures. Mus. 1827-F-2 (copié par Schmidt), Mus. 1827-F-6 (Schmidt), Mus. 1827-F-8 (Schmidt), Mus. 1827-F-15 (Lindner), Mus. 1827-F-30 (Schmidt), Mus. 1827-F-30 (Schmidt), Mus. 1827-F-34 (Schmidt), Mus. 2111-F-3 (Prache). Mus. 1827-F-32 (Lindner) donne une partie de « 2. Dessus » en ut 1, une partie de « Viola 1.a » en ut 2, et une partie de « Viola 2.a » en ut 3. Mus. 1827-F-21 (Lindner), Mus. 1827-F-32 (Lindner) et Mus. 2231-F-1 (Lindner) donnent une nomenclature similaire. Mus. 1859-F-2a (Lindner) donne une nomenclature similaire, mais avec deux parties de second violon en ut 1. Le jeu de parties séparées Mus. 2111-F-3 (la tempête d’Alcione de Marin Marais) offre un exemple concret de ce type de pratiques, puisque les trois parties intermédiaires de cordes sont dotées du nom de l’instrumentiste. Ces noms ne sont pas reportés par les musiciens ni par le copiste (ici Prache), mais par une main étrangère. H[err] Golde tient la partie de Haute-Contre, H[err] Herring la partie de Taille et H[err] Lehneiß la partie de Quinte. Le premier est listé parmi les Taille en 1709, le second dans les Haute-Contre, et le troisième est qualifié de Violoncell dans la même liste de personnel. En revanche, les deux autres altistes qui figurent sur cette liste (Johann Heinrich Praetorius et Christian Rother) n’apparaissent pas dans ce jeu de parties séparées. On voit bien ici que l’introduction de trois parties intermédiaire supposait quelques réaménagements dans l’orchestre, parmi les pupitres d’altistes mais aussi dans le pupitre de violoncelles, dont un membre pouvait prendre en charge la partie de Quinte. D-Dl, Mus. 1827-F-11 (Viola 1 et Viola 2). D-Dl, Mus. 1827-F-36 (Viola I et Viola II). D-Dl, Mus. 2142-O-6, copié par Pisendel (Hautcontre et Viola). D-Dl, Mus. 2142-O-5 : deux parties de Viola I en ut 2, deux parties de Viola II en ut 3. D-Dl, Mus. 1827-F-33 et D-Dl, Mus. 1827-F-35.
– 223 –
Chapitre 4
Tableau 4.6. Composition de la Hofkapelle de Dresde en 1709. HStA Dresden, Loc. 383/4, fol. 108-110. Daß hier bey specificirten Personen ausgesetzes jährl. Tractament, von und mit abgewichenen Johannis dieses Jahres, seinen Anfang nimmet, in deme von solcher Zeit an der Gage halber, auf S[eine]r Königl[ichen] M[ajestä]t und Churfürstl[ichen] H[oheit] zu Sachßen allerg[nä]d[ig]st[en] Mündl[ichen] Befehl, mit Ihnen durch mich tractiret worden, enthin auf nechst bevorstehende Michael[is] das erste Quartal gefällig ist, solches wird Kraft meiner eigenen Hand, Unterschrifft und vorgedruckten Petschaffts, hiermit attestiret. Dreßden, den 13. Aug. 1709. [Signature: Johann Sigismund baron von Mordaxt] O. Orchestra. Concertmeister Volumnier
1200 Thlr
Compositor di Camera Fiorelli
600 Thlr
Stephan Rinck
250 Thlr
Adam Rybitzky
Sec: Violino
300 Thlr
Lotti Second:
Violino
300 Thlr
Joh: George Lehneiß Johann Heinrich Praetorius Christian Rother Golde
Í
Í
Haute contre
Í
Í
Taille
300 Thlr 240 Thlr 300 Thlr 240 Thlr
Gottfried Herring
Violoncell
300 Thlr
D. Huisse [Jean-Baptiste Ducé]
Flute Allemande
400 Thlr
Charle Henrion
Hautbois pr:
300 Thlr
[Johann Christian] Richter
Hautbois pr:
300 Thlr
Jean Bapt: Henrion
Hautb: 2do
300 Thlr
Christian Roche
Hautb: 2do
250 Thlr
Le Conte le Bere
Flute alemande
250 Thlr
Anthon Rybitzsky
Basson
300 Thlr
Le Conte le Fils
Basson
200 Thlr
Cosmovskÿ od[er] Luparini
Organista e Compos. di Chiesa
400 Thlr
Christian Pezold
Organ: e Composi: di Camera
400 Thlr
Gottfried Bentleÿ
Tiorbista
400 Thlr
Francesco Arigoni
Tiorbista
300 Thlr
Michael Pezschmann
Braccista
160 Thlr
La France le Fils
violoncell
200 Thlr
Notista
200 Thlr
Instrument diener
100 Thlr
Herr Capellmeister [Johann Christoph] Schmidt
1200 Thlr
le gros [Simon Le Gros]
500 Thlr
diar [Pierre Diard]
600 Thlr
de barkes [Charles Debargues]
1200 Thlr
Gingestes
1200 Thlr
Cosmedit [Comédie, Troupe de Villedieu]
10000 Thlr
Rossi
500 Thlr 210 Thlr
[Total= 23 900 Thaler]
24000 Thlr
– 224 –
La dissémination de la musique
La nomenclature utilisée dans les œuvres baptisées Concertos diffère sensiblement de ce que nous avons pu observer parmi les ouvertures. On observe d’abord que presque toutes les parties de dessus sans exception sont notées en sol 2.139 Là où les ouvertures font presque toujours jouer la même chose aux deux pupitres de violon et aux deux pupitres de hautbois, les concertos contiennent en général une partie distincte pour chaque pupitre de ces instruments. On peut ausi voir que la plupart des concertos n’ont qu’une seule partie de cordes intermédiaire, libellée en ut 3 ou, dans le cas des concertos de Dieupart, en ut 2. La seule exception à cette règle est un concerto de Venturini dans lequel figurent deux parties d’alto en ut 1 et en ut 2, alors même que l’édition originale prévoit deux parties d’alto rédigées en ut 3 (Alto Viola et Tenore Viola).140 Il ressort de ces observations que la musique française et la musique « à l’italienne » faisaient l’objet à la cour de Dresde d’un type de copie et d’exécution bien particulier, se distinguant par plusieurs détails importants de nomenclature et d’usage des clés. On a donc ici un aperçu très concret et très direct sur les « deux orchestres » dont il est question dans la biographie de Pisendel. Ces deux ensembles orchestraux partageaient sans doute au moins quelques musiciens en commun, mais ils se distinguaient par leur formation instrumentale, par leurs pratiques de lecture et sans doute par leur style d’exécution. La diaspora des sources de Hanovre Alors que le répertoire français de la Hofkapelle de Dresde est bien transmis dans les matériels d’orchestre, celui des cours de Basse-Saxe n’a quasiment pas survécu. Aucune source musicale en provenance de la cour de Celle n’a pu être retrouvée pour notre période. Même le répertoire de la Hofkapelle de Hanovre a connu un destin étrange, puisqu’il doit être reconstruit à partir de sources disséminées à travers l’Europe : quelques fragments de ce répertoire subsistent encore à Darmstadt, à Londres et à Berlin. L’une de ses particularités est de présenter de nombreuses œuvres composées sur place par les musiciens français au service de la cour, notamment JeanBaptiste Farinel et Stéphane Valoy, là où les sources conservées de la Hofkapelle de Dresde sont presque exclusivement issues de la copie et de la compilation d’œuvres composées en France. Cette diaspora des sources hanovériennes, liée aussi bien à la circulation des musiciens, à la dissémination de la musique qu’à l’union personnelle de Hanovre avec l’Angleterre à partir de 1714, ne doit cependant pas faire oublier l’existence de quelques sources de musique française qui furent autrefois ou sont toujours conservées à Hanovre.141 Un livre de musique pour le clavier ayant appartenu à Ernst August, aujourd’hui perdu, contenait du répertoire français.142 Quelques pièces de musique composées par Jean-Baptiste Farinel sont transmises dans un manuscrit contenant entre autres 13 « Concerts pour le Nouvel An » composés entre 1697 et 1709 pour l’orchestre de la cour.143 Enfin, une source documente indirectement la diffusion de l’opéra français : des parties séparées de chant en français du xviie siècle.144 139
140 141 142 143
144
La première exception se trouve dans un concerto de Venturini, où les parties de violon sont notées en sol 1, tandis que les parties de hautbois sont notées en sol 2 : Mus. 2-O-1.32. La seconde exception se trouve dans un concerto de Dieupart, où les violons sont notés en sol 2, mais les flûtes en sol 1 : Mus. 2174-O-4. On peut penser qu’il s’agit dans ces deux cas de s’adapter aux pratiques de lecture des musiciens impliqués. Les flûtistes d’origine française étaient sûrement plus habitués à la lecture de la clé de sol 1 que de sol 2, d’où l’irrégularité constatée dans le concerto de Dieupart. D-Dl, Mus. 2-O-1.32. Eduard Bodemann, Die Handschriften der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Hannover, Hannover 1867. Theodor Abbetmeyer, Zur Geschichte der Musik am Hofe in Hannover vor Agostino Steffani 1636-1689. Ein Bild künstlerischer Kultur im 17. Jahrhundert, Göttingen 1931, p. 30-31. D-HVl, Ms. IV 417. Erik Albertyn, « The Hanover orchestral repertory, 1672-1714 : significant source discoveries », Early Music, 33/3, 2005, p. 449-471. Un concert est attribué à Venturini, deux à Farinel, les autres sont anonymes. Le manuscrit contient également une série d’airs, préludes et gigues avec leurs doubles, des fantaisies, un air en couplet de Valoy, et d’autres pièces pour la flûte. Albertyn attribue l’ensemble des Concerts anonymes du recueil à Farinel. D-HVl, Ms. IV 411-413. Bodemann, Die Handschriften : « Thésée, Alceste, Atys. Vermuthlich Gesangrollen aus e[iner] unbekannt[en] Oper. XVII Jahrh[undert]. 20, 20 u. 19 Bl[ätter]. 4° obl. »
– 225 –
Chapitre 4
Les manuscrits de Darmstadt L’ensemble le plus complet et le plus intéressant de sources hanovériennes est cependant représenté par un ensemble de quatre recueils conservés à Darmstadt. Trois d’entre eux contiennent des ouvertures pour orchestre avec leur suite, tandis que le dernier transmet huit « Concerts à chanter ».145 Les trois recueils de suites instrumentales sont anonymes, mais deux d’entre eux portent le nom du copiste qui les a réalisés et la date à laquelle ils ont été copiés. Le premier a été copié en 1689 par Guillaume Barré, un hautboïste originaire d’Orléans qui avait été engagé l’année précédente à la Hofkapelle de Hanovre.146 Le troisième a été copié la même année par Charles Babel, un Français originaire d’Évreux qui appartenait également au groupe des « Pfeiffern » engagés en 1688.147 Le second manuscrit ne porte pas de signature ni de datation, et il a été copié par une main différente de celle des deux autres, mais son format est très proche et sa couverture de cuir porte en lettres gravées le titre : « 12 Grands Concerts en partition. A Hanover 1690 ». La main qui copie ce manuscrit n’est pas celle de Barré ni celle de Babel : il pourrait peut-être s’agir du troisième hautboïste engagé en 1688, Gilles Héroux, si jamais chacun des trois nouveaux musiciens a été chargé de copier du répertoire pour l’orchestre à son arrivée. Comme leur date de rédaction le laisse supposer, ces trois recueils n’ont pas été rédigés indépendamment, mais semblent au contraire avoir été conçus pour répondre à un projet commun : chacun comporte douze pièces, et chacun présente une facette différente du répertoire instrumental de la Hofkapelle. Dans le premier manuscrit copié par Guillaumé Barré, les douze suites sont numérotées de façon continue et dotées du titre « Suittes ». Chacune comprend entre quatre et sept mouvements dansés, le plus souvent cinq ou six. Le dispositif du recueil est très proche de celui des Concerti di Camera publiés par Venturini en 1714, puisque chaque suite est introduite alternativement par une ouverture à la française (« Ouverture ») ou par une pièce plus libre et concertante (« Concert » ou « Simphonie »). Comme chez Venturini, ces mouvements introductifs sont de dimensions très larges et de facture très classique, les ouvertures suivant à un schéma très normé. Le texte musical est différent, mais aide à comprendre que la collection publiée par Venturini en 1714 est le reflet fidèle de pratiques déjà en vigueur à la fin des années 1680. Le manuscrit copié par Charles Babel comporte douze « Grands Concerts » de dimensions beaucoup plus étendues, d’un seul tenant et visiblement pensés pour être joués d’une seule traite. Les différentes sections de chaque concert sont très souvent contrastantes, marquées par des changements de mesure très fréquents, mais ne sont pas séparées par un saut à la ligne et ne sont pas dotées d’un titre. Comme dans les suites de Venturini et de l’autre manuscrit, on note la très forte prédominance de passages solistes composés pour le trio de vents à la française, deux hautbois et un basson, qui correspond sans aucun doute à ce qu’étaient en mesure de jouer les trois « Pfeiffern » engagés en 1688. Le contenu du manuscrit éventuellement copié par Gilles Héroux est plus hétérogène, puisqu’à côté d’un répertoire instrumental standard composé de huit « Suittes » et d’un « Concert », il transmet également de la musique de ballet regroupée en trois ensembles de mouvements qui ne sont pas dotés d’un titre générique. On peut même trouver des concordances textuelles avec certains livrets de divertissements français donnés à Hanovre dans les années 1680, par exemple avec le Triomphe de la Paix, donné en 1685 à Hanovre pour célébrer la naissance du prince Friedrich August, fils de Sophie Charlotte et du prince électeur de Brandebourg. Ainsi, le troisième mouvement de la troisième suite est intitulé « Chœur vive ce jeune prince » et transmet
145 146 147
Respectivement D-DS, Mus. ms. 1221, 1226, 1227 et 1230. Sur les trois derniers, voir Schneider, « Unbekannte Handschriften der Hofkapelle in Hannover. Zum Repertoire französischer Hofkapellen in Deutschland ». D-DS, Mus. ms. 1221. La table des matières située en fin de volume contient l’indication suivante : « Mise en partition par M.r Barre a Hannover 1689 ». D-DS, Mus. ms. 1227. La table des matières située en début de volume porte l’indication suivante : « Mise en partition à hanover 1689. par M.r Babel. » La couverture porte le titre suivant : Partition fa a Hanover 1689.
– 226 –
La dissémination de la musique
donc l’accompagnement orchestral d’un chœur chanté à trois reprises dans le ballet.148 Dans la même suite, le huitième mouvement (intitulé « Chœur Esperons ») donne l’incipit d’un chœur qui peut être retrouvé dans le livret du Triomphe de la Paix.149 Les autres mouvements de cette suite correspondent aussi au Triomphe de la paix dont ils fournissent donc la musique instrumentale : l’entrée de nymphes, l’entrée de la suite de la Paix, la marche du sacrifice, la symphonie pour Jupiter correspondent tous à des passages du livret. C’est aussi le cas de la quatrième suite, qui contient aussi un « Chœur Venez Charmante Paix » dont le titre peut être rapproché d’un passage du livret.150 Comme le livret du ballet indique que « M.r de Valois a composé toute la musique », on peut conclure que les suites ont été composées par Stéphane Valoy. Erik Albertyn mentionne également des correspondances entre ce manuscrit et le Livre pour la flûte conservé à Hanovre ainsi qu’une suite de Stéphane Valoy conservée à Berlin.151 La constance de la nomenclature utilisée pour les cordes est très frappante dans ces manuscrits. Guillaume Barré n’utilise qu’un seul type de nomenclature à quatre parties : Violon (sol 1), Haute-contre (ut 1), Taille (ut 2) et Basse ( fa 4). Lorsque des instruments à vent sont présents, ils sont notés en sol 1 et leur nom est donné en tête de chaque suite. La nomenclature utilisée par Charles Babel est identique, puisque les Concerts à 4 Violons sont écrits pour le même ensemble : Violon (sol 1), Haute-contre (ut 1), Taille (ut 2) et Basse ( fa 4). Les flûte et hautbois qui apparaissent dans les concerts n° 7 à 9 sont notés sur une portée à part, en sol 1. Le troisième manuscrit suit les mêmes pratiques, de même que François Venturini dans ses Concerti da camera publiés en 1714. On a donc ici accès à la composition de l’orchestre à cordes de la Hofkapelle de Hanovre qui semble avoir été en usage au moins entre 1690 et 1714. Notons que cette nomenclature semble avoir été beaucoup plus stable qu’à Dresde, où nous avons déjà constaté la volatilité des pupitres et des nomenclatures. Au lieu de l’orchestre à cinq parties à la française, on n’a que quatre parties. Mais au lieu de l’orchestre à quatre parties à l’italienne, on a deux parties intermédiaires de cordes et un seul pupitre de violons. Les trois manuscrits de Darmstadt comportent de nombreux passages barrés – simples mesures fautives corrigées immédiatement après, parfois passages ou mouvements entiers qui se trouvent rayés. Ceci laisse penser qu’il s’agit peut-être de partitions de travail, corrigées pendant les répétitions avec les comédiens et les danseurs, bien davantage que de copies propres destinées à orner une collection musicale. D’autre part, on observe aussi que de nombreux mouvements du manuscrit 1227 sont accompagnés de l’indication « à prendre » ou « pris », ou encore marqués avec une petite croix sur le côté gauche. Ceci indique que ce manuscrit a lui-même servi de modèle à d’autres musiciens, qui copiaient de façon sélective son contenu. Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le montrer en examinant la carrière de Stéphane Valoy, ces manuscrits ont certainement fait le voyage de Hanovre à Darmstadt en sa possession, puisqu’après avoir quitté le service de la cour de Hanovre, il fut maître de musique de la troupe de comédiens français de Darmstadt où il mourut en 1715, léguant ainsi ses manuscrits musicaux à la bibliothèque de la cour où elles sont restées jusqu’à aujourd’hui.152 Les sources de Londres et Amsterdam La Royal Music Collection de la British Library contient cinq grands volumes de musique religieuse en provenance de la Hofkapelle de Hanovre, qui transmettent le répertoire de la chapelle 148 149 150 151 152
Le Triomphe de la Paix, Hanovre 1685 : « Vive vive ce jeune Prince | Vive l’himen glorieux, | Qui donne a la Province | Ce gage pretieux. » Le Triomphe de la Paix, Hanovre 1685 : « Esperons la Victime est pure, | On n’y trouve rien qui n’augure | Un succez bien heureux. » Le Triomphe de la Paix, Hanovre 1685 : « Venez Charmante Paix | Vos douceurs ont de charmes [sic] | Vous nous comblez de bien faits, | Vous dissipez nos allarmes, | Venez Charmante Paix | Venez ne nous quittez jamais. » Respectivement D-HVl, Ms. IV 417 et D-B, Mus. ms. 30274. Albertyn, « The Hanover orchestral repertory, 1672-1714 », p. 463. Voir Chapitre 2, p. 44-46.
– 227 –
Chapitre 4
à la fin du xviie siècle et ont trouvé leur chemin vers Londres dans les années 1710 à la suite de l’union personnelle avec la cour de Hanovre.153 Parmi les compositeurs les plus représentés sont naturellement Johann Krieger, Johann Rosenmüller, Nicolaus Adam Strungk, Ruggiero Fedeli et Pietro Torri. Mais deux pièces témoignent également de l’activité des musiciens français de la cour dans le domaine de la musique d’église. La première œuvre est un psaume en musique anonyme, Laudate pueri Dominum, qui est introduit par une ouverture à la française et se conclut par une grande chaconne sur le verset « suscitans a terra ».154 La seconde est un Magnificat composé par Stéphane Valoy, qui se trouve dans le premier des cinq volumes, un recueil comprenant plusieurs autres psaumes en musique par des compositeurs ayant exercé en Allemagne du Nord à la fin du xviie siècle.155 L’ensemble témoigne de la cohérence dans le choix du répertoire : les deux compositeurs les plus représentés sont Johann Rosenmüller, qui fut compositeur pour la cour de Hanovre depuis son exil vénitien, ainsi que son élève Johann Philipp Krieger. Ruggiero Fedeli (1665-1722) a également des liens avec la cour de Hanovre : souvent sollicité à Berlin par la reine en Prusse Sophie Charlotte pour des événements musicaux au château de Lietzenburg – aujourd’hui Charlottenburg –, Fedeli composa la musique pour ses obsèques à Hanovre lorsqu’elle mourut en 1705. Pietragrua et Rossi sont en revanche plus éloignés de la cour de Hanovre, même si leurs œuvres ont très probablement été transmises à Londres par ce canal.156 Peter Wollny a déjà attiré l’attention sur cet ensemble de manuscrits en provenance de Hanovre et qui possède de nombreuses concordances avec la collection Bokemeyer. Il souligne qu’une grande part de la musique est copiée par un scribe unique à l’identité encore indéterminée, probablement originaire de Hanovre et qui aurait suivi George Ier en 1714.157 En fait, cet ensemble de copies est probablement un peu plus tardif. L’ensemble du recueil contenant le Magnificat de Valoy est copié sur le même papier, qui porte une marque de filigrane en fleur de lys avec un blason rayé, tandis que la contremarque montre le sigle « JWhatman ».158 James Whatman (1702-1759) était un fabricant de papier actif à partir de 1733 dans le comté de Kent, près de Maidstone. Installé en 1736 dans une nouvelle fabrique, il commence à y produire du papier blanc de haute qualité. Son premier filigrane connu date de 1740.159 Cette datation amènerait à réviser l’hypothèse initiale de Wollny, et conduirait à conclure qu’il s’agit de copies plus tardives qu’on ne le pensait jusqu’alors, puisqu’elles n’auraient pas été réalisées avant 1740, soit sous le règne de George II (r. 1727-1760). Il faudrait alors chercher l’identité du copiste non pas dans le personnel qui aurait suivi George Ier depuis Hanovre, mais dans le personnel en place sous le règne de son successeur. Les manuscrits que nous avons aujourd’hui seraient donc une copie tardive du matériel original de Hanovre, qui aurait été transporté directement à Londres en 1714 et aurait depuis été perdu.160 153 154 155
156
157 158 159
GB-Lbl, R.M. 24.a.1, R.M. 24.a.2, R.M. 24.a.3, R.M. 24.a.4, R.M. 24.a.5. GB-Lbl, R.M. 24.a.5. Wollny, « Zur Thüringer Rezeption des französischen Stils », p. 148. GB-Lbl, R.M. 24.a.1. Outre le Magnificat de Valoy, on trouve deux Beatus vir et un Laudate pueri de Johann Rosenmüller, trois œuvres de Johann Philipp Krieger (Cantate Domino, Cor meum atque, Confitebor tibi Domino), un Alleluia fideles plaudite de Carlo Luigi Pietragrua, un Laudate Dominum de Camilla de Rossi, un Confitebor tibi Domine de Ruggiero Fedeli. Carlo Luigi Pietragrua (1665-1726) est embauché à Dresde comme altiste en 1687, puis comme Vice-Kapellmeister en 1693. On peut ensuite le suivre à Düsseldorf (1694) puis à Vienne (1705) et à Heidelberg (1718). Il retourne ensuite à Venise, où il engage des chanteurs italiens pour la chapelle de l’évêque de Würzburg, Johann Philipp von Schönborn, sur une commande de Steffani. Rossi est vraisemblablement Camilla de Rossi, une compositrice qui écrivit quatre oratorios pour la chapelle de la cour de Vienne entre 1707 et 1710. Peter Wollny, « Zwischen Hamburg, Gottorf und Wolfenbüttel : neue Ermittlungen zur Entstehung der Sammlung Bokemeyer », Schütz-Jahrbuch, 20, 1998, p. 59-76, ici p. 68. Ce filigrane est presque identique au numéro 104 donné dans : Edward Heawood, Watermarks, maintly of the 17th and 18th centuries, Hilversum 1981. John N. Balston, The Elder James Whatman : England’s Greatest Paper Maker (1702-1759). A Study of EighteenthCentury Papermaking Technology and its Effect on a Critical Phase in the History of English White Paper Manufacture, West Farleigh 1992, vol. 1, p. 94-105. Le père de James Whatman était tanneur à Loose, et celui-ci était donc le premier fabricant de papier de sa famille : vol. 2, p. 36-39. Je remercie Rudolf Rasch pour ses précieux conseils à ce sujet.
– 228 –
La dissémination de la musique
Le Magnificat de Valoy est une œuvre d’assez grande envergure, puisqu’il compte 373 mesures – tout comme la messe, qui en comptait 289. Il est structuré de façon tout à fait régulière, puisque chaque verset du texte de l’Évangile de Luc est mis en musique pour un effectif différent. Les sections sont habituellement séparées par une double barre, mais elles peuvent aussi être enchaînées comme la première avec la seconde ou encore la neuvième avec la dixième. L’œuvre du musicien français montre certaines similitudes avec sa messe brève, tant sur le plan du style musical que dans les détails les plus concrets de la copie. On retrouve en particulier le mélange caractéristique entre un idiome musical nettement italianisant et des détails typiquement français, tels que l’alternance entre un petit chœur et un grand chœur, le traitement largement syllabique des chœurs et des lignes vocales solistes, ou encore les nombreuses indications libellées en français. Au premier rang de ces détails gallicisants se trouve toutefois la nomenclature de l’œuvre. La source londonienne reprend en effet la nomenclature de Hanovre également observable dans les manuscrits de Darmstadt, en distinguant deux parties de violon qui jouent un texte identique (sol 1), deux parties intermédiaires (ut 1 et 2) et une partie de basse ( fa 4). À côté de cet ensemble de sources londoniennes, il faut également prendre en considération les deux compilations de trios publiées à Amsterdam par Charles Babel, chez Étienne Roger en 1697 et 1698.161 Quelques années seulement après avoir quitté le service de la cour de Hanovre, où il avait déjà copié douze concerts dans le manuscrit de Darmstadt en 1689 et où il reste au moins jusqu’en 1691, Charles Babel était bassoniste à La Haye dans la troupe des comédiens français de Guillaume III d’Orange Nassau, Stathouder de Hollande et roi d’Angleterre.162 Les deux volumes publiés par Babel sont d’un grand intérêt pour l’étude du répertoire français de la cour de Hanovre : cette grande anthologie de musique publiée à la fin des années 1690 peut en effet être lue non seulement comme un vade mecum pour les musiciens actifs dans les troupes de comédiens, mais aussi comme un reflet du répertoire français en usage à la cour de Hanovre dans les mêmes années. Malheureusement, la quasi-totalité du répertoire publié par Charles Babel est anonyme. On peut simplement noter que la publication d’un volume pour une formation en trio rejoint une pratique que Babel a sans doute contribué à introduire à Hanovre : celle du trio de vents à la française, également mobilisée de façon massive par les sources de la cour de Hanovre et par Steffani. L’activité de copiste et de compilateur de Babel s’est cependant pas limitée à la publication de ces deux anthologies ni au manucrit de Darmstadt : de nombreux manuscrits disséminés à travers le monde témoignent de l’ampleur de son travail de copiste et de sa vaste connaissance du répertoire français.163 Un manuscrit particulièrement intéressant dans notre perspective est conservé à la bibliothèque de Hambourg, qui est daté de La Haye en 1696 – soit juste avant la publication du premier volume des Trios de différents autheurs.164 Il s’agit d’une compilation d’œuvres de Lully et de Johann Philipp Krieger, copiées comme les Trios sous forme de parties séparées. La musique française dans la collection Bokemeyer Le répertoire de la Hofkapelle de Hanovre ne trouva pas seulement son chemin vers les collections royales de Londres ou le marché de l’édition florissant en Hollande : il est également très présent 160
161 162 163 164
Frederick Hudson arrive à une conclusion similaire à propos des parties de L’Allegro de Händel, sur la base du même filigrane : Frederick Hudson, « The New Badford Manuscript Part-Books of Handel’s Setting of L’Allegro », Notes, 33/3, 1977, p. 531-552. Voir aussi Frederick Hudson, « The Earliest Paper made by James Whatman the Elder (1702-1759) and its Significance in Relation to G. F. Handel and John Walsh », The Music Review, 38, 1977, p. 15-32. Charles Babel, Trios de Différents Autheurs, Livre premier, Amsterdam [1697]. Charles Babel, Trios de Différents Autheurs, Livre second, Amsterdam [1698]. Pour une description du contenu, voir Rudolf Rasch, The Music Publishing House of Estienne Roger and Michel Le Cène, Catalogue en ligne. Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 177. Gustafson, « The Legacy in Instrumental Music of Charles Babel ». D-Hs, ND VI 2762. La fin du volume porte l’indication « Fin de tous les Anciens Ballets de feu | Monsieur Jean Baptiste de Lully | Remis en Ordre par Charles Babel A la Haye en 1696 ».
– 229 –
Chapitre 4
dans la collection Bokemeyer, aux côtés de quelques sources française. Cette collection, qui rassemble près de 2000 manuscrits conservés à la Staatsbibliothek de Berlin, est d’une importance capitale pour la transmission de la musique d’église luthérienne d’Allemagne du Nord de la seconde moitié du xviie siècle.165 Elle tient son nom de Heinrich Bokemeyer (1679-1751), élève à l’université de Helmstedt entre 1702 et 1704, puis théoricien et polémiste de premier plan.166 Kantor à la Martinskirche de Braunschweig entre 1704 et 1712, Bokemeyer prit des cours de composition à Wolfenbüttel auprès de Georg Österreich. C’est par ce dernier que fut en fait largement constituée la collection qui porte aujourd’hui le nom de Bokemeyer, puisque c’est Österreich qui copia ou fit copier la plus grande partie des manuscrits. Georg Österreich (1664-1735) débuta ses études à la Thomasschule de Leipzig où il fut l’élève de Johann Schelle. Après un bref séjour au lycée Johanneum de Hambourg, il commença une carrière de ténor à l’opéra du Gänsemarkt de Hambourg, puis à la cour de Wolfenbüttel entre 1686 et 1689. C’est en 1689 qu’il fut engagé par le duc Christian Albrecht comme Kapellmeister de la cour de Gottorf. Peu après la dissolution de la Hofkapelle en 1702, Österreich retourna à Braunschweig pour gérer la brasserie qu’il avait héritée de son beau-père. À partir de cette date, il fut à nouveau associé à la Hofkapelle de Wolfenbüttel, remplaçant par exemple le Kapellmeister Georg Caspar Schürmann lorsque celui-ci était absent et occupant les fonctions de Kantor de la cour à partir de 1724, poste qu’il conserva jusqu’à sa mort en 1735.167 Sa collection mêle donc plusieurs strates de répertoire : bien sûr la musique copiée pour les besoins de la Hofkapelle de Gottorf, mais également des manuscrits que Österreich avait copié avant et après son activité comme Kapellmeister. Bokemeyer reçut la bibliothèque en héritage à la mort d’Österreich, et la légua à son tour à son gendre, Johann Christian Winter, organiste à Celle. C’est probablement par l’intermédiaire de ce dernier que Forkel put racheter l’ensemble de la collection, acquise par le Königliches Institut à Berlin en 1819, où elle se trouve encore aujourd’hui, dans un état probablement incomplet.168 Une bonne partie de la collection transmet le répertoire de la Hofkapelle de Hanovre : à côté de nombreuses œuvres d’Agostino Steffani, on trouve une messe brève et une suite pour orchestre de Stéphane Valoy. Composée d’une ouverture suivie d’une gigue, d’une gavotte et d’un rondeau, la suite de Valoy présente globalement les mêmes caractéristiques que les suites présentes dans les manuscrits de Darmstadt.169 Plus originale est la messe brève composée par le maître de chapelle français, parfaitement adaptée au culte luthérien puisqu’elle comporte seulement un Kyrie et un Gloria.170 Elle a été copiée par Georg Österreich au même stade d’écriture qu’un motet de Lalande, désigné par Harald Kümmerling comme « Öe », sur un papier dont le filigrane est relevé par Kümmerling mais dont je n’ai pas pu éclarcir la provenance.171 Même si son style musical est largement international ou italianisant, plusieurs détails trahissent l’origine française du compositeur. L’alternance entre un petit chœur soliste et le grand chœur, dont Valoy fait un usage très fréquent, évoque l’effectif vocal du motet à grand chœur. Le paratexte musical est libellé en français : « Sinfonie », « Lentement », « Gay », « Doux », « Seul », « Tous », « L’on reprend au premier Kyrie jusqu’a la Ritournelle » – ainsi qu’une indication plus inhabituelle (« Hardi ») qui accompagne de nombreux passages fugués et que l’on retrouve également dans le Magnificat conservé à Londres. On notera aussi le parcours tonal fondé sur l’alternance de tons homonymes : au Kyrie en do mineur succède un Gloria en do majeur.172 165 166 167 168 169 170 171 172
Harald Kümmerling, Katalog der Sammlung Bokemeyer, Kassel 1970. Voir aussi Zwischen Schütz und Bach. Georg Österreich und Heinrich Bokemeyer als Notensammler, dir. Konrad Küster, Stuttgart 2015. Wolfgang Hirschmann, « Bokemeyer, Heinrich », in : MGG online. Carsten Lange, « Österreich, Georg », in : MGG online. Kümmerling, Katalog, p. 9-10. D-B, Mus. ms. 30274. D-B, Mus. ms. 30293. Si l’on s’appuie sur cote originale de la partition dans la bibliothèque de Gottorf (1198) et sur les hypothèses de Kümmerling concernant le développement de la collection, cette copie aurait été réalisée entre mars 1694 et novembre 1696. Voir cependant ci-dessous (note 176) les réserves exprimées par Peter Wollny. Kümmerling, Katalog der Sammlung Bokemeyer, p. 131. Sur ce point, voir aussi Chapitre 5, p. 273-282.
– 230 –
La dissémination de la musique
La messe de Valoy respecte la nomenclature caractéristique de Hanovre, puisqu’elle est écrite pour violon (sol 2), haute-contre (ut 1), taille (ut 3) et basse ( fa 4). Il faut noter que les deux parties de violon sont là encore notées sur deux systèmes différents, mais qu’elles jouent strictement la même chose. Plusieurs indices laissent penser que Georg Österreich a pris l’initiative de modifier la nomenclature des violons par rapport à la partition qu’il avait sous les yeux lors de la copie : plusieurs erreurs de copie montrent que le modèle était rédigé avec des clés différentes. On observe ainsi, dans la partie de taille de violon (ut 3), plusieurs passages écrits une tierce trop bas, probablement parce que le modèle était rédigé en ut 2 : ces passages arrivent d’ailleurs de manière intéressante après des mesures de silence, soit à un moment où le copiste a probablement oublié qu’il devait transposer la partie de taille. Les parties de violons comportent aussi des erreurs de transcription suggérant que les parties originales que Österreich avait sous les yeux étaient libellées en sol 1, l’amenant à transcrire par erreur certains passages une tierce trop bas lorsqu’il oublie de faire la transposition. On observera d’ailleurs que la partie de haute-contre, libellée en ut 1, est beaucoup moins raturée et ne contient que deux erreurs qui n’ont rien à voir avec un changement de clé : ceci peut s’expliquer par le fait qu’Österreich n’avait sans doute qu’à recopier une partie libellée dans la même clé. La nomenclature de la partition ou des parties séparées recopiées par Österreich était donc sans doute arrangée de la même manière que toutes les autres sources de Hanovre : deux parties de violon identiques (sol 1), deux parties intermédiaires (ut 1 et 2) et une partie de basse ( fa 4). Même si le noyau de la collection Bokemeyer est constitué de musique d’église italienne et allemande, plusieurs sources témoignent de la circulation de la musique française : on trouve ainsi une copie manuscrite de L’Europe galante de Campra et celle du motet à grand chœur Audite caeli (S7) de Michel-Richard de Lalande.173 Cette dernière est sans doute l’une des sources les plus fascinantes et les plus mystérieuses de la collection : cataloguée par Kümmerling au numéro 590, elle a aussi été copiée par Georg Österreich. D’après Kümmerling, la quasi-totalité de la collection fut produite par l’atelier de copistes de la cour de Gottorf entre 1692 et 1702 pour répondre aux besoins musicaux de la Hofkapelle, mais également dans une visée patrimoniale destinée à couvrir le spectre le plus large possible de musique d’église.174 Plusieurs indices laissent pourtant penser que c’est à Wolfenbüttel qu’Österreich aurait rédigé sa copie de Lalande. Cette hypothèse recoupe plusieurs points importants de la discussion engagée par Peter Wollny avec les conclusions de Kümmerling : d’une part, certaines des partitions ont été copiées en-dehors de la période d’activité d’Österreich comme Kapellmeister à Gottorf (1689-1702). D’autre part, les cotes reportées par Österreich sur les partitions de sa collection ne suffisent pas à établir une chronologie satisfaisante du développement progressif de cette dernière.175 Enfin, la question de l’usage des sources de la collection Bokemeyer mérite également d’être discutée à nouveaux frais : Wollny souligne que la copie des sources de la collection ne peut pas avoir eu pour seul objectif, comme le suppose Kümmerling, la constitution d’une bibliothèque musicale aussi complète et large que possible, destinée à l’étude. La plupart des partitions de la collection doivent avoir eu pour but au moins provisoire d’être exécutées dans l’un des lieux d’activité de Georg Österreich. Ceci implique que les partitions de la collection, aujourd’hui seules conservées, étaient à l’origine accompagnées de parties séparées qui auraient été dissociées des partitions à un moment ou à un autre de l’histoire de la collection.176
173
174 175 176
D-B, Mus. ms. 2880 : André Campra, « Ballet en Musique. L’Europe Galante ». La partition est datée de 1697, l’année de la création de l’œuvre, mais le copiste a d’abord indiqué Lully comme compositeur, avant que cette attribution ne soit corrigée. D-B, Mus. ms. 30222 : Michel Richard de Lalande, « Audite Caeli à 10. Premier et Second Dessus, Haute-contre, Taille, Quinte, Basse de Violon, Premier et Second Dessus de Voix, Haute contre, Taille, Basse, Basse Continüe ». Kümmerling, Katalog, p. 12-13. Wollny, « Zwischen Hamburg, Gottorf und Wolfenbüttel », p. 63. Wollny, « Zwischen Hamburg, Gottorf und Wolfenbüttel », p. 62-63.
– 231 –
Chapitre 4
Cette hypothèse permet d’expliquer pourquoi le titre et l’attribution qui figurent sur les partitions sont bien souvent copiés par Österreich à un stade avancé de son écriture, ou encore par une autre main que celle d’Österreich – comme c’est le cas pour le motet de Lalande : ils devaient figurer à l’origine sur une chemise de papier qui a probablement suivi les parties séparées, d’où la nécessité de compléter l’intitulé directement sur la partition. D’ailleurs, si un titre abrégé figure bien sur la première page de la partition du motet de Lalande, copié par une main différente de celle d’Österreich, cette partition est encore accompagnée de sa chemise originale dans laquelle les parties séparées étaient sans doute insérées, et sur laquelle figure, de la main d’Österreich et de façon très complète, le titre et l’attribution de l’œuvres, ainsi que l’intitulé des parties. On peut observer que la main qui a ajouté la nouvelle cote « 1063 » sur la chemise est la même que celle qui ajoute « de Lalande » en haut de la première page. L’Audite caeli S7 est l’un des tout premiers motets de Lalande.177 Les sources françaises qui transmettent cette pièce ne sont pas nombreuses : outre une copie tardive de la fin du xviiie siècle, le motet est transmis par une seule source manuscrite de la collection Philidor, où il apparaît sous deux formes différentes.178 Dans sa table des matières, Philidor a indiqué les particularités de chacune des deux versions copiées : à la page 39 figure « Audite Caeli quae Loquor », à la page 71 « Audite Caeli quae Loquor, de la manière que Mr. De la Lande l’avoit fait la premiere fois ». La première version du manuscrit est donc la seconde chronologiquement. Objet de nombreuses coupures selon un processus courant dans la réécriture par Lalande de ses propres motets, elle est nettement plus courte que la version originale. Alors que la seconde version date probablement de 1689, la première doit avoir été composée avant la nomination de Lalande comme maître de chapelle à Versailles en 1683.179 La copie allemande réalisée par Georg Österreich transmet la version la plus ancienne du motet. Comme elle n’a jamais été imprimée, on doit supposer que Georg Österreich l’a copiée sur une version manuscrite qui circulait en Allemagne à cette époque. L’écriture de Georg Österreich dans cette partition est assimilée par Kümmerling au stade « Öe ». La partition porte la cote originale 1227, qui apparaît encore sur la chemise du manuscrit. Si l’on suit l’hypothèse de Kümmerling selon laquelle les partitions étaient numérotées dans l’ordre chronologique de leur copie, ce manuscrit devrait avoir été rédigé à la même période que les deux motets de Cousser discutés au Chapitre 5 (respectivement cotés 1225 et 1228), soit entre mars 1694 et novembre 1696, puisqu’il est situé entre deux sources datées : la cote 1091 (mars 1694) et la cote 1309 (novembre 1696). Mais les Gottorfer Signaturen ne reflètent en fait pas strictement le développement chronologique de la collection Bokemeyer. Le papier de la copie fait apparaître un filigrane identifié par Kümmerling (384a). Il provient du moulin à papier de Johann Wilhelm Cast à Hasserode, non loin de Wernigerode, petite ville du Harz située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Wolfenbüttel. Johann Wilhelm Cast y aurait été actif entre 1695 et 1705. Il s’agissait là sans doute d’un des moulins à papier les plus proches de la cour, puisque la plaine de Basse-Saxe n’en comptait que très peu, contrairement à la région voisine du Harz, riche en cours d’eau nécessaires pour la fabrication du papier.180 Ce filigrane peut être retrouvé dans d’autres partitions de la collection.181 Par ailleurs, son utilisation est documentée pour les années 1695, 1700 et 1701 en combinaison avec un autre filigrane classé par Kümmerling sous le numéro 385a. 177 178 179 180 181
Sawkins, A Thematic Catalogue, p. 78-87. F-V, Ms 12. Le manuscrit F-A, Ms. 5840 (« Table de motets de feu Mr. De La Lande qui n’ont point esté gravez et l’année qu’il les a composés ») donne 1689 comme date d’exécution de ce motet. Sawkins suppose qu’il s’agit de la date de la seconde version. Viktor Siemers, Braunschweigische Papiergewerbe und die Obrigkeit, Wolfenbüttel 2002, p. 28-34. Nous donnons pour chaque partition le numéro sous lequel elle figure dans le catalogue de Kümmerling, la cote actuelle, le compositeur et ses dates d’existence, le titre, la cote originale (Gottorfer Signatur) et le copiste tel qu’il est identifié par Kümmerling. D-B, Mus. ms. 30211, Bok. 465, Antonio Gianettini (1648-1721), Confitebor tibi Domine, 1267, Österreich et un autre copiste connu sous les initiales JDF mais dont le nom complet n’a pas pu être élucidé. D-B, Mus. ms. 18882, Bok. 802, Johann Rosenmüller (1619-1684), Laudate Dominum omnes gentes, 1281, Ö. D-B, Mus. ms. 18883, Bok. 827, Rosenmüller, Homo Dei creatura, 1262, JDF. B-D, Mus.
– 232 –
La dissémination de la musique
La copie du motet de Lalande n’est pas simplement une copie, mais plutôt un arrangement de l’œuvre originale. Plusieurs modifications notables sont en effet apportées dans le dispositif fondamental du motet à grand chœur.182 Les parties instrumentales présentent peu de modifications par rapport à la source versaillaise, puisque Georg Österreich reproduit fidèlement le texte musical, les noms et les clés de la nomenclature utilisée par Lalande : premier et second dessus de violons en sol 1 (mais rassemblés sur une seule portée là où ils sont parfois notés sur deux portées distinctes chez Philidor), haute-contre en ut 1, taille en ut 2, quinte en ut 3, basse de violon en fa 4. Österreich ajoute simplement une portée pour la basse-continue qui n’est pas présente dans la copie de Philidor puisqu’elle suit la ligne de basse de violon. Le type de modification le plus frappant apporté par Österreich dans les parties instrumentales est la multiplication des ornements. Les quelques passages fautifs dans la copie de Philidor sont en règle générale corrigés par Österreich. On trouve également quelques modifications des lignes vocales médianes, qui suivent de plus près chez Österreich que chez Philidor les lignes instrumentales. De rares ornements sont omis par Österreich, et on observe enfin quelques différences minimes d’indications,183 de rythme, de hauteurs et de liaisons. Le chiffrage de la basse continue est également beaucoup plus précisément noté chez Österreich. Dans les parties vocales, la réécriture est plus profonde puisque les deux chœurs caractéristiques du motet à grand chœur (le grand et le petit chœur) sont ici rassemblés en un seul ensemble vocal, ce qui conduit Österreich ou son modèle à réécrire de nombreux passages. La nomenclature de l’unique chœur d’Österreich diffère aussi sensiblement de la tradition française, puisque si le copiste allemand reprend les cinq voix caractéristiques du grand chœur français, l’usage des clés se rapproche en revanche sensiblement de l’usage allemand : deux clés de sol 2 (deux sopranos), une clé d’ut 3 (alto), une clé d’ut 4 (ténor) et une clé de fa 4 (basse). L’usage de la clé de sol est le seul qui ne correspond pas à l’usage allemand traditionnel, puisque les parties allemandes de soprano sont habituellement notées en ut 1. L’énumération des voix en français dans le titre d’Österreich est d’ailleurs intéressante : la composition du chœur est détaillée en « Premier et Second Dessus de Voix, Haute-Contre, Taille, Basse ». Österreich féminise donc la composition du chœur français, où toutes les voix sont masculines sauf le dessus, se prive de la Basse-Taille et décale d’un système vers le grave les parties de Haute-Contre et de Taille. Il trouve ainsi un excellent compromis entre le chœur français à une voix de femme et quatre voix d’homme, et le chœur allemand ou italien à deux voix de femmes et deux voix d’hommes. L’une des questions les plus passionnantes pour le chercheur, mais aussi l’une des plus difficiles à résoudre, est celle du modèle copié par Österreich et la manière dont il a pu avoir accès à une telle œuvre, somme toute assez marginale et précoce dans la carrière de Michel Richard de Lalande. La copie d’Österreich présente plusieurs traits intéressants de ce point de vue. Tout d’abord, on remarque qu’à toutes les voix, les mesures de silence sont pourvues d’un numéro au lieu de la pause. Ceci indique que, lorsqu’il réalise sa partition, Österreich a certainement en tête la réalisation de parties séparées où il suffira de reporter le nombre total de mesures de silence. Tout à fait frappante est également la propreté de ce manuscrit, qui, en dépit de sa longueur (721 mesures de musique) contient très peu de ratures ou de corrections. Les quelques fautes commises puis corrigées par Österreich ne trahissent pas la présence d’un modèle différent, mais sont au contraire des fautes bénignes telles que des décalages de mesure ou des erreurs isolées dans la
182 183
ms. 18887, Bok. 884, Rosenmüller, In te Domine speravi, 1246, JDF et Ö. D-B, Mus. ms. 19781, Bok. 974, Johann Schelle, Nun dancket alle Gott, 1239, JDF. D-B, Mus. ms. 30293, Bok. 1035, Vesii, Venite gentes, pas de cote, JDF et Ö. D-B, Mus. ms. 23445, Bok. 1076, Friedrich Wilhelm Zachow, Von Himmel kam, sans cote, Ö. Thierry Favier, Le Motet à grand choeur. Gloria in Gallia Deo, Paris 2009. Österreich indique à plusieurs reprises un doux aux parties supérieures de cordes lors de l’entrée d’une voix soliste – notation qui n’apparaît pas chez Philidor : mes. 27, 212, 305, 466. Il note également en toute lettres (Ritournelle ou Symphonie) trois passages instrumentaux non intitulés par Philidor: mes. 298, 445, 614. On pourra noter que Georg Österreich demeure pour le reste fidèle à la terminologie qui figure dans la copie de Philidor: les Simphonies (mes. 1, 188) sont appelées Symphonie, tandis que la Ritournelle de la mes. 526 est appelée Rittournelle.
– 233 –
Chapitre 4
lecture des clés. Le seul passage où Georg Österreich modifie visiblement son modèle de façon intentionnelle, mais seulement dans un second temps, se situe à la mesure 221, à la partie de haute-contre de violon : il copie d’abord la version de Philidor, avant de se raviser et de modifier la ligne mélodique de façon à ne pas toucher le fa dièse dans l’orchestre avant le second temps de la mesure, de sorte que la voix chante seule le fa dièse au premier temps. Il écrit d’ailleurs en français un « Ré » en toutes lettres en-dessous de cette correction peu lisible. On a donc globalement l’impression de Georg Österreich copie fidèlement un modèle ligne par ligne. La faute qu’il fait à la partie de dessus (mes. 166-173) est tout à fait typique d’une copie page par page et ligne par ligne, puisqu’il confond ces quelques mesures avec un passage qui se situe un peu plus loin sur la même page, mais commence de la même façon (mes. 177-183). Le passage copié par erreur est gratté puis corrigé, avec l’indication des notes en toutes lettres au-dessus de la dernière mesure de la page. Österreich a donc apparemment commencé sa page en copiant la partie de dessus vocal. De façon intéressante, le décalage prend fin au bas de la page, ce qui indique que chaque page était copiée l’une après l’autre. Ceci pourrait indiquer que Georg Österreich copiait sa partition sur un ensemble de parties séparées. Il ne semble pas avoir introduit de modification majeure en cours de copie, et son modèle doit donc avoir été déjà très largement modifié par rapport à la version transmise par André Danican Philidor. Entre compilation et objet de mémoire : le livre de musique La musique française n’a pas été sollicitée seulement dans le cadre de chapelles princières ou ducales, ou d’une vie de cour fastueuse, pas plus que son usage ne s’est limité à des contextes de représentation extraordinaire ou de liturgies publiques marquées d’un certain degré de solennité. Le répertoire venu de France a également franchi le seuil des demeures individuelles et des appartements, et a visiblement trouvé un usage important dans la sphère privée. Ici, dans l’intimité d’une pratique musicale domestique ou dans le labeur silencieux d’un atelier de copistes, le répertoire français emprunte des chemins encore largement inexplorés, et pour une part semés d’embûches d’un type bien particulier. Une difficulté spécifique des sources destinées à un usage domestique est leur caractère très marqué de compilations : la musique française y est présente sous forme d’extraits, placés au beau milieu d’œuvres qui n’ont souvent rien à voir par leur contenu ou leur provenance. La question de l’usage de ces sources est aussi un aspect essentiel de la réflexion sur ce type de documents, puisqu’ils sont souvent réalisés pour un usage pratique immédiat. Ceci rend souvent un travail approfondi sur les sources domestiques particulièrement ardu. En effet, les extraits copiés dans les livres de musique des grands aristocrates allemands ne sont généralement pas attribués ni identifiés précisément. Puisque le livre était destiné à un usage individuel, on savait ce qu’il y avait dedans et il n’était donc pas nécessaire d’identifier, de classer et d’ordonner les extraits autrement qu’en suivant sa fantaisie, ou par des annotations à usage strictement personnel. À charge donc pour le chercheur de reconstituer, à partir des catalogues à sa disposition, et en se fondant sur les titres, les textes ou les incipits musicaux du manuscrit, le répertoire qu’il contient. Ce travail, réalisable sur des recueils de musique vocale, étant donné que le texte peut servir à identifier un extrait d’une œuvre, est en revanche beaucoup plus difficile à mettre en œuvre sur les sources de musique instrumentale, dont bien peu de choses peuvent servir à l’identification. Le livre de musique de Ludwig Rudolf de Wolfenbüttel Une source tout à fait passionnante pour l’étude de la vie quotidienne musicale à la cour de Wolfenbüttel est le journal tenu par le duc Ludwig Rudolf (1671-1735). Dernier fils du duc Anton Ulrich et de sa femme Elisabeth Juliane, il accomplit son Grand tour juste après son frère aîné August Wilhelm, entre 1685 et 1687, à travers la France, l’Italie et les Pays-Bas. Il s’engagea ensuite dans les armées impériales sous Jean III Sobieski, où il se fit remarquer pour son courage et sa valeur militaire. En 1689, un traité de succession lui assura le comté de Blankenburg. En 1690, il épousa Christine Luise von Oettingen, une mélomane très active. En 1714, à la mort de son père,
– 234 –
La dissémination de la musique
il s’installa à Blankenburg et gouverna ce territoire de moins de vingt kilomètres carrés, élevé depuis 1707 à la dignité de principauté impériale par l’empereur Joseph Ier, avec détermination en y entretenant une vie de cour très active. À la mort de son frère aîné August Wilhelm en 1731, Ludwig Rudolf accéda au gouvernement de la principauté de Wolfenbüttel qu’il conserva jusqu’à sa mort.184 Cette figure intriguante n’est pas seulement intéressante dans une perspective d’histoire politique ou militaire : Ludwig Rudolf était aussi, comme en témoigne son impressionnante collection de manuscrits, un homme d’une grande érudition et d’une immense curiosité. Dans cette collection se trouvent aussi deux fragments de son journal datés de 1701 et 1707, les deux seuls extraits qui nous soient parvenus. Rashid Pegah a transcrit et commenté les extraits se rapportant à la musique pour l’année 1707.185 Différentes entrées montrent que des extraits de Phaëton de Lully et de L’Europe galante de Campra furent exécutés à Wolfenbüttel en septembre 1707 par une troupe de comédiens français de passage, dont la composition reste malheureusement inconnue.186 Ces extraits apportent un témoignage passionnant sur la circulation de la musique et des musiciens français, ainsi que sur la proximité entre théâtre parlé et théâtre chanté, étroitement mêlés lors des représentations en français – à la différence, sans doute, du théâtre italien qui semble avoir été nettement plus distinct de l’opéra. L’autre fragment du journal de Ludwig Rudolf, le cahier de l’année 1701, est d’une toute autre nature que le journal de 1707 : alors que celui-ci est de format in-quarto, simplement relié dans une épaisse couverture de cuir brun, contenant des notices apparemment écrites en toute hâte au jour le jour, le journal de l’année 1701 est de format in-folio, relié dans une couverture de cuir rouge bordée d’or, écrit très proprement, de façon continue, sans saut de page ou changement d’écriture visible. On peut se demander s’il ne s’agit pas là d’une copie au propre d’un journal original, mais cette pratique semble peu vraisemblable. Peut-être simplement que Ludwig Rudolpf était plus attentif à la présentation matérielle de son journal en 1701 qu’en 1707. La page de titre est ornée d’une superbe aquarelle, représentant un arc de triomphe, avec le château de Wolfenbüttel à l’arrière-plan. Sur l’arc est reporté en caractères manuscrits dorés le titre latin du cahier.187 Plusieurs extraits de ce journal se rapportent de façon très précise à de la musique jouée ou entendue (Tableau 4.7). La musique s’inscrit ainsi dans un univers mental et sensoriel très large, puisque ce journal est tout à la fois exercice spirituel, livre de comptes et de dettes, mémoire des choses vues, lues et entendues, écriture de soi et consignation méticuleuse des plus petits événements de la vie quotidienne, compris comme effets de la sollicitude de Dieu. Il s’achève du reste par une action de grâce saisissante, où le jeune duc relit l’année écoulée en étendant sa prière à l’ensemble de l’univers. Dès la première page du journal, l’année 1701 s’ouvre par l’évocation de deux musiciens français, et se conclut, lors des derniers jours, de la même façon. Comme nous l’avons déjà noté dans le Chapitre 1, ces deux évocations sont des beaux exemples de circulation de musiciens français par le biais de canaux diplomatiques. Les représentations musicales extraordinaires évoquées dans le journal ont lieu presque exclusivement au mois de février et au mois d’août. La cour se trouve à Braunschweig du 29 janvier au 15 février pour la foire d’hiver, et assiste à des représentations d’opéra au théâtre public du Hagenmarkt de Braunschweig. Beaucoup d’œuvres entendues sont de Georg Caspar Schürmann (1673-1751), maître de chapelle de la cour de Wolfenbüttel : 184 185 186
187
Paul Zimmermann, « Ludwig Rudolf », in : Allgemeine Deutsche Biographie. Rashid Sascha Pegah, « Und abends war opera. Tagebuchnotizen aus dem Jahre 1707 », Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 23, 1998, p. 182-190. D-W, Cod. Guelf. 286a Blankenburg. Pegah, « Und abends war opera », p. 198 : « d. 2 Septemb. wieder le Mariage forcé, nachdem sie vorhero etwas auß der opera von Phaeton gesungen. […] d. 6. Septemb. ist wieder Commoedie geweßen; Le Devil [= Le Devin?] und haben sie vorhero auß der opera L’Europe Galante etwas gesungen […] d. 15 Septemb. deß Abends wurde von denn französischen Commoedianten; auf dem Theatro ein Actus auß Europe Galante gerepresentiert; hernach le tombeau de Maitre d’Andrée gespielet . » D-W, Cod. Guelf. 28 Blankenburg : « Diarium Ser[enissi]mi Princip[i] ac Domin: D[o]m[in]i Ludovici Rudolphi Brunsvicensium ac Luneburg: Ducis Vitam & Actiones nec non pleraque in Aula Guelphica ut et Christiano Orbi Universo notatu digna complectens. Anno Ortae Salutis MCCI. »
– 235 –
Chapitre 4
Tableau 4.7. Journal du duc Ludwig Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel pour l’année 1701 : extraits se rapportant à la musique et au son. D-W, Cod. Guelf. 28 Blankenburg. Date
Texte
24. janv.
Den 24ten Januarii war man des mittages zu Gaste beÿ dem Franzosch: Envoyé Monsieur de Bonnac, und waren selbige Persohnen beÿ Ihme: Mein H: Vatter, Frau Mutter, Mein Bruder, und Seine Gemahlin, Meiner Gemahlin, der Prinz August von Bettern, Ich, Monsr Obdam, ein so genandter Baudovin, so aus Pohlen gekommen und affairen vor dem König alhier unter händen hatte, die 2. Princessinen Eleonora von Meinungen, und die von Hollstein-Vorburg. Beÿ der Taffel war Music von Flöten und Hautbois, und spieleten auf solchen Instrumen ten 2. Franzosen, Vatter und Sohn, da von der Sohn nicht über 10. Jahr alt, zu seÿn scheine, und dennoch über alle maßen wohl blieb, so wohl der Hautbois als Flöte, absonderlich auf dem Basson : Sie hatten sich den Tag vorher beÿ der Assamblée zu Hoffe auch hören laßen, weil Sie der französische Envoyé meinem H. Vatter praesentiret.
26 janv.
den 26to Januar : ist Assamblée beÿ Mr. de Bonnac des Abends gewesen, und ist auch darbeÿ getantzet worden.
29 janv.
den 29ten Januar : ist der gantze Hoff hinüber nach Braunschweig gereiset, umb auf der bevorstehenden Winter-Meße daselbsten ihren Séjour zu halten.
6 févr.
Den 6to Febr: ist Music in der Dohm-Kirchen St: Blasii zu Braunschweig vor und nach der Predigt in Gegenwartt der Fürstl: Persohnen gehalten worden, und hat ein neuer Bassist von Coburg ein Solo gesungen.
7 févr.
Den 7ten Febr: ist Opera gewesen und nach der Opera hat man getantzet und gespielet zu Hofe, die Opera wurde tituliret Salomon.
8 févr.
den 8ten Febr. ist auf dem ordinairen Theatro wieder eine Opera in Teütscher Sprache gespielet worden, Lucius Verus benahmet den Mittag haben beÿ dem Französ. Envoyé Bonac in seinem gemietheten Hause zu Braunschweig gegeßen
10 févr.
den 10ten Febr: wurde Salomon nochmahlen gespielet.
11 févr.
den 11ten Febr: ist wiederumb eine teutsche Opera gespielet : Pharamond genandt, und nach der Opera wurde à l’ordinaire zu Hofe getantzet und gespielet.
14 févr.
den 14ten Febr: wurde Salomon zum 3ten mahl gespielet.
15 févr.
den 15ten Febr. reisete der Hoff wieder herüber nach Wolfenbüttel.
21 févr.
den 21ten Febr: ist die Italienische Opera Endimione auf dem kleinen Theatro zu Wolfenbüttel gepraesentiret worden, und hat man nach der Opera gespielet in Meines Hrn Vattern Vorgemach
24 févr.
den 24. Febr. des abends ist die Italienische Opera : Il Pastore d’Anfriso zu Hofe gespielet worden, nach deren endigung man an die Tagel gegangen […]
28 févr.
Sonsten habe Ich den 28ten Febr: die Anmerckungen über des Balthasar Gratians Criticon mitschrieben zu ende gebracht, und über die Pensées ingenieuses de Mons.r de Pascal wieder angefangen zu excerpiren.
6 mars
Kurz vorhero ist ein so genannter von Schleinitz, so nebst Seiner Frauen wehrender Winter-Meße zu Braunschweig sich aufgehalten, nach Sachsen weg gereiset ; Ich habe demselben [Tag ?] einen Jungen verehret, so auf der Hautbois und Fleute-douce spielen konte, weilen er mich darumb angesprochen.
16 mai
des abends ist der Hoff al corso zum erstenmahl gewesen von diesem Jahr in dem Lecheln-Holtze, und hat man des Abends alsdort, in dem daselbst gefindlichen Hause gegeßen ; bey der Taffel haben etliche Berg-Knappen mit Lithrinen und Violinen aufgewartttet und dabeÿ gesungen.
17 mai
diesen Tag ist eine Opera alhier zu Wolfenbüttel gespielet worden, nemblich Endymione so Italienische und schon vorher etliche mahl gespielet war ; nach endigung der Opera ist an etlichen Tafeln in dem ordinairen Eß-Gemach gespeiset worden.
30 mai
den 30ten May seÿnd meine Gemahlin, der Prinz August von Bettern, Ich, die Madme Crammen, ihr Mann, die Fräulein Papthausen, Mons: Campe des Abends umb 6. Uhr hinaus nach Unserm Gartten gefahren, haben daselbsten zu Abend gegeßen, nach deßen endigunge wir in Lecheln-Holtze in Chaise-Rolande Portieren gefahren, und habe Ich die Crammen geführet ; der Printz August und Ich haben auf der flöte gespielet, umb das Echo in einer von denen Alléen im Bechels-Holtze recht hören zu können.
26 juin
[à l’occasion de l’inauguration du couvent à Salzdahlen] Man saß en der Tafel pêle mêle, und waren mehr als 90. Persohnen an selbiger ; Es wurde eine schöne Music beÿ selbiger gehalten.
27 juin
Den 27. Jun: seÿnd wir zusammen gegen mittag wiederumb hinaus nach Saltzdahlen gefahren und haben des Mittages wie auch des Abends daselbsten geßen [sic] ; Es ist damahls eine Italienische Opera gespielet worden, genannt Il figlio delle Selve.
– 236 –
La dissémination de la musique
Tableau 4.7. (suite) 30 juin
Es hatt obgedachte Wache alle Zeit ein Lieutenant oder Föndrich [?] auf geführet, und seÿnd Sie jedesmahl auf dem Zechten Flügel der hiesigen Parade postiret gewesen, seÿnd mit selbiger zugleich abmarchiret und auf das Schloß gezogen mit Hautbois und rührendem Spiel.
8 juil.
Gegen Abend bin Ich nebst Meiner Gemahlin nach Menßen hinaus gefahren, allwo Wir beÿ Meinem Bruder gegeßen, so uns zu Gaste gebehten [sic] hatte, und waren folgende Persohnen auch mit da, die Princessinen von Meinungen und Hollstein, der französische Envoyé Mon: de Bonac, die Fräulein Henningen und Mons. Schwartzkopf ; Es wurde beÿ der Tafel musiciret und Aß man in dem Gartten unter einer von denen 3. Lauben so mitten in Gartten seÿnd.
22 juil.
Meine Gemahlin hatte des Printz Augusts Seine bande Hautbois kommen laßen, welche beÿ der Tafel aufwartteten und verkleidet waren als Bauern, wie dann auch Meiner Gemahlin und Meine Bediente sich als Bauer-Mädgens verkleidet hatten […]
9 août
den 9ten Augusti wurde eine Italienische Comoedie des Abends auf dem Großen Saal zu Braunschweig auf dem Most-Hause Italienischen Comoedianten gepraesentiret, der Harlequin hieß Stefano oder Sebastiano von Zell, und war vor diesem in Zellischen diensten gewesen, er hatte eine gar hübsche Tochter welche auf mitspielete.
11 août
des Abends ist wieder Italienische Comoedie auf dem Großen Saale gewesen.
12 août
Nach dem Eßen fuhren wir wieder hinüber nach Braunschweig, woselbsten wir eben zu recher Zeit ankahmen, umb der Italienische Comoedie mit zusehen zu können, so diesen Abend auf dem Theatro auf dem Alten Rath-Hause von denen Italienische Comoedienaten praesentiret wurde, und war es : Il Principe finto.
13 août
des Abends ist wieder Italienische Comoedie gewesen, und war es : Harlequino Simiotto.
15 août
den 15ten Augusti wurde eine Opera gespielet, so Teutsch, Nahmens Daniel, und fuhr man umb 4. Uhr nach der Redoute, allwo gespielet wurde, bis es Zeit war in die Opera zugehen ; diese wehrete von 7. Uhr an bis halb 11. Uhr nach derer endigunge jeder in Seinem Gemache des Abends speißete.
16 août
den 16ten Augusti wurde wieder eine Opera gespielet : Salomon, so schon vorige Winter-Meße gespielet worden.
17 août
des Nachmittages hat der französch. Envoyé du Bonac den gantzen Hoff mit einer Italienischen Comoedie regaliret, intituliret : Angoletta Spirito Foletto, welches die Tochter des Harlequins praesentirte, und viele Adorateurs in diesem Stücke bekahm.
18 août
den 18ten Augusti ist die Opera von Salomon wieder gespielet worden
19 août
den 19ten Augusti ist Luccius verus, auch eine Teutsche Opera gespielet worden […] Man hat der Opera verkleidet zugesehen, und war Ich als ein Jäger gekleidet, und hatte einen Grünen Rockh mit Guldenen Gallonnen an ; Wie die Opera aus war hat man an unterschiedliche Tafeln in dem großen Redout-Saale beÿ der Opera geßen [sic], und setzte Ich mich, weil sonsten kein Platz vor mir, mit an der Tafel von denen Prinzen und Princessinnen, die das Ballet Tantzen solten, worunter den Prinz von Plöre [?] der vornehmste war, welcher nach vielen hönischen Reden und raillerien, als Sie eher aufstunden wie die andern, weil Sie sich mußten zu dem bevorstehenden Ballet praepariren, mich mit Seiner schmutzigen Serviette ins Gesichte warff, mit beÿgefürgten wortten : du verfluchtes Gesicht, welches Ich damahls that als wann Ich es nicht gehöret, und dieses en Raillant annoch aufnahm. Hierauff wurde das Ballet getantzet auf dem Großen Theatro, nachdehm die Herrschafft Sich in denen Logen placiret : das gantzen Amphitheatrum war illuminiret, und waren die Logen von oben bis unten mit Zuschauern besetzet, die Persohnen des Ballets, so alle en Bergeres gekleidet waren wie auch als Jägers und Nymphen, waren folgende : die Princessinen von Meinungen, und Hollstein, Meine 2. Töchter, die Fräuleins Fettebrocken, Negendancken, Hermingen und Hapthausen, der Prinz von Plöre, der Prinz August und Christian von Bettern, der Prinz Leopold von Hollstein, Mons : Oppeln, Brion, Veltheim, Gerstorff, Amat und einige Academisten. Nach endigunge des Ballets fing man unter in dem parterre zu tantzen, und waren es fast lauter teütschen täntze.
20 août
und ließe darauff der Hertzog Rudolph August in dem Großen Reit-Hause auf dem Grauen Hofe eine Italienische Comoedie spielen, nemblich Harlequino Simiotto per amore […]
21 août
des Abends wurde wieder der Daniel gespielet.
23 août
an Meinen Cammer-diener François 50 Thlr., 12 Thlr. an Alberti, vor Meine Hautbois zu lernen […] Diesen tag war der sämbtliche Hoff in der Italienischen Comoedie, so war : 1 quattro Harlequini.
– 237 –
Chapitre 4
Tableau 4.7. (suite et fin). 7 oct.
den 7ten October ist des Abends vor dem Eßen eine Teutsche Comoedie, so aus dem franzö: vertiret, und von des Molliere pieces waren, nemblich Le Medicin malgré lui, ein Meines Herrn Vattern Vorgemache, durch die Pagen gespielet worden, nach deren endigunge selbige ein Ballet getantzet, und die vereinigung der beÿden Hollsteinischen Magens, als Plöre und Norburg, nebst der 2. verlogten Geschlungenem Nahmen durch eine helle gläntzende Piramide vorgestellet worden.
9 oct.
den 9ten October, Ist die neue aufgrichtete Granadier-Compagnie blau mit Gelben aufschlägen mondiret und schönen bordierten Granadier-Mützen unter Commando des Schloß-Haubtmans von Bennigsen stehende als Schloß-Guarde zum erstenmahl auf hiesigem Schloße aufgezogen ; Es hat selbige Marche bestanden zu Einem Unter-Officier, und 30 Gemeinen, 1 Tambour, und 1. Querpfeiffer. […] Wie man in die Kirche ging, auch wie man wieder heraus ging, wurde alle Zeit gepaucket, und auf den Trompeten geblasen. […] Nach der Predigt wurde das Te Deum Laudamus unter Trompeter und Paucken-Klang wie auch allen Choral-Instrumenten abgesungen, wobeÿ sich die Stücke umb den Schloß und StadtWall tapfer hören ließen, welche 3. mahl sämbtlich gelößet wurden. […] wurde in dem Großen Saal getantzet, und zwar die Ehren-Täntze alle nach Paucken und Trompeter, die andern aber nach ordinairen Musical=Instrumenten.
11 oct.
den 11. October wurde die Italienische Opera : Il Pastore d’Anfriso auf dem Wolfenbüttelschen Theatro gespielet, und zwischen den Entre-acten tantzeten die Fürstl. Personen die zu Braunschweig das Ballet getantzet hatten auf verstrichener Sommer-Meße etliche Entréen, und tantzete der Braütigam und die Braud auch selbst mit, wie auch etliche von denen Dames und Cavalliers.
13 oct.
beÿ der Tafel ließen sich die Paucken und Trompeten, wie auch Hautbois lustig hören.
1 nov.
den 1ten November Ist dergleichen Assemblée in Meiner Gemahlin Gemächern gewesen, und habe Ich in meinem Vorgemache, allwo ein Tafel von 12. Persohnen angerichtet war, ein Tafel-Musique von der Schloß-Capelle halten laßen.
14 nov.
den 14ten November ist Assamblée in Meiner Gemahlin Gemächern gewesen […]. Beÿ der Tafel hatten wir wieder ein Concert, worbeÿ 2. Trompeter nach der Musique mit bliesen. Hierauff, als das Confect aufgesetzet worden, meldete sich auf einmahl, abgeredetermaßen, Mein Jäger an mit seinem Wald-Horn, welches Er laut erschallen ließ […] Hierauff erschien des Prinz Augusts von Bettern Bande Hautbois ; so alle als bauern verkleidet waren, nebst einen Tambour so als ein Norwegischer Bauer sich praesentirete, welche zweÿmahl umb die Tafel blasend herumb gingen, und den Türckischen march blusen […] reterireten Wir uns wieder in Meiner Gemahlin Gemächer Paar beÿ Paar, Wie Wir an Tafel angangen, und musten vorher die Hautbois und Tambour blasend und spielend uns in die innerste Gemächer wieder convoyiren.
24 déc.
des Abends ist à l’ordinaire die Schloß-Capelle gantz illuminiret gewesen, und haben Sie nebst der Gewöhnlichen Vesper eine schöne Musique in der Cappelle gehalten. Madme d’Usson [femme de l’ambassadeur français à Wolfenbüttel] so den Tag vorhero angekommen war, hat diesen Abend Ihre erste Audienz beÿ Frau Mutter gehabt, und hat nebst ihrem Manne an der Tafel geseßen beÿ Herr Watter und Frau Mutter ; die Tafel war angerichtet in Frau Mutter Ihrem ordinairen Gemach und saß mein bruder, Seine Gemahlin, Meine Gemahlin, und Ich, auch mit an derselbigen, beÿ wehrender Tafel wurde von einer französin Mariane genant, so die Madme d’Usson mit aus Frankreich gebracht, eine Musique gemachet, und spielete sie auf einer sogenanten Viole d’Amour überaus wohl, und sang auch darbeÿ etliche französ. Lieder.
25 déc.
[chez Mr d’Usson] und beÿ der Tafel ließ sich die Mariane wieder hören, nebst einen österreicher, so auf der lauten überaus wohl spielete, welchen der Graff Rappach alhier zurücke gelaßen.
27 déc.
Des Mittages hatte Mein Herr Vatter, Mein Bruder, Seine Gemahlin, Ich und Meine Gemahlin, nebst Meiner ältesten Tochter, und dem Ältesten Prinzen von Bettern, hoffmeister Post, und CammerPraesident Imhoff beÿ d’Usson geßen [sic], und wurde beÿ der Tafel wieder von der französin musiciret. Hatt mich also der Aller-Gütigste Gott dieses 1701ten Jahres Ende Glücklich und gesund erleben laßen, welchem da vor Ewig Danck gesaget seÿ, wie auch vor aller Leibes und Seelen Wohltarten, die Er nicht so aohl mir, als Maeinen Verwandten, als Erltern, Schwestern, Bruder, Frau und Kinder, sonderauch vor diejenigen unzählig-vielen Wohltaten, so Er dem Gantzen Menschlichen Geschlecht an Seel und Leib dieses Jahr über verliehen ; Gott helffe, daß ein jedes Sterblicher also möge gelebet haben, daß er dermahl eins über kurtz oder Land, oder schon die ewige Seeligkeit erlangen, oder haben mögen, udn daß die annoch Irrende viele Schäflein, als Heÿden, Türcken, und Juden, wie auch die Geistlich-verwirreten alle mögen in künfftigen Zeiten zur Herrde Christi kommen, und mit den Glaubigen Kinders Gottes ererben das Ewige Leben.
– 238 –
La dissémination de la musique
son opéra Salomon est créé au début de la foire d’hiver le 7 février 1701 et repris trois fois en août de la même année ; l’oratorio Daniel est créé le 15 août, avant d’être repris le 21 du même mois ; sa fable en musique Endimione, créée à l’été 1700 au château de Salzdahlum, résidence d’été des ducs de Wolfenbüttel, est reprise deux fois en 1701. On notera également l’importance de Carlo Francesco Pollarolo, dont trois œuvres sont executées en 1701. Enfin, l’opéra Il figlio delle Selve d’Alessandro Scarlatti est donné à Wolfenbüttel le 27 juin 1701. Mais c’est n’est pas seulement à travers les notations quotidiennes de son journal que la musique est présente dans la vie et la mémoire de Ludwig Rudolf : son livre de chant nous permet aussi d’entrevoir la place occupée par la musique française dans les pratiques musicales domestiques de l’aristocratie allemande.188 Ce petit cahier de format oblong, relié dans une couverture de cuir assez abîmée, est presque entièrement (à l’exception des cinq derniers numéros) écrit par le même copiste qui pourrait bien être Ludwig Rudolf. Mais avant d’aborder le contenu musical proprement dit de cette compilation d’airs manuscrits, nous chercherons à la replacer dans son contexte culturel, intellectuel et social, afin de pouvoir mieux en comprendre, dans un second temps, les enjeux proprement musicaux. L’une des caractéristiques les plus frappantes de ce livre de musique, lorsqu’on l’ouvre, est l’annotation liminaire qui figure sur la première page de couverture : Tout cede au tems, mai La Vertu | resiste. Louis Rodolfe | D[uc] de Br[unswick] et L[unebourg] | Wolfenbüttel ce | 6: Ottob[re] 1705
Cette maxime en forme de sentence morale, accompagnée d’une datation et rédigée en français, permet à notre avis de pointer l’une des caractéristiques essentielles de ce livre de chant : loin d’être une simple anthologie pour l’exécution, il semble bien être – à la manière d’un journal, d’une compilation d’extraits ou d’un recueil de lieux communs – à la fois le support écrit d’une pratique quotidienne et le moyen de fixer la mémoire des choses entendues. Un petit détour par les productions manuscrites de Ludwig Rudolf apparaît nécessaire pour préciser ce que nous entendons par là. Un trait particulièrement saillant de sa personnalité est en effet son activité de compilateur polygraphe, qui semble se répercuter sur tous les plans de sa vie intellectuelle et spirituelle. Son journal, ainsi que nous l’avons vu, peut être lu comme la compilation – ou encore le recueil au sens littéral du mot – des petits évènements quotidiens compris comme effets de la grâce divine et objets privilégiés de la conscience individuelle qui se forme et se ressaisit dans un travail quotidien d’écriture. Mais l’activité compilatoire du duc de Wolfenbüttel ne s’arrête pas là: on trouve, parmi les manuscrits du fonds de Blankenburg, une quantité tout à fait impressionnante de recueils de citations ou notes de lecture rédigées par le duc au cours de ses loisirs.189 Un seul exemple d’une telle activité suffira ici. Le manuscrit 26 du fonds Blankenburg rassemble des notes de lecture tirées de l’Histoire des Juifs de Flavius Joseph ainsi que plusieurs citations en latin extraites d’un ouvrage de Middendorf, copiées entre 1702 et 1705.190 Le recueil, entièrement de la main de Ludwig Rudolf, signale soigneusement la date de début et la date de fin de lecture de chacun des ouvrages et reporte après chaque citation, le numéro de la page, du chapitre et du livre d’où elle est tirée. La plupart des citations sont des notes factuelles, ou bien au contraire des sentences morales gnomiques. Ludwig Rudolf s’inscrivait donc ici dans une tradition séculaire, celle du recueil de lieux communs, cahier de citations situé au confluent des pratiques de lecture, d’écriture et d’édification personnelle.191 188 189 190 191
D-W, Cod. Guelf. 266 Mus. Hdschr. Hans Butzmann, Die Blankenburger Handschriften, Francfort 1966. D-W, Cod. Guelf. 26 Blankenburg : Eigenhändige Excerpte Ludwigs Rudolfs 1702-1705. Les extraits de Flavius Joseph son issue d’une édition parisienne de 1677 : Histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph sous le titre d’Antiquités judaïques, trad. fr. Robert Arnaud d’Andilly, Paris 1677. Par exemple D-W, Cod. Guelf. 26 Blankenburg, p. 2 (« La veritable valeur consiste à surmonter les plus grands obstacles, et à ne pas craindre de s’exposer à la mort pour acquerir une reputation immortelle ») et p. 59 (« Fin de L’histoire des Juifs […] à Wolfenb. Le 3. Avril 1705 après ayant commencé à en excerpter le 15. juin 1702 »).
– 239 –
Chapitre 4
Le recueil est en outre ouvert par le même dispositif liminaire que le livre de musique, faisant figurer côte à côte une maxime morale rédigée en français, ayant sans doute pour fonction de placer le travail quotidien dans un contexte de dévotion personnelle, le nom du scripteur et une date : Tout avec Dieu, et rien sans | Luy. | Louis Rodolfe. D[uc]. de | B[runswick]. et L[unebourg]. | Wolfenbüttel | ce 26.me Fevrier. | 1705.
On voit bien où nous voulons en venir : si le livre de chant de Ludwig Rudolf est un recueil d’airs copié à des fins de divertissement pour un usage domestique immédiat, il est aussi solidaire d’une pratique quotidienne de compilation qui ne se limite pas à la sphère de la musique, ni même à la sphère de l’écrit. De ce point de vue, on pourrait considérer le livre de musique comme une forme particulière de recueil de lieux communs, où le choix des morceaux s’appuie non seulement sur le goût et les capacités musicales de son utilisateur, mais aussi sur une expérience individuelle d’auditeur ou de lecteur, peut-être aussi sur leur contenu textuel et les valeurs morales dont ils sont investis. Le livre de musique peut donc être lu comme la constitution d’une mémoire musicale individuelle, constituée jour après jour par le scripteur, ou le commanditaire si le duc n’est pas lui-même le copiste du livre. Dans cette perspective, la question de la datation du recueil et celle de la durée pendant laquelle il a été copié sont essentielles. La datation liminaire de 1705 peut avoir été reportée au début du processus de compilation, alors que le livre était encore vierge, ou au contraire comme touche finale après la copie. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’écriture pouvait s’étaler sur un temps très long : à titre de comparaison, la compilation des extraits de Flavius Joseph s’est étendue sur presque trois ans, de juin 1702 à avril 1705, et la maxime initiale datée du 26 février 1705 a donc été introduite au milieu de la compilation du volume. La rédaction du livre de chant de Ludwig Rudolf semble aussi s’être étalée sur un grand laps de temps, puisque les portées ont été tracées en six strates successives avec de nombreux changements de plume : le papier a été réglé avec la même patte jusqu’au folio 18 inclus, puis l’on passe à une règle plus serrée qui permet de tracer huit portées par page jusqu’au folio 20, puis une autre règle jusqu’au folio 30, avant de revenir à une règle plus large de six portées par page du folio 31 jusqu’à la fin du volume, avec encore quelques changements de patte à régler. Tous ces changements correspondent à des changements de pièce, et dans le dernier cas aussi à un changement de copiste. On peut supposer que les différentes strates temporelles de la copie du recueil pourraient dans ce cas être marquées par les changements de patte à régler. Le contenu musical de ce livre à chanter a été identifié par Hansjörg Drauschke.192 Il est très hétéroclite, tant sur le plan linguistique que sur le plan des genres musicaux représentés et de la provenance de la musique recopiée. La musique française se trouve ici environnée d’œuvres de provenances diverses, mais l’architecture du recueil reste sous-tendue par la coexistence de trois grands ensembles linguistiques : la musique française, la musique italienne et la musique allemande. Il s’agit d’une compilation d’airs pour voix de basse et basse continue, avec quelques airs pour voix d’alto et basse continue, et quelques duos avec basse. De nombreux airs sont en outre accompagnés par deux violons (Tableau 4.8). L’exécution de certaines œuvres identifiées peut être documentée grâce aux fragments du journal de Ludwig Rudolf : leur présence est donc liée au contexte immédiat de rédaction de ce livre. Rashid Pegah parvient à documenter l’exécution d’extraits de l’Europe galante de Campra les 6 et 15 septembre 1707 à Wolfenbüttel par une troupe de comédiens français.193 Peut-être ces représentations ont-elles guidé le choix de l’extrait présent dans le livre de musique (en 4e position), mais le volume semblerait avoir été commencé bien plus tôt. La présence de nombreux ex192 193
Hansjörg Drauschke, « Einleitung », in : Rugiero Fedeli, Almira, Beeskow 2011. Pegah, « Und abends war opera », p. 184.
– 240 –
La dissémination de la musique
Tableau 4.8. Contenu musical du livre de chant du duc de Wolfenbüttel Ludwig Rudolf von BraunschweigWolfenbüttel. D-W, Cod. Guelf. 266 Mus. Hdschr. Nr
Fol.
Incipit textuel (voix)
Identification
1
3r-5r
Que vois-je? C’est Issé (B)
Destouches, Issé, IV.3
2
5r
Agréables témoins de mon bonheur (B)
Berthet
3
6r-7r
Malheureux mortel (B)
Ribon
4
7r-8v
Que notre ardeur soit éternelle (B)
Campra, Europe galante, III.3
5
8v-10v
Leggi, ch’io mi parto (B)
Fedeli, Almira, I.4
6
11r-13v
Leggi, ch’io mi parto (B)
Fedeli, Almira I.9
7
14r-15v
Sostegno del regno (B)
Fedeli, Almira III.3
8
15v-18r
Malaccorta gioventù (B)
Fedeli, Almira III.10
9
18r-20v
Mia fède stabile non cangero (B)
Fedeli, Almira II.9
10
21r-22v
Svenero chi fa guerra (B)
Fedeli, Almira II.14
11
23r-23v
Corona, scettro e soglio (B)
Fedeli, Almira II.8
12
23v-24v
Tutti tese amor (B)
—
13
25r-v
Vergnügter Zeitvertreib (B)
Schürmann, Salomon I.1
14
26r-v
15
26v-27r
Saget, Schöne, darf ich hoffen (B)
Schürmann, Salomon I.10
Ti do il core ma io ripiglio (B)
—
16
27v
Nun schlägt des Unglücks Sturm und Wetter (B)
Schürmann, Salomon II.21
17 18
28r-30v
Men Unglück ist von Gott beschlossen (B)
Schürmann, Salomon III.16
28r-30v
Ja, ja, nur Eitelkeit sind alle Ding’ auf Erden (B)
Schürmann, Salomon III.21
19
28r-30v
Chi già non crede amor (B)
—
20
28r-30v
Vorrei farmi intendere (B)
—
21
31r-33v
Lieben und geliebet werden (A)
Keiser, Psyche II.7
22
34r-36r
Meine Glieder gehen ins Grab (B)
Keiser, Psyche I.7
23
36r-37r
S’ho lasciata la ritrosa (B)
—
24
37v-38v
Nodo stringete ch’al sen v’allaci (B)
—
25
39r-40v
Sommo Giove (S, B)
—
26
40v-41v
Cessi il pianto e sorga il riso (B)
—
27
41v-42v
Antri ciechi boschi e frondi (B)
—
28
43r-50r
Sangaride, ce jour est un grand jour (S, B)
Lully, Atys I.6
29
50v-51r
Quanto dolci, quando care (A)
Bononcini, Semiramide I.8
30
51v-52v
Prenditi quest’amplesso (A)
Bononcini, Semiramide I.2
31
52v-53v
Se ben regnante (A)
Bononcini, Semiramide III.3
32
54r-v
Un petit air à boire (B)
—
33
55r-56v
O charmante bouteille (S, B)
Dupin
34
56v-58v
Ami c’est grand dommage (S, B)
Dupin
35
58r-59r
En vous disant adieu (B)
—
36
59v-60v
Depuis que vous trompez esperance (B)
—
37
60v-61v
Ah c’en est fait mon cœur (B)
—
38
61v-63r
Êtes vous satisfait (B)
—
Rochers vous estes (B)
Michel Lambert
Ces vœux que tu faisais (B)
—
39
63v-64r
39b
64v
40
65r-67r
Cessez mes yeux (B)
Campra, Tancrède III.2
41
67v-68r
N’endormes que les cœurs accables (B)
—
42
68v-70r
Mes yeux ne pouvez vous jamais forcer (B)
—
– 241 –
Chapitre 4
Nr
Fol.
43
70r-71r
Incipit textuel (voix)
Identification
Que chacun à son gré (B)
—
44
71r-72r
Que du buisson dorme (B, B)
—
45
72v-73v
Conosco che sei bella (A)
—
46
73v-75r
Tornero mia cara stella (A)
—
47
75v-79r
Amorosa Violetta (A)
Pistocchi, Scherzi musicali
48
79v-80v
Se Amor ti dice che ne suoi strali (A)
—
49
81r-82r
Si scherzate luci adirate (A)
—
50
82v84v
Si quei bella (A)
—
traits de l’opéra Salomon de Georg Caspar Schürmann, que Ludwig Rudolf a entendu à plusieurs reprises à Braunschweig en août 1701, semble également liée au contexte immédiat. Notons enfin que l’Almira de Fedeli a été composée pour l’opéra de Braunschweig aux alentours de 1700,194 et que la Psyche de Keiser avait aussi été représentée à Braunschweig le 26 octobre 1701. Le manuscrit s’ouvre par une série de quatre airs français, issus aussi bien du grand répertoire lyrique de l’Académie royale de musique de Paris que de recueils d’airs de différents auteurs. Deux extraits restés anonymes (n° 2 et 3) peuvent être identifiés : le deuxième numéro est un air issu du trente-sixième Livre d’airs de différents autheurs publié en 1693 par Ballard. Il s’agit d’un air attribué à un certain Berthet.195 Alors que l’air publié par Ballard est en sol mineur pour voix de dessus, la copie de Ludwig Rudolf est en la mineur pour voix de basse. L’air pour basse qui figure en troisième position peut être retrouvé dans un recueil de Parodies bachiques de Ribon réédité par Christophe Ballard en 1696.196 Il s’agit d’une parodie d’un extrait du second acte de Phaeton de Lully lwv 61/37, originellement écrit pour voix de dessus mais transposé pour voix de basse par Ludwig Rudolf. Les extraits d’œuvres plus célèbres, issues du répertoire de l’Académie royale de musique de Paris, présentent aussi des différences textuelles importantes avec les éditions originales. Ceci pourrait indiquer que le livre de chant de Ludwig Rudolf n’est pas tant le reflet d’une circulation des imprimés qu’une sorte de photographie instantanée de la circulation de musique sous forme manuscrite à Wolfenbüttel entre 1700 et 1705. Le premier extrait de Destouches ne peut pas être tiré de l’édition originale de l’œuvre (Ballard 1697) car celle-ci ne possède que trois actes. L’édition Ballard de 1708, qui ajoute les actes IV et V par rapport à la première édition, pourrait être la source de la copie, mais c’est sans doute un peu trop tardif et de nombreuses différences substistent entre le texte musical de l’édition de 1708 et la copie réalisée pour Ludwig Rudolf. Le même constat vaut pour le duo de Campra tiré de L’Europe galante : celui-ci ne fait son apparition que dans l’édition Ballard de 1724.197 Là encore, la source imprimée paraît trop tardive pour avoir servi de modèle à la copie manuscrite. Enfin, un dernier exemple intéressant de modification par rapport à l’original est l’exemple de la scène 6 de l’acte I d’Atys de Lully (lwv 53/30-33). Ici, l’extrait est transposé en mi mineur, soit une quinte au-dessus de la version présentée dans l’édition originale. Cette transposition mise à part, les variantes sont minimes. La longueur de la copie (43 systèmes en tout) fait de cet extrait l’un des plus longs du livre. Ceci montre bien que la musique française, bien que quantitativement moins importante que la musique italienne ou allemande, avait cependant toute sa place dans les pratiques musicales quotidiennes de Ludwig Rudolf.
194 195 196 197
Drauschke, « Einleitung », p. vi. F-Pn, Rés. Vm7 282 (28), p. 22. F-Pn, 4 Vm7 1964, p. 164. Le duo ne se trouve pas dans l’édition originale de 1697, ni dans celle de 1698 (Christophe Ballard, seconde édition augmentée en 4 entrées et prologue), ni dans celle de 1699 (Christophe Ballard, troisième édition), ni dans celle de 1699 (Le Cène, quatrième édition).
– 242 –
La dissémination de la musique
Une pratique partagée D’autres livres de musique de la même époque figurent dans la bibliothèque de Wolfenbüttel : une partie séparée pour violon, qui rassemble plusieurs pièces françaises, ainsi qu’un livre de guitarre font apparaître des marques de possession de Christine Louise.198 Notons également la présence d’une partie séparée de violon datant des années 1690-1700, ayant appartenu au duc Ferdinand Albrecht, frère du duc Anton Ulrich, qui rassemble avec de nombreuses autres pièces des extraits de Lully.199 On trouve enfin une épaisse compilation manuscrite d’airs et de ritournelles extraits de seize opéras de Lully, qui semble avoir été réalisée par un copiste français et ne comporte aucune marque de possession.200 Ces manuscrits peuvent être rapprochés d’autres sources témoignant de l’intégration du répertoire français dans les pratiques musicales privées de la haute aristocratie d’Allemagne du Nord. Au premier rang figurent deux livres de clavier en provenance de la cour de Hanovre : le livre de clavecin de la princesse Amalia von BraunschweigLüneburg, ainsi qu’un autre livre de clavier, désormais perdu, ayant appartenu à Ernst August de Hanovre, et qui contenait des pièces de Jean-Henry d’Anglebert, Nicolas-Antoine Lebègue et Jacques Champion de Chambonnières.201 Le Livre de son altesse Serenissime Madame La princesse amalie de Brunsvic et Lunebourg contient, sur un total de quarante-quatre pièces, une dizaine d’extraits d’opéras de Lully et Collasse adaptés pour le clavier. Il comprend également une pièce de Chambonnières, et une pièce intitulée « Rigodons de Mr Favier » dont on retrouve à Wolfenbüttel une version monodique dans le livre de contredanse d’Ernst August Jayme.202 Ce livre semble avoir été un objet d’usage quotidien, progressivement rempli par les deux bouts : dans le sens normal, et dans le sens inverse, en retournant le livre et en l’ouvrant en commençant par la dernière page de couverture. Six copistes différents sont représentés, dont la princesse, ce qui supposer que le livre a été complété peu à peu pendant une longue période. Cet objet fétiche semble avoir accompagné Amalia tout au long de sa vie pourtant riche en périgrinations et en déménagements. Comme le montre le papier, la rédaction du livre a été commencée à Paris, où Benedicta Henriette von der Pfalz – mère d’Amalia et veuve du duc Johann Friedrich de Hanovre – s’était installée après la mort de son mari et l’installation d’Ernst August dans le duché de Hanovre.203 Benedicta Henriette et ses enfants demeurèrent dans la capitale française de 1680 à 1693, date de leur retour en Allemagne. C’est donc à Paris que furent copiées les douze premières pièces du livre, qui comprennent sept transcriptions de Lully et une pièce de Chambonnières. Après son retour à Hanovre, Amalia continua à compléter son anthologie, comme le montre l’intitulé de quelques pièces : « le prince gorge », « menuet De l’opera d’Hanover », ou encore les « rigodons de mr favier ». Enfin, la princesse prit ce livre avec elle lors de son mariage avec Joseph de Habsbourg en 1699, à Vienne où ce livre est toujours conservé. Nous avons donc là un autre beau témoignage de la place de la musique française dans les pratiques musicales domestiques les plus intimes de la haute aristocratie d’Empire. Ce livre est non seulement un support pour une pratique personnelle du clavier, mais il acquiert par son histoire une épaisseur existentielle qui le transforme, ainsi que le dit très justement Leisinger, en « objet de mémoire 204 ». 198 199 200 201 202 203
D-W, Cod. Guelf. 296 Mus. Hdschr. et Cod. Guelf. 302 Mus. Hdschr. Pour plus de détails sur ce second manuscrit : Rüdiger Thomsen-Fürst, Gitarrentabulatur der Herzogin Christine Luise (1671-1747), Michaelstein 1993. D-W, Cod. Guelf. 295 Mus. Hdschr. La page de titre porte la notation suivante : « Ferdinand Albrecht H[erzog]. Z[u]. B[raunschweig]. & L[üneburg]. d[en]. 9. Novembr. 1697 ». D-W, Cod. Guelf. 151 Mus. Hdschr. Sur le premier, voir Ulrich Leisinger, « Das Klavierbüchlein der Prinzessin Amalia von Braunschweig-Lüneburg », Jahrbuch der Ständigen Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, 2000, p. 169-178. Sur le livre perdu d’Ernest August, voir Abbetmeyer, Zur Geschichte der Musik am Hofe in Hannover, p. 30-31. D-W, Cod. Guelf. 244 Blankenburg. Leisinger, « Das Klavierbüchlein », p. 176-177. La provenance française du papier réglé imprimé sur lequel est écrit le livre, vraisemblablement vendu par la maison Ballard, peut être confirmée grâce à l’article de Laurent Guillo, « Les papiers à musique imprimés en France au xviie siècle. Un nouveau critère d’analyse des manuscrits musicaux », Revue de Musicologie, 87/2, 2001, p. 307-369.
– 243 –
Chapitre 4
Cette pratique féminine n’était cependant pas entièrement nouvelle dans la famille. Dès 1633, la princesse Sophie Elisabeth zu Mecklenburg avait commencé la rédaction d’un livre d’airs français à Güstrow.205 La livre se compose d’un choix d’airs parus dans les cinq premiers volumes de la collection des Airs de différents autheurs éditée à partir de 1607 par Gabriel Bataille. Le livre se trouve aujourd’hui dans les collections de Wolfenbüttel, où il fut apporté depuis Güstrow par Sophie Elisabeth lors de son mariage avec le duc August en 1635. Les cinq premiers volumes imprimés de Bataille se trouvent aussi, reliés ensemble, dans les collections de Wolfenbüttel.206 L’étude détaillée de ce cahier a déjà été entreprise par Karl Wilhelm Geck.207 Particulièrement remarquable est le remplacement des tablatures de luth de l’édition originale par une portée de basse continue non chiffrée, dont la mélodie est parfois corrigée et améliorée par Sophie. Quelques airs ne sont pas présents dans la collection éditée par Bataille, et pourraient donc avoir été composés par Sophie Elisabeth elle-même. Mais là encore, cet intérêt pour la musique française prend place dans une constellation plus large, où la littérature française occupe une place de choix : Sophie Elisabeth a ainsi traduit l’Astrée d’Honoré d’Urfé dans un manuscrit appelé Dorinde. Sa participation à deux sociétés savantes féminines, la Noble Académie des Loyales et la Tugendliche Gesellschaft, est également à noter. Lorsqu’elle entama la copie de son livre de musique le 1er octobre 1633 à Güstrow, sa mère Elisabeth était justement en train de terminer la traduction en allemand des dix-huit règles de l’Académie des Nobles Loyales, originalement rédigées en français.208 On note d’ailleurs que deux airs ont été copiés dans le livre par Elisabeth elle-même.209 Cela semble indiquer que ces académies ont pu offrir un contexte d’exécution possible pour ces airs de cour, qui étaient souvent chantés dans une sphère semi-privée, en société réduite, parfois même dans les ruelles, le petit espace entre le mur et le lit.210 Notons pour finir que, comme Ludwig Rudolf soixante-dix ans plus tard, Sophie Elisabeth place en exergue de son livre un « memento mori » sur la page de couverture. Et en effet, ces petits airs de cour sont bien une peinture de vanité – la fugacité d’un moment de sociabilité qui réfléchit en miniature, jusque dans sa perfection musicale et rhétorique, la brièveté et le caractère éphémère de la vie, encapsulé dans quelques minutes de musique.
204 205 206 207 208 209 210
Leisinger, « Das Klavierbüchlein », p. 178 : « Amalia hat das Klavierbuch als persönliches Erinnerungsstück bei ihrer Eheschließung mitgenommen. » D-W, Cod. Guelf. 52 Noviss. 8°. D-W, 1.1a Musica. Karl Wilhelm Geck, Sophie Elisabeth Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg (1613-1676) als Musikerin, Saarbrücken 1992, p. 99-100. Gabriele Ball, « Das Netzwerk der Herzogin Sophia Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel », Schütz-Jahrbuch, 34, 2012, p. 29-48. D-W, Cod. Guelf. 52 Noviss. 8°, Bl. 11-13. Voir notamment Anne-Madeleine Goulet, Poésie, musique et sociabilité au xviie siècle. Les « Livres d’airs de différents auteurs publiés chez Ballard de 1658 à 1694, Paris 2004.
– 244 –
Chapitre 5. L’invention allemande du style français •
La musique française est-elle soluble dans l’ouverture ? Si l’on parle de la musique produite en France, la réponse est certainement négative. Mais si l’on parle du concept de « musique française » inventé dans l’espace germanophone autour de 1700, alors la question prend un tour différent. En effet, l’éloge le plus appuyé du style français sous la plume de Johann Mattheson porte précisément sur l’ouverture, présentée comme étendard et tête de pont de l’ensemble de la production musicale française : Que les Italiens pavanent et paradent tant qu’ils veulent avec leurs voix et leurs artifices, mais qu’ils soient mis au défi de me composer une bonne ouverture à la française, ou même seulement de l’exécuter comme il faut. Cela prouve que la musique instrumentale des Français possède généralement un avantage très particulier. Les Italiens peuvent se donner tout le mal du monde avec leurs symphonies et leurs concerts, qui sont d’ailleurs aussi très beaux, il faut bien leur préférer une bonne ouverture à la française bien fraîche. Car, au-delà de la composition d’une telle Pièce avec sa Suite à la Françoise, c’est l’exécution spécifique que les Français lui donnent, si admirable, si unie et si ferme que rien ne peut la surpasser.1
Figure incontournable dans l’invention allemande du style français, le théoricien plaçait donc dès 1713 l’ouverture au-dessus de tous les autres genres instrumentaux, rassemblant en une seule opposition la question de l’origine de la musique (italienne vs française), celle des genres musicaux (l’ouverture et sa suite vs les symphonies et concerts) et celle de l’exécution (virtuosité vocale des Italiens vs exécution admirable des instrumentistes français). Cette triple superposition marquait l’aboutissement d’une évolution qui, dans le monde germanique et en Europe, avait contribué à réduire l’ensemble de la musique française au genre de l’ouverture et de sa suite. Ce processus peut être appréhendé comme une stylisation de la musique française au double sens du terme : celle-ci n’est plus simplement un répertoire musical identifié par sa provenance, mais se transforme en catégorie esthétique, en « goût » ou « style ». Du même coup, ses caractéristiques sont soumises à une forme de simplification voire de schématisation, et le foisonnement générique de la production musicale française entre 1660 et 1730 semble presque complètement ignoré par le discours théorique d’outre-Rhin : ailleurs, Mattheson ne cache pas le peu de cas qu’il fait de la musique d’église française.2
1
2
Johann Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, Hambourg 1713, p. 225-226 : « Es mögen nun aber die Italiäner mit ihren Stimmen und Künsten prahlen und prangen wie sie immer wollen, Trotz sey ihnen geboten, daß sie mir eine rechte Frantzösische Ouverture machen, oder auch einmahl, wie sichs gebühret, herausbringen solten. Daß wil so viel sagen, daß generalement die Instrumental-Music der Frantzosen recht was sonderlichs voraus habe. Ob sie auch gleich die Italiäner die größte Mühe von der Welt mit ihren Symphonien und Concerten geben, welche auch gewiß überaus schön sind, so ist doch wol eine frische Frantzösische Ouverture ihnen allen zu praeferiren. Denn, nechst der Composition einer solchen Pieçe mit ihrer Suite à la Francoise, ist die Execution in ihrem Genere, welche die Frantzosen derselbigen geben, so admirable, so unie und so ferme, daß nichts darüber seyn kan. » Johann Mattheson, Das Beschützte Orchestre, Hambourg 1717, p. 221. Mattheson, Der Vollkommene Kapellmeister, p. 223.
– 245 –
Chapitre 5
La transformation des traditions musicales européennes en autant de styles nationaux ne repose donc pas seulement sur l’identification et l’exégèse de différentes manières de composer, mais sur l’élaboration de nouvelles catégories esthétiques adossées à des genres instrumentaux clairement identifiables. Mattheson n’introduit d’ailleurs la fameuse typologie qui distingue les Italiens, les Français, les Allemands et les Anglais que dans la troisième partie de son traité, intitulée « Pars judicatoria, ou comment juger de différentes choses dans la musique ».3 Les styles nationaux servent donc d’abord à étayer le jugement de goût : c’est pour affiner son discernement et apprécier correctement la musique qu’il faut se familiariser avec leurs différences. Dans cette perspective, la composition n’est pas le seul paramètre décisif. La manière d’exécuter la musique est aussi primordiale et doit être considérée à sa juste valeur : Celui qui veut se former un jugement sain, universel et sans préjugé sur la musique italienne, française, anglaise et allemande d’aujourd’hui, ne doit pas confondre entre elles la composition et l’exécution de ces musiques nationales (si je puis m’exprimer ainsi), mais au contraire les distinguer de manière nécessaire et très précise ; car sinon il risque de porter aux nues une pièce bien exécutée, même si sa composition est médiocre, ou au contraire de mépriser complètement une composition admirable, si elle a le malheur d’être mal exécutée.4
L’art de composer et la manière de jouer sont deux axiomes fondamentaux du style français : ils doivent être soigneusement distingués et informer tout jugement de goût en ces matières. L’invention allemande du style français repose donc sur la combinaison de trois éléments : une composante poétique, qui se concentre sur les procédures de composition à la française à travers le modèle de l’ouverture, une composante pragmatique qui se penche sur les pratiques d’exécution de cette musique, et une composant esthétique qui vise à polir et à enrichir l’appréciation de la musique par l’auditeur. Retracer l’invention allemande du style français suppose donc de combiner deux approches, l’une pratique, compositionnelle et performative, et l’autre esthétique. Les stratégies d’apprentissage, d’imitation et d’adaptation du style français par des compositeurs allemands seront au cœur de la première partie : il s’agit de se mettre à la recherche d’une « méthode française » de composer dont la pierre de touche est l’ouverture. Cela implique de se pencher sur les techniques d’imitation et d’apprentissage qui sont au cœur de la formation des compositeurs : comment les modèles sont-ils sélectionnés, compilés et imités ? Comment acquiert-on l’art de composer des ouvertures et des suites à la française ? On se penchera ensuite, à travers le prisme de la cantate luthérienne, sur les expériences d’adaptation et d’hybridation de l’ouverture à française chez Bach et Telemann. Passant enfin à une échelle plus microscopique, on tentera de repérer les marqueurs du style français en-deçà des catégories génériques, dans le concret des pratiques de composition et la chair de la musique. La deuxième partie sera consacrée aux controverses sur la musique française qui rythment la vie musicale allemande entre 1700 et 1730. La querelle qui oppose Mattheson et Buttstett entre 1713 et 1717 marque l’émergence d’un débat public sur la musique française, polarisé par les valeurs de la galanterie et de la modernité. Une dizaine d’années plus tard, alors que plusieurs œuvres lyriques françaises sont reprises à Hambourg sous l’impulsion de Telemann et Kunzen autour de 1725, une seconde étape est franchie : l’émergence de la presse et l’apparition d’un espace critique dans les méta-prologues hambourgeois servent de porte-parole aux premières attaques contre la galanterie, inaugurant une mise en crise de la musique française par le biais de 3 4
Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 200-231. Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 200 : « Wer von der heutigen Italiänischen, Frantzösischen, Englischen und Teutschen Music ein generales, von allen Praejudiciis gesaubertes, und gesundes Urtheil fallen will, der muß die Composition und Execution solcher National-Music (wenn ich also reden darff) nicht mit einander confundiren, sondern nothwendig und sehr genau distinguiren ; denn sonst wird er ein wol executirtes Stück, wenn gleich die Composition mittelmäßig ist, biß am Himmel erheben, und hingegen eine vortreffliche Composition, wenn dieselbe das Unglück hat, schlecht executiret zu werden, gäntzlich verachten. »
– 246 –
L'invention allemande du style français
l’opéra. Cette évolution est définitivement entérinée dix ans après, au milieu des années 1730 : à travers un spectaculaire renversement des alliances, la musique française se trouve critiquée par les tenants d’un style musical naturel et cosmopolite par le biais de l’opéra. Elle bascule donc définitivement du côté des anti-Lumières et du conservatisme musical incarné par Johann Sebastian Bach ou Friedrich Wilhelm Marpurg qui continuent, contre Johann Scheibe et Johann Philipp Agricola, à cultiver le répertoire pour clavier et la musique religieuse d’origine française.
« Nach Französischer Art » : composer à la française Si l’ouverture fournit le véhicule et le catalyseur de l’invention allemande du style français, c’est le concerto qui assume un rôle équivalent pour la musique italienne. Quantz établit d’ailleurs un strict parallélisme entre l’évolution des deux genres : l’ouverture « doit son origine » aux Français mais fut rapidement adoptée par « quelques Compositeurs Allemands », ce qui fait que « les François essuyent presque le même sort par rapport à leurs ouvertures, que les Italiens par rapport à leur Concerto.5 » Ceci n’impliquait cependant pas une stricte égalité entre les deux genres. Même si l’engouement immédiat créé en 1712 par la publication de L’Estro armonico de Vivaldi par Roger à Amsterdam fit que le concerto se répandit comme une traînée de poudre dans toute l’Europe du Nord, une subtile différence de statut le séparait de l’ouverture au sein de la hiérarchie des genres. Laurence Dreyfus a parfaitement montré que dans certains milieux, le concerto fut rapidement déconsidéré comme un genre un peu commun, trop standardisé, voire carrément dilettante, que même les compositeurs les moins doués pouvaient pasticher facilement en appliquant quelques recettes éprouvées.6 Telemann témoigne ainsi de sa secrète aversion pour le genre du concerto lorsqu’il le découvrit pour la première fois : Comme la variété distrait, je me mis aussi à l’étude des concertos. Mais je dois avouer qu’ils n’ont jamais vraiment conquis mon cœur, même si j’en ai composé un certain nombre à propos desquels on pourrait écrire, cependant : « À défaut d’inspiration naturelle, que l’indignation inspire des vers quelconques » (Juvénal, Sat. 1). Au moins est-il vrai que la plupart respirent la France. Je ne sais pas si c’est la nature qui me fait défaut ici, tous ne pouvant pas tout faire, mais cela pourrait s’expliquer par le fait que presque tous les concertos qui me tombèrent sous la main comportaient beaucoup de passages difficiles et de sauts tortueux, mais bien peu d’harmonie et une mélodie encore pire. Je détestais les premiers car ils étaient inconfortables à ma main et à mon archet, et quant à l’indigence de ces dernières qualités auxquelles mon oreille avait été accoutumée par les musiques françaises, je ne pouvais l’aimer ni ne voulais l’imiter.7
Ce statut privilégié, l’ouverture et la suite à la française l’avaient acquis dès les années 1680, comme en témoignent notamment une série de publications qui cherchaient à promouvoir l’appropriation des pratiques orchestrales et du style français dans l’espace germanique. Les auteurs 5
6 7
Jean Joachim Quantz, Essai d’une méthode pour apprendre à jouer de la flute traversière, avec plusieurs remarques pour servir au bon goût dans la musique, Berlin 1752, p. 304 : « Elle doit son origine aux François. Lulli en a donné de bons modeles ; mais quelques Compositeurs Allemands, & surtout Haendel & Telemann, l’ont surpassé de beaucoup. Les François essuyent presque le même sort par rapport à leurs ouvertures, que les Italiens par rapport à leur Concerto. Il est seulement à regretter, que les Ouvertures, faisant un si bon effet, ne soyent plus à la mode en Allemagne. » Laurence Dreyfus, Bach and the Patterns of Invention, Cambridge 1996, p. 45-52. La première autobiographie de Telemann est publiée par Johann Mattheson, Grosse General-Baß-Schule, Hambourg 1731, p. 176 : « Alldieweil aber die Veränderung belustiget, so machte mich auch über Concerte her. Hiervon muß bekennen, daß sie mir niemahls recht von Hertzen gegangen sind, ob ich deren schon eine ziemliche Menge gemacht habe, worüber man aber schreiben möchte : Si natura negat, facit indignatio versum | Qualemcunque potest [Juv. Sat. I]. Zum wenigsten ist dieses wahr, daß sie mehrentheils nach Franckreich riechen. Ob es nun gleich wahrscheinlich, daß mir die Natur hierinne etwas versagen wollen, weil wir doch nicht alle alles können, so dürffte dennoch das eine Uhrsache mit seyn, daß ich in denen meisten Concerten, so mir zu Gesichte kamen, zwar viele Schwürigkeiten und krumme Sprünge, aber wenig Harmonie und noch schlechtere Melodie antraff, wovon ich die ersten hassete, weil sie meiner Hand und Bogen unbequehm waren, und, wegen Ermangelung derer letztern Eigenschafften, als worzu mein Ohr durch die Frantzösischen Musiquen gewöhnet war, sie nicht lieben konnte, noch imitiren mochte. »
– 247 –
Chapitre 5
de ces publications, parfois appelés les « lullystes allemands », mettaient ainsi à la disposition de leurs collègues un corpus théorique et musical ayant pour ambition de proposer à la fois une traduction linguistique et musicale des pratiques de composition et de jeu à la française, et un répertoire représentatif à la valeur exemplaire. Ces publications étaient le résultat direct d’une étude intensive du répertoire français ainsi qu’un recueil d’exemples pour les jeunes compositeurs souhaitant s’instruire dans la musique française. L’apprentissage d’une méthode La quinzaine de collections d’ouvertures publiées en Allemagne entre 1680 et 1715 n’est pas seulement l’expression d’une nouvelle mode musicale dont les représentants, au demeurant très divers, appartiendraient à une même école regroupée sous l’étiquette de « lullystes allemands ». Ce répertoire fournit plutôt un excellent point de départ pour s’interroger sur les méthodes de travail et les techniques de composition par lesquelles des musiciens de langue allemande d’origine très diverse ont pu assimiler le style français. Ces ouvertures signent en effet l’apparition d’un nouvel art de composer à la française qui plonge ses racines dans la copie, l’imitation et l’invention à partir de modèles. L’ouverture et les « lullystes allemands » Alors que les cours de Saxe et de Basse-Saxe accueillent dès les années 1660 de nombreux musiciens français parmi leur personnel, aucun phénomène d’ampleur comparable ne peut être observé dans les régions méridionales de l’Allemagne. Le prince électeur de Bavière Maximilian Emanuel était certes un grand amateur de musique et d’opéra français, mais la guerre de Succession d’Espagne le força à mener une existence nomade, d’abord à Bruxelles où il avait été nommé Gouverneur des Pays-Bas, puis dans les Flandres, à Paris ou sur les théâtres d’opération militaire.8 La cour de Württemberg à Stuttgart représente la seule exception, puisqu’on y rencontre une dizaine de musiciens français entre 1683 et 1730, nombre qui reste bien en-deçà des niveaux observés dans les cours de Saxe et en Basse-Saxe.9 Dans quelques endroits, une tendance inverse se fait même jour : certaines cours adoptent des pratiques musicales françaises sans avoir recours à du personnel français, mais en confiant à des musiciens allemands la supervision et la mise en œuvre du style français. Ansbach fournit un exemple intéressant de cette tendance : en 1683, le duc Johann Friedrich von Brandenburg-Ansbach engage dans sa Hofkapelle Christoph Friedrich Anschütz, violoniste originaire de Nuremberg qui avait été en Italie et dans les Pays-Bas, en lui ordonnant entre autres de former deux élèves par an au jeu du violon à la française et de composer de la musique pour les ballets et les comédies.10 L’année suivante, le violoniste Johann Fischer, né à Augsburg mais qui avait travaillé à Paris comme copiste de Lully aux alentour de 1665, est également engagé comme violoniste. Cette stratégie fut enfin couronnée par le recrutement la même année du violoniste Johann Sigismund Cousser, natif de Bratislava.11 Même si ce dernier, à la différence de Fischer, n’avait probablement pas séjourné à Paris, il était loin d’être un novice en matière de musique française.12 En 1680-1681, il avait dirigé à la 8 9
10 11 12
Scharrer, Zur Rezeption, p. 129-144. Owens, The Württemberg Hofkapelle. Le trompettiste Daniel Rousselin, le chanteur La Rose et Claude Reinsal sont engagés en 1683 (p. 13). Le contrebassiste François La Rose est engagé en 1697 et encore mentionné en 1724 (p. 82). La chanteuse Magdalena Sibylla von Bex, qualifiée de « Frantzösin », est engagée en 1699 (p. 59 et 316). Jean Mamere apparaît en 1715 (p. 119). En 1724, le duc Eberhard Ludwig qui venait d’hériter de la principauté de Montbéliard engage trois musiciens français : Haumale des Essarts, Lelong et Barre (p. 11). Louis d’Etry apparaît dans le personnel en 1725, Madeleine Lefebvre en 1730 : Samantha Owens, « The Court of Württemberg-Stuttgart », in : Music at German courts, 1715-1760. Changing artistic priorities, dir. Samantha Owens, Barbara M. Reul et Janice B. Stockigt, Woodbridge 2011, p. 165-195, ici p. 174 et 192. Sachs, « Die Ansbacher Hofkapelle » p. 128. Sachs, « Die Ansbacher Hofkapelle », p. 131. Samantha Owens, The Well-Travelled Musician. John Sigismond Cousser and Musical Exchange in Baroque Europe, Woodbridge 2017, p. 14.
– 248 –
L'invention allemande du style français
cour de Baden-Baden un petit ensemble de six musiciens qui comprenait trois Français : Gerard, Laprairie et La Rose.13 Mais surtout, le 26 novembre 1682, il signait à Stuttgart la préface de la première collection d’ouvertures avec leurs suites publiée dans l’Empire : la Composition de musique suivant la méthode françoise. Bien sûr, ce recueil n’est pas le premier volume de suites de danses instrumentales à avoir été imprimé en Allemagne, où la suite avait déjà une longue tradition.14 Cousser se distingue cependant radicalement de ses prédécesseurs à travers quatre caractéristiques : son titre annonce un style français ; sa préface revendique l’héritage de Lully ; il suit la nomenclature de l’orchestre à cordes français ; chaque suite est introduite par une ouverture. Avant cette date, les collections imprimées de suites de danses n’affichent jamais un style de composition français de manière explicite et n’adoptent pas la nomenclature française. Seule la collection publiée par Georg Bleyer en 1670 fait exception sur le premier point, son titre faisant référence à la « manière française d’aujourd’hui », mais elle se situe pour le reste dans la lignée des anciennes collections de suites imprimées, puisqu’elle ne comporte aucune ouverture et est composée pour un ensemble à cordes tout à fait standard.15 L’exemple de Cousser allait bientôt faire des émules, et à compter de 1682, la publication de collections d’ouvertures à la française réunissant ces quatre caractéristiques devint un trait marquant de la vie musicale allemande (Tableau 5.1). Jusqu’en 1700, cette floraison d’imprimés reste concentrée au Sud de l’Allemagne, dans les grands centres de l’édition musicale que sont Nuremberg, Augsburg et Stuttgart. À l’inverse, en Allemagne centrale et septentrionale, la transmission du répertoire d’ouvertures et de suites se fait essentiellement sous forme manuscrite. Si Georg Bleyer fait imprimer dès 1670 une collection de suites assez traditionnelle, c’est sous forme manuscrite que sa production plus moderne se diffusait, comme le montrent deux suites introduites par des ouvertures à la française très typées et dont la nomenclature est beaucoup plus proche des pratiques françaises avec deux dessus, haute-contre, taille et basse.16 Cette tendance est aussi illustrée par les suites copiées par David Pohle, aujourd’hui conservées dans la collection Düben et qui présentent une similitude remarquable avec les manuscrits de Kassel.17 À Kassel sont également conservées sous forme manuscrite douze ouvertures de l’ancien Kapellmeister de Gotha, Christian Friedrich Witt.18 Ensemble de « Six Ouvertures de Theatre accompagnées de plusieurs Airs », la Composition de musique de Cousser était dotée d’un titre en français qui mettait l’accent sur une « méthode françoise », suggérant la mise en œuvre par le compositeur d’un savoir-faire ou d’une technique particulière, d’un art fondé sur des maximes et des procédés bien spécifiques. Ce titre trahissait aussi une ambition d’exemplarité : il ne s’agissait pas de présenter une collection de pièces choisies de manière arbitraire, mais d’abord de fournir un précis de composition à la française. L’édition extrêmement soignée était publiée par le cousin du compositeur, Paul Treu, et constituée de six parties séparées reflétant les pupitres français de cordes : Premier Dessus, Second Dessus, Hautecontre, Taille, Quinte et Bassus. La dédicace mettait enfin l’accent sur l’étude approfondie du style français par Cousser :
13 14 15
16 17 18
Owens, The Well-Travelled Musician, p. 14-15. Robertson, The Courtly Consort Suite, p. 93-116. Georg Bleyer, Lust-Music, Nach ietziger Frantzösicher Manier gesetzet, Leipzig 1670. Bleyer dédie ironiquement sa collection à « Monsieur Personne » et note que les pièces françaises doivent se jouer plus vite que les allemandes : « Mercke aber nachgesetztes : 1. Daß etliche recht nach Frantzöischer Arth gesetzet, und einen geschwinden Tackt erfordern alß die Bourren Gagliarden, Gavotten &c. 2. Teutscher Arth und in gewöhnlichen Zeit-Masse bleiben, alß Allemanden, Aire, Chansoni. » Robertson, The Courtly Consort Suite, p. 119-121. Juliane Peetz, « The large Tablature Books in the Düben Collection », in : The Dissemination of Music in Seventeenth-Century Europe. Celebrating the Düben Collection. Proceedings from the International Conference at Uppsala University 2006, dir. Erik Kjellberge, Berne 2010, p. 49-72. Wollny, « Zur Thüringer Rezeption », p. 148-151.
– 249 –
Chapitre 5
Tableau 5.1. Collections de musique française publiées dans l’Empire, 1682-1706. Auteur
Titre
Georg Bleyer
Lust-Music, Nach jetziger Frantzösischer Manier gesetzet, bestehend von unterschiedlichen Airn, Bourreen, Gavotten, Gagliarden, Giquen, Chansons, Allemanden, Sarrabanden, Couranden &c.
Johann Sigismund Cousser
Composition de Musique suivant la Methode françoise Contenant Six Ouvertures de Theatre accompagnées de plusieurs Airs
Rupert Ignaz Mayr
Pythagorische Schmids-Füncklein, Bestehend in unterschiedlichen Arien, Sonatinen, Ouverturen, Allemanden, Couranten, Gavotten, Sarabanden, Giquen, Menueten, &c.
Philipp Heinrich Erlebach
VI. Ouvertures, Begleitet mit ihren darzu schicklichen Airs, nach Französischer Art und Manier
Johann Fischer
Le Journal de Printems consistant En airs, & Balets à 5 Parties, & les Trompettes à plaisir
Benedict Anton Aufschnaiter
Concors Discordia, Amori e Timori
Georg Muffat
Suavioris Harmoniae Instrumentalis Hyporchematicae Florilegium Primum
Georg Muffat
Suavioris Harmoniae Instrumentalis Hyporchematicae Florilegium Secundum
Johann Abraham Schmierer
Zodiaci musici, in XII partitas balletticas
Johann Fischer
Neu-Verfertigtes Musicalisches Divertissement […] auf die neueste Manier gesetzt
Johann Sigismund Cousser
Appolon enjoüé, Contenant Six Ouvertures de Theatre accompagnées de plusieurs Airs
Johann Sigismund Cousser
Festin des Muses, Contenant Six Ouvertures de Theatre accompagnées de plusieurs Airs
Johann Sigismund Cousser
La Cicala della Cetra d’Eunomio
Johann Joseph Fux
Concentus Musico-Instrumentalis, enhaltend sieben Partiten und zwar, vier Ouverturen, zwei Sinfonien, eine Serenade
Johann Fischer
Tafel-Musik bestehend in verschiedenen Ouverturen, Chaconnen, lustigen Suiten, auch einem Anhang von Pollnischen Däntzen à 4. & 3. Instrumentis
Johann Fischer
Musicalische Fürsten-Lust, bestehend anfänglich in unterschiedenen schönen Ouverturen, Chaconnen, lustigen Suiten und einen curiosen Anhang Polnischer Täntze mit 3 und 4 Instrumenten
Johann Christian Schieferdecker
XII. Musicalische Concerte, bestehend aus etlichen Ouverturen und Suiten
La Reconnoissance que je dois aux graces, que j’ay receües de V.A.S m’obligeant de rechercher tout ce qui peut contribuer a son divertissement, j’ay crû n’y pouvoir mieux parvenir, qu’en m’attachant a imiter ce fameux baptiste, dont les Ouvrages font a present les plaisirs de touttes les Cours de l’Europe. Je me suis reglé a suivre sa Methode, et a entrer dans ses manieres delicates, autant qu’il m’a esté possible, pour les rendre dignes d’estre exposées au discernement Universel de V.A.S.19
Douze ans plus tard, en 1694, le Florilegium Primum de Georg Muffat réunissait à son tour les quatre caractéristiques de Cousser : annonce explicite d’un style français, revendication de l’héritage lullyste, orchestre à la française, et emploi quasi systématique de l’ouverture en début de suite (seule la cinquième est introduite par un caprice).20 Comme Cousser, Muffat visait à l’exemplarité.
19 20
Cousser, Composition de Musique, partie de basse, dédicace non paginée. Georg Muffat, Suavioris Harmoniae Instrumentalis Hypochematicae Florilegium Primum, éd. Heinrich Rietsch, Vienne 1894 [Augsburg 1695].
– 250 –
L'invention allemande du style français
Ville
Date Parties séparées
Leipzig
1670
Violino (sol 2), Altus (ut 3), Tenor (ut 4), Bassus (fa 4)
Stuttgart
1682
Premier Dessus (sol 1), Second Dessus (sol 1), Haute Contre (ut 1), Taille (ut 2), Quinte (ut 3), Bassus (fa 4), Bassus (fa 4)
Augsburg
1692
Violino Primo (sol 2), Violino Secundo (ut 1), Alto, Viola da Braccio (ut 3), Basso di Viola (fa 4), Basso Continuo (fa 4)
Nuremberg
1693
Premier Dessus (sol 1), Second Dessus (sol 1), Haute Contre (ut 1), Taille (ut 2), Quinte (ut 3), Basse (fa 4)
Augsburg
1695
Premier Dessus pour les Trompettes (sol 1), Second Dessus (sol 1), Dessus (sol 1), Hautecontre (ut 1), Taille (ut 3), Quinte (ut 4), Basse (fa 4)
Nuremberg
1695
Violino Primo (sol 2), Violino Secondo (sol 2), Viola Prima (ut 1), Viola Seconda (ut 3), Basse (fa 4)
Augsburg
1695
Violino (sol 2), Violetta (ut 1), Viola (ut 3), Quinta parte (ut 4), Violone (fa 4)
Augsburg
1698
Violino (sol 2), Violetta (ut 1), Viola (ut 3), Quinta parte (ut 4), Violone (fa 4)
Augsburg
1698
Violino (sol 1), Violettta (ut 1), Viola (ut 3), Violone O Cembalo (fa 4)
Augsburg
1700
Dessus, Haute Contre, Taille, Bassus
Stuttgart
1700
Premier Dessus d’Hautbois (sol 1), Second Dessus d’Hautbois (sol 1), Dessus de Violon (sol 1), Haute Contre de Violon (ut 1), Taille de Violon (ut 3), Basson (fa 4)
Stuttgart
1700
Premier Dessus d’Hautbois (sol 1), Second Dessus d’Hautbois (sol 1), Dessus de Violon (sol 1), Haute Contre de Violon (ut 1), Taille de Violon (ut 3), Basson (fa 4)
Stuttgart
1700
Premier Dessus d’Hautbois (sol 1), Second Dessus d’Hautbois (sol 1), Dessus de Violon (sol 1), Haute Contre de Violon (ut 1), Taille de Violon (ut 3), Basson (fa 4)
Nüremberg
1701
Violino Primo (sol 2), Violino Secundo (sol 2), Haut-Bois Premiere (sol 2), Haut-Bois Seconde (sol 2), Viola (ut 3), Basso (fa 4), Fagotto (fa 4)
Hambourg
1702
Dessus (sol 1), Haute Contre & 2. Dessus (ut 1), Taille (ut 2), Bass (fa 4)
Lübeck
1706
Dessus (sol 1), Dessus (sol 1), Haute Contre & 2. Dessus (ut 1), Taille (ut 2), 1. Bass (fa 4)
Hambourg
1713
Violino Primo (sol 2), Violino Secundo (sol 2), 3. Violin & Viola (sol 2), Hautbois Primo (sol 2), Hautbois Secundo (sol 2), Hautb. Tertio (sol 2), Basson (fa 4), Bassus Continuo (fa 4).
C’est en tout cas ce que suggère le déploiement d’une somme d’érudition considérable, exposée en pas moins de quatre langues dans la longue préface qui accompagnait le second volume : latin, allemand, italien, et français.21 Le premier volume était quant à lui précédé d’une page de titre en latin annonçant cinquante pièces « dans le style chorégraphié » (« quinquaginta excultis, recentiorique stylo Choraico »), la préface précisant que Muffat avait en vue « des Airs de Balets, que J’avois composé pour la plus part à la Françoise ».22 Dans la dédicace, Muffat précisait son idéal de varietas combinant plusieurs « styles » musicaux, également désignés sous le vocable de « méthodes ».23 21 22 23
Georg Muffat, Suavioris Harmoniae Instrumentalis Hypochematicae Florilegium Secundum, éd. Heinrich Rietsch, Vienne 1895 [Augsburg 1698]. Muffat, Florilegium Primum, p. 19. Sur le « Stylus Choraicus », cf. Athanasius Kircher, Musurgia Universalis, vol. 1, éd. Ulf Scharlau, Hildesheim 1999 [Rome 1650], p. 310-315. Muffat, Florilegium Primum, p. 17-19 : « Il ne me falloit pas servir d’un simple style seul, ou d’une même methode ; mais selon les occurrences du plus sçavant mélange que J’aye pû acquerir par la pratique de diverses
– 251 –
Chapitre 5
La version allemande de la préface, plus économe, rassemblait sous le terme unique de « Art » ces deux concepts distingués dans le texte français, l’assortissant parfois d’un synonyme proche : « Manier ».24 Le titre de la collection publiée par Philipp Erlebach faisait également appel à ce dyptique : « nach Frantzösischer Art und Manier ». Il est intéressant de comparer ce vocabulaire à ce qu’écrit Telemann dans son autobiographie de 1718 sur la musique française à la cour de Hanovre, où l’allusion frappante à une « science » (« Frankreichs Wissenschaft ») suggère là encore l’existence d’un savoir, d’une technique artistique pouvant s’acquérir par l’étude et l’exercice.25 À la recherche d’une « méthode françoise » Se familiariser avec le répertoire français original était une étape certes indispensable mais non suffisante, puisqu’elle devait être suivie de longues heures d’exercice et d’innombrables essais de composition. Telemann place ainsi sa rencontre avec la musique française à la cour de Sorau sous le signe d’un travail acharné et de l’application, effets indirects de « l’ardeur » et de « l’échauffement des esprits » propres à l’expérience de l’amour : En effet, c’est là que je commençai vraiment à devenir travailleur, et ce que j’avais réalisé à Leipzig pour les pièces à chanter, je tentais de le faire ici dans la musique instrumentale, et notamment les ouvertures, car son Excellence Monsieur le Comte en raffolait, étant tout juste revenu de France. Je me procurai les œuvres de Lully, de Campra et d’autres bons auteurs, et bien que j’eusse déjà reçu à Hanovre un avantgoût prononcé de cette manière [Art], je la pénétrai désormais plus profondément, en fait je m’y jetai à corps perdu, non sans succès, et le besoin m’en est toujours resté par la suite, si bien que je pourrais rassembler jusqu’à 200 ouvertures de ma plume. À une telle ardeur et un tel développement a sans doute aussi beaucoup contribué le fait que j’avais alors jeté mon dévolu conjugal sur ma défunte femme. On dit souvent que l’amour échauffe les esprits.26
Plus de vingt ans plus tard, dans son autobiographie de 1740, Telemann répète avoir produit 200 ouvertures en deux ans.27 Au-delà du caractère démesuré et peut-être hyperbolique de ce chiffre, même compte tenu de la productivité proverbiale de Telemann, il faut surtout retenir que l’adoption d’une manière française suppose un entraînement intensif de la plume et du stylet : l’étude du répertoire, qui peut être copié, lu ou joué, est doublée d’une imitation en quantité. Pour acquérir le coup de main, il faut donc écrire peut-être pas deux cent, mais beaucoup d’ouvertures. Cet apprentissage supposait d’avoir accès à des partitions en nombre important et de les avoir sous la main un certain temps. Les anthologies de pièces instrumentales françaises, le plus souvent
24 25
26
27
nations. […] ce style commançoit chez nos Allemans peu a peu a se mettre en vogue ; […] le mépris inconsideré, & l’aversion, que quelques uns avoient eu pour cette méthode, commançoit à tomber ». Muffat, Florilegium Primum, p. 8-11. Le texte latin utilise « methodus », « stylus » et « mos Gallicus ». Mattheson, Große General-Baß-Schule, p. 172 : « Ich hatte damals das Glück, zum öfteren die Hannöverische und Wolfenbüttelische Capellen zu hören, von deren ersteren man gestehen muste : Hier ist der beste Kern von Frankreichs Wissenschaft | Zu einem hohen Baum und reiffster Frucht gediehen | Hier fühlt Apollo selbst der muntern Lieder Krafft, | Und muß, als halb beschämt, mit seiner Leyer fliehen. » Mattheson, Große General-Baß-Schule, p. 174 : « In der That, hier fieng ich erst recht an fleißig zu seyn, und das, was zu Leipzig in Singe=Sachen gethan, allhier auch in der Instrumental-Music, besonders in Ouverturen, zu versuchen, weil Se. Excellence der Herr Graf kurz zuvor aus Franckreich kommen waren, und also dieselben liebeten. Ich wurde des Lulli, Campra, und anderer guten Autoren Arbeit habhafft, und ob ich gleich in Hannover einen ziemlichen Vorschmack von dieser Art bekommen, so sahe ihr doch jetzo noch tieffer ein, und legte mich eigentlich gantz und gar, nicht ohne guten Succes, darauf, es ist mir auch der Trieb hierzu bey folgenden Zeiten immer geblieben, so daß ich biß 200. Ouverturen von meiner Feder wohl zusammen bringen könnte. Zu solchem meinem Fleisse und Zunehmen mochte damahls auch wohl diese viel mit beygetragen haben, daß ich eine eheliche Liebe auf meine seel. Frau warff. Denn man hält dafür, daß die Liebe die Geister aufmuntere. » Cette autobiographie est éditée par Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, p. 360 : « Das gläntzende Wesen dieses auf fürstlichem Fuß neu=eingerichteten Hofes munterte mich zu feurigen Unternehmungen auf, besonders in Instrumentalsachen, worunter ich die Ouvertüren mit ihren Nebenstücken vorzüglich erwehlete, weil der Herr Graf kurtz vorher aus Frankreich wiedergekommen war, und also dieselben liebte. Ich wurde des Lulli, Campra und andrer guten Meister Arbeit habhafft, und legte mich fast gantz auf derselben Schreibart, so daß ich der Ouvertüren in zwey Jahren bey 200. zusammen brachte. »
– 252 –
L'invention allemande du style français
ordonnées par ton, étaient alors un outil pédagogique indispensable : elles pouvaient être achetées sous forme imprimée ou bien constituées progressivement sous forme manuscrite. Des compilations manuscrites de pièces instrumentales extraites des opéras étaient réalisées dans l’entourage immédiat de Lully, à la cour de France, comme par exemple le second volume du Recueil de Plusieurs belles pièces de simphonies copiées et mises en ordre de tonalité par Philidor l’Aîné vers 1695.28 Souvent, de telles compilations se présentent sous forme de partition réduite, ne copiant que les parties de dessus et de basse. Si une version complète pour orchestre doit être réalisée, l’apprenti ou l’arrangeur devra alors réinventer les parties intermédiaires en fonction de l’ensemble à sa disposition. Mais comme le montre l’exemple des compilations publiées par Charles Babel en 1697 et 1698, les modèles se disséminent aussi sous forme imprimée. Lorsqu’elles sont imprimées, c’est le plus souvent sous forme d’un jeu complet de quatre ou cinq parties séparées : les « Ouvertures avec tous les airs » de divers opéras de Lully imprimées par Roger à Amsterdam sont un élément décisif pour comprendre l’apparition et la dissémination du genre de l’ouverture avec sa suite.29 Les éditeurs pouvaient cependant faire le choix d’un format plus économique en arrangeant ces pièces pour trio. Le fait que Zelenka ait acheté un exemplaire personnel des Trio des opéras de Monsieur de Lully édités en 1690 par Blaeu lors de son séjour à Vienne (1716-1719) est un excellent indice de l’usage pédagogique de ces compilations comme un réservoir d’exemples à imiter. On peut penser qu’il les avait achetés sur le conseil de Johann Fux, lequel avait publié quatre ouvertures accompagnées de leur suite dans son Concentus musico-instrumentalis quelques années auparavant.30 Assez paradoxalement, des ouvertures et suites tirées des opéras d’Agostino Steffani furent aussi éditées sous le titre de « sonates en trio » chez Étienne Roger à Amsterdam en 1706.31 Mais confronté à un nombre immense d’ouvertures à la française, produites à un rythme accéléré à partir de 1680, l’apprenti musicien pouvait être rapidement submergé : le caractère très stéréotypé des ouvertures rendait non seulement difficile l’identification et la mémorisation de silhouettes mélodiques individuelles, mais allait jusqu’à menacer son inventivité. En 1740, alors que Scheibe réfléchit de manière rétrospective sur le genre de l’ouverture à la française, il relève cette uniformité comme l’un des principaux défis pour le compositeur : Ce que l’on pourrait reprocher à ce type de composition, c’est que toutes les ouvertures commencent de la même façon. Il leur manque donc une certaine variété, qui est par ailleurs toujours nécessaire dans la musique si l’on ne veut pas que tous les morceaux sonnent comme un seul morceau. C’est pour cela que, lorsqu’on n’a pas entendu d’ouverture pendant longtemps et qu’on nous en joue tout à coup une nouvelle, on a l’impression de l’avoir déjà entendue quelque part dans un lointain passé. Cette illusion provient d’une similarité trop étroite et trop exacte, qui est cependant un élément essentiel du style de l’ouverture. C’est peut-être la très grande uniformité de toutes les ouvertures entre elles dès les premières mesures qui a contribué à faire qu’elles ne sont plus si populaires qu’elles l’étaient encore naguère.32
28 29 30 31
32
F-Pn, Rés. 533 : Recueil de plusieurs belles pieces de Simphonie copiées choisies et mises en ordre par Philidor l’aisné ordinaire de la musique du Roy et l’un des deux gardiens de la musique de sa M[ajes]té. Second tôme 1695. Carl B Schmidt, « The Amsterdam Editions of Lully’s Music. A bibliographical scrutiny with commentary », in : Lully Studies, dir. John Hadju Heyer, Cambridge 2000, p. 100-165. Voir Chapitre 4, p. 194-195. Agostino Steffani, Sonate Da Camera à Tre Due Violini Alto e Basso, Amsterdam 1705. Le jeu de parties séparées comprend : Violino Primo, Violino Secondo, Alto, Basso. La page de titre porte cette remarque : « Pour bien jouer ces Piéces il en faut doubler le Premier Violon, à moins qu’il n’y ait écrit Trio ; Car aux Trios on ne le double point & quand on trouvera deux nottes gravées l’une sur l’autre un des deux Violino doit jouer les grosses & l’auttre Violon les petittes. » Pour une description de cette édition, voir Rasch, The Music Publishing House of Estienne Roger, Catalogue en ligne. Johann Adolf Scheibe, Critischer Musicus, Leipzig 1745, p. 669-670 : « Was man diesem Satze vorwerfen könnte, ist dieses, daß er verusachet, daß sich alle Ouverturen auf einerley Art anfangen. Es fällt also eine gewisse Veränderung hinweg, die sonst in der Tonkunst durchgehends nöthig ist, wenn nicht alle Stücke wie ein Stück klingen sollen. Wenn man dahero lange Zeit keine Ouverture gehöret hat, und es wird uns endlich einmal auch eine ganz neue gespielet : so kömmt es unserm Gehöre dennoch vor, als ob man sie lange zuvor gehört hätte. Und dieses entsteht bloß aus einer allzugenau eingeschränkten Gleichheit, die doch ein wesentliches Stück in der Schreibart der Ouverturen ist. Vielleicht daß auch diese sehr große Aehnlichkeit, die alle Ouverture im Anfange mit einander haben, ein großes dazu beygetragen hat, daß sie nicht mehr so beliebt sind, als sie sonst waren. »
– 253 –
Chapitre 5
La standardisation du genre posait donc un véritable défi à la faculté d’invention et d’innovation, pouvant par exemple conduire à confondre des ouvertures différentes, à ne plus se rappeler des ouvertures déjà vues ou copiées, voire à ne plus pouvoir être certain qu’une idée musicale que l’on croit neuve n’est pas en réalité la réminiscence d’une ouverture déjà composée par quelqu’un d’autre. Pour mettre de l’ordre dans cette profusion et relever le défi, Cousser avait développé un outil à la fois simple et génial : un véritable index d’ouvertures, occupant sept pages dans son livre de lieux communs et rassemblant 193 incipits d’œuvres (Illustration 5.1).33 Les incipits, longs d’une à deux mesures, paraissent avoir été copiés au fil des lectures, sans planification ni volonté de systématisation : les lignes comportent un nombre variable d’incipits et sont toutes très remplies. On peut pourtant distinguer plusieurs strates de répertoire qui reflètent les différentes étapes dans la collecte de Cousser.
Illustration 5.1. Johann Sigismund Cousser, Commonplace book, p. 244. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, Osborn Music MS 16.
Sur la première page (244) se trouvent d’abord vingt-sept grands modèles français du genre, issus du répertoire de l’Académie royale de musique jusqu’en 1700 : Jean-Baptiste Lully, André Campra, Pascal Collasse, Marin Marais, etc. L’œuvre la plus récente de la série, l’Aréthuse de Campra (1701), est aussi la dernière à avoir été copiée, mais les autres œuvres ne figurent bien sûr pas dans l’ordre chronologique. En bas de la page figurent deux incipits tirés d’opéras de Reinhard Keiser donnés à Hambourg en 1694, pendant le mandat de Cousser comme directeur du Gänsemarkt-Oper. Sur la page suivante commence une nouvelle série de dix-neuf ouvertures qui circulaient probablement sous forme manuscrite, puisqu’elles sont non identifiables ou n’ont jamais imprimées : figure par exemple l’ouverture du prologue Polyeucte Martyr de Charpentier, 33
US-Nhub, Osborn Music MS 16. Le Commonplace Book de Johann Sigismund Cousser, à la fois recueil de citations, carnet d’adresses, livre de remèdes, compilation de traités et d’exemples musicaux, est présenté, analysé et édité par Owens, The Well-Travelled Musician, p. 183-328. L’identification individuelle des incipits a été effectuée par Samantha Owens : Owens, The Well-Travelled Musician, p. 308-320.
– 254 –
L'invention allemande du style français
composé pour le Collège d’Harcourt et resté à l’état manuscrit. On repère ensuite une série étroitement liée à la cour de Hanovre avec sept ouvertures de Steffani, cinq de Jean-Baptiste Farinel et une ouverture de Michel (« Farinelle ainée »). L’accumulation se poursuit par strates successives sur les quatre pages suivantes, reflétant le développement chronologique de la collection de Cousser. L’inventaire se termine avec quatorze opéras de Purcell donnés à Londres dans les années 1690, suivis de sept opéras donnés à Londres entre 1709 et 1712 – dont un de Johann Ernst Galliard, un de Giovanni Battista Bononcini, et trois de Georg Friedrich Händel. Ces derniers numéros ont donc probablement été ajoutés à partir de l’arrivée à Londres de Cousser en décembre 1704.34 Cousser semble avoir cessé d’alimenter son répertoire vers le milieu des années 1710, date à laquelle il arrête d’ajouter de nouveaux incipits alors même que les portées continuent encore sur les deux pages suivantes. Il devait connaître remarquablement bien sa collection, puisque seuls deux doublons ont été commis par distraction : le dernier numéro, la première mesure d’une ouverture de Jean-Claude Gillier (L’hyménée royale donnée à Paris en 1699) avait déjà été copié 30 numéros et sans doute quelques années auparavant ; et une ouverture de King a aussi été copiée deux fois.35 Sur le feuillet qui précède ce gigantesque annuaire, Cousser a commencé une autre liste d’incipits selon le même principe, mais cette fois-ci dotée d’un autre titre : « Gedruck[t]e Ouverturen, so in Londen angeschafft ». Il s’agit donc d’un répertoire imprimé acheté à Londres. Samantha Owens a montré que ces quarante incipits proviennent d’une collection publiée par John Walsh entre 1701 et 1710 : Harmonia Anglicana, or The Music of the English Stage, qui rassemble les musiques d’intermèdes composés pour les théâtres de Londres. Ce répertoire d’ouvertures, reliquat exceptionnel et remarquablement développé d’une pratique probablement partagée par d’autres compositeurs, mais que Cousser a poursuivie sur plusieurs décennies, montre bien l’assemblage de modèles très variés : après l’assimilation du canon constitué par le répertoire français des années 1670-1700, la provenance se diversifie au fil du temps et des partitions rencontrées. Quelle pouvait être la fonction d’un tel index ? Deux réponses sont possibles : soit il faisait office de catalogue pour des pièces dont une copie complète était conservée ailleurs, par exemple dans la bibliothèque musicale extrêmement bien fournie de Cousser ; soit d’un répertoire d’œuvres qu’il connaissait très bien, mais dont l’indexation n’impliquait pas nécessairement la disponibilité immédiate sous forme de copie manuscrite ou d’exemplaire imprimé. Dans les deux cas, le but est à l’évidence mnémotechnique : il s’agissait pour le compositeur de pouvoir embrasser d’un seul coup d’œil une trentaine d’exemples à la fois. Ce faisant, il pouvait stimuler et canaliser son invention, en regardant ce qui était sans doute autant un gisement de modèles possibles qu’une liste de figures mélodiques déjà prises et qu’il fallait donc éviter d’employer. Cousser écrit d’ailleurs son propre nom (« Cousser ») sous onze de ses ouvertures manuscrites, soulignant la portée mnémotechnique de ce répertoire qui ne comporte en revanche aucune de ses ouvertures imprimées. Au-delà de la constitution d’une banque personnelle de modèles, l’apprentissage du style français pouvait être facilité par la consultation de traités musicaux ou de méthodes de composition françaises. Johann Sigismund Cousser disposait ainsi, dans la bibliothèque du cabinet de travail (« Scriptor ») de sa résidence à Dublin, deux traités français de composition : celui de Gabriel Nivers et celui de Charles Masson.36 Si le premier (qui devait déjà être un peu ancien quand Cousser l’a acheté) n’est qu’un traité très général de théorie musicale sans grande utilité pratique pour le compositeur, le second est à la fois plus récent et plus concret, pouvant très bien fonctionner comme un manuel pour l’apprentissage d’un art de composer à la française, en particulier grâce à ses sections sur la prosodie. 34 35 36
Owens, The Well-Travelled Musician, p. 97. Ownens, The Well-Travelled Musician, p. 317 et 320. Owens, The Well-Travelled Musician, p. 156-157. Charles Masson, Nouveau traité des règles pour la composition de la musique, Paris 1697. Guillaume-Gabriel Nivers, Traité de la composition de musique, Paris 1667.
– 255 –
Chapitre 5
La fréquentation des Hofkapellen françaises semble également avoir joué un rôle important. La nécrologie de Johann Sebastian Bach publiée en 1754 par Carl Philipp Emanuel Bach et Johann Friedrich Agricola consacre quelques mots significatifs à la Hofkapelle de Celle, en soulignant que Bach l’entendit à plusieurs reprises et que c’est à travers elle qu’il prit contact avec la musique française : Depuis [Lüneburg] il avait régulièrement l’occasion d’aller entendre une Capelle autrefois célèbre, financée par le duc de Celle et composée principalement de Français, et par-là de se mettre à l’étude du goût français [ frantzösischem Geschmack], qui, dans ces régions, était alors quelque chose de tout à fait nouveau.37
Ce texte célèbre situe donc les premiers contacts du jeune Bach avec la musique française à Celle, alors qu’il était chanteur à la Michaelisschule de Lüneburg entre 1700 et 1702. C’est à Lüneburg qu’il étudia avec Georg Böhm et qu’il avait sans doute pu faire la connaissance de Thomas de La Selle, le maître à danser de la Ritterakademie voisine et musicien du duc de Celle. En effet, les étudiants de la Michaelisschule logeaient dans le même bâtiment que les étudiants nobles de la Ritterakademie.38 Même si les deux auteurs posent à l’évidence un regard rétrospectif sur cet épisode, qu’ils décrivent à plus de cinquante ans de distance en employant le vocable de « Geschmack » qui venait d’être popularité par Johann Joachim Quantz à travers la notion de « goûts réunis [vermischter Geschmack] », ce texte demeure un témoignage essentiel sur la mise en contact du jeune Bach avec la musique française. C’est à Celle, en compagnie de musiciens français, que débuta une pratique de la musique française qui se poursuivit pendant les cinquante années suivantes. Pratiques d’écriture et techniques de composition Comment passe-t-on de la copie des modèles à l’invention proprement dite ? Cette question est délicate : si la copie du répertoire est un phénomène qui laisse des traces, une approche de l’invention musicale est plus périlleuse dans la mesure où l’ensemble des automatismes et des décisions qui forment le processus compositionnel représentent une sorte de boîte noire inaccessible à l’historien. Plusieurs travaux ont cependant constitué la créativité musicale baroque en objet d’étude, en-deçà des traces livrées par la partition.39 Plusieurs motifs semblent jouer dans la décision de composer des ouvertures. Dans sa préface de 1693, Philipp Erlebach invoque la grande popularité dont jouissent les « ouvertures et airs composés à la manière française dans les cours et autres réunions de musiciens » pour expliquer la nécessité d’élargir le répertoire en usage afin d’éviter de ressasser toujours les mêmes morceaux. Erlebach dit ne pas s’être laissé effrayé par le fait de ne jamais être allé en France, puisque de même que l’on peut apprendre à connaître les mœurs et les paysages des peuples étrangers par les cartes, les livres et les récits de voyages, on peut aussi pénétrer leur manière et leurs techniques artistiques par « la consultation intensive, l’écoute, l’exercice et le jugement » de leurs productions artistiques. Enfin, contrairement à Muffat, Erlebach estime que la manière d’exécuter ces pièces à la française est désormais assez connue et pratiquée pour pouvoir se passer d’une explication détaillée.40 37
38 39 40
BD III, Dok. 666, p. 82 : « Auch hatte er von hier [= Lüneburg] aus Gelegenheit, sich durch öftere Anhörung einer damals berühmten Capelle, welche der Hertzog von Zelle unterhielt, und die mehrentheils aus Frantzosen bestand, im Frantzösischen Geschmacke, welcher, in dasigen Landen, zu der Zeit was ganz Neues war, fest zu setzen. » Fock, Der junge Bach, p. 44. Voir par exemple Dreyfus, Bach and the Patterns of Invention. Rebecca Herissone, Musical Creativity in Restoration England, Cambridge 2013. Erlebach, VI Ouvertures, partie de Basse, préface non paginée : « Nachdem nunmehro an den meisten Höfen, wie auch in anderen zu Musicalischen Ergetzung gewidmeten Zusammenkünfften, die nach Französischer Art gesetzte Ouverturen und Airs in grosse Ubung und Beliebung gekommen ; und aber die neugierige Welt durch immerwährende Anhörung einerley, ob gleich der besten Sachen, leicht zu einer Verdrießlichkeit kan beweget werden. […] Weil auch die Manier, solche Französische Sachen zu musiciren und aufzuführen, nunmehr zimlich bekandt ist, als halte vor unnöthig, selbige hier weitläufftig zu erklären und vorzuschreiben, sondern überlasse sie des Music-Liebhabers eigenem vernünfftigen Gutdüncken. »
– 256 –
L'invention allemande du style français
Dès la première mesure d’une ouverture, il faut prendre un nombre incalculable de décisions : la tonalité, l’incipit mélodique, la possibilité de commencer de façon dramatique avec la texture pleine de l’orchestre ou bien de façon plus galante avec les dessus, en faisant rentrer la basse seulement dans un deuxième temps. Pour composer une ouverture, Mattheson recommande de garder la première partie relativement courte, de ne pas y cadencer plus de deux fois et de trouver un thème brillant pour la partie centrale.41 Mais au-delà des recettes, chaque compositeur développe bien entendu un art assez personnel de l’ouverture et développe des caractéristiques individuelles. Les ouvertures publiées par Philipp Erlebach se caractérisent ainsi par leur profil assez consonnant ainsi que par la fréquence des cadences, des marches modulantes et des emprunts aux tons voisins qui leur confèrent une couleur très tonale : la 5e suite en fa majeur, par exemple, commence de manière très galante avec une imitation entre le dessus et la basse, mais emprunte tout de suite en si bémol majeur, ré mineur, do majeur. La partie centrale à 6/8 est en ternaire au lieu d’être à trois œ ™ œgalant œ ™ œ œ auœ contrepoint. ™œ ˙ ™œ œ ™œ œ ™œ œ b œEnfin, ° b également œ œ ™ œassez œ ™ œ œ moderne ™ œ œ ™ ™œ ™ œ aspect temps, ce qui confère et le retour œ ™ œ œun 2 œ ™ Dessus 1 et 2 œ b & œ ™ œ œœ œ = & de la partie pointée module même de façon très dramatique™ en do puis en fa mineur (Exemple 5.1). œ œ œ ™ œ œ œ ™œ œ ™ ™œ œ b œ ™ œ ™ ° œ ™ œ œ ™ œ œ ™œ ˙ œOuvertures, ™ œ œ ™ œ œ œ Nuremberg œ = b 22 œ ™ œ œ ™VI bPhilipp& Dessus 1 et 2 œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ 1693, œ ™ œ œOuverture ™ œ œ œ ™ œ 5.œ ™ œ œ ™ œ œ œ œœ ™ œ œ ™ œ œ ™œ œœ ™œœ œ ™œ Exemple Erlebach, b ∑ œ œ ™ Haute Contre 5.1. & & B œ ™œ œ = ™ ˙ œ œ œ ™ œ œ œ ™œ œ ™ ™œ œ b œ ™ œ œ ™ ° œ œ ™ œ œ ™ œ œœ ™œ bb 22 œ ™ œ œ ™ œ∑ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™œ ™ œ œ ™œ œ ™œ œ == Dessus 1 et 2 b ™ œ œœ ™™ œ œ ™™ œœ œ ™ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œœ ™ œ œ ™ œœ œ œ œœœ ™™ œœ œ ™™œœ œ ™œ & Haute Contre & ™œ œ = & B ∑ 2 œ ™œ œ ™œ b Taille B ™œ œ ™ b ™ œ œœ ™™ œ œœ ™™ œœ œ ™ œ œœ ™™ œœ œœ œ ™ œ œœ ™ œ œ ™ œœ œ œœ ™™ œœ œ ™™œœ œ ™œ œ ™ œ œ ™œ bb 22 ∑∑ = Haute Contre & B œ B Taille B œ ™œ œ œ ™œ œ ™œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œœ ™œ™œœ œ ™™œœœ œœ == B 2 ∑ œ b b Quinte œ ™ œ œ ™ œ ™œ œ b œ œ ™œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œœ ™ œœ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œœ œ ™ œœ œ ™œ œ ™ œ œ ™œ œ ™ œ œ = B ∑ 2 b Taille B B 2 ∑ œ œ ™ œ œœ ™™ œœ œœ ™™œœ œ ™œ œ ™ œ œ œ ™œ œ ™ œ œ ™™œœ œ ™œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œœ œ ™œ œ ™œœ œ == ? ? b b Quinte 2 ∑ Basse J b ¢ b œ ™ œ œ ™œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™œ œ ™ œ ™ œ œ ™ ™ ™ Bb B b 22 œ œ ™ œ œ ™ œœ ™™œœ œ ™œ œ œ œ ™ œ ™œœ œ ™ œ œ œ œ ™ œœ ™œ œœ œ == ? Quinte ? ∑∑ Basse J b ¢ b œ ™ œ œ ™œ œ ™ œ œ œ œ œ ™œ œ ™ œ ™ œ œ ™ ™ ™ œ œ œ ™œ œ œ = œ™œ œ ?Lentement ? b 2 ™œ œ ™œ œ œ 7 ∑ Jm œ œ ™ œ œœ™ œœœ œ b œ mœ ™ œ œ ™ ¢ ° Basse 2 b ˙ œ ™ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ œ œ™ œ œ œ D &b 2 ˙ œ œ œ œ œœ œ ™ nœ œ œ œ œ Lentement 7 m ° 2 œ œ œ b œ mœ ™ œ œ ™ œœ ˙ œ ˙ œ ™ œ œ œ œ ™ jœ œ œ D &b 2 ˙ j œ œ œ œ œœ œ ™ nœ œ œ œ œ j j ˙ œ ™ œ ™ HC 7& b 2 Lentement ˙ œ œ™ œ œ œ mœ ° 2 ˙ ˙ œ œ œ b œ mœ ™ œ œ ™ œ ™ œ œ ™ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ™ œ œœ D &b 2 ˙ œœœœœ j 22 œ™ œj œ œ œ ™ œ n œ œ œ œ œœ œ œj œ˙ œ ™ œ œœ ™ œ œj b HC ™ & B œ œ ˙ b2 ˙ nœ ™ œ œ ™ T J J j j 2 j j œ œ™ œ œ HC &b 2 œ ™™ œj ˙˙˙ œ œ ˙œ œ ™ œ œ ™ œ œj nœ ™ œ œ ™ T B b 2 ˙ J œ™ œ Q B b 2 œ œ œ J œ œ ˙ œ ™ œ ™ ˙ œœ œ œ™ œ œ n œ 2 œ œ™ œ œ œ j ™ B œ œ ˙ œ j bb 2 ˙ T J ™ œ ™ œ œœ ˙ œ ? œ ˙ ™ œ Q B J œ œ 2 œ œ œ œ ˙œ ™ œ œ ™ œ ™ ™ œ œ œœ ™ œ œ n œ ™ œ ˙ B œ ¢ b 2 ˙w J œœœœ œ œ™ j 2 j œ ™ ™ B ˙ œ Q ?b 2 œ™ œ œ œ ˙œ ™ œ ™ œ ™ œ œœ ™ œ œ ™ œ n œ ™ œœ œ˙ œ œ œ œ ˙œ B ¢ b 2 ˙w œ œ œ™ J œœœœ ? 2 œ œœœ˙ ™ B 11 b 2 ¢° J œ ™ œœ œw™ œ œ œ œœ™ œm ™ œ œ ™ œ œb ˙™ œ œ n œœ ™ œœ ˙Ÿœ ™ œ œ œ ™ œ ™œ œ m j wœ œ œ œ ™ b œ œ ™ œ œ œ œœ nœ œ J D &b œ™ 11 3 3 œ ™ œ Ÿœ ™ œ œ œ ™ œ m ° œ w j œ œ œ œ™ œ ™ œm œ ™ œ œ œ ™ œ b ˙ 3 œb œ œ n œ J œ™ D &b œ™ ™ œ œ j œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ ™ ™ nœ œ œ bœ ™ œ œ™ œ w b œ ™ œ b Ÿœ HC 11 & b œ ™ œ 3œ œ 3œ n œ Jœ m œ w œ™ œ œ™ œ œ œ™ j œ œ œ œ™ ° œ ™ œm œ ™ œ œ œ ™ œ b ˙ œ3 œ b œ J œ™ n œ 3 D &b œ™ j™ œ œ œ œ ™œ œ ™ œœ b œ ™ ™œ œ ™ œœ œœ ™™ œ n œ ™™ œ œ œ ™ œ œ ™ œ ™ œ œ b œ ™ œ b œ n œ b œ HC œ & œ B œ œ œ b 3 T 3 J J J œJœ w 3 j 3 œ™ œ ™ œœ b œ ™ ™œ œ ™ œœ ™™ œœ n œœ ™™ œ œ œ ™™ œ œ ™ œ ™ œ œ b œœ ™™ œœ b œ HC & B bbb œ ™™ œ œ œ œJj n œœ ™œ œ n œ œœ j T B œ œJ œ œ ™ œ œ Jœj œ ™ œJœœ ww Q œ œ œ ™ œ œ œ bœ œ œ ™ œ J 3 ™ œ ™™ œ œ ™ œ œ ™ œj œ ™ œ j œ ™ œ œœ ™ œ œ b œœ ™ œœ b œœ ™™ œ œ ™ œœJ b œœ ™™ œœ œœ œœ œ ™ j œJœ ww T B b œ™ J œ œ nœ ™ ? œ œ œ ™ b Q B b œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ B b J b œ ™ ¢ œ w œ 3 ™ œ bœ ™ œ ™œ b œ ™ œ œ ™ œ™ 3 j œ œ b j j B œ œ ™ œ œ ™ Q ?b œ œ œb œ œ ™ œ œ œ œ œ œn œ b œ ™ œ œ œ œ ™ œ ww B Jœ b 41 ¢ Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 170-171. œ 3 3 œ ™ œ b œ ™ œ œ ™ œb œ ™ œ œ œ™ ™ œ™ œ ? œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ bœ ™ œ B ¢ b œ w œ 3
3
– 257 –
Chapitre 5
Chez Cousser au contraire, les premières ouvertures de 1682 gardent une saveur un peu archaïque et modale, très proche des premiers modèles français du genre, et ménagent de nombreuses imitations entre le dessus et la basse, les voix intermédiaires étant conduites de façon assez polyphonique. La première suite révèle une maîtrise remarquable des codes français et du traitement des dissonances : la basse du refrain du rondeau « Les Enchantans » commence ainsi par un retard qui produit un accord de septième renversé, et se poursuit par un mouvement chromatique descendant. Au fil des collections, l’effectif instrumental est enrichi de vents : Apollon Enjoüé comporte ainsi des parties séparées pour deux dessus de hautbois et un basson, et Michael Robertson note également que cette collection se distingue de la première par la longueur des mouvements, l’emploi de formes à reprises et l’insertion d’une gigantesque et ambitieuse chaconne.42 Dans ses deux publications, Muffat reste aussi très proche des modèles français des années 1680 : il procède très souvent par basses conjointes, ménage de nombreuses dissonances de septième et de neuvième, use des cadences avec parcimonie, introduit de nombreuses imitations entre le dessus et la basse. Au-delà de ces variantes individuelles, toutes les ouvertures publiées dans l’espace germanique adoptent le modèle en deux ou trois parties qui s’impose chez Lully à partir de 1660, bien loin de la diversité des modèles que l’on trouve encore dans ses premières ouvertures comme celles des ballets d’Alcidiane lwv 9 (1658) ou de Xerces lwv 12 (1660). Les compositeurs allemands ne semblent pas avoir repris l’habitude de certains Français de n’écrire que la partie de dessus et de basse – Le Cerf de la Viéville rapportant qu’en dehors de « ses principaux chœurs, & de ses duo, trio, quatuor importans » dont il « faisait lui-même toutes les parties », Lully « ne faisoit que le dessus & la basse, & laissoit faire par ses Secretaires la haute-contre, la taille & la quinte, qui est ce que quelques gens appellent les fiches, ou les parties-médiantes, & que j’aimerois mieux apeler […] les parties moyennes.43 » En revanche, tous les compositeurs doublent systématiquement la partie de dessus, faisant jouer la même chose par les deux parties de violon quand elles sont séparées.44 Chez Aufchnaiter, la partie de second violon reste silencieuse pour les deux premières suites à l’italienne, et n’entre que pour doubler la partie de premier violon au début de la « Serenata 3 », la première qui commence avec une ouverture à la française. D’autres genres que l’ouverture pouvaient également être utilisés pour se faire la main au style français. Deux motets latins de Cousser conservés dans la collection Bokemeyer témoignent par exemple d’un apprentissage stylistique à partir de la musique d’église latine.45 Ces deux œuvres de jeunesse semblent en effet former un diptyque contrastant, l’un italien – « Dilata me » pour deux sopranos et orchestre à cinq – et l’autre français – « Quis det oculis » pour deux tailles chantantes, orchestre à six et deux dessus de flûte. Alors que les violons sont notés en sol 2 dans le premier cas (c’est l’habitude en Allemagne et en Italie) ils sont en sol 1 dans le deuxième (comme les dessus de violon et de flûte français). Le rythme harmonique, très régulier à la croche dans le motet à l’italienne, est beaucoup plus lent et irrégulier dans le motet à la française (Exemples 5.2 et 5.3). L’écriture pour les dessus est aussi très différente : là où le violon brode mélodiquement la dominante avec quelques motifs solistes dans le motet à l’italienne, les deux flûtes ont une ligne beaucoup plus contrapunctique et ornementée dans le motet à la française. Mais de façon plus frappante encore, c’est l’écriture pour la voix qui diffère beaucoup : alors que la ligne vocale est assez fleurie dans le motet italien, le style est beaucoup plus déclamé dans le deuxième (Exemples 5.4 et 5.5). L’origine des deux textes dévotionnels en latin demeure obscure : on remarque simplement que le texte de « Dilata me » est une version à peine modifiée d’un poème latin inséré dans le 42 43 44 45
Robertson, The Courtly Consort Suite, p. 131-132. Cité par Charles-Dominique, Les « bandes » de violons en Europe, p. 540. Robertson, The Courtly Consort Suite, p. 20-21. D-B, Mus. ms. 4238 : Johann Sigismund Cousser, « Dilata me à 7. 5 Instrumens et 2 Dessus de Voix avec la Basse=Continüe ». D-B, Mus. ms. 4239 : Johann Sigismund Cousser, « Quis det oculis à 10. 2 Flutes traversières, accompagnement de trois Instrumens, Basson, 2 Tailles de Voix, avec la Basse-Continüe ».
– 258 –
L'invention allemande du style français
Exemple 5.2. Johann Sigismund Cousser, Dilata me « Symphonia ». D-B, Mus. ms. 4238. [Violon]
&
[Violon 2]
&
Ÿ Ÿ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ b œœ œ œ œ b œ œ œ œ ° ‰Œ œ b Œ & J b œ œ œ œ œ œ œ ‰ œjœ œ œ bœ &b œ œ œ œ #œ Œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj‰ Œ œ
[Alto 1]
B
Ÿ j b œ™ œœ œœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ Œ œ™ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ‰ Œ J B
[Alto 2]
B
b œ œ œœbœ œ œ ‰ #œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ B œœ œ J
œ œ œb œ œ œ # œ œ œ œ œ b œ n œ j‰ Œ œ
? œ# œ œ œ œ œ œ œ ‰ # œJ œ œ œ b œ œ œ œ œ ¢ b œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ # œ n œ b œ œ œ œ œJ ‰ Œ œ
[B.C.]
?
Exemple 5.3. Johann Sigismund Cousser, Quis det oculis, « Symphonie ». D-B, Mus. ms. 4239.
Premiere �ûte traversiere
&
Ÿ ° b Œ ‰ œ œ ™ œJ # ˙ ™ & J
Second �ûte traversiere
&
¢&
Haute Contre
B
° b w &
Taille
B
Bb
˙
B
B ˙ ¢ b
?
?b
Symphonie
Quinte
Basse Continüe
œ ™ n œ mœ ™ b œ œ b œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œœ ˙ ‰ œJ J J
Ÿ j Œ ‰ œ œ ™ b œJ n ˙
b
w
w
˙
w
˙™
˙
#˙
˙
w
w
Œ ‰ œ J
œ
m œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ #œ œ #˙ J
bœ ™ œ ˙ J
œ ™ œj œ ™
j ˙ œ œ
œ™ œ œ™ J
œ j œ # œ ™ J œ ™ œJ
œ™ œ ™ œJ
bœ œ œ™ œ œ™ œ J J
w
˙™
w
w
œ M M œ™ J œ ™ œ œ ™ bœ
œ œ bœ ™ œ ˙ J
j b œ œ ™ œ œ #œ ¢& œ œ
Ϫ
j œ œ
j œ ˙
° b ˙ &
˙
˙™
Ϫ
œ œ™ J
Bb ˙
˙
˙
œ ™ œ #œ œ J
B ˙ ¢ b
œ™ œ ˙™ J
Ϫ
œ # œ ™ œ nœ ™ J J
?b
œ
œ
œ œ œ œ ˙ J
œ œ œ™ œ œ ˙ J ˙
œ
œ
Ϫ
œ b œ œ ™ œ Ÿœ ™ œ œ ™ J
œ œ œ œ œ
œ
œ™ œ œ™ J
˙
˙
œ
œ
œ œ
Ϫ
œ b˙ J
œ
œ
œ ™ bœ w J
œ
œ
˙
Ϫ
œ œ œ œ œ
œ
˙
œ
œ ˙
œ œ œ œ ˙
– 259 –
˙
j œ ˙
˙
Ϫ
8
j œ™ œ
w
œ œ œ ™ J #œ œ J
° œ™ &b
œ™ œ J
œ
œ
œ œ œ œ J œ nœ œ œ J
œ ˙™
œ nœ œ J œ bœ œ ™
œ J
Chapitre 5
Exemple 5.4. Johann Sigismund Cousser, Dilata me, « Dilata me in amore ». D-B, Mus. ms. 4238. Cant. 1
[B.C.]
B ?
° j j œr œ œ r ‰ jœ œ ¢& b œ J œ # œ ‰ œ œ ™ J R # œ œ ™ œ œ œ
b
Di - la - ta
?
b
di - la - ta me in a - mo
me
b ˙
˙
Bb
°?
Second Taille
Bb Bb
Second Taille
Bb
°? ?b ¢ b ? ¢ b ° b B ° b Bb B b B Bb
˙
- re
j j œ œ œ ™ œ œ œ œ #œ ™ ‰ œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ J J R J œœ J J R R ut dis - cam in - te - ri - o - ri cor -dis o
re - gus - ta
˙
˙
˙
˙
œ
˙
œ
∑ Cousser, Quis ∑ det oculis, «∑ Quis det oculis ∑ ». D-B, Mus.∑ ms. 4239. Premiere Taille5.5. Johann Sigismund b Exemple Premiere Taille
[Haute Contre]
B
b
b Bb B b B Bb
[Haute Contre] [Taille]
[Taille] [Quinte]
[Quinte] [B.C.]
? B bb
[B.C.]
?b
∑ ∑
∑ ∑ œ™ Œ œ Œ œ Œ J œœ œ ™det Quis Quis quis Ó Œ œ Œ œ Œ J œœ ∑ ∑ m bœ œ ™ œ œ Ÿœ ˙ Quis ˙ Quis ˙ quis det œ œ œ #œ œ œ œ œ m bœ œ ™ œ œ Ÿœ ˙ ˙ ˙ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
∑ œ ™# œ œ ™ œ œ œ n œ ™ œ œ J R JJ oœ ™ cu -™ lis # œ œ œ meœJ -isœ nfon œ ™ œœ J R J o ˙ cu - lis me˙ -is fon ˙ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ #œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ œ
œ œ
œ œ
œœ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙
˙œ ˙œ œ #œ
œ ˙
œ
œ #œ ˙
˙
7
Œ
°? ?b ¢ b ? ¢ b ° b B ° b Bb B b B Bb
Ó #˙
Œ Ó
#rum? ˙
Ó
rum?
w
œ œ
Quis
Œ Œ
Quis
œ œ
Quis
Œ Œ
Quis
Ó
œ œ œ™ œ J ™ œœ œ œ J
? B b œœ # œœ œœ œœ b œ n œœ ¢ b ? œ # œ œ œ b œ nœ ¢ b
°? Ó b 7
∑ ∑
œ œ
œ ™ œ œ œ ™# œ J œ ™ œ œ œ ™# œ Quis det o J
œ™ œ J R œ ™- lisœ cu J R
Quis
cu - lis me - is
det
o
œ œ nœ ™ J J œ œ fon nœ ™ me - is J J
œœ œ J œœ œ J
fon
- re
∑ ∑ bœ ™œ œ œ œ œ #œ œ JR J J b œ tem ™ œ la-chry ma œ # œ œ J R œJ œJ œ tem la -chry ma w
˙ œ™
w œ bœ J œ ™ œJ b œ œ œ™œ œ
œ
œ ™œœ
œœ
œ ™œœ œ œ
œœ ™ œ n œ
œœ
œ œ œ œ ™ œb˙
œ nœ
œ
œ ™ œb˙
œ J œ tem J
œ œ œ J J la œ - chry œ - maœ J J
tem
la - chry - ma
œ #œ œ #˙ œ #œ œ #˙ ∑ ∑
w
w ˙
˙
w ˙
Ϫ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ™ œ
? Bb ¢ b ˙˙ ? ¢ b ˙
˙
œ˙ # œ
˙œ
˙
œ
˙
#œ
œ J œ œ J œ
˙
˙
œ
˙
œ
˙
˙ ˙
˙ ˙
œ w
˙
œ
˙ ˙
˙ œ
˙
˙œ
˙
˙
˙
œ
œ
#œ
œ
#œ
w œ œ ˙ œœ œ œ˙ ™ œ ˙ œ œ™ œ ˙
œ
# ˙˙
œ
# ˙˙ ˙
célèbre ouvrage de dévotion de Thomas a Kempis, l’Imitatio Christi (Livre III, chapitre 5). Le texte de « Quis det oculis » est quant à lui très proche d’un motet à voix seule contenu dans une collection de Carlo Grossi publiée à Anvers en 1680.46 Les deux motets de Cousser, copiés par Österreich, portent les cotes originales typiques de la collection Bokemeyer (1225 et 1228). Leur cotation est assez proche de celle du motet de Lalande (cote originale 1227), ce qui indiquerait soit leur proximité sur les rayonnages dans le cas d’une cotation systématique, soit la proximité temporelle de leur copie vers 1700 dans le cas d’une cotation par ordre chronologique. Le Dilata 46
Carlo Grossi, Moderne melodie a voce sola, Anvers 1680.
– 260 –
L'invention allemande du style français
me est copié sur le même papier que le motet de Lalande, issu de la fabrique de Johann Wilhelm Cast, actif comme producteur de papier à partir de 1702. Expérimentations et hybridations Dans les cours de Passau, de Dresde, de Celle et de Hanovre, on a vu que l’établissement d’une dichotomie franco-italienne ne se limitait pas au monde de la musique mais pouvait aussi être retrouvée dans l’art des jardins ou le monde du théâtre. En musique, la prévalence de cette dualité entraîna bientôt non seulement la coexistence mais aussi des tentatives d’hybridation entre style français et style italien. Le terreau d’une telle hybridation est sans doute la coexistence de musiciens français et italiens au sein de mêmes ensemble et leur cohabitation négociée dans les Hofkapellen. Les opéras composés par Agostino Steffani pour la cour de Hanovre, ou encore les oratorios de Pietro Torri témoignent de l’adoption de pratiques française orchestrales dans le cadre d’un idiome et de genres italiens.47 Mais cette hybridation se retrouve aussi dans certaines collections de suites imprimées : un exemple fameux de jeu ludique avec le mélange des goûts est le fameux trio du Concentus Musico-Instrumentalis de Fux, où sont superposées dans une même sonate en trio une « Aria Italiana » gracieuse, en triolets et au profil galant, avec une « Arie françoise » très ornée et véhémente, caractérisée par ses rythmes pointés et inégaux. C’est surtout à l’aune du répertoire instrumental que le mélange des idiomes français et italiens a été étudié chez Georg Philipp Telemann et Johann Sebastian Bach. Laurence Dreyfus a ainsi parfaitement mis en évidence la fusion opérée entre un adagio et une sarabande dans le mouvement lent de la sonate bwv 1029 pour viole de gambe et clavecin obligé : alors que la mélodie jouée par la viole de gambe possède toutes les caractéristiques d’un adagio de concerto italien, le clavecin exhibe au contraire les signes typiques d’une sarabande française.48 Steven Zohn a également consacré des développements éclairants au mélange des styles français et italiens sous la plume de Telemann, notamment dans les genres de la Sonaten auf Concertenart ou celui de la Concertouvertüre.49 Mais une autre forme d’adaptation non moins fascinante, plus étrange peutêtre, intègre aussi des éléments stylistiques français dans le genre de la cantate luthérienne. Gallicus Adventus « Gallicus Adventus » : c’est par cette formule que Cicéron décrit, au deuxième livre de la République, « l’effroyable tempête de l’invasion gauloise » qui s’abattit sur Rome au début du ive siècle avant notre ère.50 Le dimanche 2 décembre 1714 au matin, ce ne sont pas les cris des oies du Capitole qui résonnèrent dans l’air glacé de Weimar et de Francfort, mais une musique d’église un peu particulière destinée à marquer le début d’un nouvel Adventus Christi : cet hiver-là, les deux compositeurs Bach et Telemann avaient décidé de mettre en musique le même texte d’une manière qui ressemblaient fort à une invasion française, cette fois purement musicale. Les deux cantates pour le premier dimanche de l’Avent représentaient en effet une sorte de manifeste musical dans le style français qui résonnait simultanément à quelques centaines de kilomètres de distance. La cantate Nun komm, der Heiden Heiland bwv 61 occupe une place très particulière dans la production de Johann Sebastian Bach. Elle est l’une des rares œuvres de jeunesse qui puisse être datée avec précision, puisque l’année de l’exécution est reportée sur le manuscrit.51 En outre, la seule source conservée pour cette œuvre, une partition manuscrite autographe, présente un trait particulièrement énigmatique : au verso de la page de titre, Bach a noté le déroulement musical du culte luthérien à Leipzig pour le matin d’un premier dimanche de l’Avent, sans que l’on
47 48 49 50 51
Sur Steffani, voir Chapitre 2, p. 120-122. Sur Torri, cf. Scharrer, Zur Rezeption, p. 225-288. Dreyfus, Bach and the Patterns of Invention, p. 116-123. Zohn, Music for a Mixed Taste, p. 65-117 et 283-331. Cicéron, La République, éd. Esther Bréguet, vol. 2, Paris 1980, p. 13. D-B, Mus. ms. Bach P 45, page de titre. Édition moderne dans NBA I/1.
– 261 –
Chapitre 5
sache quand ni pourquoi.52 Ceci pourrait indiquer que l’œuvre fut reprise une dizaine d’années plus tard, le 28 novembre 1723, dans le cadre du premier cycle annuel de cantates de Bach à la Thomaskirche de Leipzig – signe de la grande qualité et du pouvoir d’attraction durable exercé par cette œuvre. Plus encore que l’étrangeté de la source, c’est en effet l’alliage très particulier de différents styles musicaux qui peut venir expliquer le caractère fascinant de cette œuvre. Exemple unique de combinaison entre la forme de l’ouverture à la française et le traitement en cantus firmus d’une mélodie de choral, son équilibre suscitait déjà l’admiration de Philipp Spitta, qui lui consacre une longue analyse et voit en elle le point d’aboutissement du travail du jeune Bach dans le genre nouveau de la cantate.53 Promu maître des concerts à la cour de Weimar le 2 mars 1714, Bach avait désormais l’obligation de composer « chaque mois de nouvelles pièces » pour la chapelle de la cour.54 Son activité décuplée dans le champ de la musique d’église est alors marquée par l’abandon progressif des modèles traditionnels de musique figurée luthérienne qui avaient jusqu’alors fortement marqué son œuvre religieuse. Désormais, Bach se tourne vers le nouveau genre de la cantate, formalisé pour la première fois en 1702 par Erdmann Neumeister et caractérisé par l’alternance entre airs et récitatifs, sur le modèle de la cantate profane italienne.55 La copie d’une cantate du compositeur vénitien Antonino Biffi témoigne de l’assimilation de modèles italiens, tandis que la maîtrise des nouveaux canons formels est démontrée par exemple à travers la Jagdkantate bwv 208. Dans le domaine de la musique d’église, les trois œuvres Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt bwv 18, Ich hatte viel Bekümmernis bwv 21 et Mein Herze schwimmt im Blut bwv 199 témoignent également de l’assimilation rapide de la topique de la cantate profane italienne, transposée à la musique d’église luthérienne.56 Dans ce contexte, l’emploi d’une ouverture à la française n’a rien d’évident et présente même quelque chose de contre-intuitif. L’année précédente, Mattheson en déconseillait l’usage dans la musique d’église, recommandant au contraire d’introduire toutes les pièces religieuses par « une symphonie ou une sonate conforme à l’esprit texte, mais toujours quelque peu pondérée, à l’exclusion de l’ouverture ».57 C’est pourtant avec une netteté particulière que le premier mouvement de la cantate – le seul qui ne soit pas copié par Bach lui-même mais par son cousin Johann Lorenz Bach qui étudiait alors avec lui à Weimar – revendique le style français (Illustrations 5.2 et 5.3). Doté d’un sous-titre en français (le mot « Ouverture » est placé au-dessus de la portée de basse continue) et d’une indication de tempo également donnée en français (« gay ») pour la partie centrale, ce mouvement adopte aussi une nomenclature unique. Les violons 1 et 2 sont notés sur deux systèmes différents, mais ils jouent à l’unisson pendant toute la cantate (sauf dans le 4e numéro, un récitatif accompagné en pizzicato). L’utilisation de deux parties d’alto, courante dans les premières œuvres de Bach et dans la musique d’église d’Allemagne du Nord,58 est ici accompagnée de clés françaises puisqu’au lieu d’être notées en ut 3 et ut 4 comme d’habitude, elles sont notées en ut 1 et en ut 3, les clefs de haute-contre et de quinte de violon. 52 53 54 55 56 57
58
D-B, Mus. ms. Bach P. 45, fol. 1. Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, vol. 1, Leipzig 1873, p. 500-505. BD II, Dok. 66, p. 53. Ute Poetzsch-Seban, Die Kirchenmusik von Georg Philipp Telemann und Erdmann Neumeister. Zur Geschichte der protestantischen Kirchenkantate in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Beeskow 2006, p. 20-33. Peter Wollny, « Einführung », in : Johann Sebastian Bach, « Nun komm, der Heiden Heiland ». Kantate zum 1. Adventssonntag bwv 61, fac-similé, éd. Peter Wollny, Laaber 2000, p. V. Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 155-156 : « Ist demnach unmaßgeblich sehr wohl gethan, wenn man ein Kirchen=Stück, es sey nun ein Laudate, Magnificat, Benedictus, Gloria, Dixti, Miserere &c. […] mit einer dem Text conformen, doch allezeit etwas moderirten Symphonie oder Sonate an statt der Ouverture anheben läst, selbige aber so kurtz und nervos, als müglich ist, einrichtet. » Cf. par exemple Greta Haenen, « Die Streicher in der evangelischen Kirchenmusik in Norddeutschland », in : Zwischen Schütz und Bach. Georg Österreich und Heinrich Bokemeyer als Notensammler (Gottorf/ Wolfenbüttel), dir. Konrad Küster, Stuttgart 2015, p. 61-82.
– 262 –
L'invention allemande du style français
Illustration 5.2. Johann Sebastian Bach, Nun komm der Heiden Heiland bwv 61, début du premier mouvement. D-B, Mus. ms. Bach P 45.
Illustration 5.3. Johann Sebastian Bach, Nun komm der Heiden Heiland bwv 61, milieu du premier mouvement. D-B, Mus. ms. Bach P 45.
– 263 –
Chapitre 5
Mais outre son contexte d’exécution, cette ouverture possédait une autre particularité, puisqu’à la texture instrumentale de l’ouverture était ajouté un cantus planus : la première période du choral, énoncée en valeurs longues par chaque voix successivement, était en outre dotée d’une terminaison ornée à la française lors de sa première occurrence. Cette idée saugrenue de combinaison pourrait bien provenir du répertoire français d’orgue, où l’on introduisait volontiers un plain-chant en taille au milieu du plein jeu. Ainsi, le Kyrie de Nicolas de Grigny que Bach avait copié dans les mêmes années allie un type de texture très proche de l’ouverture au manuel avec un plain-chant énoncé en taille et en valeurs longues au pédalier (Illustration 5.4).
Illustration 5.4. Nicolas de Grigny, Kyrie en Taille. Copie de Johann Sebastian Bach. D-F, Mus. Hs. 1538.
Les commentateurs ont parfois émis l’hypothèse que l’ouverture à la française était un moyen de marquer le début de l’année liturgique et de signifier l’attente du nouveau Roi d’Israël en la personne du Christ.59 En fait, une raison beaucoup plus simple et prosaïque semble avoir poussé Bach à concevoir ce mouvement dans le style français : six semaines auparavant, les musiciens de Dresde qui avaient accompagné le prince Friedrich August pendant son séjour à Paris étaient rentrés à Dresde, rapportant avec eux plusieurs manuscrits de musique française. Or, sur le chemin du retour, ils avaient fait étape près de Weimar, comme le montre une déclaration de perte signée le 15 octobre 1714 par le postillon de la diligence après qu’il eut égaré la valise de l’organiste Christian Pezold, d’une valeur estimée à 200 Thaler.60 L’identité des musiciens qui étaient dans la voiture peut même être établie sur la base de cette déclaration : Je soussigné Hans Junge, de Kerstenleben, reconnais par la présente que le 15 octobre 1714, quatre messieurs étrangers, c’est-à-dire M. le Baron von Eben Fändrich, du régiment impérial de Herberstein, et M. Johann Christoph Schmidt, Capellmeister royal de Pologne et électoral de Saxe, avec M. Pezold et M. Pisendel, également musiciens royaux de Pologne et électoraux de Saxe, sont arrivés chez moi par la voiture de poste, et m’ont confié leurs biens, soit 3 coffres, deux sacs de manteaux et deux paquets, avant de continuer leur route. Mais vu que le coffre de M. Pezold a été perdu, comme je ne l’avais pas attaché et pas assez surveillé, je promets par la présente […] que j’emploierai non seulement toute la peine et le zèle nécessaire pour faire rechercher ledit coffre à mes frais, mais je promets aussi fidèlement que, s’il ne devait pas être retrouvé, je donnerai et procurerai à Monsieur Pezold le remboursement de sa valeur, comme le prévoit le règlement de la poste.61
59 60 61
Konrad Küster, « Weimarer Kantaten (1708-1717) », in : Bach Handbuch, Laaber 1999, p. 162. Köpp, Johann Georg Pisendel, p. 82. Köpp, Johann Georg Pisendel, p. 82 : « Ich Endes unterschriebener Hannß Junge von Kerstenleben bekenne hiermit, daß den 15. Octobris 1714. Vier Fremde Herren, als nahmentl. der hl. Baron von Eben Fändrich, von Kayserl. Herbersteinischen Regiment, und hl. Johann Christoph Schmidt, Königl. Pohlnl. und Churf. Sächßl. Capellmeister, nebst hl. Pezolden u. hl. Pissendeln gleichfalls Königl. Pohlnl. und Churfürstl. Sächßl. Musicis bey mir mit der Post ankommen, und selbe weiter fortzuschaffen, wie sie denn deren Güter alß 3. Coffer, zwey Mantel Säcke, und zwey Paquete anvertrauet. Nachdem aber unter weges hl. Pezoldens Coffer verlohren gangen, indem selber nicht angebunden, noch gennug verwahret worden, Alß gelobe ich hiermit [...], daß ich auff meine eigene Unkosten alle Mühe und Fleiß, bemelten Coffer wiederum zu schaffen nicht allein werde anwenden, sondern verspreche auch treul., daß, daferne bemelter Coffer sich nicht solte wieder finden, hl. Pezolden alle Satisfaction dem Werthe nach, und wie es die Postgerechtigkeit mit sich bringet, zu geben und zu verschaffen ».
– 264 –
L'invention allemande du style français
La destination des musiciens, Buttelstedt, se situe à une dizaine de kilomètres au Nord de Weimar, sur la route entre Erfurt et Leipzig. Rien ne prouve qu’ils se soient arrêtés à la cour de Weimar, sinon la transcription pour orgue d’un trio de François Couperin réalisée par Johann Sebastian Bach sous le titre « Aria » (bwv 587). En effet, cette transcription montre que Bach dut avoir accès à la copie manuscrite de cette pièce rapportée par Pisendel dans ses bagages, aujourd’hui conservée à Dresde, puisqu’elle ne correspond pas à la version imprimée en 1726 dans Les Nations (comme premier mouvement du troisième ordre sous le titre « L’Impériale »), mais bien à une version antérieure, qui circulait sous forme manuscrite sous le titre « La Convalescente » et fut copiée par Pisendel lors de son séjour à Paris.62 Ceci montre que les musiciens de Dresde ont vraisemblablement rencontré Bach en rentrant de Paris, lorsqu’ils firent arrêt à Weimar vers le 15 octobre 1714, et même qu’ils ont échangé des partitions. La déclaration de perte ne mentionne ni Jean-Baptiste Volumier ni Johann Christian Richter : ces deux derniers pourraient très bien avoir fait partie du groupe de voyageurs dans une autre voiture, mais ils restèrent plus probablement à Paris, puisque Kos et Hagen notent à la date du 14 décembre 1714 la présence de musiciens de la chapelle de Dresde.63 On peut donc supposer que le trio bwv 587 et la cantate bwv 61 ont été composés en même temps. L’emploi d’une ouverture à la française comme premier mouvement de cantate est donc lié au contexte immédiat de composition plus qu’à une signification théologique : il est le résultat de la rencontre avec les musiciens de Dresde et avec le répertoire qu’ils rapportaient de France. Mais le choix du texte était aussi le fruit d’une rencontre personnelle : il était tiré d’une collection de textes que Erdmann Neumeister venait tout juste de terminer et qui ne fut publiée qu’en 1717. 64 En fait, ce texte avait été fourni à Bach par Telemann, lequel était lui-même en train de commencer un nouveau cycle de cantates pour la Barfüßerkirche de Francfort, ancienne église des Cordeliers où il était maître de chapelle depuis 1712. Le baptême de Carl Philipp Emanuel Bach, dont Telemann était le parrain et auquel il se rendit le 10 mars 1714, pourrait avoir fourni une occasion de rencontre entre les deux hommes.65 Telemann avait reçu au plus tard en novembre 1714 les épreuves finales du recueil contenant tous les nouveaux textes de Neumeister pour l’année liturgique à venir, qu’il allait ensuite mettre en musique progressivement, dimanche après dimanche.66 Comme Bach, Telemann paraît avoir choisi une orientation stylistique résolument tournée vers la France, non seulement pour la cantate du premier dimanche de l’Avent mais pour la totalité de l’année liturgique : le cycle de cantates composé en 1714-1715, le deuxième cycle complet de Telemann, fut en effet diffusé dès les années 1720 sous le nom de Frankfurter Jahrgang ou de Französischer Jahrgang.67 Il précédait deux autres cycles également désignés par une attribution stylistique géographique : le Italienischer Jahrgang et le Sicilianischer Jahrgang. Un simple regard sur la partition de la première cantate de ce cycle, Nun komm der Heiden Heiland (twv 1:1775), suffit cependant pour constater l’absence à première vue de tout élément français. Au contraire, le style semble extrêmement concertant, avec une basse pulsée en croches tout au long du premier mouvement et des arpèges bariolés aux cordes qui rappellent beaucoup plus l’idiome du concerto italien que de la musique française (Exemple 5.7). L’usage de 62 63 64 65 66 67
Kerstin Delang, « Couperin - Pisendel - Bach. Überlegungen zur Echtheit und Datierung des Trios 587 anhand eines Quellenfundes in der Sächsischen Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden », Bach Jahrbuch, 93, 2007, p. 197-204. HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 785/5, fol. 8, 14 déc. 1714 : « aus Gelegenheit der von Ew: Konigl. Mayt. hier anwesenden Musicanten mit einer kleinen Cammer-Musique zu unterhalten ». Erdmann Neumeister, Geistliche Poesien, mit untermischten Biblischen Sprüchen und Choralen, Eisenach 1717. Wollny, « Einführung », in : Bach, Nun komm, p. IX. Poetzsch-Seban, Die Kirchenmusik von Georg Philipp Telemann und Erdmann Neumeister, p. 155-190. Christiane Jungius, Telemanns Frankfurter Kantatenzyklen, Kassel 2008, p. 23. On trouve l’abréviation « frz. » ou « frantz. » sur plusieurs sources de Francfort copiées dans les années 1720. Deux copies manuscrites en provenance de la Fürstenschule de Grimma portent en toutes lettres « Frantzösischer Jahrgang » sur la couverture : D-Dl, Mus. 2392-E-561a et D-Dl, Mus. 2392-E-578a.
– 265 –
Chapitre 5
Exemple 5.7. Georg Philipp Telemann, Nun komm der Heiden Heiland twv 1:1775, premier mouvement. D-F, Ms. Ff. Mus. 1285.
œœ œ œ œ œ œ ‰‰ œ œœ œœJ ‰‰ J
œœ œ œ œ œœ ‰‰ œ œœ œœ ‰‰
œœ œ œ œ œ œ ‰‰ œ œœ œœ ‰‰
œœ ‰‰ œœ œœ œœ ‰‰ œœ œœ JJ JJ
œ œ œœ ‰‰ œ œœ œœ ‰‰ œ œœ JJ JJ
œœ ‰‰ œœ œœ œœ ‰‰ œœ œœ JJ JJ
° °& b cc œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œœ &b
œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ
œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
B B bb cc œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Clarini piccoli o Corni ° ° c œœ œœ œ ‰‰ œœ œœ œ ‰‰ Oboe 1 & bb c œ œ Oboe 1 & Clarini piccoli o Corni
bc Œ ¢¢& &b c Œ
Oboe 2 Oboe 2
Violin 1 Violin 1
œœ œ jj œœ œ œ œœ ‰‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ bb cc œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ & & œ œ œ œ
Violin 2 Violin 2
Viola Viola
Cello Cello
? c œ œ œ œ œ œ œ œ ¢¢? bb c œ œ œ œ œ œ œ œ
5 ° œœ œ ° œœ œœ ‰‰ œ œœ œœ ‰‰ Ob. 1 & b Ob. 1 & b 5
Ob. 2 Ob. 2
Vln. 1 Vln. 1
Vln. 2 Vln. 2
Vla. Vla.
Vc. Vc.
Adagio Adagio
œœ ‰ œœ JJ ‰ JJ
U Uœ ‰‰ œ ŒŒ
b jj ‰ œœ œœ œœjj ‰‰ œœ œœ ¢¢& & b œœ ‰
U U j œœj ‰‰ œœJ ‰‰ œœ ŒŒ J
œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ ° °& bb œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ &
œœ ‰ œœ JJ ‰ JJ
œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ b & œ & b œœ œ œ œ B B bb œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
? ? b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ JJ ¢¢ b
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Uœ U ‰‰ œ ŒŒ
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
œœ œœ n ˙ n˙
U œœ ‰‰ œœ ‰‰ Uœœ ŒŒ # œ JJ JJ #œ Uœ œœ œœ U JJ ‰‰ JJ ‰‰ œ ŒŒ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙ œœ ˙˙
U nn œœ œœ œœ ‰ œjj ‰ U ˙˙ JJ ‰ œ ‰ œ ŒŒ œ
˙˙ œœ
˙˙ ˙˙ ˙˙
[+ Sop.] [+ Sop.]
ŒŒ œœ
œœ œœ ˙˙
-
nn œœ œœ ˙˙
Nun Nun [+ Alt.] [+ Alt.]
komm der Hey komm der Hey
Nun Nun [+ Ten.] [+ Ten.]
komm der Hey komm der Hey
-
den den
Nun komm der Hey Nun komm der Hey [+ Bass.] [+ Bass.]
-
den den
Nun komm der Hey Nun komm der Hey
-
ŒŒ œœ ŒŒ œœ ŒŒ œœ
œ œœ œœ œœ œ œœ nn œœ œœ œœ
den den
˙˙
Heil Heil
## ˙˙
- and - and
˙˙
Heil Heil
- and - and
Heil Heil
- and - and
œœ œœ ˙˙
œœ œœ œœ ## œœ ## œœ œœ ˙˙ den den
˙˙
Heil Heil
ÓÓ ÓÓ
˙˙
ÓÓ
˙˙
ÓÓ
- and - and
deux petites trompettes ou cors en fa (« clarini piccoli ò Corni ») qui jouent également des arpèges en tuilage n’apparaît pas non plus même vaguement français.68 Enfin, la présence d’un violoncelle concertant qui accompagne le dictum de basse est une autre caractéristique très italienne.69 Cette absence d’éléments français fait penser que, si Telemann s’est mis d’accord avec Bach pour lui fournir le texte de sa cantate, les deux compositeurs ont opté pour des orientations stylistiques très différentes. Ceci est d’autant plus étonnant que Telemann destinait les pièces du Französischer Jahrgang aussi bien à l’église de Francfort qu’à la Hofkapelle de Eisenach.70 Or, celle-ci avait été un haut lieu d’acclimatation du style français, comme le souligne encore Telemann dans 68 69 70
D-F, Ms. Ff. Mus. 1285. Les parties séparées sont dans le ton de fa majeur comme toutes les autres parties. La partie pour violoncelle est nommée « Violoncelle Solo ». Alternativement, une autre partie intitulée « Viola Concertato » suggère que la partie soliste pouvait être prise par l’alto. Sur l’utilisation parallèle du « Französischer Jahrgang » à Francfort et à Eisenach, voir la lettre de Telemann au Hofrath Jakob Witsch du 27 déc. 1714, in : Georg Philipp Telemann, Briefwechsel. Sämtliche erreichbare Briefe von und an Telemann, éd. Hans Grosse et Hans Rudolf Jung, Leipzig 1972, p. 175-176.
– 266 –
L'invention allemande du style français
son autobiographie de 1740.71 Les membres de l’orchestre avaient été embauchés par Pantaleon Hebenstreit, un musicien allemand qui venait de séjourner en France, et dont Telemann note « l’adresse extraordinaire dans la musique française et la composition.72 » Claus Oeffner relève dans les archives de la cour la présence de musiciens et danseurs français depuis les années 1670, sans qu’aucune liste ne nous permette de connaître la composition de la Hofkapelle au moment où Telemann fut nommé Konzertmeister en 1708.73 Louis Bonin y avait été maître de danse, avant que Pantaleon Hebenstreit n’arrive. Telemann y fut Konzertmeister en 1708, puis Kapellmeister en 1709 avant de rejoindre Francfort en 1712. Les pratiques de composition françaises sont donc logiquement très présentes dans la musique instrumentale qu’il compose pour la cour d’Eisenach, mais semblent l’être beaucoup moins à Francfort.74 L’enquête sur cet Avent gallican ne s’arrête pas là. Une troisième cantate fut en effet composée sur le texte de Neumeister. Conservée à Mügeln et longtemps attribuée à Telemann, elle était considérée comme une seconde version de la cantate précédente.75 Sur la base de son lieu de conservation (situé en dehors de l’aire de diffusion habituelle du Französischer Jahrgang) et des maladresses prosodiques dans les récitatifs, Ute Poetzsch-Seban a proposé de remettre en cause cette attribution et de considérer cette œuvre comme étant d’un autre compositeur, provisoirement désigné par les initiales TEL qui figurent sur le manuscrit.76 Mais curieusement, alors que la cantate de Telemann est d’un style très international et moderne, celle-ci présente immanquablement des caractéristiques françaises : le premier mouvement est une ouverture sans partie centrale, mais avec interpolation de périodes de choral harmonisées simplement entre les phrases de l’orchestre. L’air « Komm Jesu Komm » est accompagné par deux hautbois solistes, faisant référence au trio français de bois. Enfin, dans le chœur final, les deux pupitres de violons jouent également unisono. Notons enfin que l’ouverture de la cantate de Mügeln commence exactement comme celle de Telemann pour la cantate du dimanche de Pâques, Christ ist erstanden von der Marter (twv 1:136). Après une longue sonnerie en majeur qui précède le début de l’ouverture, celle-ci démarre exactement de la même manière dans les deux cas, si bien qu’il faut postuler que l’une des deux œuvres a été copiée sur l’autre (Exemple 5.8).77 Il est possible que la cantate de Mügeln ait été composée sur le modèle de celle que Telemann composa pour le jour de Pâques dans le Frantzösischer Jahrgang. Mais là où Telemann avait fait le choix d’un ensemble instrumental identique à celui de Bach, avec deux parties d’alto notées en ut 1 et en ut 3, le compositeur de Mügeln ne retient qu’une seule partie d’alto. Ouvertures entre Köthen et Leipzig Lorsque Bach prit ses fonctions de Kantor à la Thomaskirche de Leipzig, c’est sans aucune ambiguïté qu’il choisit de placer sous le signe de la musique française le coup d’envoi de son nouveau mandat : sa première cantate, exécutée quinze jours après son arrivée le 30 mai 1723 à la
71 72 73 74 75 76 77
Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, p. 361 : « Ich muß dieser Capelle, die am meisten nach frantzösischer Art eingerichtet war, zum Ruhm nachsagen, daß die das parisische, so sehr berühmte Opern=Orchester, welches ich nur erst vor kurtzen gehöret, übertroffen habe. » Mattheson, Grosse General-Baß-Schule, p. 175-176 : « Monsieur Pantlon, sage ich, hatte, nebst der Erfahrung auf vielerley Instrumenten, zugleich in der Frantzösischen Music und Composition eine ungemeine Geschicklichkeit ». Claus Oefner, Das Musikleben in Eisenach, 1650-1750, Dissertation, Martin-Luther Universität Halle, 1975. Zohn, Music for a Mixed Taste, p. 13-63 et 72-84. D-Müg, Nr. 355 et 395. Voir Ute Poetzsch-Seban, « Neues über den Telemannbestand im Kantoreiarchiv zu Mügeln », in : Auf der gezeigten Spur. Beiträge zur Telemannforschung. Festgabe Martin Ruhnke zum 70. Geburtstag, dir. Wolfgang Hirschmann, Wolf Hobohm, Carsten Lange, Ochserleben 1994, p. 106-127. Ute Poetzsch-Seban, « Notizen zu ‘Nun komm der Heiden Heiland’ von Georg Philipp Telemann und TEL », in : Musik zwischen Leipzig und Dresden. Zur Geschichte der Kantoreigesellschaft Mügeln 1571-1991, dir. Michael Heinemann et Peter Wollny, Oscherleben 1996, p. 125-130. Ces premières mesures sont copiées en la mineur dans l’exemplaire de Dresde : D-Dl, Mus. 2393-E-561a.
– 267 –
Chapitre 5
Exemple 5.8. Georg Philipp Telemann, Christ ist erstanden twv 1:136, premier mouvement, mes. 1-8. D-F, Ms. Ff. Mus. 796.
Violin I
Violin II
b nœ nœ ™ œ œ ™ œ œ ™ nœ œ ™ œ œ & b b c ‰ ≈ œr œ ™ n œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ n œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ™ œ œ™
Œ
b &b b c Œ
Œ
nœ œ ™ œ nœ ™ œ œ ™ œ œ ‰ ≈r œ œ ™ œ œ ™ nœ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œ ™ nœ œ ™
Viola 1
bbc B b Ó
nœ œ ™ ‰ ≈œr œ ™ n œ n œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ
Œ
Viola 2
B bbb c Ó
Œ
Œ
Cello
? bb c w b
‰ ≈œ œ™ œ œ™ œ œ R
œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ
w
w
3
Ÿ œ ≈ œbœ œ bœ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
œ™ œ œ™ œ œ™ ≈ œR
b &b b œ™ œ œ™ œ œ™
œ ™ œ œ nœ ™ œ
˙
Ÿ œ ≈ œbœ œ bœ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
œ™ œ œ™ œ œ™ ≈ œR
b &b b œ™ œ œ™ œ œ™
5
œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ
3
bb B b Ϫ
≈ b œR œ ™ œ œ ™ n œ œ ™
≈ œr œ ™ œ œ ™ œ
B bbb œ ™
≈ œ œ™ œ œ™ œ œ™ R
≈ œR œ ™ œ b œ ™ œ
Ϫ
≈ œr œ ™ œ œ ™ œ œ
œ™ œ œ™
≈ œR
? bb œ ™ b
≈ œR b œ ™ œ b œ ™ œ b œ ™
≈ œ œ™ œ œ™ œ R
Ϫ
œ™ œ œ™ œ œ ≈ œR
™ œ™ œ œ
≈ œR
œ™ œ œ
œ nœ œ œ ™ œ b &b b ‰ ≈
9
3
œ™ œ œ
œ nœ œ œ ™ œ b &b b ‰ ≈ 3
B
Ϫ
nœ ™ œ œ ™ œ ≈ œœœ 3
‰ ≈ ‰ ≈ œ™
œ™ œ œ™ œ œ™
B bbb œ ™
œ ≈R
? b Ϫ bb
œ œ œ™ œ œ™ œ bœ™ ≈ œ 3
3
nœ ™ œ œ ™
≈ œR
œ ™ œ œ ™ œ œ ™ n œ œ ™ œ Ÿœ ™
œœœ œ™ œ ≈
≈ œ œ ™ œ nœ ™ œ œ R
œ ™ œ œ ™ œ œ ™ n œ œ ™ œ Ÿœ ™
œœœ œ™ œ
3
Ϫ
œnœ œ œ ™ œ œ ™ œ nœ ™ œ œ ™ b œ œ ™ 3
œ™ œ œ™ œ œ™
œ ≈R
nœ œ ™ œ œ ™
nœ œ œ nœ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ≈ œ 3
– 268 –
™ ≈ œR œ œ ™ ≈ œR œ œ ≈ œR œ ≈œ R
œ œ
L'invention allemande du style français
Nikolaikirche – Die Elenden sollen essen bwv 75 – commençait par une admirable ouverture à la française avec chœur, qui compte sans aucun doute parmi l’une des plus belles de Bach.78 Outre sa forme, ce mouvement cumulait les marqueurs classiques du style français : l’usage des hautbois colla parte avec les violons ou en trio à la française (deux hautbois et basson, mes. 80-83), ainsi que l’emploi probable d’un petit chœur dans la partie centrale, contrastant avec le grand chœur des deux parties extrêmes.79 Mais Bach montrait aussi clairement qu’il ne s’agissait pas de n’importe quelle ouverture : loin de proposer un modèle du genre, il composait selon son habitude à contre-courant.80 Dès la deuxième mesure, une petite phrase pour hautbois solo entre les interventions pointées de l’orchestre donnait au mouvement l’allure d’un concerto pour hautbois. Plus encore, les proportions métriques normales d’une ouverture à la française se trouvaient inversées, puisque la première partie est un exemple unique d’ouverture à trois temps, tandis que la seconde est à quatre temps. Jusqu’à la fin de l’année 1723, Bach fit encore entendre deux œuvres introduites par une ouverture à la française avec chœur : une cantate pour le conseil de la ville le 30 août 1723 (Preise Jerusalem bwv 119) et une musique pour l’inauguration d’un orgue le 2 novembre 1723 (Höchsterwünschtes Freudenfest bwv 194). Ces deux ouvertures sont de facture beaucoup plus classique que la précédente, dans la mesure où les proportions métriques normales sont respectées avec le retour de la partie pointée après le fugato, une mesure à deux temps pour les parties extrêmes et à 3/4 pour la partie centrale. De plus, le chœur n’intervient que dans la partie centrale, laissant aux parties extrêmes l’allure purement instrumentale du genre sous sa forme originale. L’ouverture bwv 194/1 démarre cependant de manière surprenante avec un trio de bois à la française qu’accompagnent des gammes descendantes de cordes, les violons étant à l’unisson pendant toute la première partie. Ce dispositif est inversé lors du retour de la partie pointée à la fin du mouvement, où les cordes assurent désormais la trame du discours tandis que l’accompagnement est confié aux hautbois. Cette cantate se distingue encore par un autre aspect : ce n’est pas seulement le premier mouvement qui adopte la forme d’une ouverture à la française, mais l’ensemble de la cantate qui est structuré comme une suite. Tous les airs (à l’exclusion des récitatifs et des chorals) adoptent les caractéristiques de mouvements de danse : l’air bwv 194/5 est immanquablement une gavotte, marquée par l’anacrouse caractéristique et la répétition à la basse d’un anapeste lui aussi typique. Le duo bwv 194/9, introduit par un trio de bois à la française, possède aussi de façon très évidente le caractère galant, la métrique et le tempo d’un menuet. Les deux autres sont moins précisément caractérisés : le duo initial à 12/8 a des allures de pastorale, et l’air de ténor bwv 194/8 a des allures de gigue à la française vive et pointée, mais en binaire. Au cours de l’année suivante, Bach fit encore entendre une ouverture le 11 juin 1724, dans la cantate O Ewigkeit, du Donnerwort bwv 20. Dans le mouvement introductif, les périodes harmonisées du choral sont interpolées au sein d’une texture orchestrale typique de l’ouverture. Parallèlement, Bach continuait à employer le trio de vents à la française, bien audible le 1er janvier 1724 dans la première partie du mouvement introductif de la cantate bwv 190, ou le 3 septembre 1724 comme accompagnement du duo bwv 33/5. Mais l’exemple le plus impressionnant d’adaptation de modèles français arrive exactement une semaine plus tard : le 10 septembre 1724, la cantate Jesu, der du meine Seele bwv 78 était introduite par une immense et admirable chaconne en rondeau avec chœur. Le profil de la ligne de basse, le caractère monumental et dramatique de l’écriture, la verticalité de l’introduction instrumentale, la présence du rythme pointé et surtout l’accentuation très marquée sur le deuxième temps trahissaient des modèles français. Une cantate plus tardive conclut la période d’expérimentation autour de modèles français initiée en 1723. Dans la cantate pour le jour de Noël 1725 (Unser Mund sei voll Lachens bwv 110), Bach reprend
78 79 80
NBA I/15, BC A 94. Le chœur n’est accompagné que par le continuo dans la partie centrale. Dreyfus, Bach and the Patterns of Invention, p. 33-58 : « Composing against the grain ».
– 269 –
Chapitre 5
l’ouverture pour orchestre bwv 1068 qu’il avait déjà composée quelques années auparavant, probablement vers 1722.81 Dans cette nouvelle version, il lui ajoute un chœur dans la partie centrale fuguée. Cette œuvre marque la fin d’une phase de deux ans de travail intensif sur l’ouverture (1723-1725) : entre 1726 et 1729, Bach allait se tourner exclusivement vers le genre du concerto lorsqu’il souhaitait réutiliser des œuvres instrumentales pour le mouvement introductif de ses cantates.82 Il semble que Bach n’écrivit plus une seule ouverture jusqu’en 1734. Comment peut-on expliquer cette floraison d’ouvertures pendant les dix-huit premiers mois de son mandat à Leipzig ? Pendant sa période comme Konzertmeister à Köthen (1717-1723), Bach avait continué d’approfondir sa connaissance du répertoire instrumental français et c’est probablement là qu’il composa ses premières ouvertures pour orchestre. Les deux collections de suites pour clavier à la française (connues sous le nom de Suites anglaises et françaises) sont un très bon témoin de cette activité.83 À Köthen, Bach évoluait en outre dans un milieu de cour où figuraient plusieurs musiciens d’origine française : le maître des pages et musicien Jean-François Monjou d’origine huguenotte, engagé en 1719 avec ses deux filles. À en juger par leurs noms, le bassoniste Torlé et le hautboiste Rose, qui venaient tous les deux de la chapelle berlinoise dissoute en 1713, étaient peut-être également d’origine française.84 Les indices de contact avec les musiciens français de Dresde sont plus rares. On sait que Volumier a rencontré Bach en 1715 et en 1717. Carl Philipp Emanuel Bach indique en outre que Buffardin s’est rendu chez Bach.85 On a parfois supposé que le cinquième Concerto Brandebourgeois bwv 1050 avait été composé dès 1717, alors que Bach était maître de chapelle à Köthen, pour être exécuté à Dresde par les musiciens de la Hofkapelle – dont Jean-Baptiste Volumier et Pierre-Gabriel Buffardin – lors de la visite de Louis Marchand.86 Certaines œuvres composées pour la flûte à la fin des années 1730 (en particulier la sonate bwv 1030 et l’ouverture bwv 1067 en si mineur, ainsi que la sonate en la majeur bwv 1032) ont également pu être inspirées par Buffardin.87 Bien des années plus tard, en 1773, Scheibe affirme avoir été le témoin vivant que Bach – tout comme « d’autres amis de la musique » habitant à Leipzig – était en contact régulier avec les « virtuoses de la chapelle royale de Dresde », et qu’il « pouvait obtenir tous les jours des nouvelles sûres et complètes » de ce qui s’y passait.88 On peut donc penser que l’arrivée en Saxe fut peut-être pour Bach une raison de renouer avec la composition de musique à la française. Regards rétropectifs Ce n’est qu’après une pause de onze ans que Bach composa ce qui était probablement sa dernière ouverture pour orchestre, encore une fois dans le cadre de la cantate : le mouvement introductif de l’œuvre In allen meinen Taten bwv 97 prend la forme d’une ouverture très développée. Bach renouait avec l’alchimie qu’il avait pratiquée à Weimar vingt ans plus tôt, puisqu’un cantus firmus était ajouté à l’ouverture, mais cette fois-ci chanté seulement dans la partie centrale. La mélodie du choral, énoncée sans ornement au soprano, était accompagnée par les autres voix du chœur 81 82 83 84 85 86 87 88
Heinrich Besseler, Kritischer Bericht, NBA VII/1, p. 16. Heinrich Besseler, Kritischer Bericht, NBA VII/1, p. 9 Peter Williams, Bach. A Musical Biography, Cambridge 2016, p. 217-219. Günther Hoppe, « Köthener politische, ökonomische und höfische Verhältnisse als Schaffensbedingungen Bachs », Cöthener Bach-Hefte, 4, 1986, p. 12-62. Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach. The Learned Musician, New-York 2000, p. 193-194. Voir Chapitre 1 p. 31. Wolff, Johann Sebastian Bach. The Learned Musician, p. 234. Pieter Dirksen, « The Background to Bach’s Fifth Brandenburg Concerto », in : The Harpsichord and Its Repertoire. Proceedings of the International Harpsichord Symposium Utrecht 1990, dir. Pieter Dirksen, Utrecht, 1992, p. 157-185. Williams, Bach. A Musical Biography, p. 345. BD III Nr. 773, p. 241 : « damals, wie ich deßen aus selbst eigener Erfahrung gewiß versichert bin, ganz Leipzig eines bessern überzeuget war, und wovon man durch die Verbindung, in welcher der seel. Kapellmeister Bach und andere Freunde der Musik in Leipzig mit den Virtuosen der Königlichen Kapelle in Dresden standen, fast alle Tage sichere und gründliche Nachrichten erhalten konnte ».
– 270 –
L'invention allemande du style français
en contrepoint libre. L’ouverture faisait à nouveau usage du trio de vents à la française. À partir de cette date, Bach ne compose plus que des ouvertures pour le clavier et entame donc une phase de travail plus abstraite et plus spéculative sur le genre, détaché de son substrat orchestral : l’ouverture « nach Französischer Art » qui introduit la deuxième partie de la Clavier-Übung II fut imprimée l’année suivante en 1735. Peter Williams relève à juste titre que les quatre volumes de la Clavier-Übung comprennent systématiquement en leur milieu des ouvertures d’un genre un peu particulier et parfois très éloigné du modèle original : le premier mouvement de la Partita 4 dans le premier (1731), l’ouverture à la française proprement dite dans le second (1735), la Fughetta super Wir glauben all an einen Gott dans le troisième (1739) et la variation en ouverture dans le quatrième (1741).89 Une nouvelle manière d’appréhender l’ouverture s’inaugure donc en 1734, à distance des modèles français et privilégiant des réalisations beaucoup plus complexes. Un an avant que Bach ne fasse sonner sa dernière ouverture à la française pour orchestre à Leipzig, Telemann avait fait paraître en 1733 à Hambourg une collection radicalement différente, qui n’avait rien à voir avec la musique d’église, intitulée Musique de table. Celle-ci était partagée en trois collections de musique, chacune composée de six mouvements reflétant les principaux genres instrumentaux : une « ouverture avec la suite », un quatuor, un concert, un trio, un solo et une conclusion. Cette collection, véritable somme et démonstration d’un art de composer cosmopolite, introduite par une liste de plus de 200 souscripteurs provenant de toute l’Europe, prenait aussi un regard rétrospectif sur l’ouverture : en l’intégrant dans un ensemble de genres instrumentaux dont l’accumulation faisait de la collection un véritable manuel de composition, Telemann lui déniait le statut spécifique qu’il lui avait encore reconnu quelques décennies plus tôt.90 Par-delà l’ouverture : les marqueurs du style français En dépit de son poids énorme, tant qualitatif que quantitatif, tant sur le plan de la théorie de la musique que sur le plan de la pratique des compositeurs, l’ouverture ne représente cependant pas la totalité des expérimentations allemandes dans le style français. D’autres genres, comme le petit ou le grand motet, ont aussi retenu l’attention des compositeurs. Surtout, si l’on se place à une échelle plus réduite, en-deçà de l’appellation générique, on observe un fourmillement de pratiques compositionnelles localisées qui ne sont plus immédiatement perçues comme spécifiquement françaises aujourd’hui, mais semblent avoir été consciemment liées au style français par les compositeurs qui les employaient. Certaines ne sont plus reconstructibles : les pratiques de basse continue jouent ainsi un grand rôle dans la distinction des styles français et italiens, mais aucun témoignage ne permet de savoir si Bach ou Telemann accompagnaient à la française certains mouvements ou à l’italienne certains autres. Les emprunts harmoniques sont difficiles à cerner avec précision, même si quelques études isolées ont déjà tracé la voie à une approche de ce type.91 Une diversité de pratiques d’écriture Revenons au complexe d’œuvres évoqué à propos du Gallicus Adventus de 1714. Nous avons observé que contrairement à la cantate Nun komm de Bach, celle que Telemann compose sur le même texte ne comportait aucune caractéristique française clairement identifiable. Cela ne signifiait pourtant pas qu’il n’y en avait aucune. En effet, au-delà de ce que nous entendons aujourd’hui comme une allusion claire au style français, une variété d’éléments pouvaient dans le cadre d’une pratique de composition être inspirés par des modèles français. L’un de ces éléments est l’écriture 89 90 91
Williams, Bach. A Musical Biography, p. 566. Laurenz Lütteken, « Telemann, Georg Philipp », in : MGG online. Sur les souscripteurs français, voir Thierry Favier, « Aufgeklärte Netzwerke ? Telemann und seine französischen Liebhaber », in : Telemann und die urbanen Milieus der Aufklärung, dir. Louis Delpech et Inga Mai Groote, Munich 2017, p. 110-169. Siegbert Rampe, « Bachs Piece d’Orgve G-Dur bwv 572: Gedanken zu ihrer Konzeption », in : Bachs Musik für Tasteninstrumente, dir. Martin Geck, Dortmund 2003, p. 333-369. Dominik Sackmann, « “Französischer Schaum und deutsches Grundelement” – Französisches in Bachs Musik », Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis, 28, 2004, p. 81-93.
– 271 –
Chapitre 5
à l’unisson des parties de violon. Nous avons vu que les collections d’ouvertures imprimées dans l’espace germanique, si elles comportent parfois deux parties séparées de violon, dupliquent toujours strictement le même texte musical dans chaque partie. Bach adopte cette caractéristique dans le premier mouvement de sa cantate : si les deux pupitres de violons sont copiés sur deux systèmes différents, ils jouent strictement la même chose. On observe d’ailleurs que les violons jouent à l’unisson pendant toute la cantate, sauf dans le récitatif qui illustre le Christ frappant à la porte où les cordes sont en pizzicato. Un des passages les plus représentatifs de ce point de vue est l’air « Komm Jesu, komm » où toutes les cordes jouent à l’unisson (Exemple 5.9). C’est précisément cet air que Telemann et TEL font également accompagner par les violons à l’unisson (Exemple 5.10). Notons enfin le fait que chez Telemann comme chez TEL, les hautbois doublent toujours les violons, ce qui n’est pas sans rappeler la pratique française.92 La partition de Bach ne fait pas figurer de hautbois, mais il est possible d’imaginer que s’ils avaient été présents, ceux-ci auraient aussi joué colla parte avec les violons. Ces deux caractéristiques sont donc sans doute des reliquats de la méthode de composition française, même s’ils ne sont pas immédiatement identifiable comme tels pour nos oreilles contemporaines. Exemple 5.9. Johann Sebastian Bach, Nun komm der Heiden Heiland bwv 61, troisième mouvement, mes. 1-5. Violin I
&
9 & 8 Ϊ
Violin II
&
9 & 8 Ϊ
Viola 1
Viola 2
Tenor
Cello
B B B ?
Ÿ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ ™
Ÿ ‰ ‰ œ œ œ œ œ™ J
B 98 Œ ™
œ œ œ œ œŸ™ ‰ ‰ J
B 98 Œ ™
œ œ œ œ œŸ™ ‰ ‰ J
Ÿ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ ™ Ÿ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ Ÿœ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ ™ œ J œ œ œ œ œ œ œ Ÿœ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ ™ œ J
° 9 ¢& 8 ‹ ? 98
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
œ
j œ œ
œ œ # œJ œ J
j œ œ
j j œ œ
Plus largement, les spécificités stylistique du Französischer Jahrgang de Telemann mises en évidence par Ute Poetzsch-Seban méritent d’être brièvement mentionnées : l’emploi occasionnel d’un petit chœur contrastant avec un grand chœur, la prédilection pour un style choral homophone, la prédominance de changements de mesure dans les récitatifs, le caractère sobre et déclamé des airs qui renoncent à l’utilisation de vocalises.93 De son côté, Christiane Jungius a aussi noté la présence à partir du dimanche de Pâques de deux parties d’alto, et d’une écriture pour cordes volontiers colla parte avec le chœur.94 La triade d’œuvres que Telemann compose pour les trois jours de Pâques 1715 constitue un ensemble intéressant : nous avons déjà vu que la cantate pour le premier jour était introduite par une ouverture à la française. Au deuxième jour de Pâques, Telemann compose le dictum en forme d’écho avec un mètre ternaire. Au troisième jour, il conclut 92
93 94
D-F, Ms. Ff. Mus. 1285. Le matériel ne consiste qu’en copies faites après le départ de Telemann. Les hautbois n’apparaissent pas dans les deux partitions, copiées par Heinrich Valentin Beck entre 1721 et 1734 et Johann Balthasar König, mais dans les parties séparées copiées en 1727 par Johann Christoph Bodinus. La ligne « Clarini piccoli ò Corni » est en do dans les deux partitions, mais en fa dans les parties séparées. Poetzsch-Seban, Die Kirchenmusik von Georg Philipp Telemann und Erdmann Neumeister, p. 167-172. Jungius, Telemanns Frankfurter Kantatenzyklen, p. 295.
– 272 –
L'invention allemande du style français
Exemple 5.10. TEL, Nun komm der Heiden Heiland, troisième mouvement, mes. 1-11. D-Müg, Nr. 355 et 395. Allegro
&b
&b c œ
unisoni
Bb B ?
Bb c œ œ œ
b
Vla.
S
œœ œ
œ œ
œ œ œ
œœ œ
œ œ
œ
nœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ nœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
° bc ¢& ? c œœœœœ œ œ œ b Allegro
b
5 Vln.
œ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&b
œœœœœœœ œœœœœœœ œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ
œ œ œ œ œ Bb J ‰ œ ‰ ° ¢& b
œ œ œ œœ œ œ œ
∑
œ ‰
∑
œ œ œ œœœœœ œœœ Œ ˙ ∑
∑
˙
?b œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ
œ
Œ ˙
œœœœ
Ó
∑
œœœœ ˙
Ó
Komm Je - su
B
˙
Ó
Ó ∑
Ó
˙ ˙
˙ b œ œ ™ œ œ ™ n˙ Komm Je - su
komm!
˙
˙
˙
Ó
Ó Ó Ó
komm
˙
Ó
sa cantate avec un rondeau, bien que cela ne soit pas prévu par Neumeister dans la composition du texte. Pour le premier dimanche après l’épiphanie, Telemann compose enfin l’aria finale sous forme de chaconne. Mais au-delà de ce groupe d’œuvres, les spécificités harmoniques du style français semblent aussi avoir été au cœur des préoccupations des compositeurs. On connaît en effet l’usage fréquent que Bach fait de l’accord de dominante sur médiante, qui constitue l’un des lieux communs harmoniques les plus frappants dans les pleins jeux des livres d’orgue français. Cet accord est ainsi utilisé de manière tout à fait évidente dans la fantaisie pour orgue bwv 542. D’autres formes de dissonances sont également présentes dans la Pièce d’orgue bwv 572 dont le mouvement central reprend de façon démonstrative les codes du plein jeu à la française. Mais au-delà de ces outils harmoniques ponctuels, un certain type de modulation semble également avoir connoté, entre 1700 et 1730, le style français dans l’espace germanique : le changement de mode sur la tonique.95 Stabilité tonale et changement de mode L’apparition, la codification et la réception du style français au xviie siècle ont surtout été étudiées sous l’angle des genres musicaux, des techniques d’exécution instrumentale et vocale, des questions rythmiques et des pratiques d’orchestration. En revanche, ni les spécificités harmoniques
95
Pour un aperçu complet sur cette question, voir Louis Delpech, « Der Wechsel in die Varianttonart als Merkmal des französischen Stils um 1700. Lully, Couperin, Bach, Händel », in : Dur versus Moll. Zur Geschichte der Semantik eines musikalischen Elementarkontrasts, dir. Hans-Joachim Hinrichsen et Stefan Keym, Cologne 2020, p. 131-153.
– 273 –
Chapitre 5
ni les aspects tonaux du style français n’ont véritablement retenu l’attention des chercheurs.96 Ceci peut être expliqué par plusieurs facteurs : en cette époque de transition entre la modalité et la tonalité, aucune source théorique ne semble reconnaître de spécificité française dans l’utilisation des tons. En outre, les préjugés sur le conservatisme supposé des théoriciens français – qui se seraient contentés, contrairement à leurs collègues allemands ou italiens, de reproduire la vulgate harmonique de Zarlino pendant tout le xviie siècle – et sur l’introduction tardive de la basse continue en France ont longtemps détourné les chercheurs de ces questions.97 De ce fait, la discussion sur l’usage des tons en France reste le plus souvent limitée, avant le Traité de l’harmonie (1722) de Jean-Philippe Rameau, à la caractérisation des modes dans les Règles de Composition de MarcAntoine Charpentier – un texte qui est davantage un aide-mémoire pédagogique qu’un traité de composition, et dont le caractère confidentiel fut souvent oublié au xxe siècle.98 Les œuvres de Charpentier rappellent en outre que les pratiques harmoniques des compositeurs français étaient loin d’être homogènes et monolithiques, puisque son œuvre fourmille d’emprunts harmoniques à des modèles italiens (en particulier Carissimi) qui montrent la porosité des frontières entres les styles nationaux ainsi que la fluidité et le métissage des langages harmoniques.99 Pourtant, on a souvent remarqué que la polarité entre le mode majeur et le mode mineur avait été affirmée de manière particulièrement nette dans le discours théorique de langue française : très tôt, les douze modes de l’Antiquité ou les huit modes ecclésiastiques furent réduit aux deux modes de do et de ré, sur la base de leur grande ou de leur petite tierce.100 Dès les années 1670, Antonio Bertali évoquait une « opinion française selon laquelle il n’y aurait pas plus de deux modes, l’un par B mol, l’autre par B carre ainsi qu’ils disent.101 » Charles Masson affirme aussi, dans le livre que possédait Cousser, que presque tous les modes antiques et ecclésiastiques se ramènent au majeur et au mineur par transposition.102 Dans sa méthode de chant, Jean Rousseau leur attribue, sur la base de considérations étymologiques et visuelles, un affect fondamental : le mineur ou bémol est « plus propre pour le tendre » et se trouve représenté par une « figure ronde […] propre à rouler doucement », tandis que le majeur ou bécarre est « gay » et représenté
96
97 98 99 100
101
102
Voir cependant Bertrand Porot, « Tonalité et modalité dans les pièces de clavecin de d’Anglebert : éléments pour une analyse harmonique », Musurgia, 7/1, 2000, p. 61-87, ainsi que « Les tonalités dans les divertissements des opéras de Lully et Quinaul : approche dramaturgique », in : Formes et formations au dix-septième siècle, dir. Buford Norman, Tübingen 2006, p. 133-147. Jean Duron, « Le Bel édifice : l’architecture des tonalités », in : Vénus & Adonis (1697), tragédie en musique de Henry Desmarest. Livret, étude et commentaire, éd. Jean Duron, Sprimont 2006, p. 151-156. Gérard Geay, « Le style des vingt-quatre violons et les premières compositions du jeune Lully », in : La naissance du style français (1650–1673), dir. Jean Duron, Wavre 2008, p. 115-134. Voir par exemple Thomas Christensen, Rameau and Musical Thought in the Enlightenment, Cambridge 1993, p. 44-45. Robert Zappula, Figured Bass Accompaniment in France, Turnhout 2000, p. viii. Theodora Psychoyou, « Les Règles de composition par Monsieur Charpentier : statut des sources », in : Les Manuscrits autographes de Marc-Antoine Charpentier, dir. Catherine Cessac, Wavre 2007, p. 201-221. Graham Sadler et Shirley Thompson, « The Italian Roots of Marc-Antoine Charpentier’s Chromatic Harmony », in : Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (1650-1750). Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples (1650-1750), dir. Anne-Madeleine Goulet et Gesa zur Nieden, Kassel 2015, p. 546-570. Walter Atcherson, « Key and Mode in Seventeenth-Century Music Theory Books », Journal of Music Theory, 17/2, 1973, p. 204-232, ici p. 225 : « The second option, C major paired with D Dorian, seems to be a French phenomenon. » Voir aussi Porot, « Tonalité et modalité », p. 64 : « La réduction des modes à deux est, en fait, une notion qui apparaît assez tôt en France et qui semble être une spécificité théorique de ce pays. » Antonio Bertali, Instructio Musicalis : « einer französischen Meinung, daß nit mehr als zwey Toni seindt, einer per B moll, der ander per quadro von ihnen genent. » Cité d’après Hellmut Federhofer, « Zur handschriftlichen Überlieferung der Musiktheorie in Österreich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts », Die Musikforschung, 11/3, 1958, p. 264-279, ici p. 275. Masson, Nouveau Traité des Règles, p. 9 : « Mais afin de faciliter les moyens de parvenir plus promptement à la Composition, je ne montrerai que deux Modes, sçavoir le Mode majeur, & le Mode Mineur : dautant que ces deux Modes posez quelquefois plus haut & quelquefois plus bas, renferment tout ce que l’Antiquité a enseigné, [et] même les huit Tons que l’on chante dans l’Eglise, excepté quelques-uns qui se trouvent irreguliers. »
– 274 –
L'invention allemande du style français
par une « figure quarrée » dont l’expérience nous apprend qu’elle « ne peut rouler qu’en sautillant, par bonds, & en faisant quelque bruit.103 » Les deux modes fondamentaux n’étaient pas seulement caractérisés par leur grande ou leur petite tierce ni par les affects qu’ils suscitaient, mais aussi par le nombre et la position de leurs degrés cadentiels, ou « cordes ». D’après Charpentier, les modes mineurs en possèdent trois : la tonique, la médiante et la dominante. Au contraire, les modes majeurs n’en possèdent que deux : la tonique et la dominante.104 Il y a donc pour Charpentier une asymétrie entre les deux modes : alors que dans le mode mineur, on peut cadencer à la médiante (autrement dit : au relatif majeur) sans sortir du ton d’origine, l’inverse n’est pas vrai, puisqu’on ne peut cadencer au sixième degré (autrement dit : au relatif mineur) dans le mode majeur sans sortir du ton d’origine. L’espace tonal décrit par Charpentier ne connaît donc pas la notion de ton relatif, mais seulement la notion de finale à laquelle tout se rapporte, y compris les cordes de modulation. Cette absence singularise fortement la pratique harmonique des compositeurs français par opposition à celle de leurs collègues allemands ou italiens. En effet, on peut observer chez ces derniers une standardisation progressive de la modulation au ton relatif à partir des années 1680 : dans la sonate en trio italienne avant Corelli par exemple, Florian Edler a noté que la modulation au ton relatif remplaçait progressivement la modulation à la dominante, aussi bien dans les tons majeurs que dans les tons mineurs.105 La valeur structurelle du ton relatif est également manifeste dans de nombreux autres genres vocaux et instrumentaux, aussi bien en Italie qu’en Allemagne.106 On trouve certes occasionnellement des modulations au ton homonyme chez Corelli ou Vivaldi, mais celles-ci restent exceptionnelles et ne remettent jamais en cause le caractère structurant du ton relatif comme modulation préférée.107 En France au contraire, cette fonction est occupée par le ton homonyme : celui-ci reste le vecteur harmonique privilégié par tous les compositeurs, notamment entre deux mouvements successifs, du moins tant que l’on peut rester dans le voisinage des tonalités habituelles : le changement de mode se fait couramment en do, en ré et en sol, mais pas en fa, en si, en la ou en mi. Le ballet est un bon exemple pour observer l’évolution de cette pratique entre 1650 et 1720, dans la mesure où le changement de mode est fréquemment utilisé comme élément de contraste entre deux mouvements dansés. Celui-ci joue déjà un rôle décisif dans le Ballet Royal de la Nuict, premier ballet de cour représenté après la Fronde (1653) avec la collaboration d’Isaac de Benserade et Jean de Cambefort. Après l’ouverture en sol mineur, les deux premiers récitatifs sont conçus comme un dyptique contrastant : au « Récit de la Nuict » en ré mineur et en mètre binaire, chanté en soliste par « Mr de Cambfort » et caractérisé par ses valeurs longues, ses harmonies suaves et son caractère rêveur, succède un vigoureux « Récit des Heures » en ré majeur, chanté alternativement par un soliste et un chœur, dont le caractère énergique et le mètre ternaire viennent souligner la dimension solaire. Mais aussitôt après, Cambefort poursuit son récit avec la seconde strophe, revenant ainsi au mode mineur. Les mouvements suivants sont également caractérisés 103 104
105 106
107
Jean Rousseau, Méthode claire, certaine et facile pour apprendre à chanter la musique, Amsterdam 1710 [Paris 1678], p. 73. Marc-Antoine Charpentier, Règles de composition, in : Catherine Cessac, Marc-Antoine Charpentier, Paris 1988, p. 454 : « Les modes ont trois cordes essentielles, savoir la finale qui est la note du mode, la tierce au-dessus de la finale que l’on appelle la médiante, et la quinte au-dessus de la finale qu’on appelle la dominante. Les modes qui ont la tierce majeure n’ont que deux cordes essentielles, savoir la finale et la dominante. Les modes qui ont la tierce mineure ont trois cordes essentielles, savoir la finale, la médiante et la dominante. » Florian Edler, « Der Dur-Moll-Kontrast in der italienischen Triosonate », Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie, 3, 2006, p. 307-326. Voir par exemple Michael Talbot, « How Recitatives End and Arias Begin in the Solo Cantatas of Antonio Vivaldi », Journal of the Royal Musical Association, 126/2, 2001, p. 162-192. Ellen Harris, « Harmonic patterns in Handel’s operas », in : Eighteenth-century music in theory and practice : Essays in honor of Alfred Mann, dir. Mary Ann Parker, Stuyvesant 1994, p. 77-118. Bella Brover-Lubovsky, « ‘Die Schwarze Gredel’, or the Parallel Minor Key in Vivaldi’s Instrumental Music », Studi Vivaldiani, 3, 2003, p. 105-131.
– 275 –
Chapitre 5
par des changements réguliers de mode : les deux premières entrées sont en sol mineur, la 3e et la 4e en sol majeur. On retourne en sol mineur à partir du 2e Air pour les chasseurs. Le reste du ballet alterne constamment entre les deux modes de sol, à l’exception d’un court épisode à la médiante en si bémol majeur (Tableau 5.2). On note ainsi l’extrême stabilité tonale de l’ensemble, qui ne quitte guère le ton de sol, tantôt par bémol, tantôt par bécarre – ce procédé faisant apparaître la coloration majeure ou mineure comme une qualité secondaire du ton principal plutôt que comme un changement de ton. Tableau 5.2. Tonalités des mouvements dans le Ballet Royal de la Nuict von Isaac de Benserade und Jean de Cambefort [et al.], 1653. F-Pn, Rés. F-501. [Première Partie]
[Deuxième Partie]
Ouverture
sol m 1e Entrée, 3 Parques et la Vieillesse et la tristesse
Récit de la Nuict « Languissante clarté »
ré m
Récit de Venus « Fuyez bien loin »
do M
M
2e Entrée, Les Jeux les Ris l’Hymen
sol M
Récit des Heures « Vous poussez le soleil » La Nuict « Je descends pour charmer »
m
3 Entrée, Deux Pages
Chœur « Tenez donc vos rideaux »
M
4e Entrée, Roger Bradamante & toute sa compagnie
m si b M
1re Entrée, Les 4 Heures
sol m
2e Air pour les mesmes
m
6 Entrée, Medor & Angélique
2e Entrée, Protez
m
2e Air pour les mesmes
M
3e Entrée, 5 Nereïdes
M
7e Entrée, Cardet & Guidon
m M
4e Entrée, 6 Chasseurs
5e Entrée, La Nourisse & l’Enfant
sol m
M sol m
M
8e Entrée, Richardel & Fleur Despine
2e Air pour les mesmes
m
2e Air Triolet pour les mesmes
M
5e Entrée, 2 Bergers & deux bergeres
m
9e Entrée, Thetis & Pelée
m
6e Entrée, Un Mercier
M
2e Air pour les mesmes & 3 Grasses
M
2e Air pour les mesmes et 2 Bandits
m
3e Air, Mercure en mercier
m
3e Air pour les mesmes un Carosse
m
7e Entrée, 2 Galants & deux coquettes
m
2e Air pour les mesmes
M
8e Entrée, Les Egyptiens et les Egyptiennes
m
9e Entrée, 2 Gagnes-petis
M
10e Entrée, Les Boutiques se ferment
m
11e Entrée, 3 Allumeurs de Lenternes
M
12e Entrée, 4 Porteurs de Chaisse
m
2e Air les mesmes
M
13e Entrée, 2 Filoux
m
14e Entrée, Les Gueux les estropiez & soldats
m
Les ballets plus tardifs témoignent d’une pluralisation progressive des cordes de modulation et de l’affaiblissement de la stabilité tonale à l’échelle de l’œuvre. Ces deux évolutions sont visibles dans le Ballet des Saisons lwv 15 créé en 1661. Le début est structuré autour d’une alternance entre sol mineur et majeur. À partir du Récit des Masques au milieu de la 7e Entrée cependant, on module en si bémol majeur, médiante de sol mineur sur laquelle s’achève le ballet. Le centre tonal est encore plus instable en 1669 dans le Ballet de Flore lwv 40 : alors que le changement de mode se fait plus rare, l’apparition de modulations à la sous-dominante, à la dominante ou même au ton relatif se multiplie et devient la norme. Après le début en ré mineur, la 4e Entrée module vers sol mineur ou majeur, et l’on se trouve à partir de la 7e Entrée en si bémol majeur ou en fa majeur, à partir de la 10e en sol majeur ou mineur, et dans la dernière Entrée en do majeur. Le changement de mode sans changement de ton est donc seulement employé sur la corde de sol et se fait plus rare, perdant son caractère structurant pour se limiter aux couples de mouvements contrastants (Tableau 5.3).
– 276 –
L'invention allemande du style français
Tableau 5.3. Tonalités dans le Ballet de Flore lwv 40 de Jean-Baptiste Lully. Ouverture
lwv 40/1
ré m
Récit de l’Hyver
lwv 40/2
–
Chœur des Glaçons
lwv 40/3
–
–
–
I. Entrée, Le Soleil
lwv 40/4
–
II. Entrée, Flore et ses Compagnes
lwv 40/5
–
III. Entrée, Les Nayades et les Driades
lwv 40/6
–
Bourrée pour les mesmes
lwv 40/7
–
Second couplet
IV. Entrée, Le Printemps
lwv 40/8
sol m
V. Entrée, Les Jardiniers et les Galants
lwv 40/9
sol M
VI. Entrée, Les Galants et les Dames
lwv 40/10
sol m
Menuet pour les mesmes
lwv 40/11
–
VII. Entrée, Les Esclaves
lwv 40/12
si b M
VIII. Entrée, Les Débauchez
lwv 40/13
–
Menuet pour les mesmes
lwv 40/14
–
Serenade pour des nouveaux Mariez, Ritournelle
lwv 40/15
fa M
L’Hymen « Si vous vous aymez bien tous deux »
lwv 40/16a
–
Tous trois
lwv 40/16b
–
L’Amitié, la Fidélité « Amour veut qu’on suive »
lwv 40/17
–
IX. Entrée, Le Marié et la Mariée
lwv 40/18
si b M
Une Musicienne
lwv 40/19
fa M
X. Entrée, L’Aurore
lwv 40/20
sol m
XI. Entrée, Les Heures et les Graces
lwv 40/21
–
XII. Entrée, Vertumne
lwv 40/22
sol M
Plainte de Vénus, sur la mort d’Adonis. Ritournelle
lwv 40/24a
sol m
Vénus « Ah quelle cruauté »
lwv 40/23b
–
XIII. Entrée, Proserpine et deux de ses Compagnes
lwv 40/25
–
Pluton enlevant Proserpine
lwv 40/26
–
Les Demons
lwv 40/27
sol M
XIV. Entrée, Les Héros
lwv 40/28
sol m
Bourrée pour les mesmes
lwv 40/29
sol M
lwv 40/30-32
–
XV. Entrée, Prelude pour les Quatre Parties du Monde
lwv 40/34a
do M
Recit de l’Europe
lwv 40/34b
–
Choeur des quatre parties du monde
lwv 40/36a
–
La marche des Nations
lwv 40/33
–
Air pour l’Europe
lwv 40/35
–
Canaries
lwv 40/38
–
Menuet pour les Faunes
lwv 40/39
–
Second recit des Quatre Parties du Monde
lwv 40/36b
–
Second Choeur des Quatre Parties du Monde
lwv 40/37
–
Airs pour Jupiter et le Destin
– 277 –
Chapitre 5
Mais si l’on constate une diversification des axes de modulation dans le cadre du ballet de cour à partir de 1660, le changement de mode reste cependant un outil privilégié, y compris dans la tragédie en musique – aussi bien lors des représentations scéniques que dans les compilations instrumentales d’airs à jouer qui en sont tirées. Produite en 1686, l’Armide de Lully fournit un bon exemple, tant à cause de la planification méticuleuse qui a manifestement présidé au choix des tonalités, qu’à cause du statut canonique qu’elle acquit rapidement comme un des plus hauts modèles du genre. Bien que des modulations au ton parallèle ou à la dominante soient présentes – par exemple dans le prologue en do majeur, où les tons de la mineur et de sol mineur fonctionnent comme les antipodes de la tonalité principale –, le changement de mode conserve un fort potentiel dramatique et est employé pour colorer la tonalité principale. Au premier acte (I/3), le rondeau en do majeur qui représente le point culminant du triomphe d’Armide se trouble brusquement avec l’apparition d’un nouveau refrain en do mineur (mes. 329) alors même que le texte reste triomphant (« Que la douceur d’un triomphe est extrême, Quand on n’en doit tout l’honneur qu’à soy-même »). À l’évidence, le compositeur souligne ici l’ironie tragique d’une telle phrase, Renaud ayant en fait battu les armées d’Armide qui l’ignore encore, tout en anticipant l’irruption dramatique d’Aronte, qui interrompt les réjouissance en annonçant la déroute dans le ton de do mineur. Mais la première mention du nom de Renaud (I/4, mes. 21-22) est immédiatement suivit d’un retour en do majeur jusqu’à la fin de l’acte, le chœur laissant éclater sa fureur et exprimant sa soif de vengeance. Au cours du troisième acte, alors qu’Armide avoue à Sidonie qu’elle aime Renaud, on passe régulièrement de sol mineur à sol majeur : le mode suit les paroles de la protagoniste qui balance entre son refus d’aimer Renaud et l’abandon à ses sentiments. Le changement de mode est également visible dans le répertoire de suites pour le clavecin, où l’on observe la tendance progressive à grouper les pièces d’un même ton, mais en alternant entre le mode majeur ou le mode mineur. Dès 1677, Nicolas Lebègue avait groupé dans son premier livre de Pièces de Clavecin les suites par tons : ré mineur, ré majeur, sol mineur, sol majeur, sans toutefois que l’on puisse conclure à la présence de deux ou quatre suites.108 Les quatres suites publiées par d’Anglebert (1689) trahissent aussi la prévalence de la relation homonyme à l’échelle de la collection : la première suite est en sol majeur, la seconde en sol mineur, la troisième en ré mineur, la quatrième en ré majeur. Cette évolution est surtout visible chez Couperin, dont les nombreuses suites (« Ordres ») publiées dans les Pièces de clavecin regroupent aussi des pièces dans les deux modes. Presque toutes les suites du premier livre sont caractérisées par une ambivalence modale : la 1ère suite est en sol majeur et mineur, la 2e en ré majeur et mineur, la 3e en do mineur et majeur, la 4e en fa majeur et mineur, la 5e en la majeur et mineur. En revanche, le sixième ordre en si bémol majeur ne comprend naturellement aucune pièce en si bémol mineur. Le changement de mode apparaît aussi à une échelle plus réduite : à l’intérieur de la 7e suite en sol majeur, la succession de quatre pièces sur les âges de la vie (« Les Petits Ages ») est marquée par un changement de mode constant. Même à l’intérieur d’une pièce, une tonalité mineure peut changer de mode dans la deuxième partie, par exemple dans La Babet en ré mineur (2e ordre), ou dans Les agrémens et La Villers en la mineur (5e ordre), ou encore dans le quatrième couplet du rondeau L’épineuse (26e ordre) qui passe de fa dièse mineur au ton « épineux » de fa dièse majeur. En revanche, le changement de mode à partir d’un ton majeur n’est pas pratiqué à l’échelle d’une partie. Mais il peut se produire à l’échelle de quelques mesures : la première Allemande du 5e ordre (La Logivière en la majeur) passe à la dominante mineure (mi mineur, mes. 6) au beau milieu d’un point d’orgue qui conduit fugitivement, après la majorisation et dominantisation de la résolution, à entendre le mode mineur de la tonique (mes. 7). Le tout est répété sur la dominante de la dominante, où l’on passe de si majeur à si mineur avant de retourner en si majeur, pour atterrir finalement dans le mode mineur de la dominante (mi mineur), majorisée in extremis pour conclure la première partie (Exemple 5.11). 108
Betrand Porot, « Tonalité et modalité », p. 66.
– 278 –
L'invention allemande du style français
Exemple 5.11. François Couperin, Premier Livre de Pièces de Clavecin, Cinquième Ordre, La Logivière – Allemande, mesures 5-10.
r m M m r # # # c œjœ ™ œ mœ ™ œ œ œ œœ œr œ œœ n œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œj œ ™ n œ mœ ™ œ # œ œ œ œœ œ n œœ œ œ œ œr œ œœ ™ & œœ œ œœ œ œ™ œ œ œ œ RRJ R R RRJ M m Œ œ #˙ n œœ n œ œ œ œ # œ œ ˙œ ™ œ œ #˙ Œ ? # # # c œœ œ œœ œ ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ œ
{
m m œœ œjn œ œ œ # œ ™ œ œ ### œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ œœ & œ œ ≈ œR œJ J ‰ J R M n œ # œœ ? # # # n œœ˙ œ nœ œ œ œ
4
{
La liste de ces exemples pourrait être poursuivie. La musique d’église n’en est pas avare : dans le Te Deum lwv 55 de Jean-Baptiste Lully, chaque verset est en do majeur, à l’exception de quelques courts emprunts en sol majeur, la mineur, fa majeur et ré mineur, le retour immédiat dans le ton principal permettant à la ritournelle introductive de réapparaître au ton principal dans différents mètres et de venir ponctuer chaque verset. C’est seulement à la fin de la pièce pour le « Dignare Domine » que le compositeur change soudain de mode, passant en do mineur. Ce tournant inattendu vient souligner de façon saisissante le caractère suppliant du texte, dramatisant par ce bref assombrissement la dimension sotériologique des deux dystiques finaux, ce qui contribue également à distinguer très clairement ce passage du reste de la pièce. À titre de comparaison, la passage en la mineur qui accompagnait le début de la symphonie du verset « Patrem immensae majestatis », tout en solennisant le discours, ne produisait pas un tel effet de contraste. Souligné par l’allure grandiose du rythme pointé, le changement de mode est également manifesté par le seul changement d’armature de la pièce, puisque deux bémols sont ajoutés pour la première et la seule fois. Dans le répertoire d’orgue, les offertoires offrent un lieu privilégié de changement de mode : seules pièces qui ne soient pas soumises à la logique de l’alternatim, elles peuvent moduler librement. Le changement de mode dans la partie centrale devient de ce fait un lieu commun du genre, exemplifié par le Grand Dialogue du troisième Livre d’orgue de Marchand ou les deux offertoires de la Messe pour les Paroisses et de la Messe pour les Couvents de François Couperin : dans les deux cas, do majeur devient do mineur pour la partie contrapunctique centrale, avant de revenir dans le mode majeur pour la dernière partie. Moduler à la française Les compositeurs germaniques semblent avoir eu tout à fait conscience de cette spécificité modale du style français, puisqu’ils l’utilisent dans leurs propres compositions à la française. Les Six Suites avec leurs Préludes pour le Clavecin bwv 806-811 de Bach font systématiquement apparaître un tel changement de mode dans les paires de danses alternées qui se situent juste avant la gigue finale, au caractère léger et parfois populaire. L’emploi de cette modulation témoigne ainsi que cette collection de suites, qui se distingue aussi par des détails d’ornementation et l’usage d’une terminologie française, est peut-être la plus typiquement gallicane que Bach ait composée.109 Dans
109
Williams, Bach. A Musical Biography, p. 218 : « In conveying so many details of the usual dances, the ‘English Suites’ are the most French of Bach’s sets, especially as copied and ornamented (on uncertain authority) by his pupils. »
– 279 –
Chapitre 5
ce cadre, l’alternance entre les deux danses s’accompagne toujours d’un changement de mode : entre les deux Bourrées de la 1e suite en la majeur (bwv 806/6-7), entre les deux Bourrées de la 2e suite en la mineur (bwv 807/5-6), entre la première Gavotte et la « Gavotte II ou musette » de la 3e suite en sol mineur (bwv 808/5-6), entre le Passepied I en Rondeau et le Passepied II de la 5e suite en mi mineur (bwv 810/5-6), ainsi qu’entre les deux Gavottes de la 6e suite en ré mineur (bwv 811/5-6). Seuls les deux Menuets de la 4e suite en fa majeur ne présentent pas seulement un changement de mode, mais aussi un changement de ton, le second étant en ré mineur, sans doute pour éviter de toucher le ton de fa mineur. On observe le même phénomène dans l’Ouvertüre nach französischer Art bwv 831. Parmi les trois paires de danses qui figurent dans cette suite (deux Gavottes et deux Passepieds entre la Courante et la Sarabande, ainsi que deux Bourrées entre la Sarabande et la Gigue), la première et la dernière paire restent en si mineur, mais le second Passepied module de manière très surprenante en si majeur. L’usage de cette tonalité rare et difficile s’explique par le fait que la première version de cette ouverture était en do mineur : le passage en do majeur ne représentait alors aucune difficulté particulière. On trouve également ce changement de mode dans les suites pour orchestre : la 2e Bourrée de la 1e Suite bwv 1066 est en do mineur, alternativement avec la 1e Bourrée en do majeur. À l’inverse, les Suites pour le clavessin bwv 812-817 ne présentent pas de changement de mode à la tonique, bien que les tonalités aient très bien pu le permettre, et que l’on y trouve aussi des paires de danses légères jouées alternativement. Dans un autre cas, Bach change également le mode de la tonique de façon plus locale : dans l’Ouverture de la Suite pour orchestre bwv 1069 en ré majeur, on retrouve un procédé très similaire à celui que nous avons observé dans la Logivière de Couperin : sur un point d’orgue, à la fin de la première et de la dernière partie, le mode de la dominante se trouve fugitivement changé, ce qui colore l’atmosphère festive d’une teinte plus sombre. Aux mesures 19-21 on passe successivement de la majeur à la mineur avant de retourner en majeur pour la cadence qui conclut la première partie. Lors de la reprise transposée aux mesures 184-187, le changement de mode affecte la tonique, passant de ré majeur à ré mineur (Exemple 5.12). Le mouvement introductif de la cantate bwv 110 Unser Mund sei voll Lachens, une version retravaillée de cette ouverture, présente les mêmes caractéristiques. Georg Friedrich Händel semble également avoir eu conscience de cette convention. Son opéra Ariodante hwv 33 créé à Londres en 1735 est très intéressant de ce point de vue, puisqu’en plus de l’opéra proprement dit, Händel composa aussi la musique pour les intermèdes chorégraphiés par la danseuse française Marie Sallé et sa troupe, qui avaient été engagés pour la saison 1735-1736 au théâtre de Covent Garden. Le compositeur se voyait donc obligé de combiner le modèle traditionnel de l’opera seria en italien avec de la musique de danse française.110 Cet opéra, qui se caractérise par une planification très minutieuse et réfléchie des tonalités, se distingue également par le changement de mode à la tonique dans les divertissements. Après l’ouverture à la française en sol mineur et une gavotte dans le même ton, le premier acte commence avec l’air de Ginevra en sol majeur (« Vezzi, lusinghe ») et change donc d’entrée de jeu le mode de la tonique. La deuxième partie de la gavotte se distingue d’ailleurs par l’emploi du trio de vents à la française, deux hautbois et un basson (mesures 45-60). À la fin du premier acte, le ballet pastoral (« Ballo di ninfe, pastore e pastorelli ») ne présente pas de changement de mode sur la tonique, mais module au ton relatif : on passe de fa majeur (« Ballo ») à ré majeur (Musette I et II), avant de revenir en ré mineur (« Allegro ») puis en fa majeur (« Coro e Soli A tempo di Gavotta »). Après ce divertissement, le 2e acte commence en ré majeur. Le Ballet de la fin de l’acte II ne module pas, puisque les deux numéros (une « Entrée de’Mori » et un « Rondeau ») 110
Sur le modèle français dans cette période pour Händel, cf. Herbert Schneider, « Affinitäten und Differenzen zwischen Rameau und Händel in Opern der Jahre 1735–1737 », Händel Jahbuch, 50, 2004, p. 91-138 ; Monika Woitas, « Getantze Träume. Händel, Marie Sallé und die Verzauberung der Oper », Göttinger Händel-Beiträge, 14, 2012, p. 95-103 ; Stefan Keym, « Herrschaftssymbolik, Gattungskontext und Personalstil : Zur französischen Ouvertüre bei Lully und Händel », Händel Jahrbuch, 60, 2014, p. 317-334.
– 280 –
L'invention allemande du style français
Exemple 5.12. Johann Sebastian Bach, Ouverture bwv 1069, dernières mesures. Fl. 1, Ob. 1 Vl. 1
Vl. 2, Vla Ob. 2, 3
B.C
œ ° ## C œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ b œœ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ ‰ ™ œr œ ™ œ ˙ ## C ‰ ™ œr œœ ™™ œœ ‰ ™ œr œ ™ œ ˙œ ˙ œ ™™ œœ œœ ™™ œœ ˙ œ œ ™ œ ˙˙ ™ œœ œœ ™™ œ ˙˙ œ œ ™ œ b ˙‰ ™ b œœR œœ ™™ œœ ˙˙ œ ¢& ‰ ˙ œ R ? ## C
˙
œ
° # # œ œ œ œ œ œ œ œ n˙ & nœ œ œ œœ 5
¢&
##
? ##
n ˙˙ ‰™ ˙
‰™ œœ œœ ™ n œœ # ˙˙ ™ R
œ™ œ ˙
œ
œ™ œ ˙
œ
œj œ ™ œ œ ™™ œ œ ™ œj U w J J
r ™ œœ œœ ™™ # œœ # œœœ ™™ n œœœœ œœœ ™™™ œœ œ ™ œ œ™
jU œ ™ œ œœ ™™# œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ ww œœ œ ™ œJ œ
œ nœ œ œ œ œ œ œ # œ ™ œ œ ™ œ œ œ
œœ ‰™
œ™ œ ˙
œ œ n œ œ œ ™™# œ œ ™™
œœœœ œœœœ ˙
œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œœ œ œ œ ‰™ œ n œœ œ R
r ‰™ r œœ œœ œ œ œœ ‰™ œ œ R œ
œ™ œ
U w
restent dans la tonalité de l’air qui les précède, en mi mineur. L’acte III commence directement en ré mineur, mais le divertissement qui le conclut oscille entre ré majeur (« Coro »), sol mineur (« Gavotte ») et sol majeur (« Rondeau » et tous les mouvements suivants). Händel utilise donc aparemment ici le changement de mode de manière tout à fait consciente. Même ses brouillons laissent entrevoir un tel souci, puisque le travail sur le divertissement de l’acte II produisit certaines chutes qui furent réutilisées la même année pour l’opéra Alcina (Tableau 5.4). Alors que dans la version finale présentée le 8 janvier 1735, le divertissement de la fin du deuxième acte commence dans la tonalité du dernier air de Ginevra (mi mineur) et ne module plus jusqu’au début de l’acte III, Händel avait visiblement commencé par planifier un complexe plus important de mouvements, qu’il a finalement laissés de côté : après avoir entamé, dans la partition autographe, l’esquisse d’une Entrée des Songes agréables en sol majeur qu’il laissa inachevée, il consigna dans un cahier séparé quatre entrées pour les rêves – une Entrée des Songes agréables en mi majeur, une Entrée des songes funestes en la mineur, une Entrée des Songes agréables effrayés en la majeur, puis Le combat des Songes funestes et agréables en la majeur. Händel se souvient très probablement ici de l’exemple d’Atys, où la célébre « Entrée des Songes agréables » (lwv 53/58) est suivie d’une « Entrée des Songes funestes » (lwv 53/60). On voit ici que le ton de la majeur n’est pas seulement la synthèse entre mi majeur et la mineur, mais aussi le reliquat d’un changement de mode à la française. Si ces esquisses préliminaires avaient été conservées pour Ariodante, on aurait eu de plus un changement de mode entre l’air de Ginevra en mi mineur, la première entrée en mi majeur, et le rondeau conclusif en mi mineur. Les brouillons nous révèlent enfin que des danses avaient été prévues pour la fin du troisième acte, bien qu’elles ne furent jamais exécutées, avec une alternance entre sol majeur et sol mineur (HHA II/32, éd. Donald Burrows). L’exemple d’Ariodante est cependant fascinant pour une autre raison, puisque le changement de mode est également employé par Händel au sein même de l’écriture vocale, un cas de figure exceptionnel et à ma connaissance unique dans toute l’œuvre du compositeur. La deuxième partie de l’air « Tu preparati a morire », chanté au point culminant du deuxième acte par Ariodante qui vient d’être victime de la machination de Polinesso et se croit trompé par sa fiancée, passe en effet de mi majeur à mi mineur dans la partie centrale – exception d’autant plus frappante que tous les autres airs de l’opéra modulent, dans leur deuxième partie, au ton relatif, et juste avant la reprise du da capo, cadencent à la dominante, au relatif, ou au contre-relatif. Ce parcours tonal exceptionnel met au jour la singularité de cet air très particulier, qui contient la première annonce
– 281 –
Chapitre 5
Tableau 5.4. Georg Friedrich Händel, Ariodante hwv 33. Ton dans des divertissements dans les brouillons préparatoires. Ouverture
sol m
Gavotte
sol m
1
Aria Ginevra
I/1 Vezzi, lusinghe
sol M
15
Ballo di ninfe, pastore e pastorelli – Ballo
fa M
16
Musette I Lentement
ré M
16a
Air Lentement
sol m
17
Musette II Andante
ré M
18
Allegro
ré m
19
Coro et Soli A Tempo di Gavotte
20
Sinfonia
II/1
ré M
31
Aria Genivra Larghetto
II/10 Il mio crudel martoro
mi m
31
Entrée des Songes agréables, Fragment
fa M
sol M
31
Entrée de’Mori
31a
Entrée des Songes agréables
Alcina Acte II/28
mi m
31b-c
Entrée des Songes funestes
Alcina Acte II/29
la m
31d
Le combat des Songes funestes et agréables
Alcina Acte II/30
la M
32
Rondeau
mi m
45
Coro
ré M
mi M
46
Gavotte
sol m
46a
Gavotte
sol M
47
Rondeau
sol M
47a
Rondeau
sol M
47
Gavotte, Fragment
sol M
47
Bourrée
sol m
48
Andante allegro
sol M
49
Coro
sol M
du suicide d’Ariodante et dévoile le paradoxe tragique où l’enferme son héroïsme moral, le refus de porter la main sur son ami faisant de lui une figure christique qui préfère mourir plutôt que de commettre l’injustice. Dans cet air, le changement de mode sur la tonique creuse donc le contraste entre les deux parties du texte, et porte à incandescence la contradiction qu’ils renferment : dans la première partie, Ariodante menace de mort son rival, tandis qu’il affirme dans la deuxième partie que si jamais il avait vraiment été trompé par Ginevra, il en mourrait. Mais il est aussi possible de voir dans cette modulation au ton homonyme le reliquat d’une pratique que Händel venait d’expérimenter dans le cadre des divertissements à la française composés pour le même opéra.
La musique française comme objet de controverse « De gustibus non est disputandum » – des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Cette maxime est invoquée par deux écrivains allemands pour montrer la stérilité des débats sur la supériorité de la musique française ou italienne : Johann Mattheson et Johann Joseph Fux.111 Et pourtant, les débats sur les mérites comparés de la musique française et italienne parcourent toute l’Europe
– 282 –
L'invention allemande du style français
dans les premières années du xviiie siècle et contribuent de façon décisive à la naissance de la critique musicale.112 Dans l’espace germanique, la question du style français est traitée de façon très ponctuelle et éclatée : il n’existe pas de traité sur le style français comme il y en a sur le contrepoint, la basse continue ou le chant. C’est toujours à propos d’un autre sujet, dans une note de bas de page, en quelques phrases ou au détour d’un pamphlet que celle-ci se trouve mobilisée. Les controverses sur la musique française permettent donc d’observer l’émergence d’un discours théorique de langue allemande sur la musique française, mais aussi de faire apparaître les phénomènes d’appropriation et d’identification par lesquels les différents acteurs prennent position en fonction d’objectifs propres. Si les controverses se cristallisent autours d’idées, de positions, de procédés argumentatifs et de citations d’autorités, elles possèdent aussi souvent une face cachée et des enjeux implicites qui ne recouvrent pas forcément les termes exprimés dans le débat. Il faut donc faire la part des choses : sans nier la portée spécifiquement esthétique des prises de position sur la musique française qui rythment la vie musicale allemande entre 1710 et 1750, il convient de les replacer dans une série de tensions institutionnelles, sociales et culturelles qui dépassent de très loin la question du style français. Celui-ci apparaît comme le lieu de cristallisation d’enjeux multiples au croisement de plusieurs champs de savoir et de pouvoir.113 Sous le signe de la modernité Le débat allemand sur l’imitation des Français trouve son origine dans le cours donné à l’Université de Leipzig en 1687 par Christian Thomasius.114 Depuis lors, il est traversé par deux questions centrales : la galanterie et la modernité. Lorsque Johann Mattheson publie son premier livre en 1713, la notion de galanterie figure encore en bonne place dans le sous-titre programmatique que le jeune homme place en exergue de son ouvrage : « explication universelle et approfondie sur la manière dont un Galant Homme peut acquérir une idée complète de la grandeur et de la dignité de la musique.115 » Voir dans ce geste une simple stratégie éditoriale ou une coquetterie d’auteur serait une erreur. En effet, Mattheson fait de la galanterie non pas seulement une qualité individuelle partagée par les gens de qualité, mais bien l’une des trois composantes fondamentales de la musique, avec la mélodie et l’harmonie : Pour conclure ce chapitre, il faut encore noter que bien que l’on n’exige ordinairement que deux choses dans une Composition achevée, c’est-à-dire la Melodiam et l’Harmoniam, on ferait bien mal, par les temps qui courent, de ne pas y ajouter la troisième chose, c’est-à-dire la Galanterie, qui ne se laisse pourtant en aucun cas apprendre ni expliquer par des règles, mais que l’on ne peut acquérir qu’à travers un bon goût et un Judicium sain. Si l’on voulait faire une comparaison, au cas où notre lecteur ne serait pas assez galant pour comprendre ce que signifie la Galanterie dans la musique, on pourrait se servir d’un vêtement : le drap serait l’harmonie si nécessaire, la façon serait la mélodie que l’on doit apprivoiser, et la Borderie ou Broderie représenterait alors la Galanterie.116
111 112 113 114 115
116
Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 231. Johann Joseph Fux, Gradus ad Parnassums oder Anführung zur Regelmäßigen Musickalischen Composition, Leipzig 1742, p. 178. Georgia Cowart, Controversies over French and Italian Music, 1600-1750. The Origins of Modern Musical Criticism, PhD Dissertation, University of New Jersey, 1980. Voir notamment Antoine Lilti, « Querelles et controverses. Les formes du désaccord à l’époque moderne », Mil neuf cent. Revue d’ histoire intellectuelle, 25, 2007, p. 13-28. Thomasius, « Diskurs von der Nachahmung der Franzosen ». Johann Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, oder Universelle und gründliche Anleitung, wie ein Galant Homme einen vollkommen Begriff von der Hoheit und Würde der edlen Music erlangen, seinen Gout darnach formiren, die Terminos technicos verstehen und geschicklich von dieser vortrefflichen Wissenschaft raisonniren möge, Hambourg 1713. Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 137-138 : « Zum Beschluß dieses Capitels möchte noch überhaupt angekmerckt werden, daß, da man sonst zu einer bereits verfertigten Composition nur die zwey Stücke, nemlich : Melodiam & Harmoniam erfordert, man bey jetzigen Zeiten sehr schlecht bestehen würde, wofern man nicht das dritte Stück, nemlich die Galanterie hinzu fügte, welche sich dennoch auf keine Weise erlernen noch in Reguln verfassen läst, sondern bloß durch einen guten gout und gesundes Judicium acquiriret wird. Wolte man eine Comparaison haben, und wäre der Leser etwan nicht galant genug, zu begreiffen, was die Galanterie in der Music
– 283 –
Chapitre 5
Tout en parlant de musique, Mattheson se situe ici à la convergence de courants culturels et scientifiques beaucoup plus larges. De son vivant, il se plaignait déjà qu’on le considère uniquement comme un théoricien de la musique sans prendre en compte ses autres domaines d’activité.117 Les écrits musicaux de Mattheson doivent être rapprochés de ses autres productions dans des domaines aussi variés que la diplomatie, la littérature ou la théologie, et se trouvent ainsi inscrits dans un contexte intellectuel extrêmement riche. D’autre part, la mise en valeur de son inscription au sein de réseaux savants, diplomatiques et musiciens transnationaux permet d’avoir une idée plus juste de sa position, située au carrefour de milieux très différents.118 Une querelle des Anciens et des Modernes L’ouvrage de Mattheson n’était pas seulement une profession de foi optimiste et moderne dans la capacité de la musique à exprimer les valeurs fondamentales de la galanterie. Ouvert par un diagnostic sans appel sur la « décadence » de la musique en Allemagne, ce livre était aussi une déclaration de guerre aux musiciens de l’ancien monde, et appelait de ses vœux l’enterrement définitif de la « vieille musique ».119 Tous les lecteurs n’accueillirent pas cette profession de foi avec enthousiasme. Johann Heinrich Buttstett (1666-1727), organiste à Erfurt et ancien élève de Pachelbel, publia vers 1716 un texte de près de 200 pages qui était à la fois une défense des « fondements anciens, véritables, uniques et éternels de la musique » et une attaque en règle contre le traité de Mattheson. Buttstett lui reprochait « d’attaquer trop brutalement l’Antiquité, qu’on devrait pourtant vénérer », d’avoir « sans raison jeté aux orties » le système de solmisation de Guido d’Arezzo très utile pour l’enseignement du contrepoint strict, de commettre « plusieurs erreurs dans la description des tons ou des modes de la musique », et d’avoir « rendu les musiciens, ses compagnons, coupables de la décadence de la musique.120 » Il faut dire que Mattheson n’y allait pas de main morte : ciblant le corporatisme de la profession, il se moquait des « organistes » à tout propos et jouait les redresseurs de torts face à ses collègues encroûtés dans leurs habitudes. Buttstett lui reprochait pour sa part sa sophistication et son obscurité et le qualifiait de « galant homme » en mauvaise part.121 Dès le début de son traité, l’organiste affirmait que les « musiciens ont mis sous le tapis le style d’église, les motets et le contrepoint double, s’aidant au contraire de galanteries, de marches, de ballets, de menuets etc. dont ils font tout un foin, alors que ces choses ne représentent que les scories de la musique ».122 Dans sa réponse publiée quelques mois plus tard, Mattheson rejettait cet emploi du mot galant en notant non sans ironie que « la Galanterie est un mot bien difficile pour certains organistes.123 » Dès 1713, il avait relevé les difficultés éprouvées par certains organistes à composer une bonne ouverture à la française, un genre qui devenait sous leur plume trop long et trop ennuyeux.124
117 118 119 120 121 122
123 124
bedeute, so könte ein Kleid dazu nicht undienlich seyn, als an welchem das Tuch die so nöhtige Harmonie, die Façon die geziemende Melodie, und denn etwann die Borderie oder Broderie die Galanterie vorstellen möchte. » Wolfgang Hirschmann et Bernard Jahn, « Einleitung », in : Johann Mattheson als Vermittler und Initiator. Wissenstransfer und die Etablierung neuer Diskurse in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dir. Wolfgang Hirschmann et Bernhard Jahn, Hildesheim 2010, p. 9-10. Johann Mattheson, Texte aus dem Nachlass, éd. Wolfgang Hirschmann et Bernhard Jahn, Hildesheim 2014. Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 245. Johann Heinrich Buttstett, Ut, Mi, Sol, Re, Fa, La. Tota Musica et Harmonia Æterna, Leipzig [c.1716], préface non paginée. Voir par exemple p. 55-56. Buttstett, Ut, Mi, Sol, Re, Fa, La, p. 10 : « Auf die Music zu appliciren möchte man wohl sagen, daß die Musici den Stylum Ecclesiasticum, Motecticum, den Contrapunctum duplicem so gar unter die Banck getreten haben, sich hingegen behelffende mit Galanterien, Marchen, Balletten, Menueten &c. welche ob gleich grosses Wesen daraus gemacht wird, nur die Schlacken von der Music sind. » Mattheson, Das Beschützte Orchestre, p. 135. Voir par exemple la remarque sur les ouvertures, qui doivent être brèves et ne pas ressembler à celle des organistes qui les étirent sur trente-deux mesures. Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 171.
– 284 –
L'invention allemande du style français
Buttstett s’agaçait aussi de l’accumulation de nombreux termes étrangers, et en particulier français, sous la plume du jeune auteur hambourgeois. Lui déplaisaient en particulier les termes « Caprice » et « Boutade » que Mattheson avait empruntés aux dernières parutions françaises dans le domaine de la musique de chambre et du répertoire de viole de gambe.125 Une différence notable entre les deux textes réside en effet dans l’usage des langues étrangères et des citations : alors que Buttstett cite fréquemment de longs passages en latin et se réfère souvent à des autorités juridiques ou ecclésiastiques comme les Pères de l’Église, Martin Luther ou l’évêque de Hanovre Agostino Steffani, Mattheson parsème plus volontiers son texte de mots en français et ne cite jamais de longs passages, encore moins en latin. Cette différence montre bien le fossé intellectuel qui séparait les deux hommes. Buttstett contestait enfin fermement le privilège accordé par Mattheson à l’ouverture parmi les genres instrumentaux : Les ouvertures n’occupent justement pas le premier rang parmi toutes les pièces exécutées sur les instruments. D’autant qu’il ne se trouve presqu’aucun compositeur qui sache vraiment parvenir à la manière lulliste : le Capellmeister du prince de Schwarzburg [Philipp Heinrich] Erlebach, qui pouvait y approcher d’assez près, est désormais mort. Au contraire, il faut bien plus d’art pour parvenir à écrire des concertos à la manière des virtuoses italiens, comme Albinoni, Corelli et autres, ou bien à mon défunt maître Pachelbel pour ses sonates à deux chœurs, en particulier sa sérénade, ou encore à Johann Michel Bach pour sa Revanche et autres choses semblables.126
Cette citation est très intéressante, car elle montre que l’opposition fondamentale entre les deux auteurs au sujet de la modernité musicale recoupe leurs goûts en matière de musique instrumentale : Mattheson le Moderne privilégie l’ouverture à la française. Au contraire, Buttstett l’Ancien estime qu’il faut bien plus de science pour écrire des concertos et des motets à double chœur et appuie ses arguments sur des exemples de la génération précédente. Il est très clair que le style français se trouve alors du côté de la modernité. Mais plus fondamentalement, Buttstett contestait le projet même de distinguer et d’expliquer les styles nationaux en musique : si tout le monde n’est pas capable d’entendre la différence, mais que seule une élite de connaisseurs est en mesure de les distinguer, sur quoi peut bien reposer une telle distinction ? Du point de vue de Buttstett, Mattheson est inconséquent car il ne peut choisir son camp entre les deux styles qu’il décrit, et qu’il promeut un type de jugement esthétique fondé sur l’ouïe et le bon goût, et non sur la raison, seule source légitime d’un jugement fondé.127 Il est clair que pour Buttstett, la musique est une et indivisible, qu’elle doit être jugée d’après les règles immuables de l’art, et qu’elle ne saurait être soumise à des critères d’appréciation différents en fonction de son origine. Le conflit qui opposait les deux musiciens était donc bien plus qu’une querelle sur la valeur de la musique française : en fait, c’était un conflit de génération confrontant un jeune homme privilégié et cosmopolite vivant dans l’une des plus grandes métropoles euro-
125
126
127
Buttstett, Ut, Mi, Sol, Re, Fa, La, p. 88 : « Was der Herr Author durch Boutaden und Ricercate verstehet, ob er vielleicht muthmassentlich die alten Paduane meinet, indem er spricht, daß es eine alte Facon sey solcher Sachen, die etwa für ein Instrument alleine gesetzt sind und sich nach nichts als nach der Fantasie richteten : daß auch Fantasia, Toccaten eben diese Bedeutung haben, und alleine vors Clavier gehörten, kan ich nicht errathen. Verstehet er die Ricercaren, so hat er greulich geirret, dann diese sind da künstlichste Wesen auf dem Clavier, und sind weder Capriscio noch Fantasien zu nennen. » Sur l’usage de ces termes dans le discours théorique de langue allemande, voir Louis Delpech, « “Nach seinem eigenen plesier und gefallen”. Die Caprice im deutsch-französischen Tanz- und Musikdiskurs um 1700 », Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft, 34/2, 2019, p. 140-162. Buttstett, Ut, Mi, Sol, Re, Fa, La, p. 87-88 : « Die Ouverturen haben eben nicht unter allen Piecen, die Instrumentaliter executiret werden, das Prae ; Zumahlen da fast kein Componiste sich findet, so die rechte Lullische Art zu treffen weiß : Der Fürstl. Schwartzburgische Capellmeister Erlebach, welcher ziemlich nahe kommen, ist nun todt : sondern zu denen Concerten deren Italiänischen Virtuosen, als Albinoni, Corelli, &c. wie auch zu meines seel. Lehrmeisters Herr Pachelbels, 2. Chörichten Sonaten, in specie dessen Serenate, Johann Michel Bachs Revange und dergleichen, wird vielmehr Kunst erfordert. » Buttstett, Ut, Mi, Sol, Re, Fa, La, p. 89-91.
– 285 –
Chapitre 5
péennes avec un organiste déjà âgé, qui vivait de sa pratique de la musique d’église dans une petite ville de Thuringe et défendait le style savant et le contrepoint. On note d’ailleurs que Mattheson le traite un peu cavalièrement de « paysan de Thuringe » dans sa réponse publiée l’année suivante.128 Mais il est frappant de voir que la question des styles nationaux se trouve enrôlée dans cette querelle, qui est autant une dispute intellectuelle qu’un affrontement social, suivant une ligne de partage très claire : la musique française est du côté des galants et des Modernes, la musique italienne du côté des érudits et des Anciens. « Grand Partisan de la Musique Françoise » Mattheson ne fut pas long à répondre à l’organiste d’Erfurt : en 1717, il publia un second volume de défense, intitulé Das Beschützte Orchestre, qu’il eut la bonne idée de dédier à des personnes bien en vue dans le monde musical, mettant ainsi de son côté des alliés potentiels. Parmi les dédicataires se trouvait Georg Philipp Telemann, qui écrivit à Mattheson une lettre de remerciement en français, dans laquelle il louait son entreprise de « decouvrir le faux brillant des Anciens, & de chatier le caprice de ceux, qui les idolatrent & meprisent le siecle d’aujourdhui. » Le compositeur se rangeait donc lui aussi résolument du côté des Modernes. Mais il sous-entendait également que Mattheson n’avait pas montré assez de considération pour la musique française, qu’il n’avait pas défendue avec assez de clarté quatre ans auparavant dans Das Neu-Eröffnete Orchestre. Dans un post-scriptum ajouté à la fin de la lettre, Telemann le remerciait donc d’avoir désormais clarifié sa position dans le deuxième volume de son entreprise : P.S. Je vous remercie en particulier, Monsieur, pour avoir rasseuré le monde, que Messieurs les François ne vous sont pas si indifferens, comme un certain endroit dans le premier Tome l’avoit fait soupçonner. Je suis grand Partisan de la Musique Françoise, je l’avoue.129
Mattheson avait en effet inséré, dans Das Beschützte Orchestre, une petite note où il clarifiait sa position, probablement sur la demande de Telemann : un « certain grand compositeur » lui ayant fait le reproche d’avoir un peu trop maltraité les Français, Mattheson répond que les deux styles français et italien ont leurs mérites propres, et que les Français conservent l’avantage dans la musique instrumentale.130 Dans sa réponse à Telemann, également rédigée en français, Mattheson loue la galanterie de son expression (« Vous louez d’un tour si galant, & par des expressions si obligeantes, qu’il est difficile de n’y pas donner les mains »).131 Mais en fait, les deux hommes n’étaient pas tout à fait sur la même ligne : Mattheson défendait une vision complémentaire des deux principaux styles, chacun ayant ses mérites. Les Italiens avaient la suprématie dans la musique vocale, les Français dans la musique instrumentale. Entre août et décembre 1722, Mattheson publia d’ailleurs dans son périodique Critica Musica une traduction commentée de la querelle entre Raguenet et Le Cerf de la Viéville, le texte français figurant en regard de sa traduction allemande.132 Son attitude très neutre se reflétait dans sa préface, où il se gardait bien de prendre parti, proposant à la place une réflexion sur la musique de langue allemande.
128 129
130 131 132
Mattheson, Das Beschütze Orchestre, p. 38. Lettre de Georg Philipp Telemann à Johann Mattheson, Francfort, 18 nov. 1717. Telemann, Briefwechsel, p. 252. Le passage incriminé pouvait être celui où Mattheson reconnaissait que le goût général penchait en faveur de l’Italie. Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 207 : « Man streitet hierbey nicht, das nicht so wol die Frantzösische Composition als Execution, in ihrer Art, ihr eigenes Lob verdiene, und vielleicht der Italiänischen nicht viel nachgiebet ; allein weil ein grosses Theil in solchen Sachen von dem Gout dependiret, und aber die Frantzosen noch keine solche generale Approbation ihrer Music, als wol ihrer Sprache, in der Welt erhalten haben, so wird sich vermuhtlich das davon etwa zu machende Elogium hauptsächlich intra, und nicht gar weit extra fines Galliae erstrecken können. » Mattheson, Das Beschützte Orchestre, p. 237. Lettre de Johann Mattheson à Georg Philipp Telemann, Hambourg, 15 déc. 1717. Telemann, Briefwechsel, p. 254. Johann Mattheson, « Die Parallele, Eine Vergleichung zwischen den Italiänern und Franzosen, betreffend die Music und Opern », Critica Musica, 2/4-8, 1722, p. 91-232.
– 286 –
L'invention allemande du style français
Au contraire, Telemann se disait « grand partisan de la musique françoise » et sa galanterie pouvait difficilement passer inaperçue. L’autobiographie qu’il envoya à Mattheson en 1718 était racontée sur un ton cultivé, spirituel et enjoué, et parsemée de vers dans toutes les langues, parfois inventés par Telemann lui-même, parfois cités. Elle adoptait donc littéralement les codes de la « lettre galante », genre épistolaire dont la principale caractéristique était de mêler de la prose avec des bouts rimés.133 Dans cette autobiographie de 1718, Telemann réaffirmait à nouveau son admiration pour la musique française : le séjour à Hanovre était présenté comme le moment où il avait découvert la « science française », avant que ne commence à Sorau une phrase de travail intensif sur le genre de l’ouverture. Mais si l’on compare le texte de 1718 avec les passages correspondants de la seconde autobiographie rédigée en 1740, on constate quelques différences frappantes. Telemann s’y montre bien moins éloquent sur son amour du style français, et commence par évoquer ses modèles italiens ou italianisants, ce dont il se justifie même dans une note de bas de page.134 Son séjour à Hanovre est désormais présenté « avant tout » comme le moment de sa découverte de la musique italienne : Les deux orchestres voisins de Hanovre et Braunschweig, que j’allais entendre lors de certaines fêtes, à toutes les foires et encore en d’autres occasions, m’offrirent l’opportunité de découvrir d’assez près le style d’écriture français ici, le style de théâtre là – mais avant tout, aux deux endroits, le style italien – et de savoir les différencier.135
C’est donc à présent la composition à l’italienne (« italiänische Schreibart ») qui passe au premier plan, tandis que la manière française (« frantzösische Schreibart ») est opposée sans autre forme de procès au style « théâtral ». On remarque aussi que dans la deuxième version, ce n’est plus la cour de Wolfenbüttel mais l’opéra de Braunschweig qui sert de pendant à l’orchestre de Hanovre : Telemann crée donc ici une dichotomie implicite entre la cour et la ville, entre la vie musicale aristocratique placée sous le signe de la musique française et la vie musicale publique placée sous le signe de l’opéra, sous-entendant qu’il appartenait aux deux univers – une opposition qui était complètement absente de sa première autobiographie. Ces reformulations subtiles entre les deux autobiographies de Telemann sont donc loin d’être fortuites, mais révèlent le profond changement de statut de la musique française entre 1718 et 1740 : un quart de siècle après la première lettre à Mattheson, le style français et la galanterie naguère tellement en vogue semblaient avoir perdu leurs lettres de noblesse, et avoir cédé de leur actualité et de leur pertinence sociale au profit d’un nouveau style italien. Bach contre Marchand : un duel symbolique Un tour d’horizon des discours sur la musique française dans les années 1710 ne serait pas complet sans ménager une petite place à un épisode devenu au xixe siècle l’un des plus fameux de l’histoire de la musique occidentale : le duel musical entre Bach et Louis Marchand. Beaucoup de zones d’ombre demeurent sur l’arrivée de Marchand à Dresde, la durée de son séjour et les raisons qui l’ont conduit à séjourner dans la résidence du prince électeur de Saxe. La seule trace tangible de son passage à Dresde est un extrait de comptabilité qui documente l’attribution au musicien de deux médailles d’or, que l’on retrouve dans son inventaire après décès.136 Nos recherches dans les
133 134 135
136
Viala, La France Galante, p. 50. Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, p. 357 : « Die Sätze von Steffani und Rosenmüller, von Corelli und Caldara erwählte ich mir hier zu Mustern [en note : Da kommen die Italiäner schon in Betracht : die Frantzosen hernach.] » Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, p. 357 : « Die zwo benachbarten Capellen, zu Hanover und Braunschweig, die ich bey besondern Festen, bey allen Messen, und sonst mehrmahls besuchte, gaben mir Gelegenheit, dort die frantzösische Schreibart, und hier die theatralische ; bey beiden aber überhaupt die italiänische näher kennen, und unterscheiden zu lernen. » HStA Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 898/16, fol. 32 : « 528 Gulden 7 1/2 Reichstaler oder 130 Ducaten zu 2 Reichstaler 17 Groschen, bestehend in 3 Medaillen ; davon eine à 30 Ducaten, der Violonist
– 287 –
Chapitre 5
archives de Dresde pour l’année 1717 n’ont apporté aucune information supplémentaire à ce qui était déjà connu.137 Louis Marchand aurait quitté provisoirement le service du roi à la suite de problèmes conjugaux : d’après Marpurg, le roi avait décidé de verser la moitié du salaire de Marchand à la femme de celui-ci, le couple vivant séparé, et Marchand ne voulant plus assurer que la moitié de son service (celle pour laquelle il touchait effectivement son salaire) aurait été provisoirement congédié.138 D’après la nécrologie de Bach, c’est Volumier qui aurait fait appel aux services de ce dernier pour affronter Marchand en duel.139 Jusqu’à présent, on ne savait pas comment les deux hommes s’étaient connus. Nous avons vu qu’un inventaire d’instruments non daté de la cour de Weimar faisait mention d’un grand violon de Crémone fourni par Volumier (« Volumine aus dresden »).140 Comme Volumier entreprit un voyage à Crémone en juin 1715 pour y acheter des violons pour le compte de la cour de Dresde, c’est probablement au retour de ce voyage qu’il fournit cet instrument à la cour de Weimar et qu’il prit contact avec Bach, qui y était alors Konzertmeister. Ce document permet donc de supposer une première rencontre entre Bach et Volumier à Weimar. L’anecdote de la rencontre manquée entre Bach et Marchand a été rapportée par de multiples sources, et Marpurg observe qu’on « la raconte de différentes manières ».141 Mais comme on sait, toutes les versions rapportent que Marchand prit secrètement la fuite la veille du concours pour éviter une humiliation publique. Philipp Spitta mentionne curieusement qu’un débat sur les mérites comparés de la musique française et de la musique allemande aurait été initié par la présence de Marchand à la cour : Il se produisit alors une vive controverse pour savoir lequel des deux [Bach ou Marchand] était le plus grand. Un important parti issu des cercles de la cour se rangeait, comme le roi aimait beaucoup l’art français, du côté de Marchand, et en faveur de Bach s’engageaient avantageusement les artistes allemands de la chapelle. L’affaire se développa finalement en un débat d’idées général sur la plus grande ou la plus petite valeur de la musique allemande ou française, et Bach fut poussé par ses amis à inviter Marchand à une joute.142
Même si cette affirmation est à prendre avec précaution, puisque rien à notre connaissance ne permet de la vérifier, il est certain que l’anecdote du duel entre Bach et Marchand rencontra des
137
138 139
140 141 142
Frühwirth, der sich in Karlsbald, und die anderen beide zusammen à 100 Ducaten der Organist Marchand, der sich in der Kapelle hören lassen, zu einem Gnadengeschenk erhalten. » L’inventaire après décès de Louis Marchand comprend « une médaille d’or representant le roi de Pologne » et une « timballe d’Allemagne dorée pesant cinq onces quatre gros » : Norbert Dufourcq, « Pour une approche biographique de Louis Marchand (1669-1732) », Recherches sur la musique française classique, 17, 1977, p. 109-117. On relève seulement la présence, parmi le personnel qui accompagne Auguste le Fort dans ses divers déplacements en Saxe pour l’année 1717, d’un cuisinier (« Mundkoch ») appelé Marquand, dont la relation avec l’organiste reste inconnue : HStA Dresden, 10006 OHMA, I Nr. 25, fol. 27 (voyage à Leipzig vers mars), fol. 114 (voyage à Karlsbad), fol. 237 (voyage à Dörlitz), puis pour le voyage à la Michaelismesse de Leipzig. Friedrich Wilhelm Marpurg, Legende einiger Musikheiligen, Cologne 1786, p. 289-291. BD III, Dok. 666, p. 83 : « Der damahlige Concertmeister in Dreßden, Volumier, schrieb an Bachen, dessen Verdienste ihm nicht unbekannt waren, nach Weymar, und lud ihn ein, ohne Verzug nach Dreßden zu kommen, um mit dem hochmüthigen Marchand einen musikalischen Wettstreit, um den Vorzug, zu wagen. Bach nahm diese Einladung willig an, und reisete nach Dreßden. Volumier empfing ihn mit Freuden, und verschaffete ihm Gelegenheit seinen Gegner erst verborgen zu hören. Bach lud hierauf den Marchand durch ein höfliches Handschreiben, in welchem er sich erbot, alles was ihm Marchand musikalisches aufgeben würde, aus dem Stegreife auszuführen, und sich von ihm wieder gleiche Bereitwilligkeit versprach, zum Wettstreite ein. » HStA Weimar, Hof- und Haushaltwesen, A 9274, fol. 1 : « 5. Ein Cremoneser von Volumine aus dresden Leib Violino. » BD III, Dok. 914, p. 425 : « diese Anekdote, die man verschiedentlich erzählt ». Voir Werner Breig, « Bach und Marchand in Dresden : eine überlieferungskritische Studie », Bach Jahrbuch, 84, 1998, p. 7-18. Spitta, Johann Sebastian Bach, vol. 1, p. 575 : « Nun entspann sich ein lebhafter Streit, welcher von beiden der größere sei. Eine starke Partei aus den Hofkreisen stand, da der König französische Kunst sehr liebte, auf Marchands Seite, für Bach werden vorzugsweise die deutschen Künstler der Capelle eingetreten sein. Die Sache gestaltete sich endlich zu einem Meinungskampf über den größeren und geringeren Werth deutscher oder französischer Musik im Allgemeinen und Bach wurde durch seine Freunde angegangen, Marchand zu einem Wettstreite herauszufordern. »
– 288 –
L'invention allemande du style français
résonances nationalistes jusque dans le xixe siècle, juste après les guerres napoléoniennes. Dans une lettre à son ami Goethe, Carl Friedrich Zelter, un excellent connaisseur de l’histoire de la musique qui était aussi directeur de la Sing-Akademie à Berlin, écrivait : Le vieux Bach est, malgré toute son originalité, un fils de son pays et de son temps, et il n’a pas pu échapper à l’influence des Français, notamment de Couperin. On veut se montrer courtois, et ainsi a lieu ce qui ne devrait pas avoir lieu. Mais on peut épousseter cet élément étranger comme une écume légère, et juste en-dessous gît sa silhouette lumineuse.143
La réponse de Goethe est très éclairante : il affirme avoir « toujours trouvé très étrange » que Bach ait pu être l’objet d’une influence étrangère, lui qui était le comble de l’originalité – mais rappelle en même temps à son ami que, dans le « grand mouvement » qui s’emparait alors des sciences et des arts, « quelque chose de gallican soufflait sur tout le reste ».144 Ces réflexions tardives n’illustrent pas seulement le désastre qu’ont représenté les guerre napoléoniennes pour les relations culturelles franco-allemandes : bien avant le xixe siècle, dès les années 1730, la musique française allait connaître une mise en crise profonde dans l’espace germanique, sous le double coup du déclin de l’idéal de la galanterie et de l’ascendant connu par les premières manifestations de l’Aufklärung, les Lumières allemandes. Critique de la galanterie et crise de l’opéra français Lorsque Telemann prit la direction de l’opéra de Hambourg en 1722, un an après avoir été nommé Director Musices dans la ville hanséatique, il devint chargé de la « supervision de la musique et de la composition de nouvelles pièces, contre un salaire de 300 Thaler par an.145 » L’institution dont il était désormais responsable avait déjà produit des œuvres lyriques françaises trente ans auparavant, dans les années 1690. Mais l’arrivée de Telemann comme nouveau directeur coïncida avec la production d’une seconde triade d’œuvres françaises, fait peu étonnant au regard de l’admiration qu’il professait pour la musique française. En février 1724, la pièce Der Beschluß des Carnevals reprend le troisième acte de l’Europe Galante ; en février 1725, la Critique des hamburgischen Schau-Platzes est constituée d’extraits musicaux composés par Kunzen, Campra et Lully ; en avril 1725, la tragédie en musique Vénus et Adonis de Henry Desmarets est donnée intégralement en version originale. La tragédie en musique : un modèle à bout de souffle L’arrivée de Telemann au Gänsemarkt-Oper coïncidait avec un renouvellement du directoire de l’institution à la suite de difficultés financières.146 Mais ce renouvellement ne suffit pas à régler tous les problèmes, puisque le recrutement de Johann Paul Kunzen l’année suivante déclencha un conflit entre les nouveaux directeurs de l’opéra de Hambourg. Il semble que Kunzen, protégé par le
143
144
145
146
Lettre de Carl Friedrich Zelter à Johann Wolfgang von Goethe, Berlin, 5-14 avr. 1827. Briefwechsel, p. 992 : « Der alte Bach ist mit aller Originalität ein Sohn seines Landes und seiner Zeit und hat dem Einflusse der Franzosen, namentlich des Couperin nicht entgehn können. Man will sich auch wohl gefällig erweisen, und so entsteht – was nicht besteht. Dies Fremde kann man ihm aber abnehmen wie einen dünnen Schaum und der lichte Gehalt liegt unmittelbar darunter. » Lettre de Johann Wolfgang Goethe à Carl Friedrich Zelter, Weimar, 21-22 avr. 1827. Briefwechsel, p. 995 : « Dein gewichtiges Wort : daß der grundoriginale Bach doch auch einen fremden Einfluß auf sich wirken lassen, war mir höchst merkwürdig : ich suchte gleich Franz Couperin in dem biographischen Lexikon auf, und begreife wie, bei damaliger großer Bewegung in Künsten und Wissenschaften, etwas Gallikanisches herüberwehen konnte. » Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, p. 366 : « Ohngefehr ein Jahr hernach [1722] wurden die in Abnehmen gerathene Opern, durch einige Ministers und hochadeliche Personen, in einen verbesserten und prächtigen Stand gesetzet, und mir dabey die Aussicht über die Musik, nebst der Verfassung neuer Schauspiele, gegen 300. Rthlr. jährlichen Einkommens, aufgetragen. » Johann Mattheson, Der Musicalische Patriot, Hamburg 1728, p. 190-191.
– 289 –
Chapitre 5
comte de Callenberg, ait été imposé de force par son patron aux autres directeurs qui n’en voulaient pas. Telemann se fait l’écho de cette situation dans une lettre d’octore 1724 à Uffenbach : il décrit le « schisme » survenu à l’opéra après l’arrivée du nouveau venu. Telemann affirme que Kunzen avait été « recommandé » et « introduit dans l’orchestre en grande pompe pour devenir son monarque » en dépit de ses faibles talents musicaux, et regrette amèrement qu’un tel « potentat » soit porté aux nues par ses partisans.147 Le vocabulaire employé par Telemann est très frappant car il souligne implicitement les origines curiales de Kunzen : il s’agit d’un petit intriguant qui ne provoque que guerre et catastrophes en essayant d’imposer son pouvoir absolu. Avant son arrivée à Hambourg, Kunzen avait été « Musicus » à la Hofkapelle de Dresde, où il était resté entre 1719 et 1723.148 Il avait certainement eu l’occasion de collaborer avec les nombreux musiciens français de la cour et de développer des réseaux personnels dans ce milieu, puisque Mattheson affirme qu’il avait formé une amitié avec le maître des concerts Jean-Baptiste Volumier.149 Cette dispute trouva un écho dans la presse contemporaine, puisqu’une satire féroce des misères de l’opéra parut le 21 septembre 1724 dans le Patriot : un certain Hexameter, membre de la troupe fictive des « Comédiens de Württemberg », publiait un poème qui prenait explicitement pour modèle l’Art du Lutrin de Boileau et décrivait les troubles qui secouaient l’opéra de la ville.150 Ce personnage fictif, membre d’une troupe de comédiens au service d’une cour ducale, composait donc un poème prosaïque d’après un modèle de la galanterie littéraire française de la fin du xviie siècle. L’allusion au personnel traditionnel des cours allemandes était donc assez transparente. On peut même se demander si ce n’est pas au passage d’une véritable troupe de comédiens français à Hambourg qu’il était fait allusion. Dans le Beschluß des Carnevals donné le 21 février 1724, le premier acte reprenait l’entrée turque de L’Europe galante de Campra en modifiant sa fin, le sultan donnant l’ordre de faire venir « une troupe de François » pour donner un « tres Comique Opéra ».151 Celui-ci n’était autre que le deuxième acte, la comédie La fille Capitaine d’Antoine Jacob de Montfleury, suivie au troisième acte de l’intermède Il Capitano composé par Telemann lui-même. De fait, la présence d’artistes français parmi le personnel de l’opéra, déjà constatée dans les années 1690, connaît un nouveau pic entre 1724 et 1725. Une Mademoiselle Dimanche avait chanté en mai 1725 le role de Clénate dans l’Amphytrion de Gasparini : c’est aussi elle qui chanta quelques semaines plus tard – du moins d’après le Relations-Courier du 23 mars 1725 – le rôle de Vénus dans l’opéra de Desmarest.152 Il s’agit vraisemblablement de Louise Dimanche, qui s’était produite comme chanteuse à Bruxelles, Lille et La Haye avant de gagner Hambourg, et qui fut ensuite Kammersängerin à la cour de Dresde (probablement par l’intermédiaire de Kunzen) entre 1725 et 1732.153 Les sœurs Monjou – qui apparaissent dans les livrets de Hambourg comme « Christel Monjo » et « Melle Monjo die jüngere » – sont les filles du huguenot Jean-François 147
148 149 150 151
152 153
Lettre de Georg Philipp Telemann à Johann Friedrich Armand von Uffenbach, Hambourg, 4 oct. 1724. Telemann, Briefwechsel, p. 216-217. Sur l’usage de modèles français à Hambourg par Telemann, voir Louis Delpech, « Zwischen Galanterie und Frühaufklärung. Telemann und die Rezeption französischer Opern in Hamburg um 1725 », in : Telemann und die urbanen Milieus der Aufklärung, dir. Louis Delpech et Inga Mai Groote, Munich 2017, p. 53-74. Arndt Schnoor, « Kunzen, Johann Paul », in : MGG online. Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, p. 161 : « Seine Vorzüge machten ihm auch hier bald Freunde : wie er denn mit den nunmehro sel. Schmid und Heinichen, welche Capellmeister daselbst waren ; vor allen aber mit dem Concertmeister, Woulmyer, sehr vertraulich umgegangen ist. » Der Patriot, 24 août [21 sept.] 1724, p. 359-370. Georg Philipp Telemann, Der Beschluß des Carnevals, non paginé : « Zuliman. Dans ce jour où l’allegresse | Doit regner de tous côtés | On prepare à ma Princesse | Des plaisirs qu’elle n’a jamais encore goûtés ; | C’est une piece enjouée, | Dont une troupe de François | Ici par mon ordre arrivée | Pour la divertir a fait choix ; | Et dont (pour rendre plus riante | Une Journée aussi brillante) | La Clôture se fera | par une trés comique Opera. » Marx und Schröder, Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, p. 444. Jean-Philippe van Aelbrouck, Dictionnaire des danseurs à Bruxelles de 1600 à 1830, Liège 1994, p. 110.
– 290 –
L'invention allemande du style français
Monjou, musicien et maître des pages à la cour de Köthen à partir de 1719 : d’après Mattheson, les deux femmes avaient travaillé sous la direction de Kunzen à Wittenberg, avant de rejoindre elles aussi la Hofkapelle de Köthen où elles avaient chanté sous la direction de Bach entre 1720 et 1721.154 À partir de 1722, elles se trouvent à Hambourg, où elles se produisent dans des œuvres de Mattheson, Kunzen, Keiser, Telemann, mais aussi Händel. Une Mademoiselle Pichon, qui chante dans L’Amour saltimbanque en 1725 et apparaît dans la troisième partie de la Critique des hamburgischen Schau-Platzes, était chanteuse et danseuse à la cour de Wolfenbüttel : elle apparaît dans le livre d’adresse de 1721.155 Elle est sûrement la femme du machiniste qui apparaît dans le prologue de Desmarest. Enfin, Mademoiselle Sellin et une certaine Dubissons (peut-être Dubuisson) apparaissent aussi dans la Critique. Aux côtés de ces chanteurs français se produisent aussi naturellement des chanteurs allemands, entre autres les deux Riemschneider ou bien Westenholtz. Le nombre de danseurs et de maîtres de ballets français est aussi remarquablement élevé autour de 1725 à Hambourg. Un Monsieur Descamp (sans doute Deschamps) apparaît dans plusieurs œuvres entre 1722 et 1725, notamment dans deux œuvres de Telemann : une ode dynastique, Das frohlockende Groß=Britannien, et dans son opéra Omphale. Mademoiselle Des Forges apparaît en 1722 dans Ariadne, en 1724 dans le Beschluß der Carnevals. Monsieur Morelle est également actif à Hambourg entre 1722 et 1725, notamment dans Ariadne, Omphale et dans la Critique des Hamburgischen Schau=Platzes. Un Baptiste (aussi appelée Battiste le Jeune) sert comme maître des ballets dans plusieurs productions entre 1722 et 1726, entre autres en 1725 dans la Hamburger Schlacht-Zeit et dans Giulio Caesare in Egitto de Händel. Il s’agit peut-être du même Baptiste que celui qui avait été Kapellmeister de la cour de Schwerin entre 1709 et 1710. On retrouve également Catherine Dudard, la femme Louis Deseschaliers qui l’avait accompagné dans la mise sur pied de plusieurs opéras à Paris, Lille, Dresde, Varsovie et La Haye : une Mademoiselle ou Madame Deschalieres apparaît en 1724 et 1725 comme danseuse ou maîtresse des ballets dans de nombreuses productions (notamment le Carneval von Venedig, le Beschluß des Carnevals et dans la Critique des Hamburgischen Schau=Platzes). On a donc ici la confirmation que la production de la tragédie en musique de Desmarest en 1725 fut mise sur pied par des artistes français très proches des milieux de cour, dont beaucoup avaient des relations personnelles avec Johann Paul Kunzen. Dans l’avant-propos du livret à la tragédie en musique de Desmarets, les producteurs faisaient d’ailleurs allusion à sa nouveauté sur la scène et justifiaient leur choix auprès du public hambourgeois en faisant appel à la nécessité de cultiver des genres variés : L’insatiable penchant des hommes pour les satisfactions sensuelles est aussi la cause que même les plus agréables provoquent un dégoût insensible lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un renouvellement permanent de plusieurs sortes. C’est pourquoi, après avoir satisfait les amateurs et les connaisseurs avec tant de pièces italiennes et allemandes très recherchées, nous osons tenter l’expérience de faire maintenant apprécier plus encore ce théâtre par l’exécution d’une pièce entièrement française.156
Néanmoins, cette programmation avait de quoi surprendre et montrait bien le fossé qui séparait désormais des artistes de cour et le public hambourgeois. L’œuvre de Desmarests n’était plus une nouveauté au moment de sa reprise hambourgeoise, puisqu’elle avait été créée trente ans auparavant en 1697 sur la scène de l’Académie royale de musique à Paris.157 Depuis cette époque, 154 155 156
157
Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, p. 161. Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, p. 194. Adress-Calender der Hoch=Fürstl. Braunschw. Lüneburg. Haupt= und Residentz=Städte, Braunschweig 1721, p. 20 : « Mademoiselle N. N. Pichon, Sängerinn und Täntzerinn, Log. am kleinen Zimmerhoff in seel. Stockhausen Hauß. » Venus und Adonis, Hambourg 1725, préface non paginée : « Die zärtliche Unersättlichkeit der Menschen in sinnlichen Vergnügungen verursacht auch bey den angenehmsten derselben einen unvermerckten Eckel, wenn sie nicht durch unterschiedliche Arten beständig abgewechselt werden. Dem zur Folge hat man, nach so viel ausgesucht=Italiaenisch=Teutschen Stücken, die Liebhaber und Kenner derselben zu vergnügen, diesen Schauplatz jetzt durch ein gantz=frantzösisches Schauspiel beliebter zu machen, gewaget. » Cf. l’édition du livret dans Vénus & Adonis Tragédie en musique de Henry Desmarest (1697), éd. Jean Duron.
– 291 –
Chapitre 5
d’autres œuvres de Desmarest avaient été jouées dans l’espace germanique, entre autres dans les cours de Darmstadt, d’Ansbach et de Baden-Durlach, en version originale, en version traduite ou bien avec une nouvelle musique.158 À Hambourg, le texte original de l’opéra était reproduit littéralement dans le livret, accompagné d’une traduction allemande en regard. La version hambourgeoise ne suit pas la version imprimée par Ballard en 1697 mais une autre version plus courte, uniquement transmise par une source manuscrite : alors que Cidippe chante dans la partition imprimée un long et amer monologue aussitôt après le départ de Vénus à la fin du premier acte, elle ne chante qu’un court récitatif et quitte la scène dans le manuscrit copié par André Danican Philidor.159 La source de la reprise hambourgeoise n’était donc pas la partition générale imprimée, mais une version non publiée, probablement copiée sur le manuscrit de Philidor ou transmise par un réseau similaire. Si les cinq actes de la tragédie étaient fidèlement repris dans la production hambourgeoise, le prologue avait été complètement réécrit. Mais au lieu de faire précéder la tragédie d’un prologue en français comme en 1689, les organisateurs du spectacle firent précéder la pièce d’un « prologue comique en allemand » (« Teutschen Comiquen Vorspiel ») dont le caractère se distinguait fortement de la tonalité tragique de la pièce qu’il servait à introduire. Ce prologue en allemand appartenait en fait à un type bien particulier de prologues cultivé depuis peu sur la scène de Hambourg : le méta-prologue, une courte pièce introductive qui commentait de façon critique l’action qui allait suivre, mais proposait aussi une réflexion sur les fonctions et le rôle d’une maison d’opéra dans un contexte urbain comme celui de Hambourg.160 Critiques éclairées de la galanterie Ici, ce sont les muses en personne qui se disputent avec Momus sur la valeur et la signification de la pièce qui allait être représentée. Momus, un personnage grotesque de la mythologie grecque qui incarne le sarcasme et la moquerie, apparaît régulièrement dans les méta-prologues comme figure grincheuse et bougonne qui se fait le porte-parole et l’avocat du public hambourgeois. Momus reproche à la muse Thalia de se comporter comme un singe en chantant trop de « trucs étrangers sur ce théâtre ».161 Il s’en prend ensuite à Melpomène : Mom.
Melp. Mom.
158 159 160
161
Ich hab euch zwar versprochen/ Den Haupt-poßierlichen Publiqu’ Zu eurem Vortheil zu bekehren. Allein da ihr mir euer Wort gebrochen Kan ich in diesem Stück Euch meine Hülffe nicht gewähren. Worinn denn haben wir nicht unser Wort gehalten? […] Darinn daß ihr jetzt nicht den Caesar aufgeführet/ Und noch darzu an dessen Statt/ Was der Publiqu’ so sehr verdammet hat/ Ein gantz Frantzösisch Stück/ das allen Danck verlieret/ Zu spielen auserkohren.
Mom.
Melp. Mom.
Je vous ai certes promis/ De vous gagner les faveurs de la masse plébéienne du public Mais comme vous n’avez pas tenu parole, Je ne peux pas pour cette pièce Vous garantir mon aide. Et en quoi donc n’avons-nous pas tenu parole ? […] En ceci que vous ne représentez plus le César/ Mais qu’en outre vous avez à la place Choisi de jouer Ce que le public a tant exécré Une pièce française en entier qui enlève les mots de la bouche.
Thomas Betzwieser, « Le parcours germanique de l’œuvre lyrique d’Henry Desmarest », in : Henry Desmarest (1661-1741). Exils d’un musicien dans l’Europe du Grand Siècle, dir. Jean Duron et Yves Ferraton, Sprimont 2005, p. 309-320. Version manuscrite : F-Pn, Rés. F. 1716. Sur le « méta-prologue » comme support d’un nouvel espace de débat public, voir Wolfgang Hirschmann et Bernhard Jahn, « Oper und Öffentlichkeit. Formen impliziten Aufklärens an der Hamburger Gänsemarktoper um 1700 », in : Um 1700. Die Formierung der europäischen Aufklärung zwischen Öffnung und neuerlicher Schließung, dir. Daniel Fulda et Jörn Steigerwald, Berlin 2016, p. 184-197. Venus und Adonis, Hambourg 1725 : « Nur still ! Dein Affen=Spiel ist mir zuviel bekannt ! | Du sängst solche fremdes Zeug auf diesem Schau=Platz an/ | So daß ich mich dir unmöglich stoßen kann. »
– 292 –
L'invention allemande du style français
L’allusion au « César » rappelle cruellement aux muses que l’opéra de Desmarest n’avait été choisi qu’au pied levé, comme une alternative commode à l’exécution de l’opéra Giulio Caesare hwv 17 de Händel, après que le projet d’une création de l’œuvre à Hambourg en avril 1725 eut échoué.162 C’est alors qu’intervient Terpsichore, la muse de deux éléments très importants de l’opéra français, à savoir les chœurs et la danse. Elle affirme que la pièce a été programmée « en connaissance de cause et avec raison » (« mit Kundschaft und Vernunfft ») et qu’elle « compte parmi les meilleures ». Ceci ne suffit visiblement pas à convaincre Momus, qui répond : Mom.
Halt du doch nur das Maul/ du wirst mich wohl nicht fressen ! Ja/ weistu was Publiqu’ Von der Frantzösischen Musiqu’ Mit mir und allen Kennnern spricht : Sie taugt den Hencker nicht.
Mom.
Mais ferme ta grande gueule, tu ne vas quand même pas me bouffer ! Ouais, tu sais ce que le publiqu’ À la musique française répliqu’ Il dit, comme moi et tous les connaisseurs : Elle n’est même pas bonne pour les chiens.
Sans perdre son sang-froid face à un tel assaut de vulgarité, la muse Terpsichore chante alors en un majestueux arioso tous les avantages de la musique française, prenant implicitement le contrepied de l’opera seria italien, et donc de l’opéra de Händel qui aurait dû être donné à la place de la tragédie de Desmarest : Terp.
Die holde Macht der Symphonien, Kan Herz und Ohren an sich ziehen. Es läßt sich in den starcken Chören Mit Geist vereinte Anmuth hören. Hier folgt die Kunst der schönen Spuhr Der ungezwungenen Natur.
Terp.
Le noble pouvoir des symphonies Attire à lui les cœurs et les oreilles. Dans les chœurs bien fournis, La grâce alliée à l’esprit se fait entendre. Ici, l’art suit la belle voie D’une nature sans contrainte.
Chœurs abondants, noble musique instrumentale, naturel de la déclamation – après ce vibrant plaidoyer pour l’opéra français, même Momus doit convenir que la « musique française n’est peut-être pas entièrement bonne à jeter. » Il exprime toutefois ses réserves sur les capacités des chanteurs (« So weiß ich doch, daß du in diesem Stück | Mit Sängern schlecht versehen bist »), sur la complexité des décors et des cotumes (« Haha, der Berg gebieret eine Mauß ») et prévient que tout ce qui brille n’est pas or (« Doch ist nicht alles Gold, Was Gelb ist, gläntzt und scheint »). Dans un dernier rebondissement ironique, Apollon apparaît alors sur scène tel un deus ex machina et donne l’ordre aux muses de jouer la pièce, sans prêter attention aux plaintes de Momus, promettant qu’il viendra lui-même assister à la représentation.163 Ce prologue indique donc très clairement qu’en 1725, le public hambourgeois n’était peutêtre plus préparé à entendre une tragédie en musique française, déjà vieille de plus de trente ans et donnée en version originale. Malgré ce prologue très amusant, l’œuvre de Desmarest ne semble pas avoir remporté de grand succès, puisque Mattheson note de manière laconique : « elle ne fut jouée que deux fois, par manque de spectateurs.164 » L’attitude extrêmement critique exprimée par Momus vis-à-vis de la musique française, qui articule avec une netteté extraordinaire les attentes du public tout en réfléchissant avec lucidité sur ses limites, était également exprimée la même année dans le prologue d’une autre pièce – la Critique des hamburgischen Schau=Platzes, qui combinait en un ensemble de quatre actes indépendants une pièce de Johan Paul Kunzen, deux actes de Campra (l’entrée turque de l’Europe galante et « L’Amour saltimbanque » des Fêtes vénitiennes) et Le 162 163 164
Marx et Schröder, Die Hamburger Gänsemarkt-Oper. L’opéra de Händel fut donné pour la première fois en août 1725 à l’opéra de Braunschweig, sous la direction de Georg Caspar Schürmann, et ne fut représenté à Hambourg qu’en novembre de la même année. « Ey kehrt euch nicht daran, spielt nur auf mein Geheiß | So gut ein jeder weiß, | Und laßt den schielen Momus passen. | Ich komme selbst, sobald mein Tagwerck nur geschehn, | Was ihr bereitet anzusehen. » Mattheson, Der Musicalische Patriot, 1728, p. 192 : « Sie wurde nur zweimahl gespielet, weil es an Zuschauern fehlte. » Le calendrier des représentations établie par Marx et Schrödter confirme qu’une représentation a eu lieu le 11 avr. 1725 : Marx et Schröder, Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, p. 489.
– 293 –
Chapitre 5
Divertissement de Chambord lwv 41 de Lully (sur la comédie Monsieur de Pourceaugnac de Molière) et fut donnée en février 1725, quelques semaines seulement avant la création de Venus und Adonis.165 La construction de la Critique, dont le titre se rapporte au « prologue cocasse » qui introduit la pièce, est expliquée dans la préface du livret.166 Au lever de rideau, Momus réapparaît, mais il se trouve cette fois au pied du Parnasse, où se tiennent Apollon et les neuf muses. Il exprime à nouveau, au nom du public, son mécontentement face à la programmation de l’opéra de Hambourg. À la fin du prologue, apparaît le machiniste français Pichon, qui tient dans sa langue un petit discours sur la dureté de sa condition, interpelant les Muses : « Vous êtes plaisantes, Mesdames les Citoiennes du Parnasse, vous qui étes à vôtre aise, & qui avés du pain cuit, de tourmenter un pauvre Diable qui sue sang & eau pour gagner le sien. » Il est suivi par le peintre du théâtre, qui raconte dans une « Aria en Menuet » (en allemand) ses propres misères, avant que n’apparaisse le public en accoutrement bizarre (« Publique in einem bizarren Aufzug »). Apollon se tourne alors vers lui et lui demande : Ap. Publ.
Sprich den Publiqvue wo kommt es her/ Daß diese Opera so leer? Gefällt sie die denn nicht? Ja sie gefällt mir woll/ Doch wenn ich dir die Wahrheit sagen soll/ So sind viel tausend fremde Sachen/ Die mich ihr ab- und wiederspänstig machen.
Ap. Publ.
Dis-moi, Publiqvue, comment se fait-il Que cet Opera soit si vide ? Il ne te plaît donc pas ? Si, il me plaît bien, Mais pour dire la vérité, Ce sont ces mille et une choses de l’étranger Qui me rendent fauché et frondeur.
Parmi ces « mille et une choses de l’étranger » qui éloignent le public de l’opéra, se trouvent bien sûr les langues mais aussi les différents styles nationaux : Italiänisch versteh ich nicht/ Das teutsche ist mir viel zu schlecht/ Was ein Frantzos singt/ spielt und spricht/ Ist meinen Ohren nie gerecht.
Je ne comprends pas l’italien, L’allemand est bien trop piètre pour moi, Et ce qu’un Français chante, joue et déclame Ne convient jamais à mes oreilles.
Ces deux méta-prologues thématisent donc de manière réflexive les fonctions et les tâches de la scène de Hambourg. Ils développent une double critique : d’une part, contre les limites du public hambourgeois, mais aussi contre la surreprésentation du répertoire étranger sur la scène. Dans les deux cas, les prologues introduisent un répertoire français déjà ancien : à l’exception des Fêtes vénitiennes (1710) qui datent d’une quinzaine d’années au moment de leur reprise hambourgeoise, les autres pièces datent des années 1660 à 1690. Si on les compare avec l’opéra Giulio Caesare que Händel venait tout juste de composer et qui représentait le dernier cri en matière de modernité dramatique et musicale, on comprend qu’elles aient dû frapper le public comme étant d’un autre âge. Au-delà de l’antiquité du répertoire, c’est aussi sur le plan du genre que ces pièces représentent un modèle archaïque : elles appartiennent à des genres de théâtre musical français déjà anciens et plutôt typiques du monde de la cour – la comédie-ballet, la tragédie en musique et l’opéra-ballet. En attaquant explicitement le choix de ce répertoire, ces deux prologues critiquaient implicitement un modèle culturel galant et contribuaient à alimenter un débat public sur les valeurs de la galan-
165 166
Critique Des Hamburgischen Schau=Platzes, Hambourg 1725. Critique Des Hamburgischen Schau=Platzes, préface non paginée : « Die besondere Piecen, die man für dieses mahl dazu auserwehlt hat, sind : I. In einem Prologo, eine Critique oder Untersuchung des Hamburgischen Theatri, nemlich in welchem Stand selbiges sich anitzo befinde, was darauf gut, und was darauf etwan auszusetzten, seyn möchte. II. Eine Piece, so unter dem Nahmen, einer Türckischen Scene, oder eines Theils der berühmten Frantzösischen Opera, Europe Galante, genannt, sich im verwichenen Jahr, ihrer Artigkeit wegen, berühmt gemacht. III. Eine sehr berühmte und bekannte Piece l’Amour Saltinbanque genannt, zu welcher die vielfältige comique Balletten und Entréen, und die zur Aufführung derselben sehr habile Täntzerinn Mad. Dechalieres, Anlaß gegeben, Und IV. Eine Italiänische bekannte, wegen der darinn vorkommende sehr lächerlichen Begebenheiten berühmte, und aus dem Französischen des Molieres entliehene, Piece, Pourceaugnac genannt. »
– 294 –
L'invention allemande du style français
terie, qui était également développé au même moment dans la presse hambourgeoise naissante. Le choix de la tragédie en musique Vénus et Adonis écrite par Henry Desmarest et le librettiste JosephFrançois Duché de Vancy est d’ailleurs très éclairant de ce point de vue : non seulement les deux hommes avaient collaboré pour mettre sur pied un opéra-ballet intitulé Les Fêtes galantes (en mai 1698), mais le livret même que Duché de Vancy avait écrit pour Vénus et Adonis était déjà considéré peu après sa création comme l’adaptation galante d’un sujet antique.167 Mais ce que les programmateurs et les musiciens français n’avaient sans doute pas vu, c’est que la galanterie tombait justement sous le feu de la critique au moment même où ils mettaient en route leurs projets. Au premier rang des critiques se trouvait « l’hebdomadaire moral » Der Patriot, l’un des principaux journaux de langue allemande, publié de manière anonyme à Hambourg à partir de janvier 1724, et qui a souvent été décrit comme un levier central dans l’émergence d’un espace public et dans la promotion des idées de la Frühaufklärung.168 Le succès du Patriot fut d’ailleurs tellement retentissant que Mattheson décida quatre ans plus tard de lancer son propre hebdomadaire, appelé le Musicalischer Patriot.169 Mais dès 1724, le Patriot se moque avec férocité de ce qu’il appelle « le monde galant » en dénigrant ses pratiques sociales et culturelles, parmi lesquelles se trouvent bien sûr la pratique de la langue française et la fréquentation assidue de l’opéra. Dix ans auparavant, Mattheson comptait déjà la fréquentation régulière de l’opéra parmi les activités indispensables d’un « galant homme » souhaitant développer son goût pour la musique.170 Même si les rédacteurs du Patriot ne condamnent pas l’opéra en bloc et reconnaissent même qu’il peut contribuer à l’édification morale de l’homme171, la pratique galante de l’opéra concentre leurs critiques. La description fantaisiste d’une société fictive ennemie du Patriot (la « Gesellschaft vam schönen Wedder ») qui organiserait des réunions secrètes au cours desquelles ses membres n’auraient le droit de fumer leur tabac que dans le papier des numéros de l’hebdomadaire, est l’occasion pour le journal de se moquer de ses cibles favorites. Le journal brocarde en particulier l’usage immodéré de tournures étrangères et notamment françaises, ainsi que la fréquentation stupide de l’opéra : Dans cette société sont naturalisés les agréments étrangers suivants : Comment va votre petit chien ? Avezvous été à l’opéra hier ? Avez-vous joué au piquet ou à l’ombre lors de l’assemblée ? N. est un danseur incomparable, il a beaucoup d’esprit dans ses pieds. Avez-vous vu les œillades qui couraient d’une loge à l’autre ?172
La fiction d’une « montre philosophique », qui peut « mesurer très exactement la durée ou la brièveté de la vie raisonnable ou philosophique » qu’on a passée et ainsi indiquer « combien de temps l’on a vraiment vécu, dans le meilleur sens du terme », témoigne également du statut ambigu de l’opéra dans l’éthique du Patriot. Comme on s’en doute, le temps passé à l’opéra n’est pas comptabilisé par cette montre philosophique, alors qu’il joue au contraire un rôle essentiel dans l’éthique du monde galant : Car nous ne vivons pas, lorsque nous ne faisons que nous remuer, nous habiller, danser, bavarder, aller à l’opéra, rire, etc. – quoique le monde galant puisse en penser.173
167 168 169 170 171 172
173
Jörn Steigerwald, « La galanterie des dieux antiques : Chapelain critique de l’Adone du Cavalier Marin », Littératures classiques, 77/1, 2012, p. 281-295. Steffen Martus, Aufklärung : das deutsche 18. Jahrhundert. Ein Epochenbild, Berlin 2015, p. 223-229. Holger Böning, Der Musiker und Komponist Johann Mattheson als Hamburger Publizist. Studie zu den Anfängen der Moralischen Wochenschriften und der deutschen Musikpublizistik, Brême 2011. Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 161. Der Patriot, 22. Juni 1724, p. 247. Der Patriot, 17 fév. 1724, p. 65 : « Von den Fremden sollen schon folgende Zierlichkeiten bey der Gesellschaft das Bürger=Recht haben : Was macht ihr kleines Hündgen ? Sind sie gestern in der Opera gewesen ? Haben sie Piquet oder Ombre in der Assemble gespielet ? Der N. ist ein unvergleichlicher Täntzer, il a beaucoup d’esprit dans ses pieds. Haben sie die Œillades wol wahrgenommen, die von der einen Loge zur andern hinüber flogen ? » Der Patriot, 28 déc. 1724, p. 495-496 : « Denn wir leben nicht, wenn wir blosserdings uns bewegen, uns ankleiden, tantzen, schwätzen, zur Opera gehen, lachen, u. was auch immer die galante Welt hievon dencken mag ».
– 295 –
Chapitre 5
L’opéra appartient donc clairement à l’art de vivre du « monde galant », celui-là même qui adopte si volontiers la langue et la culture française et est souvent représenté avec tous les stéréotypes nationaux attachés à la France. Dans son vingtième numéro, l’hebdomadaire publie la lettre d’un certain Monsieur de Bel-Amour, un correspondant qui se présente comme un « Français de bonne naissance » et est apparemment très convaincu de la supériorité de son pays (« personne ne peut nier que nous soyons la meilleure nation de toute l’Europe, que nous possédions le goût le plus délicat, bien loin devant toutes les autres nations »). Le Patriot ajoute dans un commentaire : « Ce lecteur me pardonnera d’exclure toute forme de galanterie française de ces colonnes, et jamais je ne lui accorderai la moindre place dans ce papier.174 » Il est donc très compréhensible que, lorsqu’il décrit l’opéra de Hambourg, l’hebdomadaire se refuse à prendre position sur les mérites comparés des styles nationaux. Au contraire, le journal plaide pour une conception éclairée de la musique, débarassée des particularismes régionaux d’Ancien Régime : Quant à savoir si une musique française ou italienne se prête à obtenir un meilleur effet, je me garderai bien d’oser affirmer quelque chose d’incontestable là-dessus. J’ai connu des gens raisonnables qui préféraient les uns celle-ci, les autres celle-là. Chacune d’entre elles possède des charmes particuliers, qui sont prisés selon les inclinations diverses des hommes, et estimés davantage ici ou là par suite de l’habitude. Un véritable maître, aussitôt qu’il remarque quel est le goût dominant dans son environnement, ne manquera pas d’y tendre par son art, sans amoindrir aucunement la perfection essentielle de la musique.175
On voit donc émerger ici pour la première fois une conception relativiste des styles nationaux d’Ancien Régime, considérés comme les produits contingents de la tradition, du lieu, du goût et de l’habitude. La vraie musique se situe au-delà de ces formes locales et secondaires. Telemann entre deux fronts : l’opéra comique Dans l’introduction à sa Critique des Hamburgischen Schau=Platzes, Kunzen indiquait de manière tout à fait explicite le modèle qu’il avait suivi pour rassembler en un même ensemble quatre actes issus de pièces très variées : il s’agissait d’une pièce supervisée et partiellement composée par Telemann l’année précédente, qui avait conclut le carnaval et remporté un beau succès.176 Der Beschluß des Carnevals avait été donné le 21 février 1724, et représente la seule adaptation connue d’une œuvre lyrique française réalisée avec sa musique originale sous la supervision de Telemann – on ne connaît autrement que des adaptations musicales de livrets français traduits en allemand, comme Omphale (1722), Orpheus (1726) ou Die verkehrte Welt (1728).177 Cette pièce se composait de trois actes, également empruntés à des sources très diverses et formant un patchwork assez hétérogène : le premier acte, sous-titré « Ballet en musique » dans le livret, reprenait comme Kunzen la cinquième entrée turque de L’Europe galante de Campra. Toutefois, elle en modifiait substantiellement le dénouement, puisqu’au lieu de voir la Discorde prendre la fuite
174 175
176 177
Der Patriot, 17 mai 1724, p. 198 : « Er wird mir aber vergeben, daß ich alle Frantzösische Galanterien hievon ausschliesse, und ihnen niehmals einigen Platz in meinen Papieren einräumen werde. » Der Patriot, 22 juin 1724, p. 245-246 : « Ob aber zu dieser Wirckung eine Französische, oder Welsche Music geschickter sey, davon getraue ich mir nichts unwiedersprechliches fest zu setzen. Ich habe vernünftige Leute gekannt, welche bald diese jener, bald jene dieser vorgezogen. Beide haben ihre besondere Anmuth, welche, nach verschiedener Neigung der Menschen, angenommen, und durch Gewohnheit hie oder da beliebter wird. Ein Meister, so bald er den herrschenden Geschmack seines Ortes vermercket, wird nicht ermangeln, mit seiner Kunst in denselben hineinzugehen, ohne den wesentlichen Vollkommenheiten der Musik das geringste zu entziehen. » Critique des Hamburgischen Schau=Platzes, préface non paginée. Martin Ruhnke, « Telemanns Hamburger Opern und ihre italienischen und französischen Vorbilder », Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 5, 1981, p. 9-27. Peter Huth, « Telemanns Hamburger Opern nach französischen Vorbildern », in : Französische Einflüsse auf deutsche Musiker im 18. Jahrhundert, dir. Friedhelm Brusniak et Annemarie Clostermann, Cologne 1996, p. 115-148. Wolfgang Hirschmann, « Le monde renversé – Die verkehrte Welt. Zur Adaption und Transformation der Opéra comique auf deutschen Bühnen des frühen 18. Jahrhunderts » in : Telemann und Frankreich – Frankreich und Telemann, dir. Carsten Lange et al., Hildesheim 2009, p. 238-266.
– 296 –
L'invention allemande du style français
devant Vénus, les spectateurs hambourgeois pouvaient entendre le sultan ordonner la venue d’une troupe de comédiens français pour célébrer les fiançailles de sa fille Zaïde.178 Là encore, l’allusion au personnel théâtral français des cours allemandes était transparente, et donnait donc lieu à une scène de théâtre dans le théâtre : le deuxième acte était formé par la représentation d’une comédie d’Antoine Jacob de Montfleury, La fille Capitaine, suivie directement d’un acte composé par Telemann, et intitulé Il Capitano. Même si la liste des acteurs n’est pas donnée, on peut penser que les Français présents à Hambourg (accompagnés sans doute de quelques collègues dont nous ignorons l’existence) jouaient leur propre rôle dans le deuxième acte, donnant la comédie comme ils l’auraient fait dans le monde de la cour. Plus intriguant encore était le sous-titre donné par Telemann à cette œuvre : « Opera Comique ». Du point de vue générique, cette pièce s’inscrivait par-là dans une série assez conséquente de représentations comiques, que Reinhard Keiser avait inaugurée en 1707 avec l’un des plus grands succès commerciaux de l’histoire de l’opéra de Hambourg : Der angenehme Betrug oder Der Carneval von Venedig, créé en 1707 et très régulièrement repris jusqu’en 1735. Dans cette œuvre, Keiser recourait déjà au modèle d’un opéra-ballet mis en musique par Campra, Le Carnaval de Venise (1699) : le livret anonyme de cette pièce était une traduction très libre et arrangée du livret que Jean-François Regnard avait composé pour l’opéra-ballet de 1699. Quant à la musique, la préface de 1707 indiquait qu’elle provenait des sources les plus variées, mais qu’elle avait en grande partie été composée par Reinhard Keiser et André Campra.179 On a souvent supposé que les extraits musicaux qui avaient été repris de l’œuvre originale de Campra correspondaient aux trois airs français contenus dans le livret. En fait, une observation plus attentive montre que ce sont des airs à boire qui n’appartiennent pas au ballet. Ils ont donc été probablement insérés comme une touche comique de colori local. Le seul endroit où le livret de Regnard et probablement la musique de Campra sont repris textuellement par la production hambourgeoise se trouve, de manière assez ironique, dans les airs et les chœurs en italien à la fin de la troisième entrée de l’acte I. C’est donc précisément pour ces passages en italien que Keiser a repris la musique française : il s’agissait là d’une farce ironique, puisque la préface du livret incitait les auditeurs versés dans la musique à deviner quels étaient les passages musicaux que Keiser avait composé lui-même, et quels étaient ceux qu’il avait au contraire repris. Dans les années 1725 et 1726, Keiser compléta sa propre série de « méprises » en produisant encore trois œuvres supplémentaires : le Hamburger Jahr=Markt créé le 30 juin 1725,180 la Hamburger Schlacht=Zeit dont la représentation fut interdite aussitôt après sa création le 22 octobre 1725,181 et L’Inganno fedele créé en 1726.182 Parmi ces trois œuvres, les deux premières étaient qualifiées dans la préface d’« Opera comique ». Lors de son Beschluß en 1724, Telemann avait donc à la fois imité l’exemple de Keiser par le choix d’une pièce de Campra, mais aussi lancé une mode qui fit florès : la création d’œuvres assez librement agencées, de caractère plutôt comique, et dont le titre était accompagné de la mention « Opera comique ». La composition en 1728 de Die verkehrte Welt, dont la page de titre porté également la mention « Opera comique », montre que le nouveau directeur de l’opéra avait su trouver, à travers l’exemple de Keiser, une nouvelle manière d’adapter les modèles littéraires et musicaux de l’opéra français qui ne reposait plus sur une esthétique galante, n’incarnait plus le « grand goût » français mais au contraire un versant plus familier et comique de la création lyrique parisienne, et pouvaient donc trouver l’assentiment du public éclairé de Hambourg. Cette accumulation autour de 1725 témoigne d’un profond renouvellement dans les manières d’adapter le style français à un public germanique : le succès rencontré par les adaptations d’opéra-ballet désignées sous le genre hambourgeois de « l’opéra-comique » remplaçait définitivement la repré178 179 180 181 182
Georg Philipp Telemann, Der Beschluß des Carnevals. Opera comique, non paginé. Voir note 151. Der angenehme Betrug, oder der Carneval von Venedig, Hambourg 1707, préface non paginée. Der Hamburger Jahr=Marckt Oder der glückliche Betrug, Hambourg 1725. Die Hamburger Schlacht=Zeit oder Der Mißgelungene Betrug, Hambourg 1725. L’inganno Fedele Oder : Der getreue Betrug, Hambourg 1726.
– 297 –
Chapitre 5
sentation de tragédies en musique dans leur version originale, dont la désastreuse production de Desmarest en 1725 fut le dernier exemple. C’est ainsi que Telemann pouvait réagir aux critiques exprimées contre le modèle galant tout en continuant à cultiver, de manière sans doute moins démonstrative et beaucoup moins galante que dix ans auparavant, son intérêt pour les productions musicales françaises. Ces adaptations n’étaient cependant pas au goût de tout le monde : dès 1725, Mattheson condamnait le « goût corrompu » dont témoignaient ces « vulgaires adaptations183 ». Pour lui, ces adaptations comiques étaient aussi le signe que « l’énergique esprit français avait presque complètement disparu de la scène.184 » Musique française et Lumières : vers un renversement des alliances À partir des années 1730, la musique française change radicalement de statut dans l’espace germanophone. Elle est considérée non plus à travers le prisme des genres lyriques et instrumentaux qui se situent à la pointe de la modernité, mais de plus en plus à travers celui du répertoire savant de la musique d’église ou de la littérature pour orgue. Lorsque Johann Joachim Quantz, élève de Buffardin et membre de la Hofkapelle de Dresde où il avait acquis une expérience personnelle approfondie de la musique française, raconte le voyage à Paris qu’il effectua en 1726, il ne mâche pas ses mots sur l’état de la musique en France. Se rappelant son arrivée à Paris après avoir passé plusieurs mois en Italie, il écrit : Je passai alors d’un extrême à l’autre sous le rapport du goût musical, de la diversité à l’uniformité. Même si le goût français ne m’était pas du tout inconnu et que j’acceptais très bien leur manière de jouer, je ne pus pourtant pas me faire dans leurs opéras aux idées réchauffées et usées des compositeurs, ni à la faible différence entre récitatif et airs, ni aux cris exagérés et affectés de leurs chanteurs, et particulièrement de leurs chanteuses. […] La musique d’église des Français me plut davantage que leur opéra. Le Concert spirituel et le Concert italien n’étaient pas à dédaigner ; le premier était pourtant mieux fréquenté que le second. La cause en est la prévention contre la musique des étrangers, qui rend la nation française très malade et qui l’empêchera d’améliorer son goût musical aussi longtemps qu’elle s’entête dans cette voie.185
Il est particulièrement frappant que Quantz relève une différence qualitative entre les opéras entendus à l’Académie royale de musique et le répertoire de musique d’église. En fait, cette évolution dans l’appréciation de la musique française est partagée par un certain nombre d’acteurs de la vie musicale allemande et allait provoquer un véritable renversement des alliances au cours des années 1730 : alors que la musique française se situe encore aux avant-postes de la modernité musicale et intellectuelle en 1717, notamment à travers son association avec les valeurs de
183
184
185
Mattheson, Der Musikalische Patriot, p. 200 : « Der verdorbene Geschmack, mit den Operas comiques : denn eine Opera comique wiederspricht sich selbst, wie ein höllisches Paradies etc. ». Sur ce point, voir aussi Hansjörg Drauschke, « Beispiele wider den ‘verdorbenen Geschmack’. Bearbeitungen als Paradigmen für Johann Matthesons Opernästhetik der 1720er Jahre », in : Johann Mattheson als Vermittler und Initiator. Wissenstransfer und die Etablierung neur Diskurse in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dir. Wolfgang Hirschmann et Bernhard Jahn, Hildesheim 2010, p. 197-213. Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, p. 218 : « Das sogenannte Carnaval von Venedig ist aus dem Frantzösischen übersetzt und 1707 hier gespielt, auch unzehlige mahl, mit Vergnügen der Zuschauer, wiederholet worden. Hernach sind die abgeschmackten Intermezzi und Zwischen-Spiele Mode geworden ; der lebhaffte Frantzösische Geist aber hat sich fast gantz vom Theater verlohren. » Marpurg, Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, vol. 1, p. 237-239 : « Hier wurde ich, in Ansehnung des musikalischen Geschmacks, von dem einen äußersten Ende ins andere, aus der Mannigfaltigkeit in die Einförmigkeit, versetzet. Ungeachtet mir der französische Geschmack eben nicht unbekannt war, und ich ihre Art zu spielen sehr wohl leiden konnte : so gefielen mir doch, in ihren Opern, weder die aufgewärmten, und abgenutzten Gedanken ihrer Componisten, und der geringe Unterschied zwischen Recitativ und Arien ; noch das übertriebene und affectirte Geheul ihrer Sänger und besonders ihrer Sängerinnen. […] Die Kirchenmusiken der Franzosen gefielen mir besser als ihre Opern. Das Concert spirituel and das Concert italien waren nicht zu verachten : doch wurde das erstere mehr besuchet als das letztere. Die Ursach davon war ohne Zweifel, ein Vorurtheil, wider die Musik der Ausländer, woran die französische Nation sehr krank liegt : und welches sie, so lange sie noch dabey bleibt, verhindern wird, ihren Geschmack in der Musik zu verbessern. »
– 298 –
L'invention allemande du style français
la galanterie, elle est de plus en plus considérée comme rétrograde et conservatrice à partir de la troisième décennie du xviiie siècle. Ce changement de statut s’inscrit dans un contexte plus général où le projet même d’une typologie des styles nationaux devient caduque et tombe sous le feu de la critique, au nom d’un idéal universaliste et cosmopolite. De la galanterie au style galant : mutations d’un concept Dans le champ littéraire germanique, la galanterie désigne un corpus de textes très cohérent apparu entre 1680 et 1720 dans le sillage du discours sur l’imitation des Français prononcé en 1687 par Christian Thomasius à l’Université de Leipzig.186 Ses principales figures sont Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, August Bohse sous le pseudonyme Talander, Christian Friedrich Hunold sous le pseudonyme Melante, ou Johann Leonhard Rost. Ce dernier publie sous le pseudonmye de Meleaton (une forme composite de Talander et Melante) une production polymorphe et abondante parmi laquelle on repère entre autres un traité de danse française publié en 1713, un an après la parution du traité de Louis Bonin qu’il avait préfacé.187 Si l’histoire littéraire se focalise généralement sur la genèse et la structuration de ce mouvement au détriment de sa progressive désagrégation et de sa disparition, il est indéniable que les critiques exprimées dès 1725 à l’encontre de l’idéal galant contribuèrent à le faire imploser. Particulièrement frappant à cet égard est le contre-discours sur l’imitation des Français publié en 1744 par Johann Michael von Loen, qui fait référence au discours prononcé une cinquantaine d’années auparavant par Thomasius mais tire des conclusions exactement inverses, condamnant « l’imitation servile » de ses compatriotes.188 Mais cette mutation culturelle, littéraire et anthropologique provoquée par les critiques éclairées de la galanterie touchait aussi le discours sur la musique.189 Ainsi, alors que les deux premiers volumes de l’Orchestre publiés par Mattheson font un large emploi de l’adjectif « galant » toujours pris en bonne part, le troisième tome publié en 1721 pointait l’ambiguité du terme : il y a une différence entre galant et galant, le mot peut être pris en bonne et en mauvaise part, pour désigner une personne particulièrement vive et agréable dans le sens ancien, ou au contraire dans un sens plus moderne pour désigner quelqu’un aux mœurs dépravées, voire une maladie vénérienne.190 Mattheson prend bien soin d’ajouter qu’il n’emploie le terme que dans un sens positif – encore en vigueur, note-t-il, chez les Italiens. Bien plus, Mattheson donne une liste de ceux qu’il considère désormais comme les « compositeurs les plus célèbres et les plus galants de toute l’Europe » : Capelli, Bononcini, Gasparini, Marcello, Vivaldi, Caldara, Scarlatti, Lotti, Keiser, Händel, Telemann.191 Pas la moindre trace de compositeurs français, donc, mais un cortège de compositeur aimables, élégants, modernes, compréhensibles, agréables, distrayants, parfois surprenants, qui cultivent un style chantant, clair et simple – tous des Italiens à l’exception de Keiser, 186 187 188 189 190
191
Thomasius, « Diskurs von der Nachahmung der Franzosen ». Meletaon [Johann Leonhard Rost], Von der Nuetzbarkeit des Tantzens, Leipzig 1713. Voir notamment Catherine Julliard, « Johann Michael von Loen et son Discours de l’imitation des Français (1744). Un anti-Thomasius ? », Recherches germaniques, 40, 2010, p. 131-150. Pour un aperçu sur les emplois de l’adjectif galant dans la production théorique musicale, voir Wolfgang Horn, « Galant, Galanterie, Galanter Stil », in : Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, vol. 3, Stuttgart, 1973. Mattheson, Das Forschende Orchestre, p. 276 : « Zwischen galant und galant ist ein Unterschied. Wenn der Herr Rector Hübner von der Pedanterie und Galanterie, als zwo Pesten der Schulen schreibet, so verstehet er durch die letztere eben nicht viel Gutes. So wie man heutiges Tages manches verdächtiges Frauenzimmer, ja wohl garstige Kranckheiten, mit einem galanten Prædicato zu belegen pfleget. Die Italiäner aber verstehen durch einen galant huomo, eine wackern, geschickten, tüchtigen und redlichen Kerl, un valent’uomo, wie ich es denn in alten Autoribus, insonderheit aber im Artusio oft so geschrieben finde. Und in solchem, als seinen rechten genuinen Verstande, nehmen wir das Wort auch hier. » Mattheson, Das Forschende Orchestre, p. 275 : « Glaubet wohl ein Mensch in dieser Welt, daß die aller-berühmtesten und galantesten Componisten in Europa, als Gio. Mar. Capelli, Anton. Bononcini, Franc. Gasparini, Bened. Marcello, Vivaldi, Caldara, Alessand. Scarlatti, Lotti, Keiser, Händel, Telemann etc. bey allen ihren wunderschönen Sachen wohl einen eintzigen Circul=Strich gethan haben, dadurch ihre Arbeit besser, als sonst gerathen wäre ? »
– 299 –
Chapitre 5
Telemann et Händel. Ici, l’adjectif galant semble donc désigner un type musical opposé au style savant voire pédant. Cet usage du terme est encore relativement proche de son origine française, puisqu’il se trouve employé en ce sens par Bénigne de Bacilly, lorsque celui-ci oppose la manière galante et la manière sérieuse de chanter.192 On le trouve encore chez Quantz, lorsqu’il oppose à la discipline d’orchestre draconienne exigée par l’ouverture à la française une « manière trop galante de jouer, & un coup d’archet trop long, trainant & qui n’a pas une certaine force » et ne convient donc pas aux ouvertures, dans lesquelles elle « ne fait point un si bon effet, que dans un Solo ou dans une petite Musique de Chambre ».193 Dans ce cas précis, la galanterie devient donc associé au jeu à l’italienne, caractérisé par une allure recherchée et une libre ornementation de la ligne mélodique, et se trouve renvoyée à l’exact opposé d’un style de jeu sobre, enlevé et grave caractéristique de la manière française. Enfin, dans les cercles berlinois, l’adjectif galant est couplé à partir de 1750 avec le terme « Schreibart » (manière d’écrire) et prend donc un sens plus technique, lié à l’harmonie et au traitement de la dissonance. Cet usage se rencontre sous la plume de Carl Philipp Emanuel Bach, lorsqu’il explique que l’accord de quarte et quinte peut être attaqué sans préparation de la dissonance dans le style galant, par opposition au style savant contrapunctique.194 Dans son Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, Friedrich Wilhelm Marpurg – un excellent connaisseur du style français – mentionne un seul cas où il est permis de moduler directement d’un ton principal majeur au ton homonyme mineur : Dans le style galant, on a le droit, si une courte figure rythmique se trouve dans un mode majeur, de la transposer lors de sa répétition sur le même degré, mais dans une tonalité mineure, après quoi l’on retourne à l’harmonie majeur. Ce procédé ne doit en aucun cas survenir en sens contraire, quand le passage à répéter se trouve dans un mode mineur.195
Cet exemple invite à s’interroger sur les liens qui unissent ce nouveau « style galant » avec l’ancien « style français ». En effet, nous avons noté plus haut que le changement de mode sur la tonique semble avoir été employé et perçu comme un marqueur tonal du style français jusque dans les années 1730. Dans les suites de Bach, ce changement de mode apparaît dans des paires de danses au caractère moderne et populaire, par opposition aux danses plus traditionnelles telles que l’allemande, la courante, la sarabande ou la gigue : menuets, passepieds, gavottes, bourrées, rondeaux. Or, en allemand, ces danses reçoivent parfois le nom de « Galanterisätze ». Mattheson utilise en 1713 le terme de manière générique, pour désigner toutes les pièces libres écrites pour le clavecin ou le clavicorde.196 Mais sur la page de titre de ses partitas pour clavier publiées en 1731 à Leipzig
192
193 194
195
196
Bénigne de Bacilly, L’Art de bien chanter, Paris 1679, p. 15-16 : « l’un & l’autre est bon, pourveu qu’il soit bien pratiqué, & avec jugement, selon la diversité des Pieces de Musique gayes ou tristes, galantes ou serieuses. […] La legereté donne au chant, ce qui s’appelle le tour galant : mais la pesanteur donne la force aux Pieces serieuses, & qui demandent beaucoup d’expression. […] il est aussi dangereux de le loüer par la gravité & la pesanteur qui semble estre opposée à la galanterie du chant. » Quantz, Essai d’une méthode, p. 186. Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art, Clavier zu spielen, vol. 2, Berlin 1762, p. 164 : « In der galanten Schreibart kann die Quarte zuweilen unvorbereitet, mit der None vorkommen. » Voir aussi l’usage du terme dans le contexte d’une discussion sur l’ornementation dans le vol. 1, Berlin 1753, p. 118 : « Viele, besonders die affectuösen oder sprechenden Stellen eines Stückes lassen sich nicht wohl verändern. Hierher gehöret auch diejenige Schreib-Art in galanten Stücken, welche so beschaffen ist, daß man sie wegen gewisser neuen Ausdrücke und Wendungen selten das erste mahl vollkommen einsieht. » Friedrich Wilhelm Marpurg, Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, Berlin 1762, p. 25 : « In der galanten Schreibart ist es erlaubt, einen kurzen Rhytmus, bey welchem eine Durtonart zum Grunde liegt, bey der Wiederholung desselben auf eben denselben Stuffen, in eine Moltonart zu versetzen, worauf man in die Durharmonie wieder zurücke geht. Dieser Proceß findet aber im geringsten nicht umgekehrt Statt, wenn bey der zu wiederhohlenden Passage ein Moltonart zum Grunde liegt. » Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, p. 264 : « Hand- und Galanterie-Sachen, als da sind, Ouverturen, Sonaten, Toccaten, Suiten, &c. werden am besten und reinlichsten auff einem guten Clavicordio herausgebracht,
– 300 –
L'invention allemande du style français
sous le nom de Clavier-Übung, Bach utilise le terme « Galanterien » de manière plus spécifique et plus énigmatique dans le contexte de suites de danses.197 Même si cette collection ne renferme aucun exemple de changement de mode sur la tonique, elle indique que Bach lui-même pouvait se servir du terme de « Galanterien » pour désigner certaines danses pour clavier. Un dernier élément permet de jeter un pont entre l’ancien style français et le nouveau style galant. On sait que la monumentale collection de pièces pour orgue publiée en 1741 et connue sous le titre de Clavier-Übung III est introduite par un Praeludium pro Organo Pleno en mi bémol majeur bwv 552 qui inaugure solennellement l’ensemble par une écriture typique de l’ouverture à la française, à cinq voix en rythmes pointés. Les deuxième et troisième sections du prélude témoignent en revanche d’une orientation stylistique tout à fait différente. Or le second groupe thématique, très mélodieux et galant (Exemple 5.13), ménage un changement de mode entre si bémol majeur et si bémol mineur (mes. 44) avant de retourner dans le ton majeur (mes. 51). Lors de la deuxième présentation transposée du même passage, ce changement de mode affecte la tonique, conduisant de mi bémol majeur à mi bémol mineur puis en majeur (mes. 124-131). On remarque enfin que dans le troisième groupe thématique, la dominante est touchée plusieurs fois en mode mineur : on module d’abord de si bémol majeur vers fa mineur (mes. 151) puis de mi bémol majeur à si bémol mineur (mes. 159-161). On peut se demander si ce changement de mode « galant » a encore à voir avec la pratique harmonique usuelle dans les « Galanteriesätze » des suites françaises autour de 1730, où s’il s’agit plutôt de l’adoption d’un procédé complètement différent, présent par exemple sous la plume de Vivaldi dans les brèves modulations au ton homonyme.198 Quoiqu’il en soit, on perçoit bien à travers cet exemple qu’en dépit du changement de paradigme observable vers 1725, l’ancien idéal de la « galanterie » continue sans doute d’irriguer de manière sous-terraine le nouveau « style galant ». Ces liens sont d’ailleurs au cœur de l’enquête que Keith Chapin consacre au style contrapunctique de Telemann ou encore aux disputes avec la tradition dans le discours théorique allemand du premier xviiie siècle, à partir d’une et à une autre querelle célèbre : celle qui opposa Birnbaum et Scheibe autour du style de Bach.199 Exemple 5.13. Johann Sebastian Bach, Praeludium pro Organo pleno bwv 552/1, mesures 43-51.
j b j œ j j b œ b œ œ œ n œ œ œr œ œ n œ œ b œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ j b œ & b b C œJ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ J œ Œ Œ Œ Œ Œ œœ œœ œœ n œœ œœ œ œ nœ bb C œ ? œ b b œ œ & œ œ œœ œœ œœ m b œ r œ œ nœ œ b œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œj b œ b œJ œ œ œ œ œ œ n œ ™ œ w ≈ œœ œ ™ & b b œ nœ œ œ ‰ R nœ ™ Œ Œ œ œœ b œœ œ bœ œ œ b œ b œœ œœ n œ œœ ˙ ? bb œ œ œ ˙ ˙ b
5
? bb
197 198
b
∑
∑
∑
œ œ
bœ J
œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œ ˙˙˙ nœ
œ™ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ™ Ó
∑
˙
als woselbst man die Sing=Art viel deutlicher, mit Aushalten und adouciren, ausdrücken kan, denn auff den allezeit gleich starck nach=klingenden Flügeln und Epinetten. » Johann Sebastian Bach, Clavir Ubung bestehend in Praeludien, Allemanden, Courranten, Sarabanden, Giquen, Menuetten, und andern Galanterien ; Denen Liebhabern zur Gemüths Ergoetzung verfertiget, Leipzig 1731. Brover-Lubovsky, « ‘Die Schwarze Gredel’ », p. 105-131. Bella Brover-Lubovsky, Tonal Space in the Music of Antonio Vivaldi, Bloomington 2008, p. 91-121.
– 301 –
Chapitre 5
Cosmopolitisme et refus des styles nationaux : Scheibe contre Birnbaum En 1737, le jeune Johann Adolph Scheibe venait de lancer à Hambourg une nouvelle revue professant une modernité musicale éclairée, placée sous le signe du rationalisme : le Critischer Musicus. Quelques semaines seulement après son lancement, en mai 1737, il publiait une attaque en règle contre le style de son ancien professseur Johann Sebastian Bach, lui reprochant son obscurité, sa complexité et son manque de naturel.200 Scheibe opposait à Bach les compositeurs galants tels que Graun et Hasse ainsi que son nouvel ami Georg Philipp Telemann, dont la « flamme raisonnable » aurait contribué à faire connaître en Allemagne les « genres étrangers de musique » tels que l’ouverture, et que « les Français eux-mêmes doivent donc remercier pour le grand progrès qu’il a fait faire à leur musique.201 » Face à cette attaque, le professeur de rhétorique à l’Université de Leipzig Johann Abraham Birnbaum monta au créneau pour défendre l’honneur de son ami. Sa réponse, publiée par Scheibe l’année suivante, contenait un passage particulièrement intéressant à propos de l’habitude de Bach d’écrire en toutes notes les ornementations de la ligne mélodique : Nous n’avons pas encore complètement réfuté l’impossibilité qu’il y aurait selon l’auteur à jouer ou à chanter les œuvres de Bach. [Scheibe] ajoute en effet que [Bach] écrit expressément, en toutes notes, tous les agréments et les petits ornements, enfin tout ce qui est inclut dans la bonne méthode d’exécution. Soit [Scheibe] relève ce point parce qu’il est propre [à Bach] seulement, ou bien parce qu’il considère que c’est une faute. Dans le premier cas, l’erreur serait manifeste : [Bach] n’est ni le premier ni le seul à composer ainsi. Parmi la foule immense de compositeurs que je pourrais citer, je n’en appellerai qu’à Grigny et à Du Mage, qui se sont servis précisément de cette méthode dans leurs Livres d’orgue. Et dans le deuxième cas, je ne puis comprendre pourquoi cela mériterait le nom de faute.202
La convocation de Nicolas de Grigny et de Pierre Du Mage au détour d’une phrase n’est pas le fruit hasard, mais a sans doute été dictée par Bach lui-même, puisqu’il connaissait à fond l’œuvre du premier, et sans doute du deuxième. Dans la nouvelle querelle de génération qui oppose Scheibe et Birnbaum, la musique française a donc basculé du côté des Anciens. Scheibe témoigne d’ailleurs dans une note de bas de page de son incrédulité face à cette référence surprenante : Grigny et Du Mage « furent peut-être des gens biens à leur époque », mais les connaisseurs de musique sont capables de faire la différence entre le répertoire d’orgue et le répertoire vocal.203 Et c’est 199 200 201 202
203
Keith Chapin, « Scheibe’s Mistake : Sublime Simplicity and the Criteria of Classicism », Eighteenth-Century Music, 5/2, 2008, p. 165-177. Keith Chapin, « Counterpoint : From the Bees or For the Birds ? Telemann and Early Eighteenth-Century Quarrels with Tradition », Music & Letters, 92/3, 2011, p. 377-409. Scheibe, Critischer Musicus, 14 mai 1732, p. 62 : « Dieser große Mann würde die Bewunderung ganzer Nationen seyn, wenn er mehr Annehmlichkeit hätte, und wenn er nicht seinen Stücken, durch ein schwülstiges und verworrenes Wesen das Natürliche entzöge, und ihre Schönheit durch allzugroße Kunst verdunkelte ». Scheibe, Critischer Musicus, 17 sept. 1737, p. 146-147 : « Das vernünftige Feuer eines Telemanns hat auch in Deutschland diese ausländische Musikgattungen bekannt und beliebt gemacht ; wie ihm denn die Franzosen selbst eine große Verbesserung ihrer Musik zu danken haben. » Johann Abraham Birnbaum, « Unparteyische Anmerkungen über eine bedenkliche Stelle in dem sechsten Stücke des critischen Musicus », in : Scheibe, Critischer Musicus, p. 854 : « Jedoch ist hiermit der von dem Verfasser vorgewendeten Unmöglichkeit, die bachischen Stücke zu spielen, oder zu singen, noch nicht abgeholfen. Er setzt an denselben noch weiter aus: daß der Herr Hofcompositeur alle Manieren, alle kleine Auszierungen, und alles, was man unter der Methode zu spielen versteht, mit eigentlichen Noten ausdrücke. Entweder merkt der Verfasser dieses an, als etwas, das dem Herrn Hofcompositeur allein eigen seyn soll; oder er hält es vor einen Fehler überhaupt. Ist das erstere: so irrt er sich gewaltig. Der Herr Hofcompositeur ist weder der erste, noch der einzige, der also setzet. Unter einer zahlreichen Menge Componisten, so ich dießfalls anführen könnte, berufe ich mich nur auf den Grigny und Du Mage, welche in ihren Livres d’Orgue sich eben dieser Methode bedienet haben. » Johann Adolph Scheibe, « Beantwortung der unparteyischen Anmerkungen », in : Scheibe, Critischer Musicus, p. 854 : « Grigny und Du Mage mögen zwar zu ihrer Zeit ein Paar gute Leute gewesen seyn ; allein, daß ihre Livres d’Orgue des Herrn Magisters Meynung von der Nothwendigkeit des Ausdrucks der Manieren in starken Instrumental= und Vocalstücken, als von welchen der Verfasser des Briefes redet, bestärken sollten, erfordert einen großen Glauben. Kenner der Musik werden allerdings einen Unterschied unter bloßen Orgelsachen und unter andern vielstimmigen Vocal= und Instrumentalmusik machen. »
– 302 –
L'invention allemande du style français
bien aussi pour cette raison que Scheibe peut conclure sa seconde salve d’attaques, rédigée après la défense de Birnbaum, par une superbe pointe : Ce que l’on appelle le goût à la nouvelle mode et qui, selon le jugement rassis de Monsieur l’auteur impartial des Remarques, est corrompu, ce goût pourrait bien être beaucoup plus fondé et plus naturel que le goût vieux francique [altfränkischer] de ceux qui, avec Monsieur l’auteur, préfèrent la contrainte à la nature.204
Préférer la contrainte à la nature : ce serait selon Scheibe la marque d’un goût « vieux francique » partagé par Bach et ses thuriféraires. Cet adjectif péjoratif est à n’en pas douter une pique contre le vieux répertoire d’orgue français cité par Birnbaum. Il est donc clair que la musique française a désormais changé de genre et de camp : elle n’est plus du côté de l’opéra, de l’ouverture, du naturel et de la galanterie, mais elle représente au contraire par le biais des livres d’orgue un répertoire savant, obscure et pédant, à l’opposé du style galant prôné par Scheibe. En fait, cette querelle n’a pas pour seul enjeu la musique de Bach. On pourrait même dire que ce n’est pas là son enjeu principal : ce qu’elle met au jour, c’est d’abord la confrontation de deux mondes qui diffèrent radicalement sur le plan intellectuel aussi bien que sur le plan social. D’un côté Scheibe, issu d’un milieu modeste, ayant échoué à obtenir le poste d’organiste à la Thomaskirche de Leipzig lors du recrutement de 1727, et ayant quitté sa ville natale pour la bouillonnante métropole qu’était alors Hambourg. De l’autre Birnbaum, fils de juriste et juriste luimême, né et mort à Leipzig où il avait repris l’étude de son père, faisant partie du monde tranquille des notables de la ville. On perçoit bien ce que ces deux trajectoires ont de radicalement opposé, et la nécessité de prendre en compte l’affrontement social qui se joue ici entre les deux hommes pour mesurer avec justesse leurs prises de position respectives. Mais au-delà de la différence sociale entre les deux hommes et des réflexes de classe qui s’expriment dans leurs écrits, ce sont aussi deux mondes intellectuels et deux conceptions de la musique qui s’opposent. D’un côté, Scheibe défend avec fougue le style nouveau contre les tentations conservatrices de son adversaire, en mobilisant pour cela un arsenal argumentatif tout droit issu des Lumières naissantes : raison, naturel, simplicité. Son style est limpide, pragmatique, très structuré et ne s’embarrasse pas de détails superflus. Il se pose d’ailleurs en « connaisseur impartial de la musique », par opposition au « docteur » Birnbaum qui prend la défense de Bach en insistant sur le travail, le savoir-faire, le caractère subjuguant de la science du contrepoint.205 Comme on peut le sentir dans la citation donnée ci-dessus, le style argumentatif de ce dernier est beaucoup plus scolastique, procédant de façon ramifiée par distinctions successives davantage que par grands ensembles de concepts. Il ne semble pas comprendre le réseau serré d’oppositions tissé par son adversaire – naturel contre artifice, simplicité contre confusion, rationalité contre ratiocination – et choisit de réfuter point par point les positions de Scheibe sans parvenir à s’échapper du système argumentatif déployé par ce dernier. En fait, Scheibe plaidait plus radicalement pour l’abandon des styles nationaux et l’avènement d’un style cosmopolite. C’est au nom d’un style musical moderne, débarrassé du provincialisme et des particularismes des styles nationaux d’Ancien Régime, qu’il attaquait son ancien maître Johann Sebastian Bach. En septembre 1737, Scheibe attaque frontalement cette question dans un article polémique qui débutait par l’application à la musique d’une formule frappante : « Tous ceux qui pensent bien n’écrivent pas bien ; mais tous ceux qui écrivent bien doivent nécessairement bien penser.206 » Dans la suite du texte, Scheibe s’attaquait déjà au « style ampoulé »
204
205 206
Scheibe, Critischer Musicus, p. 886 : « Es dürfte allso der so genannte neumodische Geschmack, der nach dem reifen Urtheile des unpartheyischen Herrn Verfasser der Anmerkungen, zwar verdorben ist, weit gegründeter und natürlicher seyn, als der altfränkische Geschmack derjenigen, welche mit dem Herrn Verfasser den Zwang der Natur vorziehen. » Scheibe, Critischer Musicus, p. 843. Scheibe, Critischer Musicus, p. 131 : « Nicht alle, die gut denken, schreiben auch gut ; aber alle, die gut schreiben, müssen nothwendig gut denken. Dieser Satz ist in der Musik eben so allgemein, als in andern Wissenschaften. »
– 303 –
Chapitre 5
(« schwülstige Schreibart ») dont il dénonçait la complexité pédante mais aussi l’hétérogénéité anarchique : Nous trouvons dans la plupart de ces pièces un ensemble hétérogène, confus et désordonné. On écrit une ligne dans le style élevé, l’autre dans le style moyen, et la troisième enfin dans le style bas. Ici un passage français, mais là un passage italien. Tantôt apparaît un mouvement théâtral, tantôt un autre qui conviendrait à l’église. Vraiment, tout est si chaotique et si confus qu’on ne peut même pas démêler un style prédominant, ou même l’expression de quelque chose. […] Cette hétérogénéité provient aussi de ce que l’on mélange les caractères de pièces françaises, italiennes, allemandes ou autres, sans réfléchir une seconde au fait que chaque pièce nécessite d’être élaborée en vue d’elle-même.207
C’est aussi l’idée développée par Quantz dans son Essai de 1752. Le traité s’achève en effet sur une entreprise en apparence banale : il s’agit de « caractériser brièvement Musique nationale des Italiens, & celle des François, considerées chacune de son meilleur coté, & faire la comparaison de ces deux gouts.208 » Mais après avoir dressé la liste des différences, le traité finissait sur un appel vibrant à l’adoption d’un style musical débarrassé des particularismes nationaux et capable de trouver l’assentiment de tous. En fait, le projet cosmopolite de Quantz peut être compris comme un véritable projet de paix perpétuelle, fondé sur l’idée que le progrès musical et l’union des styles produira « avec le tems un bon gout universel dans la Musique. » On a ici l’expression d’un progressisme musical visionnaire et placé sous le signe de l’universalité qui n’est pas sans rappeler le projet de paix perpétuelle esquissé quarante ans plus tard par Immanuel Kant. Sous le signe des anti-Lumières musicales ? Marpurg et Agricola Quelques années avant la Querelle de Bouffons, la dispute entre Marpurg et Agricola autour de la musique française symbolise de manière peut-être encore plus frappante que la précédente un nouveau scepticisme allemand à propos de la musique française, mais aussi l’inversion complète de la charge idéologique dont celle-ci était porteuse dans l’espace germanique jusque dans les années 1720. Dans le premier numéro de la revue Der Critische Musicus an der Spree, le très conservateur et francophile Marpurg essayait de convaincre son lectorat que l’admiration portée à la musique italienne par le public allemand était exagérée. Invitant ses compatriotes à relever la tête et à ne pas juger toutes les productions musicales à l’aune de l’Italie, le rédacteur les invitait à suivre l’exemple des Français : Nous suivons en cela les Français. Chez eux, on n’examine pas si tel Allegro ou tel autre est écrit dans le goût italien, mais seulement s’il est écrit avec bon goût. Un incomparable Leclair ou un Mondonville, qui sont des maîtres éprouvés dans l’art de toucher les cœurs, laisseraient volontiers à d’autres l’honneur d’être désignés comme Veracini ou Paganelli français ; et un Calvière ou un Daquin ne feraient qu’en rire, si l’on s’avisait de qualifier leur heureuse manière de toucher l’orgue de scarlattiste. Les auteurs des splendides motets qui sont joués à la chapelle de Versailles pendant la messe de midi n’ont encore jamais cherché à faire croire aux gens qu’on devait tenir leurs ouvrages pour des imitations de l’art du chant italien.209
207
208 209
Scheibe, Critischer Musicus, p. 134-135 : « Wir finden aber in den meisten Stücken ein ungleiches, verworrenes und unordentliches Wesen. Man hat in einer Zeile hoch, in der andern mittelmäßig, und in der dritten endlich gar niedrig geschrieben. Hier stehen französische, dort aber italienische Stellen. Bald zeiget sich ein theatralischer Staz, bald auch ein anderer, der sich in die Kirche schickte. Ja, alles ist so bunt und so kraus durcheinander gemischet, daß man keinesweges eine herrschende Schreibart, oder einen gehörigen Ausdruck der Sachen finden wird. […] Diese Ungleichheit wird auch verursachet, wenn man die Charactere der französischen, italienischen, deutschen, oder anderer Stücke, unter einander wirft, ohne zu bedenken, daß jedes Stück seine eigene Ausarbeitung erfordert. » Quantz, Essai d’un méthode, p. 325. Friedrich Wilhelm Marpurg, Des Critischen Musicus an der Spree, vol. 1, Berlin 1750, p. 2 : « Wir folgen hierinnen den Frantzosen nach. Man untersuchet nicht bey ihnen, ob dieses oder jenes Allegro nach dem italiänischen, sonder ob es in dem guten Geschmack geschrieben ist. Ein unvergleichlicher Leclair oder Mondonville, diese in der Kunst, die Hertzen zu rühren, so erfahrnen Meister, würden gerne die Ehre einem andern überlassen, wenn man ihnen die Beynamen der frantzösischen Veracini oder Paganelli gäbe ; und ein Calviere oder Daquin würde nur drüber lachen, wenn man die ihnen eigene glückliche Art, die Orgel zu schlagen, die
– 304 –
L'invention allemande du style français
Il est remarquable que le répertoire choisi par Marpurg comme défense et illustration de l’indépendance des Français soit placé sous le signe de la musique instrumentale et religieuse. C’est au contraire en prenant appui sur le répertoire lyrique que, sous le pseudonyme italien d’un « musicien voyageur », Johann Friedrich Agricola publia une réponse ironique où il tournait en ridicule le patriotisme musical de son collègue berlinois, et mettait en évidence le caractère dépassé du style français, et plus généralement de la distinction entre différents styles nationaux, et réclamait leur abandon au nom de valeurs tout droit issues des Lumières – liberté, simplicité, clarté : Je confesse sans y être obligé que la plupart des compositeurs français, aussitôt qu’ils ne copient pas les étrangers, laissent bien trop peu de liberté à leur imagination musicale, suivent leur Lully de manière bien trop servile, s’oublient bien trop rarement, et composent aujourd’hui quasiment la même chose que l’année dernière, ou même que ce que leurs grand-pères ont déjà composé il y a bien longtemps ; et qu’il doit leur être bien facile d’exprimer des idées pour la plupart très communes à travers leurs chiffres bizarres, car ils ne sortent jamais du cercle des tournures les plus banales. 210
La réponse de Marpurg ne se fit pas attendre : dans le numéro du 25 mars 1749, il entamait une longue réponse qui occupa cinq numéros pleins. Ce qui est intéressant ici n’est pas tant la nature des arguments échangés, que la place singulière occupée par la musique française dans le champ du discours musical berlinois à la veille de 1750. Marpurg, qui ne manque jamais une occasion de donner des nouvelles de la vie musicale parisienne et professe apparemment pour la France une admiration aiguillonnée par son voyage à Paris, est aussi un grand spécialiste du contrepoint et un défenseur de la fugue. À l’inverse, Agricola défend des options esthétiques plus modernes et un positionnement musical plus ouvert. Comme dans le cas de la querelle entre Scheibe et Birnbaum, l’opposition entre musique française et musique italienne semble recouvrir et conditionner un rapport symétriquement opposé à la modernité musicale, la première tombant dans l’orbite de ce l’on pourrait appeler en exagérant à peine les anti-Lumières musicales.211 Tout se passe donc comme si les admirateurs germanophones de la musique française se concentraient, à partir des années 1750, sur le répertoire religieux et le répertoire pour clavier : Quantz note ainsi, nous l’avons vu, qu’il préfère la musique d’église qu’il a entendue au Concert spirituel et au Concert italien à tous les opéras auxquels il a pu assister à l’Académie royale de musique. De même, Birnbaum cite le répertoire d’orgue. Marpurg suit cette même voie, mettant en valeur les motets entendus à la Chapelle royale et la musique pour clavier (clavecin et orgue) alors que son adversaire Agricola se concentre surtout sur la musique d’opéra. Les différences d’appréciation du style français semblent dont recouper non seulement un type de rapport à la modernité musicale, mais encore des préférences de répertoire qui vont dans un cas vers l’opéra, dans l’autre vers la musique d’église et la musique pour clavier et orgue. Ceci est d’autant plus frappant qu’on ne peut pas soupçonner Agricola d’avoir ignoré le répertoire pour orgue français : tout comme Marpurg qui s’en fait le défenseur, il a copié de larges pans d’un répertoire
210
211
Scarlattische betiteln wollte. Die Verfaßer der prächtigen Moteten, die in der Capelle zu Versailles zur Mittagsmesse abgesungen zu werden pflegen, haben noch niemals die Leute zu bereden gesucht, daß man ihre Ausarbeitungen für Copien der welschen Singart halten sollte. » Flavio Anicio Olibrio [Johann Friedrich Agricola], Schreiben eines reisenden Liebhabers der Musik von der Tyber, an den critischen Musikus an der Spree, 1749, p. 4 : « Ich bekenne, ohne daß man es von mir verlanget, daß die meisten Französischen Setzer, so lange sie nicht die Ausländer auschreiben, ihrer Einbildung in der Musik allzu wenig Freyheit erlauben, dem Lully aber gar zu sclavisch folgen, sich gar zu selten vergessen, sondern heute bey nahe eben dasselbe wieder setzen, was sie von dem Jahre gesetzt, oder was ihre Groß=Väter schon vor langer Zeit gesetzt haben: und daß es ihnen sehr leicht vorkommen muß, ihre meistentheils sehr gemeinen Gedanken durch ihre eigensinnigen Ziffern auszudrucken, weil sie sich immer nur in denen gewöhnlichsten Gängen herum drehen. » Pour la suite de la dispute entre Marpurg et Agricola, voir les documents rassemblés par Hans-Günter Ottenberg, Der Critische Musicus an der Spree. Berliner Musikschrifttum von 1748 bis 1799, Leipzig 1984, p. 83-106. Voir notamment Didier Masseau, « Qu’est-ce que les anti-Lumières ? », Dix-huitième siècle, 46/1, 2014, p. 107123. Pour une présentation de Johann Sebastian Bach comme critique des Lumières, voir par exemple Dreyfus, Bach and the Patterns of Invention, p. 219-245.
– 305 –
Chapitre 5
d’orgue français dans les compilations manuscrites aujourd’hui conservées à Berlin. C'est donc au nouveau rapport entre la musique française, les Lumières et la modernité que nous engagent à réfléchir ces controverses, qui signalent non seulement une recomposition profonde du paysage musical germanique entre 1730 et 1750, marquée par le déclin paradoxal de la galanterie et du goût pour la musique française au moment de l’essor du style galant – mais aussi, plus fondamentalement, l’émergence d’une conception radicalement nouvelle de la musique, traversée par les valeurs d’universalité et de cosmopolitisme, au sein de laquelle la question des styles nationaux n’a plus sa place.
– 306 –
Conclusion L’année 1733 comme terminus • Même si les dernières pages de ce livre se sont aventurées bien au-delà de l’année 1733, celle-ci marque indéniablement la fin de l’enquête et le terminus de l’ouvrage. La rupture majeure qui survient alors dans les transferts musicaux entre la France et l’espace germanique est symbolisée par la convergence spectaculaire de trois évènements musicaux très différents qui marquent chacun à leur manière la fin d’une époque musicale, tant sur le plan du patronage de musique française et des représentations associées au style français en Allemagne que du point de vue de l’identité même du théâtre musical français. En mars 1733, un mois après la mort d’Auguste le Fort, le nouveau prince électeur de Saxe et roi de Pologne renvoyait presque tous les musiciens français de la Hofkapelle de Dresde, mettant fin au dernier ensemble musical permanent de l’Empire où les Français étaient encore largement représentés. Au-delà de ses motivations immédiates, la portée de ce geste était considérable puisqu’elle signait l’arrêt de la présence vivante de musiciens français dans l’Empire. Le même mois, Christian Förster écrivait à Telemann pour lui confirmer qu’il avait payé sa souscription à la publication de la Musique de Table, dont la parution avait été annoncée par la presse hambourgeoise en novembre et décembre 1732 et qui allait sortir incessamment. Véritable précis de composition instrumentale précédé d’une impressionnante liste de plus de 200 souscripteurs qui témoignait de son ambition cosmopolite, cet ensemble de trois « productions » portait un regard distancié et rétrospectif sur l’ouverture et sa suite à la française en l’inscrivant dans un catalogue de genres instrumentaux très divers, la figeant de ce fait en objet de patrimoine et en cliché musical. Six mois plus tard enfin, les premières notes d’Hippolyte et Aricie résonnaient sous les voûtes de l’Académie royale de musique. Première tragédie en musique de Jean-Philippe Rameau, cette œuvre créée le 1er octobre 1733 renouvelait complètement les cadres de l’un des genres musicaux les plus éminents en France, mais provoquait aussi une crise d’identité profonde qui allait nourrir l’une des plus grandes querelles sur le destin de l’opéra français, sur la place du canon louis-quatorzien et sur l’héritage de Lully. Point de rupture décisif sur le plan musical à Dresde, à Hambourg et à Paris, l’année 1733 sonnait donc le glas d’une certaine musique française et de son destin allemand – tout en ouvrant un nouveau chapitre et conduisant l’opéra français sur des chemins inexplorés. Au-delà de la coïncidence produite par ce remarquable alignement des planètes, ces trois secousses sont aussi l’aboutissement d’un ensemble de phénomènes qui couraient de façon sousterraine depuis quelques années et avaient partie liée avec la crise profonde de l’idéal galant. En effet, c’est bien à une remise en question radicale des codes de la galanterie propres à la tragédie en musique que procédait l’œuvre de Rameau et Pellegrin, et c’est aussi comme cela que l’on peut comprendre sa nouveauté inouïe et les réactions démesurées qu’elle provoqua parmi le public parisien. En proposant sa propre version de Phèdre, qui fourmille d’allusions à la pièce de Racine tout en procédant à un profond remaniement de l’intrigue, Simon-Joseph Pellegrin touchait au cœur du canon tragique louis-quatorzien et à l’un des monstres sacrés de la littérature théâtrale française. À plus de soixante ans de distance, la Querelle des ramistes et des lullystes rejouait d’ailleurs dans une certaine mesure la Querelle des sonnets qui avait accueilli la création de Phèdre.
– 307 –
Conclusion
Signe de son audace, le librettiste s’attaquait même à l’unité de lieu, décalant le changement de décor à la 3e scène du cinquième acte au lieu de le faire coïncider avec l’entracte. Cette grave atteinte à l’un des fondements de l’esthétique classique, beaucoup commentée, était relevée sobrement par le Mercure de France dans le compte rendu de l’opéra paru juste après sa création, avant que ne soit expliquée la marche arrière effectuée toutes affaires cessantes par Pellegrin et Rameau : Au Ve Acte, le Théatre ne change qu’à la troisiéme Scene. […] On a retranché ces deux premieres Scenes qui produisoient quelque irrégularité contre l’unité de lieu, par le changement de Scene, dans le même Acte. L’Auteur avoit prévenu l’objection dans sa Préface ; mais le Public ne s’y étant pas prêté, il n’a pas balancé à le satisfaire.1
Pellegrin avait en effet prévenu les objections éventuelles dans la préface de son livret en citant l’exemple de Quinault, le « créateur du genre » qui avait donné de nombreux exemples d’irrégularités de ce type.2 Mais sans doute encore davantage que cette licence manifeste, que la difficulté de la partition ou le caractère savant de la composition musicale, plus encore que quelques innovations particulièrement spectaculaires de Rameau ou l’irrévérence de Pellegrin par rapport à Racine, le cœur du problème se situait visiblement autre part. On ne peut en effet qu’être intrigué par ce commentaire du Mercure de France sur une scène de l’Acte II : « Cette Scene est sans contredit la plus belle de la Tragédie, tant du côté du Poëte, que de celui du Musicien. » La scène singularisée ici n’était pas celle du légendaire Trio des Parques, resté dans la mémoire collective comme un des points culminants de l’opéra, logiquement situé à la fin du deuxième acte, à la fois sombre prémonition de la tragédie qui s’annonce et lieu de la principale innovation musicale de Rameau par l’utilisation du genre enharmonique. Ce n’était pas non plus l’un des grands airs de monologue de Thésée ou de Phèdre, ni l’une des scènes de déclaration amoureuse passionnée qui rythment l’opéra et situent celui-ci dans la lignée de la tradition galante propre à la tragédie en musique. En fait, cet éloge formulé en passant s’appliquait à la scène infernale où Thésée déclare sa passion pour son ancien compagnon d’armes Pirithoüs et supplie Pluton de pouvoir aller le rejoindre aux Enfers, juste avant le déchaînement de fureur aveugle qui caractérise toute la fin du deuxième acte jusqu’à l’intervention bienfaisante de Neptune : Pluton reproche à Thésée le coupable projet qu’il a formé avec Pirythoüs d’enlever Proserpine. Thésée se justifie autant qu’il lui est possible. Pluton le renvoie au Tribunal des trois Juges des Enfers. Cette Scene est sans contredit la plus belle de la Tragédie, tant du côté du Poëte, que de celui du Musicien. Pluton invite toutes les Divinitez infernales à le vanger [sic]. Thésée revient, suivi de la Furie vangeresse ; ne pouvant revoir son ami que par le secours de la mort. Il l’implore.3
Ce commentaire, qui souligne à juste titre l’extraordinaire intensité dramatique, morale et musicale du dialogue entre Thésée et Pluton – dialogue quasiment philosophique qui touche des questions aussi centrales que celles du bien et du mal, de la valeur de l’amitié, de la culpabilité et de la faute, du caractère transitif de la gloire et du désir de mourir – semble avoir été entre autres motivé par un bref mais superbe exemple d’hypotypose musicale : lorsque Thésée évoque ses combats passés avec son ami, il semble ressusciter Pirithoüs et soulever à nouveau sur la scène du théâtre la poussière des armes et les sonneries de trompette à travers un air de basse martial et viril accompagné par les violons (« Sous les drapeaux de Mars unis par la valeur, je l’ai vu sur mes pas voler à la victoire »). Le Mercure ne décernait d’ailleurs pas à la musique de Rameau ses épithètes habituels d’agréable, de charmante ou de touchante, mais la qualifiait au contraire de
1
2 3
Mercure de France, oct. 1733, p. 2246. Voir en particulier Graham Sadler, « Rameau, Pellegrin and the Opéra : The Revisions of “Hippolyte et Aricie” during Its First Season », The Musical Times, 124/1687, 1983, p. 533-537. Geoffrey Burgess, « “Le théâtre ne change qu’à la troisième scène”. The Hand of the Author and Unity of Place in Act V of “Hippolyte et Aricie” », Cambridge Opera Journal, 10/3, 1998, p. 275-287. Simon-Joseph Pellegrin, Hippolyte et Aricie, Paris 1733, p. v. Mercure de France, oct. 1733, p. 2239-2240. Sur cette scène, voir Lois Rosow, « Structure and Expression in the scènes of Rameau’s “Hippolyte et Aricie” », Cambridge Opera Journal, 10/3, 1998, p. 259-273.
– 308 –
L’année 1733 comme terminus
« Musique mâle et harmonieuse » et insistait sur « ce qu’elle a de sçavant pour l’expression ».4 On ne pouvait rêver de plus bel enterrement de la tradition galante, ni un aveu plus net du fait que l’opéra français empruntait à présent des chemins neufs et inexplorés. Il n’est donc pas étonnant de constater qu’à la différence de ses prédécesseurs, la musique de Rameau ne semble avoir été ni jouée ni copiée dans l’espace germanique. Ceci ne signifiait pas une disparition complète mais un autre mode de présence, plus subliminal, plus confidentiel et plus sous-terrain : le corpus théorique de Rameau conserva ainsi une influence profonde mais largement controversée dans le discours musical allemand jusqu’à la fin du xviiie siècle.5 Quant à ses compositions, elles circulaient parfois sous forme imprimée mais n’étaient connues que par un cercle assez restreint de spécialistes, ainsi qu’en témoigne notamment la correspondance entre Telemann et Graun en 1751-1752 à propos du récitatif français, où la place de Rameau est importante mais là encore ambiguë et critiquée.6 C’est aussi sur fond de cette métamorphose radicale que l’on peut finalement relire et mieux comprendre la célèbre péroraison de la Lettre sur la musique française publiée l’année suivante par Rousseau. En effet, ce n’est qu’en raison du profond changement de statut de la musique française entre 1733 et 1753 et d’une présence désormais très atténuée dans l’espace européen que le philosophe pouvait affirmer sans crainte d’être incompris : « D’où je conclus que les Français n’ont point de musique et n’en peuvent avoir, ou que si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux.7 »
4 5 6 7
Mercure de France, oct. 1733, p. 2249. Ludwig Holtmeier, Rameaus Langer Schatten. Studien zur deutschen Musiktheorie des 18. Jahrhunderts, Hildesheim 2017. Telemann, Briefwechsel, p. 264-306. Jean-Jacques Rousseau, Lettre sur la musique française, in : Œuvres complètes, vol. 5, p. 328.
– 309 –
Sigles utilisés •
AAE AD AN A-Wn BAHild BA Osnabrück BD I-III DA Bautzen D-B D-Dl D-DS D-F D-HAu D-Hs D-HVl D-ROu F-Pn F-V GB-Lbl GStA PK HHA HStA Dresden HStA Weimar LHA Schwerin MGG NBA NLAH NLAO NLAW
Archives du Ministères des Affaires Étrangères Archives départementales Archives Nationales Vienne, Oesterreichische Nationalbibliothek Bistumsarchiv Hildesheim Bistumsarchiv Osnabrück Bach Dokumente, vol. 1-3 Diözesanarchiv des Bistums Dresden-Meißen, Bautzen Berlin, Staatsbibliothek Dresde, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek Francfort, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Hambourg, Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky Hanovre, Niedersächsische Landesbibliothek Hannover Rostock, Universitätsbibliothek Paris, Bibliothèque nationale de France Versailles, Bibliothèque municipale Londres, British Library Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin Hallische Händel-Ausgabe Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar Landeshauptarchiv Schwerin Die Musik in Geschichte und Gegenwart Neue Bach-Ausgabe Niedersächsisches Landesarchiv Hannover Niedersächsisches Landesarchiv Osnabrück Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel
– 311 –
Sources imprimées •
Livrets imprimés Celle Balet | des amours de mars et | de venus | ou | le vulcan jaloux. | Cel le 9. Fevrier 1674 Prologue | & | argument | de la comedie | Du | cavalier duppé, | Entremêlée de chants & de danses, | Et | representée sur le Theâtre de Cell, | Devant leurs altesses serenissimes, | le [insertion manuscrite dans l’espace : 7] de Juin [corrigé en : juillet] m. dc. lxxxv. | [motif floral] | a celle, | [frise] | Chez andre holvvein. La Discorde Foudroyée | representee dans un | Ballet | Entremelé de Recits, Voix & Symphonies sur le | grand theatre de Zelle pour le Mariage de | Leurs Altesses Serenissimes Monseigneur le | Prince | george louis | & | Madame la Princesse | sophie dorothee | de Brounsvic & Lunebourg. | Le 23. Novembre l’an m dc lxxxii. Le | triomfe | germanique, | balet, | Dansé au Château de Cell, | Le 16. de Janvier m. dc. lxxxvii. | pour le glorieux succez | des armes de l’empire | contre les turcs: | Et à la memoire du Jour heureux | de la naissance de s.a.s. Monsgr. le duc. | a cell, | Par andre holw. 1688. Europe, | pastorale | heroique, | ornée | De Musique, de Dances, de Machines, | & de Changemens de Theâtre: | & | representée | Au Château de Cell, | Devant Leurs Altesses Serenissimes, | Le [espace blanc] de Janvier. m. dc. lxxxix. | Typ. Andreae Holwin. Dresde le | theatre | des | plaisirs | Presenté a la Majesté de | frideric auguste | Second, roy de Pologne & | Electeur de Saxe. | par | Le Sr. Ange de Constantini, Camerier | intime, Tresorier des menus plaisirs, & Garde de | bijoux de la Chambre du roy, | & | Representé en Presance de Sa Majesté | Le roy de Danemarck. | A Dresden ce [espace blanc] 1709. Les quatre Saisons, | Divertissement de Musique | & de Dance, | pour célébrer | le | mariage | De Son Altesse Royale | De Pologne & Electo- | rale de Saxe, | 1719. | Dresde | Chéz Jean Conrad Stössel, Imprimeur de la Cour. Mirtil, | Pastorale | en Musique, | Ornée de Ballets; | Représentée par les Pensionnaires dans | les Plaisirs du Roy. | A Dresden, Chez Jean Conrad Stössel, Imprimeur de la Cour. | m dcc xxi. Le | triomphe | de | l’amour, | divertissement | en musique | orné de Ballets | pour le carnaval | de l’année 1725. | A Dresde, par Jean Conrad Stösssel, Imprimeur de la Cour.
– 313 –
Sources imprimées
Güstrow Die Lust der Music | Ballett | Auff befehl des | Durchleuchtigsten Fürsten und | Herrn | Herrn Gustaff Adolphen/ | Herzogen zu Mecklenburg/ Für- | sten zu Wenden/ Schwerin und Ratzeburg/ | auch Graffen zu Schwerin/ der Lande Rostock | und Stargard Herrn. | In Gegenwart vieler | Fürstlichen Persohnen | Getantzet | in | Dero Residenz Güstrow | Den 1. Martii Anno 1671. | Güstrow/ | Gedruckt durch Christian Scheippeln. Anno 1671. Hambourg Acis | et | Galatee | pastorale heroique | en | musique. | acis und galatee | In einem | Sing=Spiel | vorgestellet. [1689] Achile & polixene | tragedie | en | musique. | Die unglückliche Liebe | Des | achilles | Und der | polixena, | In einem Sing=Spiel vorgestellet/ nach der | Frantzösischen Musik. | Anno 1692. Acis | Und | Galatée | In einem | Singe=Spiel/ | Auff | Dem Hamburgischen Theatro | vorgestellet. | Im Jahr 1695. Der Beschluß | des | carnevals | opera comique, | auf dem |Hamburgischen | Schau=Platze | vorgestellet/ | Im Monat Februarii Anno 1724. | [règle] | Gedruckt bey Caspar Jakhel/ auf dem Dom Kirchhofe Hanovre La chasse | de | Diane | Balet Champestre | Dansé | sous une grande feuillée | au grand jardin du leiné | en presence | de la reine | mere du roy | de dannemarc. | Pour le Divertissement | de Sa Majesté. | A Hannovre. | Imprimé par Wolfgang Schwendimann cyd. Impr. Duc. | m. dc. lxxxi. le charme | de | l’amour, | mascarade mise en balet | Dansé | sur le grand theatre d’hannover | par | madame | la princesse | en presence de leurs | altesses serenissimes | au retour | de | monseigneur le duc | son pere, | a qui elle donne de divertissement | de | carnaval. | [ornement] | Imprimé à Hannover par Wolfegnag Schwendimann. | m. dc. lxxxi. Prologue | en | rejoüissance | du mariage | de leurs | altesses serenissimes | Monseigneur le prince | george | louis | et | madame la princesse | sophie | dorothée | de la tres haute et tres | puisante [sic]maison de brunswic | lunebourg, &c. &c. | Par leur tres humble, tres obeissant & tres respectueux | Serviteur | de chasteauneuf. | Imprimé à Hannover par Wolfgang Schwendimann [1682]. Prologue | Meslé de recits, de Machines, de Musique, & de Ballets, | en | réjoüissance | de l’heureux mariage | de leurs altesses serenissimes | monseigneur | le prince | electoral | de brandebourg | et | madame la princesse | sophie | charlotte | duchesse | de brunswic et lunebourg. | Par | Leur tres humble, tres-obeissant & tres-respectueux | Serviteur | De Chateauneuf. | Imprimé à Hannover par Wolfgang Schwendimann | Imprimeur Ducal. L’An 1684. Prologue | Sur lh’eureuse [sic]Naissance | du jeune prince frederic auguste | fils | de leurs altesses serenissimes | monseigneur | le prince | electoral | de brandebourg | et | madame la princesse | sophie | charlotte | duchesse | de brunswic et lunebourg. | Par | leur tres humble & tres Repectueux | Serviteur | de Châteauneuf. | Imprimé à Hannover par Georg Friderich Grimm, Imprimeur Ducal. L’An 1685.
– 314 –
Sources imprimées
Le Triomphe de la Paix | Balet | Dancè sur le grand theatre de Hannover le | 1685. En rejouissence | de l’heureuse naissance | du jeune prince | frederic | auguste | fils | de leurs altesses serenissimes | monseigneur | le prince | electoral | de Brandebourg | et | madame la princesse | sophie | charlotte | duchesse | de brunsvic et lunebourg. | Imprimé à Hannover par Georg Friedrich Grimm, Imprimeur | Ducal. L’An 1685. Hildburghausen Char=Freytags=Musique, | Welche | zu seliger Betrachtung der Erlösung | Jesu Christi, | So für unsere Sünde geschehen ist, | Von dem berühmten Mons. de Lully, | Ober-Capellmeister | Jhro Königl. Maj. in Franckreich [et]c. [et]c. | componiret. | Alleine auf gnädigsten und hohen Befehl | Des | Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, | Herrn | Ernst Friedrichs, II. | Hertzogen zu Sachsen, | Jülich, Cleve und Berg auch Engern und Westphalen, [et]c. | Jn Hoch-Fürstl. Schloß=Capelle | nicht sonder viele Erweckung deren Seelen aufgeführet, | und ausgetheilet worden | den 15. April. 1740. | [règle] | Hildburghausen, | Drucks Johann Melchior Pentzold, Fürstl. Hof=Buchdrucker. Wolfenbüttel Proser- | pine | tragedie. | Representée | à | Wolffenbuttel | m dc lxxxv. | A Wolffenbuttel, | Imprimé par caspar jean Bismarck. Proserpine [synopsis en allemand qui correspond au livret ci-dessus] Psyché | tragedie | representée | au Theatre Ducal de Wolfenbuttel | au mois d’Aoust l’année | m dc lxxxvi. | La musique est composée par Mons. Jean | Baptiste de Lully, | les Ballets par Mons. Nanquer Maistre de Dance | de la Cour. | Imprimé à Wolffenbuttel, | par Caspar Jean Bismarck. Thesee | tragedie | En Musique | representée | au Theatre Ducal de | Wolffenbuttel | au mois d’Aoust | m. dc. lxxxvii. | Wolffenbuttel | Imprimé chez Caspar Jean Bismarck. Thesée. | In einer Frantzösischen Opera und | angefügten | Balletten. | Denen | Anwesenden Hohen Zusehern | zu Ehren. | Auf dem Fürstl. Wolffenbüttelschen Theatro | gepraesentiret. | Im Augusto des 1687. Jahrs. | Wolffenbüttel/ | Gedruckt bey Caspar Johann Bißmarck.
Autres imprimés Kurtzer Bericht von der Heyrath und Beylager/ | Des Durchleuchtigsten Hochgebornen Fürsten und Herrn/ Herrn Christia- | ni II. Hertzogen zu Sachsen/ des Heiligen Römischen Reiches Ertzmarshall/ und Chur- | fürsten/ Landgraffen in Düringen/ Marggraffen zu Meissen/ und Burggraffen zu | Magdeburg/ so den 12. Septembris dieses Jahrs zu | Dreßden gehalten worden. Adress- | Calender, | Der Hoch=Fürstl. Braunschw. | Lüneb. Haupt= und Residentz= Städte, | Wolfenb. udn Braunschw. | und daselbst befindliche | Fürstlichen Hofes, | Auch anderer hohen und Nie= | dern Collegien, Instantien, und Expeditionen | Auf das Jahr Christi | m dcc xxi | Mit Hochfürstl. Approbation, | auch darüber gnädigst=ertheilter | privilegium | nicht nachzudrucken. | Verlegt, herausgegeben und zu finden, | bey | Jacob Wilhelm Heckenhauer, | Herzogl. Kunst und Kupfferstechen in Wolfenb. | [ligne] | Braunschweig, gedruckt bey Arnold Jacob Keilteln.
– 315 –
Sources imprimées
Das | Jetzt lebende | Königliche | Dreßden | In | Meissen | vorstellende | Den im Jahr 1729. | befindlichen | und | Darinnen sich würcklich aushaltenden | Resp | Königlichen und Churfürstlichen Sächßischen | Hof=Regierungs, Militair, Hauß= Kirchen= und | Privat-Etaat. | [gravure] | Anno 1729.
– 316 –
Bibliographie •
Abadie, Lisandro. « Anne de La Barre (1628-1688). Biographie d’une chanteuse de cour », Revue de Musicologie, 94/1, 2008, p. 5-44. Abbetmeyer, Theodor. Zur Geschichte der Musik am Hofe in Hannover vor Agostino Steffani 16361689. Ein Bild künstlerischer Kultur im 17. Jahrhundert, Göttingen : Homann, 1931. Aelbrouck, Jean-Philippe van. Dictionnaire des danseurs à Bruxelles de 1600 à 1830, Liège : Mardaga, 1994. Ahrendt, Rebekah. A Second Refuge. French Opera and the Huguenot Migration c.1680-c.1710, PhD Dissertation, University of California Berkeley, 2011. ––––– « Armide, the Huguenots, and The Hague », The Opera Quarterly, 28/3-4, 2012, p. 131-158. Albertyn, Erik. « The Hanover orchestral repertory, 1672-1714 : significant source discoveries », Early Music, 33/3, 2005, p. 449-471. Anonyme. Voyages faits en divers temps en Espagne, en Portugal, en Allemagne, en France, et ailleurs, Amsterdam : Georges Gallet, 1699. Ashbee, Andrew, David Lasoki, Peter Holman et Fiona Kisby. A Biographical Dictionary of English Court Musicians 1485-1714, Aldershot : Ashgate, 1998. Atcherson, Walter. « Key and Mode in Seventeenth-Century Music Theory Books », Journal of Music Theory, 17/2, 1973, p. 204-232. Aubert de la Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. Dictionnaire de la noblesse : contenant les généalogies, l’histoire et la chronologie des familles nobles de France, Paris : Boudet, 1770-1778. Babel, Rainer et Werner Paravicini (dir). Grand Tour. Adeliges Reisen und Europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2005. Bach, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art, Clavier zu spielen, vol. 1, Berlin : Winter, 1753. ––––– Versuch über die wahre Art, Clavier zu spielen, vol. 2, Berlin : Winter, 1762. Bach-Dokumente II. Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs 1685-1750, éd. Werner Neumann et Hans-Joachim Schulze, Kassel : Bärenreiter, 1969. Bach-Dokumente III. Dokumente zum Nachwirken Johann Sebastian Bachs 1750-1800, éd. HansJoachim Schulze, Kassel : Bärenreiter, 1972. de Bacilly, Bénigne. L’Art de bien chanter, Paris : auteur, 1679. Bade, Klaus J. (dir). The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe from the 17th Century to the Present, Cambridge : Cambridge University Press, 2011. Bahl, Peter. « Die Berlin-Postdamer Hofgesellschaft unter dem Großen Kurfürsten und König Friedrich I. Mit einem prosopographischen Anhang für die Jahre 1688-1713 », in : Im Schatten der Krone. Die Mark Brandenburg um 1700, dir. Frank Göse, Postdam : Verlag für Berlin-Brandenburg, 2002, p. 31-98. Balston, John N. The Elder James Whatman : England’s Greatest Paper Maker (1702-1759). A Study of Eighteenth-Century Papermaking Technology and its Effect on a Critical Phase in the History of English White Paper Manufacture, West Farleigh : Balston, 1992.
– 317 –
Bibliographie
Ball, Gabriele. « Das Netzwerk der Herzogin Sophia Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel », Schütz-Jahrbuch, 34, 2012, p. 29-48. Bardet, Bernard. Les violons de la musique de la chambre du roi sous Louis XIV, Paris : Société française de musicologie, 2016. Bauer, Volker. Die höfische Gesellschaft in Deutschland von der Mitte des 17. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts. Versuch einer Typologie, Tübingen : Max Niemeyer, 1993. Beaucaire, Charles-Prosper-Mérimée Horric de. Une mésalliance dans la maison de Brunswick (1665-1725). Éléonore Desmier d’Olbreuze duchesse de Zell, Paris : Oudin, 1884. Beaurepaire, Pierre-Yves. Le Mythe de l’Europe française au siècle. Diplomatie, culture et sociabilités au temps des Lumières, Paris : Éditions Autrement, 2007. Beaurepaire, Pierre-Yves, Philippe Bourdin et Charlotta Wolff (dir). Moving scenes. The Circulation of Music and Theatre in Europe, 1700-1815, Oxford : Oxford University Press, 2018. Beer, Johann. Musikalische Diskurse, Nuremberg : Conrad Monath 1719. Behr, Samuel Rudolph. Maître de Danse. Anleitung zu einer wohlgegründeten Tantz=Kunst, Leipzig : Heydler, 1703. Beißwenger, Kirsten. Johann Sebastian Bachs Notenbibliothek, Kassel : Bärenreiter, 1992. Bély, Lucien. Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris : Fayard, 1990. Bender, Eva. Die Prinzenreise. Bildungsaufenthalt und Kavalierstour im höfischen Kontext gegen Ende des 17. Jahrhunderts, Berlin : Lukas Verlag, 2011. Benoît, Marcelle. Les Évènements musicaux sous le règne de Louis XIV : Chronologie, Paris : Picard, 2004. ––––– Versailles et les musiciens du roi 1661-1733. Étude institutionnelle et sociale, Paris : Picard, 1971. ––––– Musiques de Cour. Chapelle, Chambre, Écurie 1661-1733, Paris : Picard, 1971. Berend, Fritz. Nicolaus Adam Strungk (1640-1700). Sein Leben und seine Werke mit Beiträgen zur Geschichte der Musik und des Theaters in Celle, Hannover, Leipzig, Hanovre : Emil Homann, 1913. Betzwieser, Thomas. « Le parcours germanique de l’œuvre lyrique d’Henry Desmarest », in : Henry Desmarest, 1661-1741. Exils d’un musicien dans l’Europe du Grand siècle, dir. Jean Duron et Yves Ferraton, Sprimont : Mardaga, 2005, p. 309-320. Beuleke, Wilhelm. Die Hugenotten in Niedersachsen, Hildesheim : Lax, 1960. Biermann, Joanna Cobb. « Die Darmstädter Hofkapelle unter Christoph Graupner 1709-1760 », in : Christoph Graupner. Hofkapellmeister in Darmstadt 1709-1760, dir. Oswald Bill, Mayence : Schott, 1987, p. 27-72. Bisaro, Xavier, Gisèle Clément et Fañch Thoraval (dir). La circulation de la musique et des musiciens d’église, France xvie-xviiie siècle, Paris : Garnier, 2017. Blechschmidt, Eva Renate. Die Amalien-Bibliothek : Musikbibliothek der Prinzessin Anna Amalia von Preußen (1723-1787). Historische Einordnung und Katalog mit Hinweisen auf die Schreiber der Handschriften, Berlin : Merseburger, 1965. Bloch, Marc. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris : Armand Colin, 1952. Bodemann, Eduard. Aus den Briefen an die Kurfürstin Sophie von Hannover, Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1891. ––––– Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder, dem Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz, und des Letzteren mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna, Leipzig : Hirtel, 1885. –––––– Die Handschriften der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Hannover, Hannover : Hahnsche Hof-Buchhandlung, 1867. Boeck, Urs. « Gartenkunst in Niedersachsen vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts », in : Historische Gärten in Niedersachsen. Katalog der Landesaustellung, Langenhagen : Popp-Druck, 2000, p. 15-29. Bourligueux, Guy. « Le mystérieux Daniel Daniélis (1635-1696) », Recherches sur la musique française classique, 4, 1964, p. 146-178.
– 318 –
Bibliographie
Böger, Richard. Die Geschichte der Familie de Châteauneuf-Vezin, sans lieu ni date. Böning, Holger. Der Musiker und Komponist Johann Mattheson als Hamburger Publizist. Studie zu den Anfängen der Moralischen Wochenschriften und der deutschen Musikpublizistik, Brême : Edition Lumière, 2011. Bösken, Franz. Musikgeschichte der Stadt Osnabrück. Die geistliche und weltliche Musik bis zum Beginne des 19. Jahrhunderts, Ratisbonne : Friedrich Pustet, 1937. Braun, Guido. Von der politischen zur kulturellen Hegemonie Frankreichs 1648-1789, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008. Braun, Werner. Vom Remter zum Gänsemarkt. Aus der Frühgeschichte der alten Gänsemarkt-Oper (1677-1697), Saarbrücken : Saarbrücken Druckerei und Verlag, 1987. Bredekamp, Horst. Leibniz und die Revolution der Gartenkunst. Herrenhausen, Versailles und die Philosophie der Blätter, Berlin : Verlag Klaus Wagenbach, 2012. Breig, Werner. « Bach und Marchand in Dresden : eine überlieferungskritische Studie », Bach Jahrbuch, 84, 1998, p. 7-18. Brenet, Michel [Marie Bobillier]. La Musique militaire, Paris : Henri Laurens, 1917. Brétéché, Marion. Les Compagnons de Mercure. Journalisme et politique dans l’Europe de Louis XIV, Ceyzérieu : Champ Vallon, 2015. Brover-Lubovsky, Bella. « ‘Die Schwarze Gredel’, or the Parallel Minor Key in Vivaldi’s Instrumental Music », Studi Vivaldiani, 3, 2003, p. 105-131. ––––– Tonal Space in the Music of Antonio Vivaldi, Bloomington : Indiana University Press, 2008, p. 91-121. Brusniak, Friedhelm. « ‘Von Besuchung der publiquen und privat-Bibliothequen’. Die Empfehlungen des Fürstlich Waldeckischen Hofmeisters Joachim Christoph Nemeitz (1679-1753) an ‘Reisende von Condition’. Ein Beitrag aus musiksoziologischer Perspective », in : Frühneuzeitliche Bibliotheken als Zentren des europäischen Kulturtransfers, dir. Claudia Brinker von der Heyde, Stuttgart : Hirzel, 2014, p. 105-112. Brunet, Pierre. Correspondance complète de Madame Duchesse d’Orléans née Princesse Palatine, vol. 1, Paris : Charpentier, 1855. Bucciarelli, Melania, Norbert Dubowy et Reinhard Strohm (dir). Italian Opera in Central Europe 1614-1780, vol. 1 : Institutions and Ceremonies, Berlin : Berliner Wissenschaftsverlag, 2006. Burgess, Geoffrey. « ‘Le théâtre ne change qu’à la troisième scène’. The Hand of the Author and Unity of Place in Act V of ‘Hippolyte et Aricie’ », Cambridge Opera Journal, 10/3, 1998, p. 275-287. Burney, Charles. A General History of Music, from the Earliest Ages to the Present Period, vol. 4, Londres : auteur, 1789. Buttstett, Johann Heinrich. Ut, Mi, Sol, Re, Fa, La. Tota Musica et Harmonia Æterna, Leipzig : Kloß, [c.1716]. Butzmann, Hans. Die Blankenburger Handschriften, Francfort : Klostermann, 1966. Büchel, Daniel, Arne Karsten et Philipp Zitzlsperger. « Mit Kunst aus der Krise? Pierre Legros’ Grabmal für Papst Gregor XV. Ludovisi in der römischen Kirche S. Ignazio », Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 29, 2002, p. 165-197. Campardon, Émile. Les Comédiens du roi de la troupe italienne pendant les deux derniers siècles, Paris : Berger-Levrault, 1880. Candaux, Jean Daniel. « Un anonyme identifié. Les souvenirs de voyage de Denis Nolhac, réfugié, marchand et manufacturier huguenot », Revue française d’histoire du livre, 53/45, 1984, p. 691-711. Carlson, Marvin. « Scandinavia’s International Baroque Theatre », Educational Theatre Journal, 28/1, 1976, p. 5-34. Cessac, Catherine. Marc-Antoine Charpentier, Paris : Fayard, 1988. ––––– L’œuvre de Daniel Daniélis (1635-1696). Catalogue thématique, Paris : CNRS, 2003.
– 319 –
Bibliographie
Chapin, Keith. « Scheibe’s Mistake : Sublime Simplicity and the Criteria of Classicism », Eighteenth-Century Music, 5/2, 2008, p. 165-177. ––––– « Counterpoint : From the Bees or For the Birds ? Telemann and Early EighteenthCentury Quarrels with Tradition », Music & Letters, 92/3, 2011, p. 377-409. Chappuzeau, Samuel. L’Europe vivante, ou relation nouvelle, historique & politique de tous ses Etats jusqu’à l’année présente, Genève : Jean Herman Widerhold, 1667. ––––– Jetztlebendendes Europas, Francfort : Johann Georg Schiele, 1670. ––––– Jetztlebenden Europae anderer Theil, Francfort : Johann Georg Schiele, 1670. ––––– Suite de l’Europe vivante contenant la relation d’un voyage fait en Allemagne, Genève : Jean Herman Widerhold, 1671. ––––– L’Allemagne protestante, ou Relation nouvelle d’un Voyage fait aux Cours des Électeurs, et des Princes protestants de l’Empire, aux mois d’Avril, May, Juin, Juillet & Aoust de l’année M. DC. LXIX, Genève : Jean Herman Widerhold, 1671. ––––– Le Théâtre françois, Lyon : Michel Mayer, 1674. ––––– Le Théâtre françois, éd. Christopher J. Gossip, Tübingen : Narr, 2009. Charles-Dominique, Luc. Les « bandes » de violons en Europe. Cinq siècles de transferts culturels des anciens ménétriers aux Tsiganes d’Europe centrale, Turnhout : Brepols, 2018. Chartier, Roger. Écouter les morts avec les yeux, Paris : Fayard/Collège de France, 2008. Christensen, Thomas. Rameau and Musical Thought in the Enlightenment, Cambridge : Cambridge University Press, 1993. Chrysander, Friedrich. « Englische, französische und deutsche Musicanten im siebenzehnten Jahrhundert am Hofe des Herzogs zu Mecklenburg-Güstrow », Niederrheinische MusikZeitung, 3/46, 1855, p. 364-367. ––––– Georg Friedrich Händel, vol. 1, Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1858. Chung, David. Keyboard Arrangements of Music by Jean-Baptiste Lully, Monuments of Seventeenthcentury Music 1, Web Library of Seventeenth-Century Music, 2015. Cicéron. La République, éd. Esther Bréguet, vol. 2, Paris : Les Belles Lettres, 1980. Clément, N. Relation du voiage de Breme, en vers burlesques dediee à Monsieur Besson, chef de la Troupe de Musiciens, et de Violons de sa Majesté le roi de Danemarc, de Norvegue, &c, Leiden : Veuve de Daniel Boxe, 1676. Clément, Daniel Louis. Notice sur l’église réformée française de Copenhague, Copenhague, Paris et Strasbourg : Hagerit et Berger-Levrault & fils, 1870. Coffey, Helen. « Opera for the House of Brunswick-Lüneburg : Italian Singers at the Hanover Court », in : Agostino Steffani. Europäischer Komponist, hannoverscher Diplomat und Bischof der Leibniz-Zeit, dir. Claudia Kaufold, Nicole K. Strohmann et Colin Timms, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, p. 107-122. Cohen, Gidon. « Missing, Biased, and Unrepresentative. The Quantitative Analysis of Multisource Biographical Data », Historical Methods, 35/4, 2002, p. 166-176. Conrads, Norbert. Ritterakademien der frühen Neuzeit : Bildung als Standesprivileg im 16. und 17. Jahrhundert, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1982. Cornaz, Marie. Les Ducs d’Arenberg et la musique au xviiie siècle. Histoire d’une collection musicale, Turnhout : Brepols, 2010. Cosandey, Fanny et Robert Descimon. L’Absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris : Éditions du Seuil, 2002. Cowart, Georgia. Controversies over French and Italian Music, 1600-1750. The Origins of Modern Musical Criticism, PhD Dissertation, University of New Jersey, 1980. Crelier, Damien. « Saint Simon et le “goût italien” : l’homosexualité dans les Mémoires », Cahiers Saint-Simon, 42, 2014, p. 47-60. Dahuron, René. Traité de la taille des arbres, et de la manière de les bien élever, Celle : Holwein, 1692.
– 320 –
Bibliographie
Delang, Kerstin. « Betrachtungen zu einigen Werken französischer Komponisten in Abschriften von Johann Georg Pisendel », in : Johann Georg Pisendel. Studien zu Leben und Werk. Bericht über das Internationale Symposium vom 23. bis 25. Mai 2005 in Dresden, dir. Ortrun Landmann et Hans Günter Ottenberg, Hildesheim : Olms, 2010, p. 77-102. ––––– « Couperin - Pisendel - Bach. Überlegungen zur Echtheit und Datierung des Trios BWV 587 anhand eines Quellenfundes in der Sächsischen Landesbibliothek Staatsund Universitätsbibliothek Dresden », Bach Jahrbuch, 93, 2007, p. 197-204. Delpech, Louis. « Les musiciens français en Allemagne du nord (1660-1730). Questions de méthode », Diasporas. Circulations, migrations, histoire, 26, 2015, p. 57-73. ––––– « “Einige Gute Französische Organisten”. The Dissemination of French Organ Music in 18-Century Germany », The Organ Yearbook, 44, 2015, p. 33-46. ––––– « Les Motets pour la chapelle du roy à la cour de Saxe. Contours et enjeux d’un transfert musical (1697-1721) », in : La circulation de la musique et des musiciens d’église, France, xviexviiie siècles, dir. Xavier Bisaro, Gisèle Clément et Fañch Thoraval, Paris : Garnier, 2017, p. 147-166. ––––– « Zwischen Galanterie und Frühaufklärung. Telemann und die Rezeption französischer Opern in Hamburg um 1725 », in : Telemann und die urbanen Milieus der Aufklärung, dir. Louis Delpech et Inga Mai Groote, Munich : edition text+kritik (Musik-Konzepte Sonderband, éd. Ulrich Tadday), 2017, p. 53-74. ––––– « Gottfried Taubert und die Rezeption französischer Musik in Dresden um 1717 », in: Tauberts « Rechtschaffener Tantzmeister » (Leipzig 1717). Kontexte – Lektüren – Praktiken, dir. Hanna Walsdorf, Marie-Thérèse Mourey et Tilden Russel, Berlin : Frank & Timme, 2019, p. 75-99. ––––– « “Nach seinem eigenen plesier und gefallen”. Die Caprice im deutsch-französischen Tanz- und Musikdiskurs um 1700 », Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft, 34/2, 2019, p. 141-162. ––––– « ‘Abends zu einem Concert de musique eingeladen.’ Aspects musicaux du séjour parisien de Friedrich August II de Saxe (1714-1715) », in : Les foyers artistiques à la fin du règne de Louis XIV (1682-1715). Musique et spectacles, dir. Anne-Madeleine Goulet, Rémy Campos, Mathieu Da Vinha et Jean Duron, Turnhout : Brepols, 2019, p. 277-295. ––––– « Der Wechsel in die Varianttonart als Mekmal des französischen Stils um 1700. Lully, Couperin, Bach, Händel », in : Dur versus Moll. Zur Geschichte der Semantik eines musikalischen Elementarkontrasts, dir. Hans Joachim Hinrichsen et Stefan Keym, Cologne : Böhlau, 2020, p. 131-153. Delpu, Pierre-Marie. « La prosopographie, une ressource pour l’histoire sociale », Hypothèses, 18/1, 2015, p. 263-274. Dirksen, Pieter. « The Background to Bach’s Fifth Brandenburg Concerto », in : The Harpsichord and Its Repertoire : Proceedings of the International Harpsichord Symposium Utrecht 1990, dir. Pieter Dirksen, Utrecht : Stimu, 1992, p. 157-185. Dompnier, Bernard, Sylvie Granger et Isabelle Langlois. « Deux mille musiciens et musiciennes d’Église en 1790 », in : Histoires individuelles, histoires collectives. Sources et approches nouvelles, dir. Christiane Demeulenaere-Douyère et Armelle Le Goff, Paris : Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2012, p. 221-236. Dosquet, Émilie. « ‘Tout est permis dans la Guerre, mais tout ce qui est permis ne se doit pas faire’ : la ‘désolation du Palatinat’ à l’épreuve du droit de la guerre », in : Les dernières guerres de Louis XIV, 1688-1715, dir. Hervé Drévillon, Bertrand Fonck et Jean-Philippe Cénat, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 229-252. Dreyfus, Laurence. Bach and the Patterns of Invention, Cambridge MA : Harvard University Press, 1996. Dubowy, Norbert. « Italienische Instrumentalisten in Deutschen Hofkapellen », in : The Eighteenth-Century Diaspora of Italian Music and Musicians, dir. Reinhard Strohm, Turnhout : Brepols, 2001, p. 61-120.
– 321 –
Bibliographie
Dubowy, Norbert, Corinna Herr et Alina Żórawska-Witkowska (dir). Italian Opera in Central Europe 1614-1780, vol. 3 : Opera Subjects and European Relationships, Berlin : Berliner Wissenschaftsverlag, 2007. Dufourcq, Norbert. « Pour une approche biographique de Louis Marchand (1669-1732) », Recherches sur la musique française classique, 17, 1977, p. 94-117. ––––– Nicolas Lebègue (1631-1702). Étude biographique suivie de nouveaux documents inédits relatifs à l’orgue français au xviie siècle, Paris : Picard, 1954. Duhamelle, Christophe. « Das Alte Reich im toten Winkel der französischen Historiographie », in : Imperium Romanum – irregulare corpus – Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie, dir. Matthias Schnettger, Mayence : Philippe von Zabern, 2002, p. 207-219. Duindam, Jeroen. Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550-1780, Cambridge : Cambridge University Press, 2003. Duron, Jean. « Le Bel édifice : l’architecture des tonalités », in : Vénus & Adonis (1697), tragédie en musique de Henry Desmarest. Livret, étude et commentaire, éd. Jean Duron et Yves Ferraton, Sprimont : Mardaga, 2006, p. 151-156. Duron, Jean et Florence Gétreau (dir.). L’orchestre à cordes sous Louis XIV. Instruments, répertoires, singularités, Paris : Vrin, 2015. Dürr, Alfred. « Zur Chronologie der Handschrift Johann Christoph Altnickols und Johann Friedrich Agricolas », Bach Jahrbuch, 56, 1970, p. 44-65. Edler, Florian. « Der Dur-Moll-Kontrast in der italienischen Triosonate », Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie, 3, 2006, p. 307-326. Edwards, Edward. Free-Town Libraries. Their formation, managment and history, Cambridge : Cambridge University Press, 2010. Espagne, Michel. Le Creuset allemand. Histoire interculturelle de la Saxe, xviiie-xixe siècles, Paris : Presses Universitaires de France, 2000. Espagne, Michel et Michael Werner. « La construction d’une référence culturelle allemande en France : genèse et histoire (1750-1914) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 42/4, 1987, p. 969-992. Favier, Thierry. Le Motet à grand chœur. Gloria in Gallia Deo, Paris : Fayard, 2009. ––––– « Aufgeklärte Netzwerke ? Telemann und seine französische Liebhaber », in : Telemann und die urbanen Milieus der Aufklärung, dir. Louis Delpech et Inga Mai Groote, Munich : edition text + kritik (Musik-Konzepte Sonderband, éd. Ulrich Tadday), 2017, p. 110-169. Fechner, Manfred. « Bemerkungen zu einigen Dresden Vivaldi-Manuskripten : Frage der Vivaldi-Pflege unter Pisendel, zur Datierung und Schreiberproblematik », in : Nuovi studi vivaldiani, dir. Antonio Fanna et Giovanni Morelli, Florence : Olschki, 1988. Federhofer, Hellmut. « Zur handschriftlichen Überlieferung der Musiktheorie in Österreich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts », Die Musikforschung, 11/3, 1958, p. 264-279. Ferret, Olivier. « D’une politique de Voltaire à une pensée du politique », in : Les Lumières radicales et le politique. Études critiques sur les travaux de Jonathan Israel, dir. Marta Garcià-Alonso, Paris : Honoré Champion, 2017, p. 195-228. Finscher, Ludwig, Laurenz Lütteken et Inga Mai Groote (éd.). Die Triosonate. Catalogue Raisonné der gedruckten Quellen, vol. 2, Munich : Henle, 2016. Fischer, Georg. Musik in Hannover, Hanovre : Hahnsche Buchhandlung, 1903. Flemming, Hans Friedrich. Der vollkommene Teutsche Soldat welcher die gantze Kriegs-Wissenschafft, insonderheit was bey der Infanterie vorkommt, vorträgt, Leipzig : Johann Christian Martini, 1726. Flick, Andreas. « ‘Der Celler Hof ist ganz verfranzt.’ Hugenotten und französische Katholiken am Hof und beim Militär Herzog Georg Wilhelms von Braunschweig-Lüneburg », Hugenotten, 72/3, 2008, p. 87-120.
– 322 –
Bibliographie
–––––
« ‘Der Celler Hof, so sagt man, ist ganz französisch, […], man sieht dort fast keinen Deutschen mehr.’ Hugenotten am Hof und beim Militär Herzog Georg Wilhelms von Braunschweig-Lüneburg », Celler Chronik, 12, 2005, p. 65-98. Fock, Gustav. Der junge Bach in Lüneburg 1700 bis 1702, Hamburg : Merseburger, 1950. Fogelberg, Stefano. The Queen Danced Alone. Court Ballet in Sweden during the Reign of Queen Christina (1638-1654), Turnhout : Brepols, 2018. Fogelberg, Stefano et Maria Schildt. « L’Amour constant et Le Ballet de Stockholm. Livret et musique pour la représentation d’un ballet de cour durant le règne de la reine Christine », Dixseptième siècle, 261/4, 2013, p. 723-751. Forwerk, Friedrich August. Geschichte und Beschreibung der königlichen katholischen Hof- und Pfarrkirche zu Dresden, Dresde : Jaussen, 1851. Franchin, Matthieu. « Les entractes musicaux de l’École des femmes : méthodologie pour une restitution archéologique », Arrêt sur scène / Scene Focus, 5, 2017, p. 112-142 Frandsen, Mary E. « Allies in the Cause of Italian Music : Schütz, Prince Johann Georg II and Musical Politics in Dresden », Journal of the Royal Musical Association, 125/1, 2000, p. 1-40. ––––– Crossing Confessional Boundaries. The Patronage of Italian Sacred Music in SeventeenthCentury Dresden, Oxford : Oxford University Press, 2006. Fransen, Jan. Les Comédiens français en Hollande aux xviie et xviiie siècles, Paris : Honoré Champion, 1925. Friedrich II. « Réfutation du prince de Machiavel », in : Œuvres de Frédéric le Grand, éd. Johann Preuss, vol. 8, Berlin : Imprimerie Royale Decker, 1848. Friese, Friedrich. Ceremoniel und Privilegia derer Trompeter und Paucker, sans lieu [c.1720]. Frostin, Charles. Les Ponchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseaux d’influence sous l’Ancien Régime, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2006. Fuchs, Max. Lexique des troupes de comédiens au xviiie siècle, Genève : Droz, 1944. Fumaroli, Marc. Quand l’Europe parlait français. Paris : Fallois, 2001. ––––– La Querelle des Anciens et des Modernes, Paris : Gallimard, 2001. Funk-Kunath, Kristina. « Spurensuche – Ein unbekanntes Porträt von Pierre Gabriel Buffardin », Bach-Jahrbuch, 104, 2018, p. 225-234. Fürstenau, Moritz. Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden, vol. 1, Dresde : Rudolf Kuntze, 1861. ––––– Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe der Churfürsten von Sachsen und Könige von Polen, vol. 2, Dresde : Rudolf Kuntze, 1862. Fux, Johann Joseph. Gradus ad Parnassums oder Anführung zur Regelmäßigen Musickalischen Composition, trad. Lorenz Mitzlern, Leipzig : Mizler, 1742. Galliard, Johann Ernst. A Comparison Between the French and Italian Musick and Opera’s. Translated from the French : To which is added A Critical Discourse upon Opera’s in England, and a Means proposed for their Improvement, Londres : John Morphew, 1709. Gauthier, Laure. L’Opéra à Hamburg 1648-1728 : naissance d’un genre, essor d’une ville, Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2010. Geay, Gérard. « Le style des vingt-quatre violons et les premières compositions du jeune Lully », in : La naissance du style français (1650-1673), dir. Jean Duron, Wavre : Mardaga, 2008, p. 115-134. Geck, Karl Wilhelm. Sophie Elisabeth Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg (1613-1676) als Musikerin, Saarbrücken : Saarbrücker Druckerei und Verlag, 1992. Glozier, Matthew et David Onnekink (dir). War, Religion and Service. Huguenot Soldiering 16851713, Aldershot : Ashgate, 2007. Goethe, Johann Wolfgang von et Carl Friedrich Zelter. Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1799 bis 1832, éd. Edith Zehm et Sabine Schäfer, vol. 1, Munich : Hanser, 1998. Goff, Moira. « Desnoyers, Charmer of the Georgian Age », Historical Dance Volume, 4/2, 2012, p. 3-10.
– 323 –
Bibliographie
Goulet, Anne-Madeleine. Poésie, musique et sociabilité au xviie siècle. Les Livres d’airs de différents auteurs publiés chez Ballard de 1658 à 1694, Paris : Honoré Champion, 2004. ––––– « Les variations de la fête », in : Regards sur la musique au temps de Louis XIV, dir. Jean Duron, Wavre : Mardaga, 2007, p. 91-112. Goulet, Anne-Madeleine et Gesa zur Nieden (dir). Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (1650-1750). Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples (1650-1750), Kassel : Bärenreiter, 2015. Göhler, Albert. Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger Messkatalogen der Jahre 1564 bis 1759 angezeigten Musikalien, Leipzig : Kahnt Nachfolger, 1902. Guillo, Laurent. « Les Ballard : imprimeurs du roi pour la musique ou imprimeurs de la musique du roi ? » in : Le Prince et la musique. Les Passions musicales de Louis XIV, dir. Jean Duron, Wavre : Mardaga, 2009, p. 275-288. ––––– Pierre I Ballard et Robert III Ballard, imprimeurs du roi pour la musique (1599-1673), Sprimont : Mardaga, 2003. ––––– « Les papiers à musique imprimés en France au siècle. Un nouveau critère d’analyse des manuscrits musicaux », Revue de Musicologie, 87/2, 2001, p. 307-369. Gustafson, Bruce. French Harpsichord Music of the 17th Century. A Thematic Catalog of the Sources with Commentary, Ann Arbor : UMI Research Press, 1977. ––––– « The legacy in instrumental music of Charles Babel, prolific transcriber of Lully’s music », in : Quellenstudien zu Jean-Baptiste Lully. L’œuvre de Lully : étude des sources. Hommage à Lionel Sawkins, dir. Jérôme de La Gorce et Herbert Schneider, Laaber : Laaber Verlag, 1990, p. 495-516. Haake, Paul. « Die Wahl Augusts des Starken zum König von Polen », Historische Vierteljahrschrift, 9/1, 1906, p. 31-84. Hache, Sophie. La Langue du ciel. Le sublime en France au xviie siècle, Paris : Honoré Champion, 2000. Haenen, Greta. « Die Streicher in der evangelischen Kirchenmusik in Norddeutschland », in : Zwischen Schütz und Bach. Georg Österreich und Heinrich Bokemeyer als Notensammler (Gottorf/Wolfenbüttel), dir. Konrad Küster, Stuttgart : Carus, 2015, p. 61-82. Harders, Levke et Hannes Schweiger. « Kollektivbiographische Ansätze », in : Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorie, dir. Christian Klein, Stuttgart : Metzler, 2009, p. 194-198. Harris, Ellen T. « Harmonic Patterns in Handel’s Operas », in : Eighteenth-century music in theory and practice. Essays in honor of Alfred Mann, dir. Mary Ann Parker, Stuyvesant : Pendragon Press, 1994, p. 77-118. ––––– Handel as Orpheus. Voice and Desire in the Chamber Cantatas, Cambridge MA : Harvard University Press, 2001. Harris-Warrick, Rebecca et Carol G. Marsh. Musical Theatre at the Court of Louis XIV. Le Mariage de la Grosse Catho, Cambridge : Cambridge University Press, 1994. Hatton, Ragnhild. George I, New Haven : Yale University Press, 2001. Havemann, Wilhelm. Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, vol. 3, Göttingen : Dietrich, 1857. Hawkins, John. A General History of the Science and Practice of Music, vol. 5, Londres : Payne & Son, 1776. Haynes, Bruce. The Eloquent Oboe. A History of the Hautboy 1640-1760, Oxford : Oxford University Press, 2001. Hazard, Paul. La Crise de la conscience européenne 1680-1715, Paris : Gallimard, 1961. Heal, Bridget. A Magnificent Faith. Art and Identity in Lutheran Germany, Oxford : Oxford University Press, 2017. Heawood, Edward. Watermarks, maintly of the 17th and 18th centuries, Hilversum : Paper Publications Society, 1981. Herissone, Rebecca. Musical Creativity in Restoration England, Cambridge : Cambridge University Press, 2013.
– 324 –
Bibliographie
Herr, Corinna, Herbert Seifert, Andrea Sommer-Mathis et Reinhard Strohm (dir). Italian Opera in Central Europe, 1614-1780, vol. 2, Italianità : Image and Practice, Berlin : Berliner Wissenschaftsverlag, 2008. Heyer, John Hajdu. « The sources of Lully’s Te Deum (lwv 55) : Implications for the Collected Works », in : Quellenstudien zu Jean-Baptiste Lully. L’œuvre de Lully : étude des sources. Hommage à Lionel Sawkins, dir. Jérôme de La Gorce et Herbert Schneider, Laaber : Laaber Verlag, 1990, p. 264-277. Hiller, Johann Adam. Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkünstler, neuerer Zeit, Leipzig : Dyk, 1784. Hirschmann, Wolfgang. « Le monde renversé – Die verkehrte Welt. Zur Adaption und Transformation der Opéra comique auf deutschen Bühnen des frühen 18. Jahrhunderts », in : Telemann und Frankreich, Frankreich und Telemann : Bericht über die Internationale Wissenschaftliche Konferenz, Magdeburg, 12. bis 14. März 1998, dir. Carsten Lange, Hildesheim : Olms, 2009, p. 238-266. Hirschmann, Wolfgang et Bernhard Jahn (dir). Johann Mattheson als Vermittler und Initiator. Wissenstransfer und die Etablierung neuer Diskurse in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Hildesheim : Olms, 2010. Hirschmann, Wolfgang et Bernhard Jahn. « Oper und Öffentlichkeit. Formen impliziten Aufklärens an der Hamburger Gänsemarktoper um 1700 », in : Um 1700. Die Formierung der europäischen Aufklärung zwischen Öffnung und neuerlicher Schließung, dir. Daniel Fulda et Jörn Steigerwald, Berlin : de Gruyter, 2016, p. 184-197. Holtmeier, Ludwig. Rameaus Langer Schatten. Studien zur deutschen Musiktheorie des 18. Jahrhunderts, Hildesheim : Olms, 2017. Hoppe, Günther. « Köthener politische, ökonomische und höfische Verhältnisse als Schaffensbedingungen Bachs », Cöthener Bach-Hefte, 4, 1986, p. 12-62. Horn, Victoria. « French Influence in Bach’s Organ Works », in : J. S. Bach as Organist. His instruments, music, and performance practices, dir. George Stauffer et Ernest May, London OHA : Indiana University Press, 1986, p. 256-273. Horn, Wolfgang. Die Dresdner Hofkirchenmusik 1720-1745. Studien zu ihren Voraussetzungen und ihrem Repertoire, Kassel : Bärenreiter, 1987. Horn, Wolfgang et Thomas Kohlhase. Zelenka-Dokumentation. Quellen und Materialien, Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1989. Hudson, Frederick. « The New Bedford Manuscript Part-Books of Handel’s Setting of L’Allegro », Notes, 33/3, 1977, p. 531-552. ––––– « The Earliest Paper made by James Whatman the Elder (1702-1759) and its Significance in Relation to G. F. Handel and John Walsh », The Music Review, 38, 1977, p. 15-32. Huth, Peter. « Telemanns Hamburger Opern nach französischen Vorbildern », in : Französische Einflüsse auf deutsche Musiker im 18. Jahrhundert, dir. Friedhelm Brusniak et Annemarie Clostermann, Cologne : Studio, 1996, p. 115-148. Huygens, Constantijn. Journaal van Constantijn Huygens den zoon. Derde Deel, Utrecht : Kemink & Zoon, 1888. Israel, Jonathan I. Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford : Oxford University Press 2001. ––––– Les Lumières radicales. La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité, 1650-1750, Paris : Éditions Amsterdam, 2010. Jennings, Neil et Margaret Jones. A Biography of Samuel Chappuzeau, a Seventeenth-Century French Huguenot Playwright, Scholar, Traveller, and Preacher. An Encyclopedic Life, Lewiston : Mellen Press, 2012. Joost, Sebastian. Zwischen Hoffnung und Ohnmacht. Auswärtige Politik als Mittel zur Durchsetzung landesherrlicher Macht in Mecklenburg (1648-1695), Berlin : Lit, 2009. Jouanna, Arlette. Le Pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté, Paris : Gallimard, 2013.
– 325 –
Bibliographie
Joseph, Flavius. Histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph sous le titre d’Antiquités judaïques, trad. Robert Arnaud D’Andilly, Paris : Pierre Le Petit, 1677. Joyeux, Béatrice. « Les transferts culturels. Un discours de la méthode », Hypothèses, 1, 2002, p. 149-162. Julliard, Catherine. « Johann Michael von Loen et son Discours de l’imitation des Français (1744). Un anti-Thomasius ? », Recherches germaniques, 40, 2010, p. 131-150. Jungius, Christiane. Telemanns Frankfurter Kantatenzyklen, Kassel : Bärenreiter, 2008. Jurgens, Madeleine. Documents du minutier central concernant l’histoire de la musique (1600-1650), vol. 1, Paris : Archives Nationales, 1967. ––––– Documents du minutier central concernant l’histoire de la musique (1600-1650), vol. 2, Paris : Archives Nationales, 1974. Kaiser, Hermann. Barocktheater in Darmstadt. Geschichte des Theaters einer deutschen Residenz im 17. und 18. Jahrhundert, Darmstadt : Eduard Roether Verlag, 1951. Kast, Paul. Die Bach-Handschriften der Berliner Staatsbibliothek, Trossingen : Hohner Verlag, 1958. Katalog der Bibliothek des Börsenvereins der deutschen Buchhändler, Leipzig : Verlag des Börsenvereins der deutschen Buchhändler, 1885. Kaufold, Claudia. Ein Musiker als Diplomat : Abbé Agostino Steffani in hannoverschen Diensten (1688-1703), Bielefeld : Verlag für Regionalgeschichte, 1997. Kägler, Britta. « Von ‘Geschücklichkeiten’, Pfauenfedern und einem ‘Phonascus’. Kollektivbiographische Studien zu deutschsprachigen Musikern in den italienischen Musikzentren Venedig und Rom (1650-1750) », in : Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (16501750). Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples (1650-1750), dir. Anne-Madeleine Goulet et Gesa zur Nieden, Kassel : Bärenreiter, 2015, p. 236-268. Keats-Rohan, Katharine. « Biography, Identity and Names : Understanding the Pursuits of the Individual in Prosopography », in : Prosopography, Approaches and Applications. A Handbook, dir. Katharine Keats-Rohan, Oxford : Oxford University Press, 2007, p. 139-181. Keym, Stefan. « Herrschaftssymbolik, Gattungskontext und Personalstil : Zur französischen Ouvertüre bei Lully und Händel », Händel Jahrbuch, 60, 2014, p. 317-334. Kjellberg, Erik. Kungliga musiker i Sverige under stormaktstiden. Studier kring deras organisation, verksamheter och status c.1620 – c.1720, thèse de doctorat, Université Uppsala, 1979. Klingebiel, Thomas. Die Hugenotten in den welfischen Landen. Eine Privilegiensammlung, Bad Karlshafen: Verlag des Deutschen Hugenotten-Vereins, 1994. Kok, Jan. « The family factor in migration decisions », in : Migration History in World History. Multidisciplinary Approaches, dir. Jan Lucassen, Leo Lucassen et Patrick Manning, Leiden : Brill, 2010, p. 215-250. Kollmar, Ulrike. Gottlob Harrer (1703-1755). Kapellmeister des Grafen Heinrich von Brühl am sächsisch-polnischen Hof und Thomaskantor in Leipzig, Hildesheim : Olms, 2006. Kollpacher-Haas, Ingrid. « Pierre-Gabriel Buffardin. Sein Leben, sein Werk », Studien zur Musikwissenschaft, 25, 1962, p. 298-306. Köpp, Kai. Johann Georg Pisendel (1697-1755) und die Anfänge der neuzeitlichen Orchesterleitung, Tutzing : Hans Schneider, 2005. ––––– « Ein Musikerverzeichnis aus dem Jahr 1718 als Referenzquelle für die Dresdner Kapellgeschichte », in : Johann Georg Pisendel. Studien zu Leben und Werk. Bericht über das Internationale Symposium vom 23. bis 25. Mai 2005 in Dresden, dir. Ortrun Landmann et Hans Günter Ottenberg, Hildesheim : Olms, 2010, p. 353-382. Kramer, Ursula. « The Court of Hesse-Darmstadt », in : Music at German Courts, 1715-1760. Changing Artistic Priorities, dir. Samantha Owens, Barbara M. Reul et Janice B. Stockigt, Woodbridge 2011, p. 333-364. Kraushar, Aleksander. Podróże królewicza polskiego, póżniejszego Augusta III (Voyages du Prince royal polonais, futur Auguste III), vol. 2, Lwów : Nakładem Wydawcy, 1911.
– 326 –
Bibliographie
Krüger, Ekkerhard. Die Musikaliensammlung des Erbprinzen Friedrich Ludwig von WürttembergStuttgart und der Herzogin Luise Friederike von Mecklenburg-Schwerin in der Universitätsbibliothek Rostock, Beeskow : Ortus Musikverlag, 2006. Kümmerling, Harald. Katalog der Sammlung Bokemeyer, Kassel : Bärenreiter, 1970. Küster, Konrad. « Weimarer Kantaten (1708-1717) », in : Bach Handbuch, dir. Konrad Küster, Laaber : Laaber Verlag, 1999. Küster, Konrad (dir). Zwischen Schütz und Bach. Georg Österreich und Heinrich Bokemeyer als Notensammler, Stuttgart : Carus, 2015. de La Gorce, Jérôme. « Contribution des Opéras de Paris et de Hambourg à l’interprétation des ouvrages lyriques donnés à La Haye au début du siècle », in : Aufklärungen. Studien zur deutsch-französischen Musikgeschichte im 18. Jahrhundert. Einflüsse und Wirkungen, dir. Wolfgang Birtel et Christoph Hellmut Mahling, Heidelberg : Carl Winter, 1986, p. 90103. de La Gorce, Jérôme et Margaret M. McGowan. « Guillaume-Louis Pecour : a Biographical Essay », Dance Research. The Journal of the Society for Dance Research, 8/2, 1990, p. 3-26. Lagrange, Charles Valet sieur de. Registre de La Grange (1658-1683), précédé d’une notice biographique, Paris : Claye, 1876. Landmann, Ortrun. « Fränzosische Elemente in der Musikpraxis des 18. Jahrhunderts am Dresdener Hof », in : Der Einfluß der französischen Musik auf die Komponisten der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Konferenzbericht der IX. Wissenschaftlichen Arbeitstagung Blankenburg/Harz, 26. Juni bis 28. Juni 1981, dir. Günter Fleischhauer, Walther Siegmund-Schultze et Eitelfriedrich Thom, Blankenburg : Harz, 1981, p. 48-56. ––––– Die Telemann-Quellen der Sächsischen Landesbibliothek. Handschriften und zeitgenössische Drucke seiner Werke, Dresde : Sächsische Landesbibliothek, 1983. ––––– Über das Musikerbe der sächsischen Staatskapelle. Drei Studien zur Geschichte der Dresdner Hofkapelle und Hofoper anhand ihrer Quellenüberlieferung in der SLUB Dresden, Dresde : Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, 2010. Lee, Everett S. « A Theory of Migration », Demography, 3/1, 1966, p. 47-57 Lefebvre, Léon. Histoire du théâtre de Lille de ses origines à nos jours, Lille : Lefebvre Ducrocq, 1907. Leibetseder, Mathis. Die Kavalierstour. Adlige Erziehungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Cologne : Böhlau, 2004 Leibniz, Gottfried Wilhelm. Sämtliche Schriften und Briefe I/2, éd. Paul Ritter, Darmstadt : Reichl, 1927. ––––– Sämtliche Schriften und Briefe I/10, éd. Gerda Utermöhlen, Günter Scheel et Kurt Müller, Berlin: Akademie Verlag, 1979. ––––– Sämtliche Schriften und Briefe I/16, éd. Malte-Ludolf Babin, Reinhard Finster et Gerd van den Heuvel, Berlin : Akademie Verlag, 2000. ––––– Sämtliche Schriften und Briefe I/22, éd. Nora Gäbeke, Sabine Sellschopp et Regina Stuber, Berlin : Akademie Verlag, 2011. Leisinger, Ulrich. « Das Klavierbüchlein der Prinzessin Amalia von Braunschweig-Lüneburg », Jahrbuch der Ständigen Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, 1, 2000, p. 169-178. Lemaigre-Gaffier, Pauline. Administrer les Menus Plaisirs du Roi. La Cour, l’État et les spectacles dans la France des Lumières, Ceyzérieu : Champ Vallon, 2016. Le Moël, Michel. « L’entrée des femmes à la Musique du Roi : Anne de La Barre et les autres », in : Études sur l’ancienne France offertes en hommage à Michel Antoine, dir. Bernard Barbiche, Paris : École des Chartes, 2003, p. 227-234. Lepetit, Bernard. « Architecture, géographie, histoire: usages de l’échelle », Genèses. Sciences sociales et histoire, 13, 1993, p. 118-138. Leti, Gregorio. Abrégé de l’histoire de la maison sérénissime et électorale de Brandebourg, ecrite par Gregorio Leti en italien et traduit en françois suivant l’extrait et par les soins de l’Auteur, Amsterdam: Roger, 1687.
– 327 –
Bibliographie
Lévi-Strauss, Claude. La Pensée sauvage, Paris : Plon, 1962. Lilti, Antoine. « Querelles et controverses. Les formes du désaccord à l’époque moderne », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 25, 2007, p. 13-28. ––––– « Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des Lumières ? », Annales. Histoire, sciences sociales, 64, 2009, p. 171-206. ––––– The Invention of Celebrity, Cambridge : Polity Press, 2017. Linnemann, Georg. Celler Musikgeschichte bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, Celle : Schweiger & Pick, 1935. Louvat-Mozolay, Bénédicte. « Le théâtre musical au xviie siècle : élaboration d’un genre nouveau ? », Littératures classiques, 21, 1994, p. 249-264. ––––– Théâtre et musique. Dramaturgie de l’insertion musicale dans le théâtre français (1550-1680), Paris : Honoré Champion, 2002. Lühr, Hans-Peter. Frankreich und Sachsen. Spurensuche in Dresden, Dresde : Dresdener Geschichtsverein, 2010. Luynes, Charles Philippe d’Albert, duc de. Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XV (17351758), vol. 10, éd. Louis Dussieux et Eudore Soulié, Paris : Firmin Didot, 1862. Malortie, Carl Ernst von. Beiträge zur Geschichte des Braunschweig-Lüneburgischen Hauses und Hofes, vol. 4, Hanovre : Hahnsche Buchhandlung, 1864. Maral, Alexandre. La Chapelle royale de Versailles sous Louis XIV. Cérémonial, liturgie et musique, Sprimont : Mardaga, 2002. Markovits, Rahul. Civiliser l’Europe. Politiques du théâtre français au xviiie siècle, Paris : Fayard, 2014. Marpurg, Friedrich Wilhelm. Des critischen Musicus an der Spree, vol. 1, Berlin : Haude und Spener, 1750. ––––– Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, vol. 1, Berlin : Johann Jacob Schützens sel. Wittwe, 1754. ––––– Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, Berlin : Lange, 1762. ––––– Legende einiger Musikheiligen, Cologne : Peter Hammer, 1786. Martus, Steffen. Aufklärung : das deutsche 18. Jahrhundert. Ein Epochenbild, Berlin : Rohwolt, 2015. Marx, Hans Joachim et Dorothea Schröder. Die Hamburger Gänsemarkt-Oper. Katalog der Textbücher, Laaber : Laaber Verlag, 1995. Masseau, Didier. « Qu’est-ce que les anti-Lumières ? », Dix-huitième siècle, 46/1, 2014, p. 107-123. Massip, Catherine. « Itinéraires d’un musicien européen : l’autobiographie de Michel Farinel (1649-1726) », in : Musik – Raum – Akkord – Bild. Festschrift zum 65. Geburtstag von Dorothea Baumann, dir. Antonio Baldassarre et al., Berne : Peter Lang, 2012, p. 131-148. ––––– La Vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin (1643-1661). Essai d’étude sociale, Paris : Picard, 1976. Masson, Charles. Nouveau traité des règles pour la composition de la musique, Paris : Ballard, 1697. Mattheson, Johann. Das Neu-Eröffnete Orchestre, Hambourg : Schiller, 1713. ––––– Das Beschützte Orchestre, Hambourg : Schiller, 1717. ––––– Das Forschende Orchestre, Hambourg : Schiller et Kißner, 1721. ––––– Critica Musica, vol. 2, Hambourg : Wiering, 1725. ––––– Der Musicalische Patriot, Hambourg : auteur, 1728. ––––– Grosse General-Baß-Schule, Hambourg : Kißner, 1731. ––––– Der Vollkommene Capellemeister, Hambourg : Herold, 1737. ––––– Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg : auteur, 1740. ––––– Texte aus dem Nachlass, éd. Wolfgang Hirschmann et Bernhard Jahn, Hildesheim : Olms, 2014. Maul, Michael. Barockoper in Leipzig (1693-1720), Freiburg : Rombach, 2009. Maunder, Richard. The Scoring of Baroque concertos, Woodbridge : Boydell Press, 2004. Maupoint, N. Bibliothèque des théâtres, Paris : Prault, 1733.
– 328 –
Bibliographie
Märker, Michael. « Französische Musiker am Hofe Augusts des Starken » in : Von der Elbe bis an die Seine. Kulturtransfer zwischen Sachsen und Frankreich im 18. und 19. Jahrhundert, dir. Michel Espagne et Matthias Middell, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 1993, p. 67-74. Meinel, Friedrich. Samuel Chappuzeau 1625-1701, Leipzig : Noske, 1908. Meletaon [Johann Leonhard Rost], Von der Nuetzbarkeit des Tantzens, Leipzig : Lochner, 1713. Meyer, Clemens. « Geschichte der Güstrower Hofkapelle : Darstellung der Musikverhältnisse am Güstrower Fürstenhofe im 16. und 17. Jahrhundert », in : Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, 83, 1919, p. 1-46. ––––– Geschichte der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle, Schwerin : Davids, 1913. Middell, Katharina. « Hugenotten zwischen Leipzig und Lyon. Die Familie Dufour », in : Übergänge und Verflechtungen. Kulturelle Transfers in Europa, dir. Gregor Kokorz et Helga Mitterbauer, Berne : Peter Lang, 2004, p. 47-72. Moeller, Katrin. Dass Willkür über Recht ginge. Hexenverfolgung in Mecklenburg im 16. und 17. Jahrhundert, Bielefeld : Verlag für Regionalgeschichte, 2007. Mongrédien, Georges. La Vie quotidienne des comédiens au temps de Molière, Paris : Hachette, 1970. Mourey, Marie-Thérèse. « Le Mercure galant et l’espace germanique », in : Le Mercure galant, témoin et acteur de la vie musicale, dir. Anne Piéjus, Paris : IRPMF, 2010, p. 13-21. Nemeitz, Joachim Christoph. Séjour de Paris Oder Getreute Anleitung, Welchergestalt Reisende von Condition sich zu verhalten haben, wenn sie ihre Zeit und Geld nützlich und wohl zu Paris anwenden wollen, Francfort : Friedrich Wilhelm Förster, 1718. ––––– Nachlese besondere Nachrichten von Italien, als ein Supplement von Misson, Burnet, Addison, und Andern, Leipzig : Johann Friedrich Gleditsch, 1726. ––––– Séjour de Paris, c’est-à-dire, Instructions fidèles, pour les Voiageurs de Condition, Comment ils se doivent conduire, s’ils veulent faire un bon usage de leur tems & argent, durant leur Séjour à Paris, Leiden : Jean van Abcoude, 1727. ––––– Vernünfftige Gedancken über allerhand historische, critische und moralische Materien, vol. 6, Francfort : Andredisch, 1745. Neumeister, Erdmann. Geistliche Poesien, mit untermischten Biblischen Sprüchen und Choralen, Eisenach : Boetius, 1717. Niekerk, Carl (dir). The Radical Enlightenment in Germany. A Cultural Perspective, Leiden : Brill Rodopi, 2018. Nivers, Guillaume-Gabriel. Traité de la composition de musique, Paris : Ballard, 1667. Noack, Elisabeth. Musikgeschichte Darmstadts vom Mittelalter bis zur Goetheszeit, Mayence : Schott, 1967. Nolhac, Denis. Voiage historique et politique de Suisse, d’Italie et d’Allemagne, Francfort : François Varrentrapp, 1736. Norlind, Tobias. « Die Musikgeschichte Schwedens in den Jahren 1630-1730 », Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft, 1/2, 1900, p. 165-212. Oakley, Stewart P. « The Interception of Posts in Celle, 1694-1700 », in : William III and Louis XIV. Essays 1680-1720 by and for Mark A. Thomson, dir. Ragnhild Hatton et John Selwyn Bromley, Liverpool : Liverpool University Press, 1968, p. 95-116. Oefner, Claus. Das Musikleben in Eisenach, 1650-1750, Dissertation, Martin-Luther Universität Halle, 1975. Olibrio, Flavio Anicio [Johann Friedrich Agricola]. Schreiben eines reisenden Liebhabers der Musik von der Tyber, an den critischen Musikus an der Spree, [Berlin 1749]. Olsen, Solveig. Christian Heinrich Postels Beitrag zur deutschen Literatur. Versuch einer Darstellung, Amsterdam : Rodopi NV, 1973. d’Originy, Antoine. Annales du théâtre italien depuis son origine jusqu’à ce jour, Paris : Veuve Duchesne, 1788.
– 329 –
Bibliographie
Ottenberg, Hans-Günter. Der Critische Musicus an der Spree. Berliner Musikschrifttum von 1748 bis 1799, Leipzig : Reclam, 1984. Owens, Samantha. The Württemberg Hofkapelle c.1680-1721, PhD Dissertation, Victoria University of Wellington, 1995. ––––– « “Eine Liebliche/ Von Vielen Violen Bestehende Music”. Ballet Instrumentation at German Protestant Courts, 1650-1700. A Study of Libretti in Wolfenbüttel and Stuttgart Libraries », Royal Musical Association Research Chronicle, 41, 2008, p. 25-67. ––––– « The Court of Württemberg-Stuttgart », in : Music at German courts, 1715-1760. Changing artistic priorities, dir. Samantha Owens, Barbara M. Reul et Janice B. Stockigt, Woodbridge : The Boydell Press, 2011, p. 165-195. ––––– The Well-Travelled Musician. John Sigismond Cousser and Musical Exchange in Baroque Europe, Woodbridge : The Boydell Press, 2017. Paczkowski, Szymon. « Christoph August von Wackerbarth (1662-1734) and His “CammerMusique” », in : Music Migration in the Early Modern Age. Centres and Peripheries. People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence, dir. Jolanta Guzy-Pasiak et Aneta Markuszewska, Varsovie 2016, p. 109-126. Paisey, David L. Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1988. Parfaict, François et Claude. Mémoires pour servir à l’histoire des spectacles de la Foire, Paris : Briasson, 1743. Parfaict, François. Histoire de l’ancien théâtre italien, Paris : Lambert, 1767. Peetz, Juliane. « The large Tablature Books in the Düben Collection », in : The Dissemination of Music in Seventeenth-Century Europe. Celebrating the Düben Collection. Proceedings from the International Conference at Uppsala University 2006, dir. Erik Kjellberg, Berne : Peter Lang, 2010, p. 49-72. Pegah, Rashid Sascha. « Begegnungen in Konstantinopel und Leipzig. Pierre Gabriel Buffardin und Johann Jacob Bach », Bach Jahrbuch, 97, 2011, p. 287-292. ––––– « “Und abends war opera”. Tagebuchnotizen aus dem Jahre 1707 », Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 23, 1998, p. 182-190. Pélissier, Léon. « Souvenirs du danseur Favier », Journal de la société d’archéologie lorraine et du musée historique lorrain, 46/11, 1897, p. 243-253. Pelus-Kaplan, Marie-Louise. « Christophe Brosseau, résident hanséatique à Paris, et son action de 1689 à 1717 » in : Les relations entre la France et les villes hanséatiques de Hambourg, Brême et Lübeck. Moyen Âge-xixe siècle, dir. Isabelle Richefort et Burghart Schmidt, Bruxelles : Peter Lang, 2006, p. 401-421. Petit, Jean-Charles. Apologie de l’excellence de la musique, Londres, auteur, 1740. Pierre, Constant. Histoire du concert spirituel 1725-1790, Paris : Heugel, 1975. Poetzsch-Seban, Ute. « Neues über den Telemannbestand im Kantoreiarchiv zu Mügeln », in : Auf der gezeigten Spur. Beiträge zur Telemannforschung. Festgabe Martin Ruhnke zum 70. Geburtstag, dir. Wolfgang Hirschmann, Wolf Hobohm, Carsten Lange, Ochserleben : Ziethen, 1994, p. 106-127. ––––– « Notizen zu ‘Nun komm der Heiden Heiland’ von Georg Philipp Telemann und TEL », in : Musik zwischen Leipzig und Dresden. Zur Geschichte der Kantoreigesellschaft Mügeln 15711991, dir. Michael Heinemann et Peter Wollny, Oscherleben : Ziethen, 1996, p. 125-130. ––––– Die Kirchenmusik von Georg Philipp Telemann und Erdmann Neumeister. Zur Geschichte der protestantischen Kirchenkantate in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Beeskow : Ortus Musikverlag, 2006. Poppe, Gerhard (dir). Schranck No: II. Das erhaltene Instrumentalmusikrepertoire der Dresdner Hofkapelle aus den ersten beiden Dritteln des 18. Jahrhunderts, Beeskow : Ortus, 2012.
– 330 –
Bibliographie
Poppe, Gerhard. « Dresdner Hofkirchenmusik von 1717 bis 1725 : Über das Verhältnis von Repertoirebetrieb, Besetzung und musikalischer Faktur in einer Situation des Neuaufbaus », in : Mitteldeutschland im musikalischen Glanz seiner Residenzen. Sachsen, Böhmen und Schlesien als Musiklandschaften im 16. und 17. Jahrhundert, dir. Peter Wollny, Beeskow : Ortus, 2005, p. 301-432. ––––– « Kontinuität der Institution oder Kontinuität des Repertoires ? Einige Bemerkungen zur Kirchenmusik am Dresdner Hof zwischen 1697 und 1717 », in : Micellaneorum de musica concentus. Karl Heller zum 65. Geburtstag am 10. Dezember 2000, dir. Alexander Walpurga, Joachim Stange-Elbe et Andreas Waczkat, Rostock : Universität Rostock, 2000, p. 49-81. Porot, Bertrand. « Tonalité et modalité dans les pièces de clavecin de d’Anglebert : éléments pour une analyse harmonique », Musurgia, 7/1, 2000, p. 61-87. ––––– « Les tonalités dans les divertissements des opéras de Lully et Quinault : approche dramaturgique », in : Formes et formations au dix-septième siècle. Actes du 37e congrès de la North American Society for Seventeenth-Century French Literature, dir. Buford Norman, Tübingen : Narr Dr. Gunter, 2006, p. 133-147. Pougin, Arthur. Les Vrais créateurs de l’Opéra français : Perrin et Cambert, Paris : Charavay, 1881. Powell, Johan S. Music and Theatre in France 1600-1680, Oxford : Oxford University Press, 2000. Pradel, Abraham du. Le Livre commode des adresses de Paris, Paris : Paul Daffis, [1692]. Printz, Wolfgang Caspar. Historische Beschreibung der edelen Sing- und Kling-Kunst, Freiberg 1690. Psychoyou, Theodora. « Les Règles de composition par Monsieur Charpentier : statut des sources », in : Les Manuscrits autographes de Marc-Antoine Charpentier, dir. Catherine Cessac, Wavre : Mardaga, 2007, p. 201-221. Quantz, Jean Joachim. Essai d’une méthode pour apprendre à jouer de la flute traversière, avec plusieurs remarques pour servir au bon goût dans la musique, Berlin : Chrétien Frédéric Voss, 1752. Quesnot de La Chesnée, Jean-Jacques. L’Opéra de La Haye. Histoire instructive et galante, Cologne [Gand]: Chez les Héritiers de Pierre le Sincere [Maximilien Graet], 1706. Rahn, Thomas. Festbeschreibung. Funktion und Topik einer Textsorte am Beispiel der Beschreibung höfischer Hochzeiten (1568-1794), Tübingen : Max Niemeyer, 2006. Rampe, Siegbert. « Das “Hintze-Manuskript”. Ein Dokument zu Biographie und Werk von Matthias Weckmann und Johann Jakob Froberger », Schütz-Jahrbuch, 19, 1997, p. 71-111. ––––– « Bachs Piece d’Orgue G-Dur BWV 572: Gedanken zu ihrer Konzeption », in : Bachs Musik für Tasteninstrumente, dir. Martin Geck, Dortmund : Klangfarben Musikverlag, 2003, p. 333-369. Rasch, Rudolf. « Athalie entre Saint-Cyr et Amsterdam: Jean Racine, Jean-Baptiste Moreau et Servaas de Konink », in : Noter, annoter, éditer la musique: Mélanges offerts à Catherine Massip, dir. Cécile Reynaud et Herbert Schneider, Genève : Droz, 2012. ––––– « Publishers and Publishers », in : Music Publishing in Europe 1600-1900. Concepts and Issues, Bibliography, dir. Rudolf Rasch, Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005, p. 183-208. ––––– The Music Publishing House of Estienne Roger and Michel-Charles Le Cène, en ligne (https://roger.sites.uu.nl/). Redrow, Sean Patrick. The Livre d’Orgue of Nicolas de Grigny and the Livre copies of J.S. Bach and J.G. Walther : a performing edition with critical commentary. DMA dissertation, Boston University, 2009. Regnard, Jean-François. « Le Départ des comédiens », in : Le Théâtre italien de Gherardi, ou le recueil général de toutes les Comédies & Scènes françoises jouées par les Comédiens italiens du roi, vol. 5, Amsterdam : Michel Charles Le Cène, 1721. Reich, Wolfgang. « Das Diarium Missionis Societatis Jesu Dresdae als Quelle für die kirchenmusikalische Praxis », in : Zelenka-Studien II. Referate und Materialien der 2. Internationalen Fachkonferenz Jan Dismas Zelenka, Dresden und Prag 1995, dir. Günter Gattermann et Wolfgang Reich, Sankt Augustin: Academia Verlag, 1997, p. 43-57 et 315-380.
– 331 –
Bibliographie
Reilly, Edward R. et John Solum. « De Lusse, Buffardin, and an Eighteenth-Century Quarter-Tone Piece », Historical Performance. The Journal of Early Music America, 5/1, 1992, p. 19-23. Reinhard, Wolfgang. Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, Munich : Beck, 1999. Rexheuser, Rex (dir). Die Personalunionen von Sachsen-Polen 1697-1763 und Hannover-England 17141837. Ein Vergleich, Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. Richards, Annette. Carl Philipp Emanuel Bach. Portrait Collection I : Catalogue (= The Complete Works, VIII/ 4.1), Los Altos : The Packard Humanities Institute, 2012. Riches, Daniel. Protestant cosmopolitanism and diplomatic culture: Brandenburg-Swedish relations in the seventeenth century, Leiden: Brill, 2013. Robertson, Michael. The Courtly Consort Suite in German-Speaking Europe, 1650-1706, Farnham : Ashgate, 2009. Roche, Daniel. Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Paris : Fayard, 2003. Roche, Martine. « Le Manuscrit de Cassel et les “Pièces pour le violon à 4 parties de différents autheurs” (Ballard, 1665) », Recherches sur la musique française classique, 9, 1969, p. 5-20. von Rohr, Julius Bernhard. Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft der Grossen Herren, Berlin : Rüdiger, 1729. Rosenthal, Paul-André. « Maintien/rupture : un nouveau couple pour l’analyse des migrations », Annales. Économies, sociétés, civilisations, 45/6, 1990, p. 1403-1431. Rosow, Lois. Lully’s Armide at the Paris Opéra: a performance history, 1686-1766, PhD Dissertation, Brandeis University, 1981. ––––– « Structure and Expression in the scènes of Rameau’s “Hippolyte et Aricie” », Cambridge Opera Journal, 10/3, 1998, p. 259-273. Rousseau, Jean. Méthode claire, certaine et facile pour apprendre à chanter la musique, Amsterdam : Pierre Mortier, 1710 [Paris 1678]. Rousseau, Jean-Jacques. Œuvres Complètes, vol. 5, éd. Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris : Gallimard, 1995. Ruhnke, Martin. « Telemanns Hamburger Opern und ihre italienischen und französischen Vorbilder », in : Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 5, 1981, p. 9-27. Russell, Tilden. Theory and Practice in Eighteenth-Century Dance : The German-French Connection, Newark : University of Delaware Press, 2018. Sachs, Curt. « Die Ansbacher Hofkapelle unter Markgraf Johann Friedrich (1672-1686) », Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft, 11, 1909, p. 105-137. ––––– Musik und Oper am kurbrandenburgischen Hof, Berlin : Julius Bard, 1910. Sackmann, Dominik. « “Französischer Schaum und deutsches Grundelement” – Französisches in Bachs Musik », Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis, 28, 2004, p. 81-93. Sadler, Graham. « Rameau, Pellegrin and the Opéra : The Revisions of “Hippolyte et Aricie” during Its First Season », The Musical Times, 124/1687, 1983, p. 533-537. ––––– « Agostino Steffani and the French Style », in : Agostino Steffani. Europäischer Komponist, hannoverscher Diplomat und Bischof der Leibniz-Zeit, dir. Claudia Kaufold, Nicole K. Strohmann et Colin Timms, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, p. 67-87. Sadler, Graham et Shirley Thompson. « The Italian Roots of Marc-Antoine Charpentier’s Chromatic Harmony », in : Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (1650-1750). Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples (1650-1750), dir. Anne-Madeleine Goulet et Gesa zur Nieden, Kassel : Bärenreiter, 2015, p. 546-570. Saemann, Hedda. Dachwerke über den welfischen Residenzbauten der Barockzeit im Kontext des höfischen Bauwesens. Untersuchungen in den ehemaligen Residenzstädten Hannover, Celle, Osnabrück, Wolfenbüttel und Braunschweig, Petersberg : Imhof, 2014. Sandman, Susan Goertzel. « The Wind Band at Louis XIV’s Court », Early Music, 5/1, 1977, p. 27-37. Sawkins, Lionel. A Thematic Catalogue of the Work of Michel-Richard de Lalande (1657-1726), Oxford : Oxford University Press, 2005.
– 332 –
Bibliographie
Scharrer, Margret. Zur Rezeption des französischen Musiktheaters an deutschen Residenzen, Sinzig : Studio, 2014. Scheibe, Johann Adolf. Critischer Musikus. Neue, vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig : Breitkopf, 1745. Schick, Sébastien. Les Liaisons avantageuses. Ministres, liens de dépendance et diplomatie dans le Saint-Empire romain germanique (1720-1760), Paris : Éditions de la Sorbonne, 2018. Schilling, Lothar. « Vom Nutzen und Nachteil eines Mythos », in : Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept ? Eine deutsch-französische Bilanz, dir. Lothar Schilling, Munich : de Gruyter, 2008, p. 13-31. Schlechte, Monika. « “Recueils des dessins et gravures représentant les solemnites du mariages”. Das Dresdner Fest von 1719 im Bild », in : Image et Spectacle. Actes du 32e colloque international d’études humanistes, dir. Pierre Béhar, Amsterdam : Centre d’études supérieures de la Renaissance, 1993, p. 117-167. Schmidt, Carl B. « The geographical spread of Lully’s operas during the late seventeenth and early eighteenth centuries: new evidence from the livrets », in : Jean Baptiste Lully and the Music of the French Baroque. Essays in Honour of James R. Anthony, dir. John Hajdu Heyer, Cambridge : Cambridge University Press, 1989, p. 183-211. ––––– « The Amsterdam Editions of Lully’s Music. A bibliographical scrutiny with commentary », in : Lully Studies, dir. John Hadju Heyer, Cambridge : Cambridge University Press, 2000, p. 100-165. Schnakenbourg, Éric. La France, le Nord et l’Europe au début du xviiie siècle, Paris : Honoré Champion, 2008. Schnath, Georg. Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und der englischen Sukzession, vol. 1, Leipzig : August Lax, 1938. Schneider, Herbert. « Opern Lullys in deutschsprachigen Bearbeitungen », Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 5, 1981, p. 69-80. ––––– « Mattheson und die französische Musik », in : New Mattheson Studies, dir. George J. Buelow et Hans Joachim Marx, Cambridge : Cambridge University Press, 1983, p. 425-442. ––––– « Unbekannte Handschriften der Hofkapelle in Hannover. Zum Repertoire französischer Hofkapellen in Deutschland », in : Aufklärungen. Studien zur deutsch-französischen Musikgeschichte im 18. Jahrhundert. Einflüsse und Wirkungen, dir. Wolfgang Birtel et Christoph Hellmut Mahling, Heidelberg : Carl Winter, 1986, p. 180-194. ––––– « The Amsterdam editions of Lully’s orchestral suites », in : Jean Baptiste Lully and the Music of the French Baroque. Essays in Honour of James R. Anthony, dir. John Hajdu Heyer, Cambridge : Cambridge University Press, 1989, p. 113-130. ––––– « A Charles Babel Manuscript restored to its original library », Revue de Musicologie, 87/2, 2001, p. 371-394. ––––– « Affinitäten und Differenzen zwischen Rameau und Händel in Opern der Jahre 1735– 1737 », Händel Jahrbuch, 50, 2004, p. 91-138. Schneider, Nicola. « Christian Heinrich von Watzdorf als Musikmäzen. Neue Erkenntnisse über Albinoni und eine sächsische Notenbibliothek des 18. Jahrhunderts », Die Musikforschung, 63/1, 2010, p. 20-34. ––––– « Die Musikhandschriftensammlung Schneider-Genewein in Zürich », Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft, 55/1, 2012, p. 19-34. Schnitzer, Claudia et Petra Hölscher (dir). Eine gute Figure machen. Kostüm und Fest am Dresdner Hof, Dresde : Verlag der Kunst Dresden, 2000. Schmidmaier, Edith. Die fürstbischöflichen Residenzen in Passau. Baugeschichte und Austattung vom Spätmittelalter bis zur Säkularisation, Francfort : Peter Lang, 1994. Schoeppl, Heinrich Ferdinand. Die Herzoge von Sachsen-Altenburg, ehem. von Hildburghausen. Bozen: Tyrolia, 1917. Schulze, Hans-Joachim. Studien zur Bach-Überlieferung im 18. Jahrhundert, Leipzig : Peters, 1984.
– 333 –
Bibliographie
Schulze, Walter. Die Quellen der Hamburger Oper (1678-1738). Eine bibliographisch-statistische Studie zur Geschichte der ersten stehenden deutschen Oper, Hambourg : Stalling, 1938. Schwinger, Tobias. Die Musikaliensammlung Thulemeier und die Berliner Musiküberlieferung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Beeskow: Ortus Musikverlag, 2006. Seebald, Christian. Libretti vom « Mittelalter ». Entdeckungen von Historie in der (nord)deutschen und europäischen Oper um 1700, Tübingen : Max Niemeyer, 2009 Segond-Genovesi, Cédric. « Collection patrimoniale, héritage(s) scientifique(s). Notes sur le fonds Jules Écorcheville (1872-1915) à la Bibliothèque nationale de France », in : La notion d’héritage dans l’histoire de la musique, dir. Cécile Davy-Rigaux, à paraître. Seydoux, Philippe. Gentilhommières et maisons fortes en Champagne, vol. 1, Paris : Éditions de la Morande, 1997. Siemens, Martin. « Musik, Tanz und Theater am Hof des Osnabrücker Fürstbischofs Ernst August I. Eine Skizze », in : Das Osnabrücker Schloss : Stadtresidenz, Villa, Verwaltungssitz, dir. Franz Joachim Verspohl, Bramsche : Rasch Verlag, 1991, p. 183-192. Siemers, Viktor. Braunschweigische Papiergewerbe und die Obrigkeit, Wolfenbüttel : Selbstverlag des Braunschweigischen Geschichtsvereins, 2002. Sievers, Heinrich. Die Musik in Hannover. Die musikalischen Strömungen in Niedersachsen vom Mittelalter bis zur Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung der Musikgeschichte der Landeshauptstadt Hannover, Hanovre : Sponholtz, 1961. Sittard, Josef. Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Württembergischen Hofe, vol. 1, Stuttgart : Kohlhammer, 1890. Sophie de Hanovre. Mémoire et lettres de voyage, éd. Dirk van der Crusse, Paris : Fayard, 1990. Souchal, François. French Sculptors of the 17th and 18th Centuries. The Reign of Louis : illustrated catalogue, Londres : Faber, 1993. Spenlé, Virginie. Die Dresdner Gemäldegalerie und Frankreich. Der « bon goût » im Sachsen des 18. Jahrhunderts, Beucha : Sax-Verlag, 2008. Spitta, Philipp. Johann Sebastian Bach, vol. 1, Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1873. Spitzer, John et Neal Zaslaw. The Birth of the Orchestra. History of an Institution 1650-1815, Oxford : Oxford University Press, 2004. Spohr, Arne. « How chances it they travel ? » Englische Musiker in Dänemark und Norddeutschland 1579-1630, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2009. Stannek, Antje. Telemachs Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts, Francfort : Campus Verlag, 2001. Stauffer, George B. « Boyvin, Grigny, d’Anglebert and Bach’s assimilation of French classical organ music », Early Music, 21/1, 1993, p. 83-96. Steigerwald, Jörn. Galanterie. Die Fabrikation einer natürlichen Ethik der höfischen Gesellschaft (1650-1710), Heidelberg : Carl Winter, 2011. –––––– « La galanterie des dieux antiques : Chapelain critique de l’Adone du Cavalier Marin », Littératures classiques, 77/1, 2012, p. 281-295. Stockigt, Janice. « The Court of Saxony-Dresden », in : Music at German Courts, 1715-1760. Changing Artistic Priorities, dir. Samantha Owens, Barbara M. Reul et Janice B. Stockigt, Woodbridge : The Boydell Press, 2011, p. 18-47. –––––– Jan Dismas Zelenka. A Bohemian Musician at the Court of Dresden, Oxford : Oxford University Press, 2000. Stollberg-Rilinger, Barbara. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation vom Ende des Mittelalters bis 1806, Munich : Beck, 2009. Strohm, Reinhard (dir). The Eighteenth-Century Diaspora of Italian Music and Musicians, Turnhout : Brepols, 2001. Strohm, Reinhard. « Italian Operisti North of the Alps, c.1700 – c.1750 », in : The EighteenthCentury Diaspora of Italian Music and Musicians, dir. Reinhard Strohm, Turnhout : Brepols, 2001, p. 1-60.
– 334 –
Bibliographie
Stuth, Steffen. Höfe und Residenzen. Untersuchungen zu den Höfen der Herzöge von Mecklenburg im 16. und 17. Jahrhundert, Brême : Temmen, 2001. Talbot, Michael. « How Recitatives End and Arias Begin in the Solo Cantatas of Antonio Vivaldi », Journal of the Royal Musical Association, 126/2, 2001, p. 162-192. Telemann, Georg Philipp. Briefwechsel. Sämtliche erreichbare Briefe von und an Telemann, éd. Hans Grosse et Hans Rudolf Jung, Leipzig : VEB Deutscher Verlag für Musik, 1972. Terey-Smith, Mary. « French Baroque Partbooks in the Uppsala University Library », Canadian Association of University Schools of Music Journal, 9/1, 1979, p. 29-47. Theiner, Augustin. Geschichte der Zurückkehr der regierenden Häuser von Braunschweig und Sachsen in den Schoss der Katholischen Kirche im achtzehnten Jahrhundert, und der Wiederherstellung der Katholischen Religion in diesen Staaten, Einsiedeln : Benziger, 1843. Thoinan, Ernest. Les Hotteterre et les Chédeville, célèbres joueurs et facteurs de flûtes, hautbois, bassons et musettes des et siècles, Paris : Sagot, 1894. Thomasius, Christian. « Diskurs von der Nachahmung der Franzosen » [1687], in : Kleine Teutsche Schriften, Hildesheim : Olms, 1994, p. 3-69. Thomsen-Fürst, Rüdiger. Gitarrentabulatur der Herzogin Christine Luise (1671-1747), Michaelstein : Eitelfriedrich Thom, 1993. ––––– « The Court of Baden-Durlach in Karlsruhe », in : Music at German Courts, 1715-1760. Changing Artistic Priorities, dir. Samantha Owens, Barbara M. Reul et Janice B. Stockigt, Woodbridge : The Boydell Press, 2011, p. 365-387. Tiersot, Julien. « Une famille de musiciens français au xviie siècle : les de La Barre », Revue de Musicologie, 9/25, 1928, p. 1-11. Timms, Colin. Polymath of the Baroque. Agostino Steffani and His Music, Oxford : Oxford University Press, 2003. ––––– « Music and Musicians in the Letters of Giuseppe Riva to Agostino Steffani (17201727) », Music and Letters, 79/1, 1998, p. 27-49. Tosi, Pietro Francesco. Observations on the Florid Song or, sentiments on the Ancient and Modern Singers, trad. Johann Ernst Galliard, Londres : Wilcox, 1743. Tournier, Michel. Le Bonheur en Allemagne ?, Paris : Gallimard, 2004. Traversier, Mélanie. « Histoire sociale et musicologie : un tournant historiographique », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 57/2, 2010, p. 190-201. –––––– « Costruire la fama musicale. La diplomazia napoletana al servizio della musica durante il regno di Carlo di Borbone », in : Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (16501750). Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples (1650-1750), dir. Anne-Madeleine Goulet et Gesa zur Nieden, Kassel : Bärenreiter, 2015, p. 171-189. ––––– « Like a Rolling Musician », Diasporas. Circulations, migrations, histoire, 26, 2015, p. 9-15. Vallas, Léon. Un siècle de musique et de théâtre à Lyon (1688-1789), Lyon : Masson, 1932. Viala, Alain. La France galante. Essai historique sur une catégorie culturelle, de ses origines jusqu’à la Révolution, Paris : Presses Universitaires de France, 2008. Voltaire, François-Marie Arouet. Siècle de Louis XIV, vol. 3, éd. Diego Venturino, in : Les Œuvres complètes de Voltaire, vol. 13a, Oxford : Oxford University Press, 2015. Vorkamp, Gerhard. « Das französische Hoftheater in Hannover (1668-1758) », Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 29, 1957, p. 121-185. Waczkat, Andreas. « ‘Les Violons du Duc’. Französische Musiker an mecklenburgischen Höfen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts », Jahrbuch der Ständigen Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, 4, 2004, p. 252-263. Walther, Johann Gottfried. Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec, Leipzig : Wolffgang Deer, 1732. Warnecke, Berthold. Kaspar Förster der Jüngere (1616-1674) und die europäische Stilvielfalt im 17. Jahrhundert, Schneverdingen : Wagner, 2004. Weber, William. « La musique ancienne in the Waning of the Ancien Régime », The Journal of Modern History, 56/1, 1984, p. 58-88.
– 335 –
Bibliographie
Werner, Michael. « Les usages de l’échelle dans la recherche sur les transferts culturels », Cahiers d’études germaniques, 28, 1995, p. 39-53. Werner, Michael et Bénédicte Zimmermann. « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 58/1, 2003, p. 7-36. Williams, Peter. Bach. A Musical Biography, Cambridge : Cambridge University Press 2016. Woitas, Monika. « Getantze Träume. Händel, Marie Sallé und die Verzauberung der Oper », Göttinger Händel-Beiträge, 14, 2012, p. 95-103. Woker, Franz Wilhelm. Geschichte der katholischen Kirche und Gemeinde in Hannover und Celle. Ein weiterer Beitrag zur Kirchengeschichte Norddeutschlands nach der Reformation, Münster : Ferdinand Schöningh, 1889. Wolff, Christoph. Johann Sebastian Bach. The Learned Musician, New York : Norton, 2000. Wolff, Hellmuth Christian. Die Barockoper in Hamburg (1678-1738), Wolfenbüttel : Möseler, 1957. Wollny, Peter. « Zwischen Hamburg, Gottorf und Wolfenbüttel : neue Ermittlungen zur Entstehung der ‘Sammlung Bokemeyer’ », Schütz-Jahrbuch, 20, 1998, p. 59-76. ––––– « Anmerkungen zu einigen Berliner Kopisten im Umkreis der Amalien-Bibliothek », Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, 1998, p. 143162. ––––– « Einführung », in : Johann Sebastian Bach, Nun komm, der Heiden Heiland. Kantate zum 1. Adventssonntag BWV 61, fac-similé, Laaber : Laaber Verlag, 2000. ––––– « Zur Thüringer Rezeption des französischen Stils im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert », Jahrbuch der Ständigen Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, 3, 2001, p. 140-152. ––––– « Zur Rezeption französischer Cembalo-Musik im Hause Bach in den 1730er Jahren : zwei neu aufgefundene Quellen », in : In Organo Pleno. Festschrift für Jean-Claude Zehnder zum 65. Geburtstag, dir. Luigi Collarile et Alexandra Nigito, Berne : Peter Lang, 2007, p. 265-276. Worp, Jacob Adolf. De Gedichten van Constantijn Huygens, vol. 4, Groningen : Wolters, 1894. ––––– De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 4, Gravenhage : Nijhoff, 1915. ––––– De Briefwisseling van Constantijn Huygens, vol. 5, Gravenhage : Nijhoff, 1916. Zappula, Robert. Figured Bass Accompaniment in France, Turnhout : Brepols, 2000. Zech, Heike Juliane. Kaskaden in der deutschten Gartenkunst des 18. Jahrhunderts. Vom architektonischen Brunnen zum naturimitierenden Wasserfall, Vienne : LIT Verlag, 2010. Ziekursch, Johannes. « August der Starke und die katholische Kirche in den Jahren 1697-1720 », Zeitschrift für Kirchengeschichte, 24, 1903, p. 86-135. Zietz, Hermann. Quellenkritische Untersuchungen an den Bach-Handschriften P 801, P 802 und P 803 aus dem « Krebs’schen Nachlass » unter besonderer Berücksichtigung der Choralbearbeitungen des jungen J. S. Bach, Hambourg : Wagner, 1969. Zobeley, Fritz. Die Musikalien der Grafen von Schönborn-Wiesentheid, vol. 1, Tutzing : Hans Schneider, 1967. ––––– Die Musikalien der Grafen von Schönborn-Wiesentheid, vol. 2, Tutzing : Hans Schneider, 1982. Zohn, Steven. Music for a Mixed Taste. Style, Genre and Meaning in Telemann’s Instrumental Works, Oxford : Oxford University Press, 2008. ––––– « Music Paper at the Dresden Court and the Chronology of Telemann’s Instrumental Music », in : Puzzle in Paper - Concept in Historical Watermark. Essays from the International Conference on the History, Function and Study of Watermarks, dir. Daniel Wayne Mosser, Michael Saffle et Ernest W. Sullivan, Londres : Roanoke, 2000, p. 125-168. Żórawska-Witkowska, Alina. « The Saxon Court of the Kingdom of Poland », in : Music at German Courts, 1715-1760. Changing Artistic Priorities, dir. Samantha Owens, Barbara M. Reul et Janice B. Stockigt, Woodbridge : The Boydell Press, 2011, p. 51-77. ––––– Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Varsovie : Königsschloss, 1997.
– 336 –
Index nominum •
Abel, Clamor Heinrich : 89, 111 Abel, N. (chanteur) : 156 Agrell, Sven : 31 Agricola, Johann Friedrich : 209, 212-215, 247, 256, 304305 Ahrendt, Rebekah : 16 Albertyn, Erik : 227 Albinoni, Tomaso : 285 Alleurs, Pierre Puchot, marquis des : 31-32 André, Catherine : 140, 159 André, Louis : 82, 95, 103, 132, 140, 145, 159, 174, 176, 192, 195 d’Anglebert, Jean-Henry : 208-209, 214, 243, 278-279 Anhalt-Köthen, Leopold von : 29 Anne, reine de Grande-Bretagne : 68 Anne d’Autriche, reine de France : 22 Anschütz, Christoph Friedrich : 248 Antonio, N. (chanteur) : 87 d’Arcy, René Martel marquis : 78, 152 d’Ardespin, Melchior : 216-217, 223 d’Arenberg, Léopold Philippe : 66 d’Arezzo, Guido : 284 Arighini, Giuseppe : 40 Ariosti, Attilio : 67 Ashbee, Andrew : 162 Aubry, Cuny : 25 Aufschnaiter, Benedikt Anton : 258 Auger, Anthoine : 178 August II, prince électeur de Saxe et roi de Pologne : 14, 30, 36-39, 42-44, 49-50, 52, 58, 64, 76, 80-82, 93-99, 106, 108-109, 122-133, 141, 147, 153, 156-157, 172, 174-175, 186-188, 204, 206, 216, 307 August III, prince électeur de Saxe et roi de Pologne : 3033, 35-36, 47, 95, 122-133, 147, 157, 162, 181, 264, 307 Auguste le Fort : voir August II d’Autriche, Marie Josèphe : 95, 130 Aveline, Antoine : 95 Babel, Charles : 44-45, 61, 67, 179, 186, 215, 226-227, 229, 253 Babel, William: 61, 67 Bach, Anna Magdalena : 208 Bach, Carl Philipp Emanuel : 31, 63-64, 256, 265, 300 Bach, Johann Jacob : 31 Bach, Johann Lorenz : 262 Bach, Johann Michael : 285
Bach, Johann Sebastian : 8, 15, 17, 29, 31, 36, 122, 160, 175, 193, 199, 208-210, 212, 214, 246-247, 256, 261-273, 279, 287-288, 291, 300-303 Bach, Johann Sebastian le Jeune : 64-65 Bacilly, Bertrand Bénigne de : 300 Ballati, N. : 117 Ballard, Christophe : 193, 200-205, 242, 292 Ballard, Jean Baptiste Christophe : 159, 195, 198, 200 Baptiste, Jean : 28, 161, 291 Baron, N. (chanteur) : 29 Barré, Guillaume : 45, 101, 179, 186, 226-227 Bataille, Gabriel : 244 Bauer, Volker : 71 Bavarini, Lucia Gaggi dite la : 122 Bayern, Maximilian II Emanuel von, prince électeur de Bavière : 31, 81, 248 Bayern, Joseph Clemens von, évêque et prince électeur de Cologne : 32, 42, 165 Beaulieu, Antoine de : 25, 157 Beaumont, Philippe Le Roy de : 25 Beauregard, François Adam : 29, 32, 67, 116, 165, 179 Beauregard, François Godefroy : 32, 67, 132, 145, 165, 172, 180, 195 Beaurepaire, Pierre-Yves : 72 Beauvallet, Jeanne : 178 Béchon, N. (musicien) : 25, 157 Beer, Johann : 146, 171 Behr, Samuel : 146 Beichlingen, Wolf Dietrich von : 52 Beißwenger, Kirsten : 210 Belleroche, Charles : 187 Bély, Lucien : 62 Bence, Pascal : 27, 152 Benserade, Isaac de : 275-276 Bernhard, Christoph : 99 Bernier, Nicolas : 200-201 Berselli, Matteo : 122, 131-132 Bertali, Antonio : 274 Berthet, N. (compositeur) : 242 Bertrand, N. (musicien) : 111, 152 Besson, N. (musicien) : 27 Beudan, Jacques : 107 Biffi, Antonino : 262 Bigot, Nicolas : 25 Biotteau, François : 105, 132, 160 Birkenstock, Johann Adam : 182
– 337 –
Index nominum
Birnbaum, Johann Abraham : 301-303, 305 Bisaro, Xavier : 16 Blaeu, frères : 194, 253 Bleyer, Georg : 249 Bloch, Marc : 9 Blondel, Jean-François : 167 Bohse, August : 299 Böhm, Georg : 256 Böger, Richard : 105 Boileau, Nicolas : 87, 290 Boiselier, N. de (administrateur) : 116 Boivin, François : 202 Bokemeyer, Heinrich : 230-231 Bonadei, Pietro Agostino : 101 Boncourt, Jean Hillaret sieur de : 84, 120, 153 Bonin, Louis : 267, 299 Bonnac, Jean-Louis d’Usson, marquis de : 35, 78 Bonne, Anne Sophie : 145, 180 Bononcini, Antonio : 67, 299 Bononcini, Giovanni : 67, 255 Bordoni, Faustina : 63, 132 Borsani, Lucrezio : 130 Boschi, Carlo : 131 Bose, Carl Gottfried von : 184 Boste, N. (compositeur) : 216, 223 Boucœur, Jacques de Rozemont sieur de : 34, 78 Boufflers, Louis François de : 66 Bouhours, Dominique : 87, 142 Bourdaloue, Louis : 162 Bourdonné, Gillette : 140 Bourgeauville, Monsieur de : 78 Bourgeois, Thomas Louis : 181, 200 Boyvin, Jacques : 208-209, 211-212, 214 Brandenburg, Friedrich August von : 45 Brandenburg, Friedrich Wilhelm de, prince électeur de Brandebourg, dit Le Grand Électeur : 29 Brandenburg, Luise Dorothea Sophie von : 66 Brandenburg, Friedrich August von : 226 Brandenburg-Ansbach, Dorothea Charlotte von : 57 Brandenburg-Ansbach, Johann Friedrich von : 57, 248 Braunschweig-Lüneburg, Christian Ludwig von : 76, 99, 101 Braunschweig-Lüneburg, Ernst August von, évêque d’Osnabrück puis duc de Hanovre : 15, 28, 34, 4042, 76-79, 83-93, 101, 110-111, 119-120, 139, 170-171, 225, 243 Braunschweig-Lüneburg, Georg von : 76-77 Braunschweig-Lüneburg, Georg Wilhelm von, duc de Celle : 17, 34, 40-42, 50, 68, 76-79, 83-84, 93, 101, 153, 157, 170 Braunschweig-Lüneburg, Johann Friedrich von, duc de Hanovre : 30, 40-42, 76-79, 85, 87-90, 99, 109-110, 120, 152, 164, 170, 243 Braunschweig-Lüneburg, Sophie Dorothea von : 84 Braunschweig-Lüneburg, Wilhelmine Amalie von : 243 Braunschweig-Wolfenbüttel, Anton Ulrich von, duc de Wolfenbüttel : 119, 164, 170, 234, 243 Braunschweig-Wolfenbüttel, August von, duc de Wolfenbüttel : 244 Braunschweig-Wolfenbüttel, August Wilhelm von, duc de Wolfenbüttel : 234-235
Braunscheig-Wolfenbüttel, Elisabeth Juliane von : 234 Braunschweig-Wolfenbüttel, Ferdinand Albrecht von : 243 Braunschweig-Wolfenbüttel, Ludwig Rudolf von, duc de Wolfenbüttel : 35, 234-242, 244 Bressan, Peter : 162 Briegel, Wolfgang Carl : 58 Brossard, Sébastien de : 166, 195 Brosseau, Christophe : 117, 148 Brühl, Heinrich von : 81-82, 195 Bruhns, Nicolaus : 208 Brunet, N. (chanteuse) : 180 Bruslard, Louis : 25 Buccow, Lucas von : 152 Buffardin, Pierre Gabriel : 31, 63-65, 68, 159, 161-163, 183, 270 Burney, Charles : 69-70 Buttstett, Johann Heinrich : 246, 284-285 Buxtehude, Dieterich : 208 Byrd, William : 69 Caillard, Claude : 58 Caillat, Guillaume : 153 Caldara, Antonio : 299 Calegari, Anna Martha : 122 Calvière, Guillaume Antoine : 304 Cambefort, Jean de : 275-276 Cambert, Robert : 143 Cambert, Marie-Anne : 143 Cammerstein, N. von (administrateur) : 116 Campistron, Jean Galbert de : 20 Campra, André : 19-20, 181, 195, 198, 201-203, 216-217, 223, 231, 235, 242, 252, 254, 289-290, 293, 296-297 Carissimi, Giacomo : 274 Cast, Johann Wilhelm : 232, 261 Caulier, Daniel : 84 Cavalli, Francesco : 140 Chabanceau de La Barre, Anne : 21-26, 28, 61, 170 Chabanceau de La Barre, Joseph : 21-26 Chabanceau de La Barre, Pierre : 22-23 Chabaron, François : 139 Chambonnières, Jacques Champion de : 22, 24, 143, 166, 243 Chanut, Pierre : 24 Chappuzeau, Samuel : 17-21, 34, 42, 85, 104, 147, 151, 167, 170, 222 Charbonnier, Martin : 119 Charles II, roi d’Angleterre : 68, 143 Charles X, roi de Suède : 26, 157 Charles XII, roi de Suède : 26, 31, 94 Charpentier, Marc-Antoine : 254, 274-275 Charpentier, Marie-Thérèse : 56 Chartier, Roger : 16 Chatellier, Joachim de : 143 Chauveau, Nicolas : 29, 160 Chauvet, Jeremias : 78 Cherrier, N. (danseur) : 33 Chmielensky, Jean : 162 Christian IV, roi de Danemark : 26-27 Christian V, roi de Danemark : 58 Christine, reine de Suède : 21-27, 157
– 338 –
Index nominum
Chrysander, Friedrich : 176 Chung, David : 208 Châteauneuf : voir Pâtissier de Châteauneuf Cicéron : 261 Clavel, fille (danseuse) : 132 Clavel, mère (chanteuse) : 180 Clavel, père (comédien) : 157 Clément, N. (musicien) : 27-28 Clément, Marianne : 33, 199 Clérambault, Louis Nicolas : 200 Clermondt, N. (musicien) : 149 Cliquot, Robert : 215 Coligny, Louis de : 23 Collasse, Pascal : 198, 216-217, 222, 243, 254 Constantin : voir Costantini, Angelo Conti, François Louis Bourbon, prince de : 81 Corbett, William : 61 Corelli, Arcangelo : 119, 275 Cornaz, Marie : 66 Corneille, Pierre : 84, 170 Corrette, Gaspard : 211-212, 214 Cossaque, N. (compositeur) : 216-217 Costantini, Angelo : 47, 49-56, 102, 120 Costantini, Constantino : 49 Couperin, François : 199, 208, 212, 265, 278-280 Courbesastre, Charles de : 139 Courbesastre, Marie de : 139 Courbesastre, Philippe de : 84, 139, 152, 159, 164, 179 Cousser, Johann Sigismund : 15, 58, 102, 146, 171, 232, 248-250, 254-255, 258-260, 274 Creholet, Pierre : 165 Créquy, François de : 76 Croissy, Charles François Colbert, marquis de : 34 Cronström, Daniel : 52, 157 Cusance, Beatrix de, duchesse de Lorraine : 23-24 Dacier, Anne : 19 Dahuron, René : 119 Danchet, Antoine : 181 Danemark, George : 68 Daniel, N. (danseur) : 25 Danielis, Daniel : 29, 100, 155, 160-161, 186 Dannilliers, N. (comédien) : 62 Daquin, Louis Claude : 304 Debargues, Charles : 33, 39, 82, 103, 130 Dedekind, Constantin Christian : 175 Delang, Kerstin : 198 Delerablée, François : 81 Delvaux, Nicolas : 60-61, 109, 179 Demouchy, Nicolas : 181 des Brosses, N. (danseur) : 84 des Forges, N. (danseuse) : 291 des Hays, Henri : 152, 159-160, 182 des Vignes, René : 17, 139, 150-152 Descamp, N. (danseur) : 291 Descartes, René : 22, 87-88 Deseschaliers, Catherine : 52-56, 62, 142, 291 Deseschaliers, Louis : 52-56, 62, 66, 108, 141-142, 148, 187, 291 Deseschaliers, Pierre : 62
Desmarest, Henri : 289-293, 295, 298 Desmier d’Olbreuse, Éléonore : 17, 76-79, 83-84, 91, 93, 110, 147, 151, 153, 170 Desnoyers, Antoine : 153 Desnoyers, François : 28, 60, 66 Desnoyers, Georges : 35-36, 61 Destouches, André Cardinal : 181, 195, 198, 216-217, 223, 242 Detrez, N. (comédienne) : 157 Deux-Points Cleebourg, Éléonore Catherine de : 157 Diard, N. (chanteuse) : 56 Diard, Pierre : 56, 102, 180 Diesel, Thomas : 119 Dieupart, Charles : 208-209, 216-217, 225 Dimanche, Louise : 47, 132, 180-181, 290 Dompnier, Bernard : 11 Drauschke, Hansjörg : 240 Drese, Johann Samuel : 175 Dreyfus, Laurence : 16, 247, 261 Drot, Jean David : 33, 189 du Bois, N. (danseur) : 60 du Bros, N. (danseur) : 60 du Cormier, N. (machiniste) : 45 du Hautlondel, Anne Henriette : 47-49, 64-66 du Hautlondel, Jean Baptiste Joseph dit La France le fils : 46-49, 106, 132, 219 du Hautlondel, Jeanne Sophie : 47 du Hautlondel, Marie Gabrielle : 48 du Hautlondel, Robert dit La France le père : 46-49, 103, 219 du Héron, N. (diplomate) : 78 du Mage, Pierre : 302 du Masis, N. (musicienne) : 132, 180 du Matin, N. (musicien) : 117 du Mont, Henry : 22, 29, 202, 204 du Rocher, N. (comédien) : 162 du Verger, Thomas Mathieu dit : 178 du Vivier, Pierre : 152, 164 Dubreuil, Michel : 105, 182 Dubuisson, N. (chanteuse) : 291 Ducé, Jean-Baptiste : 39, 102 Duché de Vancy, Joseph François : 295 Duclos, N. (comédienne) : 158 Dudard, Catherine : voir Deseschaliers, Catherine Duden, Christian : 38 Duden, Johann Caspar : 38 Dufour, Marguerite : 195 Duindam, Jeroen : 72 Dulondel, N. (comédien) : 47, 66 Dumanoir, Guillaume : 142 Dumont, N. (chanteur) : 58 Dupont, Guillaume : 62 Durastanti, Margherita : 131 Dürr, Alfred : 212 Dusmeniel, Charles : 97 Duval, François : 183 Edler, Florian : 275 Elias, Norbert : 72 Ennuyé, Antoine : 100
– 339 –
Index nominum
Fuzelier, N. (diplomate) : 34
Ennuyé, Charles : 100 Ennuyé, Georges Louis : 101 Ennuyé, Marie : 101 Erlebach, Philipp Heinrich : 252, 256-257, 285 Espagne, Michel : 9, 80 d’Este, Luigi : 152 d’Estrades, Godefroi : 78 Failly, Marie : 138 Falaiseau, Pierre de : 149, 152 Farinel, Jean-Baptiste : 35, 45, 68, 84, 89, 92-93, 110-111, 120-122, 145, 170, 172, 175-176, 183-185, 221, 225, 255 Farinel, Michel : 92-93, 143, 145, 176 Farinel, Robert : 176 Farinelli, Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, dit : 121 Farinet, N. (musicien) : 58 Faucart, Jacques : 26 Favier, Bernard Henri : 140 Favier, Jacques : 139-140, 145, 150 Favier, Jean I : 139-140 Favier, Jean II : 139-140 Favier, Jean III : 82, 140-141 Favier, Jean-Jacques : 17, 60, 84, 139-140, 143, 145-146, 152, 158, 162, 243 Favier, Jehan : 139-140 Favier, Thierry : 16 Fedeli, Ruggiero : 67, 182, 228, 242 Fénelon, François : 19 Fischer, Johann : 248 Flavius Joseph : 239-240 Flemming, Jacob Heinrich von : 81, 156, 162, 177 Flemming, Hans Friedrich von : 177, 179 Floridor, Josias de Soulas dit : 84, 105 Fonpré, Jean Barrié dit : 43, 62 Fontenelle, Bernard le Bovier de : 19 Forkel, Johann Nikolaus : 8, 31, 230 Forlot, Étienne : 84, 152, 179 Forstmeyer, Franz : 38 Förster, Christian : 307 Förster, Kaspar : 27-28 Foucault, Henry : 200-201, 211 Franchin, Matthieu : 166 Francine, François de : 140 Francine, Jean Nicolas de : 54 Fransen, Jan : 55 France, Christine de, duchesse de Savoie : 176 Frederik III, roi de Danemark : 26-27 Fri, Louis de : 165 Friedrich I, prince électeur de Brandebour et roi de Prusse : 29, 39, 81, 82, 84 Friedrich II, prince électeur de Brandebourg et roi de Prusse, dit Frédéric Le Grand : 71 Friedrich Wilhelm I, prince électeur de Brandebourg et roi de Prusse, dit le Roi Soldat : 63, 183 Fuchs, Max : 47 Fumaroli, Marc : 72 Fürstenau, Moritz : 55 Fux, Johann Joseph : 38, 194, 216, 253, 261, 282
Galliard, Johann Ernst : 61, 67-70, 152, 183, 255 Gallois, Louis : 62 Garset, Pierre : 25 Gasparini, Francesco : 299 Gaudon, Charles : 151 Gaudon, Louis : 84, 139, 151, 165-166, 174 Gault, Gabriel : 92 Gaultier, Pierre de : 106, 132, 153-154, 156-157, 186 George Ier, roi de Grande-Bretagne : 76, 84, 92, 176, 184, 228 George II, roi de Grande-Bretagne : 228 Gerard, N. (musicien) : 249 Gersdorf, Abraham Wolfgang von : 43, 149 Gérard, Bernard : 29 Gilbert, Gabriel : 84 Gillier, Jean-Claude : 255 Gobert, Thomas : 22 Goethe, Johann Wolfgang von : 8, 289 Goezel, N. (musicien) : 63 Göhler, Albert : 211 Gonzague, Anne de : 76 Goulet, Anne-Madeleine : 10 Gourville, Jean Hérault de : 34, 77-78, 93 Gouy, Jacques de : 22 Grabe, Christian : 155-156 Graep, Bernard : 101 Graep, Jean-François : 101, 152 Grassi, Florio : 63, 159 Graun, Carl Heinrich : 302, 309 Graupner, Christoph : 45 Gresle, Ferdinand : 109 Gresle, Johann Wolfgang : 108 Gresle, Tobias : 108 Gridé, N. (copiste) : 117 Griffon, Nicolas : 140 Grigny, Nicolas de : 208-211, 264, 302 Grimm, Ernst Heinrich : 101, 178 Grossi, Carlo : 260 Grot, Baptiste de : 58 Grundig, Johann Gottfried : 199 Guarnier, Charles : 28 Guénin, Jacques : 188-190, 199, 201 Guerin, Jacques : 107 Guerin, Jean-Baptiste : 107 Guicciardi, Francesco : 122 Guignon, Jean-Pierre : 199, 217 Guilain, Jean-Adam : 212, 214-215 Guillaume II, roi d’Angleterre : 66 Guillaume III d’Orange-Nassau, roi d’Angleterre : 43, 46, 170-171, 229 Guilleroy, Pierre : 25-26 Gustafson, Bruce : 208 Haesler, Otto : 120 Hahn, Hermann Joachim : 153 Händel, Georg Friedrich : 60-61, 69, 102, 121, 131, 255, 280-282, 291, 293-294, 299-300 Hagen, Wilhelm von : 265
– 340 –
Index nominum
Hannover, Ernst August von : voir BraunschweigLüneburg, Ernst August von Hannover, Friedrich Ludwig von : 35-36 Hannover, Sophie von : 14-15, 40-42, 76, 84-93, 109-110, 139, 170 Harrer, Gottlob : 81 Harson, Johann Samuel : 209, 214 Hasse, Johann Adolph : 60, 63, 132, 302 Haumale des Essarts, N. (musicien) : 175, 200 Hawkins, John : 68-69 Hazard, Paul : 17 Hebenstreit, Pantaleon : 175, 267 Heinemann, Michael : 16 Heinichen, Johann David : 30, 95-97, 106, 122-127, 174, 216 Hennig, Tobias : 108 Henrichant, Pierre André : 44 Henrion, Charles : 108, 149 Henrion, Jean-Baptiste : 108, 179 Héroux, Georges : 153 Héroux, Gilles : 153, 178-179, 226 Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig von : 57-58 Hessen-Eschweg, Frederik von : 157 Hessen-Kassel, Friedrich von : 66 Hessen-Kassel, Wilhelm von : 28 Hiller, Johann Adam : 131 Hoffmann, Peter : 33, 123-126 Hofmannswaldau, Christian Hoffmann von : 299 Holwein, Andreas : 119 Horn, Wolfgang : 204 Houdar de la Motte, Antoine : 19-20, 181 Houte, Leonhard von der : 29, 160 Huaut, Nicolas : 47 d’Humières, Louis Crevant duc : 176 Hunold, Christian Friedrich : 299 Huygens, Constantijn : 21-24, 166 Huygens, Constantijn le jeune : 170 Israel, Jonathan : 73 Jacques II, roi d’Angleterre : 66 Jemme, Élie : 34, 67, 85, 89-93, 139, 149, 158, 175, 180 Jemme, Elizabeth : 92 Jemme, Ernst August : 67, 243 Jemme, Georg Ludwig : 102 Jemme, Michael : 180 Jordan, Karl Gustav von : 55 Joseph Ier de Habsbourg, empereur : 235, 243 Josse, Guillaume : 17, 84, 150-152, 181 Jourdain, N. (musicien) : 29 Junge, Hans : 264 Jungius, Christiane : 272 Kant, Immanuel : 10, 304 Keiser, Reinhard : 242, 254, 291, 297, 299-300 Kellner, sœurs : 58 Kempis, Thomas a : 260 Kerll, Johann Caspar : 214 Keßelhutt, Christoph : 150 Kirnberger, Johann : 214
Kobayashi, Yoshitake : 209 Kohlhase, Thomas : 209 Konink, Servaas von der : voir Le Roy, Servais Korb, Hermann : 119 Kos, Jozef : 32, 123, 130, 265 Kräuter, David : 193-194 Kremberg Jakob : 58 Krieger, Johann Philipp : 228-229 Krüger, Ekkehard : 194 Kunzen, Johann Paul : 246, 289-291, 293, 296 Kümmerling, Harald : 231 La Barre : voir Chabanceau de La Barre La Croix, N. (musicien) : 111, 152 La Croix, Adrien de : 25 La Croix, François de : 25 La Fleur, Anne Éléonore : 159 La Fontaine, Pierre : 149 La Gardie, Magnus de : 23, 25 La Garenne, N. (musicien) : 116, 179, 183 La Lande, N. de (musicien) : 117 La Rivière, Achille Languillet dit : 84 La Rivière, Anne Godelet dite : 153 La Rose, N. (musicien): 249 La Selle, Charles de : 158 La Selle, Thomas de : 17, 27, 139, 143, 151-152, 165, 182, 256 La Touche, Charles Henri de : 156 La Vigne, Anthoine Martin dit : 138 La Vigne, Georges : 153, 165 La Vigne, Marie-Madeleine : 165 La Vigne, Philippe le jeune : 60 La Vigne, Philippe Martin dit : 17, 60, 84, 115-116, 138, 143, 150, 152-153, 158, 165, 174, 185 Labuissière, N. (musicien) : 29 Laforest, N. (administrateur) : 150-151 Lalande, Michel Richard de : 171, 202, 231-233, 260 Lamberg, Philipp von : 119 Lambert, Michel : 145 Landmann, Ortrun : 205 Lapierre, Guillaume : 150, 158 Laprairie, N. (musicien) : 249 Lauterbach, Johann Balthasar : 119 Le Borgne, Joseph : 180 Le Borgne, Paul Joseph : 180 Le Borgne, Pauline : 104, 106, 172, 180 Le Cerf de La Viéville, Jean Laurent : 258 Le Clerc, Charles Nicolas : 201 Le Conte le fils (musicien) : 102 Le Conte le père (musicien) : 102 Le Conte, Louis : 84, 105, 111, 181 Le Conte, N. (danseuse) : 102 Le Couvreur, Adrienne : 142 Le Gros, Jean : 141 Le Gros, Pierre l’aîné : 141 Le Gros, Pierre le jeune : 141 Le Gros, Simon : 102, 141, 172 Le Riche, François : 66-67, 95, 156, 162, 172, 184 Le Roy, Servais : 29, 100, 160-161 Le Sage, Louis : 47 Le Tellier, Charles Maurice : 145
– 341 –
Index nominum
Le Tourneur, Denis : 115, 118, 139-140, 143, 152, 158, 179, 183 Le Tourneur, Henri : 118, 140 Lebègue, Nicolas : 212-214, 278 Leclair, Jean-Marie : 199, 304 Lefebvre, N. (libraire) : 212 Lehmann, Christian : 37-38, 156 Lehneis, Mathias : 183 Leibniz, Gottfried Wilhelm : 86-87, 117, 120, 148, 170 Lemaigre-Gaffier, Pauline : 73 Leplat, Raymond : 80, 95-96 Lescat, Philippe : 215 Leszcynski, Stanislas : 94, 141 Letellier, Marie : 32, 165 Lévi-Strauss, Claude : 100 Linage, Philippe : 138 Lilti, Antoine : 57 Lindner, Johann Jacob : 216 Liszt, Franz : 57 Loeillet, Jean-Baptiste : 62 Loen, Johann Michael von : 299 Loges, Jacques de : 27-28, 153 Loges, Marie de : 153 Longuelune, Zacharias : 80 Lorenzani, Paolo : 202 Lorraine-Vaudémont, Charles Henri de : 60 Loss, Johann Adolph von : 35-36 Lotti, Antonio : 30, 122-126, 131, 216, 299 Lotti, Friedrich : 101 Louis XIII, roi de France : 22 Louis XIV, roi de France : 20, 26, 62, 71, 76-79, 88, 93, 140, 143, 204, 206 Louis XV, roi de France : 203 Louvat-Mozolay, Bénédicte : 166 Louvois, François Michel Le Tellier, marquis de : 33 Lübeck, N. (musicien) : 150 Luccini, N. (poète) : 122 Lully, Jean-Baptiste : 19-20, 57-59, 81, 143, 158, 171-172, 187, 191, 194-195, 198, 202-206, 216-217, 222-223, 235, 242, 252-254, 258, 277-279, 289, 294, 298-300, 307 Lully, Louis : 198, 217, 222 Lusse, Charles de : 64 Luther, Martin : 93, 285 Luynes, Charles d’Albert, duc de : 63 Léger, Johann Bourcard : 186 Mahaut, Antoine : 64 Maillard, Jean : 152, 159 Maillard, N. (musicien) : 58 Maintenon, Françoise d’Aubigné, marquise de : 71 Manteuffel, Ernst Christoph von : 81 Marais, Marin : 31, 198, 216-217, 222, 254 Marchand, Louis : 8, 36, 122, 212, 270, 279, 287-288 Maréchal, Pierre : 106, 158, 178-179, 183 Marianne, N. (musicienne) : 35, 180 Markovits, Rahul : 11, 16, 21, 40, 72, 141, 144 Marpurg, Friedrich Wilhelm : 183, 209, 214, 247, 288, 300, 304-305 Maruccini, Margherita Catterina Zani dite la : 122 Marcello, Benedetto : 299
Marx, Hans Joachim : 60 Massillon, Jean-Baptiste : 162 Masson, Charles : 255, 274 Mattheson, Johann : 59, 81, 121, 218, 221, 245-246, 257, 262, 282-287, 290-291, 293, 295 Maupoint, N. (écrivain) : 50 Mauro, Alessandro : 47 Mauro, Ortensio : 120 Mayer, Johann Andreas : 221 Mazuel, Jean : 140 Mecklenburg, Christian Louis I von, duc de Schwerin : 28, 75 Mecklenburg, Gustav Adolph von, duc de Güstrow : 28, 75 Mecklenburg-Gottorf, Christian Albrecht : 230 Médicis, Ferdinand de : 61, 121 Mersenne, Marin : 22-23 Meyer, Clemens : 28 Mézétin : voir Costantini, Angelo Michel, Antoine : 33 Middendorf, Joachim : 239 Mignier, Jean : 152, 159-160 Miltlitz, Carl Borromäus von : 205 Milton, John : 69 Molière, Jean-Baptiste Poquelin dit : 93, 142, 143, 167, 294 Monari, Clemente : 100 Mondonville, Jean Joseph Cassanéa de : 304 Monjou, Jean-François : 270, 290-291 Monjou, sœurs : 290-291 Montfleury, Antoine Jacob de : 290, 297 Montmorency, Elisabeth Angélique de : 75 Mordaxt, Johann Sigismund von : 104, 106, 132, 179 Morelle, N. (danseur) : 291 Morin, Jean-Baptiste : 200 Mortier, Pierre : 195 Mouret, Jean Joseph : 198, 216-217, 223 Moureval, Philippe : 28 Muffat, Georg : 119, 218, 221-222, 250-251, 256, 258 Mutant, Antoine : 107 Nanon, N. (chanteuse) : 87, 149, 152, 180 Nanteuil, N. (comédien) : 118 Nemeitz, Joachim Christoph : 30, 137, 142 Neumeister, Erdmann : 262, 265, 273 Nicolai, Johann Nicolaus : 200 Nivers, Guillaume Gabriel : 211, 255 Nolhac, Denis : 60 Nordlin, Tobias : 26 Oettingen, Christine Luise von : 234, 243 Oettingen-Wallenstein, Kraft Ernst : 195 d’Orange, Amalie : 23 d’Orange, Friedrich Heinrich : 23 d’Orléans, Anne Marie Louise, dite Mademoiselle : 37 d’Orléans, Elisabeth Charlotte dite Liselotte von der Pfalz duchesse, dite Madame Palatine : 34, 37, 86, 90-93, 203 d’Orléans, Henriette d’Angleterre duchesse, dite Madame : 37, 92 d’Orléans, Marguerite de Lorraine duchesse, dite Madame : 37
– 342 –
Index nominum
d’Orléans, Philippe II duc, dit Monsieur : 89, 91, 93 Österreich, Georg : 58, 230-234, 260 Owens, Samantha : 255 Oxenstiern, Erik Axelsson : 27 Pachelbel, Johann : 284-285 Paganelli, Giuseppe Antonio : 304 Paisible, James : 61 Pallavicini, Stefano : 130, 219 Parfaict, frères : 47 Pâtissier de Châteauneuf, Marie Charlotte : 105, 165 Pâtissier de Châteauneuf, Antoinette Bénédicte : 45, 153 Pâtissier de Châteauneuf, Auguste Pierre : 42, 45, 47, 84, 93 Pavie, Gabrielle : 68 Pécour, Claude : 17, 84, 116, 18, 139, 151, 158-159, 165, 181182 Pécour, Guillaume Louis : 138 Pécour, Louis Alexandre : 138 Pécour, Louise Madeleine : 138, 152 Pécour, Louis : 138, 140 Pegah, Rashid Sascha : 31, 235 Pellegrin, Simon Joseph : 307-308 Pepusch, Johann Christoph : 69 Pepusch, Heinrich Gottfried : 37, 155, 178 Perrin, Pierre : 143 Personelli, Geramolo : 122 Peruzzi, Antonio Maria : 47-49, 64-66 Petit, Jean Charles : 175 Petzold, Gottlieb August : 37-38, 155 Pez, Johann Christoph : 200 Pezold, Christian : 30, 147-148, 264 Pfalz, Benedicta Henriette von der : 76, 90, 243 Pfalz, Eduard von der : 76 Pfalz, Elisabeth von der : 87 Pfalz, Karl Ludwig von der : 86-91 Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von : 81 Pfleger, Augustin : 155, 186 Phélypeaux, Raymond Balthazar : 77 Philidor l’Aîné, André Danican dit : 232-234, 253, 292 Philidor, Alexandre Danican dit : 179 Picart, Nicolas : 25 Pichon, N. (chanteuse) : 291 Pichon, N. (machiniste) : 294 Pietragrua, Carlo Luigi : 228 Pigniatten, Giuseppe : 114 Pinel, N. (musicien) : 152 Piquard, N. (musicien) : 29 Pisendel, Johann Georg : 118, 131, 175, 198-199, 201, 216, 225, 265 Platen, Franz Ernst von : 171-172 Platen, Klara Elisabeth von : 153 Podewils, Heinrich von : 76 Poetzsch-Seban, Ute : 267, 272 Pohle, David : 175, 249 Poisson, N. (comédien) : 82, 130, 153-154 Pollarolo, Carlo Francesco : 239 Pompierin, N. (comédien) : 84 Poppe, Gerhard : 95 Postel, Christian Heinrich : 58 Potier N. (danseur) : 55
Potot, Pierre : 29 Prache du Tilloy, Jean : 103, 132, 162-163, 187-188, 216-217 Prache du Tilloy, Marguerite Geneviève : 132, 162-163, 172, 180 Praslin, César Gabriel de Choiseul-Chevigny, duc de : 157 Pressis-Praslin, César III Auguste de Choiseul de : 92 Prevost, Jean Nicolas : 44, 47, 181 Prevost, Paul : 26, 29, 161 Prin, N. (comédien) : 62 Printz, Wolfgang Caspar : 177 Purcell, Henry : 255 Quantz, Johann Joachim : 60, 64, 66, 118, 183-184, 199201, 247, 256, 298, 300, 304-305 Quesnot de la Chesnée, Jean-Jacques : 53-56, 147 Quinault, Philippe : 19-20, 308 Rabe, Christian : 38 Racine, Jean : 166, 170, 307-308 Raguenet, François : 69 Raison, André : 212 Rameau, Jean-Philippe : 7, 216, 274, 307-309 Ravielle, Jeanne : 100 Ravissart, Johannes Anthonius : 29, 160 Rebel, Jean Féry : 159, 198, 201 Redrow, Sean Patrick : 210 Regnard, Jean-François : 49, 297 Reich, Wolfgang : 95 Reincken, Johann Adam : 208 Remez, N. (danseur) : 62 Ribon, N. (compositeur) : 242 Richter, Johann Christian : 30, 265 Rieck, Christian Ernst : 67 Riemschneider, frères : 291 Rigaud, Hyacinthe : 141 Rinelon, N. (danseur) : 62 Ristori, Giovanni Alberto : 95-97, 102 Ristori, Tommaso : 51, 61 Riva, Giuseppe : 70 Robeau, François : 17, 91, 115, 139, 145, 150, 182 Robeau, Hilaire : 91, 139, 145 Robeau, Marguerite : 90-93, 139, 158 Robert, Pierre : 29, 204, 206 Robertson, Michael : 258 Robinson, N. (danseur) : 62 Roche, Daniel : 17 Roche, Martine : 193 Rochebrune, N. de (comédien) : 84 Rochois, Marie : 56 Roger, Étienne : 120, 122, 161, 213, 215, 229, 247, 253 Romainville, Charles de la Haye dit : 43-45, 48 Rose, Louis : 29, 270 Rosenmüller, Johann : 228 Rosidor, Claude-Ferdinand Guillemay dit : 26, 52, 157 Rosidor, Jean Guillemay dit : 26 Rossi, Camilla de : 228 Rost, Johann Leonhard : 299 Rousseau, Jean-Jacques : 7, 309 Rousseau, Jean : 274 Rybinski, Adam : 219
– 343 –
Index nominum
Sachsen, Friedrich von, prince électeur de Saxe : 93 Sachsen, Friedrich August I von : voir August II Sachsen, Friedrich August II von : voir August III Sachsen, Johann Georg II von, prince électeur de Saxe : 94, 97 Sachsen, Johann Georg III von, prince électeur de Saxe : 97, 107 Sachsen, Johann Georg IV von, prince électeur de Saxe : 97 Sachsen-Hildburghausen, Ernst Friedrich von : 203-204 Sachsen-Weimar, Johann Ernst von : 193-194 Sachsen-Weissenfels, Friedrich von : 94 Sadler, Graham : 121 Saint-Amour, N. (musicien) : 152, 165, 179 Saint-Hyacinthe, Hyacinthe Cordonnier die Thémiseul de : 19 Sallé, Marie : 280 Salvay, François de : 101 Salvay, Madeleine de : 61, 101, 131 Sardin, Jean : 107 Savoie, Christine de France duchesse de : 176 Scarlatti, Alessandro : 239, 299 Scheibe, Johann Adolph : 247, 253, 270, 301-303, 305 Schelle, Johann : 230 Schenck, N. von (diplomate) : 94 Schmelzer, Johann Heinrich : 221 Schmidt, Johann Christoph : 30, 44, 106, 123-131, 176, 216, 264 Schmidt, Johann Wolfgang : 216 Schneider, Herbert : 8 Schönborn-Wiesentheid, Rudolf Franz Erwein von : 61, 202 Schopp, Albert : 155 Schott, Gerhard : 56, 58 Schröder, Dorothea : 60 Schubert, Franz : 206 Schulze, Heinrich : 175 Schürer, Johann Georg : 204 Schürmann, Georg Caspar : 230, 235, 242 Schütz, Heinrich : 97, 99, 104 Schweiberger, Anton : 108 Schwerin, Otto von : 24 Scudéry, Madeleine de : 86 Sellin, N. (chanteuse) : 291 Sellius, Adam : 211-212 Senesino, Francesco Bernardi dit : 122, 131-132 Silvestre, Louis de : 80 Simon, N. (musicien) : 149 Sinski, Louise : 152 Sobieski, Jakob : 81 Sobieski, Jean : 81, 234 Sophie Amalia von Braunschweig-Calenberg, reine de Danemark : 26-27, 68, 171 Sophie Charlotte von Hannover, reine de Prusse : 39, 67, 82, 84, 149, 226, 228 Soulas, Charles de : 105 Soulas, Marguerite de : 105 Spinoza, Baruch de : 87-88 Spitta, Philipp : 262, 288 Spitzer, John : 218
Spohr, Arne : 10 Sporck, Franz Anton : 64 Staël, Germaine de : 10 Stammk, Johann Friedrich : 165 Stechinelli, N. (agent) : 159 Steffani, Agostino : 35, 40, 68-70, 120-122, 152, 183-184, 229-230, 253, 255, 261, 285 Steinberg, Charles : 108 Stella, Santa : 122 Strohm, Reinhard : 137-138 Strungk, Nikolaus Adam : 43, 97-99, 111, 127, 228 Stuart, Elisabeth : 24 Stuck, Jean-Baptiste : 200-201 Surlis, Jean de : 43-45 Syntamoir, N. (musicien) : 149 Tarquini, Vittoria : 121, 184 Telemann, Georg Philipp : 15, 66-67, 172, 175, 201, 212, 215-216, 246, 252, 261, 265-267, 271-273, 286-287, 289-291, 296-302, 307, 309 Tettau, Johann Wilhelm von : 155 Thanne, Wolf Adam von der : 78, 116 Thiboust, N. (danseur) : 60 Thiekle, Gottfried Friedrich : 114 Thieme, Clemens : 175 Thomae, Johann Christoph : 182 Thomas, Christoph : 28 Thomas, Judith : 195 Thomasius, Christian : 86, 283, 299 Tilly, François de : 81, 174 Tilly, N. (comédien) : 84 Tissier, Gabrielle : 178-179 Torcy, Jean Baptiste Colbert, marquis de : 34, 62 Torlé, Johann : 270 Torri, Pietro : 228, 261 Tosi, Pier Francesco : 69 Tourteville, François de : 156 Treu, Paul : 249 Uffenbach, Zacharias Conrad von : 170, 290 d’Urfé, Honoré : 244 Valois, N. de (comédien) : 62 Valoy, Bérénice : 46, 106 Valoy, François : 45-46, 84, 106, 153 Valoy, Stéphane : 44-46, 84, 106, 111, 120, 173, 175-176, 186, 225, 227-228, 230-231 Valzania, Michael Ange : 109 Vaurinville, Louise de : 199, 201 Venturini, François : 101, 122, 172, 176, 185, 215-217, 223227 Venturini, Henrietta : 101 Veracini, Francesco Maria : 122-126, 131, 304 Verdier, Pierre : 25-26 Verdion, Otto Gerhard : 38 Verjus, Louis de : 77 Verpré, François de : 22 Vesemann, Andreas : 151 Vezin, Pierre : 105-106, 111, 120, 153, 165 Vezin, Sophie Amélie : 153
– 344 –
Index nominum
Viala, Alain : 19, 73 Vidor, N. (danseur) : 62 Villedieu, Michel de : 43-49, 103 Vivaldi, Antonio : 64, 215, 247, 275, 299, 301 Vogler, Johann Caspar : 208, 211 Vogt, Hans Jurgen : 101, 178 Voiture, Marguerite : 139-140 Voltaire, François-Marie Arouet : 71, 142 Volumier, Jean-Baptiste : 29-30, 36-39, 67, 102, 104-106, 118, 122, 126, 131-132, 145, 155-156, 175-176, 182, 186-188, 199, 219, 222, 265, 270, 288, 290 Volumier, Jean-Jacques : 37 Volumier, Jonas : 37 Volumier, Pierre Habert sieur de : 37 Vorkamp, Gerhard : 171 Vota, Karl Moritz : 94 Voullon, Alexandre : 25 Wackerbarth, Christoph August von : 81, 108-109, 130, 156 Wagner, Richard : 204 Walsh, John : 255 Walther, Johann Gottfried : 68, 122, 208-211 Watteau, Antoine : 50-51 Watzdorff, Christian Heinrich von : 132 Watzdorff, Christoph Heinrich von : 81, 123, 126, 130, 132, 187 Weckmann, Matthias : 27 Werner, Michael : 9-12 Weßnitzer, Matthias : 174
Westenholz, frères : 291 Whatman, James : 228 Wiedemann, Bernhard Gottfried : 37-38, 155-156 Williams, Peter : 271 Winter, Johann Christian : 230 Witt, Christian Friedrich : 249 Wollny, Peter : 214, 228, 231 Woulmyer : voir Volumier Württemberg, Eberhard Ludwig von : 171, 218 Württemberg, Magdalena Sibylla von : 154, 218 Württemberg-Stuttgart, Friedrich Ludwig von : 194, 200-201 Württemberg-Winnental, Friedrich Karl von : 218 Zanovelli, Jean-Baptiste : 185 Zarlino, Gioseffo : 274 Zaslaw, Neal : 218 Zelenka, Jan Dismas : 95-97, 194-195, 204-205, 253 Zelter, Carl Friedrich : 8, 289 Zimmermann, Bénédicte : 12 Zohn, Steven : 174, 261 Żórawska-Witkowska, Alina : 55, 188 Zucker, Johann Christoph : 205 Zur Nieden, Gesa : 10
– 345 –
Table des matières • Introduction ◊
7
Chapitre 1. L’Europe galante comme marché du travail L’émergence d’un marché international
◊
◊ 17
21
Anne de La Barre et l’Europe du Nord ◊ 21 Les préparatifs d’un voyage ◊ 22 Les cours royales de Suède et Danemark ◊ 24 Les cours allemandes ◊ 28 Un marché en expansion ◊ 30 L’Europe des Grands tours ◊ 30 Diplomaties de la musique française ◊ 33 Marginalité religieuse et itinéraires d’un blasphémateur L’Europe des troupes
◊
◊
36
39
Des comédiens entre la Hollande et l’Empire ◊ 39 Construire le théâtre français ◊ 40 De la Hollande à la Saxe : les troupes du Roi de Pologne ◊ 43 Les musiciens dans les troupes ◊ 44 La troupe de l’opéra de Pologne : les limites d’un modèle ◊ 49 La mission impossible de Constantin ◊ 49 Les impresarios : Louis Deseschaliers et Catherine Dudard ◊ 52 De Dresde à La Haye : un changement de modèle ◊ 55 Du mécène au public : l’invention de la célébrité musicale
◊
56
L’Europe des métropoles et de la célébrité ◊ 57 Urbaniser l’opéra français ◊ 57 Laboratoires de célébrité ◊ 60 La Hollande « au centre des affaires » ◊ 61 De Dresde à l’Europe des Lumières ◊ 63 De la cour aux métropoles ◊ 63 L’apparition d’une figure publique ◊ 66 Johann Ernst Galliard et l’Angleterre ◊ 67
Chapitre 2. Administrer la musique française Mécénat musical et identités aristocratiques
◊
◊
71
73
Les États impériaux entre le Roi et l’Empereur ◊ 74 Musique et équilibres géopolitiques en Basse-Saxe ◊ 76 Politiques françaises d’Auguste le Fort ◊ 80 Des divertissements entre politique et galanterie ◊ 82 Identités galantes et patronage de musique française ◊ 86 Sophie de Hanovre entre galanterie et Lumières radicales ◊ 86 Entre Osnabrück et le Palais Royal : connections féminines ◊ 90 Tolérance confessionnelle et indifférence religieuse ◊ 93
– 347 –
Table des matières
La construction administrative d’une catégorie stylistique
◊
97
Pensée sauvage et bricolage administratif ◊ 100 Désignation, origine, identité ◊ 100 De la comédie à la Hofkapelle ◊ 102 Gouverner la musique française ◊ 107 Le prix de la musique ◊ 109 Musique et typologies comptables ◊ 110 Effectifs et salaires ◊ 115 L’économie matérielle de la musique ◊ 116 Négocier les goûts réunis
◊ 118
Pratiques d’hybridation ◊ 119 Horticulture et musique : des structures bicéphales ◊ 119 Les musiciens français et l’ascension de Steffani ◊ 120 La musique française en question ◊ 122 Musique française, musique italienne : un royal affrontement L’administration face aux conflits ◊ 126 Ruptures et reconfigurations ◊ 130 Un divertissement français ◊ 130 Le renvoi des Français et le règne d’Auguste III ◊ 132
◊
Chapitre 3. Frantzösische Musicanten : une biographie collective ◊ Musiciens migrants ◊
135
137
Les ressorts de la migration ◊ 138 Réseaux socio-professionnels et facteur familial ◊ 138 Les raisons du départ ◊ 141 L’attrait de l’étranger ◊ 144 La vie dans l’Empire ◊ 147 Voyage et installation ◊ 147 Pratique religieuse et identités confessionnelles ◊ 151 Faveur, cabales, patrons : le monde de la cour ◊ 154 « L’esprit de retour » ◊ 157 Une mobilité permanente ◊ 158 Revenir au pays ◊ 160 Le bonheur en Allemagne ? Installations, reconversions, dynasties Servir un autre maître
122
◊
◊ 164
166
Les espaces de la musique française ◊ 166 Le théâtre ◊ 166 La table et la chambre ◊ 171 L’église ◊ 173 Identités remarquables ◊ 174 Maîtres de chapelle, maîtres de concert ◊ 174 Les bandes de hautbois, entre musique militaire et musique de cour Chanteuses et actrices françaises ◊ 179 Les tâches du musicien ◊ 181 L’enseignement de la musique et de la danse ◊ 181 Le musicien comme agent d’affaires et diplomate ◊ 184 Copier la musique française ◊ 185
Chapitre 4. La dissémination de la musique Les imprimés musicaux : de l’achat à la copie
◊
◊
191
193
Les collections de cour ◊ 193 Une mosaïque de provenances ◊ 193 Objet de collection ou support de pratiques ? Air de cour et cantate ◊ 200
– 348 –
◊
195
◊
176
Table des matières
Les sources du motet ◊ 201 Un corpus exemplaire ◊ 202 Les motets de Lully à Dresde ◊ 204 Les motets de Robert à Dresde ◊ 206 Du livre d’orgue à l’Orgelbüchlein ◊ 208 Les copies de Weimar ◊ 209 Adam Sellius, libraire français ◊ 211 Les copies berlinoises ◊ 212 La musique française dans les collections manuscrites ◊ 215 Les suites françaises dans le répertoire de la Hofkapelle de Dresde ◊ 215 Matériel d’orchestre et répertoire français ◊ 216 Pratiques orchestrales et disciplinisation ◊ 217 Nomenclatures à la française ◊ 222 La diaspora des sources de Hanovre ◊ 225 Les manuscrits de Darmstadt ◊ 226 Les sources de Londres et Amsterdam ◊ 227 La musique française dans la collection Bokemeyer ◊ 229 Entre compilation et objet de mémoire : le livre de musique ◊ 234 Le livre de musique de Ludwig Rudolf de Wolfenbüttel ◊ 234 Une pratique partagée ◊ 243
Chapitre 5. L’invention allemande du style français ◊ 245 « Nach Französischer Art » : composer à la française ◊ 247 L’apprentissage d’une méthode ◊ 248 L’ouverture et les « lullystes allemands » ◊ 248 À la recherche d’une « méthode françoise » ◊ 252 Pratiques d’écriture et techniques de composition ◊ 256 Expérimentations et hybridations ◊ 261 Gallicus Adventus ◊ 261 Ouvertures entre Köthen et Leipzig ◊ 267 Regards rétrospectifs ◊ 270 Par-delà l’ouverture : les marqueurs du style français ◊ 271 Une diversité de pratiques d’écriture ◊ 271 Stabilité tonale et changement de mode ◊ 273 Moduler à la française ◊ 279 La musique française comme objet de controverse ◊ 282 Sous le signe de la modernité ◊ 283 Une querelle des Anciens et des Modernes ◊ 284 « Grand Partisan de la Musique Françoise » ◊ 286 Bach contre Marchand : un duel symbolique ◊ 287 Critique de la galanterie et crise de l’opéra français ◊ 289 La tragédie en musique : un modèle à bout de souffle ◊ 289 Critiques éclairées de la galanterie ◊ 292 Telemann entre deux fronts : l’opéra comique ◊ 296 Musique française et Lumières : vers un renversement des alliances ◊ 298 De la galanterie au style galant : mutations d’un concept ◊ 299 Cosmopolitisme et refus des styles nationaux : Scheibe contre Birnbaum ◊ 302 Sous le signe des anti-Lumières musicales ? Marpurg et Agricola ◊ 304
Conclusion. L’année 1733 comme terminus ◊ 307 Sigles utilisés ◊ 311 Sources imprimées ◊ 313 Bibliographie ◊ 317 Index nominum ◊ 337
– 349 –