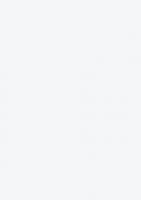Conscience tragique: Penser le néant, vivre de rien 9782343171609, 2343171602
"La pensée tragique traverse l'irréductible déchirure de l'homme, considérant, outre les tourments auxque
128 91 3MB
French Pages 260 Year 2019
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
CHAPITRE II ÉCHOS DU RÉEL
CHAPITRE III HORS DU TEMPS ?
CHAPITRE IV SAGESSE TRAGIQUE
CONCLUSION
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Emmanuelle Bruyas
File loading please wait...
Citation preview
Emmanuelle Bruyas est docteure en philosophie et auteure de textes littéraires, fragments et nouvelles. Elle a été notamment cofondatrice et rédactrice en chef de la revue pluridisciplinaire L’Aleph de 1998 à 2005. Elle est membre du comité rédactionnel de la revue Alkemie depuis 2017. Publications : François Chirpaz, chemins de philosophie. Entretiens avec Emmanuelle Bruyas (L’Harmattan, 2014), Trajections (Bellier, 2016 – Ouvrage paru sous le nom d’Emma Bruyas-Veyrat). Site Internet : www.humus-plume.fr
Emmanuelle BRUYAS
La pensée tragique traverse l’irréductible déchirure de l’homme, considérant, outre les tourments auxquels il est exposé, sa vocation, comme celle de toute chose, à la mort et à l’oubli. Décidée à cheminer loin des rivages consolants, une telle pensée se recommande, selon Clément Rosset, d’une logique du pire, s’efforçant d’appréhender le réel dans sa présence singulière et chaotique, où chaque existence, émergence hasardeuse et éphémère, n’est arrimée à rien. Nous avons tenté de repérer les points d’impact de cette logique. Il s’est agi tout d’abord de penser l’épreuve de la condition humaine : découverte de celle-ci sous son jour précaire, l’enracinant au sein du réel destructeur. Nous avons envisagé ensuite les implications de cette traversée première, interrogeant la possibilité du suicide et celle de l’approche religieuse de notre destin. Si l’idée du suicide représente un important sas de liberté pour l’existant, la pensée tragique ne prône pourtant pas le passage à l’acte, celui-ci constituant, au fond, une tentative de neutralisation de la mort, plutôt qu’un véritable affrontement de notre finitude. Elle ne s’inscrit pas, non plus, dans la perspective de la foi religieuse, y discernant, quelle que puisse être la profondeur de son inspiration, une façon d’éluder l’impact de notre mortalité intime et la dureté de notre présence au monde. Dès lors, avons-nous essayé de cerner les contours d’une sagesse tragique. Invitation à un accueil sans partage de la totalité tragique du réel, sollicitant une attention aiguë à l’instant présent, reconnaissant aussi dans l’humour et dans la joie, plus encore, l’écho gracieux d’une capacité de jubilation à même de résister à la peine.
bibliothèque
Emmanuelle BRUYAS
CONSCIENCE TRAGIQUE Penser le néant, vivre de rien
CONSCIENCE TRAGIQUE
CONSCIENCE TRAGIQUE
Photo de couverture par E. Bruyas ISBN : 978-2-343-17160-9
26.50 €
OUVERTURE
PHILOSOPHIQUE bibliothèque
Conscience tragique Penser le néant, vivre de rien
Ouverture philosophique Collection dirigée par Dominique Chateau, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot Une collection d’ouvrages qui se propose d’accueillir des travaux originaux sans exclusive d’écoles ou de thématiques. Il s’agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu’elles soient le fait de philosophes « professionnels » ou non. On n’y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique ; elle est réputée être le fait de tous ceux qu’habite la passion de penser, qu’ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou… polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernières parutions Roberto MIGUELEZ, Sur la rationalisation, Essais, 2019. Hamdou Rabby SY, Déconstruire l’imposture identitaire, Humanisme et éthique de la déconstruction, 2019. Jean-Michel CHARRUE, La philosophie néo-platonicienne de l’éducation, Hypatie, Plotin, Jamblique, Proclus, 2019. Komi KOUVON, La responsabilité éthique dans les sociétés postcommunicationnelles, 2019. Nikos FOUFAS, De la force et de la violence chez Thucydide, 2019. Christian MARTIN, L’amour de l’art ou l’évanescence du discours, 2019. Lauréline CHRETIEN, Amour libre et anarchie, La révolution sexuelle selon E. Armand, 2019. Marie-Pierre FRONDZIAK, Croyance et soumission, De la critique de la religion à la critique sociale, réflexions à partir de Spinoza et Freud, 2019. Karim BEN HAMIDA, L’utopie du cerveau global. Le web 2.0 et la construction sociale de la connaissance, 2019. Enrique DUSSEL, Vingt thèses de politique, 2018. Fabrice MOUSSIESSI, Essai d’épistémologie comparative chez Imré Lakatos. Pour une nouvelle interprétation de la rationalité scientifique, 2018. Alberto DA SILVA, Florence DRAVET, Gabriela DE FREITAS, Gustavo DE CASTRO (dir.), L’imaginaire de la catastrophe dans la communication et les arts, 2018. Dominique PAUL, Entre chair et lumière. De la possibilité d’une distance critique par l’objet-image, 2018. Charles MAURICE, La Société émancipatrice, 2018. Élie VOLF et Michel HENRY, Rationalité en philosophie des sciences, 2018.
Emmanuelle BRUYAS
Conscience tragique Penser le néant, vivre de rien
© L’Harmattan, 2019 5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris www.editions-harmattan.fr
ISBN : 978-2-343-17160-9 EAN : 9782343171609
INTRODUCTION […] voyez, à travers la cohue des mimes, Une forme rampante fait son entrée ! Une chose rouge de sang qui vient en se tordant De la partie solitaire de la scène ! Elle se tord ! elle se tord ! – Avec des angoisses mortelles Les mimes deviennent sa pâture, Et les séraphins sanglotent en voyant les dents du ver Mâcher des caillots de sang humain. Toutes les lumières s’éteignent – toutes –, toutes ! Et sur chaque forme frissonnante, Le rideau, vaste drap mortuaire, Descend avec la violence d’une tempête, – Et les anges, tous pâles et blêmes, Se levant et se dévoilant, affirment Que ce drame est une tragédie qui s’appelle l’Homme, Et dont le héros est le ver conquérant1.
L’horreur d’une existence vouée à la mort, tel est le fond de cruauté latente résidant derrière « l’illusion de la force, de la gaieté, du bonheur, l’illusion de l’éclat et de la poésie de la vie2 ». Joseph Conrad et ses compagnons de traversée ne sont pas près de l’oublier. Depuis qu’« il » avait embarqué sur le navire, l’atmosphère était devenue lourde et étouffante. Au sein de l’équipage un malaise grandissant. C’est « lui » qui focalise l’attention des marins, malgré leur tentative de fermer les yeux et de s’absorber dans leurs tâches quotidiennes. « Lui » : Le Nègre du « Narcisse », Jimmy Wait, le moribond caché dans une des cabines du bateau. « Il nous fascinait. Il ne laissait jamais s’éteindre le doute. Son ombre enveloppait le navire. Invulnérable dans sa promesse de prompte corruption il piétinait notre amour-propre et nous démontrait chaque jour notre manque de courage moral ; il contaminait notre vie3. » Cela est exprimé au plus juste : ce n’est pas tant la mort de Jimmy qui frappe si profondément la conscience des marins rompus à une existence rude et dangereuse, mais cette station pesante et menaçante dans la cabine, offrant un symbole éclatant de l’imminence de la mort. Voilà ce qui réellement importe : notre état de cadavre virtuel. Étrange visiteur issu d’un univers de ténèbres. Inquiétant témoin de ce devant quoi la raison humaine recule, à savoir la nécessité inéluctable de sa propre disparition. La mise en 1
E. Poe, « Ligeia », Histoires Extraordinaires, Éditions Garnier Frères, « Chefs-d’œuvre étrangers », 1958, p. 266. 2 J. Conrad, Le Nègre du « Narcisse », Gallimard, « L’Imaginaire », 1983, p. 160. 3 Ibid., p. 54.
5
INTRODUCTION
scène de Conrad nous paraît déterminante comme premier éclairage du tragique. Car la mort dont elle nous parle est très éloignée d’une mort envisagée comme simple point final de la vie ; elle est présence, dimension fondamentale de l’existence humaine, et non image vaporeuse. Le tragique s’expose ici, dans cette immanence de la mort à la vie, expression de la mortalité profonde qui constitue la face obscure de notre existence. Vocation à la déchéance, à la mort et à l’oubli. Où réside proprement le tragique ? En ceci que la mort n’est pas seulement fin, mais cette énigme qu’est la disparition totale, l’annulation de son propre être, et aussi, de proche en proche, de tout ce que nous aimons et connaissons. Outre pour chacun son tragique propre qui est de concevoir, à plus ou moins brève échéance, ses projets et ses réalisations personnelles comme essentiellement rompus et engloutis par l’oubli, il y a encore tous ces autres naufrages que sont la perte d’êtres aimés et la destruction d’œuvres d’art qui, aussi grandioses soient-elles à nos yeux, sont également destinées à être avalées par le temps. Gouffre d’anéantissement menaçant toute chose, à la source d’une certaine amertume susceptible de ternir, de dévaluer la jouissance que nous sommes à même d’éprouver ici-bas. De quel savoir de la mort cette amertume nous parle-t-elle ? À l’image de la présence brute et oppressante de Jimmy Wait, la pensée tragique nous ouvre à une pensée de la mort forte et implacable, exposant ce pouvoir de réduire à néant ce qui a existé. Le tragique ne réside donc pas tant dans l’irrémédiable mort des étants que dans le sentiment de perte absolue, de véritable fin du monde qu’elle inflige. Toute chose est également dérisoire et éphémère impliquant que ce qui est pour nous le bien le plus précieux – notre vie propre, celle de nos proches, telle ou telle œuvre –, est à la fois dénué de toute valeur et de toute consistance, tout cela ne menant à rien. Pouvoir d’annulation, d’effacement total, scellant l’insignifiance de l’existence humaine et nous amenant à vivre, pour ainsi dire, en mortsvivants. Ce que la réflexion de Molloy nous semble traduire au plus près : « Ma vie, ma vie, tantôt j’en parle comme d’une chose finie, tantôt comme d’une plaisanterie qui dure encore, et j’ai tort, car elle est finie et elle dure à la fois, mais par quel temps du verbe exprimer cela1 ? » Ce qui existe à peine existe-t-il ? Certes, de la mort elle-même, nous n’avons rien à dire, l’écart entre la mort effective et la pensée de la mort étant incommensurable. Dans une telle perspective, nous pourrions considérer, à l’instar d’Épicure, que c’est par ignorance que nous craignons la mort et qu’il est en conséquence inutile de nous tourmenter. En effet, la mort n’est, pour le vivant que nous sommes encore, qu’un pur néant, puisque, tant que nous sommes là, elle n’est pas, et
1
S. Beckett, Molloy, Minuit, 1951, p. 47.
6
INTRODUCTION
quand elle advient, nous ne sommes plus1. La mort en tant que ma mort n’est rien d’observable, dans la mesure où elle marque la fin de la temporalisation, de la conscience. Au fond, la mort ne nous est rien. Pour être objectivement exacte, une telle approche est emblématique de la tentative de rester aveugle au tragique de l’existence, glissant alors sur la mort réduite à une réalité plate, simple limite de l’existence humaine qui ne nous concerne pas, plutôt que de s’efforcer de la considérer dans son épaisseur en appréhendant la vie sur son lit de mort. Car s’il n’est pas, à proprement parler, d’expérience de la mort, celle-ci n’arrivant qu’une fois, nous ne sentons pas moins peser sur nous son impalpable présence. La mort des autres, des êtres qui nous sont proches, constitue à cet égard une expérience primordiale. À travers ce déchirement que représente la perte d’un être aimé, il y a la tristesse de la séparation définitive, mais aussi l’éveil de la conscience latente de notre mortalité profonde. Au cœur de la conscience tragique : la mort n’est pas que le dernier acte qui n’a, au fond, pas grand-chose à voir avec notre existence, elle informe au contraire la totalité de notre existence. Embarquement dans l’irréversible d’un monde en perpétuel devenir, dessinant la distinction entre la mort, point final de nos vies, et le mourir, somme des morts qui nous amène à éprouver la mort incessamment tant que nous vivons. Chaque homme est doté de cette conscience à la fois de sa propre mort et de tout ce qui l’entoure. Mais cette conscience est généralement très floue et voilée. Nous savons que nous allons mourir un jour, … dans l’avenir, à un moment indéterminé. Indétermination essentielle qui laisse la mort dans la pénombre, nous évitant le sort douloureux du condamné à mort qui, en plus du fait qu’il mourra, connaît la date de son exécution. Cadre incertain de notre périmètre de respiration qui permet précisément à la vie de se déployer. En sorte que la mort est appréhendée comme un événement qui, certes, arrive tous les jours, surtout aux autres2, survenant « certainement » mais « provisoirement pas encore »3. Tricherie de cette « sorte d’approximation protectrice4 », qui n’est en soi aucunement blâmable. C’est dans la mesure
1 Ainsi Épicure déclare-t-il à Ménécée : « Accoutume-toi à penser que la mort, avec nous, n’a aucun rapport ; car tout bien et tout mal résident dans la sensation : or, la mort est privation de sensation. » (Épicure, Lettre à Ménécée, in Lettres, maximes, sentences, Le Livre de Poche, « Classiques de la philosophie », 1994, 124, p. 192). 2 Voir L. Tolstoï, La Mort d’Ivan Illitch. À l’annonce de la mort d’Ivan, Tolstoï ne manque pas d’observer que ses amis et collègues songent bien vite, non seulement à leur avancement, mais, plus profondément encore, au fait que c’était une chance qu’il s’agisse de lui et non pas d’eux. Ce soulagement des collègues d’Ivan est emblématique de cette tentative de mise à distance, repoussant, ainsi, au plus loin l’effectivité de la mort de moi. 3 F. Dastur, La Mort. Essai sur la finitude, Hatier, « Optiques Philosophie », 1994, p. 53. 4 V. Jankélévitch, Entretien avec Daniel Diné, Penser la mort ?, Liana Levi, « Piccolo », 2003, p. 28. « C’est comme si nous réservions superbement la mort aux gens qui passent dans
7
INTRODUCTION
où elle ne se laisse pas fasciner par la mort et sait suffisamment la tenir à distance que l’existence humaine peut être supportable. Mais cette mise à distance, pour essentielle qu’elle soit, coïncide le plus souvent avec une véritable occultation. En nous entretenant du divertissement, Blaise Pascal a mis en évidence les stratégies par lesquelles les hommes tentent d’étouffer leur conscience tragique1. En parlant du bavardage dans l’anonymat du « on », Martin Heidegger a pointé la superficialité dans laquelle nous sommes tentés de nous réfugier pour éviter la rencontre avec nous-mêmes. « On meurt » : cette expression est l’écho même de cette tentative de banalisation et d’aliénation. Elle manifeste un rapport biaisé et inauthentique à la mort apparaissant, alors, comme un terme abstrait, une simple réalité théorique. Cette mort-là est impersonnelle et rassurante, car précisément « la mort-propre, diluée en concepts, perd son caractère tragique, devient inoffensive et anodine2… » Cette mort-là a perdu tout venin, occultant le fait qu’elle soit possible à tout instant et la fragilité de notre personne vouée au non-être et à l’oubli. Car, en faisant ainsi de la mort un événement arrivant de l’extérieur, l’homme se sent à l’abri puisque, tant qu’elle n’est pas survenue, il peut se raconter des histoires et se croire immortel3. Si bien que l’on aboutit à une représentation lointaine du fait de mourir, à une quasi-absence de conscience de la finitude. Outre chez d’aucuns le postulat d’une vitalité naïve, c’est la mise en évidence d’une essentielle distorsion comme si nous n’étions pas correctement taillés pour cette vie qui est nôtre et qu’une anomalie s’était glissée dans notre programmation : nous sommes incapables de recevoir l’information centrale qui nous constitue. Mourir pourrait, en effet, représenter simplement la rançon logique d’avoir existé – la nature reprend ce qu’elle a donné. Et il est d’ailleurs bien des cas, comme le remarque Roland Quilliot, où la mort n’inspire pas nécessairement l’horreur, bien souvent au gré de l’usure d’un âge avancé suscitant une certaine fatigue de vivre et un progressif lâcher prise. « Elle la rue. C’est cela la tricherie essentielle, appliquer la mort aux autres par un report perpétuel et un ajournement. Et cela est justifié par la nécessité de l’existence. Elle suppose perpétuellement cette tricherie. » (Ibid., p. 29). 1 Voir B. Pascal, Pensées, éd. Brunschvicg, 139. Voir aussi les pensées 142, 143, 168, 171. Pascal désigne par là toutes les manœuvres par lesquelles les hommes s’appliquent à se fuir, à se délivrer d’eux-mêmes, grâce aux multiples dérivatifs puisés dans l’action, les relations sociales, les nouveautés, etc., autant d’occupations plus ou moins futiles dont nous meublons nos journées et par lesquelles nous cherchons à nous réinstaller dans l’épaisseur du devenir. 2 V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 2, Seuil, « Points Essais », 1981, p. 25. 3 Partant du fait que l’homme ne parvient pas à se représenter sa propre mort, Sigmund Freud considère que « personne, au fond, ne croit à sa propre mort ou, ce qui revient au même : dans l’inconscient, chacun de nous est persuadé de son immortalité. » (S. Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort », Essais de psychanalyse, Payot, « Prismes », 1987, p. 26).
8
INTRODUCTION
peut être acceptée comme un phénomène naturel, et même être considérée comme l’achèvement normal d’une existence réussie, le point d’orgue qui donne sa plénitude à un destin qui est parvenu à son terme : le danger redouté étant alors surtout qu’elle ne vienne pas assez tôt, qu’elle laisse un homme qui fut fort et fier se laisser humilier et dégrader par la maladie et la vieillesse1 ». N’oublions pas en effet ces vieillards décatis, à l’existence piteuse et brimée, qui ne réjouissent que leurs proches heureux de brandir le quasi-centenaire de la famille. Guy de Maupassant a mis en évidence le caractère parfois sordide de cette situation à travers la figure d’un vieillard dont la famille regarde les derniers plaisirs s’épuiser peu à peu et auquel elle refuse quelque gourmandise sous prétexte de veiller à sa santé, comme si réduit à l’état de « débris inerte et tremblotant2 », sa « santé » devait représenter un enjeu majeur. Mais, au-delà de ces considérations, « distorsion » nous paraît être le maître-mot du tragique : en possession d’un savoir dont nous ne savons que faire, comme si, écrit Clément Rosset, « un programmateur divin et universel » avait commis « un impair de base, adressant une information confidentielle à un terminal hors d’état de la recevoir, de la maîtriser et de l’intégrer à son propre programme : révélant à l’homme une vérité qu’il est incapable d’admettre, mais aussi, et malheureusement, très capable d’entendre »3. Et c’est dans cette distorsion, cet « impossible-nécessaire », précisément, que Vladimir Jankélévitch situe « l’essence même du tragique », à savoir « ce déchirement d’une situation inconcevable et pourtant naturelle »4. Rien de plus banal que de mourir, rien de plus évident que ce germe létal qui caractérise nos existences, mais rien de plus indigeste non plus. Les hommes savent ce qui rôde, ce qui les guette, mais ils font semblant de ne rien savoir ou plutôt, comme l’écrit le philosophe en écho à l’expression très avisée de Jacques Madaule, ils n’y croient pas5. Expression du caractère fondamentalement équivoque de la mort, de la façon paradoxale dont nous l’appréhendons, révélant une certaine incapacité des hommes à l’assimiler à leur nature. Si bien, écrit Cioran, qu’elle « reste en eux à l’écart d’eux ; elle reste telle quelle, différente de ce qu’ils sont. […] elle se présente pour nous à la fois comme situation limite et comme donnée directe. Nous courons vers elle, et pourtant nous y sommes déjà. Alors même que nous l’incorporons à notre vie, nous ne pouvons nous empêcher
1
R. Quilliot, Qu’est-ce que la mort ?, Armand Colin, « U : Philosophie », 2000, p. 43. G. de Maupassant, « Une famille », Contes et nouvelles, II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1979, p. 767. 3 C. Rosset, Le Principe de cruauté, Minuit, « Critique », 1988, p. 24-25. 4 V. Jankélévitch, La Mort, Flammarion, « Champs », 1992, p. 440. 5 « Je sais que je mourrai, mais je ne le crois pas. » (J. Madaule, Considérations de la mort, Corréa). Expression fréquemment citée par V. Jankélévitch. 2
9
INTRODUCTION
de la placer dans l’avenir1. » Même reconnue en lui, l’homme s’acharne toujours malgré tout à situer la mort devant lui, à la projeter au-dehors. Et pourtant c’est elle qui nous ouvre à notre dimension temporelle. Sans cela, s’éprouver dans le temps n’aurait aucune signification pour nous. Il reste qu’il est plus aisé de fuir la mort que de la constater en soi-même, de mettre en œuvre des subterfuges pour l’évacuer de soi aussi loin que possible. Jusqu’à coïncider donc, pour nombre de nos congénères, avec une complète occultation. De là vient que, d’une manière générale, est authentifié au simple « décès » (c’est-à-dire un passage, une séparation) ce qui est le fondement même de notre existence. De là vient aussi que la préoccupation du mourir est le plus souvent considérée comme une inconvenance, un signe de disposition morbide, voire d’inadaptation pathologique de l’individu. L’appréhension de l’existence à la lueur de la mort qui nous détermine est-elle l’indice d’un déséquilibre pathologique de l’individu ou bien plutôt le signe d’une pensée en quête de lucidité ? C’est cette deuxième perspective que, bien entendu, nous retenons ici. À partir de là, peut-on mieux cerner l’intention de la pensée tragique. Celle-ci, Rosset le précise très nettement, consiste à rendre disponible à l’homme – à sa conscience et à sa parole – un savoir possédé mais enfoui et dissimulé, parce qu’estimé trop indigeste, non à révéler quelque chose d’ignoré et dont l’homme se passe très bien. Pourquoi une telle démarche, une telle exigence ? Parce qu’elle estime, au plus profond, que le véritable malheur vient de l’incapacité à penser son malheur. Le déni est à la source de comportements d’évitement, amenant à vivre, à des degrés divers, « à côté de la plaque ». Depuis la folie pure et simple jusqu’à ces mirages et fantasmagories tissés pour dissimuler la réalité : enfantement d’arrièremondes consolants, mouvements utopistes et autres leurres qui, en enjolivant le monde, misent sur l’espoir d’un sursis ou d’un sens caché. Conduites de dénégation du réel consistant à porter son attention partout, sauf ici et maintenant, pour se masquer notamment la gratuité du malheur et, au fond, la fragilité de toute existence vouée au non-être et à l’oubli. Dans un entretien, Rosset parle de ce « vice inhérent à la condition humaine : pour échapper au sentiment de mourir, les hommes regardent ailleurs, et préfèrent fuir ce qui est pour adorer ce qui n’est pas2 ».
1
Cioran, La Tentation d’exister, in Œuvres, Gallimard, « Quarto », 1995, p. 962. Cioran écrit aussi : « Au fond de soi, chacun se sent et se croit immortel, dût-il savoir qu’il va expirer dans un instant. On peut tout comprendre, tout admettre, tout réaliser, sauf sa mort, alors même qu’on y pense sans relâche et que l’on y est résigné. » (Cioran, De l’inconvénient d’être né, in Œuvres, op. cit., p. 1368-1369). 2 C. Rosset, « Clément Rosset : Le gai savant », Entretien avec Raphaël Enthoven, Le Point, n°1740, 19/01/2006.
10
INTRODUCTION
La pensée tragique considère, quant à elle, que la plus grande lucidité envers soi-même, supposant la prise en compte de ce que le réel a d’inéluctable et d’irrémédiable, pour n’être nullement confortable, est plus bénéfique que celle de l’illusion. L’abandon de toute conscience tragique contribue à plonger les individus dans la dispersion, le mensonge et le désarroi. Fuite en avant à la source d’une attention distraite au monde et de chutes d’autant plus cuisantes lorsque l’abrupte platitude des faits reprend ses droits. Considérant que l’homme vit avec, enfouies en lui, l’angoisse et la mort, et que l’on n’échappe pas au réel, la pensée tragique désigne une orientation de l’esprit décidée à ne pas composer avec les leurres et l’oubli. Ainsi, là où l’illusionné s’emploie à élaborer une version optimiste de son sort, le penseur tragique s’essaie à voir le réel tel qu’il est. En quoi il se recommande, selon Rosset, d’une « logique du pire ». « Réussir à penser le pire », telle est la visée de la pensée tragique, supposant l’appréhension du réel dans sa présence singulière et chaotique, au sein duquel chaque existence, émergence hasardeuse et éphémère, n’est arrimée à rien. Sur ce point des distinctions préalables sont requises entre tragique et pessimisme. Parler du pire, de logique du pire ne peut manquer, en effet, de convoquer le terme de « pessimisme1 ». L’on trouve souvent, d’ailleurs, les deux termes employés indifféremment, à l’instar de synonymes. Il est évident que l’intérêt porté à la face sombre de l’existence crée un rapprochement. Pourtant, s’il est une humeur commune sans aucun doute, il y a aussi une importante différence d’approche, à la fois comme le précise Rosset en termes de contenu et d’intention2. Le pessimisme, auquel Arthur Schopenhauer a donné ses lettres de noblesse, reconnaît un ordre du monde, ordre qu’il considère comme déplorable, décevant, désolant, absurde. Dans cette perspective, le monde n’a rien d’hasardeux, de chaotique ; il est entièrement constitué et « mal » constitué. Autrement dit, face inverse de l’optimisme leibnizien, de tous les mondes possibles, notre monde est le pire qui soit. Affirmation du pire donc, à partir de « la considération du déjà ordonné3 », prisonnier lui-même d’une logique absurde. Ainsi, avec la volonté, Schopenhauer estime-t-il détenir le principe de constitution du fond des choses, la clé donnant l’ultime interprétation du monde. Celui-ci est tout entier mu par la volonté, finalité sans fin se déployant aveuglément et incessamment, ne visant à rien, sinon à s’auto-dévorer et s’auto-engendrer indéfiniment, se constituant en nous comme vouloir-vivre. Ce qui fait de l’homme un être perdu dans un univers dénué de rime et de raison, condamné à une vie absurde, soumise à l’impulsion d’un désir insatiable, se jouant donc sur fond de souffrance et de 1
Du latin pessimus, « le pire », superlatif de malus, « mauvais ». C. Rosset, Logique du pire, PUF, « Quadrige », 1993, p. 18-19. 3 Ibid., p. 15. 2
11
INTRODUCTION
déception. En quoi, comme nous le verrons plus nettement par la suite, l’approche du pire caractéristique du pessimisme se traduit non seulement par une attitude comptable – le mal l’emporte sur le bien, la somme des douleurs et des peines l’emporte sur celle du plaisir et de la joie –, mais surtout elle n’accorde aucune positivité au plaisir ou à la joie, ces derniers ne représentant qu’un arrêt provisoire d’une douleur ou d’un besoin. Ce qui signifie que, pour le penseur pessimiste, un ordre est postulé au départ, une « vision du monde » préexiste aux constats désolés. Il y a du dépit et du mépris dans le pessimisme qui dépasse les incontournables moments d’affliction. Si bien que l’aboutissement logique d’une telle pensée est celui d’une philosophie du renoncement, de la résignation, de la mise en retrait. Le pessimisme invite à « mourir au monde » déclaré indigne de retenir l’attention. Il s’agit donc de se délivrer le plus possible du monde, Schopenhauer prônant pour cela l’abandon de tout désir, capable d’aboutir à l’arrêt du vouloir-vivre, état d’apaisement purgé des affects à la source de souffrances perpétuelles. La pensée tragique, quant à elle, ne reconnaît aucun ordre, ne se recommande pas d’une vision du monde initiale. À l’inverse du pessimisme, elle procède de l’affirmation du hasard : pas d’ordre, pas de « nature » constituée, mais une instabilité totale. Le hasard, autrement dit l’appréhension du réel, sans qu’aucun principe, fût-il aveugle à l’instar de la volonté schopenhauerienne, ne puisse en rendre compte. « Le pessimiste parle après avoir vu ; le terroriste tragique parle pour dire l’impossibilité de voir1. » Si la pensée tragique se recommande d’une logique du pire, celle-ci ne désigne donc pas une logique du monde, mais plutôt une logique de pensée, disposition d’esprit consistant à dépouiller l’homme de toute pensée consolante, dont celui-ci tente de se garantir en cas de malheur. Ceci non pour abattre l’homme avant l’heure ou le convaincre du mépris des choses terrestres, mais pour l’amener à appréhender la réalité dans son innocente cruauté. Les diagnostics peuvent certes s’accorder – aucune existence, compte tenu de son caractère précaire et insignifiant, qui soit objectivement digne de fixer l’intérêt –, mais des optiques de pensée différentes. Ce n’est donc pas l’humeur, mais bien « l’objet de l’interrogation, qui sépare penseurs tragiques et pessimistes2 ». Pas de hasard dans le monde du pessimiste, mais un ordonnancement reconnu, déclaré mauvais, incohérent, absurde. En quoi la philosophie pessimiste est une philosophie du donné et une philosophie de l’absurde. Comme nous tenterons de le montrer, si le sentiment du non-sens et de l’absurde constitue sans doute une étape inévitable de la constitution de la conscience tragique, celle-ci ne s’y maintient pas. Juger le monde absurde
1 2
Ibid. Ibid., p. 16.
12
INTRODUCTION
reviendrait à chercher un principe d’interprétation là où il n’y a, à ses yeux, précisément rien à interpréter. Reste alors la considération de l’insignifiant, l’appréhension du réel dans sa mouvance toujours singulière et hasardeuse. Dès lors, la pensée tragique ne vise pas un détachement nourri du mépris du monde. Plus impitoyable à cet égard que le pessimisme, si la pensée tragique refuse de montrer la condition humaine sous un jour plus riant qu’elle n’est, c’est pour inciter l’homme à une prise en charge lucide de la réalité, qu’il lui appartient donc de refuser ou d’accepter comme telle, loin de toute perspective compensatoire, comme l’est l’extinction du vouloir-vivre prônée par Schopenhauer. Horizons de pensée différents donc. En quoi le tragique ne se confond pas avec le pessimisme. Distinction essentielle qui s’affinera au fil de notre propos. Nous avons commencé à caractériser l’exigence et la visée de la pensée tragique, tentons aussi de préciser auprès de quelles figures de penseurs nous estimons trouver une telle exigence. Notons d’emblée que la démarche entreprise suppose qu’un large champ soit parcouru. Depuis les sentiers pierreux de la Grèce, la préoccupation du tragique glisse et circule, s’échappant des écoles et de tout courant unitaire. Nous trouverons ainsi l’écho de figures antiques centrales, tels que Sophocle, Pyrrhon ou Lucrèce. Mais il s’agit également de suivre l’empreinte de cette pensée dans le monde moderne et contemporain – celui qui s’ouvre avec Michel de Montaigne, Pascal, évidemment, jusqu’à des penseurs plus proches de nous, tels que Friedrich Nietzsche et Rosset, dont la philosophie, comme nos précédentes références le laissent entendre, nous semble pleinement illustrer l’effort pour affirmer et penser le pire jusqu’au bout de ses implications. De même, cette réflexion nous apparaît comme un arcane pour pénétrer au cœur de la littérature : William Shakespeare, Yves Bonnefoy, Eugène Ionesco, Samuel Beckett… en sont des figures emblématiques. S’il est, donc, une identité au sens d’une communauté d’inspiration, celle-ci doit être appréhendée de manière plurielle. Les philosophes ou écrivains que nous rencontrerons ne représentent certes pas, à travers les âges et les particularités propres à chacun, un groupe de penseurs homogènes. Néanmoins un même élan sombre les traverse, un même état d’esprit les relie : celui qui cherche à ne pas s’en laisser conter à propos de l’existence, préférant la voir dans toute sa crudité plutôt que selon une version édulcorée et rassurante. Leur point de rencontre : la reconnaissance du tragique qui nous échoit, un effort vers la lucidité. Ces penseurs-là ont ainsi ce dénominateur commun d’être des désillusionnistes profonds s’efforçant, à ce titre, d’appréhender le réel dans sa fragilité et son instabilité hasardeuse. Pour tenter de traverser les différents points d’impact d’une telle logique du pire, il nous paraît nécessaire, en premier lieu, de nous efforcer de penser l’épreuve de la condition humaine, mettant au jour sa précarité fondamentale 13
INTRODUCTION
et la réinscrivant, par là même, au sein du réel chaotique, indifférent à nos doléances et objections. Il nous faudra voir, tout d’abord, selon quelles étapes est susceptible de se constituer la conscience de soi tragique. À la faveur de quels points saignants le travail de sape du néant est-il susceptible de se signaler ? L’épreuve du tragique. Parler d’« épreuve » suppose une confrontation personnelle. Ce qui signifie que le rapport à notre mortalité ne peut nullement s’établir selon un savoir théorique. Un savoir tout fait est aussi un savoir qui ne concerne personne. Le concernement vécu, en première personne, avec son inséparable cortège de douleur et de déchirure, voilà la condition du savoir. Comme l’exprime à cet égard Miguel de Unamuno : « Il ne suffit pas de penser notre destinée, il faut la sentir1. » Ce n’est, comme chacun sait, que dans et par des moments d’intensité douloureuse que nous pouvons atteindre l’essentiel concernant notre existence2. La souffrance est le lieu de nos rencontres. Elle représente cette brèche ou effraction douloureuse capable de dépasser les barrières corporelles et mentales et leur fonction d’équilibre, et de révéler le caractère précaire de l’être humain. « Souffrir pour comprendre3 », est-il dit dans Agamemnon. Voilà ce que nous désignons par épreuve : par définition une expérience dont je ne suis pas le maître, un certain pâtir, dont l’intrusion dans l’existence détermine un passage à un autre ordre de la réalité. C’est cela qu’il s’agit pour nous de décrire initialement, convoquant à cette fin un certain nombre d’images et de sentiments. Images d’abord : il nous paraît requis de tenter d’esquisser un tableau de notre vie humaine placée sous l’horizon de sa mortelle destinée. Ce sera pour nous le moyen de planter le décor, de situer le lieu du tragique. Ce pour quoi, nous le précisons, Beckett sera un interlocuteur central, la radicalité et la virtuosité de son théâtre nous semblant une expression remarquable du tragique de la condition humaine4. Toujours cette même histoire de l’homme voué à chuter, à affronter en pure perte les forces du néant et de la mort, mais servie par une scène sans faste, sans fioritures, ayant rejoint le déroulement même de nos existences. Cloués dans l’immobilité, rivés à leur seule intériorité, les acolytes de 1
M. de Unamuno, Le Sentiment tragique de la vie, Gallimard, « Idées », 1965, p. 28. F. Nietzsche, Aurore, Gallimard, « Folio essais », 1989, § 114, p. 93-95. 3 Eschyle, Agamemnon, in Œuvres, II, Les Belles Lettres, « Collection des universités de France », 1952, v. 177, p. 16. 4 Point sur lequel Ionesco ne nous contredira pas : « Beckett est essentiellement tragique. Tragique, parce que, justement, chez lui, c’est la totalité de la condition humaine qui entre en jeu, et non pas l’homme de telle ou telle société, ni l’homme vu à travers et aliéné par une certaine idéologie qui, à la fois, simplifie et ampute la réalité historique et métaphysique, la réalité authentique dans laquelle l’homme est intégré. » (E. Ionesco, Notes et contre-notes, Gallimard, « Folio essais », 1991, p. 192). 2
14
INTRODUCTION
Beckett, tels que Vladimir, Hamm ou Winnie, nous tendent sans détour le miroir de notre fragile constitution. Le tragique émerge alors directement des temps morts, de ce temps qui passe tout en ne passant pas – temps de l’ennui –, de ce temps qui oppresse et coupe le souffle – temps de l’angoisse –, pour nous ramener à notre insignifiance. C’est ainsi à partir d’éléments, nous semble-t-il, essentiels – destin, ennui − le temps « fournisseur du néant1 », selon l’expression du Solitaire de Ionesco, que nous analyserons d’abord. Ceci pour, ensuite, envisager l’épreuve proprement dite. Comment l’homme s’initie-t-il à sa propre et complète humanité et avec quelle impression au fond des yeux en ressort-il ? Un certain pâtir, disions-nous. Car il est bien évident que ce n’est pas selon n’importe quelle souffrance que l’homme peut parvenir à hauteur de sa destinée. C’est, plus précisément, à la faveur d’un type particulier mais fondamental d’expérience vécue que l’individu est susceptible de réaliser sa mortalité foncière. Comme Heidegger l’a clairement repéré, c’est dans l’angoisse, qui porte l’homme au-devant de lui-même, que se dévoile authentiquement la mortalité. Nouvelle vision, celle-ci nécessairement funeste, que la douleur va instituer : passage de la perte à la perdition révélant l’étreinte indéfectible de la vie et de la mort ruinant tout état d’opposition des termes ; ouverture à la gratuité de nos cheminements. Exposer un certain nombre d’images, rendre visibles, palpables des phénomènes intérieurs profondément vécus qui signent l’ouverture du tragique. Voilà le premier jalon de notre trajet. Il ne s’agit pas de faire une apologie de la souffrance, mais de reconnaître que l’on n’éprouve toute l’ambiguïté de la vie humaine que par le tourment individuel, les creux de l’ennui, les accents mélancoliques, la nuit claire et froide de la descente angoissée. Échos du réel. Que peut signifier une telle vacillation pour la pensée qui tente de se rapporter au réel ? De quelle appréhension philosophique du réel peut se recommander la pensée tragique ? Comme nous le suggérions précédemment, tout ordre, toute stabilité paraissent inenvisageables. Le réel est rendu aux apparences mouvantes et fuyantes qui le constituent. S’établira alors une ligne nette de démarcation avec une certaine tradition philosophique dont la visée majeure paraît animée d’une volonté d’ignorer le texte de la réalité pour l’élaboration d’une vision davantage magnifiée et rassurante. Si bien que, traditionnellement et majoritairement, la philosophie a eu comme visée majeure, non pas « de révéler à l’homme la vérité, mais bien de la lui faire oublier2 ». C’est dire que si l’homme du commun admet
1 2
E. Ionesco, Le Solitaire, Mercure de France, 1973, p. 135. C. Rosset, Le Principe de cruauté, op. cit., p. 26.
15
INTRODUCTION
difficilement les choses telles qu’elles sont, le philosophe est porteur de carences comparables. Ainsi peut-on caractériser le philosophe antitragique : le réel étant la source de la souffrance, il s’agit de le débouter de sa prétention à être le seul, d’établir que le réel n’est pas le réel. Il a besoin de miroir, de double, autant de termes exprimant la mise à distance du réel. Dans une telle perspective, ce dernier se voit réduit à la duplication de quelque arrière-monde salvateur considéré comme la « vérité » de ce qui existe. Comme si la philosophie, par sa volonté hégémonique, se sentait dispensée d’accepter le réel tel qu’il est en le soumettant aux catégories de pensée. Contre cette philosophie qui éloigne, défigure et nie le réel, la pensée tragique soutient, selon l’expression de Rosset, le principe de réalité suffisante. Il ne s’agit alors nullement de faire tenir le monde dans un système, mais de l’appréhender comme un univers fragmenté, chaotique. La pensée tragique n’entend rien récupérer du côté des Idées, des essences ou de l’Être. Ne rien enjoliver est un enjeu majeur. Le réel demande à être reconnu dans toute sa crudité, loin des doubles qui tendent à le disqualifier. Hors du temps ? Quelles implications ce trajet peut-il avoir s’agissant de la conduite de son existence ? Une piste de sortie, une extraction de l’emprise du temps mortifère est-elle envisageable et souhaitable ? Se présente en premier lieu la voie suicidaire. L’appréhension de l’existence sous son jour fugitif et hasardeux, au sein d’un univers indifférent, se pose-t-elle comme une invitation à maintenir le fil de la vie ou bien à le briser ? L’épreuve et son chemin de la désillusion deviennent pour l’existant une forme d’enquête à l’issue de laquelle il peut décider de demeurer ou non dans l’aventure, mesurant par là même la force de son attachement à l’existence. Il s’agira tout d’abord de reconnaître dans l’acte de la mort volontaire l’affrontement toujours singulier d’un individu avec son destin. Il importe en effet, en la matière, de dépasser tout raisonnement abstrait sur l’homme pour l’appréhender dans l’épaisseur de son individualité. De quoi reconnaître, non seulement, la complexité et la dimension toujours mystérieuse du suicide qui interdisent tout jugement péremptoire du tribunal humain, mais aussi cette ultime porte de sortie comme un fondamental sas de liberté pour l’existant. Mais considérer le suicide comme possibilité essentielle de l’existence ne signifie nullement que la visée soit, pour autant, d’inciter quiconque à passer à l’acte. Car, dans la perspective tragique, cette autodestruction, si elle conserve sa pertinence en tant qu’expression de la mort volontaire, ne s’inscrit-elle pas, au fond, dans les tentatives de neutralisation de la mort ? En ce sens, la liberté intérieure que la possibilité du suicide autorise ressortit avant tout à l’idée de se donner la mort non à l’acte en soi.
16
INTRODUCTION
Et si, selon Nietzsche, tout ce qui est décisif advient « malgré » quelque chose1, ne peut-on échapper à l’accablement et au dégoût d’exister grâce à un goût de vivre capable de résister à la perception du caractère objectivement indésirable de l’existence ? Par ailleurs, si cette sortie par la voie rapide n’apparaît pas comme une solution, une voie d’affrontement lucide du tragique, ne peut-on malgré tout surmonter la mort ? Si l’on se recommande, cette fois, de la part non pas spéculative ou intellectuelle, mais intime et émotionnelle de notre individualité, est-il envisageable de nous arrimer à un au-delà du temps, tel que la croyance religieuse nous le propose, rompant ainsi la perspective d’une disparition totale ? Ou bien cette promesse d’une autre vie s’offrant à l’issue de notre parcours terrestre ne serait-elle, aux yeux de la pensée tragique, une façon d’éluder l’impact de notre mortalité profonde en cherchant des éléments de consolation à la dureté de notre présence au monde, tamisant par là même notre angoisse ? Si l’ordre du divin ne semble pas alors offrir une confrontation suffisante à la réalité, n’est-il pas possible de prendre en charge sa condition de mortel sans chercher une quelconque justification supérieure ? Une alliance est-elle possible entre la désillusion et l’agir ? Peut-on en particulier concilier la lucidité avec l’allégresse ? Sagesse tragique. Dans cette perspective, nous tenterons, au terme de ce cheminement, de dégager un certain nombre de maîtres-mots de l’attitude devant la vie dont peut se recommander la pensée tragique. De quoi essayer d’exposer les contours d’une sagesse tragique. Sagesse, non à entendre comme un ensemble de préceptes censés nous dispenser l’heureuse feuille de route de notre trajet d’existence, mais bien plutôt comme une tentative de trouver la cohérence entre le vivre et l’appréhension tragique de la réalité, s’attachant à repérer les principales exigences d’une existence menée en pleine connaissance de cause. En débusquant un certain nombre d’illusions, qu’elles soient d’ordre ontologique, moral ou religieux, celle-ci nous semble proposer un positionnement dans la vie à la fois lucide et ouvert : présence au monde consistant à vivre ici et maintenant de manière aussi intense et pacifiée que possible, sans la certitude illusoire des idées reçues, sans, non plus, de velléités d’évasion dans quelque absolu supraterrestre. Expression de la quête d’un art de vivre supposant un acquiescement sans partage à l’existence, une acceptation du devenir avec la certitude de l’anéantissement. À côté d’une méditation de la mort, d’une intériorisation
1
F. Nietzsche, Ecce homo, in Ecce homo – Nietzsche contre Wagner, GF – Flammarion, 1992, « Pourquoi j’écris de si bons livres », Ainsi parlait Zarathoustra, § 1, p. 125.
17
INTRODUCTION
du néant qui nous échoit, elle nous invite, au-delà d’un climat dépressionnaire, à un accueil serein et bienveillant des apparences et, autant que possible, rieur et joyeux. Penser le néant, vivre de rien. Car, même si l’entreprise est risquée, – puisqu’elle nous place au bord de l’extinction –, pour peu que l’on ait survécu à cette charge destructrice de la pensée, il y a derrière celle-ci la volonté de vivre selon ces noires lucidités, selon la mortelle crudité du réel, et si possible – une certaine dose d’humour aidant –, avec une forme de sérénité et le sens du jeu de l’enfant d’Héraclite. La destruction a ses propres sentiers : elle vise, par-delà les tentures décolorées, l’aménagement d’un espace pour vivre, des retrouvailles avec la terre, capables de percevoir l’écho paradoxal et fou d’une allégresse surgissant comme une grâce qui, en ne guérissant rien, vient effacer la peine et témoigner par là même, contre toute attente, de l’amour du réel.
18
CHAPITRE I L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE « La vie serait différente du tout au tout si la mort ne l’accompagnait pas dès ses débuts, mais se présentait seulement à son terme. » Georg Simmel, Mélanges de philosophie relativiste.
« Y a-t-il un concept d’un pas venant dans la nuit, d’un cri, de l’éboulement d’une pierre dans les broussailles ? De l’impression que fait une maison vide ? Mais non, rien n’a été gardé du réel que ce qui convient à notre repos1. » Aborder le tragique, tenter d’en retracer les incidences, implique que la pensée retrouve ses veines, ses artères, ses viscères. L’intelligence conceptuelle, comme le suggère Yves Bonnefoy, parce qu’elle se tient en dehors des échos concrets de notre condition, fait subir une congélation superficielle à l’existence. Cette congélation doit être brisée pour que nous puissions retrouver le cœur profond de l’existence, ainsi que Sören Kierkegaard, lui aussi, nous y invite : « Dans la langue de l’abstraction, ce qui constitue la difficulté de l’existence et de l’existant, bien loin d’être éclairci, n’apparaît à vrai dire jamais ; justement parce que la pensée abstraite est sub specie aeterni, elle fait abstraction du concret, du temporel, du devenir de l’existence, de la détresse de l’homme […]. L’embarras de la pensée abstraite se montre précisément dans toutes les questions d’existence, où l’abstraction escamote la difficulté et la met de côté, puis se vante de tout expliquer2 ». En sorte que le langage conceptuel, résultant d’une longue ascèse pour se déprendre du corps, apparaît, sinon totalement fallacieux, du moins insuffisant à aborder les rivages du tragique. Penser l’existence sous cet horizon impose un souci de concrétude, une réflexion qui tente de se formuler hors de l’abri lisse des concepts. La pensée tragique est essentiellement grinçante, se laisse traverser par les questions les plus graves et les plus douloureuses et, avant tout, par la question de notre finitude et de ses implications. Se glisser dans les mailles du tragique, comme y insiste Bonnefoy, va de pair avec une « exigence têtue », celle de ne penser et de ne discourir qu’à travers la mort3. Il faut parler de terre, de pierre, de tombeau. Et encore sans doute faudrait-il ajouter
1
Y. Bonnefoy, L’Improbable et autres essais, Gallimard, « Folio essais », 1992, p. 15. S. Kierkegaard, Post-scriptum aux Miettes philosophiques, Gallimard, « Tel », 2002, p. 256257. 3 Y. Bonnefoy, L’Improbable et autres essais, op. cit., p. 34. 2
19
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
le crâne de Yorick1. Le tragique, parce qu’il touche précisément au cœur profond de l’existence, résiste contre la pente traditionnelle de la philosophie et de son caractère primordial d’une certaine rationalité, cherchant à totaliser l’expérience jusqu’à en édifier un système. Il ne s’agit pas de représenter des idées, mais d’intercepter un certain nombre d’images étroitement tissées dans la texture rugueuse du réel, de mettre en relief ces phénomènes intérieurs profondément vécus qui signent l’ouverture du tragique. C’est pourquoi la démarche adoptée ici nous paraît imposer, en premier lieu, une certaine « remise en scène » pour laquelle, comme nous l’annoncions, Beckett sera un de nos interlocuteurs privilégiés. Notre condition n’apparaît réellement dans sa nudité qu’à partir du moment où l’univers se fissure suffisamment pour révéler sa capacité à broyer l’empreinte humaine, enserrant chacun d’une même cruauté pour le marquer du sceau de sa précarité. Triomphe de la mort venant déchirer la toile cotonneuse des atmosphères les plus protégées, ainsi que Gustave Flaubert le donne à voir dans L’Éducation sentimentale. Nous voici chez Mme Rosanette, plongés au milieu d’un bal costumé et de son pouls trépidant. Les couples dansent, les rires fusent, l’alcool circule allègrement dans les veines des convives… Ambiance festive dont les volutes légères s’effondrent soudain : Et la Sphinx buvait de l’eau de vie, criait à plein gosier, se démenait comme un démon. Tout à coup ses joues s’enflèrent, et, ne résistant plus au sang qui l’étouffait, elle porta sa serviette contre ses lèvres, puis la jeta sous la table. Frédéric l’avait vue. – “Ce n’est rien !” Et, à ses instances pour partir et se soigner, elle répondit lentement : “Bah ! à quoi bon ? autant ça qu’autre chose ! la vie n’est pas si drôle !” Alors, il frissonna, pris d’une tristesse glaciale, comme s’il avait aperçu des mondes entiers de misère et de désespoir, un réchaud de charbon près d’un lit de sangle, et les cadavres de la Morgue en tablier de cuir, avec le robinet d’eau froide qui coule sur leurs cheveux2.
Puis se ferme le rideau sur ces mortelles coulisses et recommence le récit du bal, comme si rien ne s’était passé. On peut, avec Flaubert, appréhender la vie à la manière de cette fête dont la féerie tourne court : la mort est là, sorte de monstre invisible et tentaculaire serpentant sans relâche en nousmêmes pour nous clouer à notre insignifiance. « Quelque chose d’indéfini vous sépare de votre propre personne et vous rive au non-être3. » Rappel que le néant est là, résidant au cœur de notre constitution.
1
W. Shakespeare, Hamlet, in Richard III – Roméo et Juliette – Hamlet, GF – Flammarion, 1964, Acte V, Scène I, p. 357-358. 2 G. Flaubert, L’Éducation Sentimentale, France Loisirs, 1998, 2e partie, chap. 1, p. 169-170. 3 G. Flaubert, Correspondance, À Louise Colet. 2 septembre 1853.
20
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Emprunter les sillages du néant ne peut aller, par conséquent, sans suivre la ligne néantisante du temps. Ainsi faut-il l’aborder à travers un certain nombre de tonalités fondamentales, irréductibles à des désagréments passagers, révélatrices de son trajet souterrain. Expression des forces invisibles qui tissent et (dés)orientent nos existences. De quoi tenter de repérer les étapes susceptibles de présider à la reconnaissance du tragique. C’est pourquoi le premier jalon de notre trajet doit, selon nous, en passer par l’épreuve, un certain pâtir qui nous accule à une solitude qui n’est plus, alors, que l’autre nom de la finitude. La pensée tragique est une philosophie pour laquelle la déchirure, l’épreuve, sont un donné existentiel et non un phénomène négligeable. « Une vérité qui n’est pas éprouvée par la douleur, écrit Jankélévitch, est une demi-vérité, une vérité spécieuse et sans âme. Ce qui s’installe sans être éprouvé est comme s’il n’était pas1. » L’initiation à sa propre et complète humanité ne peut se faire sans l’intrusion de la douleur. D’où, à l’encontre d’une stricte intellectualité, une importance majeure du corps et des signes qu’il renvoie à notre conscience. Ce qui fait dire à Cioran que ce n’est qu’« en exténuant et en martyrisant nos sens que nous apercevons notre néant2 ». Capter la vision tragique signifie d’abord retraverser l’épreuve, ces signes, ces points saignants par lesquels est susceptible de se constituer la conscience tragique. Effraction douloureuse venant ouvrir successivement et concrètement les portes à la tragédie de l’existence et pointer la dimension précaire de notre condition.
1 2
V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 2, op. cit., p. 196. Cioran, La Tentation d’exister, in Œuvres, op. cit., p. 952.
21
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
I. Fin de partie La peste du destin « Comme dans une procession les premiers rangs échappent à la vue en s’éloignant, comme dans un torrent les flots courent à telle vitesse qu’ils laissent en arrière notre perception, de même, dans la vie, les choses passent, s’éloignent, et, bien qu’elles paraissent se fixer, aucune ne demeure même un seul instant et ne cesse de fuir. » Philon d’Alexandrie, De Josepho.
Avec Bonnefoy, nous avons commencé à parler de pierre et de tombeau, autant de termes susceptibles de ne pas laisser l’esprit en repos pour s’intéresser à la vocation la plus propre de l’homme : son destin de destruction et de mort. Parler de la mort de l’individu en termes de destin, c’est insister, comme la notion grecque de « destin », la Moïra1, le signifiait, sur cette part de temps limitée qui a été assignée à l’homme. Quoique nous fassions, le temps nous est compté, faisant de chacun un être voué à la mort. Avant de mobiliser une conception de l’existence en termes de prédétermination, telle qu’on peut la trouver notamment chez les stoïciens, le destin parle de ce qui travaille au plus profond ce cheminement qu’est l’existence, de ce rendez-vous avec soi-même que l’on ne peut manquer : « la temporalité de notre vie est, comme l’explicite Marcel Conche, fondamentalement (dans le principe et dès l’origine) une temporalité finie, la mort est notre mort2 ». Au simple fait d’exister s’associe la garantie de périr. La mort transforme ainsi la vie de l’individu en destin, fixant les limites de l’humaine temporalité. Telle est la Loi singulière qui frappe l’individu, signant notre aliénation au temps « comme à une puissance destinale universelle qui nous entraîne et nous annule3 ». Comment esquisser, alors, un tableau de notre vie humaine placée sous l’horizon du temps mortel qui en est l’étoffe ? Envisager l’existence mise à nu invite à aller chercher de sombres images. Et il en est une qui nous semble mériter de retenir particulièrement l’attention, dans la mesure où on la voit circuler sitôt que l’existence est appréhendée dans sa vive écorchure,
1
Le terme « Moïra » signifie en grec à la fois « destin », « lot », ou « part assignée ». Les hommes sont soumis au destin comme interruption et limite de la condition humaine, comme expression de leur mortalité. Les Moires ou Trois Parques se nomment Clotho, Lachésis et Atropos. Le fil de la vie est filé sur le fuseau de Clotho, mesuré par la baguette de Lachésis et coupé par les ciseaux d’Atropos réputée pour être la plus terrible des trois, « celle à laquelle on ne peut échapper ». Voir R. Graves, Les Mythes grecs, Le Livre de Poche, « La Pochothèque », 2002, p. 69-70. S’exprime le lien étroit entre le destin et le temps, le devenir inéluctable qui fait passer toutes choses de la naissance à la mort. 2 M. Conche, Temps et destin, PUF, « Perspectives critiques », 1992, p. 125. 3 Ibid., p. 46.
22
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
brisée dans son élan, ramenée à sa radicale finitude. Nous nous autorisons d’une telle image atmosphérique avec la peste. Lorsque la pensée s’assombrit et cherche une image de ce qui ronge l’effort humain au plus profond, la peste, nous semble-t-il, n’est pas loin. Outre son impact réel dans l’histoire des hommes, nous voyons en effet celle-ci circuler, au cours des âges, comme une des images les plus tenaces de la déchéance humaine. Ne pourrait-on pas concevoir le destin comme la peste, demandait Antonin Artaud au moment de définir le théâtre essentiel1 ? À l’image d’un mal où la vie est tranchée à chaque minute, à l’image de la perpétuation d’un crime, la peste et son lent travail de destruction organique interne symbolisent la disparition promise de l’ordre apparent. Manière de mettre en avant « un fond de cruauté latente » habituellement masqué. Et si le théâtre essentiel est comme la peste et que, comme elle, il est le temps du mal, le triomphe des forces noires, c’est la faute non pas de la peste ou du théâtre, mais de la vie, la vie étant le vrai double du théâtre2. Artaud n’entend ainsi parler que de la réalité. Ce qui envahit la cité avec l’épidémie, c’est la brusque intrusion d’une réalité qui excède toute institution, tout ordre, et qui ramène les hommes à un état de dissolution inorganique. Pour l’auteur, le théâtre a cette fonction non de représenter des idées ou des sentiments, mais de ramener les hommes à une réalité plus dense qu’ils ont oubliée. C’est dire que l’on n’aborde pas authentiquement l’existence sur un lit de roses, mais au creux de la peste destructrice dont on ne vient pas à bout. Et ce n’est sans doute pas de manière fortuite que Lucrèce achève le De Natura Rerum sur cette image ravageuse, évoquant dans des termes saisissants cette « contagion inexorable » et sa mort galopante constituant « des monceaux de cadavres » : « personne que la maladie, la mort, ou le deuil n’atteignît en ces temps de malheur »3. Le penseur, en concentrant son attention sur la peste, apporte une dernière tonalité tragique à l’épicurisme dont il se recommande. Cette image terminale ne donne-t-elle pas, en effet, toute sa coloration à ce que son tempérament sombre l’amenait à éprouver au plus profond : la misère de l’homme, traversé de tourments, guetté par d’innombrables maladies et autour duquel la mort ne cesse de rôder au hasard, prête à frapper à chaque instant sur le fil bref et périlleux du temps ? C’est aussi à la faveur de l’épidémie de peste qui s’abat sur la cité de Thèbes qu’Œdipe est amené à partir à la découverte de son destin funeste. La peste, c’est l’effondrement des limites, l’expression de ces images marquantes de l’affaissement humain. Lorsque la mort frappe sans distinction d’âge ou de catégorie et de manière vécue comme obscène, car
1
A. Artaud, « Le théâtre et la peste », in Le Théâtre et son double, Gallimard, « Folio essais », 1985, p. 21-47. 2 Ibid., p. 45. 3 Lucrèce, De la nature, GF – Flammarion, 1964, livre VI, p. 230-231.
23
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
sans possibilité de la masquer, le désordre investit la place, emplissant l’atmosphère d’un parfum de désastre. La grande épidémie de peste qui a frappé l’Europe au XIVe siècle1, dévorant des pans entiers de population, a certainement été la grande inspiratrice d’un art funèbre avec les danses macabres qui montraient la vie profondément imprégnée de la présence de la mort, pouvant frapper à toute heure et n’épargnant personne sur son passage. Expression flagrante de la fatalité pesant sur l’espèce humaine, la danse macabre montre un défilé de personnages de toutes conditions sociales, que des cadavres entraînent en sautillant, dansant ou jouant de la musique, rappelant que chacun est au même rang devant la mort. Les morts et les vivants s’alternent et se touchent en un geste familier à l’image des danseurs d’une farandole. Danses vertigineuses révélant la mort sans fard, sous son jour squelettique, tenant par la main les hommes de toutes catégories et de tous âges. Elle offre ainsi le symbole privilégié de la présence de la mort dans la vie. Le spectacle des ravages de la peste noire ouvre à la vision du triomphe de la mort, rappelle qu’elle est une compagne de tous les jours. Plus de masque de chair, mais des crânes, suggérant le caractère dérisoire de toutes nos réalisations. Dans ce sillon, Le Triomphe de la Mort de Pieter Bruegel2 nous apparaît des plus édifiants. Le tableau nous expose une vision d’apocalypse, de fin du monde : les squelettes de la mort fauchent les vivants sans exception – le Roi, vêtu de pourpre et serrant son sceptre, est tiré par un premier squelette qui brandit un sablier révélant au monarque que son temps est écoulé, alors qu’un autre squelette en armure se saisit de ses richesses ; un couple d’amants essaie de s’abstraire de la scène en se berçant de musique, sans se douter que dans leur dos un squelette les accompagne au violon ; en tout lieu voit-on des hommes massacrés, qu’ils soient noyés, piétinés ou pendus… Une ligne noire traverse la toile de part en part, laissant émerger partout des armées de squelettes. Toute résistance est vouée à l’échec dans ce paysage de mort : l’herbe et les arbres sont desséchés, les chevaux sont décharnés. À l’arrière-plan, derrière les collines, brûle un feu infernal, tandis que de multiples incendies parsèment l’espace. Il est vain de brandir l’épée contre la mort, d’essayer de se dissimuler sous une table ou de se cacher dans un tronc d’arbre creux. De même, les honneurs, les richesses et les distractions, chansons d’amour ou jeux de cartes, sont dérisoires. Les vivants se réfugient dans une caisse dont la porte est marquée d’une croix. Mais il est patent d’après la façon dont celle-ci est représentée (squelettes en masse de chaque 1
Rappelons que les épidémies de peste ont rythmé la vie des populations européennes entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Certaines flambées, particulièrement agressives, cumulées aux guerres et aux famines, ont fait des ravages. Ainsi la grande peste noire qui frappa l’Europe au milieu du XIVe siècle, fit en quelques décennies passer la population de 80 à 60 millions. Cette épidémie de mort alla jusqu’à faire craindre la disparition de l’humanité. 2 Toile réalisée vers 1562.
24
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
côté, derrière des boucliers marqués d’une croix) et dont est conçue la porte à abattant, qu’ils s’engouffrent dans un piège. On peut repérer aussi, au premier plan, une exposition allégorique de la mort à travers la présence de deux des trois Parques qui, comme nous l’avons rappelé, sont chargées dans la mythologie grecque de couper le fil de la vie. Ainsi, voit-on deux femmes étendues sur le sol. Sur le point d’être écrasée par un chariot rempli de crânes, la première, incarnant Atropos, tient des ciseaux, tandis que la seconde, figure de Clotho, tient un fuseau. Bruegel dépeint la cessation de la vie de façon violente. Le tableau offre de la mort une image d’une cruauté saisissante, donnant le sentiment d’une mort tout aussi définitive qu’implacable, venant chercher les hommes, les happer, les travailler au corps. « Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais1 », lit-on aux dernières lignes du roman d’Albert Camus, La Peste. Qu’est-ce à dire sinon que si l’on peut espérer éradiquer peut-être définitivement le fléau de la peste, on ne peut évacuer le mal qu’elle signifie, la menace incessante qu’elle fait peser sur les hommes ? Le vieil asthmatique soigné par le docteur Rieux l’a dit un peu plus tôt : « Mais qu’est-ce que ça veut dire, la peste ? C’est la vie, et voilà tout2. » Et nous retrouvons aussi la peste en arrière-plan du Septième Sceau3, où Ingmar Bergman met en scène la magistrale partie d’échecs entre le chevalier Antonius Block et la mort. Un habitant d’un village ravagé par le fléau s’écriera : « La mort est dans votre dos ». La peste révèle ce visage noir de la présence permanente et entêtée de la mort, cette « habile tacticienne » qui finira, après avoir accordé quelque délai, par conduire le chevalier face à son destin. Le film nous laisse sur une dernière image, celle sur la crête d’une colline de la danse macabre… La peste et son écho surpassent les âges au titre d’une des expressions les plus éclatantes de notre destin mortel. Elle symbolise cette déchirure dans la trame continue du temps, cette trace qui constitue notre destin, l’empreinte indélébile de cette mort qui ronge les identités. Nous sommes soumis à une dégradation générale et irréversible qui a pour nom entropie4. Le temps, maladie à la fois congénitale et incurable, fait rimer notre vie avec perte d’être : « la régression est inscrite à l’intérieur même de la progression et marche du même pas […] ; démentant sans cesse la réalisation de l’être, la marche au non-être double cette réalisation avec le processus inverse qui est comme une ligne souterraine contrepointée à la première ; à chaque moment la positivité implique une négativité et l’évolution une involution qui est comme sa transposition juxtalinéaire ; le quasi-inexistant devient sans cesse
1
A. Camus, La Peste, Gallimard, « Blanche », 1947, p. 331. Ibid., p. 330. 3 I. Bergman, Le Septième Sceau, film de 1957. 4 Du grec entropè, action de se retourner, involution. 2
25
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
un peu plus existant, tout en marchant vers l’inexistence1 ! » Le temps, instrument de notre développement et de notre réalisation, est simultanément l’instrument de notre anéantissement. La route ténébreuse d’Héraclite s’éclaircit : « La route qui monte et celle qui descend sont une et identique2. » C’est ainsi que notre meilleur allié est également notre pire ennemi : le temps, grâce auquel l’existant s’affirme en niant le non-être de la mort, est une mort progressive. Nous nous abreuvons du poison qui nous tuera. Paradoxologie de « l’organe-obstacle », selon l’expression fameuse de Jankélévitch, qui fait de notre marche une chute tout autant constamment ajournée que perpétuellement continuée dans le gouffre et la mort. Mais nous, ce qui nous est donné C’est de ne reposer nulle part, Ils s’amenuisent, ils tombent Les hommes de douleur Aveuglément d’une heure Dans l’autre Comme l’eau rejaillissant De rocher en rocher, Dans l’Incertain, Tout au long des années3.
La vie s’épuise dans une mort incessante. Nous survivons d’énergie, jusqu’au moment où l’entropie nous laissera sans recours, gagnera les moindres parcelles de notre présence jusqu’à l’annihiler. La vie n’est ainsi « qu’un combat perpétuel pour l’existence même, avec la certitude d’être enfin vaincus4 », en concluait Schopenhauer. Vocation au désastre, en sorte que vivre, c’est déjà vivre sa mort. Nous sommes pris dans le flux de l’apparition-disparition – « apparition disparaissante » dirait Jankélévitch –, dans le courant de la vie inséparable de son changement constant, de ses renversements perpétuels et de son aspiration létale. Notre vie se défait tout en se faisant. Notre condition est, par conséquent, à appréhender comme cette existence éclatée, ne se réalisant qu’en se déréalisant, à la fois violemment et insensiblement, nous mettant face à notre propre énigme. « Le mystère, c’est la corrélation. Pourquoi faut-il que toute affirmation implique négation5 ? » Le mystère, la distorsion, expression du principe tragique qui préside à nos existences. Nous retrouvons aussi ces mots de Jankélévitch,
1
V. Jankélévitch, La Mort, op. cit., p. 105. Héraclite, Fragments, GF – Flammarion, 2002, fragment 28.6 (DK B60 / M 33), p. 221. 3 Hölderlin, Poèmes antérieurs (1796-1799), in Hymnes, élégies et autres poèmes, GF – Flammarion, 1983, « Hypérion – Chant du Destin », p. 38. 4 A. Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, PUF, 1966, chap. 57, p. 395. Désormais abrégé en Le Monde… 5 V. Jankélévitch, Entretien avec Robert Hébrard, L’Arc, « Vladimir Jankélévitch », n°75, 1979, p. 10. 2
26
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
évoquant la musique et sa mélancolie fondamentale, dont la profondeur se reconnaît à l’allusion qui est faite à « un tragique sans causes qui est le tragique de l’existence. Ce tragique immotivé, c’est l’irréversibilité du temps1. » Et la distinction opérée par le philosophe entre Destin et Destinée prend ici toute sa portée. Nous sommes placés sous le signe implacable du temps et de la mort. Le temps est ainsi l’indice irrécusable de la finitude. Le devenir ou irréversibilité, qui constitue l’essence du temps, condamne l’existence à ce que le philosophe nomme la « semelfactivité ». « Tout instant, dans l’absolu, est inouï et inédit, parce que tout instant est “semelfactif” et, théoriquement, ne se compare à nul autre ; dans l’existence la plus tristement monotone, un instant se différencie toujours du précédent, une soirée d’automne d’une autre soirée d’automne, par quelque qualité imperceptible : les couleurs du couchant, le parfum du vent… […] Un événement qui est advenu une seule fois dans l’histoire d’un homme – une rencontre, une aventure, un premier baiser, une soirée de printemps –, et qui ne s’est jamais renouvelé depuis, sera comme s’il n’était jamais advenu : du moins sera-t-il équivoque et douteux pour toujours et jusqu’à la fin des temps2. » Passé irrévocable – ce qui est fait ne peut être défait – et « inconsistance du devenir » car ce qui est unique s’irréalise de lui-même, « misère de l’irréversible » qui rend le temps insaisissable et méconnaissable, une succession de « never more », autant d’instants uniques, de premièresdernières fois, qui ne se renouvelleront pas, s’articulant avec les termes de limite et de finitude humaine. Renvoi au tragique de l’existence, expression de notre condition d’êtres comme scindés entre deux sérieux : « le sérieux de l’action prosaïque du travail qui transforme l’humanité d’aujourd’hui et prépare celle de demain ; c’est le sérieux des choses à faire et à venir3 ». Mais il ne faut pas omettre l’autre sérieux « qui diffère métaphysiquement du premier, car son domaine est celui du jamais plus, du ne plus4 ». Ce partage entre deux sérieux exprime cette distinction essentielle entre Destinée et Destin : « La destinée exprime plutôt le sérieux de l’action transformatrice ; le destin plutôt le sérieux du tragique qui s’exprime au futur par la mort, au passé dans l’irréparable5. » Sans doute, comme l’écrit Kierkegaard, l’homme à la conscience non encore déniaisée verra-t-il là une disposition morbide et émettra-t-il en son for intérieur quelque protestation : « mais l’homme sage et rangé, qui s’en va le matin à son bureau et rentre pour le dîner, dira sans doute que c’est là une 1
V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé (Entretiens avec Béatrice Berlowitz), Gallimard, « Blanche », 1978, p. 258. 2 V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 2, op. cit., p. 94. 3 V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, op. cit., p. 64. 4 Ibid. 5 Ibid.
27
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
exagération, car son pas habituel c’est tout à fait la médiation ; comment s’apercevrait-il qu’il ne cesse de tomber, lui qui ne fait qu’aller droit devant soi1 ! » Le temps n’est-il pas en effet cette substance infiniment malléable qui permet à l’existant d’être ce qu’il est ? N’est-il pas l’instrument même de notre développement, de notre réalisation, de notre complétude ? Le temps, certes, nous permet de nous éprouver libres devant le destin et de donner aux choses leur coloration. « Cependant, comme le traduisent les mots de Georg Simmel, cette vie qui devient plus pleine et plus forte est située dans un contexte d’ensemble axé sur la mort2. » Être et non-être : la durée qui est la condition de la vie est en même temps sa destruction. C’est là qu’est le hic, la contradiction agonisante. C’est ici que s’assoit le tragique, se nourrissant de l’implacable horizon de notre finitude. Le destin, c’est cela : ce poids mort qui nous précède et nous poursuit. Sénèque, habité du sentiment de l’extrême fragilité des choses humaines, au sein desquelles rien n’est certain que la mort qui travaille dans l’ombre, s’exprimait en ce sens, déclarant que la mort est surtout derrière nous : si elle est devant nous, c’est qu’elle est surtout déjà derrière nous. « Le dernier jour aboutit à la mort ; chaque jour s’y acheminait. Elle ne fait pas sur nous main basse, elle nous grignote3. » C’est alors une scène privilégiée que ce cheminement peut nous inviter à considérer à présent. Cette scène est celle que Beckett nous donne d’arpenter, nourrie par une parole et des personnages sondant la condition humaine au plus profond. – Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. (Un temps.) Les grains s’ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c’est un tas, un petit tas, l’impossible tas4.
Sentence inaugurale de Fin de partie, c’est Clov qui prononce ces mots au lever du rideau. Debout sur les planches, son regard est « fixe », sa voix est « blanche ». À ses côtés, ne cessant de le supplier de l’achever, son maître et « père adoptif », Hamm. Le décor : inexistant, rien qu’une chambre grise. D’emblée, l’univers est bouché, clos et saturé. Tapie dans l’ombre, la mort guette, rôde. « Toute la maison pue le cadavre5 », déclare Hamm. À la
1
S. Kierkegaard, Miettes philosophiques, in Miettes philosophiques – Le Concept de l’angoisse – Traité du désespoir, Gallimard, « Tel », 1990, p. 75. 2 G. Simmel, « Métaphysique de la mort », La Tragédie de la culture, Rivages, « Rivages poche / Petite Bibliothèque », 1993, p. 171. 3 Sénèque, Lettres à Lucilius, in Entretiens – Lettres à Lucilius, Robert Laffont, « Bouquins », 1993, livres XIX-XX, lettre 120, 18, p. 1073. Voir aussi livre I, lettre 1, 2 : « Là est l’erreur, en effet : nous ne voyons la mort que devant nous, alors qu’une grosse partie de la mort est déjà dans notre dos ; tout ce que nous laissons derrière nous de notre existence appartient à la mort. » (p. 603). 4 S. Beckett, Fin de partie, Minuit, 1957, p. 15-16. Désormais abrégé en FP. 5 Ibid., p. 65.
28
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
table de jeu le croupier a trouvé l’expression adéquate : la roue tourne, mais « les jeux sont faits ». Dès le début, la partie est finie. Sur la scène, quelle présence ? Hamm, recouvert d’un vieux drap, est assis dans un fauteuil à roulettes. Paralysé et aveugle, ses yeux sont « tout blancs ». Clov ne peut ni s’asseoir ni se tenir droit en raison de sa démarche « raide et vacillante ». Les parents de Hamm, Nell et Nagg, ayant laissé leurs « guibolles » dans un accident de tandem, ne sont que des vieillards culs-de-jatte s’éteignant lentement dans deux poubelles. Galerie d’estropiés et de mutilés : dépouillement flagrant des vertus dites « constructives » du temps pour la mise en évidence de sa dimension mortifère. Art et manière de vider d’emblée la conscience du spectateur de ses illusions humaines d’un horizon ouvert sur un florissant avenir pour l’emplir des données immédiates du réel : notre vie croît à l’ombre de la mort. Le temps, étoffe de notre vie humaine, c’est celui du sablier : un écoulement et non un progrès scalaire. D’où la comparaison temps-vie, grain-instant faite par Clov. Parce que nous sommes là pour ne plus y être, notre avancée, bien loin de marquer un progrès, ne représente que le chemin vers notre destin d’anéantissement. HAMM. – Mais réfléchissez, réfléchissez, vous êtes sur terre, c’est sans remède1 !
Aussi s’agit-il de nous suggérer par avance le caractère foncièrement dépourvu d’avenir de nos existences, en nous plongeant dans un univers régi par la dimension mortifère du temps. C’est pourquoi Beckett ne nous présente pas des personnages intacts physiquement pour recourir à des artifices scéniques qui feraient ressortir leur déconfiture. Il marque les corps profondément, directement, même si souvent les infirmités initiales s’accentuent encore au fil des mots. Ce qui, dans l’espace-temps de la pièce, met d’autant plus en évidence le travail de sape du temps, inlassable mangeur de chair humaine. Notons que l’omniprésence du corps est un des traits remarquables des écrits de Beckett. Personne, ou presque, n’est épargné : entre guibolles perdues et autres moignons, l’on rencontre quasi exclusivement des êtres entamés dans leur chair. Des personnages au corps délabré, coincés par quelque handicap, par leur enfouissement ou simplement avachis par leur épuisement2.
1
Ibid., p. 91. En attendant Godot – Vladimir souffre de la vessie ; son compère Estragon a mal aux pieds. Oh les beaux jours – Winnie est prisonnière d’un mamelon de terre, enfouie au début jusqu’à la taille, puis jusqu’au cou. Comédie – Les trois personnages, F1, F2 et H sont coincés dans des jarres. La dernière bande – Krapp doté d’une « voix fêlée très particulière » est un vieillard usé à la « démarche laborieuse », « très myope » et « dur d’oreille ».
2
29
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
La scène nous offre l’image d’un monde à bout, agonisant, peuplé de corps morcelés, disloqués, privés le plus souvent de leur verticalité, contraints à gémir ou à ramper, comme autant de symboles du délabrement interne des personnages. Sur les planches, toujours la même existence égarée, close, perdue et sans repères, en un lieu qui n’offre aucun contour du monde familier. Un espace rétréci et confiné, privé de la profondeur de l’espace ordinaire et restreint à l’alentour immédiat. Beckett n’abaisse pas l’homme à loisir, il le montre sans faux-semblants, dans son humanité désarmée, portant en lui le poids de la condition humaine1, selon l’effet de verre grossissant que la scène permet et requiert. Une façon de mettre en éveil la conscience du spectateur et du lecteur par une exposition sans détour de notre marche scandée de multiples trébuchements et vouée à s’échouer dans un trou. Ce qu’il nous rend perceptible, d’une part en faisant de l’infirmité notre état naturel − marquage sur le corps de notre condition de « fauchés » de la vie ; d’autre part en enfermant ses personnages dans l’ennui. Entrée, selon les mots de Stefan Zweig, au cœur de ces « heures vides, creuses, qui portent en elles le destin. Elles apparaissent comme des nuages sombres et indifférents qui approchent avant de se perdre à nouveau, mais elles demeurent, tenaces, opiniâtres2. »
La dislocation du temps par l’ennui « Il ferait volontiers de la terre un débris / Et dans un bâillement avalerait le monde ; / C’est l’Ennui ! » Charles Baudelaire, « Au lecteur », Les Fleurs du mal.
Pour chaque jour d’une vie bien portante et affairée, bien entendu le temps nous porte et notre contradicteur pourra ainsi nous répondre que, si la fin ne nous appartient pas, les modalités de ce temps, elles, nous appartiennent. Qu’est-ce donc pour l’homme que le monde, sinon l’espace qu’il peut habiter parce qu’il peut s’y installer, ordonnant l’alentour pour l’ajuster à sa vie propre ? Quelle est la coloration de cette existence, sinon ce temps qui se vit en un présent tissé de mémoire et ouvert à d’autres moments à venir ? Le temps aboli l’est certes définitivement, mais il n’apparaît pas tout à fait mort tant qu’en persiste le souvenir. Et l’ouverture sur l’avenir offre au présent la promesse qu’il n’est pas simple ressassement de ce qui a déjà été dit ou fait. C’est cela qui constitue le présent ordinaire de la vie pour
1
Voir notamment En attendant Godot où Vladimir déclare : « à cet endroit, en ce moment, l’humanité c’est nous, que ça nous plaise ou non. » (S. Beckett, En attendant Godot, Minuit, 1952, p. 112). Désormais abrégé en EAG. 2 S. Zweig, L’Amour d’Erika Ewald, Le Livre de Poche, 1992, p. 37.
30
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
l’homme : l’installation dans l’épaisseur d’une durée empreinte de mémoire et orientée vers un futur. Une installation donc jamais totalement figée puisque capable d’évoquer son passé et, par ses souhaits et ses projets, tendue vers d’autres jours à venir. À nous la souplesse de l’emploi du temps. Le temps laisse le temps au temps… Le temps nous laisse le temps… de croître, de grandir, de nous affirmer et, ce faisant, de nous cramponner à une illusoire royauté. Puisque la date de la mort lui est soustraite, il paraît naturel à l’homme de ne pas chercher à en approfondir la nature. « On meurt ». Il sait de cette science toute générale que les hommes meurent, il sait qu’il mourra sans savoir quand et, de ce fait, se sent exempté de chercher à approfondir le rapport avec la temporalité et sa mort-propre. Et puis, comme le relevait Pascal, notre propre intérêt est un merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement1. Mais de quelle factice sécurité, de quel fragile équilibre s’agit-il là ! Que l’ennui vienne s’immiscer dans la trame continue du temps, qu’il vienne ronger les aiguilles de l’horloge et les tentures de l’existence vont commencer à se ternir sérieusement. Nous ne parlons pas ici, bien évidemment, de l’ennui au sens banal du terme, dont on se défait par quelque distraction. Il importe, en effet, de distinguer nettement l’ennui ordinaire, courant que l’on chasse plus ou moins aisément par de multiples passe-temps, de l’ennui profond qui, pour révéler sa part essentielle, demande que l’on reconnaisse sa tonalité propre. Cet ennui n’est pas réductible à un simple vague à l’âme en l’absence d’occupations précises, capables de fixer l’attention. C’est méconnaître l’ennui que de le réduire au simple désœuvrement, de le mettre seulement en rapport avec le travail ou son absence, ou de l’attribuer à un tempérament indolent. Dans cet ordre d’idées, Fernando Pessoa écrit dans son Livre de l’intranquillité : « J’entends souvent dire que l’ennui est la maladie des gens apathiques, ou bien des gens qui n’ont rien à faire. Cette affection de l’âme, cependant, est plus subtile : elle atteint les êtres qui y sont prédisposés, et elle épargne moins, en fait, ceux qui travaillent, […] que les gens vraiment apathiques. […] L’ennui des grands actifs est le pire de tous2. » L’ennui fouille bien au-delà des creux de l’emploi du temps. Et Nietzsche s’exprime dans le même sens, en rapprochant la capacité d’ennui de l’activité et de la finesse d’esprit : « “Le Magyar est beaucoup trop paresseux pour s’ennuyer”, ce proverbe donne à penser. Les animaux les plus subtils et les plus actifs sont seuls capables d’ennui. – Ce serait bien une idée pour un grand poète que l’ennui de Dieu le septième jour de la création3. » 1
B. Pascal, Pensées, op. cit., 82. F. Pessoa, Le Livre de l’intranquillité, II, Christian Bourgois, 1992, 100, p. 112. 3 F. Nietzsche, « Le voyageur et son ombre », Humain, trop humain, II, Gallimard, « Folio essais », 1987, § 56, p. 208. 2
31
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Il est notable, cependant, que l’ennui est souvent abordé de manière biaisée, celui-ci étant réduit à la simple lassitude ou au seul désœuvrement et, ainsi, perçu comme un défaut de volonté de l’individu (« je ne sais pas quoi faire »)1. Celui-ci est alors appréhendé comme cette passion triste à laquelle on succombe par paresse. Aspect trivial qui explique que l’on en parle peu et qu’il est rarement abordé de front. On glisse ainsi sur l’ennui comme sur un désagrément passager, à l’image du caillou dans la chaussure. Ce manque d’approfondissement de l’ennui explique que celui-ci a été le plus souvent rangé au nombre des sentiments abordés en philosophie avec une certaine condescendance. Il ne se dit pourtant pas la même chose dans « cela m’ennuie » et « je suis en proie à l’ennui ». Sensation ici d’emprisonnement de laquelle émerge l’écho d’une capture intégrale de soi, comme ces mots de Dino, tentant d’analyser l’ennui qui le ronge, l’expriment au plus juste : « il me semblait être muré vivant en moi-même comme dans une prison hermétique et étouffante2 ». L’ennui ordinaire, issu du désœuvrement ou d’une activité monotone, peut être vaincu avec telle ou telle distraction. L’ennui profond, lui, n’a rien d’un malaise ordinaire, mais d’un saisissement vis-à-vis duquel toute diversion s’avère vaine. D’un côté donc, pour reprendre les termes de Heidegger, l’ennui « lointain » dans le cas où telle ou telle chose nous ennuie, tel travail ou telle occupation. De l’autre, l’ennui profond « qui éclôt lorsque “l’on s’ennuie”3 ». Il s’agit là de mesurer l’écart entre un sentiment ou une simple émotion et ce que le philosophe nomme « tonalité » ou « disposition affective ». L’ennui est émotion quand je suis ennuyé par quelque chose de déterminé. Il est, en revanche, tonalité affective lorsque c’est le monde entier qui m’ennuie. Ici se creuse la différence entre l’ennui de situation et l’ennui existentiel. Nous nous penchons donc sur l’ennui fondamental, désignant l’ennui même de vivre : « non l’ennui passager ; non l’ennui par fatigue, ou l’ennui dont on voit le germe, ou celui dont on sait les bornes ; mais cet ennui parfait, ce pur ennui, cet ennui qui n’a point l’infortune ou l’infirmité pour origine, et qui s’accommode de la plus heureuse à contempler de toutes les conditions, – cet ennui enfin, qui n’a d’autre substance que la vie même, et 1
Telle est, comme le relève Heidegger, l’appréciation courante de l’ennui qui entend bien ne pas chercher à en approfondir la nature. L’ennui dans cette perspective est « gênant, désagréable et insupportable » et « toutes les choses de ce genre sont aussi de peu de valeur, elles sont indignes et à rejeter. Être ennuyé est un signe qui dénote un caractère superficiel, de façade. Celui qui fixe à sa vie une vraie tâche et lui donne un contenu n’a pas à redouter l’ennui et est assuré devant lui. » (M. Heidegger, Les Concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde – finitude – solitude, Gallimard, « Bibliothèque de Philosophie », 1992, § 36, p. 239). 2 A. Moravia, L’Ennui, Le Livre de Poche, 1965, p. 14-15. 3 M. Heidegger, « Qu’est-ce que la métaphysique ? », Questions I et II, Gallimard, « Tel », 1990, p. 56.
32
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
d’autre cause seconde que la clairvoyance du vivant1. » À la différence d’émotions ou de sentiments déterminés qui sont en relation avec un objet particulier, les tonalités affectives fondamentales atteignent le monde dans son entier. Elles n’ont pas de lieu propre. C’est ce que nous confirme Cioran : « la douleur est localisée, tandis que l’ennui évoque un mal sans siège, sans support, sans rien sinon ce rien, inidentifiable, qui vous érode2 ». Tonalité affective qui, comme nous le verrons avec l’angoisse, n’a rien de fortuit ou d’accidentel, l’ennui constitue un ressort central, pour ne pas dire le plus central, de notre existence. Menace permanente de l’affadissement de nos journées, temporellement, l’ennui ne nous quitte jamais complètement. Il y a un indéniable fond d’ennui propre à notre existence, qui n’est peut-être rien d’autre que l’ennui fondamental d’exister, « toujours aux aguets – comme l’exprime Schopenhauer – pour occuper le moindre vide laissé par le souci3 ». Ce qui fait dire, d’ailleurs, au même Schopenhauer que la vie, comme un pendule, oscille de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui4. Rappelons que, dans la droite ligne du pessimisme du philosophe allemand, si le pôle de la vie oscille sans autre intermédiaire de la souffrance à l’ennui, c’est que n’est reconnue une positivité qu’à la souffrance. Le plaisir, la jouissance sont pure négativité en tant que cessation d’une douleur ou d’un besoin. La vie, autrement dit, est souffrance ou indifférence, mais jamais véritablement jouissance. Dans notre optique, il n’est pas question de ne reconnaître aucune positivité à la jouissance – et c’est là un des points de grand écart entre le pessimisme et la pensée tragique qu’il nous faudra affiner –, mais il n’en reste pas moins que l’ennui incarne ce guetteur tenace et indéracinable de notre trajet temporel d’existence. Comment, dès lors, appréhender cet ennui et l’expérience particulière qu’il constitue ? Le temps de l’ennui est un temps immobile où l’on ne fait pas de progrès. Le temps passe mais il ne se passe rien. « Les instants se suivent les uns les autres : rien ne leur prête l’illusion d’un contenu ou l’apparence d’une signification ; ils se déroulent ; leur cours n’est pas le nôtre ; nous en contemplons l’écoulement, prisonniers d’une perception stupide5. » À la fluidité du temps, libre succession d’instants, carrière par excellence de notre réalisation, de notre complétude, s’est substituée une temporalité essentiellement immobile, évidée, sans consistance, privée de toute substance régénératrice. L’ennui, c’est ce cancer ou cette maladie du temps qui prend une dimension autonome, débordante, étouffante.
1
P. Valéry, L’Âme et la Danse, in Œuvres, II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 167. Nous soulignons. 2 Cioran, Écartèlement, in Œuvres, op. cit., p. 1481. 3 Le Monde…, chap. 58, p. 407. 4 Ibid., chap. 57, p. 394. 5 Cioran, Précis de décomposition, in Œuvres, op. cit., p. 591.
33
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Temps figé, dévitalisé : une source gelée, une panne du devenir. Le temps, sous son plus hideux visage, est désormais devenu un obstacle complet où je ne fais que subir l’arrêt des pulsations vitales. En s’installant et en emprisonnant notre perception, l’ennui offre la démonstration même que : « La parfaite obéissance du temps n’a d’égale que la résistance infinie de la temporalité1. » Des aiguilles sans flèches, emmêlées, embrouillées à l’horloge du mur : « Le Temps, détraqué, s’est arrêté. Il ne remplit plus sa mission fondamentale, qui est de faire advenir l’avenir. Plus rien n’advient, il n’y a plus de futurition2 ». Perdant ses qualités de futurition, d’à-venir, il implique la ruine de l’idée de progrès, d’un temps où l’individu se réaliserait (selon son mérite personnel) pour son propre bonheur ou son propre malheur, alors qu’il ne fait que se perdre sans recours : « il n’est plus cette droite orientée vers un futur, telle que l’a constituée l’héritage judéochrétien. Il représente, au contraire, un cercle éternellement refermé sur luimême, à la manière de la roue d’Ixion3. » Cercle infernal de la roue de feu d’Ixion. Le temps tourne, mais il n’avance pas. Le devenir épouse l’éternel retour des cycles, le devenir va là même d’où il vient. Au lieu de faire advenir l’avenir, le devenir bégaye, croupit sur place. Ici survenir égale revenir. Pris dans ce Temps dont on ne soupçonnait pas la dévorante majuscule, on se retrouve piteux et minuscule. Expérience première d’un vide de sens qui englobe l’ensemble de ce qui nous entoure. « L’ennui est l’écho en nous du temps qui se déchire…, la révélation du vide, le tarissement de ce délire qui soutient – ou invente la vie4… » Ceux qui sont au courant s’en souviennent : l’ennui, en prenant place au sein de nos journées, c’est la puce mise à l’oreille, le début du soupçon : « Il n’attend rien, et il s’attend vaguement à tout : il pressent on ne sait quoi, des possibilités de misère inconnues, une détresse indéterminée autant qu’inexplicable5. » Soupçon à la faveur duquel l’on pressent, dans cet abîme vertigineux de l’ennui, que le sens est une illusion créée par les hommes pour meubler le vide, échapper au néant qui gît au fond de l’existence, à « l’insignifiance universelle6 » dont la conscience rend l’existence à sa fragile nudité.
1
V. Jankélévitch, La Mort, op. cit., p. 104. C. Rosset, Schopenhauer, philosophe de l’absurde, PUF, « Quadrige », 1989, p. 96. 3 Ibid., p. 95. Comme l’explicite R. Graves (Les mythes grecs, op. cit.), la roue de feu d’Ixion (« indigène fort », p. 283), toujours placé aux côtés de Sisyphe au Tartare, symbolise le soleil (p. 346). Le dieu-Soleil demandait, pour inaugurer son année, des sacrifices humains passés par le feu. 4 Cioran, Précis de décomposition, in op. cit., p. 591. 5 V. Jankélévitch, L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux, Aubier Montaigne, « Présence et pensée », 1976, p. 126. 6 Ainsi Cioran qualifie-t-il l’ennui profond : « Il ne s’agit pas de l’ennui que l’on peut combattre par des distractions, la conversation ou des plaisirs, mais d’un ennui, pourrait-on dire, fondamental ; et qui consiste en ceci : plus ou moins brusquement, chez soi ou chez les 2
34
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Être en proie à l’ennui et commencer à s’expérimenter, à s’éprouver soimême dans son humanité friable vont de pair. L’individu pris dans les filets de l’ennui éprouve un creux dans son être ; amorce, entrevision d’un gouffre plus profond, à l’image d’une « masse d’un gris terne et mélancolique, ombre qui s’accroche inexorablement et jalousement à chaque minute et brandit sans cesse un poing menaçant1 ». Le changement de posture ou de lieu ne modifiera rien : un malaise s’insinue en soi, d’une tonalité inquiète et fondamentale, un mal-être se dessine. Car l’on sent bien alors qu’il ne s’agit pas là d’un désagrément purement passager qui, en s’évanouissant, ne laissera pas sa trace fondamentale : la part d’insignifiance de l’existence, le délitement du sens, de tout « aller vers ». L’ennui met au jour l’absence de sens dont il jaillit. De ce fait, il est susceptible de préparer une transformation profonde de soi, tout en révélant la naïveté et la superficialité de l’homme qui n’a pas flirté avec l’ennui. C’est dire avec Cioran, fin connaisseur de ce « cyclone au ralenti2 », que : « Celui qui ne connaît point l’ennui se trouve encore à l’enfance du monde, où les âges attendaient de naître ; il demeure fermé à ce temps fatigué qui se survit, qui rit de ses dimensions, et succombe au seuil de son propre… avenir, entraînant avec lui la matière, élevée subitement à un lyrisme de négation3. » De là une certaine nécessité du divertissement au sens pascalien du terme – nous ne pouvons évidemment pas vivre et stationner dans le flux de ce temps moribond – ; mais de là également, comme le relevait Nietzsche, une certaine vulgarité chez celui qui cherche à chasser l’ennui à tout prix4. En lui, l’individu peut éprouver son aliénation à la temporalité, la coloration autres, ou devant un très beau paysage, tout se vide de contenu et de sens. Le vide est en soi et hors de soi. Tout l’univers demeure frappé de nullité. Et rien ne nous intéresse, rien ne mérite notre attention. L’ennui est un vertige, mais un vertige tranquille, monotone ; c’est la révélation de l’insignifiance universelle ». (Cioran, Entretien avec Fernando Savater, Entretiens, Gallimard, coll. « Arcades », 1995, p. 29). Voir aussi Écartèlement : « Une fois qu’il s’insinue en vous et que vous tombez sous son invisible hégémonie, tout paraît insignifiant à côté. » (in op. cit., p. 1481). 1 S. Zweig, L’Amour d’Erika Ewald, op. cit., p. 37. 2 Cioran, Aveux et Anathèmes, in Œuvres, op. cit., p. 1668. Cioran confie lui-même que, non seulement sa vie « a été dominée par l’expérience de l’ennui » (Entretien avec Fernando Savater, Entretiens, op. cit., p. 29), mais aussi que cette expérience s’est faite très tôt, dès l’âge de cinq ans (voir l’Entretien avec Léo Gillet, Entretiens, op. cit., p. 69). Voir aussi De l’inconvénient d’être né, in op. cit., p. 1274. 3 Cioran, Précis de décomposition, in op. cit., p. 591. 4 F. Nietzsche, Le Gai Savoir, Gallimard, « Folio essais », 1989, § 42, p. 84. Nietzsche met l’accent sur le versant positif de l’ennui : parce qu’il sait inaugurer une profonde communion avec soi-même, le chasser à tout prix est « aussi vulgaire que le fait de travailler sans plaisir ». Voir aussi « Le voyageur et son ombre », Humain, trop humain, II, op. cit., § 200, insistant sur le fait que l’ennui et la solitude qu’il instaure autorisent une « communion profonde avec soi-même et la nature. Qui se retranche complètement contre l’ennui se retranche aussi de soi : il ne lui sera jamais donné de boire la plus tonique des gorgées à sa propre source intérieure. » (p. 265).
35
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
du temps qui disloque, entrave notre aspiration à l’être en nous entraînant perpétuellement loin de nous-mêmes. C’est pourquoi l’ennui constitue un mode primordial de connaissance car, en nous désengluant du monde, il nous ouvre aux strates profondes de la condition humaine. C’est en ce sens que Pascal, qui en avait décelé toute la portée existentielle, écrivait que l’homme peut en cette occasion sentir « son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide1 ». L’ennui représente le premier moment du déclin de l’instinct de vie. Il désigne le sentiment de la vacuité de toute chose comme de la vanité de toute action, donc de l’irréductible altérité du monde. Dans cette expérience, la vie propre comme le monde semblent perdre tout sens, toute consistance, précisément parce que l’ennui provoque, ainsi que l’analyse Cioran, le sentiment d’un décollement par rapport au temps2. Le temps n’est plus alors le temps requis ou restant pour accomplir telle ou telle tâche, donc empreint du sens conféré par le projet à accomplir. Il est désormais un cadre vide à l’intérieur duquel toute chose apparaît comme simplement là, sans raison. Ce manque d’adhésion au temps explicite que l’on soit alors réduit à la perception de l’écoulement des heures, indépendamment de ce qui advient, de tout événement susceptible de scander le temps. Dino, souffrant de cet insolite et douloureux détachement, exprime combien, alors, plus rien n’a de goût, tout paraît équivalent, décoloré et flétri, comme si le rapport avec le monde et les autres s’abolissait3. L’ennui est là, provoquant nausée et vide. C’est le temps lui-même qui est senti, sa vacuité omniprésente. Essayer de nous rabattre sur l’aspect purement quantitatif du temps – regarder sa montre ou l’horloge – est une action vouée à l’échec. Nous essayons en vain de nous extraire de cette emprise en faisant « passer » le temps, en « tuant » le temps : quête d’une occupation capable de nous libérer du vide de l’ennui. Le temps de l’ennui nous révèle combien le temps n’est pas en notre pouvoir, combien nous lui sommes soumis. L’ennui rogne, ronge les remparts et les illusions de la vie épaisse et joufflue. En cela, il nous apparaît comme cette expression première du mal de vivre logé au cœur de l’homme. Mal de vivre qui a trouvé sans doute son vrai nom avec la mélancolie et son accablante humeur noire, que l’on peut précisément qualifier avec Cioran d’« ennui raffiné ». En cela, l’ennui rejoint 1
B. Pascal, Pensées, op. cit., 131. « Je me rappelle on ne peut plus clairement cet après-midi où, pour la première fois, en face de l’univers vacant, je n’étais plus que fuite d’instants rebelles à remplir encore leur fonction propre. Le temps se décollait de l’être à mes dépens. » (Cioran, De l’inconvénient d’être né, in op. cit., p. 1274). Voir aussi l’Entretien avec Léo Gillet où Cioran écrit : « j’ai senti le temps se décoller de l’existence. Car c’est ça l’ennui. Dans la vie l’existence et le temps marchent ensemble, font une unité organique. On avance avec le temps. Dans l’ennui le temps se détache de l’existence et nous devient extérieur. » (Entretiens, op. cit., p. 70). 3 A. Moravia, L’Ennui, op. cit. Voir notamment le passage p. 7-8 : « Au point où j’en suis […] je ne sais quel miracle. » 2
36
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
les rivages mélancoliques sur un même tracé des échos du tragique. La mélancolie est ce voile noir, cette colonne de fumée qui sépare des autres pour mieux les voir dans leur réalité profonde. Souffle qui dissipe les vapeurs du monde. Nudité des visages. Suppression des écorces du réel. Conscience aiguë et douloureuse d’un intervalle qui se creuse dans la ligne temporelle. C’est se sentir agressé par les gestes, terrassé par les bruits, déchiré par les conversations. Auxquelles on ne prend pas part, tout paraissant enserré dans une brume épaisse. Trop de mots. Trop de claquements d’os. Être intérieurement habité et travaillé par le néant creusant en soi sa trouée sombre. Le temps se modifie profondément dans sa structure : élan vers l’avenir stoppé, temps stagnant lamentablement, morne répétition des instants sans ouverture vers un lendemain. L’ennui considéré dans sa dimension profonde constitue une approche essentielle de la nature entropique de notre condition. Il n’a donc rien d’un vulgaire accident psychologique, d’une forme accidentelle de l’expérience contre laquelle il nous reviendrait de lutter. Il est cette tonalité affective privilégiée qui exprime, d’une part, toute l’ambivalence de notre rapport au temps : ce temps que nous passons notre temps à quémander pour réaliser tel ou tel projet, nous ne pensons plus alors qu’à le « tuer ». Il met en évidence, d’autre part, ce fait essentiel que le plus dur à supporter pour une conscience déchargée de tout souci, c’est sa propre ipséité. Enseignement essentiel de l’ennui : la conscience exempte de tout souci ou fardeau est à elle-même son fardeau. Jankélévitch l’a mis en évidence : ce qui pèse si lourd alors, ce n’est pas la vie, la réflexion ou encore l’ensemble du monde, mais bien « la charge de son ipséité et de sa propre destinée1 » qui, rendue à elle-même, n’est que « le fait nu de mon existence comme personne2 ». La liberté est douloureuse. Cette liberté que nous ne cessons d’appeler de nos vœux vient nous piquer au vif en nous mettant à nu et face à notre responsabilité vis-à-vis de ce temps dont nous disposons, précisément parce que mise à nu, l’existence ne se distingue pas du néant. L’immense bâillement qui s’engouffre dans la vie distille un arrière-goût de néant, du néant promis. Ne dit-on pas « s’ennuyer mortellement » ? L’ennui qui terrasse l’individu, plaçant la conscience face à son pur destin, commence à parler de mort annoncée. Dès lors qu’il n’y a plus rien à attendre, qu’attend-on sinon sa propre mort ? L’ennui est cette attente sans objet, cette attente de rien, pour rien, qui ne peut que nous renvoyer à notre propre vide et révéler la singularité de notre manière d’exister. Nous tuons le temps et nous nous ennuyons mortellement, tout en courant après le temps dont la fuite nous oppresse. Distorsion que Jankélévitch exprime au plus juste : « Les heures arrêtées nous ennuient, mais les heures fugaces et les moments irréversibles nous inspirent des
1 2
V. Jankélévitch, L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux, op. cit., p. 113. Ibid., p. 114.
37
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
regrets cuisants. Le temps nous paraît long, et la vie nous semble courte. Comment des années si courtes se fabriquent-elles avec des journées si longues ? Brève et longue, telle est la vie : comprenne qui pourra ! Car cette existence interminable aura été finalement une vie brève, brévissime comme l’éclair dans la nuit1. » C’est là toute la portée de l’ennui profond de se caractériser par ce profond paradoxe : « ce qui laisse vide – à la manière de l’envoûtement – est le temps du Dasein comme tel. Et ce qui fait traîner en astreignant est ce temps dans sa possibilité comme instant, c’est l’être-temporel du Dasein luimême, relativement à ce qui lui est propre essentiellement, et plus précisément dans le sens de la possibilisation du Dasein en général : horizon et instant. L’élément qui ennuie dans l’ennui profond, donc – selon ce qui précède – ce qui uniquement et véritablement ennuie, c’est l’être-temporel dans une modalité précise de sa temporation2. » Situation éminemment paradoxale de l’ennui profond que souligne ici Heidegger. Le temps propre à l’être, caractérisé à la fois par la dimension d’instant et d’horizon, ce qui advient et ce qui perdure, se voit totalement brouillé par l’ennui : sur le premier versant, les instants ne se succèdent plus, le temps, traînant en longueur, semble se détacher de l’existence ; sur l’autre et simultanément, l’individu esseulé prend conscience de la brièveté de sa vie, découvre sa finitude. De quoi mettre en évidence que la présence englobante du monde se dévoile à nous à la faveur de sentiments particuliers. Et tel est le cas précisément de l’ennui profond qui « essaimant comme un brouillard silencieux dans les abîmes de la réalité-humaine, rapproche les hommes et les choses, et vous-mêmes avec tous, dans une indifférenciation étonnante3 ». Voici l’ennui véritable, profond, « où un rien nous accable parce que tout vraiment nous pèse4 ». Cet ennui-là nous ouvre au monde, à l’existant dans son ensemble. En cela, il constitue bien pour le Dasein une « disposition affective » privilégiée. Rappelons, au-delà de la dimension essentiellement intraduisible du terme et de la portée ontologique que Heidegger entend lui donner, que Dasein (littéralement « être-là ») est, comme le suggère Jeanne Hersch, quasiment synonyme d’« homme », en tant que le mot désigne l’étant qui découvre qu’il-est-là : dans le monde, en un lieu, dans une situation où il est jeté5. Heidegger écrit dans la conférence « Le concept du temps » : « par être-là nous entendons l’étant que nous
1
Ibid., p. 171. M. Heidegger, Les Concepts fondamentaux de la métaphysique, op. cit., § 35, p. 238. 3 M. Heidegger, « Qu’est-ce que la métaphysique ? », op. cit., p. 56. 4 M. Corvez, La Philosophie de Heidegger, PUF, « Initiation philosophique », 1961, p. 35. 5 J. Hersch, L’Étonnement philosophique. Une histoire de la philosophie, Gallimard, « Folio essais », 1993, p. 416. 2
38
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
connaissons comme vie humaine en son être (in seinem Sein)1 ». Le Dasein désigne l’être de l’existant humain en tant qu’existence singulière concrète, l’existence humaine étant conçue comme être-au-monde. Avec le Dasein, Heidegger vise l’homme dans sa dimension profonde, l’être humain dans son essence. Il recherche les éléments susceptibles de le caractériser en profondeur. Que dire et comprendre, à partir de là, de la disposition affective que le philosophe allemand met en évidence ? Celle-ci doit être considérée comme un trait fondamental de notre être-au-monde. En ce sens, elle n’est pas un phénomène purement objectif ou seulement subjectif dans l’homme qui ne nous renseignerait que sur notre vie mentale. Elle se constitue dans la polarité entre l’homme et le monde qui l’entoure2. C’est ainsi que le Dasein entretient un rapport avec le monde, trouve un fondement dans l’existant. C’est à travers la disposition affective que le Dasein se rend compte qu’il existe3, il voit et sent ce qu’il est et comment il se sent4. Par ailleurs, elle met en lumière sa situation au milieu des existants auxquels il est ouvert. La disposition m’ouvre donc à la totalité de l’existant. « Elle me manifeste que je suis un être situé, individualisé : le lieu où se rencontrent le monde, les autres et moi-même5. » C’est dire que la disposition affective, en ouvrant le monde en son entier, constitue un cadre primordial pour la perception et la compréhension, le cadre à partir duquel le monde, les êtres et les choses nous apparaissent, s’avèrent ou non porteurs de sens. Cela signifie que le Dasein se dévoile d’abord à lui-même sur le mode affectif, plus originellement que ne pourrait l’autoriser la connaissance théorique. Or l’ennui profond, en raison de son caractère englobant, de l’« envoûtement » dans lequel il nous plonge, est reconnu par le philosophe comme dimension essentielle du Dasein humain ; il fait partie de ces tonalités fondamentales qui témoignent du mode d’être de l’homme tel qu’il est, « à savoir le Dasein lui-même dans la manière dont il est, dans la manière dont il se trouve et se situe auprès de lui-même et auprès des choses6 ». L’ennui profond nous dévoile notre essence véritable d’être « jeté » dans le monde, sans ancrage. Accession à la conscience de notre être-au-monde, qui offre une ouverture concrète au questionnement sur notre condition, sur la singularité de notre manière d’exister.
1
M. Heidegger, « Le concept du temps » (1924), in M. Haar (sous la dir.), Cahier de l’Herne / Heidegger, Le Livre de Poche, « Biblio essais », 1986, p. 38. 2 Lars Fr. H. Svendsen, Petite philosophie de l’ennui, Le Livre de Poche, 2006, p. 159. 3 Rappelons que le terme « existence », comme l’explicite J. Hersch, doit être entendu, chez Heidegger, d’après la racine du mot « existere » (ek-sistere), qui signifie « surgir hors de… ». 4 « La disposition révèle “comment on se sent”, “comment on va”. » (M. Heidegger, Être et Temps, Gallimard, « Bibliothèque de Philosophie », 1986, § 29, p. 178). 5 M. Corvez, La Philosophie de Heidegger, op. cit., p. 34. 6 M. Heidegger, Les Concepts fondamentaux de la métaphysique, op. cit., § 36, p. 240.
39
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
La déréliction s’avance, dépouillant du trop-plein de significations, et nous verrons ultérieurement quelles implications profondes peuvent en découler pour l’existant humain. Disons pour l’heure que, dans l’ennui, l’on se trouve dans une tonalité affective à travers laquelle le monde n’apparaît plus comme un champ de possibilités. Dans cette crise des rapports de l’homme et de la réalité, les possibilités se retirent. Signe premier de la présence indéracinable du vide en l’homme. Comme nous l’avons vu, dans l’ennui, les événements, les objets et les êtres ne changent pas, mais apparaissent comme vides de sens. Première mise en jeu de notre être-aumonde pour cet étant particulier que nous sommes. L’ennui en touchant au cœur profond de l’existence1, en s’attaquant à son armature même, nous met face à notre impuissance radicale envers ce temps inerte et disloqué, et nous rappelle à notre modestie. À travers le temps de l’ennui, stagnant, brouillé et dévastateur, notre existence, emprisonnée et ramenée à son propre vide, peut reconnaître la manifestation même du temps mortifère2. Depuis l’écho glacé de l’ennui jusqu’à l’angoisse du néant, le temps ne peut manquer d’être le lieu du tourment, pour la simple et bonne raison qu’il se confond rigoureusement avec notre existence. L’homme, « tumeur du temps », n’en est qu’une « excroissance », qu’une « souffrance »3. Ce n’est donc pas assez dire, rigoureusement parlant, que nous vivons « dans le temps », comme s’il était un courant indépendant et extérieur à notre être. Nous « vivons le temps », les deux termes sont indissociables. Comme Heidegger s’est attaché à le démontrer, le temps n’a rien d’un cadre dans lequel se placerait l’existence du Dasein. Sa structure est constituée par le temps. Le temps est notre étoffe même, il est l’expression du fait d’exister. Exister signifie se temporaliser. L’être humain est le temps et c’est en tant que tel qu’il est capable de connaître et de se comprendre. Si notre destin a un caractère « effrayant », comme nous le confirme Jorge Luis Borges, c’est « parce qu’il est irréversible, parce qu’il est de fer. Le temps est la substance dont je suis fait. Le temps est un fleuve qui m’entraîne, mais je suis le temps ; c’est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre ; c’est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Pour notre malheur, le monde est réel, et moi, pour mon malheur, je suis Borges4. » 1
Dans La Nausée, Roquentin dit précisément trouver dans l’ennui le « cœur profond de l’existence ». Il s’exprime en ces termes : « De temps en temps je bâille si fort que les larmes me roulent sur les joues. C’est un ennui profond, profond, le cœur profond de l’existence, la matière même dont je suis fait. » (J.-P. Sartre, La Nausée, Gallimard, « Folio », 1972, p. 222). 2 Dans cet ordre d’idées, Louis Lavelle écrit : « La conscience du temps, sous sa forme la plus pure, c’est l’ennui, c’est-à-dire la conscience d’un intervalle que rien ne traverse ou que rien ne peut combler. » (L. Lavelle, Du temps et de l’éternité, Aubier-Montaigne, 1945, p. 236). 3 J.-M. Domenach, Le Retour du tragique, Seuil, « Points », 1972, p. 260-261. 4 J. L. Borges, « Nouvelle réfutation du temps », Enquêtes, Gallimard, 1986, p. 247-248.
40
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Et nous, pour notre malheur, nous sommes faits de la substance de ce temps qui, à mesure que nous nous affirmons, ne fait en somme que nous acheminer vers notre inexistence − « c’est l’homme tout entier qui est le temps incarné, un temps à deux pattes qui va, qui vient et qui meurt1 ».
1
V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, op. cit., p. 30.
41
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
II. Non-être et insignifiance Angoisse et non-être « La sensation d’oppression était si grande / qu’on n’eut plus de souvenir tout à coup, / plus de pensée d’avenir. » Peter Handke, Le Non-sens et le bonheur.
« Il y a une angoisse acide et trouble, aussi puissante qu’un couteau, et dont l’écartèlement a le poids de la terre, une angoisse en éclairs, en ponctuation de gouffres, serrés et pressés comme des punaises, comme une sorte de vermine dure et dont tous les mouvements sont figés, une angoisse où l’esprit s’étrangle et se coupe lui-même, − se tue. Elle ne consume rien qui ne lui appartienne, elle naît de sa propre asphyxie. Elle est une congélation de la moelle, une absence de feu mental, un manque de circulation de la vie1. » L’angoisse. Voici la « disposibilité affective fondamentale2 », ainsi nommée par Heidegger, à la faveur de laquelle l’homme réalise que, loin d’être maître de son être, il est déterminé par le néant qui est le fondement de son être. Car si, comme nous avons essayé de le montrer, l’ennui « semble préluder à la tragédie comme l’“aura” annonce la crise3 », il paraît néanmoins insuffisant, à lui seul, à produire la révélation tragique. La raison en est simple : à la différence de l’« aura » qui « annonce cette crise effectivement », l’ennui, lui, « préface sans fin »4, fonctionne rigoureusement en circuit fermé. « L’ennui, qui a l’air de tout approfondir, n’approfondit en fait rien, pour la raison qu’il ne descend qu’en lui-même et ne sonde que son propre vide5. » Et en cela, à l’image du serpent qui se mord la queue, il devient lui-même l’enfer dont il distillait les premières vapeurs. « L’ennui est bien une forme d’anxiété mais d’une anxiété purgée de peur. Lorsqu’on s’ennuie on ne redoute en effet rien, sinon l’ennui lui-même6. » Le cœur de l’ennui constitue le premier écœurement fondamental. En cela, il est un premier révélateur mais qui, ne redoutant plus que lui-même, nécessite un autre détonateur. Dans l’ennui, la vie, en s’engourdissant, pousse si l’on peut dire la porte du néant : vie en la mort, mais sans atteindre encore à la déchirure. Noyant le réel dans son indifférence, avec lui tout
1
A. Artaud, L’Ombilic des Limbes, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 1968, p. 74. M. Heidegger, Être et Temps, op. cit., § 40, p. 233. 3 V. Jankélévitch, L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux, op. cit., p. 126. 4 Ibid. 5 Cioran, Écartèlement, in op. cit., p. 1495. 6 Cioran, Aveux et Anathèmes, in op. cit., p. 1647. 2
42
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
devient morne et terne ; il apporte avec lui la torpeur, non le tourment et la déchirure, requis pour un véritable dessillement des yeux. L’ennui constitue une première révélation du monde, mais c’est par l’angoisse que l’homme s’ouvre décidément au monde. Qu’est-ce que l’angoisse a de plus que l’ennui ? Elle est, comme lui, un guetteur impitoyable disposé à nous ouvrir à notre humanité, mais doté d’une capacité de déchirure interne. Aussi, là où l’ennui voit le cycle du réel tourner sur lui-même, l’angoisse voit la réalité avec un verre grossissant, seul à même de la faire proprement apparaître dans toute sa crudité. Par le désarroi qu’elle produit, l’angoisse incarne cette tonalité affective essentielle seule en mesure d’imbiber totalement les éléments du réel. C’est donc saisi par l’angoisse que l’homme peut vraiment se révéler à lui-même dans sa misère, dans son état désarmé, dans son néant. Puissance d’« écartèlement », on ne peut mieux condensée dans les propos d’Artaud ci-dessus, que nous allons tenter de décrire. L’angoisse est à ranger sous le régime des émotions fortes, précisément en ce qu’elle se présente comme une secousse affective soudaine de tout notre être. Mais, avec l’angoisse, nous n’évoquons pas n’importe quelle émotion forte, car une fois l’orage affectif passé tout ne s’arrête pas pour autant. L’angoisse désigne une émotion dotée d’une valeur très particulière, car susceptible d’ouvrir sur un autre ordre de la réalité. Et l’on comprend pourquoi Heidegger l’a qualifiée de « disposition affective fondamentale ». L’angoisse peut surgir à la suite d’un événement capable de fissurer le cours ordinaire du quotidien – rupture affective amicale ou amoureuse, maladie, violence subie de la part des autres ou des éléments, perte d’un proche. Tout ce qui peut briser le point de vue de l’inébranlable et faire vaciller l’existence. Mais de même que, face à ces entailles, beaucoup d’individus courbent la tête pour rejoindre le chemin de l’ignorance d’euxmêmes et esquiver le tranchant aigu de leur précarité, de même, l’angoisse, pour celui dont la sensibilité ne se satisfait guère d’occultation, peut survenir pour ainsi dire sans prévenir, un jour a priori comme un autre. « Encore un beau jour », dirait Winnie. L’angoisse pour se déclencher n’a donc nul besoin d’événement exceptionnel. Celle-ci peut survenir dans le cours de l’existence à la faveur d’une certaine inclinaison du paysage ou, comme pour Grégor Keuschnig, à la suite d’un rêve susceptible de fendiller l’enchaînement coutumier et rassurant des images quotidiennes1. Ainsi Keuschnig a-t-il rêvé qu’il tuait une vieille femme. Au sortir de ce rêve perturbant, les heures vont alors prendre un tour inédit : l’angoisse va investir Grégor. Pour l’homme saisi par l’angoisse, s’inaugure un voyage de l’extérieur à l’intérieur, au centre de soi. Représentons-nous sa marche : les lieux qu’il
1
P. Handke, L’Heure de la sensation vraie, Gallimard, « Folio », 1988.
43
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
foule en ce moment de ses pieds lui sont connus, familiers. Et puis tout à coup : crac, panne d’électricité, tout le bel édifice s’écroule. « D’un seul coup, il ne fit plus partie de rien1. » Naufrage subit que les mots de Peter Handke, traduisant l’effondrement du cadre d’existence de Keuschnig, expriment pleinement. Une peur inexplicable le gagne, diffuse, sans objet assignable. Voici l’angoisse et sa teneur essentielle : à la différence de la peur qui contient une menace précise toujours issue d’« un étant nocif intérieur au monde2 », le propre de l’angoisse est de n’avoir trait à aucune source identifiable. De même que nous avons distingué l’ennui ordinaire de l’ennui profond, il importe de préciser les contours de l’angoisse. Celle-ci n’est pas réductible à l’inquiétude ou à la peur. L’inquiétude est un sentiment vague d’une menace, mais non accompagné de détresse, tandis que la peur répond à une menace déterminée. La peur n’a rien d’anodin, dans la mesure où elle nous ouvre à la conscience de la fragilité de notre présence au monde. Elle est une épreuve immédiate et brutale du réel qui demande alors à être reconnu sous son jour menaçant. Il reste que, dans la mesure où son objet intentionnel est déterminé, la peur est une affection qui, en principe tout au moins, ne me laisse pas totalement désemparé. Que je parvienne ou non à le mettre en œuvre, je peux me représenter un moyen de l’apaiser ou de m’y dérober, les conditions donc d’un dégagement de son emprise ou de sa suppression. Or l’angoisse signifie détresse et effroi, mais sans qu’il y ait pour autant un danger identifiable. Ce qui signifie rappeler toute la différence entre le sentiment qui a souvent un objet intentionnel et la tonalité affective qui est sans objet parce qu’elle concerne plutôt la totalité des objets, autrement dit le monde. « L’angoisse est foncièrement différente de la crainte. […] Certes, l’angoisse est toujours “angoisse devant…”, mais non point devant ceci ou cela. L’angoisse “devant…” est toujours angoisse “pour…”, mais non point pour ceci ou pour cela. Pourtant, l’indétermination de ce devant quoi et pour quoi nous nous angoissons n’est pas un manque pur et simple de détermination ; c’est l’impossibilité essentielle de recevoir une détermination quelconque3. » Distinction fondamentale qui permet de marquer la spécificité de l’angoisse. Tandis que l’objet à fuir, redoutable, est la cause directe de la peur, « l’objet angoissant, telle une menace vague, a toujours quelque chose de brumeux et d’indéfinissable4 ». Ce qui importe donc est son caractère englobant : elle concerne la totalité des objets, c’est-à-dire le
1
Ibid., p. 10. M. Heidegger, Être et Temps, op. cit., § 40, p. 234. 3 M. Heidegger, « Qu’est-ce que la métaphysique ? », op. cit., p. 57-58. On trouve dans les Cahiers de Cioran une appréciation de l’angoisse du même ordre : « L’angoisse n’a pas besoin d’un danger extérieur ; généralement elle vit sous une menace sans objet. » (Cioran, Cahiers (1957-1972), Gallimard, « Blanche », 1997, p. 370). 4 V. Jankélévitch, L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux, op. cit., p. 55. 2
44
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
monde lui-même. Sorte de monstre absent, d’ennemi invisible et insaisissable. C’est le rien qui angoisse l’angoisse, un rien qui est partout et nulle part. Autrement dit, c’est l’être-au-monde lui-même. De sorte que l’on peut considérer qu’avec l’angoisse je suis menacé comme existence, et non pas au sein de celle-ci. Nulle extériorité ici. Mise en jeu de notre « propre pouvoir-être-au-monde1 », c’est du centre même de notre être, en effet, que l’angoisse s’exhale. Personne à appeler à la rescousse. Nul endroit où fuir. Impossibilité soudaine de reculer ou d’avancer. L’angoisse est ce « défilé étroit » (du latin angustia, dérivé de angustus : « étroit, resserré ») qui nous accule dans l’impasse, nous cloue littéralement sur place en proie à une incommensurable détresse : HAMM (avec angoisse). – Mais qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qui se passe ? CLOV. – Quelque chose suit son cours2.
Quelque chose qui exige l’épreuve de sa manifestation. « L’angoisse est, selon les mots de Jankélévitch, le désarroi produit en nous par l’appréhension d’un instant qui suspendra la continuation douillette de l’intervalle, qui va interrompre la berceuse des répétitions somnolentes3. » Voilà ce qui fait battre le cœur de l’angoisse : « l’avènement du tout-autreordre, de l’absolument-autre4 ». Frissons. Grincement de dents. Sensation d’étouffement, d’une intolérable oppression. Processus de désaffection enclenché. Le monde semble se fermer autour de soi : « une vapeur fuligineuse s’essore du fond de l’âme et s’interpose entre le désir et la vie ; elle forme un écran livide, nous sépare du reste du monde dont la chaleur, l’amour, la couleur, l’harmonie ne nous parviennent plus que réfractés en une transposition abstraite5 ». Un vide s’opère : effondrement de toute valeur, chute de l’être dans une insignifiance totale du monde. C’est l’écroulement du familier. Familier désignant, d’une part, le monde ordinaire de la vie quotidienne : « l’utilisable du monde ambiant6 », l’ensemble des objets qui sont sous la main et alentour, et, d’autre part, le monde des relations avec autrui : le monde de l’« être-avec en compagnie des autres » ou mit sein7. Dans l’angoisse, c’est tout cela qui s’effondre ; tout se retire, n’étant plus disponible, et laisse l’homme par conséquent dans son entière solitude : « solus ipse8 » (« lui-même seul »). L’homme se retrouve seul, tout seul. L’impression cruelle – comme celle du Solitaire – « d’être 1
M. Heidegger, Être et Temps, op. cit., § 40, p. 237. FP, p. 28. 3 V. Jankélévitch, L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux, op. cit., p. 69. 4 Ibid., p. 61. 5 A. Gide, Isabelle, Le Livre de Poche, 1960, p. 104-105. 6 M. Heidegger, Être et Temps, op. cit., § 40, p. 237. 7 Ibid., § 53, p. 318. 8 Ibid., § 40, p. 237. 2
45
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
séparé du reste, l’impression d’être dans une sorte de cage en verre1 » : un « spectateur sur le plateau au milieu des acteurs2 ». Plus auprès de personne, l’homme a perdu son chez-soi3. Dans l’angoisse, en effet, on se sent « étrangé4 ». Ce que les propos de Winnie, prise désormais dans les rets de l’angoisse, traduisent on ne peut plus nettement : – Étrange, de tels revenants, à un tel moment. (Un temps.) Étrange ? (Un temps.) Non, ici tout est étrange5. – Ça pourrait sembler étrange – oui, sans doute – ce…comment dire ? – ce que je viens de dire – oui, sans doute – (elle ramasse le revolver) – étrange – (elle se tourne pour rentrer le revolver dans le sac) – si ce n’était – (sur le point de rentrer le revolver elle arrête son geste et revient de face) – si ce n’était – (elle dépose le revolver à sa droite, s’arrête de ranger, lève la tête) – que tout semble étrange. (Un temps.) Très étrange. (Un temps.) Jamais rien qui change. (Un temps.) Et de plus en plus étrange6.
Sentiment d’égarement absolu qui pousse l’angoisse à son paroxysme, que Freud a décrit et analysé sous le titre de Das Unheimliche7 (ce qui n’appartient pas à la maison et pourtant y demeure), terme à la double connotation que l’on peut traduire en français par « inquiétante étrangeté » ou par « étrange familier ». Freud l’explicite ainsi : « l’inquiétante étrangeté est cette variété particulière de l’effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, au depuis longtemps familier8 ». L’effrayant, l’épouvante angoissée, ne sont donc pas issus de l’irruption du nouveau, de l’inédit, mais précisément et paradoxalement du connu, du familier, de l’apprivoisé. L’inquiétant émane de l’écho trouvé en nous de ces choses que l’on voudrait voir rester dans l’ombre, demeurer étrangères à nous-mêmes. Et, comme Freud le reconnaît, rien ne paraît plus étrangement inquiétant que ce qui se rattache à la mort, dans la mesure où l’homme ne se résout pas à reconnaître l’évidence de sa mortalité. La situation vécue constitue alors une sorte de retour du refoulé qui vient menacer les défenses mises en place et provoquer l’apparition de l’angoisse. Comme l’exprime A., « il implique donc que nous sommes éjectés de la coquille protectrice de nos perceptions habituelles, comme si nous nous trouvions soudain hors de nous-mêmes, à la dérive dans un monde que nous
1
E. Ionesco, Le Solitaire, op. cit., p. 99. Ibid., p. 74. 3 « L’être-au prend le “mode” existential du pas-chez-soi. » (M. Heidegger, Être et Temps, op. cit., § 40, p. 238). 4 Ibid. 5 S. Beckett, Oh les beaux jours, Minuit, 1963, p. 51. Désormais abrégé en OBJ. 6 Ibid., p. 53. 7 S. Freud, « L’inquiétante étrangeté », L’Inquiétante étrangeté et autres essais, Gallimard, « Connaissance de l’Inconscient », 1985. 8 Ibid., p. 215. 2
46
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
ne comprenons pas. Par définition, nous sommes perdus dans ce monde. Nous ne pouvons pas espérer y retrouver notre chemin1 ». Keuschnig, dans sa chute, éprouve lui aussi ce complet effondrement des repères : « Bien qu’il vît les mêmes choses que toujours, sous le même angle de vue, tout, cependant, était devenu étranger et pouvait ainsi être vécu2. » Le monde semble s’effriter autour de lui, apparaissant dès lors sous un jour désarticulé et menaçant. Tout semble désormais poreux, signe de mort. Ainsi, notamment, le simple fait que sa fille soit en train de manger de la mortadelle3 s’inscrit dans le faisceau des signes de la désagrégation envahissante de tout rempart protecteur. La réalité de l’habitude se met à vaciller pour prendre une tout autre signification. Le plus familier devient le plus étranger. Vertige. Moment crucial de l’aléatoire d’exister. Qui suis-je ? Où suis-je ? Déréliction. Être jeté-là, perdu au monde, littéralement égaré, abandonné, sur cette terre si familière, si étrangère. Sous nos pas incertains, le sol se dérobe. « Nos pas paraissaient adhérer au sol, et nous découvrons brusquement qu’il n’y a rien qui ressemble au sol, qu’il n’y a rien non plus qui ressemble à des pas4. » Vertige de l’étrangeté : rien ne change et, cependant, tout a changé. Je m’y reconnais mais je ne m’y retrouve plus, plus du tout. On ne touche à sa propre profondeur que dans l’égarement le plus grand. Qui suis-je ? Impossible de faire coïncider, de (ré)concilier le moi d’hier et celui d’aujourd’hui. Où suis-je ? Impossible de retrouver son lieu propre, de se situer dans ce moment que l’on est en train de vivre. Perte des repères, de toute assise, de toute base ferme. « Voir soudain – et trop tard – le présent, le proche, le familier, comme absent, lointain et étrange, est l’expérience tragique par excellence5. » Expérience tragique par excellence, comme l’exprime Rosset, puisqu’elle signifie perdre de vue l’image familière à laquelle on était attaché et avec laquelle on vivait en sécurité (le bon vivant, le bien-portant…) pour se découvrir tout à coup perdu, non pas tant au dehors, dans l’univers externe, mais dans le champ devenu singulier et inquiétant de son existence intime. Car c’est, du même coup, se retrouver nu, sans protection : sans identité, sans amour et sans vie. Être investi totalement par le vide que les mots de Cioran décrivent au plus près : « l’expérience du vide. On ne voit plus rien en dehors du rien, et ce rien est tout6. » Et le Néant n’est plus très loin : « Je pressentais quelque chose de vide, quelque chose de noir, quelque chose
1
P. Auster, L’Invention de la solitude, Actes Sud, « Babel », 1992, p. 232. P. Handke, L’Heure de la sensation vraie, op. cit., p. 149. 3 Ibid., p. 109. 4 Cioran, Écartèlement, in op. cit., p. 1451. 5 C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 60. 6 Cioran, Des larmes et des saints, in Œuvres, op. cit., p. 306. 2
47
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
d’hostile, de géant… mais plus moi1… » Sans doute Rosset n’a-t-il pas tort : le fondement de l’angoisse, apparemment lié à la simple découverte que l’autre visible n’était pas l’autre réel, ressortit en fait à « une terreur plus profonde : de n’être pas moi-même celui que je croyais être. Et, plus profondément encore, de soupçonner en cette occasion que je suis peut-être non pas quelque chose, mais rien2. » L’angoisse, en faisant vaciller toute l’importance du monde banal dans le néant, l’angoisse devant rien, fait surgir devant nous la facticité de notre existence et révèle ainsi l’homme à lui-même. Parce que dans l’angoisse se produit un glissement de l’existant dans son ensemble, il ne reste rien comme appui. « Seule, la pure réalité-humaine réalisant sa présence est encore là dans la secousse qui la laisse en suspens, et qui ne lui permet de se raccrocher à rien3. » Dans ce glissement dans le vide de l’existant, il ne reste et il ne nous survient que ce « rien ». Autrement dit, le Néant lui-même. « Que l’angoisse dévoile le Néant, c’est ce que l’homme confirme lui-même lorsque l’angoisse a cédé. Avec le clairvoyant regard que porte le souvenir tout frais, nous sommes forcés de dire : ce devant quoi et pour quoi nous nous angoissions n’était “réellement”… rien. En effet : le Néant lui-même – comme tel – était là4. » « Comme tel », c’est-à-dire non point comme une fiction ou une simple émotion, mais bien comme la possibilité de révélation de l’étant pour le Dasein humain qui en est si profondément imprégné que Heidegger n’hésite pas à employer la formule : l’homme est le lieu-tenant (« Platz-halter ») ou la sentinelle du Néant5. L’Heure de la sensation vraie. Grégor Keuschnig l’a suffisamment éprouvée : « Sentiments de vie empruntés ; que l’organisme, ce jour-là, rejetait tout de suite. Et la seule activité qu’il avait encore, c’était ce rejet : avait-il éliminé les sentiments artificiels, alors il ne restait rien de sensible de lui ; rien d’autre, en tout cas, qu’une absence d’être d’une lourdeur cadavérique, pesante ; mise en travers du monde entier6. » La mort drapée perd de son vernis, manque son maquillage. Le cadavre potentiel que nous sommes se profile, s’insinue, se pavane au creux de nos entrailles. Existence mise à nu, sans fard, tous les masques arrachés, ramenée à sa chair ni plus ni moins, à sa cadavérique dimension. Géographie intérieure de notre vérité intime et implacable, révélant à l’homme sa mortalité profonde. Certes, je ne puis coïncider avec ma propre mort. Néanmoins, si l’angoisse n’est pas, à proprement parler, une révélation de la mort, elle se pose bien comme une saisie du néant qui nous détermine. Elle est 1
G. Bataille, Le Bleu du ciel, in Œuvres complètes, III, Gallimard, « Blanche », 1974, p. 430. C. Rosset, Le Réel et son double, Gallimard, « Folio essais », 1993, p. 96. 3 M. Heidegger, « Qu’est-ce que la métaphysique ? », op. cit., p. 59. 4 Ibid. 5 Ibid., p. 66. 6 P. Handke, L’Heure de la sensation vraie, op. cit., p. 62. 2
48
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
l’assomption de la proximité du néant, du non-être potentiel de l’être propre. En elle, par la « fluidification absolue de toute subsistance1 » qu’elle opère, l’homme se place devant le rien de la possible impossibilité de son existence. Il n’est plus temps d’appréhender la mort, comme tente de le faire Drogo, comme « cette chose connue et absurde qui ne pouvait le concerner2 ». Se retrouvant face à lui-même, devant sa pure et simple précarité, l’homme découvre son être en tant qu’« être vers la mort ». Et cette mort signifie non pas fin ou simple cessation de la vie, mais destruction, négation totale et radicale de son être : la possibilité de l’impossibilité pure et simple « de tout comportement envers…, de tout exister3 ». L’angoisse contient ainsi la révélation, « non pas intellectuelle et abstraite mais affective et vitale4 » de notre finitude, c’est-à-dire du caractère fondamentalement fini de la temporalité de notre vie. « Dans l’angoisse se dissipent les illusions qui masquent le rien fondamental – l’apparence. L’angoisse nous mène jusqu’au rien, jusqu’au point où il apparaît, à la lumière absolument non voilée de la mort, d’abord que le rien est notre étoffe même, ensuite que l’on vit non pour ou en vue de mais pour rien5 ». Au bout, tout au bout de la nuit : y parvenir pour comprendre que cette nuit nous habite. Dévoilement. Découverte. L’expérience cruciale : point d’aboutissement de la révélation graduelle dans un concentré d’abattement et de néantisation. À nos oreilles semble résonner un lugubre écho, à l’image du Cri d’Edvard Munch6 retentissant dans la nuit. Au premier plan de la composition, la bouche ouverte du personnage au visage cadavérique, se tenant la tête entre les mains et immergé dans un paysage instable aux lignes sinueuses et aux couleurs violentes, impose l’expression du cri s’échappant des profondeurs humaines. Version picturale de la douleur et du désarroi de l’individu investi par l’angoisse. Munch a raconté la genèse de ce tableau : « Je longeais le chemin avec deux amis ; c’est alors que le soleil se coucha, le ciel devint tout à coup rouge couleur de sang. Je m’arrêtai, m’adossai, épuisé à mort contre une barrière. Le fjord d’un noir bleuté et la ville étaient inondés de sang et ravagés par des langues de feu. Mes amis poursuivirent leur chemin, tandis que je tremblais encore d’angoisse, et je sentis que la nature était traversée par un long cri infini7. » Être écartelé, mis en miettes. Tempête dans la tête. Le ciel est terrible, impitoyable. Rouge. Rouge sang.
1
Expression de Hegel citée par F. Dastur dans La Mort, op. cit., p. 74. D. Buzzati, Le Désert des Tartares, Le Livre de Poche, 1968, p. 79. 3 M. Heidegger, Être et Temps, op. cit., § 53, p. 317. 4 M. Conche, Temps et destin, op. cit., p. 125. 5 Ibid., p. 136. 6 Toile du peintre expressionniste norvégien Edvard Munch peinte en 1893. 7 Extrait du journal de Munch du 22 janvier 1892. Cité par Y. Hersant, Mélancolies, Robert Laffont, « Bouquins », 2005, p. 804. 2
49
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
– Veux-tu baigner ta joie Dans le rouge couchant ? le voilà loin, froide est la terre L’oiseau de nuit froisse l’air Désagréablement devant tes yeux1.
Le cri ou la mesure de la solitude de l’homme ramené à sa précarité essentielle. Vladimir a raison – « L’air est plein de nos cris. (Il écoute.) Mais l’habitude est une grande sourdine2. » Cette fois-ci – le fil de la quotidienneté rompu par le tranchant de la douleur –, nous pouvons les entendre. Cris épars soudain résorbés en un seul grand Cri qui résonne en soi-même : écho de notre déchirure interne, de notre conscience douloureuse. Sentiment – même s’il est illusoire – de porter en soi toutes les souffrances de la condition humaine. Sentiment, d’ailleurs, peut-être pas si illusoire que cela si l’on en croit Georges Poulet commentant la pensée baudelairienne : « À ce point, la profondeur d’existence cesse d’être une profondeur individuelle. Ce n’est plus simplement dans les espaces temporels de sa vie propre, que l’âme entend résonner l’écho de ses plaintes et de ses joies : “C’est un cri répété par mille sentinelles,” sentinelles qui, depuis l’origine des temps, se renvoient de l’une à l’autre le même cri, cri qui n’est plus celui d’un être particulier, mais d’un être général en qui l’angoisse humaine retentit3. » L’angoisse désigne cette immense enflure, douleur à la fois la plus individuelle qui soit et la plus universelle, comme si ce cri étouffé intégrait en lui-même tous les cris des autres hommes. C’est pourquoi ma douleur est celle de tous les hommes, ma mort est celle de tous les hommes, autrement dit de l’homme. Mais, si l’angoisse sait dépasser les barrières de l’individualité pour parler de la mort de l’homme, il n’est pas question pour autant de nier notre subjectivité et la solitude qui lui est attachée. Ce qui amène Borges à écrire dans son poème Toi : « Un seul homme est né, un seul homme est mort sur la terre. […] Un seul homme est mort dans les hôpitaux, dans des navires, dans la rude solitude, dans l’alcôve de l’habitude et de l’amour. […] Je parle de l’unique, de l’un, de celui qui est toujours seul4. » Et c’est bien la mort de l’individu, de chaque individu que Borges désigne ici, loin des généralités et des abstractions. En effet, si la mort n’est plus, dès lors, un terme abstrait ou une réalité théorique, c’est bien parce qu’il s’agit avant tout de ma mort, et non de celle des hommes en général. C’est moi qui suis menacé de mort et c’est à ce titre 1
Hölderlin, Poèmes antérieurs, op. cit., « La Brièveté », p. 32. EAG, p. 128. 3 G. Poulet, Études sur le temps humain, I, Presses Pocket, « Agora », 1989, p. 385. 4 J. L. Borges, « Toi », L’Or des tigres, in Œuvres complètes, II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 277-278. 2
50
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
que je prends conscience de mon individualité. L’empreinte de la mort est là, dans tous nos pores, interdisant toute catharsis. Je réalise que je vais mourir, moi et pas un autre. Et, comme l’explicite Jankélévitch : « Réaliser qu’on va mourir, ce n’est pas déduire de la vérité générale un cas particulier, c’est s’appliquer à soi-même la vérité inconcevable, la vérité sanglante du déchirement et de l’arrachement à l’être1. » En se situant par rapport à sa possibilité la plus extrême qu’est la mort, l’homme accède à la conscience de son individualité et s’arrache à l’anonymat du « on » dans lequel il se laisse si facilement dissoudre. Je sais que « je » suis, précisément parce que c’est moi, et non l’homme en général (« on meurt »), qui suis condamné à mort et perpétuellement menacé par elle. De là le vertige qui s’empare inévitablement de l’homme ainsi livré au sentiment du presque-rien qu’il est. La mort est ma mort, et je ne comprends rien à ma propre mort. Négation radicale au cœur de l’être, le rapport établi avec notre propre mortalité vient enrayer notre marche par l’effet d’une contradiction intestine. Naufrage de la futurition. Démenti flagrant de tout ce qui constitue l’élan humain : ce sont des mots qui ne veulent plus rien dire tels que « but », « finalité », nécessaires corollaires d’un pas non vacillant, décidé, sensé enfin. Crépusculaire découverte – Basculement de l’existence dans le non-sens.
Non-sens, absurdité, insignifiance « Quelqu’un est parti de toi qui n’y était jamais entré. » Christian Bobin, Souveraineté du vide.
« Exister est un phénomène colossal – qui n’a aucun sens2. » L’expression est de Cioran, mais l’impression, celle de tout homme parvenu au sommet de sa lucidité, à ce degré d’acuité à propos de son existence. Introuvable sens d’une existence rendue à son indigence. Ainsi que l’exprime Jankélévitch dans des propos, nous semble-t-il, déterminants, la mort n’est « ni le Rien fondateur ni le Néant créateur, mais elle est le plat non-sens du sens et le pur et simple non-être de l’être. […] La mort représente la précarité, la fondamentale inconsistance de tout ce qui est humain : loin de fournir à une vie essentiellement infondée le fondement et l’assiette qui lui manquent, elle creuse dans cette vie, tout au contraire, le trou et le vide problématique du non-sens ; la mortalité achève de rendre fugace, poreux, fantasmatique ce devenir déjà privé de consistance. […] Le rapport de notre être avec son propre néant ruine totalement les fondations
1 2
V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 2, op. cit., p. 26. Cioran, Écartèlement, in op. cit., p. 1450.
51
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
de cet être1. » Est pointé là ce moment où l’homme, ramené à la vacuité de son existence, écrasé par l’écho mortel de son destin, s’approche au plus près de la révélation de sa petitesse, capable d’éprouver alors toute la porosité et le caractère insensé de sa marche. Rythme quotidien qui s’affaisse sur lui-même. Temps dégoulinant. La conscience tragique éprouve l’existence dans son arrachement à l’ordinaire, à la faveur duquel s’impose la force invisible et implacable de la disparition. Expérience radicale de notre finitude situant notre existence à sa juste dimension, travaillée par le vide et tissée d’insignifiance. Le non-sens découle du caractère gratuit de cette vie et de cette disparition. Mes projets, le travail que j’accomplis, ont sans doute un sens à mes yeux, mais l’ensemble n’en a pas. « La fin de la vie, hélas ! n’était pas le but de la vie, […] la fin de la vie s’inscrit en faux contre les fins de la vie. Le non-être, qui est la fin de l’être, n’en était nullement la raison d’être ! […] Le non-être consacre finalement le non-sens de la vie2. » De sorte que l’on ne doit pas dire – Peter Handke le souligne avec justesse : « Le sens s’est perdu » mais « Le non-sens est retrouvé »3.
Non-sens. C’est, par une sorte d’enroulement de la pensée sur elle-même, un effroi rétrospectif qui s’étend sur notre passé : véritable épouvante « devant ce temps qu’on croyait vivant, et qui se révèle soudain éternellement mort, immobile et figé depuis toujours. […]. L’homme croyait agir au sein d’un temps libre et régénérateur ; en réalité, il était entre les mains d’un cadavre4. » Révélation du temps tragique : il vient « phagocyter » le nôtre pour le rendre nul et non avenu, ne nous faisant plus guère entrevoir, en définitive, qu’un temps mécanique et une vie effrayante de nullité. Comme si jamais rien ne s’était passé ! La colère qui s’empare d’Estragon est là pour en attester : – Reconnais ! Qu’est-ce qu’il y a à reconnaître ? J’ai tiré ma roulure de vie au milieu des sables ! Et tu veux que j’y voie des nuances5 !
L’image scénique qui s’y ajoute n’en est que plus saisissante. Lucky, la corde au cou, traîne une lourde valise remplie de sable dont il semble ne pas vouloir ou ne pas pouvoir se débarrasser6. Bagages du trajet d’une vie : du sable… La plage est vide : rien qu’une étendue déserte et désolante. La 1
V. Jankélévitch, La Mort, op. cit., p. 69. Ibid., p. 71. 3 P. Handke, Le Non-sens et le bonheur, Christian Bourgois, 1993, p. 99. 4 C. Rosset, Schopenhauer, philosophe de l’absurde, op. cit., p. 97. 5 EAG, p. 85-86. 6 Ibid., p. 125. 2
52
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
prophétie de Hamm est réalisée : on se retrouve petit plein perdu dans le vide1. Il ne reste rien, plus rien. Rien qu’un grand vide envahissant tout. Comme celle des personnages sur la scène, notre vie – par-delà sa dimension imprévisible et les îlots de sens que l’on a pu se construire – semble avoir rejoint le temps égal de la matière. Tout fout le camp, nous glisse entre les doigts. Comme du sable précisément : on a beau serrer le poing, les grains s’infiltrent entre les doigts et réintègrent la surface morne de la plage. Un petit tas bien vite aplani. Comme si jamais rien ne s’était passé. Reprise en écho des propos de Clov au départ, l’instant-grain évoqué par Hamm en fin de partie en est la flagrante expression : – Instants sur instants, plouff, plouff, comme les grains de mil de… (il cherche)… ce vieux Grec, et toute la vie on attend que ça vous fasse une vie2. – Instants nuls, toujours nuls, mais qui font le compte, que le compte y est, et l’histoire close3.
La vie, ainsi rendue à sa précarité profonde, n’est qu’évanouissement de moments. « Je le vois – à l’instar d’Ulysse –, tous tant que nous vivons, nous ne sommes que des fantômes, une ombre vaine4. » Sa propre dépouille entre les mains, si l’on peut dire, l’homme arrive à une dimension fantomatique de lui-même. Déroutante impression d’être à la fois présent-absent de sa propre vie. C’est celle de Hamm : – Absent, toujours. Tout s’est fait sans moi. Je ne sais pas ce qui s’est passé. (Un temps.) Tu sais ce qui s’est passé, toi ? (Un temps.) Clov5 !
C’est celle aussi de Pozzo désormais aveugle : – Un beau jour je me suis réveillé, aveugle comme le destin. (Un temps.) Je me demande parfois si je ne dors pas encore6.
Ou encore celle de Vladimir après le départ de Pozzo et de Lucky : – Est-ce que j’ai dormi, pendant que les autres souffraient ? Est-ce que je dors en ce moment ? Demain, quand je croirai me réveiller, que dirai-je de cette journée ? Qu’avec Estragon mon ami, à cet endroit, jusqu’à la tombée de la nuit, j’ai attendu Godot ? Que Pozzo est passé, avec son porteur, et qu’il nous a parlé ? Sans doute. Mais dans tout cela qu’y aura-t-il de vrai7 ?
1
FP, p. 53. Ibid., p. 93. 3 Ibid., p. 111. 4 Sophocle, Ajax, in Œuvres, I, Ajax – Antigone – Œdipe-Roi – Électre, Les Belles Lettres, « Collection des universités de France », 1946, v. 125-126, p. 17. 5 FP, p. 98. 6 EAG, p. 122. 7 Ibid., p. 128. 2
53
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
La conscience de soi tragique est inséparable d’un sentiment aigu de dépossession. Comme si notre vie, entourée d’une sorte de demi-sommeil, n’était qu’un songe, selon la fameuse expression de Calderon. Prospéro, prêtant sa voix à Shakespeare, ne manque pas de le souligner : Nous sommes de la même étoffe que les songes Et notre vie infime est cernée de sommeil1…
Depuis toujours une puissance destinale s’est emparée de nous, semblant détacher, séparer, démolir, accomplir son « sale boulot » presque dans notre dos, à notre insu. Expression d’une passivité fondamentale liée à l’action, là pour sans cesse nous déposséder de nous-mêmes et nous réduire à rien, à notre inconsistance, à notre inanité, à notre impuissance. Notre vie, ainsi rendue à sa fantomale dimension, ne ressemble qu’à une véritable gageure, un monumental ratage, une pitoyable pirouette. Un désastre savamment orchestré, dont nous sommes les acteurs piteux et les jouets inconscients. Vision terrible d’une cruelle farce, d’une vaste mascarade. Car, même si c’est l’illusion qui crée la désillusion, le dindon de la farce c’est nous. H. – Je le sais maintenant, tout cela n’était que… comédie2.
Que reconnaître à la source de cette déconvenue ? Sans doute, à ce point, suivre le fil de l’histoire d’Œdipe peut-il s’avérer particulièrement éclairant, celle-ci nous amenant sur la voie du double comme structure de l’illusion. Le cas d’Œdipe illustre, en effet, ce que Rosset a analysé, notamment à travers l’illusion oraculaire, à savoir l’idée de l’autrement être, consistant à jeter un voile sur la réalité et à s’inventer un double fantasmatique qui pourrait éviter les retrouvailles avec soi-même. Œdipe, rappelons-le, pense avoir été pris au piège alors qu’il n’y a eu aucun piège : le réel n’a fait que se réaliser. Plus encore, c’est en voulant fuir l’annonce de l’oracle que celui-ci s’est réalisé le plus sûrement. On peut même estimer, avec Rosset, qu’Œdipe n’aurait sans doute pas pu trouver de chemin plus direct pour accomplir son destin3. Ironie du sort que l’on traduit généralement en parlant de « ruse » ou de « tour » du destin : non seulement l’oracle se réalise, mais, qui plus est, à travers les gestes mêmes de l’esquive. 1 W. Shakespeare, La Tempête, GF – Flammarion, 1991, Acte IV, Scène I, p. 225. Voir aussi Bossuet qui s’exprime en des termes proches : « Que la place est petite que nous occupons en ce monde ! si petite certainement et si peu considérable, qu’il me semble que toute ma vie n’est qu’un songe. » (J.-B. Bossuet, Sermon sur la mort, Le Nouveau Commerce, 1990, p. 19). 2 S. Beckett, Comédie (1963), in Comédie et actes divers, Minuit, 1972, p. 23. 3 Voir C. Rosset, Le Réel et son double, op. cit., p. 38 et Fantasmagories, Minuit, « Paradoxe », 2006, p. 76.
54
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Jean Baudrillard le reconnaît : « Bien sûr : c’est en cherchant à échapper à son destin qu’on y court plus sûrement. Bien sûr : chacun cherche sa propre mort, et les actes manqués sont les plus réussis. Bien sûr, les signes suivent des cheminements inconscients1. » Baudrillard s’intéresse en particulier à « la mort à Samarkande2 », l’histoire de ce soldat qui, rencontrant la Mort, croit discerner un geste menaçant à son encontre et décide alors de fuir à Samarkande pour lui échapper. Le roi convoque la Mort, lui reprochant d’effrayer ainsi un de ses plus valeureux sujets. À quoi celle-ci répond que son geste n’était que de surprise de voir le soldat ici, alors qu’ils avaient rendez-vous le lendemain à Samarkande… Au lieu d’offrir un sursis, le départ du soldat a donc signé son arrêt de mort. Œdipe, quant à lui, devant l’énigme que pose la peste, ne voit pas de signe pour lui-même ou, plutôt, l’interprète-t-il à contre-courant. Il pense que la découverte du meurtrier du roi Laïos raffermira la haute stature que sa sagesse lui a permis d’acquérir, non qu’il emprunte là le chemin de sa chute. Il ne voit pas que son propre langage le trahit déjà, car le langage, lui, sait où il va. C’est en lui, en effet, que « se noue l’enchaînement ironique et fatal3 ». Œdipe, lorsqu’il proclame : « c’est pour moi-même que j’effacerai cette souillure4 », dit aussi, selon le double sens du vers souligné par le scholiaste, que « c’est lui-même » qu’il découvrira comme criminel (ego phanô). Outre le fait de mettre fin à la peste, il pense qu’en débusquant le meurtrier de son prédécesseur, il sert là aussi sa propre cause, estimant logiquement que celuici pourrait encore chercher à s’attaquer au monarque de la cité. Mais, comme le laisse deviner l’amphibologie tragique des mots, quoiqu’il se figure, Œdipe devra coïncider avec lui-même. Qu’y a-t-il à comprendre, au fond, ici ? Le pire n’est-il pas de réaliser qu’il n’y a en fait rien à interpréter et que le malheur est de n’être précisément que soi, sans distance, sans double salutaire, en mesure d’éviter le rendez-vous avec soi-même ? Quand nous parlons de « rendez-vous », précisons bien qu’il n’y a rien à lire en termes d’histoire écrite à l’avance et autre croyance du même ordre. L’histoire exemplaire d’Œdipe ne doit leurrer personne, pas plus que le conte du soldat à Samarkande. La littérature oraculaire est édifiante pour le message qu’elle délivre symboliquement en toile de fond : on n’échappe pas à soi-même et, si l’on croit fuir, l’on se rattrape malgré tout. En quoi elle procède à une reconstruction des faits après coup, donnant aux récits leur arrière-plan de destin inflexible. Ce qui, pour le destin ordinaire des hommes, signifie, comme nous l’avons vu avec la peste, que la mort participe à sa définition et, pour cela, travaille immanquablement 1
J. Baudrillard, De la séduction, Gallimard, « Folio essais », 1988, p. 101. Notons que ce conte arabe retient également l’attention de C. Rosset pour illustrer la réflexion mise en œuvre dans Le Réel et son double. 3 J. Baudrillard, Les Stratégies fatales, Le Livre de Poche, « Biblio essais », 1990, p. 150. 4 Sophocle, Œdipe-Roi, in Œuvres, I, op. cit., v. 137-138, p. 146. 2
55
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
dans l’ombre. On pourra éviter des événements seulement possibles, mais on ne fera pas que l’homme ne tombe jamais malade et qu’il ne soit pas mortel. Pour le reste, comme nous le préciserons par la suite, productions hasardeuses et occasionnelles suffisent à composer le cheminement destinal. L’histoire d’Œdipe, ainsi que celle du soldat à Samarkande, nous intéressent, par conséquent, non pour la dimension oraculaire qui en constitue la trame, mais bien pour ce qu’elles disent à travers ce ressort du récit. Sans doute, d’abord, que l’homme est à lui-même sa propre énigme. Elles nous parlent aussi de ce trouble sentiment d’être dupé, lors même que l’on sait que l’existence se tisse de cette propension de l’homme à se fourvoyer sur son propre compte et, enfin, de sa faible capacité d’acceptation de la réalité. Énigme de l’émergence hasardeuse de cette existence et de sa destruction obligée signant, pour l’homme, la précarité de sa condition qu’il ne sait guère assimiler à lui-même. Nous l’avons vu avec l’angoisse et le sentiment d’inquiétante étrangeté qui lui est attaché. L’étranger, l’inquiétant ressortissent au plus proche, au connu depuis toujours. Or, quoi de plus proche et de plus lointain que sa propre mort, quoi de plus impossible et de plus nécessaire ? Quoi, donc, de plus « étrange familier » pour l’homme que sa propre mortalité ? Pourtant, si le fait de l’existence elle-même ne laisse pas d’être énigmatique, le secret est un secret de polichinelle. L’homme sait qu’il n’est en vie que pour autant qu’il a les traces de la mort sur lui et en lui, mais il est aussi bien peu disposé à l’admettre. Ce qui fait écrire à Rosset : « Rien de plus fragile que la faculté humaine d’admettre la réalité, d’accepter sans réserves l’impérieuse prérogative du réel1. » Au lieu de reconnaître la simplicité chaotique, la dimension tout autant éphémère qu’hasardeuse de toute chose, l’homme est tenté le plus souvent de se réfugier dans des versions nettement plus rassurantes du réel. D’où sa fréquente propension à chercher des signes capables tout à la fois de confirmer et de conjurer ses propres peurs. Sans quoi les voyants et autres cartomanciennes seraient depuis longtemps désœuvrés. Ces trafiquants d’illusion ont du succès précisément dans la mesure où ils répètent les peurs de leurs clients avant de leur offrir une « grille de lecture » et la « solution miracle » qui, bien sûr, n’existe nulle part. Il n’y a décidément rien à voir dans une boule de cristal. Car le réel n’a aucun message significatif à renvoyer. L’homme se cherche et se perd dans un réseau de signes qui n’ont rien à lui dire : Œdipe pense qu’en partant en quête du criminel, il part à la recherche d’un autre que lui et continue à accomplir, par là même, un destin glorieux, très éloigné des termes de l’oracle. Le soldat, quant à lui, croyant discerner un signe menaçant de la mort, se figure un moyen de lui échapper.
1
C. Rosset, Le Réel et son double, op. cit., p. 7.
56
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
L’homme du commun sait ce qui se trame en lui, mais il n’y croit pas. Les autres meurent, d’accord, mais pas moi. Outre l’attitude consistant à se voiler la face, ajoutons à cela ce que Jankélévitch écrit sur la plénitude première affirmative. Il diagnostique par là ceci que, si rien de fâcheux ne vient briser trop tôt l’élan humain, la méfiance n’est pas un état premier. C’est une suffisance, une certaine plénitude d’être qui s’affirme d’abord le plus souvent chez un individu bénéficiant d’une croissance ordinaire. « Le moi a un visage, il n’est pas seulement la tache blanche, la place laissée vide par le non-moi environnant1 ! » Le temps, nous le disions au départ, c’est d’abord pour l’individu ce qui permet de croître, de grandir et, ce faisant, de laisser place à l’illusion-tentation de la possession. Cela implique, en ce sens, que l’homme ne se doute pas de ce qui l’attend, même s’il le sait. Ce qui prévaut, c’est un sentiment de confiance, de sécurité. Sentiment forcément fallacieux, « sécurité » et « mortel » étant déjà une contradiction dans les termes. Sécurité qui constitue donc, comme le rappelle Hécate, « la plus grande ennemie des mortels2 ». C’est dire que, plus encore que l’alliée de l’illusion, la fausse sécurité « en constitue la substance même et au fond l’illusion en personne3 ». Se croire au début d’une histoire ou capable, comme Œdipe, d’un ajustement à sa guise de celle-ci, alors qu’elle est déjà fondamentalement finie. Ce qui, pour l’homme, se traduit par l’illusion consistant à croire échapper à son destin, alors que son destin c’est de mourir et qu’à ce rendez-vous là, tout au moins, il devra être ponctuel4. Il reste qu’entre ce temps qui semble se mobiliser pour l’existant comme production évolutive et le temps qui détruit tout, il y a toute la place pour la déchirure de la conscience tragique. Le temps travaille pour nous, mais pendant ce temps, il nous oblige au sens unique, creusant le sillon implacable de l’involution et acculant l’existence au non-sens. Pour celui qui ose se ressaisir à la faveur d’instants privilégiés, tels que la perte d’un être aimé, ou au travers de tonalités affectives majeures, tels que l’ennui et, plus encore, l’angoisse, où, selon l’expression de Cioran, le temps semble se décoller de l’existence pour nous pousser en dehors de la trame continue et confiante du temps, il y a ce trou noir répétant que je dois m’écraser tôt ou tard dans un rien absolu.
1
V. Jankélévitch, La Mort, op. cit., p. 101. W. Shakespeare, Macbeth, in Othello – Le Roi Lear – Macbeth, GF – Flammarion, 1964, Acte III, Scène V, p. 287. 3 C. Rosset, Le Réel et son double, op. cit., p. 106. Le philosophe écrit encore : « […] la sécurité est un piège qui achève de lier le héros tragique à son destin et d’enfermer l’homme en lui-même. » (Ibid.). 4 C. Rosset cite l’expression d’André Ruellan tirée de son Manuel du savoir-mourir : « La mort est un rendez-vous avec soi : il faut être exact au moins une fois. » (Ibid., p. 102). 2
57
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Les instants de notre vie, rongés par leur entropie inflexible, paraissent alors sombrer dans un passé inatteignable, une inconsistance profonde. Car ce qui se dissipe a-t-il existé ? Ce sentiment qu’on n’était pas là tout en étant présent, de la vie qui s’évanouit tel un songe, que ça se trame dans notre dos, d’un « tour » du destin émane sans doute de ce soufflet désaccordé qui nous définit dans notre marche trébuchante. Un autre aspect important à considérer est celui que Jankélévitch nomme la « prévoyance imprévoyante1 ». Expression traduisant au plus près cette trouble posture consistant à être surpris par le plus prévisible. Le réel surgit sous les augures de l’imprévu, ce en quoi l’on peut être certain de ne jamais s’attendre à ce à quoi l’on s’attend. L’identité humaine est creusée par le temps mortifère, établissant pour elle un rendez-vous obligé, mais rien n’est dit sur les termes de ce rendez-vous final, pas plus que sur la somme de petites morts qu’elle ne manquera pas d’essuyer. Certitude incertaine qui scelle notre état d’impréparation. C’est sans doute cette certitude incertaine qui, tout en créant une aire essentielle de déploiement de notre existence, est à la source de cette caractéristique du fait tragique de se laisser imprévisiblement reconnaître. On s’y attendait, mais l’on est pourtant surpris et désemparé. Est-ce parce que l’événement est inexplicablement autre ou bien trop lui-même, c’est-à-dire « simple, particulier, unique de son espèce2 », donc insignifiant et dépourvu d’échappatoire ? On avait imaginé les choses ailleurs, autrement, plus tard. Pourtant il n’y avait rien à imaginer, plutôt autrement qu’ainsi. Car rien n’est écrit sur la façon dont les choses doivent se produire. Et c’est là le propre du destin, d’être tout autant fortuit que déterminé. Certitude de l’imprévisibilité, à la source de ce fréquent sentiment qu’il s’agit là d’un arrêt arbitraire, voire injuste. Ce en quoi il surprend et déçoit toujours, sa réalisation même venant exclure définitivement toute autre version des faits. Pourtant cette autre version n’existe nulle part. La « victime » s’estimant trompée est incapable d’énoncer cet « autre » événement, dont l’événement réel a pris la place. Ainsi s’éclaire la nature de la « tromperie » : celle-ci réside tout entière dans l’illusion d’être trompé. « C’est donc le sentiment d’être trompé qui est ici trompeur. En se réalisant, l’événement n’a rien fait que se réaliser. Il n’a pas pris la place d’un autre événement3. » L’espoir n’était-il pas seulement, au fond, que la page reste blanche… ? Car le réel, avant d’être l’indicible, est surtout le désagréable, nourrissant le secret espoir chez l’homme qu’il passera peut-être à travers les mailles du filet. Prothèses du rêve que l’événement réel fait voler en éclats, excluant par son existence même tout autre scénario de la réalité.
1
V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, op. cit., p. 162. C. Rosset, Le Réel et son double, op. cit., p. 52. 3 Ibid., p. 39. 2
58
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
C’est dire, avec Rosset, que le destin n’est rien d’autre que le caractère irréfutablement présent de ce qui existe. « “On n’échappe pas au destin” signifie tout simplement qu’on n’échappe pas au réel1. » C’est l’occasion ici de repréciser ce qui requiert notre attention dans la notion de destin, de nécessité tragique. Ce serait se méprendre, comme insiste le philosophe, que d’y voir « le déroulement inéluctable d’un processus à partir d’une certaine situation donnée2 ». Le destin désigne bien plutôt « ce donné même à partir de quoi un déroulement est à la fois possible et nécessaire, déjà inscrit dans le détail, d’ailleurs, du donné initial3 ». Ainsi le ressort de l’ennui chez Beckett, et de manière générale pour l’homme le fait d’être un homme, voué à ce titre à la déchéance, à la mort et à l’oubli. Pour le reste, on ne trouvera aucun enchaînement nécessaire de déterminations conduisant à la chute. Et l’histoire d’Œdipe, d’ailleurs, ne dit pas autre chose. L’oracle devait certes se réaliser, mais n’a pourtant jamais dit comment cela devait se produire. L’homme doit subir les assauts du temps, mais rien dans ce cadre ne doit pourtant nécessairement s’enchaîner de telle ou telle façon. D’où la nature proprement imprévisible du fait tragique dont la caractéristique est de s’imposer ici et maintenant. Ce qui amène Rosset à donner ce dernier éclairage sur la nécessité tragique : « Non-nécessité globale d’une chaîne de nécessités fatales, c’est ainsi qu’on peut définir ce que les Tragiques grecs entendaient par cette notion de nécessité […]. Elle se distingue de la nécessité au sens ordinaire en ce qu’elle désigne des faits plutôt que des effets4. » De quoi ici tordre le cou à un autre fréquent contresens à propos du tragique. Le caractère tragique de ce qui existe est, en effet, fréquemment attribué à un « ailleurs » par rapport à l’existence, tel un halo irrationnel, expression d’une puissance fatale extérieure à l’homme, qui fondrait accidentellement sur lui pour gripper son mécanisme qui, sans cela, serait harmonieux, épanoui et équilibré. Or nous l’avons rappelé : le tragique est redoutable précisément parce que, tout en étant imprévisible, il ressortit au plus lointain connu, au familier par excellence. Le tragique n’est donc tel que par la proximité qui le caractérise. Ce en quoi son terrain est celui du quotidien, non des catastrophes, sa loge l’intériorité, non l’extériorité. Le tragique est là au départ, « partout là où il y a présence5 ». Si bien que le monstre invisible qui déchire l’homme est compris en lui-même, tissant les termes de sa chute. De sorte que l’on peut s’autoriser à considérer, avec Rosset, qu’il n’y a pas deux ordres de la réalité : l’un tragique et l’autre nontragique. Il y a seulement deux types de regard sur celle-ci. 1
Ibid., p. 50. C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 58. 3 Ibid. Nous soulignons. 4 Ibid. 5 Ibid., p. 57. 2
59
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Le premier qui, confronté à une réalité désagréable ou douloureuse, préfère, à l’instar d’Œdipe, sinon se crever les yeux, du moins se voiler la face, fuir la réalité plutôt que de l’affronter. Ce qui peut se traduire de multiples façons. Folie dans le cas le plus extrême, qui est la manière la plus radicale de s’extraire de la réalité grâce à un total délabrement mental. On trouvera encore l’alcoolique, le drogué et, à un moindre degré, le cas du refoulement tel que décrit par Freud, comme forme de mise à distance plus ou moins provisoire, puisque mon inconscient conserve, malgré tout, des traces du réel occulté. Enfin, le cas le plus fréquent de l’illusion : j’ai reconnu l’existence du réel, mais je décide de ne pas compter avec, de regarder ailleurs, là où il ne se passe rien de fâcheux. Nous sommes alors à mi-chemin entre la reconnaissance et le rejet. Il s’agit là non d’une perception fausse, mais proprement inutile1 : j’ai vu, j’ai reconnu, j’ai admis, mais je refuse d’en tirer les conséquences qui s’imposent, d’adapter mon comportement à ma perception. D’où il ressort la structure essentielle de l’illusion : « un art de percevoir juste mais de tomber à côté dans la conséquence2 ». Ce qui conduit à faire d’un événement unique deux événements divergents, établissant le lien étroit entre illusion et duplication : je est un autre, la vraie vie est ailleurs, le réel n’est pas le réel. L’illusionné ne s’aveugle donc qu’autant qu’il voit double. Il y a un homme dans le placard, mais ma maîtresse ne me trompe pas ; mon mari me roue de coups, mais c’est un homme aimant ; j’ai une maladie incurable, mais je ne vais pas mourir… Autant de chroniques de la vie ordinaire, auxquels l’homme entend résister en se racontant des histoires. À l’encontre de ces versions du réel, tantôt cocasses, tantôt catastrophiques et, dans tous les cas, fallacieuses, l’on peut dès lors se sentir autorisé à défendre la vision tragique de la réalité qui, pour n’être ni magnifiée ni rassurante, a le mérite de n’être pas mensongère. Ce second regard d’obédience tragique est celui qui se résout à son unicité, à l’application des peines prononcées. Le verdict revient, entêté : s’il est un malheur, il est d’être seulement soi-même, rien que cela. Le réel demande à être reconnu dans ses aléas, sa singularité, son caractère éphémère et insignifiant. Ce qui ne peut manquer de laisser place, dans un premier temps tout au moins, à une certaine gamme de sentiments et, au premier chef, à celui d’absurdité. Le sentiment d’absurdité peut difficilement, en effet, ne pas investir l’homme parvenu à la conscience exacerbée de sa précarité. « Comment l’existence peut-elle être à la fois niée par une nihilisation radicale, et perpétuellement entretenue, regonflée, renflouée par une continuation infernale ? […] les damnés qui mijotent à petit feu dans les marmites du
1 2
C. Rosset, Le Réel et son double, op. cit., p. 10. Ibid., p. 16.
60
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
diable sont-ils morts ou vivants ? Ils ne sont en vérité ni l’un ni l’autre. Cette existence sans cesse détruite, sans cesse renaissante, cette existence tragiquement déchirée est l’absurdité même1. » « Absurdité », voilà ce qui résonne dans le cerveau martelé de l’homme tragique. Tout semble profondément vain, inutile et absurde désormais. C’est l’inanité de notre cheminement, de notre terrestre vagabondage qui se manifeste à l’être déconfit. Le sentiment d’absurdité apparaît comme une étape incontournable de la conscience. N’est-elle pas inévitable cette « confrontation » entre ce que Camus appelle l’« irrationnel » du monde et « ce désir éperdu de clarté dont l’appel résonne au plus profond de l’homme2 » ? C’est le non-sens qui la fonde, car avec lui un autre temps a émergé. Le temps – tellement dénué de consistance et d’épaisseur – de la privation de toute raison d’être : signe d’une existence qui se sait entraînée dans le mouvement d’une dépense injustifiée et insignifiante. L’atmosphère absurde coïncide avec cet éveil de la conscience qui s’extrait du tourbillon quotidien et se ressaisit de l’ensemble des gestes, indéfiniment répétés, par la marche humaine. L’absurde se révèle dans un recommencement perpétuel. Ainsi, Camus reprend-t-il la chaîne de nos gestes quotidiens : « Lever, tramway, quatre heures de bureau ou d’usine, repas, tramway, quatre heures de travail, repas, sommeil et lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi sur le même rythme3 ». Chaque nuit Estragon est battu sans que l’on sache par qui et pourquoi, chaque soir il vient attendre Godot en compagnie de Vladimir. La vie de Winnie est dictée par une sonnerie perçante l’obligeant à ouvrir les yeux4… L’enchaînement machinal des gestes quotidiens se rompt, « les décors s’écroulent5 ». La condition humaine est rendue à sa vacuité tragique. Le « sentiment de l’absurdité », c’est cela : « Ce divorce entre l’homme de sa vie, l’acteur et son décor6 ». C’est une question qui, subreptice, dans le crâne s’immisce : « Pourquoi ? ». Le pourquoi à partir duquel s’érigent, selon l’expression de Camus, les « murs absurdes7 ». « Pourquoi ? » murmure l’homme X de Camus. « Quel est notre rôle là-dedans8 ? », demande Estragon. « Pourquoi cette comédie, tous les jours9 ? », s’interrogent Nell et Clov en parlant des gestes, continuellement les mêmes, qu’on attend d’eux. Rien à répondre. « Ça ne rime à rien » est l’expression qui convient. 1
V. Jankélévitch, La Mort, op. cit., p. 109. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, France Loisirs, 1989, p. 32. 3 Ibid., p. 25. 4 OBJ, p. 12, 59, 60, 62, 64, 70, 77. 5 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 25. 6 Ibid., p. 19. 7 Ibid., p. 23. 8 EAG, p. 24. 9 FP, p. 29, 49. 2
61
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Dans sa course folle et insensée, dans sa vaine agitation, c’est la comédie humaine qui transpire de toutes parts. La dérision de tout acte, de toute parole. Perte d’un goût : le goût de vivre, cette saveur sucrée qui fait qu’un être avance obstinément jusqu’à sa dernière heure, jusqu’à la coupe du poison terminal. Dans la bouche, une nausée accablante : « À quoi bon ? » C’est précisément à la faveur de cette « lassitude teintée d’étonnement1 », permettant au sentiment d’absurdité de déchirer l’atmosphère de la quotidienneté somnolente, que la nausée trouve son lieu d’expression. Roquentin l’exprime au plus près : l’existence au moment de son envahissement se révèle grise et gluante. Et ce, précisément, parce que l’existence, privée de sa gangue protectrice, « colle » strictement à ellemême2. Rendue à elle-même, à son insignifiance, l’existence s’éprouve sur le mode intense de la nausée et de l’absurdité. Marche privée d’appui. Errance dans l’incohérence. « Est absurde ce qui n’a pas de but3 ». C’est dire que l’atmosphère absurde, avec son inséparable cortège de nausée et de déchirure, ne peut manquer de s’appesantir, selon les termes de Ionesco, sur un homme littéralement « perdu », dont la démarche devient « insensée, inutile, étouffante4 ». L’existence apparaît comme arrimée à rien, comme un fait, gratuit et absurde. « Le mot d’Absurdité naît à présent sous ma plume ; […] j’ai fait l’expérience de l’absolu : l’absolu ou l’absurde5. » Non-sens – Absurdité. Absurdité d’une existence où se poser, s’affirmer, c’est déjà se nier ; où tenter de voler, c’est se briser les ailes. La figure d’Icare est l’exact paradigme de cette pesanteur implacable. On pense aussi à Molloy qui décide d’enfourcher une bicyclette, pensant y trouver une légèreté, une forme d’envol susceptible de faciliter son cheminement. Mais cette illusion de puissance ne dure guère : le terrien est pesant et l’ange dégringole ou s’enlise. Worm était destiné à voler et pourtant il ne peut guère que se traîner dans une merde gluante. Il faudrait pouvoir. Et les phrases à bon marché du type « vouloir, c’est pouvoir » sonnent terriblement creux. Le roi se meurt est à cet égard plus qu’édifiant. « C’est un problème de volonté », « Tu peux si tu veux »6. La reine Marie, deuxième épouse du roi Bérenger Ier, auquel a été annoncée sa mort proche, essaie de le persuader qu’en s’armant de volonté il peut recouvrer son pouvoir, passer outre le diagnostic mortel, lui assénant au passage tous les lieux communs qui lui traversent l’esprit. Non, on ne peut rien faire. 1
A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 25. C. Rosset, Principes de sagesse et de folie, Minuit, « Critique », 1991, p. 40. 3 E. Ionesco, Notes et contre-notes, op. cit., p. 338. 4 Ibid. 5 J.-P. Sartre, La Nausée, op. cit., p. 183-184. 6 E. Ionesco, Le Roi se meurt, Gallimard, « Folio », 1973, p. 41, 42. 2
62
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
« Dès qu’il s’efforce, l’homme retombe, culbute dans un trou, s’évanouit1 », choit lamentablement. À ce stade, le leurre, ce sont les images de vie robuste et florissante. Le moment est décidément venu de reconnaître dans les éclopés et les estropiés de Beckett les seuls vrais frères exposant l’infirmité comme notre lot commun. Voilà ce qui se fait jour : une certaine inaptitude de l’homme lui-même à l’existence. Un sentiment de carence, de caducité se répand sur la totalité de l’existence : le monde et moi, tout est uniformisé dans la même impuissance. Si nous avions, par conséquent, des Dieux à incriminer, ce serait non de mourir, mais de vivre2. De vivre de notre invivable vie et pourtant la seule à vivre. De vivre d’une vie qui a à ce point partie liée avec la mort, qui entretient avec elle d’aussi troubles rapports, nous contraignant à vivre, pour ainsi dire, en morts-vivants et nous conduisant, par là même, à la mise en cause d’une vie qui ne sait que s’écrouler. La pensée tragique ne stationne pourtant pas dans l’absurde. L’existence, le monde ne peuvent être, en effet, considérés absurdes que par rapport à un certain sens supposé présent « au moins partiellement dans ce monde, sens dont l’insuffisance constitue le “manque” qui vient paradoxalement meubler l’idée d’absurdité3 ». Les propos de Handke l’exprimaient pleinement : le sens ne s’est pas perdu ou raréfié, le non-sens a été retrouvé. Le manque est manque de rien : sentiment d’avoir perdu quelque chose qui, pourtant, n’était pas là. À ce titre, la vacance du sens implique l’absurde, le non-sens retrouvé implique le non-sens tragique, l’insignifiance. Si le sentiment de l’absurde apparaît donc comme une étape inévitable de la conscience face à l’insignifiance de notre trajet, l’existence ne peut être, pour autant, déclarée en elle-même absurde. « C’est ainsi », voilà tout, et Camus le reconnaît : « Je disais que le monde est absurde et j’allais trop vite. Ce monde en lui-même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on en peut dire4. » Ionesco, lui aussi, se montre prudent avec l’emploi du terme : « Dire que le monde est absurde, c’est critiquer l’image que nous en avons faite. Mais je dois dire que personnellement je serais plutôt enclin à ne plus l’interpréter5. » Entre le sentiment de l’absurde et l’absurdité proclamée de l’univers, il y a un écart d’importance. Il y a absurde et absurde, peut-on dire. L’absurde qui se clôt sur lui-même et l’absurde sous-tendu par une vision tragique. Ainsi, l’absurde de Camus est-il un point de départ et non un point d’arrivée, la notion première de ses vérités et non la vérité ultime : « l’absurde ne peut être considéré que comme une position de départ, même si son souvenir et 1
J.-M. Domenach, Le Retour du tragique, op. cit., p. 264. Ibid., p. 261. 3 C. Rosset, L’Anti-nature. Éléments pour une philosophie tragique, PUF, « Quadrige », 1990, p. 67. 4 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 32. 5 E. Ionesco, Notes et contre-notes, op. cit., p. 367. 2
63
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
son émotion accompagnent les démarches ultérieures1 ». L’humeur peut certes laisser des traces, mais celle-ci n’implique pas un jugement définitif. Le monde n’est pas en lui-même absurde ; il ne nous paraît tel, que parce que nous lui demandons obstinément quelque chose qu’il se refuse à nous accorder. Il est « ce divorce entre l’esprit qui désire et le monde qui déçoit2 ». Le sentiment de l’absurdité, nous l’avons vu, découle de ce moment où la conscience n’est pas loin de se noyer à l’intérieur d’elle-même parce que tous les remparts qui « sécurisaient » l’existence sont mis à mal. L’absurde, quant à lui, suppose que l’on reconnaisse et affirme un certain ordre considéré comme désolant, dissonant ou désaccordé. Le pessimisme de Schopenhauer constitue une illustration forte d’une telle posture. Le monde est absurde en raison précisément, non d’une absence de finalité, mais au contraire d’un trop-plein de finalité, dont la caractéristique est d’être une finalité sans fin. La volonté qui meut le monde s’auto-engendre indéfiniment, de manière aveugle et inlassable, s’éprouvant comme vouloirvivre. La volonté est, par conséquent, à appréhender comme un effort dénué de but et de fin. Ce en quoi tout dans l’œuvre converge vers ce point fixe, ce même centre. Quel que soit, en effet, le thème abordé par le philosophe, − animaux, libre-arbitre, morale, religion, suicide, ascétisme, contemplation esthétique, amour, mort… −, celui-ci vient alimenter son unique pensée, à savoir la toute-puissance de la volonté qui constitue le fond des choses, que ce soit pour en confirmer l’emprise ou pour exprimer la capacité de s’en détacher. Si bien que l’on aboutit à des conclusions qui peuvent paraître surprenantes. Ainsi, la conception plutôt paradoxale de la mort : le scandale ou l’absurde de la mort vient de la destruction seulement apparente qu’elle opère3. Le philosophe exprime cela très clairement dans sa Métaphysique de la mort. Comme le commente Rosset : « L’absurde de la mort n’est pas le scandale propre à la disparition brutale de la personne, à ce soudain passage au néant qui transforme une personnalité humaine en un amas physique de chairs inertes. Non, ce qu’il y a de tragique dans la mort, selon Schopenhauer, c’est précisément qu’elle ne tue pas, qu’elle ne fait disparaître qu’en apparence4. »
1
A. Camus, « L’énigme », L’Été, in Noces suivi de L’Été, Gallimard, « Folio », 1972, p. 147. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 56. 3 « La Métaphysique de la mort. De la mort et de son rapport avec l’indestructibilité de notre être en soi » constitue le chap. XLI des Suppléments au livre IV du Monde comme volonté et comme représentation. Rappelons qu’en tant que postkantien, Schopenhauer entend maintenir la dualité irréductible entre le phénomène et la chose en soi, à la différence que celle-ci n’est pas au-dessus de nous, mais en nous. 4 C. Rosset, Schopenhauer, philosophe de l’absurde, op. cit., p. 98-99. 2
64
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
La vie est brève, la mort fauche sans cesse, pourtant l’être véritable des choses n’est pas frappé par la mort, il reste impérissable, hors d’atteinte. Ainsi, selon Schopenhauer, la mort est-elle à l’espèce ce que le sommeil est à l’individu1. Tout se répète, selon un cycle indéfini et insatiable d’autodévoration et d’auto-engendrement de la volonté. Par conséquent, la mort n’atteint que l’apparence phénoménale et individualisée de telle manifestation singulière de la volonté qui, elle, demeure indestructible. Ce en quoi la souffrance est le fond de toute vie, et le monde « le royaume du hasard et de l’erreur2 ». D’où, comme nous le verrons, sa quête d’un détachement, d’une délivrance capable d’amener à une extinction du vouloir-vivre, qui amène sa pensée proche des rivages du bouddhisme. L’enjeu est de cesser d’être le jouet de la volonté, à la source de souffrances toujours renaissantes. La contemplation esthétique, en particulier, est appréhendée comme une étape vers l’abolition du vouloir-vivre. Le pessimisme, dont se recommande Schopenhauer, n’est donc pas absence de sens, mais trop-plein. Trop-plein de finalité qui est, elle-même, dépourvue de fin, proprement insensée. Distinction qui recoupe celle amorcée dans notre phase introductive entre pessimisme et tragique. Maintenir le sentiment de l’absurde devant le monde et l’existence conduit au pessimisme. Le monde a un ordre strict au sein duquel l’homme, pantin ridicule, a une fonction. C’est-à-dire la reconnaissance, non seulement d’un monde en décomposition, mais d’un ordre des choses radicalement mauvais et absurde. Des humeurs communes certes, mais des conclusions différentes. Comme nous tenterons de l’analyser plus précisément par la suite, la pensée tragique ne reconnaît aucun ordre, aucun ensemble constitué. Non-sens – Insignifiance. C’est dire que le non-sens tragique n’est pas absurde ou insensé, mais seulement insignifiant. Il s’agissait bien d’un semblant de sens qui a sombré de manière définitive. En quoi le tragique trouve avec le silence son allié naturel, comme ce qui se dérobe à tout vœu interprétatif. Insignifiance radicale, hasard, facticité, artifice. Là peut se dégager la portée philosophique de la perspective tragique, ainsi que Rosset l’a pleinement mis en évidence : elle représente à l’égard de tout « sens » une activité proprement destructrice et désastreuse, dans la mesure où elle refuse toute interprétation de la destruction, c’est-à-dire toute tentative de sauvetage ou de récupération des significations détruites. L’image la plus parlante, à cet égard, est celle du naufrage. Aucun terrain sûr où loger le sens, celui-ci ayant été englouti d’un coup et définitivement. Beckett, en décrivant des êtres amoindris, totalement condamnés à l’impuissance et à l’ennui, leur permet précisément d’être d’autant plus 1
A. Schopenhauer, Métaphysique de la mort, in Métaphysique de l’amour – Métaphysique de la mort, 10/18, 1980, p. 115, 120. 2 Le Monde…, chap. 59, p. 409.
65
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
lucides, dans la mesure où rien ne peut masquer leur regard. Dépouillés qu’ils sont de toute signification, aussi éphémère soit-elle, ils peuvent mieux que quiconque témoigner du non-sens fondamental. D’où sans doute l’autodérision mêlée d’angoisse dont fait preuve Hamm lorsqu’il demande : « On n’est pas en train de… de… signifier quelque chose ? » Ce à quoi Clov répondra : « Signifier ? Nous, signifier ! (Rire bref.) Ah elle est bonne1 ! » La conscience profonde du non-sens interdit de croire encore à un quelconque sens. Évidemment, tant que l’on se démène encore à exister, tant que l’on s’essaie à agir, l’on projette inévitablement un sens. Mais un sens qui se sait intrinsèquement à court terme, prêt à se retourner sur lui-même à tout moment. Une forme de simulacre. « Mais quelle est cette histoire de ne pouvoir mourir, vivre, naître2 », demande L’Innommable. Cette histoire, tel un « accouchement interminable à l’existence », c’est celle d’un manque à être, « l’histoire impossible par absence d’être, l’histoire d’une absence d’être3 ». L’idée d’une vie bien vivante ne tient plus. Ce n’est plus une vie, c’est la vie qui meurt.
1
FP, p. 49. S. Beckett, L’Innommable, Minuit, 1953, p. 139. 3 J.-M. Domenach, Le Retour du tragique, op. cit., p. 264. 2
66
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
III. La Vision tragique « Le sable glisse et cède, et je suis son déclin ; / Lorsque au dernier instant la masse l’abandonne, / Je crois sentir dans sa chute qui tourbillonne / La hâte d’un désordre étrangement humain. […] / Rien ne peut entraver cette fuite inlassable. / C’est moi qui saigne, non le cristal traversé. / Par un rite éternel le sable déplacé / Se consume ; et mes jours s’en vont avec le sable. » Jorge Luis Borges, Le Sablier.
La perdition, l’état de mort « La mort effective ne se présente jamais que comme une confirmation ». Max Scheler, Mort et Survie.
« Gardons-nous de dire que la mort serait opposée à la vie. Le vivant n’est qu’un genre de ce qui est mort, et un genre fort rare1. » La Mort, tel est bien le personnage central de cette histoire, de ce bref cheminement que l’on appelle la vie. Tel est le terme qui ne peut manquer de se glisser dans le tableau, non pas comme un simple terme justement mis en dernière instance au bout d’une série colorée, librement composée, mais bien comme le fondement même de notre existence. Intrusion de la mort dans la vie venue ruiner définitivement la représentation de la mort comme détermination extrinsèque ou limite externe, ainsi que le voudrait notamment Jean-Paul Sartre, pour qui la mort conserve toujours un aspect accidentel, demeure par essence extérieure à l’être humain2. Considérer que « nous mourons toujours par-dessus le marché », revient à contourner le tragique et à se ranger du côté des philosophes qui dénient à la mort toute réalité essentielle pour l’homme. À la question : « La mort est-elle tapie à l’intérieur de la vie comme ce crâne hideux au dedans du visage dont il est l’ossature3 ? », il faut répondre par l’affirmative. S’énonce la vision tragique du destin humain, telle qu’elle s’impose à la pensée qui a connu le climat angoissant de l’attente vaine et de la mort qui rode. C’est dire qu’à ce stade, la mort ne peut plus apparaître comme une pure interruption de l’existence, mais au contraire comme le fondement « inapparent » et la source « nocturne » de tout apparaître4.
1
F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., § 109, p. 138. « La mort est un pur fait, comme la naissance ; elle vient à nous du dehors et elle nous transforme en dehors. » (J.-P. Sartre, L’Être et le Néant, Gallimard, « Tel », 1980, p. 604). C’est dire que la mort n’est pas inscrite dans la réalité humaine, qu’elle n’est pas mon plus grand possible. Voir en particulier, sur ce point, IVe partie, chap. I, II, E, p. 589-612. 3 V. Jankélévitch, La Mort, op. cit., p. 44. 4 F. Dastur, La Mort, op. cit., p. 74. 2
67
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Comme Heidegger l’a mis en évidence, découvrir son être en tant qu’« être vers la mort » signifie comprendre que la mort n’est pas réductible à un événement futur (ce qui serait « inauthentique »), mais qu’elle est possibilité toujours imminente, qui confère son unicité à chaque instant et qui ne cesse, en tant que néant, de nous néantiser. L’homme se tient constamment dans le néant. « Car nous ne sommes que l’écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout c’est la grande mort que chacun porte en soi1. » La mort est, comme l’écrit Rainer Maria Rilke, le noyau même de la vie : La mort est grande. Et nous sommes siens, Le rire aux lèvres. Et quand nous nous croyons au cœur de la vie, C’est elle qui ose pleurer Au cœur de nous2.
La vie à titre d’entité distincte, voilà la fiction. La mort n’est pas un accident interrompant pour ainsi dire du dehors la trame continue de la vie, « comme si, dit Simmel, à un moment donné, le fil de la vie était brusquement “coupé”, qui jusqu’alors avait continué d’être filé intégralement en tant que vie3 ». Parce qu’elle est un rendez-vous avec soimême, parce qu’elle habite la vie, il n’y a rien de moins accidentel et, partant, de plus vital que la mort. Celle-ci n’est pas une limite extérieure déterminant la vie par le dehors. C’est par l’intérieur et a priori que la mort est attachée à la vie : « à chaque instant de la vie nous sommes des êtres qui allons mourir et cet instant serait tout autre si telle n’était pas notre destination […]. On voit maintenant clairement la signification de la mort comme créatrice de forme. Elle ne se contente pas de limiter notre vie, c’est-à-dire de lui donner forme à l’heure du trépas, au contraire, elle est pour notre vie un facteur de forme, qui donne coloration à tous ses contenus : en fixant les limites de la vie dans la totalité, la mort exerce d’avance une action sur chacun de ses contenus et de ses instants4 ». Cela est également nettement formulé par Max Scheler qui exprime avec force que « la mort n’est pas située à la fin réelle de la vie » comme si elle était une limite de fait externe bordant celle-ci ; « la mort, au contraire, accompagne la vie tout entière à titre de partie intégrante de tous ses moments5 ».
1
R. M. Rilke, Le Livre de la pauvreté et de la mort, Actes Sud, 1982, p. 20. R. M. Rilke, Le Livre des images, in Œuvres poétiques et théâtrales, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1997, « Finale », p. 267. 3 G. Simmel, « Métaphysique de la mort », op. cit., p. 170. 4 Ibid., p. 171-172. 5 M. Scheler, Mort et Survie, Aubier Montaigne, « Philosophie de l’esprit », 1952, p. 34. 2
68
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Étreintes évidentes, affinités certaines, reconnues, éprouvées jusque dans le tréfonds de notre être à la faveur de l’angoisse. En tant que saisie du néant, révélation de la structure fondamentale de la mort dans l’existence humaine, l’angoisse nous a découvert le point précis où être et non-être s’identifient. Vie et mort devenus des termes non-antinomiques, non séparés par une ligne de partage. Disons, avec Octavio Paz, équivalents : Sur sa falaise fauve un instant je vis la vraie vie Elle avait le visage de la mort elles étaient le même visage dissous dans la même mer étincelante1
Intériorisation de la mort. Ruine de l’état d’opposition des termes, faisant voler en éclats l’illusoire frontière entre la vie et la mort. Elles ne sont plus des entités distinctes et successives ou les deux figures d’une même chose ; elles ne sont qu’une même chose. Livré à l’inquiétante étrangeté d’un séjour sans point d’ancrage, l’homme en vient à réaliser que la mort n’est pas uniquement « un terme angoissant promettant toute perspective humaine à la fragilité et à l’éphémère », mais qu’elle est avant tout « l’état même de ce que l’homme connaît, pense et vit. Plus tragique que la mort événementielle, parce que hasardeuse en un sens plus profond, apparaît finalement la vie : celle-là n’est que perte, celle-ci signifie perdition2. » La perdition qui nous échoit. Parce que tout est voué à perte et destruction, le caractère mort-né de tout ce qui existe ne tarde pas à s’imposer avec violence, pour ne pas dire avec terreur, à la conscience : tout va à la mort, tout est mort. On se perd (événement : accident dans le cours de l’être), alors qu’on est en perdition (état : mise en question de l’être en général). C’est dire que la mort ne peut décidément plus être seulement considérée, selon le vœu de Sartre, comme événement pouvant survenir à tout moment dans le cours des choses et des êtres, mais bien comme la source nocturne de tout apparaître. Se creuse nettement l’écart entre la mort et le mourir. Ainsi en va-t-il de l’homme : il a beau ne mourir qu’une fois, il n’en est pas moins continuellement en état de perdition. Montaigne l’exprime pleinement dans une pertinente évocation de notre condition. « À chaque minute il me semble que je m’échappe3. » Ou encore : « Je m’échappe tous les jours et me dérobe à moi4. » Ce qui le conduit au constat suivant : « Nous n’avons aucune communication à l’être, parce que toute humaine nature est toujours au milieu entre le naître et le mourir, ne 1
O. Paz, « Le balcon », D’un mot à l’autre, in Le Feu de chaque jour, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 1990, p. 91-92. 2 C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 106. 3 M. de Montaigne, Essais, Gallimard, « Folio classique », 1973, I, chap. XX, p. 149. 4 Ibid., II, chap. XVII, p. 399.
69
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
baillant de soi qu’une obscure apparence et ombre, et une incertaine et débile opinion1. » Perte d’un être que nous ne possédons pas, que nous n’avons jamais possédé, précisément parce que c’est de l’être et qu’il n’est que le compagnon imaginaire de notre dénuement, de notre indigence. Sa réflexion l’amène à cette compréhension que la mort nous accompagne tout au long de la vie et qu’elle ne peut donc être réduite uniquement au terme de celle-ci. Il écrit en ce sens : « Le continuel ouvrage de votre vie, c’est bâtir la mort2. » Nous sommes dans la mort pendant que nous sommes en vie. Par conséquent, « la mort touche bien plus rudement le mourant que le mort, et plus vivement et essentiellement3 ». Et n’est-ce pas à la lueur de cette méditation que s’éclaire le mouvement des Essais qui, tout en exprimant la quête du moi de se fixer dans l’écrit, insistent sur l’impossibilité d’atteindre la stabilité de l’être ? Si bien que Montaigne entreprend non pas de représenter l’« être », mais de peindre « le passage [...] de jour en jour, de minute en minute4 », car le moi n’est que bigarrure, figure mobile, incessante métamorphose. « Nous sommes tous de lopins et d’une contexture si informe et diverse, que chaque pièce, chaque moment, fait son jeu. Et se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes, que de nous à autrui5. » C’est donc en détruisant l’illusion d’un moi, subsistant, permanent, entièrement saisissable que le texte se construit. « Moi à cette heure et moi tantôt, sommes bien deux6 ». Au sein de son unité imaginaire, le sujet n’est qu’une multiplicité, une pluralité de moi successifs, une mosaïque étrange de « pièces rapportées7 ». Autant de « je » qui varient sans cesse au gré du « vent des occasions8 ». À chaque moment, je suis un autre moi-même. La conscience aiguë de cette inconsistance du moi semble ainsi éclairer en profondeur le caractère mouvant de l’écriture de Montaigne, qui ne cherche pas, en conséquence, à cimenter le sujet mais, plutôt, à l’appréhender dans son morcellement et sa décomposition. Mise au jour de l’irréductible fragmentation commandant tout un chacun. Écriture de la précarité creusant le moi et sa dimension éphémère. Peindre le passage, autrement dit « le mouvement même par lequel l’être quitte l’être, par lequel il se dérobe à soi, par lequel il se sent mourir9 ». Comme le commente Françoise Dastur : « Il inaugure ainsi une tout autre conception de la
1
Ibid., II, chap. XII, p. 348. Ibid., I, chap. XX, p. 155. 3 Ibid. 4 Ibid., III, chap. II, p. 44. 5 Ibid., II, chap. I, p. 22. 6 Ibid., III, chap. IX, p. 233. 7 Ibid., II, chap. I, p. 21. 8 Ibid., p. 17. 9 G. Poulet, Études sur le temps humain, I, op. cit., p. 54. 2
70
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
mortalité, axée non plus sur l’instant critique de la mort, mais sur le mourir conçu comme le mode d’être fondamental de l’homme1 ». Sans cesse dépossédés de nous-mêmes, à proprement parler nous ne sommes pas. Aussi notre mal-être n’est-il que l’émanation de notre perpétuel manque à être. De même, ennui, angoisse, nausée constituent autant de signaux émetteurs, d’approches éparpillées de ce terme plus fort, plus profond, plus impitoyable, plus essentiel qu’est la perdition. Les choses et les êtres ne sont vivants que dans la mesure où ils sont repérables, identifiables. Que vienne à disparaître tout repère et tout meurt. Perdition désigne ainsi, comme y insiste Rosset, non la somme des pertes que nous ne manquerons pas d’essuyer, mais « la vérité générale que rien n’est à perdre, rien n’étant tenu2 ». La perdition : cette mise hors d’usage de tous les référentiels qui fait de la mort plutôt un état permanent qu’un événement possible et isolé, nous enracinant dans une terre ravagée et désertique. Ce n’est pas fortuit si des pièces comme Fin de partie et Oh les beaux jours se situent dans un univers totalement isolé de la vie, constitué d’espaces vides et inquiétants : chambre grise et sans meubles3, étendue d’herbe brûlée4, voire un désert5. Si, dans En attendant Godot, on peut encore trouver un chemin et un arbre, au bout du compte la scène beckettienne aboutit à un décor inexistant que l’auteur semble annihiler peu à peu pour laisser toute la place à l’écho du néant. « Huis clos » qui se déroule bien, comme celui de Sartre, dans un autre monde, « mais dans un autre monde qui n’est pas la mort fictivement vécue par des vivants, mais la vie réellement vécue comme une mort6 ». Aussi, à l’image d’une terre aride et inhospitalière, la scène n’offre-t-elle aucune véritable issue et lorsque l’on trouve une fenêtre, c’est pour constater un monde sans vie. Désire-t-on en effet, à l’instar de Hamm, le paralytique aveugle, savoir à quoi ressemble la terre au-dehors, on trouve un univers frappé de stérilité : HAMM. – Les flots, comment sont les flots ? CLOV. – Les flots ? (Il braque la lunette.) Du plomb. HAMM. – Et le soleil ? CLOV (regardant toujours). – Néant7.
1
F. Dastur, Comment affronter la mort ?, Bayard, 2005, p. 76. C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 105. 3 Fin de partie – Intérieur sans meubles, baigné d’une lumière grisâtre. 4 Oh les beaux jours – Etendue d’herbe brûlée avec, au centre, le mamelon de terre dans lequel est enterrée Winnie. 5 Acte sans paroles I – Un désert. On trouve aussi dans Cendres un bord de mer désert. 6 J.-M. Domenach, Le Retour du tragique, op. cit., p. 262. Nous soulignons. 7 FP, p. 47-48. 2
71
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Cette fois, comme l’annonçait F1 dans Comédie, tout est « noir, silencieux, révolu, oblitéré1 ». L’univers est bouché, sombre, froid, inerte. Rien qui puisse mimer une présence, de la vie enfin. Seul, prisonnier dans sa cellule depuis déjà plusieurs jours, abandonné, Biélov en donne l’exacte transcription : « La vie est morte. Il reste quelque chose d’étranger, d’effrayant. […]. Et l’abîme connu en bas, plein de mort et de silence, s’est ouvert devant les yeux. Pour la dernière fois la flamme s’est élancée en un éclat rouge, gémissant, puis s’est éteinte2. » Le gouffre et la mort enclosent désormais toutes choses. Mort est l’état de tout ce qui existe, de tout ce qui a pu jadis revêtir une apparence de vie. En témoigne l’humour macabre de Hamm : HAMM. – Cette nuit j’ai vu dans ma poitrine. Il y avait un gros bobo. CLOV. – Tu as vu ton cœur. HAMM. – Non, c’était vivant3.
Processus de désaffection achevé. La mort n’apparaît plus comme le terme inéluctable de toute « vie » ; c’est la vie elle-même qui perd sa dimension vivante, « révélant ainsi son appartenance originelle à la mort4 ». Si initialement cela correspond pour l’individu à un processus de dénaturation5, couplé à un mécanisme d’épouvante, − normal puisque survenant comme toujours trop tard : bien après que ce soit installée la croyance en l’idée d’une vie −, à proprement parler : « Ce qui existe est – a toujours été – rien6. » Le fond des choses, humaines et non humaines, est le rien. La mort ne s’empare pas d’une vie préalablement existante. Elle ne se superpose pas à la vie, car il n’y a jamais eu de vie. « La vie n’a pas cessé ; elle n’a, en fait, pas commencé7. » Il n’y a donc pas opposition de l’état de vie à l’état de mort, ce dernier désignant l’état même de ce qui existe. Nous aboutissons à une conception de la mortalité, sur la même ligne que Montaigne, centrée donc, non pas sur l’instant critique de la mort, mais bien sur le mourir appréhendé comme le mode d’être fondamental de l’homme. Conception qui est au fondement de l’analyse de l’être vers la mort que propose Heidegger. La mort s’inscrit, en effet, dans la philosophie heideggerienne, précisément parce que dès le début elle appartient à la vie. Non pas, donc, en tant que la dernière heure ou que certaines formes particulières de la mort que nous pourrions combattre.
1
S. Beckett, Comédie, in op. cit., p. 10. E. Zamiatine, Seul, Rivages, 1990, p. 93. 3 FP, p. 49. 4 C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 105. 5 E. Ionesco, Le Roi se meurt, op. cit., p. 27, 28, 45. 6 C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 98. 7 Ibid., p. 99. 2
72
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Il s’agit de la mort qui appartient à la vie, qui lui est d’emblée intimement liée. « Le finir auquel on pense dans le cas de la mort ne signifie pas pour le Dasein être-à-la-fin, mais au contraire un être vers la fin de cet étant. La mort est une manière d’être que le Dasein assume sitôt qu’il est1. » Et Heidegger d’ajouter, citant le poème médiéval Le laboureur de Bohème : « Sitôt qu’un homme vient à la vie, il est tout de suite assez vieux pour mourir. » Voilà ce qui échoit à l’homme. Présence, et non pas accident surgissant du dehors de notre existence, la mort est inscrite dans l’essence même de l’homme. Exister signifie être jeté dès le départ sur les avenues de la mort. « La “possibilité” de la mort-événement est seconde et relative » en considération de « la “possibilité” de la réalité humaine-état »2. Celle-ci étant déjà pourvue d’un état de mort, l’événement mortel se contentera, pour ainsi dire, de le ressaisir, de le confirmer. L’homme est ainsi toujours déjà sa fin, celle-ci ne pouvant par conséquent lui arriver du « dehors » que parce qu’il est, dès l’origine, déjà ouvert à elle. Se saisir en état de perdition signifie comprendre profondément, et non pas, là encore, de manière théorique, que la naissance et la mort ne sont pas des événements marquant les limites externes d’une existence, mais les dimensions fondamentales de l’exister. C’est dire que la naissance est en elle-même déjà une ouverture à la mort, que le fait de naître nous investit par lui-même du pouvoir de mourir. À partir du moment où la mort est appréhendée non plus comme extrinsèque et étrangère à la vie, mais comme lui étant coextensive, l’englobant tout au long de son cours, la mort n’est pas uniquement devant, mais aussi derrière nous, puisque dès notre naissance la mort commence son œuvre. Quelle que soit la violence de cette image, elle est pourtant telle : le berceau et le cercueil vont de pair. N’est-il pas alors à propos de concevoir, avec Cioran, que : « Nous avons perdu en naissant autant que nous perdrons en mourant. Tout3 » ?
1
M. Heidegger, Être et Temps, op. cit., § 48, p. 299. C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 106. 3 Cioran, De l’inconvénient d’être né, in op. cit., p. 1305. 2
73
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Le crime d’être né « Qu’on me gracie, si je suis coupable, et me laisse expier, dans le temps, en allant et venant, chaque jour un peu plus pur, un peu plus mort. Le tort que j’ai c’est de vouloir penser, un des torts, même de cette façon, tel que je suis je ne devrais pas le pouvoir, même de cette façon. Mais qui ai-je donc pu offenser aussi gravement, pour que je sois puni de cette façon incompréhensible… » Samuel Beckett, Textes pour rien.
« Le premier des biens est tout à fait hors de ta portée : ne pas être né, ne pas être, ne rien être. Mais le second des biens pour toi est… de mourir sous peu1. » Au roi Midas qui demandait quel était le premier des biens, le sage Silène, précepteur de Dionysos, fit cette réponse. Propos que l’on retrouve notamment aussi chez Sophocle, exprimé de manière fort similaire par le chœur informé du sort d’Œdipe : « Ne pas naître, voilà qui vaut mieux que tout. Ou encore, arrivé au jour, retourner d’où l’on vient, au plus vite, c’est le sort à mettre aussitôt après2. » Même expression d’un mal inhérent à l’existence – Même aspiration à ne pas être né. Pointe saillante du sentiment tragique de la vie. Comment, en effet, l’homme parvenu aux confins de son existence ne se retrouverait-il pas dans ces propos des anciens ? De finitude à natalité le glissement de la pensée forcément s’opère. Parce que naître, c’est bel et bien « arriver chez les morts, “déboucher en plein ossuaire”3 », il n’y a qu’un seul accident véritable : la naissance. « Elles accouchent à cheval sur une tombe, le jour brille un instant, puis c’est la nuit à nouveau4 », déclarera Pozzo en parlant de nos mères, juste avant de quitter la scène. Comme le commente Ludovic Janvier : « La mauvaise naissance, d’avoir consenti à vivre dans sa mère, puis à la quitter, a tout à voir avec l’insupportable sentiment de la contingence : c’est au regard d’un absolu regard, le sentiment de l’originelle imperfection, de la radicale déperdition d’être où l’on est inscrit5. » Le berceau et la tombe nouent de troubles étreintes. Loin d’être considéré comme un don ou une bénédiction, comme l’exprime la voix populaire, le surgissement hors du sein maternel est dès lors appréhendé comme l’erreur, la dissonance fondamentale.
1
F. Nietzsche, La Naissance de la tragédie, 10/18, 1991, § 3, p. 45. Sophocle, Œdipe à Colone, in Œuvres, III, Philoctète – Œdipe à Colone, Les Belles Lettres, « Collection des universités de France », 1990, v. 1224-1228, p. 129. 3 J.-M. Domenach, Le Retour du tragique, op. cit., p. 261. 4 EAG, p. 126. Paroles auxquelles Vladimir fera écho un peu plus tard : « À cheval sur une tombe et une naissance difficile. Du fond du trou, rêveusement, le fossoyeur applique ses fers. » (Ibid., p. 128). 5 L. Janvier, Beckett, Seuil, « Écrivains de toujours », 1969, p. 92. 2
74
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Nous aboutissons à la mise en cause, en définitive, du commencement, du cri initial, de l’heure inaugurale1. Parce que la mort, loin de se présenter seulement au terme de la vie, l’accompagne dès son départ ; parce que naître, c’est déjà mourir. À ce stade, les deux mondes de la vie et de la mort s’entremêlent au plus haut point. De sorte que l’on pourrait écrire avec Pessoa, selon les termes déchirés de l’intranquillité : « Les morts naissent, ils ne meurent pas2. » Distorsion encore et toujours. Mort interminable. Fin qui n’en finit pas de finir, où l’on meurt de ne pas mourir. De là « l’inconvénient d’être né » d’un Cioran déclarant : « Nous ne courons pas vers la mort, nous fuyons la catastrophe de la naissance3 », et, plus profondément encore, le trouble sentiment d’un véritable crime attaché à la naissance. Car, comme le relève Sigismond, « c’est le plus grand crime de l’homme que d’être né4 ! » Écho en nous de ces vers de Calderon commentés déjà par Schopenhauer qui y voyait la véritable signification de la tragédie, à savoir que « le héros n’expie pas ses péchés individuels, mais le péché originel, c’est-à-dire le crime de l’existence elle-même5 ». Propos que Beckett reprendra lui aussi à son compte, appréhendant, dès son premier ouvrage consacré à Marcel Proust, le sujet tragique et sa régénération d’une culpabilité sans faute : « La tragédie n’a pas de lien avec la justice humaine. La tragédie est le récit d’une expiation, mais pas l’expiation minable de la violation d’une loi locale codifiée par des fripons à l’usage des imbéciles ; le personnage tragique représente l’expiation du péché originel, du péché éternel et originel qu’ils ont commis, lui et tous ses socii malorum : le péché d’être né6. » Vision d’une faute attachée à l’existence même et, plus spécifiquement, à la naissance. Sorte de culpabilité aux contours imprécis qui fait que l’on se sent coupable sans avoir commis aucune faute. Lointain écho du péché originel, en tant que signe de néantisation actuelle par la mort. Pourquoi cette fin qui n’en finit pas de finir ? Cette mort sans coupable est cependant culpabilisante. Tel est le paradoxe auquel nous ramène immanquablement le tragique : le paradoxe de la culpabilité innocente, d’une culpabilité originelle liée à l’espèce et dont l’individu a le sentiment de manifestement devoir payer le prix.
1
Ainsi ces mots de Beckett dans Têtes-mortes : « Non, je ne regrette rien, tout ce que je regrette c’est d’avoir vu le jour, c’est si long, mourir, je l’ai toujours dit, si lassant, à la longue. » (Têtes-mortes, Minuit, 1972, « d’un ouvrage abandonné », p. 17). Voir aussi Solo, où le récitant ouvre son propos (télégraphique) sur cette phrase : « Sa naissance fut sa perte. » (Catastrophe et autres dramaticules, Minuit, 1982, p. 30). 2 F. Pessoa, Le Livre de l’intranquillité, I, Christian Bourgois, 1988, 98, p. 172. 3 Cioran, De l’inconvénient d’être né, in op. cit., I, p. 1271. 4 P. Calderon de la Barca, La Vie est un songe, Librio, 1996, p. 8. 5 Le Monde…, chap. 51, p. 325 suivi des deux vers de Calderon. 6 S. Beckett, Proust, Minuit, 1990, p. 79 suivi également des deux vers de Calderon.
75
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
Ce à quoi En attendant Godot fera écho, une décapante ironie soulignant alors le paradoxe : VLADIMIR. – Si on se repentait ? ESTRAGON. – De quoi ? VLADIMIR. – Eh bien… (Il cherche.) On n’aurait pas besoin d’entrer dans les détails. ESTRAGON. – D’être né1 ?
La prise de conscience de soi semble aller de pair avec la naissance de l’homme coupable. Cette culpabilité révèle sans doute, le plus nettement, l’image tragique de la subjectivité à la fois isolée et intérieurement déchirée. Comme l’écrit Poulet, commentant la nausée sartrienne, à partir du moment où exister coïncide avec un échouage, une chute privée de toute raison d’être, émerge ce sentiment : « Exister, c’est trébucher, rouler en bas d’une pente. Sorte de péché originel, sans juge, sans faute et sans coupable, qui ferait qu’on se découvre tombé dans l’existence. Loin d’être un don, l’existence serait plutôt une soustraction, une privation d’être2. » Le sentiment tragique introduit, ainsi, le concept paradoxal d’une culpabilité innocente, d’une culpabilité d’ordre métaphysique, dans la mesure où elle précède et dépasse toute faute commise. Sentiment vague du péché repris et thématisé, comme l’on sait, par le christianisme avec le dogme du péché originel3. La position chrétienne reconnaît la vocation dès l’origine de l’homme à la mort. Ce en quoi elle n’est pas étrangère au tragique. L’homme est « semé corruptible », écrit saint Paul. Mais, et c’est là que se creuse un premier écart avec la vision tragique, le péché originel ne désigne pas un vague état, expression symbolique de la déchirure interne de l’homme instruit de son état de perdition. Si la mort est intimement liée à notre existence, c’est par l’effet d’un péché tout autant actif qu’ancestral, emblématique de la rupture originelle de l’alliance avec Dieu, qui a installé l’homme dans une situation de dette à son égard. La dette de mort est à appréhender en ce sens. La mort n’a donc rien de gratuit, elle est le « salaire du péché4 ». Si l’homme meurt dès sa naissance, à chaque instant, c’est donc, « non seulement parce qu’il se rapproche de la mort, mais parce que chaque instant 1
EAG, p. 13. G. Poulet, Études sur le temps humain, III, Presses Pocket, « Agora », 1989, p. 225-226. 3 Rappelons que, au-delà du dogme développé dans le christianisme et destiné à expliquer l’origine du mal et de la mort, le terme de « péché originel » a été créé par saint Augustin, sans doute aux environs de 397, afin de désigner précisément l’état de péché dans lequel se trouve tout homme, en tant qu’il est issu d’une race pécheresse. Plus tard, le terme a été étendu au péché d’Adam, père de l’humanité. 4 Voir Les Épîtres de saint Paul, « Épître aux Romains », chap. 5, 12 : « Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort a passé en tous les hommes, situation dans laquelle tous ont péché ». Pour toutes les citations de La Bible, nous nous référons à La Bible de Jérusalem. 2
76
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
porte en lui la corruption et la pourriture1 ». Et dans cette perspective, comme nous l’analyserons plus loin, seul l’événement surnaturel de la résurrection peut rompre ces attaches de l’homme à la mort et lui offrir une nouvelle création. Au-delà de toute question de croyance religieuse, il est intéressant de chercher à comprendre comment ce dogme a pu, lui-même, être formé. Celui-ci, comme l’exprime Dastur dans le sillage de Heidegger, n’a certainement pu être formulé que parce que l’être humain, en naissant, voit s’étendre derrière lui un passé absolu qu’il ne pourra jamais complètement s’approprier et dont il est pourtant « originairement » coupable2. Ce qui conduit Cioran à considérer que : « Tout être qui se manifeste rajeunit à sa façon le péché originel3 », reconnaissant par là une certaine fécondité du concept4. Cioran ne s’intéresse pas ici, comme il le précise, à l’interprétation théologique du péché, mais bien à ce qu’il permet d’exprimer sur l’homme, sur cette impression de brisure originaire qui le caractérise. Nous faisons l’expérience d’une « culpabilité » du fait même que notre être implique avec nécessité la possibilité du non-être. La confrontation à « cette énigme qu’est la disparition totale de son propre être5 », la remise en question de notre existence et de ses vacillations impliquent celle de notre propre naissance. Le sentiment de culpabilité survient après coup, c’est-àdire qu’il requiert la prise de conscience de la responsabilité d’une dette à laquelle l’existant ne peut se soustraire et dont il ne peut s’acquitter. La naissance et le passé absolu qu’elle représente. Comme l’angoisse, cette culpabilité nous place donc face à ce défi paradoxal que l’être humain n’est et ne sera jamais l’origine de son propre être, mais doit assumer l’étrangeté inhérente à la condition humaine. Selon l’analyse heideggerienne, « l’être-en-dette » est intimement lié au devoir mourir, à « l’être vers la mort ». L’être humain est seul devant sa mort qui est sa possibilité la plus propre. Cette dette de mort me renvoie à ma singularité irremplaçable, puisque nul ne peut mourir à ma place, se substituer à moi s’agissant du rapport à établir avec ma propre mort6. Il faut préciser, comme l’explicite Nathalie Sarthou-Lajus, que cette injonction m’appelant à la responsabilité de mon être vers la mort se situe hors de toute considération éthique, dans la mesure où je ne meurs pas pour quelqu’un7. Heidegger recourt à dessein au neutre,
1
E. Morin, L’Homme et la Mort, Seuil, « Points », 1970, p. 232. F. Dastur, La Mort, op. cit., p. 66. 3 Cioran, Syllogismes de l’amertume, in Œuvres, op. cit., p. 812. 4 Cioran, Entretien avec Georg Carpat Focke, Entretiens, op. cit., p. 250. 5 F. Dastur, Comment affronter la mort ?, op. cit., p. 6. 6 « Nul ne peut décharger l’autre de son trépas. […] Le trépas, c’est à chaque Dasein de le prendre chaque fois lui-même sur soi. » (M. Heidegger, Être et Temps, op. cit., § 47, p. 293). 7 N. Sarthou-Lajus, La Culpabilité, Armand Colin/VUEF, « Cursus », 2002, p. 126. 2
77
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
« es ruft », ôtant ainsi à l’idée de dette toute portée éthique et relationnelle. L’injonction qui appelle d’en « Haut » l’existant à sa possibilité la plus propre, à son être vers la mort, advient certes de plus loin que lui, sans pour cela venir d’un autre que lui. « L’étrangeté de l’origine de cet appel renvoie le Dasein à la déréliction de son être-jeté et au néant de la mort à laquelle sa réponse est destinée1. » Assumer, dans cette perspective, signifie reconnaître non sa situation de pécheur, mais sa déréliction originelle. Renvoi donc à la solitude de l’existant, se distinguant nettement de la souillure du péché issu de la perspective chrétienne. Effet de la déréliction, la culpabilité tragique, en parlant du péché d’être né, évoque, nous l’avons vu, une culpabilité sans faute réelle, sorte d’expiation insondable, sans juge et sans coupable. La conception chrétienne, quant à elle, suppose que le croyant endosse, non pas symboliquement mais réellement la faute du premier homme, et entre, pour cela, dans la logique d’un repentir héréditaire. Ce en quoi la vie chrétienne demande au fidèle de faire pénitence, faisant du repentir perpétuel un acte inséparable de la vie du croyant. Tel est le point spécifique de la doctrine du péché originel : les générations présentes endurent, à travers de multiples souffrances, les conséquences du passé, passé qui implique donc une profonde et indissoluble solidarité dans le péché. Outre ses propres péchés et ceux d’autrui, le chrétien doit donc aussi se faire pardonner les péchés ancestraux, ceux qu’il n’a pas commis. Sa vie morale et religieuse est marquée, au cœur d’elle-même, par un péché toujours déjà présent, avant même toute faute imputable à un libre exercice personnel. Mais, précisément, l’expérience chrétienne de la culpabilité doit permettre de dégager un sens du péché : la repentance porte en elle un espoir de purification. Elle est en conséquence ouverte « à la promesse d’une grâce et d’une rédemption qui commencent avec le repentir de l’homme coupable2 ». Le dogme de la chute et de la rédemption implique, ainsi, que l’homme a le sentiment qu’il dépend de lui que sa vie soit sauvée ou perdue dans la mesure où il sera jugé sur ses actes, plus exactement sur la pureté de sa conscience. Or, ici, notre conscience et la droiture de son intention ne peuvent être convoquées. La formulation tragique de la culpabilité parle d’un arrachement se situant en deçà du bien et du mal, hors de toute connotation éthique, très éloignée donc du couple repentir-espoir de purification. Ce « péché originel » est, comme le relève Janvier, ce qui le distingue radicalement de l’autre issu de la perspective chrétienne. Nous sommes dans le registre de l’inguérissable, privé de perspective rédemptrice. En nous plaçant, par conséquent, hors des raisons avancées par la religion, nourrie de
1 2
Ibid. Ibid., p. 12.
78
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
la déficience originelle de la créature humaine, nous vivons de ce fait avec le sentiment trouble d’une culpabilité privée de la rédemption. Camus l’exprimait à sa manière : « l’absurde c’est le péché sans Dieu1 ». Existence ramenée à son caractère profondément désancré, à son état de déréliction originaire, vouée dès lors à se sentir elle-même en cause, l’existant n’ayant même pas la possibilité de se repentir. Privé de la rédemption, le péché originel n’est autre que culpabilité d’être. Parce que « tout ici est faute, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas de qui, on ne sait pas envers qui, quelqu’un dit on2 ». Sentiment archaïque du péché qui met la vie en faute, mais commandé donc ici par l’image de cette exemplaire punition : « l’expiation immémoriale3 », comme le dit Molloy. Nous n’expions pas, par conséquent, quelque faute ancestrale ou le courroux des Dieux, mais c’est la vie qui est le crime. Ce n’est pas la mort, c’est la vie – en tant que néantisation actuelle par la mort – qui est l’expiation. « Chacun expie son premier instant4. » Notre seul tort, c’est d’être. C’est la vie elle-même, c’est-à-dire le fait d’être engendré qui semble devoir être expié : être initié à la destruction après avoir été initié à l’existence. C’est ainsi à la reconnaissance d’une malédiction liée à l’existence même, d’une culpabilité sans faute individuelle, qu’aboutit la vision tragique. En quoi, notamment, la tragédie grecque représente toujours ce paradoxe d’un homme à la fois coupable et innocent, aveugle et lucide, libre et livré aux puissances du destin. Il est important de rappeler que, à la différence du héros épique qui se distingue par ses exploits, le héros tragique est remarquable par sa volonté d’assumer jusqu’à sa mort une histoire criminelle qui le précède et le poursuit, lors même qu’il est totalement innocent. Œdipe a reconstitué le chemin le ramenant à la catastrophe annoncée. Si, dans un premier temps, il se crève les yeux, sa force et sa lucidité viendront de sa capacité à se reprendre et à assumer sa part. Il l’endosse et la supporte jusqu’à la fin. La conscience réfléchie ressaisit l’enchaînement des faits comme destin. Autrement dit, elle assume sa culpabilité dans l’acte même où elle met au jour son innocence. Expression du caractère à la fois justifié et immérité de la souffrance humaine. Justifié parce que naître, c’est en soi ressusciter les puissances de destruction et de mort. Immérité, parce que tout aussi gratuit que fondamental : « Quel péché as-tu commis pour naître, quel crime pour exister ? Ta douleur comme ton destin est sans motif. Souffrir véritablement c’est accepter l’invasion des maux sans l’excuse de la causalité, comme une faveur de la nature démente, comme un miracle
1
A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 49. S. Beckett, L’Innommable, op. cit., p. 195. 3 S. Beckett, Molloy, op. cit., p. 105. 4 Cioran, De l’inconvénient d’être né, in op. cit., p. 1369. 2
79
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
négatif1… » Notons, pour revenir à Œdipe, que si le personnage et le chœur déplorent l’impuissance de l’homme face au destin souverain, personne ne s’interroge sur la raison de ce qui se produit. À aucun moment, en effet, Sophocle n’entreprend d’expliquer la sévérité du sort réservé à Œdipe. Nous voici donc bien en présence d’une sorte de « souffrir originaire », qui fait de nous des êtres, pour ainsi dire, toujours déjà déchus. Déjà déchus avant de déchoir. « La vérité et le fond des choses – nous dit Schopenhauer –, c’est que chacun doit considérer comme siennes tout ce qu’il y a de douleurs dans l’univers, comme réelles toutes celles qui sont simplement possibles, tant qu’il porte en lui la ferme volonté de vivre, tant qu’il met toutes ses forces à affirmer la vie2. » Car, selon la thèse du philosophe, la distinction des individus est illusoire, la volonté est unique et indivisible. Nous pouvons bien, en conséquence, retenir l’analyse de Schopenhauer et nous sentir tenus d’assumer la condition de l’espèce ; seulement il ne semble pas moins aberrant d’en être tenus pour responsables. Michel de Ghelderode l’exprime nettement : « Tout le monde est coupable et personne n’est responsable3 ! » On ne peut pas, en effet, sérieusement accuser la créature finie de n’être que ce qu’elle est, pour la raison simple « qu’il n’y a jamais eu de candidat à l’existence4… » « Personne, comme le souligne Jankélévitch, ne se rappelle avoir délibérément choisi son destin ou son caractère dans une existence prénatale5… » L’être qui est n’a jamais eu à choisir entre naître et ne pas naître. Je ne décide pas de mon existence. Elle m’est donnée avant toute initiative. Elle est donc une donation passive qu’aucune décision mienne ne précède. Passivité essentielle signifiant, ainsi, qu’« à quelque moment qu’on la considère, la créature finie est déjà négation positive ou position niée6 ». De quoi s’autoriser à conclure avec Jankélévitch : « Avant la naissance il n’y avait personne pour choisir, et après il était déjà trop tard7 ! » En atteste la crudité des mots de Ghelderode : […] l’innocent qui vient de naître n’est pas sûr de n’avoir point mérité la potence en pissant dans sa berce8 !
1
Cioran, Précis de décomposition, in op. cit., p. 605. Le monde…, chap. 63, p. 445. 3 M. de Ghelderode, Les Entretiens d’Ostende, L’Ether Vague, 1992, p. 136. 4 V. Jankélévitch, La Mort, op. cit., p. 102. 5 Ibid., p. 101. 6 Ibid., p. 102. Nous soulignons. 7 Ibid. 8 M. de Ghelderode, Marie la Misérable, in Théâtre, IV, Gallimard, « Blanche », 1955, p. 242. Voir aussi Les Entretiens d’Ostende : « Même l’enfant qui vient de naître est coupable ». (op. cit., p. 136). 2
80
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
D’où aussi l’hésitation de Vladimir qui, comme nous l’avons vu, songe à se repentir sans trop savoir de quoi. Comment alors ne pas se sentir jouet de l’espèce qui perpétue toute sa misère ? Schopenhauer n’a pas tort : il y a bien, à cet égard, quelque chose de sordide dans le vouloir-vivre, dans cet entêtement à vouloir se reproduire par la génération. Plongeant à présent « notre regard dans le tumulte de la vie, nous voyons tous les êtres accaparés par les maux et les soucis de cette existence, tendant de toutes leurs forces à satisfaire des besoins sans fin et à se défendre contre des souffrances variées, sans pourtant pouvoir espérer autre chose que la conservation de cette vie individuelle tourmentée, pendant un bref laps de temps. Or, au milieu de cette mêlée, nous voyons se rencontrer les regards pleins de désirs de deux amoureux. – Mais pourquoi est-ce à la dérobée, craintivement, furtivement ? – Parce que ces amoureux sont les traîtres qui cherchent en secret à perpétuer toute cette misère et toutes ces peines, vouées sans eux à une fin prochaine ; ils veulent empêcher que tout cela cesse, comme leurs semblables l’ont fait avant eux1. » On songe à cette comparaison des hommes avec des horloges faite par Schopenhauer, ces hommes qui, pour la plupart, poursuivent inlassablement leur « marche titubante » vers la mort « en compagnie d’une procession d’idées triviales »2, dans l’ignorance forcenée de ce qu’ils sont. À chaque naissance, « c’est l’horloge de la vie humaine qui se remonte, pour reprendre sa petite ritournelle, déjà répétée une infinité de fois, phrase par phrase, mesure par mesure, avec des variations insignifiantes3 ». Ainsi, Hamm n’hésitera pas à demander des comptes à Nagg, son père qui, à ce stade de souffrance exacerbée, se voit alors qualifié de « maudit progéniteur » et « fornicateur »4 : HAMM. – Salopard ! Pourquoi m’as-tu fait ? NAGG. – Je ne pouvais pas savoir. HAMM. – Quoi ? Qu’est-ce que tu ne pouvais pas savoir ? NAGG. – Que ce serait toi5.
Et si Nell et Nagg sont enfermés dans leurs poubelles, c’est précisément parce que celles-ci font office de cachots nauséabonds. Les parents de Hamm subissent le sort de criminels ayant propagé la mort ; ce qu’ils ont fait en donnant la vie6.
1
A. Schopenhauer, Métaphysique de l’amour, in Métaphysique de l’amour – Métaphysique de la mort, op. cit., p. 88. 2 Le Monde…, chap. 58, p. 406. 3 Ibid. 4 FP, p. 23, 24. 5 Ibid., p. 69. 6 Type de condamnation à laquelle ces propos de Cioran peuvent faire écho : « Avoir commis tous les crimes, hormis celui d’être père. » (Cioran, De l’inconvénient d’être né, in op. cit., p. 1273).
81
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
L’on comprend de même le scandale mêlé de peur et d’incrédulité que provoque dans Fin de partie et Oh les beaux jours l’apparition d’êtres vivants – hommes ou animaux. Ainsi, lorsque Clov au moyen de sa lunette croit avoir vu quelqu’un, Hamm réagit avec une extrême virulence contre ce « procréateur en puissance » : CLOV (regardant). – Quelqu’un ! C’est quelqu’un ! HAMM. – Eh bien, va l’exterminer. (Clov descend de l’escabeau.) Quelqu’un ! (Vibrant.) Fais ton devoir1 !
Significatif aussi est l’étonnement effrayé de Winnie à la vue d’une fourmi… – Tiens ! Qu’est-ce que je vois là ? […] On dirait de la vie ! […] Une fourmi ! […] Willie, une fourmi, vivante2 !
…ou encore de Hamm à l’idée que subsistent un rat3 ou une simple puce : – Mais à partir de là l’humanité pourrait se reconstituer ! Attrape-la, pour l’amour du ciel ! […] – Une puce ! C’est épouvantable ! Quelle journée4 !
Cette apparente cruauté, mêlée à un sens certain de la dérision, est sans doute là pour exprimer cette solitude qui se heurte, se cogne et se blesse aux parois du désarroi, effet de la perdition. Au-delà des échos corrosifs de ces répliques, demeure ce sentiment de payer sa dette pour un choix qui n’a pourtant jamais eu lieu. N’est-ce pas précisément cela qui est ressenti par la conscience qui remonte le courant de la naissance ? Payer le prix d’une « candidature » pour laquelle nul n’a jamais postulé ? – Mais je ne suis pas coupable ! dit K..., c’est une erreur. D’ailleurs, comment un homme peut-il être coupable ? Nous sommes tous des hommes ici, l’un comme l’autre. – C’est juste, répondit l’abbé, mais c’est ainsi que parlent les coupables5.
Être coupable devant aucune autorité, être convoqué à un procès sans avoir commis de faute particulière. Ainsi Joseph K., inculpé, ne sait ni pour quelles raisons ni devant quels juges il l’est. Il a beau se défendre, proclamer que son innocence ne peut être remise en cause, il meurt « comme un chien » un couteau de boucher enfoncé dans le cœur. « “Comme un chien ! ” dit-il, 1
FP, p. 103. OBJ, p. 36. 3 FP, p. 75. 4 Ibid., p. 50. 5 F. Kafka, Le Procès, Le Livre de Poche, 1963, p. 343. 2
82
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
et c’était comme si la honte dût lui survivre1. » Cette honte qui préexiste et qui dépasse le champ de son existence est destinée à lui survivre, à survivre à chacun. Vivre, c’est se commettre. Être né, c’est exister. Et exister, c’est être jugé. Un prévenu libre : la pire condition. Pour rien : n’être coupable de rien, mais être condamné, devoir payer malgré tout. Gratuité, culpabilité liée au fait même d’exister, comme le soulignent ces mots de Cioran : « Au fond, que fait chaque homme ? Il s’expie lui-même2. » À partir du moment où il n’y a pas de don de l’être, ne reste que la chute dans l’existence. On s’éprouve comme étant là sans l’entremise de personne, de rien. Il n’y a pas d’issue à cette plaie ouverte. Inarrangeable souffrance. Nous arrivons alors à ce point où la faute n’est plus que peine, cette peine qui « demeure, nue, crue, sans l’aide des mots qui lui donnaient espoir3 ». Que dire de ce sentiment incontournable issu de la traversée angoissée ? Creusant le sillon de cette peine nue et crue, plus encore que de la honte, se dessine la trace d’un profond sentiment d’humiliation. C’est là, selon nous, ce qui sépare peut-être le plus radicalement les deux formes de culpabilité, chrétienne et tragique. La culpabilité chrétienne suppose la honte qui appelle au repentir. La culpabilité tragique évoque plutôt une forme d’humiliation. Ainsi l’exprime François George, commentant la pensée de Jankélévitch : « Le fait est que je suis là, et que je n’y suis pour rien, et que ma conscience et ma liberté s’en trouvent grandement humiliées. En deçà de toutes les significations, de toutes les justifications que la conscience donnera librement à sa présence dans le monde […], demeure comme une limite et comme un démenti le fait brut de cette présence4 ». Nous sommes bien dans le registre de l’inguérissable, à jamais sans rédemption. Existence arrimée à rien, marquée par l’empreinte indélébile de la facticité. En se rapportant à sa finitude essentielle, l’homme ne découvre pas seulement son propre « être vers la mort », mais aussi, simultanément, qu’il n’existe qu’en tant qu’« être-jeté-là », donné à lui-même comme un fait, sans appui, se trouvant malgré lui dans telle situation particulière, en un lieu et un temps déterminés. Mis devant lui-même comme être-au-monde, l’existant s’aperçoit qu’il existe sans l’avoir choisi ; il se saisit comme proprement « jeté » dans l’existence. Exister, c’est être livré à, projet jeté au monde. « La situation d’être-jeté s’accompagne du sentiment d’être abandonnés à notre sort parmi les existants qui nous pressent5. » La déréliction est inhérente à notre condition. Ce qui signifie qu’elle n’est pas un événement passé, mais un caractère permanent de l’existence. Je suis toujours déjà jeté au monde et abandonné à moi-même. Se révèlent, ainsi, la 1
Ibid., p. 367. Cioran, Le Crépuscule des pensées, in Œuvres, op. cit., p. 359. 3 L. Janvier, Beckett, op. cit., p. 94. 4 F. George, « La pensée en personne », L’Arc, « Vladimir Jankélévitch », op. cit., p. 20. 5 M. Corvez, La philosophie de Heidegger, op. cit., p. 37. 2
83
L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE
contingence et la précarité de mon existence. Je ne vois pas seulement, dès lors, que je suis, mais que je dois être. Je suis tenu de me réaliser, de prendre en charge cette présence. Assumer mon existence est une tâche à laquelle je ne peux me soustraire. Je ne serai que par le déploiement de mes propres possibilités. Dès que j’existe, mon être m’est donné comme un devoir-être. Exister signifie être né, autrement dit ne pas être à l’origine de soi-même. C’est pourquoi la finitude radicale de l’existence ne peut être qu’assumée. L’authenticité de son être dépend alors, pour chacun, de son aptitude à la reconnaître et à l’accepter. Soit repli, refuge dans l’anonymat du « on » où bavardent des armées de « divertis », suivant les codes d’un même cadre d’ignorance : « on meurt », « ils meurent », je ne suis pas vraiment concerné... Existence se satisfaisant d’un rapport impersonnel et, par conséquent, tronqué à notre condition. Soit tentative d’affronter sa finitude : tordre l’arrachement, malaxer la solitude, pour qu’elle rende un son singulier, seul fidèle à la partition qui se joue. Celle du pas d’un existant qui refuse l’esquive, pour se confronter au caractère toujours irréductiblement « mien » de l’existence et, de ce fait, au rapport à établir avec sa mortalité constitutive. « Au début de toutes choses, écrit le Loup des steppes, il n’y a ni innocence ni ingénuité ; tout ce qui est créé, même ce qui apparaît comme le plus simple, est déjà coupable, déjà lancé dans le torrent boueux du devenir, et ne peut jamais, jamais remonter le courant1. » Le crime d’être né traduit, au fond, cette étape de l’existant que nous sommes qui réalise qu’il ne se définit que par son arrachement primordial, impliquant l’obligation de se créer soi-même, d’assumer lucidement son déracinement.
1
H. Hesse, Le Loup des steppes, Presses Pocket, 1985, « Traité du loup des steppes », p. 38.
84
CHAPITRE II ÉCHOS DU RÉEL « Tant mal que pis encore et tout dans l’écarquillé encore. Tout d’un seul coup comme jadis. Mieux plus mal que tout. Les trois courbés. L’écarquillé. Le vide étroit tout entier. Nulles taches brouillées. Tout net. Net obscur. Trou noir béant sur tout. Absorbant tout. Déversant tout. » Samuel Beckett, Cap au pire.
Après cela, aucune consolation ne prend plus : « aucun océan ou ciel étoilé ne peut, par sa beauté, me faire oublier cette souffrance qui sourd de mon corps comme si elle y avait toujours été, lovée, cachée dès le premier cri lorsque je fis connaissance avec la lumière du monde1 ». Cela n’a rien à voir avec de la rancœur ou avec un refus forcené d’oublier. Il s’agit d’honnêteté, de rigueur, de lucidité tout simplement : de la perception du caractère constitutionnellement irréparable de ce qui a été éprouvé là. L’Irréparable ronge avec sa dent maudite Notre âme, piteux monument2.
« Il n’est plus possible de revenir en arrière, au temps où il n’y avait pas encore la mort, où l’on cessait de vivre sans avoir jamais été mortel3. » Passé de l’autre côté de la vie, on ne revient pas en arrière. En soi-même, telle une plaie ouverte, demeure ce trou du néant : puits grondant de notre inanité, de notre constitutive facticité. « Disparition du vide ne se peut4. » Ce vide que l’on a découvert en soi, rien ne peut faire qu’il n’ait jamais eu lieu. Toujours d’ailleurs, il resurgira ce déchirement − sourde solitude, malaise intérieur, angoisse renaissante −, sonnant comme un rappel à l’ordre. L’épreuve du tragique est l’épreuve décisive. Consécration d’une fracture, d’une irréversible brisure : véritable brèche dans la vie avec laquelle il faut désormais compter. « Les vaisseaux sont brûlés, la voie du retour est interdite ! Il faut aller de l’avant, vers un avenir inconnu et toujours terrible5 ». Le tragique ne se recommande que de lui-même ; il est sans
1
Y. Simon, « La dernière passion », in Les Séductions de l’existence, Le Livre de Poche, « Biblio essais », 1990, p. 94-95. 2 Ch. Baudelaire, « L’irréparable », Les Fleurs du mal, in Œuvres complètes, I, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 55. 3 M. Conche, Temps et destin, op. cit., p. 132-133. 4 S. Beckett, Cap au pire, Minuit, 1991, p. 22. 5 L. Chestov, « La philosophie de la tragédie », Pages choisies, Nrf, 1931, Préface.
85
ÉCHOS DU RÉEL
concession. Traversée sûre de sa chute, de son écrabouillement. Il est vain de tenter de se débarrasser de l’angoisse de la mort. Plus loin que cela encore, serait-ce souhaitable ? Ce serait fuir la condition de l’existence et tomber dans cette forme d’inauthenticité dénoncée par Heidegger consistant à se laisser diluer dans le « on », à entretenir cette sorte de laisser-aller propre à une existence divertie d’elle-même, rassurante mais abstraite, anonyme, insipide. Ce serait esquiver notre existence, ignorer notre intrinsèque solitude découverte à la faveur de l’épreuve douloureuse qui nous révèle à nousmêmes dans notre précarité. L’existence est là, dans sa présence vivante qu’autant qu’elle est menacée. Trajet au fil des échos de l’ennui et de l’angoisse qui ouvre à cette compréhension qui peut faire écrire à Maupassant : « Quoi que nous tentions, quoi que nous fassions, quels que soient l’élan de nos cœurs, l’appel de nos lèvres et l’étreinte de nos bras, nous sommes toujours seuls1. » La solitude s’apprend, expression des limites définitives du moi précaire. Solitude qui n’est donc que l’autre nom de notre finitude. L’angoisse nous a ouverts à la finitude radicale et c’est d’elle qu’il faut repartir toujours. Comme le souligne Freud, se réconcilier avec la mort ne signifie pas affrontement lucide, prise de risque ou apaisement, mais tout au contraire stratégie d’évitement, « tendance à exclure la mort des comptes de la vie2 », dont l’enjeu est de trouver un moyen, des lignes de fuite permettant de « conserver encore, en dépit des vicissitudes de la vie, une vie à l’abri de toute atteinte3 ». Il ne s’agit pas de chercher une « réconciliation », en ce sens que la mort conserve son étrangeté4, mais de maintenir cet ancrage dans l’humain à partir de l’empreinte centrale de sa finitude, de laisser sa place à ce noyau négatif de l’existence, à l’irrémédiable. Si la perspective tragique suppose de prendre en charge notre existence avec lucidité, elle enveloppe aussi la totalité du réel auquel celle-ci est attachée. Cela implique plus largement, pour la pensée, une clarification de l’approche philosophique du réel qu’elle estime être en mesure de formuler. Nous avons commencé à avancer un certain nombre de termes importants,
1
G. de Maupassant, « Solitude », Contes et nouvelles, I, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1974, p. 1256. 2 S. Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort », op. cit., p. 28. 3 Ibid., p. 29. Freud prend comme exemple le monde de la fiction, littérature ou théâtre, où nous allons chercher un substitut à ce que la vie, en quête d’une protection contre le danger capable de « risquer la mise suprême », nous fait perdre. Par ces barrières de protection excluant le risque de mort, la vie s’appauvrit indéniablement, est de fait plus insipide, puisqu’elle perd son contenu majeur. Alors c’est dans les œuvres de fiction que nous allons chercher à retrouver un peu du sel de la vie, au gré d’une pluralité de destins et au spectacle d’hommes qui savent mourir ou se tuent entre eux. Ici nous pouvons nous identifier facilement à tel ou tel héros et mourir avec lui sans dommage, puisque nous pouvons néanmoins lui survivre. 4 F. Dastur, Comment affronter la mort ?, op. cit., p. 88.
86
ÉCHOS DU RÉEL
tels qu’insignifiance, perdition ou hasard. Il convient donc d’envisager le réel en prenant acte des enseignements de cette traversée première. De quelle appréhension du réel peut se recommander la pensée tragique ? Un principe de cruauté paraît requis, comme l’énonce Rosset dans son ouvrage du même titre : « Tout ce qui vise à atténuer la cruauté de la vérité, à atténuer les aspérités du réel, a pour conséquence immanquable de discréditer la plus géniale des entreprises comme la plus estimable des causes1 ». Cette cruauté-là ne cherche pas à blesser, à faire souffrir. Elle tente de porter un regard sur le réel proprement dénué d’espoir, autrement dit décidé à ne rien enjoliver. C’est pourquoi peut être dite cruelle toute œuvre qui s’essaie à énoncer ce qui est, sans céder de terrain au voile protecteur du rêve. Dès lors peut-on, en effet, parler de « cruauté », le réel dépouillé, selon le sens propre du terme2, de la peau lisse et truquée des illusions, n’ayant rien d’agréable. L’appréhension du réel qui en découle, privée de l’écran cotonneux du rêve et des illusions, suppose une posture composée d’intranquillité et d’inconfort. Nietzsche s’exprime en ce sens, associant la volonté de connaissance à une forme de « cruauté raffinée » que l’esprit accepte de s’infliger en se contraignant « à connaître contre sa pente naturelle, et bien souvent aussi contre les vœux de son cœur −, en l’obligeant à nier là où il voudrait approuver, aimer, adorer3 ». Appréhender le réel selon le principe de cruauté implique la volonté de ne pas injecter ce que l’on désire y trouver. Ce en quoi Ghelderode peut écrire : « Cruauté veut dire réalité, peinture exacte, sans mensonge4. » Il importe, par conséquent, de rendre les aspérités du réel : il faut se placer du côté de la rugosité, et non pas du poli et du lisse. La pensée tragique ne peut ainsi se reconnaître qu’à partir d’une approche du caractère mouvant, chaotique et instable du réel, se recommandant d’un scepticisme profond à l’encontre de toutes ses versions édulcorées.
1
C. Rosset, Le Principe de cruauté, op. cit., p. 7. L’auteur rappelle ainsi : « Cruor, d’où dérive crudelis (cruel) ainsi que crudus (cru, non digéré, indigeste), désigne la chair écorchée et sanglante : soit la chose elle-même dénuée de ses atours ou accompagnements ordinaires, en l’occurrence la peau, et réduite ainsi à son unique réalité, aussi saignante qu’indigeste. » (Ibid., p. 18). 3 F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, Gallimard, « Idées », 1975, § 229, p. 169. 4 M. de Ghelderode, Les Entretiens d’Ostende, op. cit., p. 169. 2
87
ÉCHOS DU RÉEL
I. Dérive ontologique « Les vérités de la métaphysique sont les vérités des masques. » Oscar Wilde, Aphorismes.
Conche rappelle dans sa confession que « chaque philosophie se fonde sur une décision touchant ce qui est réel – ce qui mérite d’être dit “réel” – et ce qui ne l’est pas1 ». On peut, à partir de là, distinguer avec Rosset deux types de philosophes : les philosophes-médecins pour qui importe avant tout l’épreuve de la réalité quel que soit son caractère désagréable, et les philosophes-guérisseurs2. Les premiers sont impitoyables, mais efficaces, conscients qu’on ne guérit que ceux qui disposent d’un « fond de santé » suffisant pour supporter l’administration de la vérité ; les seconds inefficaces, leur profond désir étant d’appliquer des baumes calmants afin d’anesthésier l’angoisse humaine. Autrement dit, à partir du moment où le réel déçoit ou angoisse, le philosophe-guérisseur, « grand constructeur d’abstractions devant l’éternel », prend en charge de lui donner un sens transcendant. « Son premier soin est ainsi d’essayer d’établir coûte que coûte que le réel n’est pas réel, puisque c’est le réel dont on souffre et qui est en somme la cause de tout le mal3. » Distinction qui recoupe celle établie par Conche entre les philosophies qui « mettent des masques sur l’horrible réalité » et « celles qui ôtent les masques »4. Sous les masques, nous pouvons reconnaître toute philosophie à tendance métaphysique qui, à ce titre, « tient le “réel” quotidien pour une duplication dont seule la vision de l’Original pourrait lui livrer le sens et la clef5 ». Ôtent les masques ceux qui estiment, au contraire, que le réel ne peut être authentiquement abordé que dans son unicité et son innocente cruauté. Afin d’appréhender le divorce irrémédiable des deux approches, il nous paraît important de développer tout d’abord les procédures fondamentales du versant métaphysique de la philosophie. Ceci pour mieux tenter de déceler les failles de ce jeu de masques et caractériser clairement l’appréhension tragique du réel.
1
M. Conche, Confession d’un philosophe (Réponses à André Comte-Sponville), Le Livre de Poche, « Biblio essais », 2004, p. 147. 2 C. Rosset, Le Principe de cruauté, op. cit., p. 31. 3 Ibid., p. 27. 4 M. Conche, Entretien avec S. Charles, in S. Charles, Une fin de siècle philosophique, Liber, 1999, p. 103. 5 C. Rosset, Le Réel. Traité de l’idiotie, Minuit, « Critique », 1977, p. 151.
88
ÉCHOS DU RÉEL
Ici et là-bas « L’essentiel de la réalité est le sens. Ce qui n’a pas de sens n’est pas réel pour nous. Chaque parcelle de la réalité vit dans la mesure où elle participe d’un sens universel. » Bruno Schulz, Les Boutiques de cannelle.
Il importe, sans doute, de repartir du projet initial de la philosophie. Dès l’origine, celle-ci s’est donné pour tâche de procurer une image cohérente du monde et de l’homme. C’est là ce qui constitue la spécificité de la démarche philosophique : sa visée n’est pas de rendre compte de tel ou tel pan de la réalité, mais de l’ensemble de celle-ci. Aussi procède-t-elle à une recomposition synthétique du monde perçu. Mue par cet objectif d’interprétation du réel, elle se constitue par l’opération suivante : elle part du constat de l’existence des lieux et des êtres, de la collection des choses ou des situations et, de là, tente de déterminer − par-delà leur diversité et leurs variations − l’invariance capable de réaliser l’unité de ces multiplicités. Or en quoi consiste, au fond, le plus souvent l’entreprise ? À dépasser l’univers des apparences afin de mettre en évidence des différences invisibles, des solidarités cachées. Ainsi se constitue-t-il aisément un « autre monde » parallèle au premier. Voilà à quoi l’on aboutit. « À l’univers changeant et bariolé des apparences, écrit Daniel Parrochia, se superpose un double idéal : un monde de principes et d’architectures secrètes qui en rend compte, véritable système de “variables cachées”, réputées nécessaires à son “explication”1. » D’où découle inévitablement, pour la pensée laissant libre cours à la dérive métaphysique de la philosophie, un mouvement d’éloignement par rapport au réel immédiat, autrement dit celui de la perception sensible, conduisant à cette « condition étrange », épinglée par Rosset, consistant à « dissoudre l’objet même de leur théorie »2. De ce fait, la réalité dont on entend rendre compte dans son ensemble se voit reléguée au second plan, « dépossédée de sa prétention à être justement la réalité, rien que la réalité, toute la réalité3 ». La découverte de cette possibilité d’énoncer, au-delà des apparences changeantes, l’existence d’une stabilité dans l’être, c’est-à-dire les lois d’un réel complet, siège de la vérité et image d’une harmonieuse totalité, trouve, comme nous le savons, son origine en Grèce. Et avec Platon au premier chef. Il faut se reporter pour cela au texte majeur du récit de la caverne ouvrant le livre VII de la République4, véritable modèle d’un tel schéma de pensée. Le
1
D. Parrochia, Le Réel, Bordas, « Philosophie présente », 1991, p. 11-12. C. Rosset, Le Principe de cruauté, op. cit., p. 11. 3 Ibid. 4 Platon, La République, in Œuvres complètes, Flammarion, 2011 (édition revue), livre VII, 514 a – 518 d, p. 1679-1684. 2
89
ÉCHOS DU RÉEL
présupposé platonicien de l’autre monde se retrouve en effet, au-delà des variations propres à chaque investigation philosophique, dans tous les systèmes métaphysiques d’obédience dualiste. Les hommes sont, rappelonsle, comparés à des prisonniers enchaînés qui ne peuvent tourner le cou et qui n’aperçoivent sur le fond de leur prison que des ombres projetées par des objets défilant derrière eux à la lumière d’un feu éloigné. Leur posture ne leur permet donc d’accéder qu’aux ombres, non aux objets réels dont ils sont les ombres. Ainsi prennent-ils immanquablement les ombres pour la réalité. Étrange mise en scène, destinée à illustrer le propos du philosophe, ainsi que le souligne d’ailleurs Glaucon, l’interlocuteur de Socrate1. Les prisonniers qui prennent les ombres pour la réalité sont semblables à nous, pris au piège du sensible, assimilé d’emblée à l’illusion. Selon Platon, en effet, il faut assimiler « l’espace qui se révèle grâce à la vue à l’habitation dans la prison, et le feu qui s’y trouve à la puissance du soleil2 ». Les objets qui passent sont ceux du monde intelligible, et le soleil qui les éclaire, c’est l’Idée du Bien, source de toute science et de toute existence. Et voici l’Idéal posé au-delà de ce monde. L’ici et l’ailleurs – l’ici-bas et l’au-delà (« l’autre monde ») – l’apparent et le vrai, sont appréhendés dans un rapport de séparation et de hiérarchie, puisque l’idéalité du deuxième fournit son fondement au premier, sa consistance provisoire, son intelligibilité et son sens. Ainsi existe-t-il explicitement chez Platon une théorie des deux mondes. Le premier est le monde sensible, c’est-à-dire celui dans lequel nous vivons, affecté par le changement, la dégradation et la mort. Le second, essence du premier, est le monde intelligible, c’est-à-dire celui des Idées immuables, incorruptibles et éternelles. La théorie platonicienne des Idées suppose, en effet, un empire hypothétique d’essences immatérielles, éternelles et immuables. Les Idées désignent les archétypes de la réalité, selon lesquels sont formés les objets du monde visible. Le seul monde qui est véritablement est celui de la permanence, le monde des Idées. Notre monde sensible est soumis à l’empire des Idées ; il ne tire sa réalité que de sa participation au monde intelligible. Sur le chemin des Idées ou le rejet orchestré de l’apparence : notre monde n’est qu’un reflet fort pâle du monde supérieur où siègent les vérités éternelles (telles que le Beau, le Bien ou Dieu). Entreprise philosophique mue par la claire intention de procéder à la démolition du réel, le sensible et l’immédiat ayant été assimilés à l’illusion. Selon la perspective philosophique de Platon, l’illusion est en effet de prendre la réalité sensible pour la réalité réelle, alors que tout réel sensible n’est que le reflet de la réalité intelligible qui est la seule réalité réelle. Ce qui est véritablement, ce n’est pas la multiplicité des choses sensibles, mais la forme ou l’idée 1
« Tu écris là, dit-il, une image étrange et de bien étranges prisonniers. » (Ibid., 515 a, p. 1679). 2 Ibid., 517 b, p. 1682.
90
ÉCHOS DU RÉEL
permanente, immuable et pure, dont toutes participent et qui permet de les désigner du même nom. S’exprime le clair refus, par conséquent, d’accorder aux choses concrètes toute réalité pour attribuer celle-ci aux seules essences et Idées abstraites. Ce qui importe, ce n’est donc pas la plante qui, en tant qu’elle imite ou copie le réel sous une forme sensible, n’est pas réelle, mais l’idée de la plante, la forme intelligible, invisible, seule réelle. Dès lors, les choses existantes se voient privées de leur entière réalité, tandis que n’est digne de se voir accorder le statut de réalité que ce qui est privé de toute réalité. On le voit : ce qui parle derrière ce schéma, pour le moins paradoxal, est la peur d’une contamination. Rosset estime, à ce titre, que le ciel des Idées illustre, on ne peut mieux, « la faculté d’interrompre tout contact avec le monde sensible. […] d’en finir avec toute espèce de réalité1 ». Tout se passe donc comme si notre monde, imparfait, soumis à la dégradation et à la perte, n’était que le reflet d’un autre, celui-ci parfait et immuable, qui aurait lieu ailleurs. Séjour du soleilréalité, contre séjour de l’ombre-illusion. Ici ne renvoie qu’à un là-bas insaisissable, invitation à déserter le monde présent pour un autre, mirage lumineux. Ce en quoi, selon Platon, l’homme est initialement dans un lieu d’exil, équivalant à un moment d’égarement. Même s’il ne s’agit nullement pour l’homme de s’extraire de la condition humaine – le prisonnier qui a contemplé le soleil revient dans la caverne –, l’essentiel est de porter le regard au-delà. Au lieu de reconnaître la prégnance du sensible et de l’immédiateté, la métaphysique platonicienne entend, par conséquent, les reléguer au second plan, afin si l’on peut dire de les dévorer tout à fait. Comment ne pas émettre quelque soupçon ? Car comment ne pas déceler dans cette élaboration intellectuelle, coiffée des Idées immuables et éternelles, la hantise du temps, du changement et de la dégradation ? Le temps apparaît comme « la reproduction déchiquetée » de l’éternité, archétype suprême « qui englobe tous les autres et les exalte »2. Animé d’un profond esprit critique vis-à-vis d’un tel schéma éternitaire, Borges dans son Histoire de l’éternité qualifie alors celle-ci de « fille de l’homme3 », conçue « secrètement pour essayer de pallier la fuite du temps4 ». L’auteur considère, en effet, que le temps « est pour nous un problème inquiétant, exigeant, le plus vital peut-être de la métaphysique5 » et qu’affirmer, comme le fait Plotin dans les Ennéades, que l’on ne peut définir la nature du temps sans connaître l’éternité conçue comme son archétype et son modèle, est une façon aberrante de régler le problème du temps. Il écrit : « Cet avertissement 1
C. Rosset, Fantasmagories, op. cit., p. 70. J. L. Borges, Histoire de l’éternité, in Histoire universelle de l’infamie – Histoire de l’éternité, Christian Bourgois, 1985, p. 147. 3 Ibid., p. 138. 4 Ibid., p. 162. 5 Ibid., p. 137. Nous soulignons. 2
91
ÉCHOS DU RÉEL
préliminaire – d’autant plus grave qu’on le croit sincère – enlève, je crois, toute possibilité de nous entendre avec l’homme qui l’écrivit1. » Même verdict pour son illustre prédécesseur, Platon, qui, dans le Timée, fait du temps une image mobile de l’éternité : « postulat impuissant à distraire personne de la conviction que l’éternité est au contraire une image dont le temps est le support2 ». D’où le désir de Borges de « faire l’histoire de cette image, de ce vocable absurde enrichi par les disputes des hommes3 ». Le temps est celui de la corruption, de la destruction et de la décadence. Nous sommes plongés dans le temps qui détruit et disloque toutes choses, ce dont Platon semble peu disposé à s’accommoder. Ainsi peut-on constater chez le philosophe une appréhension certaine du changement, comme en témoigne, notamment, un texte des Lois prononcé par L’Étranger d’Athènes : « Il est certain que, à l’exception du changement qui transforme en bien ce qui est mal, on ne trouvera rien de beaucoup plus périlleux que le changement4 ». Il faut à tout prix fixer. Déchirure qui semble au cœur de la philosophie de Platon : sa pensée est travaillée par un désir d’éternité qui s’exprime en particulier dans les mythes, par lesquels il tente d’avoir un moyen de communication avec la permanence de l’intelligible. La dérive ontologique de la philosophie, dont Platon a pleinement formulé les termes, expose son refus de la réalité temporelle dans laquelle l’homme et toute chose s’épuisent. La conception du réel défendue dans cette optique apparaît comme un contournement radical du tragique, dont la fonction est de penser une métaphysique exempte de tout contact avec le réel immédiat impliquant, quant à lui, fragilité, instabilité hasardeuse et sentiment de la mort. L’on ne s’étonnera donc pas que, selon la perspective platonicienne, la méditation de la pensée doive s’affranchir autant que possible du corps. À partir du moment où ce qui est véritablement, ce sont les Idées, les réalités intelligibles, permanentes, immuables et pures, et non pas la multiplicité des choses sensibles, ce qui définit l’homme de manière essentielle, c’est ce qui en lui est incorruptible, son âme. Dès lors, la promotion de la vie de l’esprit suppose la dévalorisation de la vie sensible. Platon ouvre clairement, non seulement la voie à la distinction entre l’âme et le corps, donc entre le côté « spirituel » de notre être et son côté « matériel », si ancrée dans la tradition de pensée occidentale, mais il se réapproprie aussi l’idée d’origine orphique du corps comme prison ou tombeau de l’âme. L’homme est à appréhender comme cet être scindé en deux parts, l’une immortelle, l’âme, qui le rapproche du divin, l’autre mortelle, le corps, qui appartient à l’ordre du devenir, de ce qui naît et périt. D’où la conception du « corps-tombeau », 1
Ibid. Ibid. 3 Ibid. 4 Platon, Les Lois, in Œuvres complètes, op. cit., livre VII, 797 d, p. 846. 2
92
ÉCHOS DU RÉEL
soma-sèma, et la vision selon laquelle la part divine de l’homme est emprisonnée dans sa part terrestre et doit s’en délivrer. La philosophie acquiert, dès lors, cette vocation privilégiée de délier l’âme du commerce avec le corps, de son attachement au sensible. Platon développe nettement cette idée dans le Phédon : le philosopher est une mort métaphorique dans la mesure où il suppose l’effort de séparation d’avec la nature corruptible du corps et la sortie hors du temps vers l’intemporalité des idées. Que dit la philosophie à l’âme des amis du savoir ? « Elle lui montre que la démarche consistant à examiner une chose au moyen de la vue est toute remplie d’illusions et remplie d’illusions aussi celle qui se sert des oreilles ou de n’importe quel autre sens ; elle persuade l’âme de prendre ses distances, dans la mesure où il n’est pas absolument indispensable de recourir aux sens. Elle l’invite à se rassembler et à se ramasser elle-même en elle-même, à ne se fier à rien d’autre qu’à elle-même1 ». L’intellect humain doit se départir de tout mélange avec sa part corporelle pour laisser la place à l’œil de l’âme. Et nous l’avons vu avec le récit de la caverne : l’important est de s’extraire de l’empire des ombres, symbole du monde visible, pour entreprendre l’ascension vers la lumière du soleil, astre symbolique de la région lumineuse et invisible des Idées. Le philosophe est celui qui réalise qu’il est captif de l’illusion sensible et que sa vraie patrie se trouve du côté de l’intelligible. Dans une telle optique, le projet d’appréhender l’ensemble de la réalité est devenu celui de se déprendre de celle-ci, considérée comme essentiellement douteuse et proprement insuffisante, à l’image d’un accusé estimé incapable de défendre lui-même sa propre cause. Du coup, la pensée philosophique a cédé à ce que nous pourrions caractériser comme l’intention du lisse : considérer que tout désordre n’est qu’apparent, s’intéresser au réel dans sa « vérité », non plus dans ses apparences, alliées du mensonge. Il s’agit, autrement dit, de substituer aux apparences mouvantes et changeantes, assimilées pour cela à une pseudo-réalité mensongère, − sorte de « duplication falsifiée2 », de succédané du réel véritable −, la réalité de la structure des choses. Le projet philosophique consiste à mettre de l’ordre dans le divers, à rendre raison du multiple et, au fond, à réduire les ambiguïtés de tous ordres, au profit d’un réel docile, maîtrisé et réenchanté. Ainsi, selon Platon, l’idée est-elle conçue par opposition à la réalité sensible et au monde de la vie, elle est la réalité véritable. Illusions flatteuses et rassurantes de la pensée métaphysique qui témoignent au fond d’une profonde indifférence au réel. Ainsi, cette façon de l’ignorer, cette aptitude à l’escamoter au profit de ce qu’il peut prêter à dire. Ce en quoi la métaphysique traditionnelle procède par l’affirmation d’une réalité originelle
1 2
Platon, Phédon, in Œuvres complètes, op. cit., 83 a, p. 1202. C. Rosset, Le Réel et son double, op. cit., p. 59.
93
ÉCHOS DU RÉEL
ou d’un monde intelligible opposé aux apparences, dont le défaut majeur est d’être hasardeuses et travaillées par la perdition. La métaphysique désigne ainsi la possibilité de dépasser le domaine de l’immédiat sensible et de connaître toutes choses à partir de ce qui est plus réel, plus exactement, à partir de ce qui, seul, est effectivement réel, de ce qui est selon les termes de Platon ontôs on, ou « réellement réel », à savoir le monde des essences ou des formes, des eidè ; ou encore à partir de la « cause première » d’après Aristote. En somme, la philosophie métaphysique, en voulant contourner le réel, n’a fait que le dupliquer pour pouvoir l’accepter. Tout cela émane, nous l’avons vu, d’un parti pris philosophique, à savoir la pensée de l’insuffisance de la réalité immédiate. D’où la dérive, l’esquive ontologique. Suivant le trajet de Rosset, trois « guérisseurs » allemands emblématiques peuvent être également convoqués : Kant, Hegel et Heidegger. Avec Kant, la médecine adopte la posture de la dévotion : il n’y a de guérison possible que si l’on y croit. Il évoque en cela la figure de l’inguérissable : « il a inventé des remèdes sans danger, qui peuvent être administrés sans qu’on ait à craindre que le malade en guérisse. La critique est passée, attentive et scrupuleuse, et a laissé intact l’ensemble des opinions et des croyances. Ou plutôt elle les a raffermies1. » La Critique de la raison pure, en effet, a établi l’irrecevabilité de l’entreprise métaphysique. Par ailleurs, elle a tout maintenu à sa manière. La critique a conclu, eu égard à notre constitution sensorielle, que nous ne pouvons prétendre à une connaissance coupée de notre ancrage sensible. Kant a souligné que les concepts et les catégories de l’entendement ne sont valables que pour rendre compte de ce qui entre dans le champ de notre expérience. Le philosophe a, à sa manière, ramené la finitude dans le champ de la connaissance. Dès que la pensée entend se « décoller » de la sensibilité et spéculer sur le monde dans sa totalité, l’âme ou Dieu, elle ne peut prétendre énoncer quoi que ce soit de certain. La prétention à un savoir absolu est donc nettement barrée du champ d’investigation de notre pensée. Mais, s’il n’y a pour nous de connaissance possible que du monde phénoménal, du moins cette connaissance ne nous entrave aucunement et nous laisse-t-elle libres de penser du monde nouménal ce que les exigences de la raison pratique nous obligeront à en penser. Nous ne pouvons savoir ce que sont en eux-mêmes le monde, l’âme ou Dieu, mais nous pouvons les penser comme nous voulons. Ces idées de la raison n’ont certes pas de réalité objective, puisque aucune intuition ne peut être donnée qui leur corresponde, mais elles ont cependant une certaine réalité, par le fait même qu’elles sont des idées de la raison. C’est pourquoi Kant a pu écrire dans sa Critique de la raison pure : « Je dus donc abolir le
1
C. Rosset, Le Réel, op. cit., p. 62.
94
ÉCHOS DU RÉEL
savoir afin d’obtenir une place pour la croyance1. » Autrement dit, si la morale exige que nous croyions en la liberté de l’homme, en l’immortalité de l’âme et en l’existence de Dieu, cette croyance ne coûtera rien à l’appareil critique. J’y crois et cela suffit. C’est pourquoi l’on peut suivre Rosset qui, à propos de ces deux ouvrages fondamentaux que sont la Critique de la raison pure et la Critique de la raison pratique, parle de « critique non criticante2 ». La critique, certes, est passée, mais elle a tout laissé en place. Kant découvre une voûte étoilée qui l’enchante et le rassure : « le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi3 ». Hegel, quant à lui, incarne davantage la figure de l’illusionniste, en tant qu’artisan d’un ingénieux tour de passe-passe philosophique. Considérant que la religion et la philosophie se doivent d’élever l’homme à la vie infinie, il « décèle en chaque chose la manifestation de la Raison, de l’Idée, de l’Esprit, mais omet de préciser jamais la nature de cette Idée, de cet Esprit, de cette Raison4 ». Annonce du sens sans jamais le montrer. Le sens, selon la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel, ne cesse de prendre corps suivant la courbe du devenir… Moments, ruses de l’histoire et multiples médiations, travail du négatif en vue du positif, expriment sans conteste l’habileté spéculative du philosophe, mais rien sur la nature du sens en question. Le système hégélien, bâti à partir du concept de Savoir Absolu, s’emploie, en effet, à nous annoncer un sens sans jamais en éclairer la nature. Que nous donne-t-il alors, sinon seulement l’illusion d’un sens se réalisant à travers l’Idée, la Raison et l’Esprit ? Sauf, ajoute Rosset, si l’on emboîte le pas de Hegel en estimant que les termes « Idée », « Raison » et « Esprit » sont des notions en quelque sorte autosuffisantes, qui peuvent donc très bien se passer de définition : « c’est peut-être là le privilège du “Savoir Absolu” que de dispenser de tout savoir particulier, de dispenser notamment de préciser la nature de ce qu’on y sait5 ». Ligne de fuite hégélienne. Manque de réel toujours, maquillé par un manque patent de clarté. Les propos de Kierkegaard, qui a lu de près l’œuvre de Hegel, offrent, nous semble-t-il, une conclusion édifiante : « Pour ma part, j’ai dépensé assez de temps pour approfondir le système hégélien, et je ne crois nullement l’avoir compris ; j’ai même la naïveté de croire que, lorsque, malgré toutes mes peines, je n’arrive pas à saisir sa pensée en certains passages, c’est qu’il n’est pas tout à fait au clair avec lui-même6 ».
1
E. Kant, Critique de la raison pure, PUF, « Quadrige », 1990, p. 24. C. Rosset, Le Réel, op. cit., p. 61. 3 E. Kant, Critique de la raison pratique, Gallimard, « Folio essais », 1989, p. 212. 4 C. Rosset, Le Réel, op. cit., p. 54. 5 Ibid., p. 55. 6 S. Kierkegaard, Crainte et Tremblement, Fernand Aubier, « Philosophie de l’esprit », 1946, p. 41-42. 2
95
ÉCHOS DU RÉEL
Mais revenons à Heidegger dont les analyses ont constitué une importante source de méditation. En ce qui concerne le philosophe de la Forêt-Noire, dans la mesure où il distingue l’être de l’étant, il dissocie « la présence de toute réalité effectivement présente, l’isole de la contamination de la part de ce qui existe pour en faire la source mystique et inviolable de tout ce qui vient à l’existence. Il est superflu de relever le caractère romantique et germanique de cette hallucination philosophique1. » La réflexion de Heidegger sur l’étant nommé Dasein, cet étant que nous sommes qui a pour essence d’exister, est une thèse ontologique. La pertinente description heideggerienne de la mort est en effet, ne l’oublions pas, sous-tendue par une théorie de l’être, dont l’homme est le prétendu « berger ». Et si Heidegger s’intéresse au Dasein, c’est précisément parce qu’il incarne l’être questionnant, le « là », comme le dit Ricœur, de la question de l’être. Le Dasein est le seul qui, parmi les « étants », est compréhension, révélation de l’être. Dans cette perspective, non seulement l’existence ne fait pas sortir de la question de l’être, mais, au contraire, exister pour le Dasein ne veut pas dire autre chose qu’être ouvert originairement à l’être. L’analytique existentiale de Heidegger interprète donc l’existence à partir et à travers la question de l’être. Interroger l’essence de l’homme est ainsi considéré comme la voie de la compréhension de l’être. La réflexion sur l’être-au-monde a permis de souligner que l’existence est marquée, de manière indépassable, par la facticité et la finitude. L’homme, ainsi appréhendé dans une lumière tragique, est cet être marqué par la déréliction qui le condamne à inventer son existence sans savoir d’où il vient et où il va, sinon que la finitude accompagne chacun de ses pas. Mais cet accent tragique est atténué dès lors que le Dasein est appréhendé comme le lieu d’interrogation du sens de l’être. Nous sommes, pour ainsi dire, « embarqués » pour la contrée de l’être dotant notre présence en sursis d’une sorte d’épaisseur ontologique, comme si nous pouvions dépasser notre présence effective, ici et maintenant, pour nous ouvrir à une présence plus ample et plus « subtile ». De quoi laisser planer au-dessus de l’existence sensible un halo mystérieux et englobant capable, selon Rosset, de « prêter assistance à l’étroite singularité de ce qui existe2 ». Parler d’être, c’est d’une façon ou d’une autre introduire une dualité, selon laquelle l’existence sensible temporelle et changeante, prise dans le relais de l’être, n’est plus seulement prise au piège de son exposition à être sans autre recours. Elle acquiert un statut qui inspire sans nul doute Heidegger, mais que rien, pourtant, ne nous autorise à prononcer. La présence, pour ce que nous pouvons en énoncer, ne se dissocie pas du présent ; elle ne régit pas le présent mais le constitue. Heidegger se serait-il, sur ce point, laissé prendre
1 2
C. Rosset, Principes de sagesse et de folie, op. cit., p. 37. Ibid., p. 11.
96
ÉCHOS DU RÉEL
au pouvoir de fascination de son propre « génie verbal1 » ? Ce pourquoi Cioran n’hésite pas à dénoncer en Heidegger ce « manipulateur sans pareil » du réel, ayant accordé « une importance vertigineuse » à la gangue des mots. Dérive ontologique qui va à l’encontre de la pensée tragique pour laquelle l’être « ne sera jamais “en question” – pas même en question2 ». C’est dire que loin d’incarner le « berger de l’être », l’homme est bien plutôt « berger du néant, conservateur sans objets à conserver3 ». Rien n’est à garder, rien n’étant tenu. L’être, nous l’avons vu en particulier avec Montaigne, ne semble guère que le complément imaginaire de notre dénuement. L’épreuve de la réalité nous place uniquement dans le domaine de la différence, du mouvant, du devenir et de la pluralité, et ne nous donne donc nulle part l’être. Que déceler dans ces entreprises philosophiques sinon des symptômes patents de rejets de la réalité ou, tout au moins, comme c’est le cas pour Heidegger, une volonté de ne pas s’en remettre totalement à elle, grâce au fantasme de son double ?
La dévaluation du réel « La seule mais grande faiblesse des arguments philosophiques tendant à faire douter de la pleine et entière réalité du réel est que ceux-ci dissimulent la véritable difficulté qu’il y a à prendre en considération le réel et seulement le réel : difficulté qui, si elle réside secondairement dans le caractère incompréhensible de la réalité, réside d’abord et principalement dans son caractère douloureux. » Clément Rosset, Le Principe de cruauté.
Au réel tel qu’il se donne, c’est-à-dire au réel perçu, s’oppose le « réellement réel » ou, en tout cas, un autre réel capable d’apporter soutien et assistance. « Mettre l’immédiateté à l’écart, la rapporter à un autre monde qui en possède la clef, à la fois du point de vue de sa signification et du point de vue de sa réalité, telle est donc l’entreprise métaphysique par excellence4. » Ainsi, la distanciation établie par Platon entre sensible et intelligible, par Kant entre phénomène et noumène, par Hegel entre réalité empirique et réalité rationnelle, par Heidegger entre étant et être, en sontelles des formulations remarquables. Par cette distinction, s’établit immanquablement une dévaluation du réel banal, ordinaire, déclaré soit indigne de retenir l’attention, soit insuffisant à nourrir la pensée en quête d’un abri du sens, au profit, par conséquent, d’un autre réel, réputé à la fois plus vrai, plus consistant et beaucoup plus inspirant. C’est là l’attitude d’un homme présent au monde, les yeux ouverts, mais qui, confronté au caractère 1
Cioran, Entretien avec Sylvie Jaudeau, Entretiens, op. cit., p. 216. C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 107. 3 Ibid. 4 C. Rosset, Le Réel et son double, op. cit., p. 68. 2
97
ÉCHOS DU RÉEL
désagréable de la réalité, détourne aussitôt son regard pour aller voir « ailleurs ». Forme de rejet du réel que nous avons retrouvée au niveau de la sensibilité commune qui, face à la réalité des faits, dès lors que celle-ci se manifeste sous un jour décevant ou douloureux, révèle sa faible capacité de tolérance, disposée, en cela, à refuser d’en tirer les conséquences et à se raconter des histoires. Parce qu’éprouvée dans sa cruauté, autrement dit sa dimension intrinsèquement douloureuse, irréfutablement présente et indifférente à nos requêtes ou aux objections de nos désirs, la réalité demande à être reconnue dans sa vive écorchure et sa crudité. Dès lors qu’elle se heurte à l’intolérance de l’individu concerné, celle-ci se voit en quelque sorte mise à la porte, frappée d’une fin de non-recevoir, pour donner lieu à des versions illusoires et fantasmagoriques : ce n’est pas la « bonne » version des faits puisque j’en souffre, je est un « autre », la vraie vie « doit » être ailleurs. Tentation à laquelle n’échappe pas l’investigation philosophique du réel. Au double de l’événement, caractéristique d’une tentative de fuite du réel, correspond alors un double plus large, celui de la réalité en général, « autre monde » destiné à rendre compte de celui-ci qui, sans cela, resterait à jamais particulier et insignifiant. Ce que précisément n’admet pas le métaphysicien. D’où il semble résulter, à des degrés divers, un certain accord des esprits sur la dévalorisation du réel, sa considération à titre de « moindre-être » au profit de la suprématie, de la monarchie de l’être. Il s’agit, d’une façon ou d’une autre, de nous inciter à entretenir un rapport de suspicion vis-à-vis de la réalité sensible au profit d’entités stables, que l’on affirme leur réalité (Platon) ou que l’on se contente de postuler leur possibilité (Kant), leur avènement (Hegel) ou leur caractère englobant (Heidegger). Nous aboutissons à un « brouillage » du réel, dont l’enjeu est de se désengluer du seul réel immédiat, de le délaisser tout au moins dans sa fragilité et sa mouvance, pour s’intéresser à des formes ou figures réputées « élevées » de celui-ci. Se glisse dans chacune de ces élaborations philosophiques l’ombre d’un Être prometteur, seule garantie d’une pensée solide et glorieuse. Arrogante prétention de la métaphysique, en ce qu’elle hiérarchise et sépare deux mondes et, se parant de valeurs suprêmes, installe le réel dans l’illusion ou l’ampute de son monopole d’existence. Ontologiser l’Être revient, ainsi, à avilir le paraître, à déprécier le réel, puisque ne peut être dit « réel » que ce qui, de quelque façon, double, « copie » autre chose. Si bien que l’on aboutit au paradoxe suivant : une non prise en considération du réel lui-même, c’est-à-dire de ce qui existe, mais de quelque chose de tout à fait autre qui n’a plus rien à voir avec ce réel au sein duquel nous vivons. Toutes ses caractéristiques se voient lissées, solidifiées, absolutisées. Ressort alors nettement l’activité dédoublante de l’esprit, meilleur moyen que l’homme a trouvé pour s’échapper à bon compte du réel sous les dehors, qui plus est, comme le relève ironiquement Rosset, du plus grand sérieux et de la plus grande rigueur. 98
ÉCHOS DU RÉEL
Où réside donc la perversité du double ? C’est que le réel postulé, pour réussir pleinement son avènement, suppose une certaine mise à l’écart de l’autre réel qu’il prétend coiffer de sa suprématie, comparable à « l’élimination d’une autre candidature à l’accession à la réalité1 ». Effort de « court-circuitage » d’autant plus appuyé et virulent que le concurrent est plus crédible. La duplication du réel entend ainsi usurper les droits de la réalité première, c’est-à-dire celle dans laquelle nous sommes immergés, à s’imposer comme la seule. Le réel, auquel on a retiré son monopole d’existence, n’est dès lors que « l’apparence visible de la réalité invisible : une présence divine explique le présent terrestre, tout comme la présence de l’être, selon Heidegger, délivre la nature présente de ce qui est actuellement étant2 ». Il ne peut plus prétendre être lui-même et rien d’autre. L’existence de la réalité n’est évidemment pas contestée en tant que telle, mais c’est le fait qu’elle « puisse être tenue pour parfaitement existante3 » qui l’est. Aussi le double entretient-il une inévitable suspicion quant à sa prétention à exister. De quoi entraîner perte de crédibilité, mise en doute, mise à distance du réel le plus irréfutable. « N’en croyez pas vos yeux » ne cesse de suggérer le thème du double : le réel que vous traversez, auquel vous participez, parce qu’il est exposé à une duplication, n’est qu’un spectacle, « sans garantie aucune de la part du réel censé s’y produire4 », indice par conséquent de son moindre être, de son peu de réalité. Celui qui prétend « voir », doit proprement voir « double », pour mieux détourner son regard « du spectacle de ce qui est au profit de la suggestion de ce qui n’est pas, déterminant ainsi une sorte d’anesthésie générale à l’égard du réel ambiant5 ». Reste à savoir si une telle prétention de l’esprit humain d’échapper aux prises du réel immédiat n’est pas assimilable à un vœu chimérique. Dans sa propre activité d’esprit, l’homme estime faire l’expérience d’une transcendance, du dépassement de soi par un absolu capable de donner sens à l’être-au-monde. « Le “roseau pensant” trouve dans l’exercice même de sa pensée une suffisance qui le persuade que la mort n’est rien, qu’elle broie sans doute, mais qu’elle est sans prise sur cette pensée qui s’édifie par ellemême, sans aucun recours hors de soi et qui ne saurait être entamée par ce qui n’est pas elle6. » Mais le roseau pensant, ainsi nommé par Pascal7, ne présume-t-il pas de ses forces ? De la puissance qu’elle découvre à travers l’exercice de la pensée, l’intelligence humaine peut-elle sans conteste s’élever à la pensée de ce qui ne passe pas ? Et discerner à travers Idées, âme
1
C. Rosset, L’Objet singulier, Minuit, « Critique », 1985 (édition augmentée), p. 12. Ibid. 3 Ibid., p. 14. 4 Ibid. 5 Ibid. Nous soulignons. 6 R. Mehl, Le Vieillissement et la mort, PUF, « Initiation philosophique », 1962, p. 13. 7 B. Pascal, Pensées, op. cit., 347, 348. 2
99
ÉCHOS DU RÉEL
du monde, Esprit, Être, des entités permanentes et inentamables persistant à travers le devenir et l’éphémère, frayant ainsi, du même coup, sa potentielle part éternelle ? Le désir d’éternité qui trouve ici sa source peut-il se croire en mesure de dépasser le tissu temporel de notre vie et d’ignorer l’impact de la voix du corps ? L’esprit, par sa capacité d’élévation au-dessus du donné, peut-il se confier à une vision d’un surréel, capable de se détourner de la matière épaisse du monde, de la vie dans ses turbulences et sa fragilité, grâce à des entités prometteuses et abstraites ou des systèmes totalisants et éternitaires ? La philosophie nietzschéenne a constitué, à cet égard, une attaque marquante contre cette arrogance du pur esprit qui prépare le terrain de son éternisation. Ce pourquoi Nietzsche s’est efforcé de briser cette hiérarchie établie entre l’âme et le corps et de traduire l’entrelacs complexe des deux termes. Le corps nous amène au cœur de nos découvertes, il n’est pas cette simple enveloppe dont l’esprit est revêtu et qu’il peut évacuer à l’envi. On peut retenir, parmi nombre de fusées corporelles, des déclarations telles que « tous les préjugés viennent des tripes1 » ou bien encore, pour exprimer la disposition « stomacale » de l’esprit, « l’esprit est bien un estomac2 ». Le philosophe allemand ramène promptement le corps à la table de l’esprit. Il s’agit, par là, de briser la confiance de celui-ci dans ses seules forces, en renouant le dialogue entre notre part spirituelle et corporelle : l’esprit qui se croit seul aux commandes de la conscience s’illusionne ; le corps a trop à dire à l’esprit pour pouvoir être mis de côté. Car le corps n’est pas le simple réceptacle de fonctions physiologiques ou un pur instrument de l’esprit ; il est au contraire le maître du jeu, le sujet véritable de la pensée. Parce que tout passe par le corps, pensées et sentiments émanent de lui, loin de la pure volonté d’un « je » s’appréhendant comme un pilote désincarné et transparent à lui-même. C’est pourquoi, à l’encontre de la tradition idéaliste, Nietzsche ira loin, en affirmant que face à la grande raison du corps, que le philosophe nomme le « soi » pour rompre avec le « je » égocentrique, confiant dans ses escapades spirituelles, l’esprit n'est peut-être que l’une de ses activités. « Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère, se tient un puissant maître, un inconnu montreur de route – qui se nomme soi. En ton corps il habite, il est ton corps. Il est plus de raison en ton corps qu’en ta meilleure sagesse3. » La grande raison du corps souffle au je et à ses « fiers élans » la trame de ses inspirations. L’on sait que Nietzsche, en particulier, a tiré de la maladie, des tortures que celle-ci a infligées toute sa vie à son corps et des répits qu’elle lui a accordés, cet enseignement essentiel. L’homme lucide doit 1
F. Nietzsche, Ecce homo, op. cit., « Pourquoi je suis si avisé », § 1, p. 74. F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. M. de Gandillac, Gallimard, « Folio essais », 1985, « D’anciennes et de nouvelles tables », p. 256. 3 Ibid., « Des contempteurs du corps », p. 46. 2
100
ÉCHOS DU RÉEL
savoir reconnaître qu’il y a toujours d’abord le corps. Il marque non seulement l’empreinte de nos pas sur terre, mais il se trouve aussi, comme nous l’avons vu précédemment, à la source de nos lumières spirituelles : ennui, angoisse, malaise, nausée – tonalités affectives, états d’abattement et de tourment –, mais aussi rire et joie, sur lesquels nous aurons à revenir, passent par le corps. Pour que la pensée parvienne à se ressaisir de ces états afin de réfléchir sur sa condition, cela ne se peut avec un simple corpsinstrument ou corps-machine, selon le vœu cartésien, mais avec un corps proprement expressif, à l’avant-poste, véritable « souffleur » présent derrière nos pensées et nos sentiments. Peut ainsi s’exprimer un clair soupçon vis-à-vis de cette échappée de son ancrage terrestre que l’esprit s’autorise. C’est dire que la prise en compte ou non du corps est symptomatique des régions dans lesquelles une philosophie entend s’aventurer et se risquer. Régions lointaines, proprement désincarnées, à l’abri du temps et de la mort, ou régions soucieuses de l’immédiat, creusant leur sillon au plus près des parages de notre finitude. L’entrelacs est complexe et subtil et demande à ne pas être ignoré ou encore lâché en route, au nom d’une éclaircie improbable. Ainsi de l’Être de Heidegger qui, après avoir exploré l’écho de nos dispositions affectives, s’est estimé en mesure de désolidariser la présence de notre seul présent effectif, ici et maintenant. Aussi l’esprit qui prétend oublier son épaisseur charnelle ne fait-il que traduire ce qui le gêne, l’embarrasse, lui rappelle ses plis, ses veines, son embarquement dans l’irréversible. Nous n’existons et ne formulons nos réflexions que depuis cette épaisseur. Toute pensée se tient dans ce nœud de notre être incarné et non dans un « esprit », expression d’une âme qui s’espère immortelle. « Infinis esprits se trouvent ruinés par leur propre force et souplesse1 », rappelle déjà Montaigne, soucieux d’exprimer les dérapages de l’esprit dès lors qu’il compte sur ses seules forces. C’est dire que la puissance de l’esprit en signe aussi la faiblesse : l’esprit, par sa capacité même d’émancipation du donné, est prompt à s’égarer. Le corps doit, par conséquent, être réhabilité dans son devenir. Ancré dans le réel, traversé par les courants multiples du temps, affliction ou réjouissance, loin d’induire l’esprit en erreur, il est notre guide le plus sûr et sa prise en compte un critérium du souci de ne pas céder à la tentation d’esquiver notre précarité. C’est ce qui permet à Nietzsche de distinguer deux types de volonté : affirmative ou réactive. Affirmative, la volonté qui, pour affirmer la vie, n’entend pas écarter ses sources affectives et corporelles, et ignorer ce qui ne lui convient pas, la douleur et la mort. Réactive, celle qui, par son mépris du corps et sa survalorisation de l’esprit, témoigne contre la vie en récusant sa dimension éphémère. Cette tradition nourrit le terrain propre à la décadence :
1
M. de Montaigne, Essais, op. cit., II, chap. XII, p. 207.
101
ÉCHOS DU RÉEL
le corps ignoré ou calomnié, les instincts dévalorisés sont rejetés du côté de la pure apparence, au nom du refus de la finitude et de la douleur inscrites dans la chair. Le mépris du corps ne fait que traduire la volonté de se détourner de la vie. Du coup, la pensée se voit appelée à résider dans l'arrière-monde. Nietzsche s’efforce par là de mettre en évidence que l’Idéal du monde intelligible est le fruit d’une projection d’ordre psychologique : l’homme ignore sa véritable nature en élaborant, par-delà le monde sensible, la fiction d’un autre monde pourvu des qualités conformes à son désir, telles que substantialité, transcendance, éternité. Ainsi devient-il, selon les mots du philosophe, un « halluciné de l’arrière-monde ». « L’homme projette, en quelque sorte, en dehors de lui, son instinct de vérité, son “but”, pour en faire le monde de l’être, le monde métaphysique, la “chose en soi”, le monde existant déjà1. » Le discours métaphysique se donne ainsi comme celui de l’absolu et de l’intemporel. Son texte est tissé de métaphores usées, oubliées comme telles, qu’il transforme en concepts et en catégories. Si bien qu’il implique, dans sa composition même, la croyance à l’« autre monde », constitué d’essences stables et éternelles. L’entreprise métaphysique est alors bien le résultat d’un dédoublement, le « monde » dupliqué, subsumé sous des catégories préservées de la trouée du temps. Nietzsche résume justement ce procédé par le terme allemand noch einmal : « encore une fois ». Il s’agit donc de comprendre que l’autre monde, le prétendu « monde-vérité », s’est édifié et a forgé ses « instruments » de connaissance dans le langage du monde sensible : « Au lieu d’utiliser les formes comme des instruments pour rendre le monde maniable et déterminable à son usage, la folie des philosophes voulut découvrir que, derrière ces catégories, se cachait la conception de ce monde, auquel ne correspond pas l’autre monde, celui où nous vivons2… » Dès lors, pouvonsnous retrouver la pertinence de la critique nietzschéenne décidée à réfuter toute thèse ontologique ou métaphysique et estimant, à partir de là, que « les signes distinctifs que l’on a donnés de la véritable “essence des choses” sont les signes caractéristiques du non-être, du néant ; de cette contradiction, on a édifié le “monde-vérité” en vrai monde3 ». « Encore une fois ». Si le monde dit « vrai » est celui du platonisme et de la métaphysique, alors le tragique est méconnu ou évacué. Ce qui fait dire à Nietzsche que « les philosophes sont prévenus contre l’apparence, le changement, la douleur, la mort, le corporel, les sens, le destin et le déterminisme, l’absurde4 », leur visée restant l’union à l’Être, seule garantie 1
F. Nietzsche, La Volonté de puissance, trad. H. Albert, Le Livre de Poche, « Classiques de la philosophie », 1991, § 280, p. 310. 2 Ibid., § 288, p. 322. 3 F. Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, GF – Flammarion, 1985, p. 94. 4 F. Nietzsche, La Volonté de puissance, trad. G. Bianquis, I, Gallimard, « Tel », 1995, § 48, p. 18.
102
ÉCHOS DU RÉEL
possible d’allégresse. Cioran considère en ce sens que « l’expérience métaphysique, désertant la chronologie et les modalités de notre être, vit dans l’intimité de l’absolu1 ». La volonté proclamée de connaître traduit la volonté de créer un monde intelligible capable de nier le changement, la douleur, la contradiction, l’ambiguïté et, donc, la source même de tout cela : le devenir. C’est dire que la raison se trouve plaquée sur le devenir selon une volonté d’appropriation. En cherchant par exemple des solidarités cachées, en utilisant le principe d’identité, celle-ci entend ruiner toute dimension chaotique et hasardeuse des choses existantes. Or rien ne correspond à l’identité, nous ne trouvons dans le réel que de multiples exemplaires. La substance, l’Être, ne sont que des conventions arbitraires, en aucun cas « la réalité » des choses instables et éphémères. L’origine de la raison et de sa quête métaphysique est à situer dans le refus de la réalité, du devenir et de la souffrance. Le problème semble bien, en dernière instance, ainsi que l’exprime Rosset, celui de la digestion du réel : « Ce qui caractérise la pensée tragique est sa capacité digestive (comme la pensée du hasard se définit par sa surface d’accueil) ; est non tragique toute pensée présentant des symptômes de rejet, d’intolérance, au sens physiologique du terme, et qui en déduit la nécessité, donc la possibilité, d’un “mieux” par rapport à “ce qui existe”2. » C’est précisément pour lutter contre cette indigestion patente du réel que Nietzsche s’est donné comme objectif de surmonter les philosophes, en annulant le monde de l’être, estimant que, sous l’impulsion notamment du platonisme et de sa doctrine de l’« être », la philosophie occidentale s’est égarée dans les impasses d’une ontologie métaphysique. En d’autres termes, la philosophie est devenue un discours rationnel sur l’être dont elle prétend définir les prédicats transcendantaux. La visée de cette démarche se dégage : l’« être » ainsi révélé dans ses attributs permet de déterminer l’essence d’un fondement suprasensible doté du privilège, de l’infini privilège, devrionsnous dire, de déprécier le devenir sensible, assimilable à une simple illusion indigne d’intérêt. Il s’agit pour Nietzsche et pour tous ceux qui refusent l’esquive ontologique de récuser l’entreprise métaphysique, c’est-à-dire tout simplement de garder les pieds sur terre. Le réel ne se laisse épuiser par aucune interprétation, car l’être du phénomène n’est pas un fond substantiel, mais l’absence même de fond, l’abîme. Par conséquent, la critique de la distinction entre « monde intelligible » et « monde sensible » s’impose, dans la mesure où elle n’est qu’une terrible erreur d’appréciation de l’apparence : « Qu’est-ce que pour moi l’“apparence” ! Non pas en vérité le contraire d’un être quelconque – et que puis-je dire d’un être quelconque, qui ne revienne à énoncer les attributs de
1 2
Cioran, La Tentation d’exister, in op. cit., p. 906. C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 163.
103
ÉCHOS DU RÉEL
son apparence ! Ce n’est certainement pas un masque inerte que l’on pourrait appliquer et sans doute aussi retirer à quelque X inconnu ! L’apparence pour moi, c’est la réalité agissante et vivante elle-même, qui, dans sa façon d’être ironique à l’égard d’elle-même, va jusqu’à me faire sentir qu’il n’y a là qu’apparence, feu follet et danses des elfes, et rien de plus1 ». Nietzsche vise ici plus précisément le dualisme métaphysique de Kant et le traitement qu’il fait des concepts de phénomène et de réalité. Sous couvert de « sauver les phénomènes », le réel est réduit à une vaine « apparence » destinée à faire ressortir l’éclat d’une réalité pensée sur le modèle d’un absolu interdisant tout rapport. Trouble nature de la fameuse « chose en soi » kantienne. Trouble entreprise que celle de l’esprit humain s’estimant en mesure de poser les termes d’un réel docile et prometteur hors des séquences du temps et, pour tout dire, du réel existant. Fort de ce constat, Parrochia, considérant notamment la démarche platonicienne ou la philosophie hégélienne, peut alors associer les termes « idéalisme » et « déréalisation »2, citant pour cela les termes lumineux de Bonnefoy : « Toutes choses d’ici, pays de l’osier, de la robe, de la pierre, c’est-à-dire : pays de l’eau sur les osiers et les pierres, pays des robes tachées. Ce rire couvert de sang, je vous le dis, trafiquants d’éternel, visages symétriques, absence du regard, pèse plus lourd dans la tête de l’homme que les parfaites Idées, qui ne savent que déteindre sur sa bouche3. » Nous pouvons rejoindre l’horizon philosophique de la recherche de l’écrivain, exprimée dans Anti-Platon, qui s’arrime précisément à « l’objet » terrestre et refuse les « parfaites Idées » en préférant au surréel, aux images-mondes et aux tentations occultistes et conceptuelles des « trafiquants d’éternels », la réalité finie d’un présent immanent intensément vécu. Il s’agit, dès lors, de considérer qu’en sortant de la caverne ou autres antichambres de l’ascension vers l’Être, la pensée, loin d’accéder à la réalité essentielle, entre bien plutôt, selon une expression de David Hume, dans « le pays des fées4 », univers de fantaisie et de divagation. On peut ainsi s’autoriser à parler de puissantes fantasmagories s’agissant des propositions de la métaphysique d’inspiration dualiste : puissantes parce qu’elles prétendent fonder l’être, mais fantasmagories car elles n’édifient que des mythes, aboutissent en tout cas à des mises en scène trahissant leur désir de déconnexion du réel. Le diagnostic établi par Rosset dans Le Réel et son double se fonde sur ce soupçon, à savoir que la structure fondamentale du discours métaphysique depuis Platon, procédant à une telle duplication du réel, relève de l’incapacité à reconnaître et accepter le réel dans toute sa dimension 1
F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., § 54, p. 91. D. Parrochia, Le Réel, op. cit., chap. 1, p. 11-35. 3 Y. Bonnefoy, « Anti-Platon », Poèmes, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 1982, p. 33. 4 D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, GF – Flammarion, 1983, p. 139. 2
104
ÉCHOS DU RÉEL
tragique. L’illusion métaphysique ou le monde et son double. Aussi aboutissons-nous à l’établissement d’une double série. Le réel est mouvant, fuyant, insatisfaisant, décevant, intolérablement soumis à l’emprise du temps..., eh bien doublons-le ! De quoi lui ajouter tous les caractères qui lui manquent : stabilité, incorruptibilité, etc. Les métaphysiciens, à l’instar de drogués, sont proprement « en manque ». Il leur faut une dose supplémentaire pour s’accommoder du réel et maintenir ainsi ce que l’auteur nomme « l’espoir d’un sursis qui retarderait indéfiniment l’application des peines prononcées, l’ombre de l’autre entretenant à jamais l’ombre d’un doute1 ». Autrement dit, et c’est là que le soupçon acquiert tout son poids, l’on peut estimer que le souci proclamé d’intelligibilité du réel, dont la métaphysique se réclame pour justifier son recours à l’autre, ne découle pas d’un simple intérêt intellectuel, mais du secret espoir que, si le réel ne nous livre pas tout quant à lui-même, il reste une certaine marge de manœuvre : « rien ne pourra y être tenu pour certain ni définitif, même s’il s’agit des certitudes les moins plaisantes et les plus cruelles2 ». À l’aune des précédentes analyses, il ressort que l’esprit qui prétend nouer des noces avec la permanence, loin de faire montre de sa vaillance, révèle bien plutôt sa difficulté à s’accommoder du réel dans sa présence tout autant instable qu’implacable et insignifiante. Essences et autres entités gèlent le réel, nous empêchant de saisir le devenir des choses dans leurs contrastes et leurs séquences hasardeuses. Pas d’ordre du monde, pas de cosmos, d’Idées, d’Essences, d’Être, d’ordre métaphysique ou encore de plan de la Nature. La seule « vérité » que l’on puisse énoncer est la vie dans sa crudité et son unicité. Les philosophes, à l’image de Platon, Kant, Hegel ou encore Heidegger, peuvent ainsi apparaître comme ces habiles « manipulateurs » du réel, pour reprendre le terme utilisé par Cioran à propos de Heidegger. Toute approche d’obédience métaphysique est par conséquent bannie. En conclusion, loin d’une logique interne déterminée et explicable telle que la voudrait par exemple un Hegel, le réel peut-il être dit autre chose qu’un fait tout autant solitaire qu’unique et inconnaissable ? Dès lors, comment appréhender le réel ? Ne peut-on s’autoriser à une remise en question de cette quête obstinée de la philosophie à vouloir percer le sens et la raison du devenir, prête pour cela à édifier des systèmes ou à supposer des abris de l’être ?
1 2
C. Rosset, L’Objet singulier, op. cit., p. 97. Ibid.
105
ÉCHOS DU RÉEL
II. Redescendre le chemin des idées « Restent cependant les apparences : pourquoi ne pas les hausser au niveau d’un style ? C’est là définir toute époque intelligente. » Cioran, Précis de décomposition.
Le réel, n’est-ce pas d’abord ce que je subis, ce qui me résiste ? Comme nous avons tenté de le mettre en évidence, le propre de la réalité est de s’imposer hors des raisons que l’on peut énoncer. C’est en quoi elle déborde tout autant nos anticipations personnelles que les descriptions intellectuelles que l’on peut en proposer. C’est ce que nous confirme Ferdinand Alquié lorsqu’il écrit : « La réalité est ce qui revient sans cesse, c’est l’obstacle qui est toujours là, la gêne qu’il ne suffit pas d’oublier pour la détruire1. » La mise à distance de la réalité, pour être rassurante, n’en est pas moins toujours provisoire. L’enjeu est alors de s’efforcer d’avoir une relation juste avec les choses. Qu’entendre par relation juste ? Non pas prétendre détenir la « vérité » du réel, mais tenter de garder autant que possible la connexion avec celui-ci tel qu’il nous est donné, d’élaborer sa vision du monde sans recours au surnaturel, au transcendant, etc. Nous ne parlons plus du même monde : non d’un monde indice d’un autre, mais d’un monde rendu à son unicité, sans remède, ni secours. À la thèse de la métaphysique traditionnelle dont le propos est soutenu par la croyance en un univers du sens, l’idée qu’« au commencement était le Verbe », le Logos, ou autre terme substantiel, et que l’univers est, au fond, un vaste ensemble à décrypter, l’on peut dès lors opposer une tout autre appréhension du réel nourrie, bien plutôt, selon l’expression pascalienne, du silence de l’univers.
1
F. Alquié, « Réalité », in Encyclopaedia Universalis.
106
ÉCHOS DU RÉEL
Seulement idiot « Pourquoi prenons-nous titre d’être, de cet instant qui n’est qu’une éloise dans le cours infini d’une nuit éternelle, et une interruption si brève de notre perpétuelle et naturelle condition ? » Michel de Montaigne, Essais.
Au réel conçu comme « un grand livre de signes à déchiffrer1 », il s’agit, dès lors, d’opposer la thèse selon laquelle le réel est dépourvu de sens et d’intention. Si bien que le code de la Nature – au lieu d’être considéré comme un « foisonnement de possibilités interprétatives2 » – est ramené à sa dimension hasardeuse et insignifiante. Il est indécodable dans la mesure où il n’y a précisément rien à comprendre, aucune intention de faire signe. Il y a bien un mystère de l’être, mais cela ne signifie pas, pour autant, qu’il y a un secret que nous sommes en mesure de percer. C’est précisément le propos de ceux qui ne veulent en aucun cas occulter la dimension tragique de l’existence et du monde. Ce en quoi Rosset affirme sans ambages l’insignifiance totale du réel, sa profonde « idiotie ». Il peut paraître guère plaisant d’être traité d’idiot si l’on en reste au sens trivial du terme oscillant entre « abruti », « stupide » ou « ignorant » dans le meilleur des cas. Mais si l’on fait l’effort, comme nous y invite le philosophe, de le ramener à son sens premier, l’étymologie renvoie au terme grec idiôtès, le « particulier », le « singulier », une chose ou une personne simple, unique3. « Le sens n’échappe jamais à la monotonie d’être quelconque, nécessairement non nécessaire. Les messages en provenance du réel sont donc toujours finalement indifférents parce que d’une même teneur, monotone et insignifiante4 ». L’idiotie du réel désigne donc sa fondamentale singularité. Silence implacable du réel qui ne signifie pas que celui-ci soit déclaré sans intérêt ou absurde. Cela ne revient pas, non plus, à affirmer que la question ontologique est évacuée ou ne se pose pas. Le fait qu’il y ait « quelque chose » plutôt que rien est et demeure mystérieux, mais « il est de toute façon vain d’essayer d’en penser quoi que ce soit5 ». Le réel est définitivement énigmatique. Il ne s’agit donc pas dans ce parti pris d’affirmer péremptoirement qu’il n’y a de toute façon rien au-delà de l’apparence et en dehors des ombres de la caverne. Puisque, évidemment, personne ne peut savoir avec certitude qu’alors nous entrons, selon les termes de Hume, dans « le pays des fées ». 1
D. Parrochia, Le Réel, op. cit., p. 161. Ibid. 3 C. Rosset, Le Réel, op. cit., p. 42. 4 Ibid., p. 29. 5 Ibid., p. 40. 2
107
ÉCHOS DU RÉEL
C’est pourquoi nous employons à dessein le terme « parti pris ». La pensée dans son inquiétude et dans la démarche qu’elle entreprend ne s’engage qu’à partir d’une décision, ne fût-elle, selon le message nietzschéen, que l’expression de notre idiosyncrasie. La décision que nous tentons de retracer consiste à appréhender le réel tel qu’il se donne à nous, sans le « recourssecours », si l’on ose dire, à une quelconque instance extérieure, propre à tout penchant « métaphysique », depuis l’Idée platonicienne jusqu’à l’être de Heidegger. Appréhender le réel ne revient pas, par conséquent, à chercher à le dupliquer, à le redoubler, mais à reconnaître son caractère mouvant, corruptible, tragique. Ce qui suppose une acceptation du monde tel qu’il est, sans surcharge de superstition. Le monde est le monde sans qu’il y ait besoin pour cela d’un autre du monde comme nécessaire complément de son interprétation. Un tel programme philosophique, auquel invite toute métaphysique, refuse, nous l’avons vu, un monde sans garantie d’un autre apportant assise, consistance et justification. Duplication du réel qui estime ainsi trouver l’original, le modèle, l’être, considérant que le monde et l’existence ne peuvent recevoir leur être que de leur double. Admettre la simplicité du monde revient, tout au contraire, « à considérer l’existence comme unique, privée de toute possibilité d’en appeler à une instance extérieure à elle-même1 ». Pas d’attente de copie conforme, pas de dénégation du réel qui n’est que ce qu’il est, c’est-à-dire sans double. Accueillir et apprécier le réel sans « mise à plus tard » suppose donc d’admettre tout ce qui est sans condition, « une adoption de l’unique »2. La métaphysique d’inspiration dualiste procède à l’établissement de niveaux d’être. Ainsi l’illusion se caractérise-t-elle, selon Rosset, par une « duplication hallucinatoire » de l’unique. Car est proprement réel ce qui répond au principe d’identité énonçant que A est A. Rien d’autre. Pas de restriction. Le réel n’est rien d’autre que cela même, qu’il est réel. Il n’y a de discours sur le réel que tautologique : le réel est le réel. Pourquoi insister sur le caractère tautologique du réel ? Afin précisément de mettre en évidence son caractère unique, singulier, non duplicable. « Démon de la tautologie » qui n’implique pas, pour autant, qu’une philosophie à tendance tautologique se réduise à cette énonciation. On peut décrire, mais avec la conscience qu’on n’épuisera jamais le réel. Dire que « le réel loge à l’enseigne de la tautologie » ne signifie pas ignorer toute sa complexité et sa mouvance, mais se refuser à un discours d’inspiration dualiste. À partir de là, les possibilités de réflexion et d’argumentation existent dans un foisonnement multiple. La richesse de la tautologie réside donc, avant tout, dans l’enseignement qu’elle dispense sur « la nature du réel, en livrant son identité et en dévoilant son unicité. Le monde est le monde et il n’existe rien d’autre que le monde3. » 1
C. Rosset, L’Objet singulier, op. cit., p. 95-96. Ibid., p. 110. 3 C. Rosset, Le Démon de la tautologie, Minuit, « Paradoxe », 1997, p. 50. 2
108
ÉCHOS DU RÉEL
Aucun double de celui-ci n’est décelable. Ce sont ces évidences qui sont à penser dans toute leur difficulté et leurs aspects à bien des égards déplaisants. De quoi mettre en garde contre les perpétuels essais d’esquive, au regard de la dimension profondément indésirable ou indigeste de ce A (qui n’est autre que A) – la mort de soi ou des autres en étant l’évocation même. L’enjeu est de s’essayer à penser l’évidence sans la contourner, avec la difficulté que cette entreprise suppose, car, comme le rappelle Rosset, « rien n’est si “rapide” […] que le réel ; lequel advient si vite qu’il réclame pour être perçu, comme une partition musicale compliquée, un déchiffrage virtuose. Et rien n’est non plus si proche : il est la proximité même1. » Et l’auteur de reprendre ces mots de Heidegger qui, tenté par le prestige de l’Être, a manifestement décidé d’en ignorer la pertinence : « notre relation à ce qui nous est proche est depuis toujours émoussée et sans vigueur. Car le chemin des choses proches, pour nous autres hommes, est de tout temps le plus long, et pour cette raison le plus difficile2. » Qu’est-ce que ce chemin des choses proches ? La difficulté d’appréhension de l’à-peine saisissable où toute vision ne peut être qu’une entrevision, où le temps manque pour disposer d’un attirail conceptuel confiant dans ses prises du réel. On ne parlera pas d’Être qui s’étale pour le qualifier, mais bien plutôt de « presque-rien », selon les mots de Jankélévitch, soucieux de trouver leur pierre de taille dans l’étoffe même de la fugacité : de quoi apparaître comme quantité infiniment évanouissante, un presque-rien donc, autrement dit tendant irrésistiblement vers le rien du tout. Dérisoire. Ténuité. L’image des grains de sable s’infiltrant entre les doigts reste peut-être la plus parlante. On croit le tenir, il s’évanouit, se dissipe déjà, nous laissant totalement démunis. Sans plus rien à étreindre, comme une histoire d’amour qui tourne court. La dimension insaisissable du réel demande ainsi à être rappelée, couplée à son caractère infiniment présent, prégnant, prenant par son extrême crudité, son tranchant mortel. Le réel dans sa mobilité, sa rapidité, sa fugacité et sa prégnance, déjouant tous les plans d’analyse, ne se laisse décidément pas « attraper » ou modéliser par la magie d’un langage logico-ontologique, aussi subtil soit-il. Revenir à un tel face à face avec le réel est l’enjeu même de l’orientation tragique de la pensée. Dès lors, aux plans ontologiques nourris d’une insuffisance du réel, il s’agit d’opposer un « principe de réalité suffisante3 ». C’est-à-dire, ne pas chercher à évacuer le caractère indéniablement douloureux et tragique du réel, ne pas vouloir injecter du grandiose ou du sens là où il n’y en a pas, mais l’appréhender dans son immédiateté, comme un plein qui se suffit à lui-même. Ce que nous 1
Ibid., p. 51. M. Heidegger, Le Principe de raison, Gallimard, « Tel », 1983, p. 47. 3 C. Rosset, Le Principe de cruauté, op. cit., p. 9. 2
109
ÉCHOS DU RÉEL
désignons précisément par la démarche tragique : récuser les entités philosophiques (Idée, Être, Esprit…) qui, en enjolivant le réel, le font perdre de vue. Quelle est la tâche de la pensée qui se veut lucide ? Surtout ne pas chercher à gommer, polir ou effacer, mais tenter de capter le dérisoire, de rendre les équivoques, les aspérités du réel, son aspect cruel et tragique, loin de toute velléité de duplication. Sinon l’on perd l’objet même de la pensée. Sinon l’on rend du même coup la matière invisible, on la fait s’évanouir sous le jeu de la vie. Il s’agit à l’inverse d’en reconnaître, et peut-être d’en aimer, à la fois les grincements et la mortelle résistance. Contre les systèmes clos et lisses, il s’agit alors de procéder à une réhabilitation de l’apparence, de la présence crue, portant en elle son absence destinale. Le réel se donne avec ses creux, ses dénivellations, ses gouffres, ses ténèbres. Sans ces gammes de la partition l’air sonne faux. Qui se trompe dans cette optique ? Celui qui a opté pour le lisse, l’appoint ou la trahison du double. Nous retrouvons là le propos du matérialisme et du scepticisme : aucun double du réel n’est repérable. Le réel est ce qu’il est, n’est que ce qu’il est. En dehors de lui, il n’y a pas de monde intelligible, d’arrièremonde solaire et consolant. Cet effort d’acceptation du monde tel qu’il est, sans injection de superstition, réunit, au-delà de leurs différences respectives, une lignée de penseurs au nombre desquels, on trouvera les figures de Lucrèce, Montaigne, Hume, Nietzsche, pour ne citer qu’eux. Nous avons déjà largement évoqué l’entreprise d’annihilation du monde de l’Être mise en œuvre par Nietzsche. Il nous paraît intéressant de nous recommander ici également de l’empreinte plus ancienne laissée par Pyrrhon, le père du scepticisme. La veine sceptique de Montaigne et de Hume n’est plus à établir, mais il importe de noter, par ailleurs, que Nietzsche, estimant que « les grands esprits sont des sceptiques1 », ne manque pas de rendre hommage, dans nombre de passages de son œuvre2, au regard profondément désabusé de Pyrrhon, fidèle à l’indifférence du réel. S’il est donc une puissance de l’esprit, elle s’exprime avant tout dans cette capacité à se libérer du cachot des certitudes, de la prétendue science de l’esprit qui se croit en mesure d’emprisonner le réel dans des entités lisses et stables. Le scepticisme de Pyrrhon nous paraît emblématique de cette capacité à briser le monde fictif de l’Être, à œuvrer à la désillusion pour rendre le réel à ses apparences mouvantes et changeantes. Ainsi, écrit Conche à propos de Pyrrhon, « il lui vint à l’esprit que le chemin à suivre n’allait pas de l’apparence à l’être, comme le crut Platon, mais au contraire de l’être, qui n’est jamais que l’objet
1
F. Nietzsche, L’Antéchrist, 10/18, 1967, § 54, p. 89. Voir notamment L’Antéchrist, op. cit., § 12 ; La Volonté de puissance, trad. H. Albert, op. cit., § 238, 240, 254. 2
110
ÉCHOS DU RÉEL
d’une réification illusoire, à l’apparence pure et universelle1 ». Rappeler les termes exemplaires de cet effort de redescente du chemin des Idées nous paraît un éclairage édifiant de la tentative de s’en tenir au texte incertain et vacillant de la réalité. La leçon pyrrhonienne. Quelle est cette leçon de Pyrrhon que Conche invite particulièrement à retenir au sein d’une démarche tragique ? Si nous ne pouvons rien énoncer au-delà des apparences, ce n’est pas tant en raison d’un défaut ou d’une limitation de notre esprit (comme le prétendent les phénoménistes), mais avant tout parce qu’il n’y a rien de stable à saisir. Nous nous fions ici à la lecture originale du pyrrhonisme proposée par Conche, soucieuse de lever d’importants amalgames. À cet égard, il paraît important de reconduire la distinction opérée par le philosophe entre le dernier scepticisme ou scepticisme phénoméniste (c’est-à-dire celui de Sextus Empiricus qui vécut à la fin du Ier siècle après J.-C. ou au début du IIe) et le pyrrhonisme proprement dit (fondé aux environs de l’an 300 avant J.-C.). Car ce qui fait toute l’originalité du pyrrhonisme par rapport à la version plus tardive de Sextus, c’est d’être non une philosophie du phénomène défini par rapport à un être qu’il occulterait, mais une philosophie de l’apparence universelle. Il ne s’agit donc pas de conserver la scission de l’apparent et du caché, de distinguer le phénomène et l’être, mais au contraire « de dissoudre l’être lui-même : il n’y a que l’apparence sans rien qui apparaisse2 ». Retour essentiel à une telle charge destructrice de la pensée. Face à la multiplicité des points de vue entretenant tous un rapport inadéquat avec le vrai, seul reste le non-jugement. Il faut dire, selon Pyrrhon, de chaque chose qu’elle n’est pas plus qu’elle n’est pas, ou qu’elle est et n’est pas, ou qu’elle n’est ni n’est pas. La formule clé du pyrrhonisme est en effet le ou mallon, « pas plus » : rien n’est plutôt ceci que cela. Aussi, la pensée pyrrhonienne procède-t-elle à la mise en question de la notion de vérité de l’étant et de l’idée d’être. De quoi conduire à la destruction de la possibilité d’une pensée de l’être, l’appréhension du réel de manière mouvante et dynamique puisque réduit aux apparitions qui le constituent. Tout se résout et se dissout dans l’apparence. Ce qui suppose de congédier un certain nombre de notions, de catégories qui prétendent ordonner, donner sens à l’insensé. Hécatombe de la vérité dont le pyrrhonisme tire les dernières conséquences. Le sceptique pyrrhonien n’est certain que d’une chose : il se meut dans un univers aux contours flous, imprécis, indécidables. Ainsi, détruire pour lui, c’est avant tout détruire la possibilité d’un univers suspendu à l’ancrage ontologique, à la pensée de l’être. Reste la réduction du réel aux apparences qui le composent, et seulement à elles. Hormis cela,
1 2
M. Conche, Pyrrhon ou l’apparence, PUF, « Perspectives critiques », 1994, p. 38. Ibid., p. 119.
111
ÉCHOS DU RÉEL
nihil. Forme de nihilisme ontologique, non pas absolu, au sens d’un pur néant, mais relatif, qui récuse toute ontologie. C’est dire que s’il est clair qu’il n’y a pas rien, rien n’atteste que ce soit un être qui nous sépare du néant. Pas l’être, mais le devenir ; pas le néant, seulement l’apparence. Il n’y a donc pas absolument rien, mais en tout cas aucun être susceptible de résister à l’universalité du paraître et du devenir. La porte du néant, pourrions-nous dire, si elle n’est pas enfoncée, est entrouverte. En prônant le non-jugement et en se livrant à l’apparence pure, le pyrrhonien fait s’écrouler le champ de l’être. Le rien auquel aboutit Pyrrhon n’est donc pas un néant pur et simple (de chaque chose on ne peut pas plus dire l’être que le non-être et inversement), mais « une forme du rien qui ne se pense pas par rapport à l’être : l’apparence1 ». Timon de Phlionte, disciple immédiat de Pyrrhon, caractérise ainsi, selon l’aristotélicien Aristoclès de Messène, l’enseignement de son maître : Il est nécessaire, avant tout, de faire porter l’examen sur notre pouvoir de connaissance, car si la nature ne nous a pas faits capables de connaître, il n’y a plus à poursuivre l’examen de quelque autre chose que ce soit. Il y a eu, effectivement, autrefois, des philosophes pour émettre une telle assertion, et Aristote les a réfutés. Cependant Pyrrhon d’Elis aussi soutint en maître cette thèse. Il est vrai qu’il n’a laissé aucun écrit, mais Timon, son disciple, dit que celui qui veut être heureux a trois points à considérer : d’abord quelle est la nature des choses ; ensuite dans quelle disposition nous devons être à leur égard ; enfin ce qui en résultera pour ceux qui sont dans cette disposition. Les choses, dit-il, il [Pyrrhon] les montre également in-différentes, immesurables, in-décidables. C’est pourquoi ni nos sensations, ni nos jugements, ne peuvent, ni dire vrai, ni se tromper. Par suite, il ne faut pas leur accorder la moindre confiance, mais être sans jugement, sans inclination d’aucun côté, inébranlable, en disant de chaque chose qu’elle n’est pas plus qu’elle n’est pas, ou qu’elle est et n’est pas, ou qu’elle n’est ni n’est pas. Pour ceux qui se trouvent dans ces dispositions, ce qui en résultera, dit Timon, c’est d’abord l’aphasie, puis l’ataraxie2...
Un parcours nous est donc suggéré par le texte : 1. Poser la question de savoir ce que sont les choses en elles-mêmes. Ce qui amène à reconnaître que les choses entre elles − « également indifférentes, im-mesurables, indécidables » − sont sans différences ; 2. Envisager dans quelle disposition nous devons être à leur égard. D’où il ressort que, par suite, nous ne pouvons formuler aucun jugement ; 3. Ce qui en découlera pour ceux qui sont dans cette disposition. De cette abstention résulte l’ataraxie, symbole de paix intérieure.
1
Ibid., p. 81. Texte d’Aristoclès de Messène dans Eusèbe de Césarée (268-325), Préparation évangélique, XIX, 18, 1-4. Traduction de M. Conche, Pyrrhon ou l’apparence, op. cit., p. 59-61.
2
112
ÉCHOS DU RÉEL
Nous ne nous arrêterons pas sur le dernier point, l’ataraxie rencontrée par Pyrrhon au fond du non-jugement. Est visée là l’absence de troubles, la suppression de la souffrance, perspective commune aux philosophies hellénistiques. Nous reviendrons ultérieurement sur cette forme de sagesse nourrie de la quête d’un certain détachement vis-à-vis des tourments de l’existence afin de caractériser en regard la visée moins distanciée et, de ce fait, plus déchirée de la vision tragique. Pour l’heure, restons au niveau de l’appréhension des apparences proposée par le scepticisme pyrrhonien, dans laquelle peut aisément se retrouver, nous semble-t-il, la pensée tragique du réel. Considérons alors les deux premiers points distingués par Timon : L’indifférence dans les choses. « Adiaphora : in-différentes sont les choses entre elles ou mieux, non différentes vivent et s’épanouissent (pephuke) les choses que l’homme logico-ontologique nomme et croit maîtriser1. » Les choses sont pour nous in-différentes et in-discriminables, non pas parce que sensations et jugements sont inaptes à saisir les choses elles-mêmes, leurs différences, leurs normes, leurs principes de détermination ; mais c’est, au contraire, parce que les choses mêmes sont « in-différentes, im-mesurables, in-décidables » que, en conséquence de cela, les sens et les jugements ne peuvent dire ni le vrai, ni le faux. C’est l’indifférence dans les choses, l’in-différence entre les choses mêmes, qui rend les sens et la raison incapables de vérité et de fausseté, et non l’inverse. Une telle indifférence objective résulte précisément de la négation de l’être, de l’essence et de la substance de la philosophie platonico-aristotélicienne, négation qui est impliquée dans ce texte de Diogène Laërce : « Pyrrhon disait que rien n’est beau, ni laid, ni juste, ni injuste, et, pareillement, au sujet de toutes choses, que rien n’est en vérité, mais qu’en tout les hommes agissent selon la convention et la coutume, car chaque chose n’est pas plutôt (ou mallon) ceci que cela2. » Adiaphorie : le principe de non-différence absolue, point-clé de la pensée de Pyrrhon. Il n’est pas possible de fonder la différence des étants ; ils se résolvent en apparences. Ainsi quand Timon écrit dans son livre des Sensations : « je n’affirme pas que le miel est doux, mais je reconnais qu’il apparaît tel3 », il entend que le miel se réduit à son apparaître, et qu’il n’y a pas, au-delà de l’apparence, un « être vrai » du miel. Ou mallon, « pas plutôt ceci que cela » : l’être n’est pas. Ce qui signifie que l’apparence est le dernier mot, il n’y a pas à aller au-delà. Citons encore ce vers de Timon témoignant ici de la pensée pyrrhonienne : « L’apparence, où qu’elle se
1
P. Carré, D’Elis à Taxila, éloge de la vacuité, Criterion, 1991, p. 67. Diogène Laërce, Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, II, GF – Flammarion, 1965, livre IX, p. 191. Selon les propos de Diogène, nous utilisons des traductions différentes, mais, pour plus de commodité, nous signalons à chaque fois la pagination de notre édition. 3 Ibid., livre IX, p. 207. 2
113
ÉCHOS DU RÉEL
présente, l’emporte sur tout1. » De quoi s’agit-il là ? De l’apparence pure, qu’il ne faut donc surtout pas, comme Conche l’a nettement précisé, confondre avec le « phénomène ». Car le phénomène manifeste quelque chose d’autre ; il renvoie à un au-delà du phénomène, à un non-manifesté. Il implique l’opposition de ce qui apparaît et du non-apparent, de l’immédiat et du médiat, de l’évident et du caché. Il s’inscrit dans la scission de la sphère totale entre ce qui se montre et ce qui se cache, scission qui se retrouve d’une manière générale chez les dogmatiques, mais également chez la plupart des sceptiques postpyrrhoniens, dont le scepticisme s’inscrit dans le cadre même du dogmatisme. Depuis Sextus Empiricus, l’interprétation classique a constamment attribué à Pyrrhon la distinction du phénomène et de l’être, celle-là même que, à travers la notion de non-différence dans les choses, il a précisément voulu annuler. Le pyrrhonisme, il nous faut insister sur ce point, ne confond pas le phénomène et l’apparence, et la distinction de l’apparent et du caché n’est pas pyrrhonienne. Car la non-différence dans les choses signifie précisément l’abolition de leur être et leur résolution en apparences. Ce que veut Pyrrhon, c’est précisément penser l’unité de la sphère totale, non par le biais de l’idée d’être mais de l’idée d’apparence, comme apparence pure et universelle, c’est-à-dire non apparence-de (d’un « être »), ni apparence-pour (un « être », à savoir le sujet)2, mais apparence qui ne renvoie qu’à elle-même. La sphère pyrrhonienne de l’apparence ne laisse absolument rien hors d’elle. Avec l’apparence, c’est bien une forme du rien qui ne se pense pas par rapport à l’être que nous découvre Pyrrhon. Le socle de la métaphysique vacille et s’écroule : l’idée d’être (le fait qu’il y ait des étants) ou de vérité de l’étant (le fait de dire ce qui est), reléguée au royaume des chimères, ne peut plus faire sens aux yeux du sceptique pyrrhonien. Le non-jugement. Timon nous expose ensuite la « disposition » pyrrhonienne − « sans jugement, sans inclination, inébranlable ». En ce sens et à proprement parler, Pyrrhon ne doute pas : ses éléments sont la négation et l’abstention3. Car, c’est le lieu de le préciser, le doute, la « suspension du jugement » ne remettent pas en question le jugement lui-même comme lieu de la vérité, c’est-à-dire cela même que le pyrrhonisme s’attache à remettre en question. La notion d’épochè, au sens de suspension, n’est, là encore, pas proprement pyrrhonienne. C’est, dans le scepticisme, une notion plus tardive liée à la lutte antidogmatique. La disposition fondamentale de Pyrrhon est donc le non-jugement, en ce sens que c’est la possibilité même du jugement qui est récusée. Il rejette par conséquent les principes mêmes du jugement qui, selon Aristote et la métaphysique issue de lui, enferme le droit que la pensée s’arroge au sujet de l’étant : le principe de raison (qui présuppose, 1
Ibid. M. Conche, Pyrrhon ou l’apparence, op. cit., p. 8, 101, 102. 3 Ibid., p. 103. 2
114
ÉCHOS DU RÉEL
d’abord, que les choses soient ainsi plutôt qu’autrement), le principe de noncontradiction (qui affirme que ceci est cela, ou n’est pas cela), et le principe du tiers exclu. Selon la démonstration d’Aristote, si une même chose est dite en même temps être et ne pas être, on ne dit rien et, en définitive, « rien n’est »1. Pyrrhon admet l’argumentation, à la différence que, comme l’écrit Conche, la conclusion − l’impossibilité de fonder la différence des étants −, qui d’après Aristote équivaut à une absurdité, n’en est pas une aux yeux de Pyrrhon2. « Rien n’est », non pas absolument rien, c’est-à-dire le néant pur ou le non-être, mais le rien de l’apparence. Dès lors qu’il n’y a pas de critère pour distinguer les apparences « essentielles » et les apparences « inessentielles », celles-ci ne se contredisent pas. Toutes ont valeur égale (apparence de tour ronde = apparence de tour carrée, etc.). Comment la contradiction est-elle évitée ? Par le fait précisément de ne jamais passer de l’apparence à l’être, de ne jamais dire : « Cela est » (jugement impliquant la différence du vrai et du faux, de l’être et du non-être). En s’abstenant de juger, Pyrrhon reste en deçà de la contradiction. Il parvient ainsi à briser l’argumentation aristotélicienne à sa racine. L’aboutissement est le silence. Et c’est ce silence-là qui est précieux. Car il n’est pas celui de la démission de la pensée, mais celui qui s’établit, non seulement contre les affirmations par trop bruissantes des dogmatiques, mais surtout comme le témoignage de l’acquisition d’un équilibre interne. Savoir se taire, ne pas se prononcer, voilà la force. L’aphasie (c’est-à-dire l’abstention envers toute affirmation qu’elle soit positive ou négative, ou proposition comportant le verbe « être ») ne doit donc aucunement être confondue avec le mutisme, mais elle consiste dans la non-assertion, le nondit de l’être. Je ne définis rien ; il n’y a rien de compréhensible. L’apparence est maîtresse de toute chose. C’est dire que notre dépit ne vient pas tant d’une imperfection réelle, d’un défaut de notre constitution, que de l’idée illusoire que nous avons forgée d’une certitude qui n’existe pas. Point essentiel du message sceptique : la réflexion devrait servir à mettre en avant notre vaine agitation et non à nous faire poursuivre des chimères. Le nonjugement ne doit donc surtout pas être assimilé à un moyen d’éviter l’erreur ou à l’expression d’une hésitation paresseuse. L’attitude silencieuse du pyrrhonien n’a rien d’un flottement nauséeux ; elle traduit un profond effort de lucidité consistant à récuser toute quête de fondation. En somme, Pyrrhon n’enseigne aucun dogme, à l’inverse, son incertitude assumée libère la vie « des dogmes, des idées, des croyances, du langage, de tout ce qui est interprétation3 », pour la rendre à elle-même, et rien qu’à elle-même. 1
Aristote, Métaphysique, I, Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 1933, livre Γ, 1008 a 22, p. 134. 2 M. Conche, Pyrrhon ou l’apparence, op. cit., p. 113. 3 M. Conche, « Pyrrhon », in Dictionnaire des philosophes, PUF, 1984, p. 2373.
115
ÉCHOS DU RÉEL
Tout est voué à perte et destruction. Voilà ce que dit profondément l’apparence absolue, en laquelle tout s’enfouit et s’engloutit. Et Pyrrhon ne l’oubliait nullement. Il avait lu Homère ; il avait médité : l’étreinte mortelle du Temps ne lui échappait pas. Au sein de l’absence totale de repère, il n’y a qu’un maître suprême : le Temps. Reconnu comme tel, c’est-à-dire avec son implacable majuscule. L’apparence universelle, l’universelle ironie, c’est avant tout celle du Temps. « Toute notre vie est commandée par l’intuition de l’apparence universelle, ou, si l’on préfère, de l’universalité de la mort1. » Il y a, au creux de l’attitude sceptique, une profonde intériorisation de notre finitude, de notre condition d’êtres voués au néant. Selon Philon d’Athènes, Pyrrhon citait fréquemment Homère qu’il admirait beaucoup et avait fait son refrain du vers suivant de L’Iliade : Telle est la race des feuilles, telle est aussi celle des hommes2.
Ainsi aimait-il reprendre les vers d’Homère touchant à la dimension éphémère de l’homme, à l’image de la condition des feuilles, vouées à la dissémination et à l’anéantissement. Il citait souvent, comme le relate Diogène Laërce3, ces deux vers prononcés par Achille : Allons ! mon bon ami, meurs donc à ton tour. Pourquoi te lamenter ainsi ? Patrocle aussi est mort, lui qui valait cent fois plus que toi4.
Notre dimension éphémère, notre inconsistance primordiale, notre manque à être, notre inanité profonde, voilà ce que n’occultait pas Pyrrhon. Précarité de l’existence reconnue. Rien ne demeure, tout passe et trépasse. Toutes choses ne « sont » pas, à proprement parler, puisque réduites à de simples apparences, et toutes, ainsi, subissent la morsure du temps et donc de la mort qui n’épargne rien sur son passage. Nous sommes pris dans le mouvement de l’apparition-disparition, dans le courant de la vie inséparable de son changement ininterrompu, de ses renversements incessants et de son germe létal. C’est avant tout cela être en chemin, et le pyrrhonien ne l’occulte pas, il l’accueille dans son évidence crue. L’illusion ontologique selon laquelle je me figure qu’il y a, et donc me persuade d’une consistance du réel, débusquée par le scepticisme, a cette conséquence immanquable : ne pas oublier que nous ne possédons rien et surtout pas nous-mêmes, que tout cela n’est qu’apparence et voué au néant. La soumission aux apparences nous invite, ainsi, à nous rappeler la leçon pyrrhonienne, signant ici ses
1
M. Conche, Pyrrhon ou l’apparence, op. cit., p. 203. Homère, L’Iliade, Le Livre de Poche, 1992, VI, p. 135. 3 Diogène Laërce, Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, II, op. cit., livre IX, p. 193. 4 Homère, L’Iliade, op. cit., XXI, p. 492. 2
116
ÉCHOS DU RÉEL
attaches aux rivages du tragique. Celui-ci ne se réduit pas au scepticisme car, comme nous tenterons de le mettre en évidence, la visée n’est pas l’ataraxie, néanmoins un certain nombre de points de jonction peuvent être établis s’agissant de l’appréhension du réel et de la vie humaine. Il ne nous semble donc pas abusif de considérer, avec Conche, le pyrrhonisme comme une philosophie de la mort. Ce serait même manquer la méditation pyrrhonienne que de ne pas l’associer à une méditation de la mort. La référence homérique, expression du sentiment du néant de l’homme, n’a rien de fortuit. Refrain d’une pensée de la finitude, d’une intériorisation profonde de notre néant destinal. Puisque la réalité se réduit au pur paraître, le Temps revendique son emprise sur toute chose ; il est « l’universel ironiste qui renverse la prétention de toute chose à persévérer dans son être1 ». L’image des feuilles dit cela : la dimension fantomatique de l’homme qui, pour peu qu’il cherche à se retourner sur lui-même, réalise la précarité de toute identité, toujours donc, en cela, accidentellement constituée et sûrement défaite. Œuvrent en nous et en chaque chose, inlassablement et consciencieusement, les forces de dissolution et de mort. Reconnaître l’apparence pure et universelle, c’est-à-dire répugner à se réfugier dans des entités stables, telles les Idées platoniciennes, va de pair avec une conscience exacerbée de notre précarité, ainsi que du caractère illusoire de toute évasion dans un royaume d’Êtres incorruptibles. Car ce qui importe avant tout c’est l’ici et le maintenant, la situation présente, avec son cortège de perte et de destruction. « L’apparence n’a aucun caractère illusoire puisqu’elle est maintenant la “réalité” même, elle est tout ce qu’il y a ; l’illusion consiste à réifier des entités permanentes hors et au-dessus du déroulement quotidien de la vie (Dieu, Idée, Substance, Essence, Atome, etc.), elle consiste aussi, alors que tout se résout dans la vie insurmontablement éphémère, à croire à un salut possible par les traces2. » Rien n’est. Rien ne demeure. Tout paraît et disparaît. Ainsi toute stabilité ne peut-elle être que passagère. La question de l’être n’est pas posée. Est reconnu le mouvement incessant qui anime toute chose. Toute réalité est appréhendée selon un équilibre instable, à la fois dynamique et provisoire. Sont récusées les oppositions familières à la pensée occidentale – devenir et être, apparence et réalité, sensible et intelligible – pour laquelle celles-ci permettent de structurer notre approche du réel. Ces oppositions perdent leur pertinence dans cet horizon philosophique. Puisque rien n’est tenu, puisque rien ne peut être possédé, nous sommes invités à la représentation d’un monde dénaturé, ne se prêtant pas à l’injection trop humaine de sens. 1
M. Conche, Pyrrhon ou l’apparence, op. cit., p. 9. M. Conche, « L’apparence », Orientation philosophique, PUF, « Perspectives critiques », 1990, p. 272.
2
117
ÉCHOS DU RÉEL
Le réel retrouvé Le diagnostic paraît clair désormais. À travers le mirage du double, l’homme s’arrange pour fuir la réalité trop simple, trop insupportable, trop rugueuse ; il déconnecte sa logique pour ne pas voir. Il se construit alors une autre image ou version du monde en développant la pratique de l’illusion telle que Platon s’est employé à la transmettre. Il procède en doublant la réalité grâce aux images en miroir, beaucoup plus séduisantes et rassurantes. « Il y a en effet deux grandes possibilités de contact avec le réel : le contact rugueux, qui bute sur les choses et n’en tire rien d’autre que le sentiment de leur présence silencieuse, et le contact lisse, poli, en miroir, qui remplace la présence des choses par leur apparition en images. Le contact rugueux est un contact sans double ; le contact lisse n’existe qu’avec l’appoint du double1. » Distinction qui recoupe celle établie entre les deux types de philosophes : les philosophes-médecins, qui entendent s’accommoder du pire, et les philosophes-guérisseurs qui appellent de leurs vœux un mieux-être. En quoi nous avons pu repérer des systèmes de pensées qui organisent à des degrés divers le refus du réel et la quête d’un sens, et détecter, ainsi, une inclination spontanée au double, une préférence accordée à ce qui n’existe pas plutôt qu’à ce qui existe. C’est là le nerf, si l’on peut dire, de la tendance métaphysique, prête à la mise en œuvre des plus subtiles esquives pour éviter ce qui est. À travers, en particulier, les analyses de Rosset et les échos de penseurs comme Pyrrhon, Montaigne et Nietzsche, il s’est agi de dénoncer ce désir trop fréquent de croyance à la réalité de l’irréel. Parce qu’il est ce qu’il est, indistinctement fortuit et déterminé, autrement dit insignifiant, le réel est assurément source de déception. La tentation est grande, alors, pour l’intelligence humaine de passer outre son écho tragique pour lui supposer un sens et lui accoler des valeurs imaginaires, qui « sont autant d’ombres portées sur la véritable “valeur” ou “nature” du réel2 ». Celui-ci se voit dépouillé de sa rugosité et devient le théâtre de multiples tours de passe-passe. Le voici mis à distance et dépossédé de son unicité grâce à la magie d’un double garant d’un ordre, d’un sens, d’une stabilité dans l’être, capable donc d’évacuer le caractère à la fois incompréhensible et douloureux de la réalité. Jeu de masques, de reflets, qui permet ensuite de prétendre détenir les termes d’une fondation, d’expliquer, de justifier, au lieu d’une affirmation du réel sans recherche d’une solution supérieure. Illusion particulièrement tenace, reprise par toute une tradition philosophique depuis Platon, consistant ainsi à vouloir quitter le réel immédiat pour faire son miel d’une interprétation dualiste de la réalité, comptant sur l’irradiation d’un être qui ne se trouve nulle part. 1 2
C. Rosset, Le Réel, op. cit., p. 43. Ibid., p. 40.
118
ÉCHOS DU RÉEL
L’appréhension tragique de la réalité vise à récuser cette façon d’éliminer le réel effectivement présent pour s’engouffrer dans des versions fantasmagoriques. À ce titre, la pensée acquiert cette vocation première, non pas d’aboutir à une certitude philosophique, mais de débusquer l’illusion. « Il en va un peu de la qualité des vérités philosophiques comme de celles des éponges qu’on utilise au tableau noir et auxquelles on ne demande rien d’autre que de réussir à bien effacer. En d’autres termes, une vérité philosophique est d’ordre essentiellement hygiénique : elle ne procure aucune certitude mais protège l’organisme mental contre l’ensemble des germes porteurs d’illusion et de folie1. » L’intérêt premier d’une « vérité » philosophique réside dans sa vertu négative ou critique, autrement dit sa capacité à chasser des idées qu’elle estime « tenues abusivement pour vraies et évidentes2 ». La force d’une œuvre philosophique se mesure alors, avant tout, à l’ensemble des illusions et des mirages qu’elle s’emploie à défaire. Vapeurs tragiques et échos sceptiques s’associent. Loin de toute injection de sens, de profondeur et d’« arrière-mondes », il s’agit de rendre les aspérités du réel : cela signifie qu’il est requis de se placer du côté de la rugosité, et non pas du poli et du lisse. Nous retrouvons là une ligne de penseurs qui, contre ceux qui se figurent que le vrai se situe au-delà de la mort, estiment selon des termes empruntés à Bonnefoy que : « Rien n’est que par la mort. Et rien n’est vrai qui ne se prouve par la mort3. » Il ne s’agit pas là de fascination ou de complaisance morbide mais d’entêtement. L’auteur parle précisément, comme nous le relevions au début de notre réflexion, d’« exigence têtue », celle de ne penser et de ne discourir qu’à travers la mort, de ne reconnaître qu’une logique : celle du pire. Là est la plus difficile des pensées, puisqu’elle consiste à détruire radicalement cette propension de l’intelligence humaine à penser tout de suite « autrement » face au caractère douloureux de la réalité, cette décision d’aller voir « ailleurs » pour se fabriquer des surréels fantasmatiques. L’enjeu philosophique n’est pas du côté de la guérison, mais bien de celui de la peste : « ce qui doit être recherché et dit avant tout est le tragique4 ». Notre expérience immédiate du réel est celle de l’irrémédiable, de l’irrévocable, de l’unique : le réel n'est que ce qu’il est, indifférent à nos doléances, dépourvu de sens et d’intention. Et par-dessus tout sans recours. De cette absence, nous supportons difficilement la tragique cruauté. Aussi, sommes-nous disposés à nous raccrocher à des illusions, à accueillir volontiers toutes les versions édulcorées de l’existence.
1
C. Rosset, Le Principe de cruauté, op. cit., p. 37. Ibid. 3 Y. Bonnefoy, L’Improbable et autres essais, op. cit., p. 34. 4 C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 11. 2
119
ÉCHOS DU RÉEL
Vice tenace : pour échapper au sentiment du mourir, les hommes préfèrent regarder ailleurs, au-delà de ce qui apparaît, de ce qui se donne dans la présence effective, fuir ce qui est pour révérer ce qui n’est pas. À ce réel insupportablement simple et muet, ils inventent des doublures, dont le bavardage tend à nous faire croire que ce qui est est aussi autre chose. À l’encontre de ces échafaudages illusoires, l’important n’est pas d’avoir raison, mais de se tenir au plus près de ce que nous pouvons énoncer sans désir de tromperie. Logique du pire qui suppose de « priver l’homme de tout ce dont celui-ci s’est intellectuellement muni à titre de provision et de remède en cas de malheur1 ». La délivrance est sans doute amère aux yeux de l’illusionné, mais elle a cette vertu de dissiper nombre de mirages. Elle peut briser la superbe de penseurs persuadés d’être détenteurs d’un savoir absolu, l’industrie bien huilée des faiseurs d’illusions, apôtres toujours renaissants des lendemains qui chantent ou des autres mondes utopiques, au lieu de s’essayer à œuvrer à l’intérieur de celui-ci. Elle peut ramener l’homme aux rivages poreux du monde, le seul qu’il nous est donné d’expérimenter, autrement dit en perpétuel devenir, nous exposant à l’incertitude et à la mort. Posture qui n’a certes rien de confortable, mais qui, aux yeux du regard tragique, paraît moins nuisible que celle de l’illusion. Rappelons qu’il n’y a là aucune délectation morbide. La visée n’est pas de rappeler à l’homme un savoir dont il pourrait aisément se passer sans dommage majeur, mais de l’inciter à prendre en charge la réalité et le risque d’angoisse qui lui est attaché. Car le réel… est réel, banal, unique, persistant. C’est pourquoi, dans l’optique tragique, « l’esquive est toujours une erreur » : même si elle soulage momentanément, elle est vaine, « parce que le réel a toujours raison »2, mortellement raison. Et c’est cela qui importe avant toute autre considération. Tenter de se barricader derrière le mensonge pour ignorer le caractère affreux de la réalité et se fabriquer une version optimiste de son sort, c’est entrer dans une logique inflationniste du mensonge – il faudra toujours de nouveaux mensonges pour renforcer le mensonge initial, créant, à moins de sombrer dans la folie, un climat de mensonge intenable à plus ou moins long terme. Vivre ainsi, bercé de mirages et d’illusions, c’est vivre d’abord « à côté de la plaque », chuter ensuite d’autant plus durement quand devra rendre gorge le scénario rassurant de la réalité qu’on avait pu se raconter. Car le réel rattrape toujours le fuyard, et l’esquiver c’est se révéler avant tout incapable d’admettre l’indifférence tragique du monde, autrement dit le caractère éphémère de toute chose et la gratuité de ses malheurs inéluctables. L’anti-tragique aboutit ainsi à une équation simple : « que si la vérité est
1 2
Ibid., p. 10. C. Rosset, Le Réel et son double, op. cit., p. 125.
120
ÉCHOS DU RÉEL
cruelle, c’est qu’elle est fausse1 ». Ce à quoi l’on peut répondre, faisant toujours écho à Rosset, que « si la réalité peut en effet être cruelle, elle n’en est pas moins réelle2 ». D’où la vision tragique de l’existence que l’on peut se sentir autorisé à réaffirmer et qui, au lieu d’enfanter sans relâche des doubles, des fables ou des utopies pour éclipser le caractère abrupt de la réalité, accepte le réel tel qu’il est, toujours singulier, « irréparablement unique et idiot3 », avec tout ce qu’il peut comporter à nos yeux d’instable, de cruel, de douloureux ou d’injuste. De quoi repérer derrière des élaborations philosophiques réputées profondes parce que complexes et auréolées d’un jargon philosophique, à l’image notamment de l’odyssée de l’Esprit de Hegel, avant tout une communauté d’illusions destinée à masquer l’expérience immédiate que nous avons du réel, celle de l’irrémédiable, de l’irrattrapable, de l’unique et de l’insignifiance. Considérant que la profondeur du tragique réside dans cette capacité à penser l’immédiat, Rosset appartient à ceux qui énoncent les évidences simples pour tenter de nous les faire redécouvrir, en insistant sur la dimension tautologique du réel. Dire, par conséquent, que le réel est le réel ne constitue pas un discours pauvre ou plat, mais signifie rappeler qu’il n’est que ce qu’il est, sans doublures bavardes, seulement simple et muet. D’où l’affirmation de l’idiotie du réel. Voilà l’idiotie : l’existence en tant que fait singulier, sans reflet ni double. S’attacher à montrer que le réel est idiot, c’est mettre en évidence que toute réalité est nécessairement quelconque, « hormis le fait de sa réalité même qui est l’énigme par excellence, c’est-à-dire tout le contraire du quelconque4 ». C’est dire ensuite qu’attribuer une signification au réel est totalement illusoire et que le hasard peut suffire à tout expliquer. Le hasard visant bien sûr ce qui se passe dans l’existence, ses aléas, pas le fait de l’existence elle-même, s’agissant duquel il est vain de tenter de penser quoi que ce soit. « En fait, le pire qu’on puisse faire, écrit Bonnefoy, est de ne pas reconnaître l’empire du hasard sur la vie. Car celle-ci est finitude, c’est là l’évidence ultime, qu’il importe donc d’affronter ; et le hasard est son caractère essentiel5. » Car c’est alors que l’on est prêt à s’engouffrer dans des « images-mondes » qui, quelques grandioses soient-elles – ainsi des puissantes élaborations intellectuelles de Platon –, n’en sont pas moins déconnectées du réel pour céder à leur désir d’un monde traduit en images déprises de la texture de l’immédiat. 1
C. Rosset, Le Principe de cruauté, op. cit., p. 29. Ibid., p. 30. 3 C. Rosset, Le Réel, op. cit., p. 51. 4 Ibid., p. 40. 5 Y. Bonnefoy, « Yves Bonnefoy, la présence au monde et au langage », Entretien avec Jean Roudaut, Magazine Littéraire, « Louis Althusser », n°304, novembre 1992, p. 100. 2
121
ÉCHOS DU RÉEL
Les images peuvent s’efforcer de se soumettre à la critique de l’immédiat et s’offrir alors comme un moyen de préhension du réel. Ainsi de la métaphore qui ne cherche pas à recréer le réel, mais qui, par son dire indirect, son « porter ailleurs » consistant à nommer une chose par une autre, peut nous amener à une redécouverte de celui-ci. Pour autant que la métaphore soit subtile et pertinente, elle parvient, par la voie détournée, à mieux désigner une chose que si elle l’indiquait directement. D’où vient ce pouvoir expressif ? Parce qu’elle produit « un “effet de réel” […] par la nouveauté de la façon dont elle le désigne1 ». Rosset, reconnaissant un tel pouvoir à la métaphore, cite Pierre Guiraud qui s’exprime en ce sens : « La métaphore actualise quelque analogie de forme, de couleur, de goût, d’odeur, de comportement, de fonction, etc., dans une relation neuve et pas encore perçue ; relation singulière qui correspond à une vision originale, qui avait jusqu’ici échappé à la langue2 ». C’est dire que la métaphore, loin de s’extraire du réel, se tient au plus près de celui-ci, sachant en offrir un nouvel éclairage, grâce à une habile re-création des moyens utilisés généralement. « Elle ne fait pas surgir un monde neuf, mais un monde remis à neuf3. » Mais les images peuvent aussi s’extraire de la présence par la quête d’un éclat surplombant l’ancrage hasardeux, poreux, toujours particulier du réel que nous retrouvons dans tout discours philosophique formulé selon une inspiration dualiste. Purgée des scories, des rugosités du réel, l’élaboration intellectuelle mise en œuvre n’est alors plus « qu’une “image” – voici le mot dans un autre sens – du monde, et non celui-ci, non sa présence indéfaite, non son unité revécue4 ». Rendre le réel à sa part hasardeuse et à son insignifiance revient à le rendre à lui-même, à reconnaître son caractère unique, en soulignant par là même la finitude. Il est, dès lors, inutile de s’échiner à « fouiller » dans les choses pour leur extorquer un secret introuvable : « c’est à leur surface, à la lisière de leur existence, qu’elles sont incompréhensibles : non d’être telles, mais tout simplement d’être5 ». Le réel déborde toujours les inscriptions intellectuelles que l’on peut en donner ; de même que son avènement déjoue généralement nos tentatives d’anticipation. Sa meilleure définition est sans doute le caractère irréfutablement présent de ce qui existe. Ce en quoi il est la seule chose du monde à laquelle on ne s’habitue jamais6.
1
C. Rosset, Le Démon de la tautologie, op. cit., p. 43. P. Guiraud, Le Langage, Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, 1968, p. 478. Cité par C. Rosset, Ibid. 3 Ibid. 4 Y. Bonnefoy, « Yves Bonnefoy, la présence au monde et au langage », Entretien avec Jean Roudaut, op. cit., p. 100. 5 C. Rosset, Le Réel, op. cit., p. 40. 6 C. Rosset, Fantasmagories, op. cit., p. 71. Voir aussi Principes de sagesse et de folie, op. cit., p. 59. 2
122
ÉCHOS DU RÉEL
Dans cette perspective, la grandeur de l’homme n’est pas de se déprendre du réel pour s’élever vers d’autres sphères. Il faut y voir bien plutôt sa faiblesse, sa peur précisément de reconnaître un réel dans toute sa crudité, son désir de se garder une marge de manœuvre. Le réel est, pourtant, irrévocablement placé sous ce signe cru. S’il est donc une intelligence de sa véritable condition, elle ne réside pas dans un exercice consistant à défaire les mailles de la temporalité, mais dans la capacité à reconnaître un principe de réalité suffisante excluant toute doublure trompeuse. Le fossé se creuse avec l’idée du double qui, dépourvue de réel ancrage, appartient au registre de l’illusion dans la mesure où elle « se complaît dans l’imagination d’une réalité qui n’existe en aucune façon1 ». Prolongement fantomatique ou double fantasmatique du réel, substituant au règne de ce qui existe le règne de ce qui n’existe pas. Obstination à créer de toutes pièces un monde factice, plutôt que d’essayer de s’arranger avec la réalité. De là son caractère nuisible, capable de troubler la raison et qui, pour cela, reste à dénoncer comme « illusion majeure de l’esprit humain », dès lors qu’il s’annonce comme « rival fantomal du réel, comme compensation, subtile et dérisoire à la fois, des souffrances attachées à la prise en charge de la réalité »2. La vision tragique suppose, par conséquent, comme le commente Roland Jaccard, que l’« on ne peut vraiment philosopher qu’après avoir compris dans sa chair combien on est nul, insignifiant et banal3 ». Si l’on ne veut pas dissoudre le mélange d’être et de non-être qui est nôtre, la méditation ne peut donc être que méditation sur l’apparence. Cela suppose, non de rechercher ce que le réel « représente », mais de l’appréhender dans sa présence singulière, ici et maintenant. De quoi conclure : « ne cherchez pas le réel ailleurs qu’ici et maintenant, car il est ici et maintenant, seulement ici et maintenant4 ». La dépendance de la pensée à l’égard de l’existence et de la crudité du réel a cette conséquence d’entraîner la réflexion loin de la métaphysique et de l’ontologie pour la maintenir au plus près de notre vulnérabilité temporelle et corporelle. Ainsi, l’existence questionnante ne se définit pas proprement comme capacité à se poser la question du sens de l’être, mais bien plutôt comme l’exposition au choix de son être. Dès lors, la pensée de l’existence sous l’horizon du tragique doit s’attacher à la question du « comment exister », c’est-à-dire du choix de soi comme existant. Jean Beaufret écrit à propos de Kierkegaard : « L’existant est ainsi celui à qui quelque chose est instant, et qui se sent dès lors pressé, interpellé, réclamé par l’instance. Celui à qui rien n’est instant n’existe
1
C. Rosset, Impressions fugitives, Minuit, 2004, p. 20-21. C. Rosset, Fantasmagories, op. cit., p. 59. 3 R. Jaccard, « Qu’est-il arrivé à Clément Rosset ? », Le Monde, 5 novembre 1999. 4 C. Rosset, Le Réel, op. cit., p. 152. 2
123
ÉCHOS DU RÉEL
pas1. » Mise en évidence de la dimension décisive du temps. N’est existant que celui pour qui l’instant est appel au choix de soi. Or, une fois formulées ces réflexions sur l’existence et le réel, c’est la question de notre maintien en cette vie qui nous semble se poser avant tout. Est-ce parce que le réel est privé de justifications que l’on ne peut plus le supporter pour autant ? Le malaise, la nausée, l’angoisse ont-ils vocation à se cristalliser dans un dégoût mortel ? Cette existence arrimée à rien trouve-telle son juste écho dans la voie suicidaire ?
1
J. Beaufret, Introduction aux philosophies de l’existence. De Kierkegaard à Heidegger, Denoël, « Bibliothèque Médiations », 1971, p. 84-85.
124
CHAPITRE III HORS DU TEMPS ? Il nous faut repartir de notre point d’arrivée précédent, à savoir la déchirure tragique susceptible de mettre en cause la poursuite de notre existence. Morts l’homme et le monde, un réel mouvant et rendu à sa vacillation profonde… Comment vivre alors que les remparts du moi s’effondrent ? Que reste-t-il à faire de sa propre vie ? Appel à une mort anticipée ? À partir du moment où l’existence et le réel s’affaissent, la tentation du suicide paraît inévitable. Comment ne pas se suicider après avoir éliminé toutes les façades enchantées, les pilules de l’illusion et de l’optimisme ? Où trouver sa force ? Ne reste-t-il que le cul-de-sac ? Impossible à ce stade de ne pas songer à un départ anticipé. La pensée de la mort volontaire rôde inévitablement dans les parages du tragique. Beckett ne manque pas, d’ailleurs, de laisser la pensée suicidaire planer sur la scène. Ainsi, revient-elle trois fois dans En attendant Godot, manifestée par Estragon à bout de ressources et dont le désir d’en finir revient régulièrement : « Si on se pendait ? » suggère-t-il abruptement, en début et en fin de pièce1. Sur cette suggestion, Vladimir et Estragon envisagent cette solution à titre d’une ultime diversion, mais renoncent la première fois de peur que la branche de l’arbre frêle ne se brise, tandis que la seconde fois, leur seule arme, la corde qui tient lieu de ceinture à Estragon, n’est pas assez solide... Quant à Winnie, elle garde toujours son « Brownie2 » près d’elle au cas où… « quand je perds courage et jalouse les bêtes qu’on égorge3 ». Que faire désormais ? Jouer le jeu ou abandonner la partie ? L’acte d’auto-suppression s’impose-t-il à la conscience déniaisée ? Le rien est-il préférable au presque-rien ? Faut-il en somme, comme disait Hamlet, « se donner quittance » ? Nous nous interrogerons tout d’abord sur la signification de l’acte de la mort volontaire, à travers notamment son rapport primordial avec la liberté. Ceci afin de proposer ensuite le positionnement qui nous paraît s’accorder avec la perspective tragique.
1
EAG, p. 21, 132. Estragon dira encore (regardant l’arbre) : « Dommage qu’on n’ait pas un bout de corde. » (p. 74). 2 OBJ, p. 18, 39, 40, 53, 64. 3 Ibid., p. 24.
125
HORS DU TEMPS
?
I. La liberté à mort « Nous sommes maîtres d’une résolution d’autant plus alléchante que nous ne la mettons pas à profit : est-il plus grande richesse que le suicide que chacun porte en soi ? » Cioran, Précis de décomposition.
Hors la logique de la vie Il paraît primordial de reconnaître dans le suicide, non pas un phénomène, mais un événement existentiel. Distinction essentielle, car elle rappelle qu’il s’agit d’abord de la situation singulière d’un individu face à son destin. Rappelons avant tout que le suicide est multiforme : par honneur (ainsi le seppuku japonais), par peur de la souffrance ou de la déchéance, par amour de la liberté tel Caton, par désespoir amoureux, par dépression1 ou chronique mélancolie tel Kleist et sa compagne Henriette Vogel2, par révolte tel le suicide de Zweig face à l’arrivée au pouvoir des nazis… Ou encore, comme il semble important de le souligner, bien souvent en raison de ces catastrophes minuscules qui, trop imprécises aux yeux des autres, à la recherche de grandes catastrophes capables d’expliquer cet acte terminal, font que, selon les termes de Maupassant, l’« on met sur ces morts, le mot “Mystère”3 ». Le suicide, c’est aussi cela : « la lente succession des petites misères de la vie, la désorganisation fatale d’une existence solitaire, dont les rêves sont disparus », donnant ainsi « la raison de ces fins tragiques que les nerveux et les sensitifs seuls comprendront »4. Jean Baechler, dans son étude, ne parle pas par hasard des suicides5, soucieux d’exprimer leur irréductible diversité. Ajoutons à cela ceux qui se suicident à l’issue d’une longue réflexion et ceux qui agissent avec impulsivité. Les manifestations du suicide sont d’une extrême diversité et l’orientation dans ces méandres de la mort donnée par soi particulièrement malaisée. Quelle commune mesure trouvera-t-on entre tel ou tel suicide ? Dès lors, la question souvent posée de savoir si le suicide est un acte guidé
1
Voir en particulier William Styron qui montre combien la tentation du suicide peut être puissante lorsque la dépression gagne les moindres parcelles de l’existence. W. Styron, Face aux ténèbres, Gallimard, « Du monde entier », 1990. 2 Tous deux étaient visiblement davantage liés par un désir de mort commun que par amour, selon la brillante analyse de Zweig. Voir S. Zweig, Le Combat avec le démon, Belfond, « Le Livre de Poche », 1983, p. 19-88. 3 G. de Maupassant, « Suicides », Contes et nouvelles, I, op. cit., p. 175. 4 Ibid. 5 J. Baechler, Les Suicides, Calmann-Lévy, 1975.
126
HORS DU TEMPS
?
par le courage (héros contre le destin) ou par la lâcheté1 (être faible, incapable de résister aux assauts du sort), s’il est une victoire ou une fuite, semble un faux problème. Il n’y a pas à porter de jugement moral à l’égard du suicide. Goethe a mis ces mots dans la bouche de Werther s’adressant à Albert qui prétend que le suicide ne peut être regardé que comme une faiblesse « car, dit-il, de bonne foi, il est plus aisé de mourir que de supporter avec constance une vie pleine de tourments2 ». Werther, agacé par ce qu’il considère comme « un lieu commun insignifiant », réplique pour finir : « La nature humaine a ses bornes, continuai-je ; elle peut jusqu’à un certain point supporter la joie, la peine, la douleur : ce point passé, elle succombe. La question n’est donc pas de savoir si un homme est faible ou s’il est fort, mais s’il peut soutenir le poids de ses souffrances, qu’elles soient morales ou physiques ; et je trouve aussi étonnant que l’on nomme lâche le malheureux qui se prive de la vie que si l’on donnait ce nom au malade qui succombe à une fièvre maligne3. » S’il est un critère, il réside dans cette seule appréciation : la mesure de ce qu’un homme peut supporter. Nous ne sommes pas dans une seule démarche intellectuelle, mais face à une réalité difficile dans laquelle le désir de vivre s’étiole ou a fait long feu. Que les motifs nous paraissent futiles ou respectables, il y a quelqu’un qui n’en peut plus. Envisager le suicide, non pas comme un phénomène mais comme un événement existentiel, a des conséquences éthiques et philosophiques d’importance. De quoi rappeler, non seulement qu’il n’y a pas à porter un jugement, à élaborer une théorie sur le suicide, mais aussi, contre les opinions toutes faites, que le suicide n’est aucunement la propriété des sociologues ou des psychiatres, si l’on tient à produire une réflexion sur la mort volontaire. Michel Cornu, à travers l’éthique tragique de l’inquiétude qu’il s’essaie à développer, y insiste : le suicide, envisagé comme événement existentiel, ne peut être compris par les sciences, parce qu’il est un mystère et non un problème4. Henry de Montherlant écrivait en ce sens : « Quand j’entends expliquer les raisons de tel suicide, j’ai toujours l’impression d’être sacrilège. Car il n’y a que le suicidé qui les ait connues, et qui ait été en mesure de les comprendre. Je ne dis pas : de les faire comprendre ; elles sont le plus souvent multiples, et inextricables, et hors de portée d’un tiers5. » Infinie variété des motifs, imbrication de multiples facteurs, sans oublier, en dernière instance, la disposition d’esprit qui crée le moment décisif. Car
1
Le suicide perçu comme une preuve de lâcheté est à ranger selon G. Flaubert au nombre des idées reçues. Voir G. Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, Mille et une nuits, 1994, p. 80. 2 J. W. von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, Gallimard, « Folio », 1973, p. 80. 3 Ibid., p. 80-81. 4 M. Cornu, « Le suicide est-il un problème ? », article issu d’une conférence donnée le 2 décembre 2000 [En ligne]. http://www.pinel.qc.ca/ (consulté le 19 février 2004) 5 H. de Montherlant, Le Treizième César, Gallimard, « Soleil », 1970, p. 117.
127
HORS DU TEMPS
?
même si le processus de l’intention suicidaire a abouti, reste encore ce moment qui décide : une inclinaison du paysage, le geste qui sauve ou qui retarde comme dans le cas d’Emma Bovary1, le mot ou l’attitude qui, comme l’écrit Camus, achève et dessine les contours de l’acte. « Ce qui déclenche la crise est presque toujours incontrôlable. Les journaux parlent souvent de “chagrins intimes” ou de “maladie incurable”. Ces explications sont valables. Mais il faudrait savoir si le jour même un ami du désespéré ne lui a pas parlé sur un ton indifférent. Celui-là est le coupable. Car cela peut suffire à précipiter toutes les rancœurs et toutes les lassitudes encore en suspension2. » La complexité et la dimension toujours mystérieuse de l’acte suicidaire doivent être reconnues. Cela implique d’admettre, comme l’exprime Cornu, que l’on ne peut « com-prendre » autrui, autrement dit l’identifier au savoir que l’on peut prétendre en avoir. À partir de là, condamner ou être obnubilé par une optique de soin, se révèle comme « une manière d’avoir pouvoir sur celui qui tente de se suicider ou se suicide3 ». Ainsi les sciences ne font-elles que chercher des causes pour « remédier au mal de vivre en prenant en toutes circonstances le parti de la vie » et ne sont préoccupées, en conséquence, que par le souci de mettre en œuvre « des thérapeutiques préventives et curatives », et n’atteignent pas la réalité de l’acte puisqu’elles ignorent la question du sens à laquelle renvoie un acte humain. Dans le même ordre d’idées, Konrad Michel, médecin psychiatre ayant beaucoup travaillé sur la prévention du suicide et se ralliant initialement à ce type de raisonnements, retranscrit la réponse de l’écrivain August E. Hohler à un de ses articles intitulé « Le suicide est évitable » : « … Konrad Michel ne se pose pas la question du sens. Il semble partir du principe que le sens de la vie est de vivre : l’Homme doit vivre, il doit fonctionner. Son désespoir éventuel est une erreur passagère, réparable. Le suicide serait une erreur, une exagération, un court-circuit, une panne. L’Homme serait une machine et la médecine un service de dépannage. C’est obscène et j’entends déjà rire de loin Jean Améry, qui en savait long sur l’Homme et ses abîmes4. » Si
1
Lorsque Rodolphe, l’amant d’Emma Bovary, rompt avec elle, brisant ses rêves amoureux et son projet de fuite avec lui, prise de vertige, elle s’enfuit au grenier où elle éprouve la tentation du suicide. Les cris de Charles à la recherche d’Emma, interrompant l’aspiration du vide, empêchent très certainement sa chute probable par la fenêtre… Emma réalise qu’elle était très proche de la mort. « L’idée qu’elle venait d’échapper à la mort faillit la faire s’évanouir de terreur ; elle ferma les yeux » (p. 232). L’arrivée de sa bonne Félicité, le contact de sa main posée sur sa manche, la fait tressaillir et achève de la ramener au rythme quotidien de la maison : « Et il fallut descendre ! il fallut se mettre à table ! » (p. 233). Voir G. Flaubert, Madame Bovary, Garnier Flammarion, 1979, deuxième partie, chap. 13. 2 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 18-19. 3 M. Cornu, « Le suicide est-il un problème ? », op. cit. 4 K. Michel, « De quoi ont besoin les personnes suicidaires ? », in H.-B. Peter et P. Mösli (sous la dir.), Suicide. La fin d’un tabou ?, Labor et Fides, « Le champ éthique », 2003, p. 18.
128
HORS DU TEMPS
?
K. Michel retranscrit ces propos, c’est qu’il a lui-même perdu son fils par suicide et a été de ce fait amené à réviser dramatiquement son approche et ses certitudes… L’important est plutôt d’essayer de se situer au plus près de l’acte suicidaire, comme nous y invitait Jean Améry. La contribution de l’auteur sur la question du suicide nous paraît déterminante par la justesse et la profondeur de son ton, tentant de saisir au plus près ce que peut signifier Porter la main sur soi. Le suicidant s’extrait de la logique vitale, estimant qu’elle n’est pas la valeur suprême. Améry parle d’inclination à la mort, tourne finement autour pour extirper les sentiments d’échec et de dégoût de la vie dont elle se nourrit, estimant que tant que l’on s’en tient à la seule logique de la vie, on ne peut rien dire de sensé sur le suicide. Si l’on veut bien faire l’effort de sortir des chiffres et de placer la détresse et la liberté humaines au cœur des préoccupations, la perception est foncièrement différente. Comme l’écrit Paul Morand : « Le suicide est un des tristes privilèges de l’espèce humaine ; pour se tuer, il faut d’abord savoir que l’on vit et que l’on vit mal1. » C’est pourquoi Améry se situe délibérément en dehors de toute suicidologie, aux antipodes de la démarche scientifique. Une telle démarche permet d’apprendre certes nombre de choses, d’aligner des éléments d’analyse et des statistiques (non d’ailleurs sans contradictions) : dans quel pays on se suicide le plus et pour quelles raisons apparentes, quelles tranches d’âge sont les plus exposées, pourquoi les hommes se suicident plus que les femmes… En somme, de retirer des informations sur les processus psychiques et sociaux susceptibles de conduire à la mort volontaire. Mais cette suicidologie ne nous apprend rien sur le suicide dans sa dimension de drame individuel. Si le texte de l’auteur se situe au-delà de la psychologie et de la sociologie et commence « là ou s’arrête la suicidologie scientifique2 », c’est précisément pour appréhender la mort volontaire (le choix de l’expression « mort volontaire » n’est évidemment pas anodin, tenant à préserver l’autonomie de l’acte par rapport au goût d’homicide qui émane du terme suicide – sui caedere « se tuer »), non pas de l’extérieur, mais pour se situer au cœur même de l’intention suicidaire. « J’ai essayé de ne pas voir la mort volontaire de l’extérieur, dans l’optique du monde des vivants ou des survivants, mais depuis le for intérieur de ceux que j’appelle suicidaires ou suicidants3. » Si on ne tente pas de pénétrer dans ces ténèbres, on ne peut rien dire. Cela ne permet pas de cerner utilement le phénomène, précisément parce que là n’est pas la visée. L’intérêt est de se situer sur la voie qui mène à l’événement. 1
P. Morand, L’Art de mourir, L’esprit du temps, 1992, p. 19. J. Améry, Porter la main sur soi, Actes Sud, 1996, p. 11. 3 Ibid., p. 11-12. « Suicidant » désigne celui qui s’anéantit, et « suicidaire » celui qui couve le projet de mettre fin à ses jours. 2
129
HORS DU TEMPS
?
Le personnage de L’Endormeuse pénètre au cœur cette atmosphère asphyxiante où l’on sort de la logique de la vie, imaginant cette foule des morts volontaires et faisant défiler dans son esprit les multiples modalités du suicide. Poison, couteau de cuisine, rasoir, corde ou chute dans les flots… Il sent leurs angoisses, sait les chagrins qui les ont menés jusqu’à ce seuil sinistre « car je sens l’infamie trompeuse de la vie, comme personne, plus que moi, ne l’a sentie. Comme je les ai compris, ceux qui, […], ayant perdu les êtres aimés, réveillés du rêve d’une récompense tardive, […], et désabusés des mirages du bonheur, en ont assez et veulent finir ce drame sans trêve ou cette honteuse comédie1. » Lorsque la comédie n’est plus que « honteuse », que les jours paraissent seulement féroces, et qu’aucune parcelle d’existence ne semble décidée à ménager d’ouverture joyeuse, alors l’atmosphère devient insoutenable et dessine les gestes de l’arrêt volontaire. « La sensation de la vie qui recommence chaque jour, de la vie fraîche2 » a déserté les lieux. Les yeux deviennent fixes, le souffle s’étrangle et les lèvres se crispent. « Le suicide ! mais c’est la force de ceux qui n’en ont plus, c’est l’espoir de ceux qui ne croient plus, c’est le sublime courage des vaincus ! Oui, il y a au moins une porte à cette vie, nous pouvons toujours l’ouvrir et passer de l’autre côté. La nature a eu un mouvement de pitié ; elle ne nous a pas emprisonnés. Merci pour les désespérés3 ! » Alors, les mots de Maupassant l’expriment au plus juste, le suicide peut être abordé sans jugement hâtif et ce sas de sortie compris comme ce non-emprisonnement essentiel, puisque demeure « toujours cette porte que les dieux rêvés ne peuvent même fermer ». L’auteur se fait le porte-parole de ces « désespérés las de vivre » et formule une adresse au monde, à la société qui, imagine-t-il, un jour « comprendra mieux », autorisant une mort plus douce, « qui ne soit point répugnante ou effroyable4 ». Il imagine même un lieu où l’on irait mourir en douceur, grâce à l’Endormeuse, dispositif inoculant la mort via l’émanation d’un gaz imperceptible et parfumé. Au-delà de cette rêverie et des prolongations que l’on pourrait faire du côté de l’euthanasie5, le message délivré est bien celui d’une meilleure compréhension de cet acte existentiel. Compréhension et évolution des mentalités que souhaitait également Améry : « Aussi longtemps qu’un certain mouvement ne sera pas inauguré par des personnes qui n’ont rien à voir avec la psychologie et la psychiatrie, pour revendiquer avec insistance l’absolue reconnaissance de la liberté de la
1
G. de Maupassant, « L’Endormeuse », Contes et nouvelles, II, op. cit., p. 1160-1161. Ibid., p. 1159. 3 Ibid., p. 1161. 4 Ibid. 5 Rappelons que le mot « euthanasie » signifie bonne mort, mort douce et sans souffrance et non comme le traduit l’acception moderne : « geste ou omission du geste qui provoque délibérément la mort du malade qui souffre de façon insupportable ou vit une dégradation insoutenable ». 2
130
HORS DU TEMPS
?
mort volontaire comme droit inaliénable de l’homme, les choses ne bougeront pas1. » La réponse à l’appel se fait attendre… Bien sûr, la logique vitale déborde de toute part, telle une lourde prescription, le programme supposé de nos réactions : « Il faut bien vivre », entend-on dans la bouche des gens, comme pour conjurer les misères subies ou celles qu’ils ont eux-mêmes orchestrées. Mais Améry pose la question : « Faut-il vraiment vivre ? » Rester là, par le seul fait que l’on est là ? Le suicide est le désaveu flagrant et légitime de cette logique vitale. En cela, le suicidaire dérange évidemment, fait figure de marginal, puisqu’il fait vaciller la logique même de l’existence sans cesse réitérée, en projetant le néant dans l’atmosphère. S’annonce ici une des raisons majeures du discrédit qui frappe le suicide : « le suicidé, écrit Baechler, vient fâcheusement rappeler aux autres qu’ils sont mortels, alors que tous les efforts sont déployés pour faire oublier cette réalité désagréable2 ». Voici énoncé sans doute le véritable motif de l’interdit et des tabous pesant sur le suicide : mettre fin à ses jours, c’est rappeler sans détour aux autres leur condition mortelle. Nous en revenons au cœur de notre propos, à la peur d’être renvoyé à sa propre mort, à la mort éludée. Georges Minois n’hésite pas à poser la question au terme de sa réflexion : « ce refus collectif et individuel n’est-il pas dicté par l’invincible répulsion de chacun à évoquer un sort dont il sait qu’il sera inéluctablement le sien3 » ? Et la réponse paraît nette, à l’aune des attitudes de rejet de l’acte suicidaire, de la répulsion qu’il ne manque pas de susciter. Principe évident de protection dans l’endurcissement des cœurs. « Les cœurs, vides de fraternité, s’endurcissent, et ils sont bien obligés, sans quoi leur mécanisme se détraquerait4. » Le suicidaire s’est extrait de la voix du groupe qui proclame sans cesse « on doit bien vivre ». Dans cette perspective, comme le commente Baechler, les suicidés sont perçus comme « de mauvais drôles qui oublient ou ignorent leurs devoirs5 ». Le suicidé est un trouble-fête qui déstabilise l’ordre social et fait vaciller la confiance que la société a en elle-même, celle-ci se sentant alors coupable ou placée au banc des accusés. Sans doute, à ce titre, le choix du suicidaire pourra-t-il difficilement être admis simplement en tant que tel, puisqu’il enfreint cet entêtement à la vie. Que la société veuille se défendre contre son propre suicide, cela se comprend. Mais, au-delà des mesures compréhensibles de préservation de la logique vitale, on ne peut pas pour autant ne pas appeler à une plus grande compréhension de l’acte suicidaire, car comme insiste Améry il n’en reste pas moins un chemin de liberté dont il nous paraît requis de définir les contours. 1
J. Améry, Porter la main sur soi, op. cit., p. 63. J. Baechler, Les Suicides, op. cit., p. 116. 3 G. Minois, Histoire du suicide, Fayard, 1995, p. 380. 4 J. Améry, Porter la main sur soi, op. cit., p. 155. 5 J. Baechler, Les Suicides, op. cit., p. 115. 2
131
HORS DU TEMPS
?
Ténébreuse liberté Les arguments majeurs traditionnellement opposés au suicide ne peuvent guère, dans notre perspective, que représenter des postures insuffisantes : simplisme (le suicidé est un démissionnaire lâche ou un ingrat) ou pure voix de l’intérêt (préserver la suprématie de Dieu, de l’autorité sociale ou morale), mues précisément, au plus profond, par un contournement du tragique (ne pas laisser quiconque rappeler notre mortalité profonde, vouloir s’arrimer à l’idée rassurante que vivre à tout prix vaut mieux que la mort). L’enjeu de notre réflexion nous amène à considérer l’individu dépouillé de ces considérations. Et à comprendre la portée que peut avoir le suicide, à travers lequel il en va à la fois du malheur et de la liberté, de l’humanité et de la dignité. Conche raisonne en supposant que nous soyons privés de cette possibilité de nous donner la mort. La conséquence serait inévitable : nous vivrions sans liberté de vivre. Privés de la liberté de mourir, notre maintien dans la vie ne le serait pas par choix. Si bien que celui-ci serait comparable à un séjour en prison. Bien entendu, cet esclavage n’en est pas un pour qui la règle interdisant le suicide est raisonnable. Obéir à cette règle, dans la mesure où j’en reconnais le bien-fondé, abolit un rapport d’esclavage, puisque je ne lui obéis pas sous la contrainte. En revanche, pour celui pour qui la règle interdisant de se donner la mort ne paraît pas fondée en raison, elle ne peut être ressentie que comme un enfermement. Et si l’on avance l’argument qu’il faut de bonnes raisons, Conche rappelle qu’en ce domaine, celles-ci ne peuvent être que subjectives. Précisément parce que l’on ne peut définir objectivement ce qu’est une vie supportable. « Les raisons de mourir sont des raisons singulières et concrètes1. » C’est pourquoi lorsqu’un individu estime que la vie ne lui est plus supportable pour telles ou telles raisons, même si celles-ci ne constituent pas des raisons suffisantes à mes yeux, une fois que la mort est donnée, je ne puis que me taire et en aucun cas moraliser sur cette mort. Ce serait considérer ces raisons du dehors, de manière abstraite et leur ôter toute signification – pour quelqu’un cela a représenté une raison suffisante pour passer à l’acte –, et ajouter le poids de la culpabilité au malheur et au désespoir. L’homme s’appartient et la mort librement voulue l’atteste. Avec Améry, nous pouvons reconnaître dans le suicide l’ultime liberté de l’humanité, puisque le candidat au suicide a la parole, « lance le premier mot2 », répond à la destinée par l’acte autonome de la mort volontaire, au lieu de l’attendre passivement. Quels que soient les motifs qui le poussent à cette extrémité, c’est lui qui porte le coup. En cela, nous l’avons vu, il « échappe totalement 1 2
M. Conche, Le Fondement de la morale, PUF, « Perspectives critiques », 1993, p. 98. J. Améry, Porter la main sur soi, op. cit., p. 26.
132
HORS DU TEMPS
?
à la logique de la vie1 » qui scande dans la vie quotidienne « il faut bien vivre » ou « il faut faire avec ». Le suicide apparaît, par conséquent, avant toute chose comme une affirmation de la liberté et de la dignité, dirigé qu’il est contre le règne aveugle de la nature. Il incarne cette capacité de rompre la symétrie entre la naissance et la mort. La vie m’a été donnée sans l’intervention de ma volonté. En ce sens, je ne suis pas la cause suffisante de ma vie2, tandis que je puis être celle de ma mort. Il suffit que j’en fasse le choix. « À l’instant même où l’homme se dit qu’il peut envoyer la vie promener, il est déjà libre, même si c’est une effroyable manière de l’être3. » La mort volontaire, en rejetant la cuirasse de la logique vitale, se pose comme cet acte de liberté qui ne promet pas la « liberté de faire autre chose », mais « la libération de quelque chose »4. L’important ici, dans le terme « liberté », réside par conséquent non plus dans l’idée de cette ouverture humaine tendue en avant vers la possibilité de réaliser un jour ceci ou cela, mais dans l’écho de libération qu’il comporte. Rupture des attaches de celui qui se sait seul, cette fois irrémédiablement, car sa tension n’est plus que celle du grand saut. Puisque l’aboutissement de cette libération est mortel, la liberté disparaît, certes, en même temps que l’oppression dont on se déprend. C’est pourquoi Améry parle de chemin de la liberté, comme la « recherche du grand air » et non comme « la liberté et le grand air eux-mêmes »5. Un chemin qui ne mène nulle part, mais la faculté d’emprunter ce chemin qui permet précisément d’appréhender le suicide comme le dernier rempart de la liberté. « Il ne va pas bien notre suicidaire, et tout n’allait pas au mieux pour notre suicidant. Nous ne devrions pas leur refuser le respect que mérite leur conduite, ni notre sympathie, d’autant que nous faisons nous-même piètre figure. Nous avons une allure lamentable, tout le monde le constatera. Ainsi allons-nous pleurer, tout bas, la tête baissée et le geste bienséant, celui qui nous a quittés dans la liberté6. » Ténébreuse et paradoxale liberté certes, puisqu’il s’agit d’une liberté qui nous prive de toute liberté future. Ce en quoi d’aucuns7 contestent la présence effective de la liberté dans l’acte du suicide, considérant que c’est abolir du même coup cette liberté. Cet acte requiert un pouvoir qui se nie en s’exerçant, la liberté se retournant contre elle-même. Or, mettre délibérément un point d’arrêt et nier n’est pas la même chose. J’use de ma liberté pour 1
Ibid. M. Conche, Le Fondement de la morale, op. cit., p. 96. 3 J. Améry, Porter la main sur soi, op. cit., p. 138. 4 Ibid., p. 134. 5 Ibid., p. 145. 6 Ibid., p. 156. J. Améry s’est suicidé deux ans après l’écriture de son ouvrage Porter la main sur soi publié en 1976. 7 Voir notamment L. Meynard, Le Suicide. Étude morale et métaphysique, PUF, « Initiation philosophique », 1962, chap. 2 : « Suicide et liberté ». 2
133
HORS DU TEMPS
?
mettre fin à ma vie. Je ne détruis pas ma liberté, j’en fais usage une dernière fois. En cela, le suicide correspond au dernier geste libre possible. Par cet acte mortel, je manifeste ma liberté, même si simultanément j’y mets un point d’arrêt. Ce en quoi Améry parle d’acte à la fois absurde et paradoxal. C’est absurde et contradictoire, parce que tout ce que nous appelons « bien » ne l’est que sous couleur de vie, n’apparaît tel que dans le cadre de la vie, mais précisément ce jugement paradoxal montre combien l’homme sur le point de faire le grand saut ne se situe plus dans la vie et sa logique. Il est déjà ailleurs, au-delà de la raison en tant qu’« esprit au service de la vie ». C’est précisément là que se rejoignent tous les suicides, dans leur mystère et leur logique contradictoire. Le candidat à la mort volontaire sait qu’en s’affranchissant de la vie il supprime la conscience sans laquelle rien n’existe pour nous, il sait qu’il supprime par le fait même le sujet de la liberté. D’où, pour ceux dont le raisonnement est exclusivement attaché aux rives de la vie, la conclusion que la libération apportée par le suicide ne peut être qualifiée d’acte libre. Mais ce dernier acte, par lequel un homme se fige une fois pour toutes dans la mort et coupe court à tout élan futur, enlève-t-il pour autant sa substance à l’élan qui lui a permis de se libérer, fût-ce pour s’effondrer ? Intrinsèque contradiction, mais qui n’abolit pas pour autant ce noyau de liberté coïncidant avec la garantie de la dignité humaine. Ne peut-on pas considérer que ce foudroiement même et la contradiction qu’il intègre sont l’expression la plus haute de la liberté humaine ? Penser la liberté du geste suicidaire signifie que le suicide résonne comme cette alternative de chaque instant, cette possibilité de choisir soimême, à l’intérieur du champ clos de notre finitude, le moment où il est temps de mourir. Point d’importance majeure. Parce que la vie pourrait sembler intolérable sans cette porte de sortie par la voie rapide. En sachant ce geste à portée de main, je me sais libre de décider du moment de ma propre mort. Endriade amène Elisa à le reconnaître : Et maintenant, Élisa, une question : vous êtes-vous jamais demandé où prenait naissance en nous l’idée de liberté ? Quelle est son origine première ? La condition absolument indispensable qui nous fait demeurer, même en prison, même au seuil de la mort, parfaitement maîtres de notre destin ? Et sans laquelle nous deviendrions fous ? – Mon Dieu, dit Elisa Ismani. Je dois vous avouer que je n’ai jamais pensé à tous ces problèmes… – Je veux dire, reprit Endriade, que la vie nous deviendrait vite insupportable, même dans les conditions les plus heureuses, si la possibilité de suicide, d’autodestruction, disparaissait. Personne n’y pense, bien sûr. Mais essayez un peu d’imaginer ce que deviendrait le monde si nous apprenions un jour que personne ne peut disposer même de sa propre vie… Un bagne épouvantable. Fous, nous deviendrions fous1. 1
D. Buzzati, L’Image de pierre, 10/18, « Domaine étranger », 1998, p. 94.
134
HORS DU TEMPS
?
Conversation capitale qui reconnaît dans la possibilité du suicide le terme même de l’idée de liberté humaine. C’est la raison pour laquelle Endriade, après avoir conçu Numéro Un, sorte de cerveau surpuissant, et désirant doter cette machine de sentiments humains, lui alloue symboliquement la touche maîtresse : une charge de dynamite susceptible d’être commandée à tout moment, demeurant malgré tout symbolique puisque cette charge explosive n’est au fond qu’une poudre inoffensive, au cas où la machine déciderait d’en finir réellement. C’est d’ailleurs de ce mensonge que découlera la rage terrible de Numéro Un : trop humanisée pour supporter les rouages d’acier, les antennes et autres dispositifs qui interdisent toute figure humaine, la machine décide d’en finir, mais réalisant qu’au lieu de dynamite sa liberté se réduit à un explosif factice, tous ses conduits se révoltent. En une ultime vengeance, elle cherche à tuer Elisa en l’enfermant dans une pièce d’acier. Alors son concepteur, réalisant le caractère effroyable de son œuvre, détruit ce qui lui tenait lieu d’âme, ne laissant place qu’à un lourd silence exténué. L’homme n’a de garantie de sa liberté qu’autant qu’il a cette faculté de disposer de son existence. Car, sans le suicide, son idée même, il n’y aurait plus aucune liberté, aussi ténue soit-elle. Manière pour l’individu de proclamer son autonomie et la souveraineté qu’il détient sur sa propre vie. C’est la preuve d’une certaine maîtrise que l’individu possède sur son existence en n’obéissant pas au seul instinct de conservation, fût-ce pour offrir celle-ci délibérément à la Faucheuse. Il est important de se reporter aux stoïciens sur ce point qui ont donné ses lettres de noblesse au suicide en en faisant l’acte philosophique par excellence, considérant que l’homme ordinaire – trop tenu par le vulgaire élan vital – vit autant qu’il peut, tandis que l’homme supérieur, lui, vit autant qu’il doit. Il sait que s’offre à lui une sortie raisonnable, une voie libératrice : le suicide. La position des stoïciens est déterminante dans la mesure où elle légitime le suicide comme un acte libre, permettant de sauvegarder ou de manifester la dignité de l’homme, et en cela reconnaît la valeur de l’individu. Il s’agit de considérer l’homme maître de son destin, de sa mort y compris. Ainsi Sénèque écrit-il, notamment, à propos de la mort volontaire : « de toutes parts s’ouvrent à la liberté des chemins nombreux, courts, aisés. Remercions le dieu de ce que l’on ne peut retenir nul de nous dans la vie : les nécessités en personne, on a licence de les piétiner1. »
1
Sénèque, Lettres à Lucilius, in op. cit., livre I, lettre 12, 10, p. 628. Pour marquer le contraste avec l’approche chrétienne du suicide, l’on peut aussi se reporter à ce passage de La Providence, où Sénèque fait un éloge du suicide à travers la déclaration divine : « Par-dessus tout j’ai pris soin que l’on ne pût vous retenir malgré vous : l’issue est grande ouverte. […] de toutes les nécessités auxquelles je vous ai soumis, je n’en ai rendu aucune plus facile que la mort. J’ai placé la vie sur une pente : elle y glisse. Prenez-y garde et vous verrez combien la
135
HORS DU TEMPS
?
Quelle est la doctrine de l’école du Portique en matière de suicide ? Sans encourager le suicide, elle l’admet et le respecte, reconnaissant en lui un acte libre susceptible de préserver ou encore de manifester la dignité de l’homme et, à ce titre, lui est favorable, surtout dans certaines circonstances. Dans cette optique, comme l’explicite Paul Veyne, la vie doit être quittée avec autant d’indifférence joyeuse que l’on quitte un banquet. Or on le quitte dans cinq cas : si quelqu’un que l’on aime a besoin de nous ; s’il survient un malotru qui donne mauvais ton au banquet ; si les mets sont avariés et rendent malades ; s’il n’y a rien à boire et à manger ; si l’ivresse a fait perdre la raison. De même, peut-on énoncer cinq cas où il est raisonnablement permis, voire prescrit de quitter la vie : s’il faut sacrifier ses jours à un ami ou à la patrie ; si un tyran nous force à dire ou à faire des choses malhonnêtes ; si l’on a une maladie incurable ou douloureuse ou une mutilation et que l’âme ne puisse se servir du corps ; si l’on est en proie à la misère, à la pauvreté ; si l’on devient fou1. Vivre pour vivre, autrement dit, n’a aucune valeur. Aussi n’y a-t-il pas lieu de déployer un héroïsme inutile pour supporter par exemple la pauvreté et la douleur. Si l’on a la force requise pour les endurer, faisons-le, sinon tant pis, nous pouvons nous en libérer en quittant la vie. Dans bien des passages, Sénèque se situe dans la lignée de la doctrine, néanmoins la fréquence et la complaisance des éloges que le philosophe adresse à la mort, clé de la vraie liberté, ressortissent à son tempérament plus sombre2. Au-delà de ces nuances d’approche, le suicide est un point très important du stoïcisme, celui-ci permettant d’appréhender les orages qui nous menacent avec sérénité. Il y a une porte de sortie, une ouverture libre. Rappelons également que, si le suicide tient une place importante au Portique, d’autres écoles philosophiques lui reconnaissent une pertinence. Les cyrénaïques, les cyniques, les épicuriens, soucieux de la préservation de la liberté intérieure, estiment eux aussi, avec leurs nuances respectives, que la vie ne mérite d’être conservée que si elle est un bien, qu’elle peut être menée raisonnablement et dignement. « C’est un mal que la nécessité, mais
voie qui mène à la liberté est courte et commode à suivre. […] vous avez la mort sous la main. » (in op. cit., VI, 7, 8, 9, p. 307). 1 Diogène Laërce résume l’approche stoïcienne en ces termes : « Le sage peut avec raison donner sa vie pour sa patrie et ses amis, et encore se tuer s’il est dans de pénibles douleurs, s’il a perdu un membre ou encore s’il a une maladie incurable. » (Diogène Laërce, Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, II, op. cit., livre VII, p. 94). 2 Il faut préciser en effet, comme P. Veyne le montre très clairement (voir l’introduction aux Lettres à Lucilius, in op. cit.), qu’il existe un certain écart entre le stoïcisme des fondateurs et celui de Sénèque, surtout celui des Lettres à Lucilius : plus sombre, moins confiant et enthousiaste (il mourra de se propre main un an ou deux après avoir écrit ce texte). Sénèque philosophe et poète tragique coïncident dans la figure âgée du penseur, offrant un certain lyrisme du suicide. Voir en particulier la Lettre 77 où Sénèque relate un suicide avec une certaine délectation.
136
HORS DU TEMPS
?
il n’y a aucune nécessité de vivre avec la nécessité1 », écrit Épicure. Il ne s’agit pas de prôner le suicide et la sagesse recommande, certes, de ne pas se précipiter et de n’agir qu’après mûre réflexion. Mais si la vie devient insupportable, le suicide est à notre disposition. La leçon des Anciens est claire et importante : il s’agit de reconnaître la valeur de l’individu, dont la liberté réside dans le pouvoir de décider luimême de sa vie et de sa mort. L’ouverture du suicide peut ainsi résonner comme la manifestation de la dignité humaine et l’affirmation de la liberté de l’individu capable de mettre en échec la contingence. L’idée du suicide est salutaire, car elle est la possibilité toujours offerte d’en finir ; elle maintient jusqu’au dernier instant l’ouverture de ce que Sénèque nomme la « route de la liberté ». Le philosophe, après avoir évoqué les « profès de sagesse » déniant « le droit d’attenter à sa vie », poursuit ainsi sa Lettre 70 à Lucilius : « Parler ainsi c’est ne pas comprendre que l’on ferme la route de la liberté. Un des plus grands bienfaits de l’éternelle loi, c’est que, bornant à un seul moyen l’entrée dans la vie, elle en a multiplié les issues. Attendrai-je la brutalité de la maladie ou celle de l’homme, alors que je suis en mesure de me faire jour à travers les tourments et de balayer les obstacles ? […] Vivre t’agrée : vis donc. Il ne t’agrée pas : libre à toi de t’en retourner d’où tu es venu2. » Porte toujours ouverte, clé de la vraie liberté permettant de dénouer cette tension, « cet effort sans but et sans fin qui constitue la vie même3 », selon les mots de Jean-Marie Guyau. C’est dire, à l’encontre notamment des psychiatres qui ont tendance à considérer que la pensée du suicide est forcément l’indice, sinon d’un total déséquilibre pathologique, tout au moins d’un cerveau enfiévré ou déprimé, que l’on peut sentir calmement, comme Sénèque l’exprime, que le suicide est à sa disposition. Ils n’envisagent pas cette porte de sortie comme telle, lui ôtant tout climat de sérénité, considérant que l’instinct de conservation doit primer et que s’il fait défaut il y a forcément trouble. Veyne écrit dans cet ordre d’idées : « Les psychiatres auront tendance à nier que cette calme disponibilité à la mort existe ; par naturalisme inconscient, ils professent que la vie ne peut vouloir la destruction de la vie, sauf dépression, pathologie, maladie. Mais si ce naturalisme n’était qu’une légende ? S’il existait des gens aptes à se tuer et qui y voient l’échappatoire souveraine, sans que cette idée délectable ait un caractère obsessionnel ? Ils sentent qu’en cas de besoin se tuer sera un soulagement, voire un plaisir sublime : cela leur suffit4. » Il nous importe d’insister sur ce point : l’idée du suicide peut constituer un principe de soulagement essentiel et n’a pas à être réduite à un déséquilibre psychique au nom d’un instinct de conservation supposé 1
Épicure, Sentences vaticanes, in Lettres, maximes, sentences, op. cit., 9, p. 210. Sénèque, Lettres à Lucilius, in op. cit., livre VIII, lettre 70, 14, 15, p. 782. 3 Cité par P. Veyne, Préface, in op. cit., p. CXV. 4 Ibid., p. CXXV. 2
137
HORS DU TEMPS
?
implanté dans l’homme « sain ». Et lorsque Cioran écrit que sans l’idée du suicide, il se serait suicidé depuis longtemps, il ne s’agit pas de provocation ou de pose esthétique, mais de la considération calme de ce principe de soulagement que représente le suicide. Celui-ci peut alors apparaître comme ce recours toujours en vue, évitant de se sentir irrémédiablement coincé et, en cela, comme le signe suprême de la liberté humaine. La pensée suicidaire aide à supporter les orages de la vie puisque, au plus profond de mon accablement, je sais qu’il me reste la liberté d’en finir, de mettre fin à la partie. L’ouverture du suicide est ainsi ce puissant aiguillon de la pensée susceptible d’accompagner et de soutenir à sa façon. C’est suggérer déjà qu’il peut s’avérer en cela le principal motif du non-suicide.
Une affaire de goût « Mais qu’est-ce qu’une existence complète, et que signifie savoir ? – Garder une soif de vie dans les crépuscules… » Cioran, Le Crépuscule des pensées.
Nous avons reconnu dans l’acte suicidaire un droit irréductible et dans le « il faut bien vivre » une formulation creuse. Comment un homme peut-il arriver à ce choix sans retour du suicide ? Précisément parce que la vie humaine n’est pas une simple évidence qui, comme le cycle naturel, se nourrit de sa seule éclosion. La peur de la mort est une chose, au point que la plupart de nos congénères refoulent au plus profond la pensée de la mort ; la quête d’une vie humaine en est une autre, susceptible de faire vaciller la puissance de l’instinct de conservation. C’est, comme nous avons tenté de le rappeler, parce que l’homme ne se réduit pas à la nature qu’il peut en arriver à dépasser sa peur pour se jeter dans la mort. Nombreux sont les hommes qui, tellement tenus par leur instinct de conservation, résistent à tout, préfèrent endosser une vie médiocre plutôt que la mort. Mais d’autres refusent de mourir passivement précisément parce que l’élan humain se brise sur les murs de l’échec1. « Le désir humain de vivre est désir d’une vie humaine ; loin de lui être contraire, le suicide est dans la logique de ce désir2. » C’est en quoi le suicide consacre, selon les mots d’Améry, la déchirure du dit « règlement de la nature » d’après lequel la vie
1
Le suicide est ce privilège humain qui, selon Baechler, met en évidence la dimension illusoire des campagnes de prévention et de dépistage du suicide : « Un point me paraît solidement établi : quel que soit notre avenir, il y aura toujours des suicidés et en proportion à peu près constante. On peut le déplorer, on peut aussi considérer que c’est le tribut que l’homme paie pour sa condition d’homme, que le suicide est une des illustrations de l’humanité. » (J. Baechler, Les Suicides, op. cit., p. 102). 2 M. Conche, Le Fondement de la morale, op. cit., p. 99.
138
HORS DU TEMPS
?
est le bien suprême1, et la possibilité d’y recourir pour l’homme assure une indéniable liberté existentielle. Reste à savoir désormais si la relation anticipée à la mort qui s’instaure dans le tragique implique le suicide. Reprenons alors notre question initiale : prendre acte de l’insignifiance et de la vanité de l’existence conduit-il inévitablement au suicide ? À partir du moment où la mort contamine la vie, la vie appelle-t-elle la mort ? De l’émergence du « pourquoi vivre », issu de la conscience aiguë de sa propre finitude, découle naturellement la pensée du « pourquoi ne pas mourir ? ». Avoir tué en soi les raisons de vivre signifie-til du même coup s’inoculer la mort, mettre fin à son destin, renoncer à sa propre affirmation ? Nous parlons, en conséquence, ici essentiellement du suicide sans motifs matériels, désintéressé, du suicide d’idées, intellectuel ou philosophique, pas de l’acte de se tuer pour échapper à la maladie, à la ruine, à un désespoir amoureux ou en raison, comme l’évoque Cioran, des « horreurs dont l’univers regorge2 ». L’on pourrait presque parler ici, selon les mots de l’auteur, de suicide qui « surgit de rien, sans motif apparent, “sans raison” : le suicide pur3 » se posant comme un défi au destin. Nous avons suggéré déjà que l’idée du suicide peut s’avérer un inestimable soutien. Cioran a posé la question : « Pourquoi je ne me tue pas ? » Précisément parce que je dispose du suicide. Les Syllogismes de l’amertume l’expriment à leur manière : « Je ne vis que parce qu’il est en mon pouvoir de mourir quand bon me semblera : sans l’idée du suicide, je me serais tué depuis toujours4. » Le penseur roumain prononce là, selon nous, des termes déterminants. En ce sens, le suicide est avant tout une idée salvatrice qui, par l’ouverture qu’elle confère, peut dissuader de passer à l’acte : « si je suis encore en vie c’est grâce à cette idée. Je n’ai pu endurer la vie que grâce à elle, elle était mon soutien : “Tu es maître de ta vie, tu peux te tuer quand tu veux”, et toutes mes folies, tous mes excès, c’est ainsi que j’ai pu les supporter. Et peu à peu cette idée a commencé à devenir quelque chose comme Dieu pour un chrétien, un appui ; j’avais un point fixe dans la vie5. » C’est la possibilité de mettre fin à sa vie quand on le souhaite qui rend celle-ci d’autant plus supportable. Implacable logique de l’argument. Mais l’argument n’est pas que logique ; il est aussi la trace d’un cheminement intérieur qui aboutit à la mise au jour de ce point de chute libre qui permet de se maintenir dans l’existence. La capacité de s’autodétruire est le rappel de
1
J. Améry, Porter la main sur soi, op. cit., p. 27. Cioran, Le Mauvais Démiurge, in Œuvres, op. cit., p. 1208. 3 Ibid. 4 Cioran, Syllogismes de l’amertume, in op. cit., p. 775. Voir aussi Le Mauvais Démiurge, in op. cit., p. 1206 : « Combien de fois ne me suis-je pas dit que, sans l’idée du suicide, on se tuerait sur-le-champ ! ». 5 Cioran, Entretien avec Fritz J. Raddatz, in Œuvres, op. cit., p. 1786. 2
139
HORS DU TEMPS
?
cette évidence tout aussi simple qu’essentielle : on ne peut vivre et vivre correctement que si l’on sait que cela peut finir. Ce que Nietzsche exprime à sa façon non sans un certain humour mordant : « La pensée du suicide est une puissante consolation : elle nous aide à passer maintes mauvaises nuits1. » Hermann Hesse montre cela avec force à travers le cas du Loup des steppes. Harry Haller, le « loup des steppes », solitaire et déraciné, exilé en ce monde, ne prenant guère part au festin de la vie, mène la vie d’un « suicidé ». Son « ombrageuse distance », sa vive écorchure, son sentiment d’être égaré parmi les hommes l’amènent au bord de la vie. Le suicide représente sa tentation, « le genre de mort le plus vraisemblable2 » à ses yeux, mais cette ligne de faille, cette « faiblesse apparente », va précisément se transformer en « une force et un appui »3. L’idée du suicide peut ainsi être à la source d’une ténacité en mesure de dissuader du désir d’abréger son existence. « L’idée que le chemin de la mort lui était accessible à n’importe quel moment, il en fit, comme des milliers de ses semblables, non seulement un jeu d’imagination d’adolescent mélancolique, mais un appui et une consolation. […] Il existe beaucoup de suicidés qui puisent dans cette idée des forces extraordinaires4. » Ressort du même coup ici toute l’importance de la confrontation personnelle avec cette question. De même que l’idée du suicide, comme le fait d’écrire et de s’exprimer dessus, a souvent comme conséquence de dissuader du désir de se supprimer – « Comme si parler du suicide servait en même temps à l’exorciser5 » –, à l’inverse, celui qui ne s’est jamais confronté à cette idée basculera d’autant plus facilement – « Celui qui n’a jamais envisagé de se tuer s’y décidera bien plus promptement que celui qui ne cesse d’y penser6. » L’exemple de Cioran est des plus emblématiques. Comme l’écrit George Balan, « il était traversé par toutes les angoisses imaginables, et si on inventorie ses réflexions sur la mort, on ne peut pas se retenir de penser qu’il détient, très probablement, le record du désir de s’éteindre et, qui plus est, comme composante d’une vision profondément tragique du destin humain7 ». Mais précisément, l’intimité avec la mort, avec
1
F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, op. cit., § 157, p. 102. H. Hesse, Le Loup des steppes, op. cit., « Traité du loup des steppes », p. 13. 3 Ibid., p. 15. 4 Ibid., p. 15-16. 5 G. Minois, Histoire du suicide, op. cit., p. 112. 6 Cioran, Le Mauvais Démiurge, in op. cit., p. 1207. Et Cioran poursuit : « Tout acte crucial étant plus facile à accomplir par irréflexion que par examen, l’esprit vierge de suicide, une fois qu’il s’y sent poussé, n’aura aucune défense contre cette impulsion subite ; il sera aveuglé et secoué par la révélation d’une issue définitive, qu’il n’avait pas considérée auparavant ; – alors que l’autre pourra toujours retarder un geste qu’il a indéfiniment pesé et repesé, qu’il connaît à fond et auquel il se résoudra sans passion, s’il s’y résout jamais. » 7 G. Balan, Emil Cioran, Josette Lyon, « Les maîtres à penser du XXe siècle », 2003, p. 42. 2
140
HORS DU TEMPS
?
l’idée de sa propre mort, peut devenir une source de vitalité. Grâce à la réflexion qu’elle engendre, l’idée du suicide peut s’avérer alors un appui essentiel, parvenant, à défaut d’un sens, à donner du prix à la vie. Quels sont, à partir de là, d’un point de vue intellectuel, les éléments susceptibles d’amener à ce refus du suicide ? Se suicider pourrait apparaître comme la solution, sinon la plus souhaitable, du moins la plus logique, la réponse à la gratuité de l’existence par l’acte capable de se poser comme un défi au destin. Pourtant, nous le suggérions au départ de notre réflexion, le fait de rester dans la proximité de la mort, ne signifie pas se faire l’apôtre d’un raisonnement négateur qui conduirait au suicide effectif. Car cette autodestruction serait-elle l’aveu d’un tragique accompli ou bien cette extraction du temps serait-elle une esquive ? Zarathoustra vante la mort libre, voulue, parce que l’on estime qu’« il est temps ». Il s’agit de savoir mourir à temps, parce que la mort ainsi entendue scelle l’accomplissement d’un destin, non la défaite d’une vie flétrie qui laisse la place à la « mort grimaçante, qui se glisse comme une voleuse1 ». Mais, pour cela, Zarathoustra prononce un autre appel : « Puissent venir prêcheurs de prompte mort ! Sur les arbres de la vie ils seraient pour moi les justes tempêtes et les justes secoueurs ! Mais je n’entends prêcher que lente mort et que patience pour tout le “terrestre”2. » La patience préconisée par Zarathoustra a des choses à dire : elle rappelle que si la mort volontaire peut s’avérer une façon de clore un parcours d’existence, encore faut-il, pour que cette clôture soit pertinente, que ce parcours en soit un. Clore son destin suppose un affrontement préalable, la tentative de vivre sa vie pleinement. Mourir ainsi suppose d’être en mesure de faire un « bilan » de sa vie, donc d’avoir vécu au sens plein du terme. « Mourir fièrement lorsqu’il n’est plus possible de vivre fièrement. La mort choisie librement, la mort en temps voulu, avec lucidité et d’un cœur joyeux, accomplie au milieu d’enfants et de témoins, alors qu’un adieu réel est encore possible, alors que celui qui nous quitte existe encore et qu’il est véritablement capable d’évaluer ce qu’il a voulu, ce qu’il a atteint, de récapituler sa vie3. » C’est dire, une fois de plus, que reconnaître le suicide comme mort légitime ne signifie pas le prôner pour autant sans autres considérations. Nietzsche, en évoquant cet « art difficile de partir à temps », proche en cela du « moment opportun » des stoïciens, parle de savoir prendre congé à
1
F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. M. de Gandillac, op. cit., « De la libre mort », p. 96. Voir aussi « Le voyageur et son ombre », Humain, trop humain, II, op. cit., § 185, p. 258. 2 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. M. de Gandillac, op. cit., « De la libre mort », p. 96-97. 3 F. Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, op. cit., « Flâneries inactuelles », § 36, p. 151-152. Voir aussi, Humain, trop humain, I, Gallimard, « Folio essais », 1987, § 80, p. 84-85.
141
HORS DU TEMPS
?
temps, non de se précipiter au plus vite dans la mort. Aussi ne fait-il pas une révérence au suicide en tant que tel. Si cette mort, dans notre perspective, peut apparaître, comme aux yeux du « loup des steppes », un genre de mort très vraisemblable, elle n’est pas pour autant recherchée en elle-même. Jaccard écrit à propos de son rejet de l’acte suicidaire : « Parce que la vie est une maladie dont j’ai renoncé à guérir1. » La vie comme maladie, signifiant que, d’une certaine façon, on se suicide toujours trop tard et que le suicide s’avère une fausse solution à la tragédie de l’existence. À la source du maintien dans l’existence, il y a cette conscience que le suicide ne résout rien : « Il n’existe pas d’issue à la souffrance tant qu’on vit ; mais la mort n’est pas une solution, puisqu’en résolvant tout, elle ne résout rien2. » En nous déchargeant du poids de notre finitude, la mort volontaire n’abolit pas pour autant le tragique de la condition humaine. L’on peut dès lors considérer, avec Dastur, que le suicide, et le sentiment de toute puissance qu’il peut susciter, est aux antipodes d’une véritable assomption de la finitude, dans la mesure où il s’inscrit dans les tentatives de neutralisation de la mort3. Fausse solution que ce défi lancé à la mort, puisqu’il est paradoxalement une manœuvre, une stratégie pour y échapper. Se situer ainsi hors du temps n’entamerait en rien notre condition de mortel, notre soumission intrinsèque à la mort. C’est dire que la liberté intérieure que confère l’idée du suicide n’acquiert toute sa dignité que si elle en reste une. En ce sens, le suicide est avant tout cette idée salvatrice, qui n’acquiert une réelle valeur qu’en tant que telle. Aussi, le passage à l’acte démentirait-il le degré de lucidité que la pensée tragique permet d’atteindre, nous révélant à nous-même comme cet être vivant en suspens dans le néant. Le suicide ne peut guère apparaître comme « solution » aux yeux de celui qui a rompu les attaches sensées à la vie. Et l’on saisit la portée des mots de Cioran qui, dans les Syllogismes de l’amertume, fait observer que le suicide en son fond n’est pas un geste pessimiste : « Ne se suicident que les optimistes, les optimistes qui ne peuvent plus l’être. Les autres, n’ayant aucune raison de vivre, pourquoi en auraient-ils de mourir4 ? » En ce sens, l’on peut comprendre Schopenhauer lorsqu’il estime que le suicide peut incarner une ruse de la vie, entérinant l’attachement au vouloir-vivre. Le suicidant ne cesse pas au fond de vouloir la vie, ce sont les conditions dans lesquelles il vit qu’il rejette5. Le philosophe nuance cependant son propos en établissant une distinction entre le suicide par inanition, lui semblant seul 1
R. Jaccard, Texte inédit, in Dictionnaire insolite, Zulma, « Grain d’orage », 1998, « 20 raisons de ne pas me suicider », 18, p. 29. 2 Cioran, Le Livre des leurres, in Œuvres, op. cit., p. 123. 3 F. Dastur, Comment affronter la mort ?, op. cit., p. 58. 4 Cioran, Syllogismes de l’amertume, in op. cit., p. 783-784. 5 Le Monde…, chap. 69, p. 499.
142
HORS DU TEMPS
?
traduire une négation du vouloir-vivre, et le suicide « ordinaire », révélant plutôt un désir de vivre1. À ce titre, il exprime une protestation du vouloirvivre contre les douleurs de la vie. L’homme se tue le plus souvent paradoxalement parce qu’il voudrait vivre. « Par suite, écrit-il, en détruisant son corps, ce n’est pas au vouloirvivre, c’est simplement à la vie qu’il renonce2. » Le suicide, comme nous avons tenté de le mettre en évidence, n’entre pas en contradiction avec le désir humain, il est, pour reprendre l’expression de Baechler, « le tribut que l’homme paie pour sa condition d’homme3 ». De quoi rappeler que le suicide participe de la logique même de la quête d’une vie humaine qui, se sentant entravée dans son effort, n’admet pas sa souffrance et retourne son énergie contre elle-même. Illustration de la tentative d’inscrire le sens humain escompté, de constituer une existence répondant à ce désir, non réductible donc à la seule logique vitale et capable de conduire à cette logique illogique de la mort. On songe à cette réflexion de Primo Levi, alors qu’il était acculé au pire, brisé dans son humanité, anéanti physiquement et moralement par la sauvagerie nazie : « De ma vie d’alors il ne me reste plus aujourd’hui que la force d’endurer la faim et le froid ; je ne suis plus assez vivant pour être capable de me supprimer4. » Il faut être suffisamment « vivant », en possession de son humanité, pour envisager de mettre fin à ses jours. Ce n’est que lorsque Levi aura retrouvé sa figure humaine et sa capacité d’analyse, lui permettant de nourrir une réflexion sur l’horreur qu’il a été contraint d’endurer, qu’il en viendra, comme l’on sait, à se suicider. Nous avons suffisamment insisté là-dessus : la signification et l’intentionnalité de l’acte suicidaire sont très variables et échappent bien souvent dans leur complexité. Celui-ci garde toujours sa dimension mystérieuse et éminemment singulière, impliquant qu’il n’y a, en la matière, aucune certitude. Il n’en reste pas moins, si l’on tente d’ouvrir quelque piste de réflexion, que l’appréhension de l’autodestruction comme seule visée de la mort est beaucoup trop restrictive. L’intentionnalité du suicide n’est pas seulement la mort, dans la mesure où peut s’y glisser une certaine croyance dans la fin de la vie comme « solution5 ». Paul-Louis Landsberg écrit : « L’acte du suicide n’exprime pas le désespoir, me paraît-il, mais une espérance, peut-être folle et déviée, qui
1
Ibid., p. 502. Ibid., p. 499. 3 J. Baechler, Les Suicides, op. cit., p. 102. 4 P. Levi, Si c’est un homme, Pocket, 1988, p. 153. Nous soulignons. 5 Kleist lui-même semblait voir dans l’acte de se suicider le moyen de se réconcilier avec le monde, de répondre à sa soif d’absolu : « La vérité, c’est qu’on ne pouvait pas m’aider sur terre », écrivait-il à Ulrike. (L. Richard, « Kleist : un désir d’absolu », Magazine Littéraire, « Les suicidés de la littérature », n°256, juillet – août 1988, p. 23). 2
143
HORS DU TEMPS
?
s’adresse à la grande région inconnue au-delà de la mort. J’oserai le paradoxe : l’homme se tue souvent parce qu’il ne peut et ne veut pas désespérer1. » Ces mots nous paraissent essentiels, laissant entendre, dans nombre d’actes suicidaires, l’écho de la quête d’un ailleurs, guidé par un certain optimisme. Ainsi correspond-il, paradoxalement et fréquemment, à une forme d’affirmation de la vie. Sans doute faut-il apporter un bémol, préciser en tout cas ce que le terme « affirmation » peut signifier dans ce contexte. Il peut paraître, en effet, exagéré de parler d’« affirmation » si l’on veut bien toujours songer à ce flottement entre la vie et la mort de la détresse humaine en passe d’accomplir le geste suicidaire. Le découragement, les poumons qui se dégonflent, le fait d’en avoir assez de son humiliation, de sa souffrance, l’envie que « ça cesse »… Mais cet essoufflement, cette vie poussée à bout, ce dégoût imprimant la mort donnée en connaissance de cause, n’est pas contradictoire, nous l’avons vu, avec le désir humain nourri d’attente de la réalisation d’un certain nombre de promesses capables d’éviter le court-circuit suicidaire. Et, pour nombre d’individus, on pourra deviner à la racine de leur acte un espoir tenace en cette vie, au point d’en arriver à la quitter, comme ces propos de Morand le laissent entendre : « être dégoûté de la vie, c’est encore avoir foi en elle, c’est la croire une fête unique, à laquelle on n’a pas été invité, une table splendidement dressée d’où l’on a été chassé ayant faim. C’est pourquoi le suicide n’est jamais plus fréquent qu’aux époques où l’on croit au bonheur2. » Ces mots ont une résonance d’autant plus forte aujourd’hui. Ainsi l’époque contemporaine – qui dans les sociétés occidentales meurt de se gargariser du bonheur –, est des plus emblématiques à cet égard, puisqu’on y enregistre un taux de suicide élevé. Et, au-delà des époques, on se tue généralement plus en temps de paix qu’en temps de guerre, dans les pays prospères que dans les pays pauvres, même si la part la plus importante des suicides dans les pays développés émane des couches modestes de la population, c’est-à-dire dans les moments et dans les lieux où la vie peut apparaître comme cette « table splendidement dressée d’où l’on a été chassé ayant faim ». Ainsi peut-on estimer, au-delà de la pluralité des suicides, que ce sont en effet bien souvent les optimistes qui se suicident, en tout cas ceux qui « étaient assurés du sens de la vie3 ». Rappelons les mots de Cioran : « Les autres, n’ayant aucune raison de vivre, pourquoi en auraient-ils de mourir ? » À partir du moment où l’on n’entretient plus d’illusion sur l’existence d’une solution à l’insignifiance de la vie, s’annulent du même coup en soi les raisons d’en finir. Se suicider, ce serait sans doute accorder encore trop d’importance à la vie ; ce serait la 1
P.-L. Landsberg, Le Problème moral du suicide, in Essai sur l’expérience de la mort et Le Problème moral du suicide, Seuil, « Points Sagesses », 1993, p. 125. Nous soulignons. 2 P. Morand, L’Art de mourir, op. cit., p. 21. 3 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 20.
144
HORS DU TEMPS
?
prendre terriblement au sérieux en lui accordant une valorisation illusoire au point de se sacrifier en son nom. Mais l’on nous dira encore qu’il faut un sens et que si celui-ci fait défaut, la vie est invivable. Le tragique a rendu l’existence à son insignifiance, à sa gratuité. Va-t-on pour cela se suicider ? Si le suicide n’est pas une solution au problème métaphysique de la vie, la vie exige-t-elle, cependant, pour se maintenir qu’on lui découvre un sens ? Estimer que l’on ne sort pas de l’insensé, malgré tous les îlots de sens que l’on se donne temporairement, ramène-t-il forcément au suicide ? Le lien communément admis entre ce qui peut donner sens à notre vie et maintien dans la vie ne nous paraît pas déterminant. Nous pouvons même aller jusqu’à considérer que c’est le non-sens absolu de l’existence qui fournit une raison d’exister : « Le fait que la vie n’ait aucun sens est une raison de vivre, la seule du reste1. » Reste le pur fait de vivre dans son évidence crue. Reste l’acte de marcher sur le fil tranchant du temps, invitant à une acceptation concrète de l’existence, de sa dimension insensée. C’est pourquoi le raisonnement de Camus dans Le mythe de Sisyphe s’avère à première vue paradoxal lorsqu’il relie, au début de sa réflexion, l’acte de se suicider au fait d’estimer si la vie vaut ou non la peine d’être vécue en fonction du sens que l’on peut lui attribuer : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie. […] Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions2. » Nous ne vivons pas en effet forcément parce que nous estimons pouvoir attribuer un caractère sensé à notre trajet d’existence. Et dans notre perspective, c’est tout l’inverse qui se produit. Camus ne manque pas d’ailleurs, au fil de son raisonnement, d’apporter une rectification : « Ce n’est pas en vain qu’on a jusqu’ici joué sur les mots et feint de croire que refuser un sens à la vie conduit forcément à déclarer qu’elle ne vaut pas la peine d’être vécue. En vérité il n’y a aucune commune mesure forcée entre ces deux jugements3. » Il ne s’agit donc pas de rechercher la grâce d’une valeur qui vienne justifier notre existence. Le refus de reconnaître un sens valable à celle-ci n’implique pas logiquement la décision de se donner la mort. Pas de commune mesure entre le refus de la mort volontaire et les raisons de vivre, entre l’acceptation de l’existence et le fait de lui reconnaître un sens. C’est suggérer déjà que le tragique de l’existence peut être assumé. Vivre sous cet horizon, c’est alors accepter le tragique de la condition humaine sans chercher à se leurrer ou à sa dérober. Posture qui permet alors d’écrire :
1
Cioran, Aveux et Anathèmes, in op. cit., p. 1667. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 17-18. 3 Ibid., p. 21. 2
145
HORS DU TEMPS
?
« Par le seul jeu de la conscience, je transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort – et je refuse le suicide1. » À la tentation de l’anéantissement répond, selon les mots de Cioran, « la tentation d’exister2 ». Précisément, le fait d’avoir ce recours et de ne pas en user révèle non un attachement persistant à la vie au sens d’un simple instinct de survie, d’un attachement viscéral, mais plutôt la capacité à lui trouver encore quelque saveur. « À ce très vieil ami qui m’annonce sa décision de mettre fin à ses jours, je réponds qu’il ne fallait pas trop se presser, que la dernière partie du jeu ne manque pas complètement d’attrait, et qu’on peut s’arranger même avec l’intolérable, à condition de ne jamais oublier que tout est bluff, bluff générateur de supplices3… » De la dimension corrosive de ces mots de Cioran, ressort ceci que le sens de sa propre dérision peut être à la source d’une certaine ténacité. La tentation du suicide et le questionnement sur cette tentation, couplés à la conscience de la gratuité de notre cheminement, peuvent ramener à la surface cette saveur persistante. Cela peut paraître profondément paradoxal : nous mettons en évidence une conception de l’existence qui n’est aucunement de nature à stimuler l’appétit de vivre. Mais, tout démolir et décider de considérer son sort en face n’empêche pas de rester attaché aux débris. C’est dire, au-delà de ce cheminement de pensée, de cette conscience, que le fait de poursuivre, malgré tout, son existence sous l’horizon du tragique n’est pas affaire de raison. « Cela veut dire que le choix de la vie, de préférence à la mort, ne peut aucunement être fondé. Mais alors pourquoi affirmer la vie ? Simplement par vitalité4. » Aspect que Beckett n’a pas manqué de relever à sa façon. En effet, si presque tous ses personnages envisagent le suicide, ils ne passent pourtant pas à l’acte. Et ce, précisément, sans fournir une quelconque justification, sans énoncer ce qui les retient5. Quelque chose persiste encore, les maintenant dans le flux de l’existence. La souffrance est là, palpable, dégoulinant des mots, s’échappant des répliques en des appels angoissés. La tentation d’y mettre fin est présente et pourtant le geste n’est pas accompli. Expression d’une ténacité persistante que traduisent selon nous au plus juste ces mots de l’écrivain à la fin de L’Innommable : « je ne peux pas continuer, je vais continuer6 ».
1
Ibid., p. 69. Cioran, rappelons-le, a écrit un ouvrage portant ce titre. 3 Cioran, Aveux et Anathèmes, in op. cit., p. 1708. 4 M. Conche, « La sagesse tragique », Orientation philosophique, op. cit., p. 181. 5 Ce à quoi ces mots de Cioran peuvent faire écho : « Pourquoi je ne me tue pas ? – Si je savais exactement ce qui m’en empêche, je n’aurais plus de questions à me poser puisque j’aurais répondu à toutes. » (Cioran, Le Mauvais Démiurge, in op. cit., p. 1214). 6 S. Beckett, L’Innommable, op. cit., p. 213. 2
146
HORS DU TEMPS
?
De la noirceur, d’une lucidité qui n’ouvre pas de porte à l’espoir, peut s’extraire une force à la fois inspiratrice et source d’énergie, invitation à absorber la souffrance, à assumer notre propre mortalité dont il nous faudra définir les modalités. Plus réfléchi que ses semblables dont il observe l’agitation, triste et lucide, délicat et sensible, éprouvant toute « l’ambiguïté de la vie humaine1 », Harry est parfois prêt à vaciller, traverse de puissantes tempêtes intérieures, mais ne se supprime pourtant pas : « il entend vivre derrière les vitres le monde et les humains, se sait exclu, mais ne se tue pas, car un reste de foi lui dit qu’il lui faut absorber jusqu’à la lie cette souffrance, cette souffrance empoisonnée qui est dans son cœur, et que c’est d’elle, de cette souffrance, qu’il lui faut mourir2 ». Le rejet de l’acte suicidaire révèle sans doute en dernière instance, outre une vitalité persistante, la capacité à garder sa curiosité3, n’abhorrant pas suffisamment la vie pour y mettre fin, sans omettre pour autant la morsure de notre finitude. Ainsi ces mots de Cioran dans Aveux et Anathèmes : « Se débarrasser de la vie, c’est se priver du bonheur de s’en moquer. Unique réponse possible à quelqu’un qui vous annonce son intention d’en finir4. » Précisément, l’intimité avec la mort en offrant le sens aigu de sa propre dérision, peut s’avérer une source profonde, non seulement d’énergie vitale, mais aussi très certainement – nous y reviendrons – de créativité. C’est dire que si persiste une lumière intérieure, même infime, capable de stimuler une curiosité, de faire émerger l’humour et de préserver quelque joie intime, elle est susceptible de s’opposer comme un rempart contre la tentation suicidaire. Vitalité, curiosité, sens de sa propre dérision et l’humour qui peut s’y associer5, autant de termes traduisant un climat susceptible d’accueillir sans doute une importante veine créative et, en tout cas, un goût incitant à poursuivre notre marche insensée. De même que le tragique, à travers la considération du souffrir et de la détresse humaine, nous enseigne que si l’on en reste à la seule logique de la vie on ne peut rien exprimer de sensé sur le suicide, il nous révèle qu’il n’y a pas non plus de logique totale de la mort. Ainsi peut-on estimer qu’un pur suicide philosophique, c’est-à-dire motivé par la seule réflexion 1
H. Hesse, Le Loup des steppes, op. cit., Préface de l’éditeur, p. 31. Ibid., p. 28-29. 3 « Ce qui m’attache encore aux choses, c’est une soif héritée d’ancêtres qui ont poussé la curiosité d’exister jusqu’à l’ignominie. » (nous soulignons) (Cioran, Aveux et Anathèmes, in op. cit., p. 1660). 4 Ibid., p. 1670. 5 Humour dont la vivacité peut amener un penseur comme Cioran à écrire : « Vivre est une impossibilité dont je n’ai cessé de prendre conscience, jour après jour, pendant, disons, quarante ans… » (Cioran, Le Mauvais Démiurge, in op. cit., p. 1237) ou encore : « Réfutation du suicide : n’est-il pas inélégant d’abandonner un monde qui s’est mis si volontiers au service de notre tristesse ? » (Cioran, Syllogismes de l’amertume, in op. cit., p. 783). 2
147
HORS DU TEMPS
?
intellectuelle, n’existe pas. « En réalité, écrit Minois, on ne se tue pas par pur raisonnement ; seule une machine est capable de s’autodétruire au bout d’un calcul1. » On trouve toujours un mélange complexe d’éléments rationnels et passionnels signifiant qu’il n’y a pas, à proprement parler, de suicide philosophique : « Aucun suicide ne procède uniquement d’une réflexion sur l’inutilité du monde ou sur le néant de la vie2. » Si cette réflexion est déterminante et peut être à l’origine d’un questionnement suicidaire, le passage à l’acte n’en dépend plus directement. On ne met pas froidement fin à sa vie en l’absence de motifs passionnels. Il y a l’impulsion hors de toute « raison » qui aboutit au suicide, impliquant que la dimension organique ne peut jamais être évacuée. Il s’agit, comme l’écrit Cioran, d’un acte qui se décide hors du champ de la seule raison : « Il n’y a pas, à vrai dire, de volonté ou de décision rationnelle de se suicider, mais seulement des déterminants organiques et intimes qui vous y prédestinent3. » C’est dire qu’au-delà de tout motif rationnel, le suicidaire a un « penchant pathologique » pour la mort qu’il ne peut annihiler, précisément parce que l’emportent les ondes d’un effondrement interne. Importe ainsi dans le suicide « le fait de ne plus pouvoir vivre, qui dérive non d’un caprice mais de la tragédie intérieure la plus effroyable4 ». Inaptitude à poursuivre l’exercice de la vie, épuisement, usure, déséquilibre vital trop grand, vie à bout d’énergie, hors donc de la seule raison de passer à l’acte. Aussi, au bout du compte, paraît-il primordial de rappeler que l’on ne se suicide pas uniquement au nom d’un raisonnement. Si le suicide, comme le reconnaît Baechler, est avant tout rationnel5, – les fous ne se suicident pas –, incarnant à sa façon la solution à un problème, on ne met pas fin à sa vie pour des raisons seulement intellectuelles. Au point que profondément convaincu de l’insignifiance de notre cheminement, un individu peut rester en vie. Ce que ceux que Cioran appelle les « abrutis » ne saisissent généralement pas. « Réfléchir longuement sur la mort ou sur d’autres questions angoissantes porte à la vie un coup plus ou moins décisif, mais il n’en est pas moins vrai que ce genre de tourment ne peut affecter qu’un être déjà atteint. Les hommes ne se suicident jamais pour des raisons extérieures, mais à cause d’un déséquilibre interne, organique. Les mêmes événements laissent certains indifférents, marquent les autres, et poussent d’autres encore au
1
G. Minois, Histoire du suicide, op. cit., p. 308. Cioran, Sur les cimes du désespoir, in Œuvres, op. cit., p. 55. 3 Ibid. 4 Ibid., p. 56. 5 « […] le suicide est un acte positif, qui suppose une capacité minimale à combiner des pensées et des gestes ; là où la conscience s’est dissoute, on ne trouve pas de suicide. » (J. Baechler, Les Suicides, op. cit., p. 111). 2
148
HORS DU TEMPS
?
suicide. Pour arriver à l’obsession du suicide, il faut tant de tourment, tant de supplice, un effondrement des barrières intérieures si violent que la vie n’est plus qu’une sinistre agitation, un vertige, un tourbillon tragique1. » La vie est à la fois pour soi-même ce bien précieux que je possède pour déployer mon existence propre et ce bien tout relatif puisque le lieu même de la souffrance. À chacun donc de chercher à le préserver ou, à l’inverse, s’il devient cette charge trop lourde à porter, de s’en défaire par le suicide. Jamais de réponse définitive pour chacun, auquel il revient de se déterminer en fonction de sa situation et de sa complexion personnelle. Ce cheminement dans les allées du suicide nous a permis, en tout cas, de reconnaître combien les menaces intérieures peuvent peser lourd, s’avérer incitatives, s’agissant de notre maintien en vie. Elles surgissent en nous, font effraction et peuvent s’installer de façon à faire vaciller notre appréhension du dépôt de cette vie. La vision tragique est d’autant plus proche de cette vacillation qu’elle perçoit la fragilité de notre parcours existentiel. La traversée ou non de ces pôles de destruction est entre les mains de chacun. Une question, sans doute, de la persistance de certains termes, tels que vitalité, curiosité imprimant la volonté de poursuivre le questionnement sur ce trajet, et indéniablement humour et capacité de réjouissance. Une affaire de goût très certainement…
1
Cioran, Sur les cimes du désespoir, in op. cit., p. 55-56.
149
HORS DU TEMPS
?
II. La passion du possible ? « Être seul et sans dieux, voilà la mort. » Hölderlin, Empédocle.
La dépendance de la pensée à l’égard de l’existence a eu pour conséquence de creuser le trou de l’insignifiance et de déporter notre réflexion loin de la métaphysique et de l’ontologie. Mais si l’on se place sur un plan davantage affectif et émotionnel qu’intellectuel, une telle déportation peut-elle maintenir, malgré tout, l’invitation à se tourner vers la religion ? Le monde de l’insignifiance ne peut-il trouver une échappée de l’autre côté du temps ? Trouvera-t-on un envers du temps qui serait l’éternité ? Au pôle tourmenté et souffrant, alimenté par l’horizon de notre finitude, notre vie estelle susceptible d’en associer un autre, celui-ci à la fois solide et lumineux, placé sous le sceau de l’éternité ? La mort peut-elle s’affirmer comme unité de la finitude temporelle et de l’aspiration à l’éternité ? L’Ici-bas et l’Au-delà : la question métaphysique de la survivance après la mort se pose dessinant l’autre versant ontologique du mourir. La mort estelle notre destin ultime, ou bien n’est-elle qu’un passage vers une forme autre de la vie, ainsi que nous l’enseignent les diverses religions ? Au-delà de notre mourir intime, tout ne peut-il rester arrimé à l’espoir de survivre ? Non pas seulement l’espoir donc, mais l’espérance dont la portée est de s’extraire des désirs mondains et de tendre hors des séquences du temps. L’espérance religieuse se présente, prétendant qu’il peut y avoir un lendemain, un autre futur. Avenir suprême qui abolirait tous les autres destinés à s’échouer. Ici la consolation cherche un sentier, la promesse d’un Autre ordre.
La pente de l’éternité Chemin de consolation. La disparition totale de son propre être est cette énigme devant laquelle la raison humaine se sent désarmée. La mort est cette échéance à laquelle je ne puis échapper et qui, pourtant, en tant qu’événement ne m’arrivera jamais, puisque je ne serai plus là pour y assister. L’on sait qu’Épicure trouvait là un puissant motif de dédramatisation, précisément parce qu’il s’arrimait à la mort comme événement futur et évacuait de son raisonnement celle-ci comme dimension fondamentale de l’exister. Mais, comme nous avons essayé de le montrer, cette impossibilité d’accueillir la mort en tant que telle, le fait qu’elle ne puisse à proprement parler être vécue et que je ne puisse penser ma mort, 150
HORS DU TEMPS
?
n’enlève rien à son imminence et ne permet donc pas, pour autant, de la réduire à un événement marquant la limitation externe de notre existence. Je n’existe qu’en tant que je suis exposé à la mort à chaque instant. Nous avons vu que l’angoisse, en particulier, nous ouvre à cette dimension fondamentale et nous révèle que l’on n’accède à l’humanité qu’à travers la conscience de sa propre mortalité. Et si bon nombre d’hommes contournent autant que possible la traversée de l’angoisse pour étouffer cette conscience de leur finitude, ils n’en sont pas moins confrontés à la mort des autres, en particulier à celle de leurs proches et à la déchirure intime et extrême qu’elle peut représenter. L’expérience du deuil constitue l’expérience première. Or cette mort de l’autre ne nous atteint pas seulement parce que nous ne partagerons plus de moments ensemble, mais aussi parce qu’elle réveille en nous cette conscience latente de notre mortalité profonde qui constitue la part obscure de notre existence. « Car, écrit Dastur, l’homme ne parvient à la conscience de soi qu’à travers l’angoisse de la mort et c’est celle-ci qui se voit à chaque fois ravivée par la mort d’autrui1. » Que cela soit le plus souvent suivi d’une intériorisation minimale est une donnée manifeste – le divertissement ne lâche pas prise facilement. Cette fuite révèle combien la mort est objet d’épouvante et il semble que l’on ne puisse guère l’affronter par la pensée que dans la mesure où l’on parvient à la relativiser. L’existence humaine ne peut, en conséquence, pleinement se déployer sans combat mené contre la mort et, à ce titre, l’ensemble des productions culturelles de l’humanité peut être perçu comme autant de dispositifs de défense destinés à tenir la mort à distance. Un combat pourtant vain, puisque la mort ne saurait rater ses rendez-vous et finit toujours par l’emporter. Rappel de l’ambivalence essentielle envers notre finitude : la conscience du caractère éphémère de notre condition, un « se-savoir » mortel, couplé à un refus d’inscrire notre existence dans ces étroites limites, à la source d’une certaine relativisation de notre mortalité. Mais il est différentes façons de mener ce combat, depuis le déploiement de l’esprit, à la source de l’art, de la philosophie, de la science, de tout processus culturel et de la transmission du savoir qu’il entend assurer d’une génération à l’autre, témoignant d’une capacité de dépassement des limites de la seule corporéité, jusqu’à la conviction intime que l’on peut surmonter définitivement la mort. Et c’est là que la pente religieuse trouve son élan, depuis les pratiques funéraires qui témoignent de l’existence de rites et de croyances archaïques véhiculant une expérience collective du sacré, jusqu’aux religions instituées. Que pouvons-nous lire dans cette soif d’éternité ? À quels besoins répond-elle ? Quelle portée est-il possible de lui reconnaître ?
1
F. Dastur, Comment affronter la mort ?, op. cit., p. 8.
151
HORS DU TEMPS
?
Considérons d’abord la pratique des rites funéraires. L’homme enterre ses morts. Plus que l’usage des outils ou l’invention du langage, l’on peut estimer que les rites funéraires sont la caractérisation même de l’accession à l’humanité1. Éventail de pratiques – inhumation, momification, crémation, exposition des morts – qui vont contre l’abandon du cadavre à l’œuvre de la nature. Autant de gestes, de soins, de mises en scène qui marquent l’avènement de la culture, dans la mesure où cela témoigne du refus de se soumettre au seul ordre naturel, au cycle de la vie et de la mort qui régit tous les vivants. Gestes qui demeurent symboliques puisqu’il reste impossible de s’opposer à l’irréversible, mais qui témoignent du rapport ambigu à la mort propre aux êtres humains, constitué tout à la fois de reconnaissance et de déni. Reconnaissance dans la mesure où le rite funéraire est une façon de prendre acte de la disparition du défunt, de celui qui est parvenu au terme de son existence. Ce que le mot « défunt », issu du terme latin defunctus, signifie clairement2. Le défunt désigne celui qui « a accompli sa vie », en a fini avec elle et, en conséquence, le « mort ». Le rite autorise, par ailleurs, la constitution d’une mémoire collective : le traitement qu’il offre au cadavre fait qu’il n’est plus alors seulement cette dépouille inquiétante, dont la corruption manifeste, le statut intermédiaire entre la personne et la chose, sont perçus bien souvent comme source de pollution et potentiellement générateur d’angoisses. Qu’il soit momifié, brûlé, enterré, rejeté loin des vivants, la visée est, comme l’explicite Louis-Vincent Thomas, « de fixer le devenir du cadavre3 », de composer avec le pourrissement inexorable du corps et l’horreur que celui-ci inspire. « Plus encore, […] il s’agit de ritualiser la rupture qu’est la mort pour la rendre supportable4. » Le rite funéraire libère alors le défunt de cet étrange statut en le mettant à l’écart des vivants. Une culture ne peut donc être telle que si elle est une culture de la mort. La perte de l’autre étant attestée publiquement, le rite est une façon de reconnaître sa mort comme une donnée de fait irrécusable et, partant, son absence définitive. Mais c’est cela même qui autorise, du même coup, la constitution d’une mémoire familiale ou collective. Le traitement du cadavre et sa mise à l’écart vont, en effet, de pair avec la volonté « de trouver une 1 Les données préhistoriques récentes semblent le confirmer. Voir notamment R. Leakey, L’Origine de l’Humanité, Hachette Littératures, 1997. D’après l’auteur, l’on peut estimer que les sépultures apparurent de façon presque certaine à l’époque de Néandertal, mais ne prirent des formes plus raffinées (dépôt d’objets dans les tombeaux) qu’au cours du Paléolithique supérieur (p. 161). Le premier enterrement volontaire dont on ait des traces est un enterrement d’homme de Néandertal, pratiqué il y a un peu plus de 100 000 ans (p. 195). 2 Defuns 1243 ; lat. defunctus, p. p. de defungi « accomplir sa vie » (Dictionnaire Le Robert). 3 L.-V. Thomas, Le Cadavre. De la biologie à l’anthropologie, Éditions Complexe, « De la science », 1980, p. 10. 4 Ibid.
152
HORS DU TEMPS
?
possibilité de renouer avec le disparu le rapport brutalement interrompu par la mort1 ». D’où le déni susceptible de se dessiner, puisque le rite entend généralement accéder à un nouveau mode de rapport avec le trépassé qui, dans cette perspective, continue d’exister dans l’au-delà. La quête de l’éternité se profile ici, ainsi qu’en témoigne le langage mis en œuvre. Les termes de « décès » et de « trépas » généralement employés pour désigner la mort sont plus qu’éloquents. Celle-ci est, à ce titre, considérée comme un départ vers un ailleurs ou comme un passage à une autre forme d’existence. Tentative ultime d’apaiser l’angoisse de l’homme, le rite du deuil s’emploie à circonscrire la figure de la mort. Il autorise l’établissement d’un rapport désormais spirituel avec le disparu qui peut trouver place dans l’enchaînement des générations, survivant, un certain temps au moins, dans la mémoire des autres. C’est précisément ce en quoi la communauté humaine se noue tout autant avec nos prédécesseurs qu’avec nos contemporains. C’est là qu’elle trouve son ciment culturel. Ainsi parlera-t-on de l’« esprit » des ancêtres et s’appuiera-t-on sur la transmission que cela autorise. Mais, on le voit, depuis la constitution d’une mémoire des survivants assurant la continuité du groupe social, peut émerger le sentiment qu’il reste quelque chose d’invisible mais de solide, une « âme » du défunt qui semble dépasser l’individu empirique. La croyance en l’immortalité de l’âme trouve là sa source. Espérance religieuse et au-delà fêtent ici leurs noces. Face à l’idée de la perte irrémédiable, quelle issue offre par conséquent la religion ? Celle qui consiste à se convaincre que celle que nous appelons « la mort » n’en est pas vraiment une et que, avec l’instant fatidique du trépas, s’ouvre un passage grâce auquel nous attend autre chose. C’est par le salut que l’âme humaine s’affranchit du temps : les religions proposent de manière générale, à travers les aspirations au salut (communes à la doctrine de l’éternité de l’âme, de la réincarnation et de la résurrection) des affranchissements des limites du temps et de la mort, dans la vie éternelle des bienheureux et des justes. Ainsi la béatitude du Saint n’est-elle pas autre chose qu’une parcelle et une prémisse de l’éternité promise au royaume des cieux au sein de l’existence temporelle. Le mysticisme du moine, qui cherche à se tenir le plus proche possible de l’absolu divin dans une vie contemplative, apparaît, quant à lui, comme un effort exemplaire pour s’affranchir du temps et pour rejoindre l’éternité de Dieu. Déni de la mort : résurrection, migration des âmes ou encore nouvelle naissance par la réincarnation, intentions religieuses qui, comme le reconnaît Freud, rabaissent la vie au rang de simple préparation. En arrière-plan de toutes les religions, on trouve toujours cette « intention de ravir à la mort sa
1
F. Dastur, Comment affronter la mort ?, op. cit., p. 15.
153
HORS DU TEMPS
?
signification d’abolition de la vie1 ». Par quoi se caractérise, en effet, la conscience religieuse universelle ? Par le système formé des deux notions de mort et de survie. Selon la conscience religieuse, la mort n’est pas sans lendemain – l’idée d’une mort irrévocable, point final sans recours aucun aux espoirs est bannie, une forme de survivance va de soi. Dans cette perspective, le christianisme doit retenir tout particulièrement notre attention, dans la mesure où il a inauguré une conception originale de la temporalité : outre l’idée d’une temporalité linéaire et non cyclique, il développe en effet celle de jugement dernier et de résurrection des corps. Cela signifie que la survie, liée au salut de la personne, n’est pas appréhendée seulement comme une prolongation de la vie, mais comme l’inauguration d’une vie nouvelle. Est établie, du même coup, une coupure nette entre le monde d’ici-bas et l’au-delà, qui ne renvoie plus seulement à une vie se prolongeant après la mort, mais à une vie éternelle triomphant de manière radicale de la vie terrestre. Il ne s’agit donc pas seulement d’une forme de seconde vie, mais de la vraie vie. Consécution de la mort et de la résurrection que l’on retrouve dans les cérémonies du culte. Le prêtre ou autre messager divin, le cercueil sous les yeux, viennent expliquer à l’assistance que la vraie vie commence, que ce corps déjà pourrissant entre ces quatre planches de bois n’est pas à retenir, bien au contraire, puisqu’il ne représente rien sinon le symbole de l’entrée dans la vraie vie qu’est la vie céleste. Les mots de Pascal sont à cet égard particulièrement éloquents : « Ne considérons plus un homme comme ayant cessé de vivre, quoi que la nature suggère ; mais comme commençant à vivre, comme la vérité l’assure. Ne considérons plus son âme comme périe et réduite au néant, mais comme vivifiée et unie au souverain vivant : et corrigeons ainsi, par l’attention à ces vérités, les sentiments d’erreur qui sont si empreints en nous-mêmes, et ces mouvements d’horreur qui sont si naturels à l’homme2. » La sur-vie vient tapisser le coût de la mort. L’immortalité dénie la perte de l’individualité. La mort religieuse est une fausse mort, une pseudo-mort, pas un néant véritable, dans la mesure où elle inaugure un passage décisif. Le deuil est adouci et vivifié par l’écho acidulé des cieux. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ; je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main3. » Voici énoncée la promesse de la vie éternelle, appel même à mourir à cette existence terrestre d’où la vraie vie est absente pour accéder à l’existence authentique promise. Le Nouveau Testament est plus qu’édifiant sur ce point, en particulier les textes concernant la résurrection de Jésus qui, d’après L’Évangile selon saint 1
S. Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort », op. cit., p. 34. B. Pascal, Lettre sur la mort de M. Pascal le père, écrite par Pascal à sa sœur aînée, Madame Perier, et à son mari (17 octobre 1651), in Œuvres complètes de Blaise Pascal, II, L. Hachette, 1913, p. 24. 3 L’Évangile selon saint Jean, chap. 10, 27-28. 2
154
HORS DU TEMPS
?
Jean, dit de lui-même : « Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais1. » Ou encore : « Qui aime sa vie la perd ; et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle2. » Dénégation de la vie terrestre au profit de la vie céleste, la finitude humaine étant la marque de notre imperfection opposée à l’infinité divine. Pascal, qui reprochait aux hommes leur divertissement forcené, n’oublie pas cette dimension des Évangiles et invite l’homme à renoncer à « l’amour de la terre, dont la contagion l’infecte toujours durant cette vie3 ». Car, avec la mort, l’âme « achève son immolation, et est reçue dans le sein de Dieu4 ». Il faut se reporter également à saint Paul qui a sans doute établi le dogme avec la plus grande netteté et a, en cela, le plus contribué à élaborer ces notions. Ce n’est pas par hasard que Nietzsche voyait en lui « le premier chrétien, l’inventeur de la christianité5 ! » Sa contribution majeure a consisté, en effet, à ne pas dissocier la mort et la résurrection qui ont marqué l’existence de Jésus de celles qui composent la vie spirituelle de tout chrétien. Il a, au contraire, souligné la solidarité profonde de l’aspect sotériologique (« sauveur ») et de l’aspect eschatologique (préoccupation des fins dernières de l’homme et du monde) des deux notions. Les oppositions pauliniennes de l’homme extérieur et de l’homme intérieur6, du vieil homme et de l’Homme Nouveau7 sont à appréhender dans ce sens. Ainsi, en recevant le baptême, le chrétien meurt de la mort du Christ et ressuscite avec lui. Cette union mystique entre le fidèle et Dieu ressort clairement de ces lignes de l’Épître aux Romains : « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si c’est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection 1
L’Évangile selon saint Jean, chap. 11, 25-26. L’Évangile selon saint Jean, chap. 12, 25. On trouve une formulation proche dans L’Évangile selon saint Matthieu : « Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » (chap. 16, 24). 3 B. Pascal, Lettre sur la mort de M. Pascal le père, écrite par Pascal à sa sœur aînée, Madame Perier, et à son mari, in op. cit., p. 23. 4 Ibid. 5 F. Nietzsche, Aurore, op. cit., § 68, p. 60. 6 « C’est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s’en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » (Les Épîtres de saint Paul, « Deuxième épître aux Corinthiens », chap. 4, 16). 7 « […] si du moins vous l’avez reçu dans une prédication et un enseignement conformes à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu’il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme, qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l’Homme Nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » (Les Épîtres de saint Paul, « Épître aux Ephésiens », chap. 4, 21-24). 2
155
HORS DU TEMPS
?
semblable ; comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l’impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d’être asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus, que la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui1. » Cette perspective de la résurrection promise par Jésus-Christ donne lieu, comme l’on sait, à un célèbre hymne triomphal, qui condense toute l’argumentation : « Où est-elle, ô mort, ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon2 ? » Ces mots de saint Paul dévoilent l’essence même de la foi chrétienne, à savoir que, quoi qu’il en soit, la vie aura le dernier mot parce que l’être, en son fond, est vie. Jésus-Christ vient soustraire la nature humaine à l’empire de la mort, offrant ainsi une victoire totale : le corps semé corruptible renaît incorruptible en une glorieuse résurrection. C’est là que ressort toute l’importance du symbole du Christ en croix. Celui-ci révèle un sens aigu du tragique de la condition humaine, en montrant la mort sur la croix du Christ délaissé par un Dieu qui se tait, couplé à l’idée du Dieu triomphant de la mort grâce à l’acte divin de la résurrection. L’attitude de l’homme-Dieu exprime, à travers l’épreuve de sa mort, le déchirement de la mort-propre, la déréliction suprême : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné3 ? » Ces mots, les derniers que Jésus en croix a prononcés dans un cri, juste avant de mourir, selon les témoignages de Marc et Matthieu, ne se laissent pas facilement interpréter. Xavier Léon-Dufour, notamment, nous met en garde contre une lecture trop lisse de ces paroles du Christ, consistant, sur la base de la coïncidence de celles-ci avec le psaume 22, 1, à supposer « que Jésus a dit en secret la fin du psaume qui débouche sur la victoire de la vie4 ». Car Jésus ne prononce rien de plus. Reste le « pourquoi » sur lequel il meurt et auquel, par conséquent, il est difficile d’ôter sa part troublante. Ce sentiment d’abandon est-il assimilable au désarroi éprouvé face au silence de Dieu tandis que d’atroces douleurs s’inscrivent dans la chair ? Expression d’un doute qui s’arrache de la souffrance paroxystique de l’épreuve de la crucifixion ? Cri du juste souffrant, interpellant Dieu dans l’espoir d’un futur plus serein ? Cette dimension d’interpellation doit sans doute rendre attentif à un aspect notable de la formulation du « pourquoi », dont Léon-Dufour souligne l’importance : « ce pourquoi il l’a dit s’adressant à Dieu en un dialogue qui suppose Dieu présent. Il a ainsi manifesté sa foi en Dieu qui ne l’abandonne pas, mais
1
Les Épîtres de saint Paul, « Épître aux Romains », chap. 6, 4-9. Les Épîtres de saint Paul, « Première épître aux Corinthiens », chap. 15, 55. Saint Paul écrit aussi dans cette même épître : « Le dernier ennemi détruit, c’est la Mort » (chap. 15, 26). 3 L’Évangile selon saint Marc, chap. 15, 34 ; L’Évangile selon saint Matthieu, chap. 27, 46. 4 X. Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, Seuil, « Livre de vie », 1996, p. 96. 2
156
HORS DU TEMPS
?
l’abandonne aux ténèbres de la mort1. » En ce sens, pouvons-nous retrouver l’écho des voix de la tradition chrétienne qui s’accordent pour reconnaître dans ce cri l’expression de la solidarité de Jésus avec son peuple et, plus profondément encore, avec l’humanité tout entière. Ce cri de Jésus traduit l’appel de l’homme, abandonné à l’immanence finie, comme donc dépossédé de la transcendance. Et si sa souffrance est telle, c’est qu’il endosse le sort de celui qu’il n’est pas, de l’homme pécheur, dont il rachète la faute (son abandon de Dieu) par son martyre (son abandon par Dieu), nous ouvrant du même coup au royaume de la vie éternelle. À travers le cri de Jésus, se formule la réponse qui ne vient qu’après sa mort, précisément parce qu’il n’a pas triché avec elle. Le centurion qui l’a regardé expirer le dit : « Vraiment cet homme était fils de Dieu2 ! » Et la résurrection vient donner aux croyants toute sa portée révélatrice au cri du fils de Dieu : la bonne nouvelle s’accomplit3, consacrant la victoire de la vie. Mort et résurrection du Christ, mort de l’homme ancien et émergence de l’Homme Nouveau par la re-création de la résurrection : « la condition mortelle de l’homme s’y voit en quelque sorte “relevée” dans la personne du Christ ressuscité4 ». Ressort toute la force de ce paradoxe du crucifié, autrement dit « d’un dieu qui devient en mourant maître de la mort5 », qui, en se laissant saisir par la mort, en triomphe du même coup. Nietzsche voyait, à juste titre, dans cette mort du Christ « le coup de génie du christianisme6 », symbole même du Dieu qui s’offre en sacrifice pour racheter la dette de l’homme, triomphant de manière décisive de la mort. On peut trouver là, sans doute, le dispositif le plus élaboré de mise en échec de la mort, d’affirmation inconditionnelle de la vie que le cri de triomphe de saint Paul précédemment évoqué symbolise pleinement. Ainsi n’y aurait-il pas de véritable mort ou, plutôt, il ne tiendrait qu’à l’individu de ne pas se recroqueviller sur sa finitude pour y discerner la promesse de l’infini. C’est donc parce que l’individu s’érige en fin absolue et se ferme à sa dimension d’éternité que la mort est pour lui source de tragique et d’angoisse. Dans cette optique, le tragique de la mort individuelle trouve un motif puissant pour s’estomper. La mort n’est plus alors qu’un rite de passage coïncidant avec une forme de retraite autorisant une autre vie, 1
Ibid. L’Évangile selon saint Marc, chap. 15, 39 ; L’Évangile selon saint Matthieu, chap. 27, 54. 3 Se reporter en particulier aux propos de Pierre prononcés à la Pentecôte, affirmant la résurrection de Jésus après qu’il a été livré, selon le dessein de Dieu, aux mains des hommes assassins : « […] mais Dieu l’a ressuscité, le délivrant des affres de l’Hadès » et de la corruption (Les Actes des Apôtres, 2, 23-24 ; 2, 27). 4 F. Dastur, La Mort, op. cit., p. 14. 5 Ibid. 6 F. Nietzsche, La Généalogie de la morale, Gallimard, « Idées », 1966, Deuxième dissertation, § 21, p. 132. 2
157
HORS DU TEMPS
?
soustraite aux vicissitudes du temps. « L’angoisse, comme le commente Robert Mehl, accuse seulement l’immensité de notre amour-propre, notre défaite devant une vie que nous n’avons pas su dominer et où nous n’avons pas su discerner la présence de l’éternité1. » Et Pascal insistera sur cette dimension de notre état désarmé pour ébranler les certitudes, inciter l’homme à questionner son existence au lieu de se perdre dans un divertissement effréné et, à partir de là, à s’ouvrir au message du Christ. Notre ennui et notre agitation inquiète, notre déréliction, sont la marque de notre déchéance et de notre corruption. « Misère de l’homme sans Dieu » qui doit inciter l’homme à parier pour la promesse divine capable de l’extraire de son délaissement mortel, incarnée au plus profond par la figure du Christ2. C’est pourquoi le christianisme invite l’être humain non à ignorer sa mort, mais à la méditer. Vivre en chrétien suppose de vivre dans la conscience de sa mort. De la sorte, il peut mesurer sa déchéance, se persuader d’autant mieux de sa situation d’exil sur cette terre. Telle est la meilleure garantie pour s’ouvrir à la vie de l’esprit, recevoir le dépôt de cette vie surnaturelle. À partir de là, l’homme reviendra à l’essentiel, refusera les jouissances méprisables, appréhendera, selon la leçon platonicienne, la prison qu’est son corps3 pour mieux mourir à lui-même, à sa vanité qui l’empêche de reconnaître cet ordre éternel. Dès lors, la mort ne sera plus source d’épouvante, puisqu’elle n’atteindra que ce qui en nous ne mérite pas de subsister, mais accomplissement de tout notre être. Il s’agit donc de s’accoutumer à la mort pour chasser la crainte qu’elle peut susciter et, ainsi, s’ouvrir les portes de la vie éternelle. Mort-passage et résurrection triomphante que le Christ, comme nous l’avons vu, représente de manière éclatante. Son déchirement et sa victoire résonnent comme l’élimination même du tragique. « Tout le tragique de la condition humaine, que symbolise la mort sur la croix d’un fils de Dieu délaissé par son père, se voit ainsi, d’un coup, justifié en même temps qu’aboli4. » Il est manifeste que la méditation de la mort à laquelle est invité le croyant exclut de ce périmètre toute véritable assomption de la mortalité, celle-ci étant convoquée et considérée pour mieux être battue en brèche. La religion peut ainsi être considérée comme, avant tout, « un puissant dispositif 1
R. Mehl, Le Vieillissement et la mort, op. cit., p. 15. Voir l’éclairage apporté par F. Chirpaz sur la référence au Christ et sur cette « décision de l’existence » que symbolise le pari, traduction dans le langage de la raison de l’« acte de foi » que vise Pascal, « […] s’appuyant sur la compréhension du Médiateur entre Dieu et l’homme. » (F. Chirpaz, Pascal. La Condition de l’homme, Michalon, « Le bien commun », 2000, p. 111). Voir en particulier l’analyse de l’auteur, p. 107-112. 3 Voir Platon, Phédon, in Œuvres complètes, op. cit., 82 e, p. 1202. Ce en quoi Pascal ne manquera pas de reconnaître en Platon un bon introducteur au christianisme. Il écrit : « Platon, pour disposer au christianisme. » (B. Pascal, Pensées, op. cit., 219). 4 F. Dastur, Comment affronter la mort ?, op. cit., p. 69. 2
158
HORS DU TEMPS
?
d’affirmation inconditionnelle de la vie et de mise en échec de la mort1 ». La mort n’est pas une fin, mais bien ce passage qui ouvre sur l’éternité. Ce qui implique que, de la naissance à la mort, c’est toute l’existence qui est passage. Dès lors que la vie est entrebâillée par l’espérance, cette ouverture, même si elle ne perd rien de sa gravité en ne balayant pas la difficulté à vivre et l’inquiétude d’un revers de manche, signe la sortie de l’horizon du tragique. Ainsi Gabriel Marcel qui, par-delà la dimension tragique de sa pensée, fraie une voie à l’espérance. À l’itinérance, traversée de l’existence, voyage qui ne sait son but, son trajet philosophique ne peut se résoudre, comme il l’exprime dans ses entretiens avec Paul Ricœur. Soutenue par la croyance d’un possible dépassement de la finitude, l’ouverture de l’espérance se présente, capable de clore le cheminement tâtonnant de l’êtreau-monde pour lui offrir un sens supérieur. D’où ces mots de Ricœur commentant le versant religieux de la pensée de Marcel : « l’espérance c’est ce qui fait que la marche n’est pas simple errance. […] c’est indivisément le labyrinthe de l’existence et le rais d’espérance qui la traverse qui constituent l’unité de votre philosophie concrète2 ». Par l’ouverture religieuse, l’homme se constitue, par conséquent, un univers à la fois sensé et prometteur. Il se concilie ainsi l’au-delà de son savoir, de son pouvoir et de son espérance. Il peut se sentir à même de surmonter sa solitude et son sentiment de déréliction au sein de l’univers.
Quel antidote ? « S’il y a un péché contre la vie, ce n’est peut-être pas tant d’en désespérer que d’espérer une autre vie, et se dérober à l’implacable grandeur de celle-ci. » Albert Camus, Noces.
La pente de l’éternité nous a conduits des rites funéraires qui intègrent la mort tout en la niant, jusqu’aux religions instituées qui postulent un au-delà définitif, et dont le christianisme nous a paru le plus emblématique. Ce trajet multiforme et long de l’idée d’éternité semble n’avoir eu de cesse d’ôter à la mort son caractère implacable, de la maquiller avec les idées de passage, de voyage, de métamorphose, de nouvelle vie et d’au-delà salvateur. Tout semble mis en œuvre pour doter le moi empirique implacablement mortel d’un je solide et protecteur, auquel serait réservé un second souffle lumineux que la notion de résurrection incarne, si l’on peut dire, au plus près. L’audelà devient une vraie vie après la mort. Quête du suprême antidote capable de briser le lien indéfectible de la vie et de la mort, de minimiser pour notre angoisse la déchirure tragique. 1 2
F. Dastur, La Mort, op. cit., p. 12. P. Ricœur – G. Marcel, Entretiens, Aubier-Montaigne, « Présence et Pensée », 1968, p. 127.
159
HORS DU TEMPS
?
Cette tentative ne peut-elle, dès lors, être envisagée comme cette position de l’esprit humain destinée à se déprendre du temps comme principe de dégradation et de mort, prête pour cela à concevoir des récits qui, s’ils savent se montrer puissants, n’en relèvent pas moins d’une médication illusoire et imaginaire ? Cette posture ne résonne-t-elle pas comme l’écho de cette fascination de l’esprit disposé à peupler son monde d’entités inentamables : le vrai, l’âme, Dieu ? Il paraît important de rappeler, bien entendu, que la vision religieuse, même si elle a pu être l’objet de rationalisations plus ou moins marquées de la part des théologiens, se distingue nettement de la vision philosophique et scientifique des choses par son caractère affectif, sa dimension profondément intime. Et l’on sait combien Pascal s’est montré soucieux de bien distinguer le Dieu de la religion du « Dieu des philosophes et des savants », opposant pour cela l’ordre du cœur à celui de la raison1. À ce titre, le penseur chrétien a souligné que le Christ ne transmet pas un savoir auquel ses disciples doivent adhérer en raison, mais qu’il invite ceux qui partagent son amour à suivre l’écho de sa Parole. Ceci étant, même si la modalité religieuse est reconnue comme résolument affective, ne peut-on discerner, malgré tout, au cœur de celle-ci, cette tentation d’une duplicité du regard, précédemment analysée, disposée à élaborer des fantasmagories consolantes capables de détourner l’attention du seul texte de la réalité ? Bien entendu, la question de la survie ne peut en aucun cas être tranchée. Il ne s’agit donc pas de nier Dieu, mais de mettre en évidence les conséquences pernicieuses d’une telle postulation. Conséquences qui nous apparaissent problématiques, essentiellement, sur deux axes. D’abord, le désir d’immortalité peut apparaître non seulement comme un rêve, mais, plus que cela, il conduit généralement à la dévalorisation de notre vie terrestre et des plaisirs ou des dons qu’elle peut receler. La vie supraterrestre, pour se rehausser, demande un mépris des plaisirs terrestres, et nous avons vu que le christianisme développe très nettement cet argument. L’on sait que c’est une des principales critiques que Nietzsche adresse à la religion chrétienne. Il lui reproche le mépris de la vie qu’elle professe au lieu d’une adhésion sans réserve, le « grand oui » à la vie auquel il tend. Il voit dans l’idéal ascétique, héritage négatif que son père pasteur notamment lui a transmis, « la lente mise à mort par soi-même2 », donc une forme de suicide.
1
B. Pascal, Pensées, op. cit. Voir en particulier les pensées 248, 252, 267, 282, 283, 284. Pascal entend souligner ainsi le rôle irremplaçable de la religion, à savoir donner à percevoir ce qui est « sensible au cœur » (278), qui « a ses raisons, que la raison ne connaît point » (277). « Voilà ce que c’est que la foi : Dieu sensible au cœur, non à la raison. » (278). 2 F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., § 131, p. 153. Dans Par-delà bien et mal, Nietzsche écrit également : « Partout où la névrose religieuse est apparue sur la terre, nous la trouvons liée à trois régimes dangereux : solitude, jeûne et continence ». Sitôt que cette « névrose » apparaît dans une civilisation, déplore-t-il, voit-on émerger « convulsions de pénitence », « négation du monde et de la volonté » (F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, op. cit., § 47,
160
HORS DU TEMPS
?
Le christianisme a, certes, clairement formulé son rejet de la mort volontaire, estimant que nous devons supporter la vie sans nous arroger le droit de nous donner la mort. Mais cette vie n’en est pas moins déclarée, dans de nombreux textes, méprisable et haïssable1. Paul Claudel, pourtant catholique fervent, n’a pas manqué de condamner cet aspect de la religion, en l’occurrence de la religion chrétienne. Reprenant notamment la position de Pascal estimant que l’accession au bonheur est impossible ici-bas, il écrit : « Le bonheur d’être catholique, c’est d’abord pour moi celui de communier avec l’univers, d’être solide avec ces choses premières et fondamentales qui sont la mer, la terre, le ciel et la parole de Dieu2. » Les propos de Claudel témoignent que, dans la perspective religieuse, les plaisirs d’ici-bas ne sont pas forcément bannis ou dévalorisés, considérés qu’ils sont comme autant de dons de Dieu. Toutefois, malgré la formulation de bémols de cet ordre, à partir du moment où la vie terrestre est considérée avant tout comme un passage, où l’espérance est là, la loi divine et sa définition du bonheur l’emportent. Se considérer comme un être déchu en raison de l’empreinte du péché originel, se croire en exil, c’est imaginer sa « vraie » patrie ailleurs et plus tard. Ce en quoi les religions offrent une perspective de bonheur transcendant la vie terrestre, invitant à dépasser les plaisirs et les exaltations d’ici-bas. L’espérance d’une félicité éternelle, fondée sur la croyance en un au-delà, suppose une hiérarchisation, qui transforme peu ou prou l’existence en prison, faisant dériver l’attention du « prisonnier » vers ce qui est censé se trouver derrière le mur. À l’aumônier qui a forcé la porte de sa cellule et qui entend l’entretenir de Dieu, capable d’offrir à la prison de cette vie une sortie lumineuse, Meursault oppose précisément la plénitude de la vie : un visage, la peau d’une femme aimée, les odeurs de terre, le soleil… Et il pourra se dire, la nuit précédant son exécution, s’ouvrant alors à « la tendre indifférence du monde » : « De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais encore3. » Seul et sans
p. 67-68). Voir aussi La Volonté de puissance, trad. H. Albert, op. cit., § 483, p. 511-512 où Nietzsche oppose le « oui » de l’homme tragique au « non » de l’homme chrétien. 1 Nous avons déjà évoqué le Nouveau Testament qui abonde en passages invitant les fidèles à mépriser la vie terrestre. Cette vie est haïssable, nous devons aspirer à rejoindre Dieu et la vie éternelle. Nous ne devons pas, néanmoins, couper court à notre vie. Il nous faut supporter les épreuves susceptibles de nous accabler et attendre que Dieu nous reprenne la vie. C’est d’ailleurs, comme l’exprime G. Minois, « le difficile exercice sur lequel doit reposer la vie chrétienne » : « La vie est haïssable, mais il faut la supporter ; la mort est souhaitable, mais il ne faut pas se la donner » (G. Minois, Histoire du suicide, op. cit., p 36). Perspective qu’éclaire, semble-t-il, l’expression « porter sa croix ». 2 Cité par L. Muron, « Pascal et Claudel : le bonheur chrétien », Magazine Littéraire, « La tentation du bonheur », n°389, juillet – août 2000, p. 35. 3 A. Camus, L’Étranger, Gallimard, « Folio », 1972, p. 186.
161
HORS DU TEMPS
?
Dieu, mais reconnaissant à sa façon des sensations intenses qu’il a pu éprouver en cette vie. Ensuite, la religion en appréhendant la mort comme une « fausse mort », ne fait-elle pas vivre dans la méconnaissance de la mort, dans l’illusion ? Elle est censée préparer à la mort, mais à une mort niée en tant que telle. Et, comme le remarque Conche, à ceux qui objecteraient que peut-être la mort n’existe pas, le raisonnement tient tout de même si l’on veut garder un regard philosophique. Car, « pour le philosophe, il faut vivre dans l’hypothèse contraire, l’hypothèse du pire, car se préparer au pire est une loi de la sagesse1 ». Là où l’homme religieux croit au meilleur, le penseur tragique suppose le pire. Selon les mots de Nietzsche, « la mort et le silence de mort constituent l’unique certitude et ce qu’il y a de commun à tous dans cet avenir2 » ! Sur ce besoin d’ôter à la mort son caractère implacable, Cioran écrit : « Toujours ce besoin de faire de la mort un accident ou un moyen, de la réduire au trépas, au lieu de la considérer comme une présence, toujours ce besoin de la déposséder. Et si les religions n’en ont fait qu’un prétexte ou un épouvantail – un instrument de propagande – il revient aux incroyants de lui rendre justice et de la rétablir dans ses droits3. » La lucidité sur ce qu’il nous est effectivement donné de traverser doit nous inciter à ne pas occulter la sentence mortelle. Car, comme l’écrit Jankélévitch, le problème de la mort n’est pas cette image « qui poursuit l’humanité depuis l’origine des temps » du passage d’une rive à l’autre. Passage sans passeur, la contrée de la mort n’évoque pas un nouveau pays. « Telle est la pensée la plus difficile à formuler puisqu’elle est a priori exclusive de toute mise en relation : la mort est un passage à rien4. » Car que peut évoquer le cadavre ? Il n’évoque pas la figure d’un « autre », mais rien. Les termes de « transformation », de « devenir » n’ont plus aucun sens. On peut alors parler d’un « passage qui fait semblant de passer et qui ne passe nulle part5 ». Et l’on peut conclure avec Jankélévitch, rappelant chacun au chevet du mort et aux émanations issues de ces parages mortels : « La mort ne désigne ni une altérité ni un futur. Le silence qui s’établit autour du lit de mort n’exprime pas seulement le déchirement de la séparation irréversible, mais aussi notre angoisse à la vue de ce mort, notre horreur devant cette absurdité en forme de cadavre informe, devant ce présent-absent happé dans un vide pour lequel nous n’avons plus de mots, notre désespoir au seuil de cet anti-futur6. » Au regard des témoins, le « passager » fait piètre figure,
1
M. Conche, Le Fondement de la morale, op. cit., p. 107. F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., § 278, p. 191. 3 Cioran, La Tentation d’exister, in op. cit., p. 963. 4 V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, op. cit., p. 169. 5 Ibid. 6 Ibid., p. 170. 2
162
HORS DU TEMPS
?
creusant le trou de son absence sans laisser quelque bribe d’une quelconque adresse, sans laisser supposer non plus l’éclosion de nouvelles formes de vie. Le cadavre pourrissant me découvre l’absence irrémédiable d’autrui, rien qui puisse mimer quelque mode d’existence. Certes, le fait biologique du mourir n’est pas un critère suffisant d’interrogation. Nous l’avons rappelé, le mystère et son écho tragique sont en dessous, ils résident dans la corrélation : le fait que la croissance porte en elle la décroissance. Il ne s’agit donc pas de s’attarder indéfiniment sur « Milady Vermine1 ». Il reste que la considération de cette ultime figure imposée qu’offre le cadavre ne peut manquer d’être édifiante. Elle ramène abruptement à la réalité en chair et en os, crue, nue, mettant à mal la tentation de la duplicité du regard, prête à glisser sur le fait de l’existence elle-même. Difficile de mettre un voile sur la réalité qui se joue sous les yeux de ceux qu’elle happe alors. Le réel rappelle qu’il est là, qu’il a toujours été là où les hommes s’effondrent et meurent. L’homme est cet être destiné à mourir dont la limite intime fait tomber un rideau pour jamais. Peut-on alors ignorer l’impact profond de ce déchirement et repousser sans conteste l’idée d’anéantissement ? Ne doit-on estimer, en conséquence, à considérer l’étreinte indéfectible de la vie et de la mort, que celle-ci « n’est pas économisable, l’immortalité n’est pas plus concevable qu’une lumière sans ombre, qu’une musique sans silence. La mort est la maladie des bienportants, elle est incurable par définition2. » La reconnaissance en tant que tel du mouvement de la vie et de la mort semble rendre caduque toute idée religieuse du monde. Le réel et l’infini ne se cumulent pas pour qui veut considérer les choses en toute lucidité et froideur d’esprit. N’y a-t-il pas, dès lors, quelque légitime soupçon à émettre vis-à-vis de la perspective de survie à laquelle l’expérience religieuse entend nous ouvrir ? Soupçons. Ne pas ôter à la mort son empreinte destructrice peut ainsi être considéré comme un enjeu essentiel et amener à la formulation d’une certaine méfiance. À ce titre, l’immortalité et la figure divine qui en est la garantie même peuvent apparaître comme cette ultime stratégie par laquelle l’homme entend se dispenser d’affronter la perspective de sa propre disparition, un postulat destiné avant tout à le rassurer contre la dimension néantisante du temps. À ce stade, l’argumentation déployée par des pensées du soupçon peut retenir notre attention. Ainsi notamment, pour ne citer qu’eux, les réflexions formulées par Nietzsche et Freud3. La visée des deux penseurs est intéressante, dans la mesure où, malgré leur différence respective et le ton parfois très virulent de la critique, celui de Nietzsche en particulier, celle-ci 1
W. Shakespeare, Hamlet, in op. cit., Acte V, Scène I, p. 354. V. Jankélévitch, Entretien avec Robert Hébrard, L’Arc, op. cit., p. 11. 3 Rappelons que P. Ricœur a qualifié Nietzsche et Freud, au même titre que Marx, de « maîtres du soupçon ». 2
163
HORS DU TEMPS
?
ne se limite pas à l’élaboration d’une machine de guerre contre la foi religieuse. Tous deux cherchent avant tout à libérer l’homme de toute tutelle, incitant, l’un avec la philosophie, l’autre avec la psychanalyse, l’homme à se prendre en charge. Aussi tentent-ils d’éclairer la genèse de la religion par la mise en évidence de son soubassement humain. À cette fin sont convoqués des motifs d’ordre psychologique et sociologique révélant dans le sentiment religieux un produit de l’imagination motivé par la quête d’un analgésique pour faire taire nos peurs et répondre à la dureté de la vie. Intéressons-nous d’abord au soupçon nietzschéen. Nietzsche se voulait, certes, un des adversaires les plus redoutables du christianisme et il n’hésite pas à employer un ton acerbe, voire acide, mais l’examen de la foi religieuse qu’il conduit n’est pas destiné à s’arrêter sur ce seul versant critique. Il vise à définir les contours du type d’homme qu’il appelle de ses vœux. Non donc un contempteur de la vie, disposé à projeter le sens de l’existence dans une autre vie, arrière-monde illusoire censé délivrer une félicité supraterrestre, mais un affirmateur de la vie qui n’entend pas écarter ce qui ne lui convient pas : la cruauté, la souffrance, la mort. Nietzsche, nous l’avons rappelé, tient en priorité à combattre le christianisme, en raison de l’idéal ascétique qu’il prône, dans lequel il perçoit un profond refus du monde1. Le philosophe considère que l’on ne peut accorder de crédit à la religion dans la mesure où « toute religion est née de la peur et du besoin, c’est par les voies de la raison égarée qu’elle s’est insinuée dans l’existence2 ». Pour libérer notre esprit de ces mensonges, il tente d’expliciter le surgissement et l’extension de la religion au sein des communautés humaines à partir d’une enquête d’ordre psychologique et sociologique. Comment donc l’idée de Dieu et la religion ont-elles pu naître dans l’esprit des hommes jusqu’à se propager dans toute l’humanité ? Considérant que les dieux tirent leur origine et leur essence de l’esprit des hommes, Nietzsche s’essaie à en repérer la racine. Il situe alors leur émergence dans « l’intellect d’une humanité primitive et sans maturité3 », déconcertée par les forces dont elle constate la manifestation dans la nature ou en l’homme. La raison, ainsi inquiétée, se laisse gagner par son trouble et, au lieu de rattacher ces phénomènes à une causalité naturelle, « les met au compte de l’arbitraire et de la liberté d’une puissance supérieure4 ». Un cataclysme est manifestation du courroux des dieux, un individu hystérique a subi un sortilège, un malaise intérieur est sentiment du péché…
1
Nietzsche, précisons-le, n’incrimine pas tant le Christ, dont le message lui paraît globalement moins empreint du ressentiment qu’il abhorre, que ses disciples, et saint Paul en particulier. 2 F. Nietzsche, Humain, trop humain, I, op. cit., § 110, p. 106. 3 F. Nietzsche, Aurore, op. cit., § 91, p. 74. 4 M. Neusch, Aux sources de l’athéisme contemporain. Cent ans de débats sur Dieu, Centurion, « Foi vivante », 1993, p. 156.
164
HORS DU TEMPS
?
Ainsi, la religion apparaît-elle comme une forme d’illusion, un emballement de l’imagination, qui se nourrit d’une confusion entre la cause et l’effet. Le philosophe, dans Le Crépuscule des idoles, y voit l’erreur la plus dangereuse qui, dès lors qu’elle est « sanctifiée », porte précisément le nom de « religion ». Celle-ci se fonde sur cette « perversion de la raison » consistant à inverser la causalité naturelle et dont les prêtres se font les promoteurs1. En somme, l’homme religieux ne sait pas distinguer la réalité de son imagination. La religion étant une croyance en une réalité imaginaire, l’homme, impuissant à maîtriser les forces qui le dominent, entretient avec elles des rapports magiques. Pour ne pas demeurer le jouet de ces forces qui le dépassent et pour se concilier les faveurs divines, il déploie les stratégies propres à ce domaine composées de louanges et de demandes. C’est par « des supplications et des prières, par la soumission, par l’engagement à s’acquitter d’offrandes et de tributs réguliers, par des célébrations flatteuses qu’il sera possible d’exercer une contrainte sur les puissances de la nature, en ce sens qu’on se les rendra favorables : l’amour enchaîne et on l’enchaîne2 ». Produit d’une imagination débridée, le processus de la fabrication des dieux relève, par conséquent, selon Nietzsche ni plus ni moins d’une forme de délire. L’homme religieux se forge une explication personnelle du monde qui envahit son esprit avec une force telle qu’il n’ose plus se figurer que l’inventeur n’est autre que lui-même. Phénomène de dédoublement de la personnalité qui l’amène à projeter en dehors de lui ce qui émane de lui. L’homme en vient, autrement dit, à considérer comme une révélation divine ce qui est une création issue de son propre esprit. « L’erreur de l’esprit comme cause confondu avec la réalité ! Considéré comme mesure de la réalité ! Et dénommé Dieu3 ! » La clé de ce jeu inconscient de dédoublement, auquel s’adonne l’homme religieux, est bien évidemment la satisfaction personnelle qu’il en retire. À partir du moment où son hypothèse est comprise comme une révélation d’en haut, sa croyance s’en trouve fortifiée et s’évite les affres du doute. Face à une vie souvent rude, menacée par le malheur, il se donne, qui plus est, un moyen suprême d’y échapper et se console des peines endurées grâce à l’espérance d’une autre vie. Promesse d’une vie meilleure, de l’obtention du bonheur dans l’au-delà. Le croyant détient, du même coup, le remède à son mal. Poison et contrepoison distillés en même temps ont de quoi tranquilliser l’esprit. La religion a donc aux yeux de Nietzsche un incontestable fondement psychologique appartenant à cette physiologie de l’erreur, consistant à confondre la cause avec l’effet4. Mais le philosophe n’arrête pas là ses 1
F. Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, op. cit., « Les quatre grandes erreurs », § 1, p. 103. F. Nietzsche, Humain, trop humain, I, op. cit., chap. III : « La vie religieuse », § 111, p. 109. 3 F. Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, op. cit., « Les quatre grandes erreurs », § 3, p. 107. 4 Ibid., § 6, p. 110. 2
165
HORS DU TEMPS
?
investigations. Il s’emploie aussi à éclairer l’extension quasi universelle de la religion, ainsi que les formes diverses qu’elle peut recouvrir. Pour cela, Nietzsche procède selon une approche d’ordre sociologique. Il remarque en particulier, comme le commente Marcel Neusch, que « toute religion, en tant que comportement de masse, a besoin d’un fondateur qui en développe la logique et l’impose aux autres1 ». C’est dire que ce fondateur ne crée rien en tant que tel ; il se distingue bien plutôt par sa finesse psychologique. « Il appartient à un fondateur de religion d’être infaillible dans la connaissance psychologique d’une certaine moyenne catégorie d’âmes qui attendent de prendre conscience de ce qu’elles ont de commun entre elles2. » À partir de cette conscience, il fait alors office de rassembleur dont la vocation est de donner sens et valeur à un mode de vie dont il repère les contours et dont il sait capter les aspirations latentes. L’importance et l’originalité du fondateur résident donc dans sa capacité à discerner les traits saillants d’une manière de vivre qu’il choisit, et à laquelle il sait offrir un but, insufflant alors confiance au groupe humain qui s’y reconnaît. « C’est lui qui par cette conscience les rassemble : sous ce rapport la fondation d’une religion donne lieu toujours à une immense fête de la reconnaissance mutuelle des âmes3. » Le fondateur d’une religion est, ainsi, avant tout un rassembleur par la confiance, voire le fanatisme, qu’il sait inspirer à une certaine catégorie de gens. D’où l’on saisit qu’il puisse y avoir diversité de religions, selon le groupe d’hommes sur lequel le fondateur concentre son attention. Mais, quelles que soient les valeurs professées, on peut identifier un même processus sociologique : « il s’agit essentiellement d’une conscientisation4 ». Fenêtres psychologiques et sociologiques, donc, ouvertes sur la religion, la ramenant à ses strates humaines en quête d’extraordinaire et de surnaturel, loin en tout cas de tout halo insondable et nébuleux. Approche résolument méfiante que l’analyse freudienne vient corroborer. Il paraît important de noter au préalable que Freud, même s’il associe la maturité de l’homme à l’abandon des dieux, ne cherche pas tant à déconstruire la foi de ses patients, qu’à en comprendre les tenants et aboutissants. N’ayant jamais éprouvé lui-même le besoin émotionnel de croire en l’existence d’un Être suprême, il cherche plutôt à saisir la nature de ce « sentiment océanique », selon l’expression de Romain Rolland, que d’aucuns considèrent comme la source véritable de la religiosité. Sentiment particulier, sensation de l’« éternité » comme « quelque chose de sans
1
M. Neusch, Aux sources de l’athéisme contemporain, op. cit., p. 158-159. F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., § 353, p. 252. 3 Ibid. 4 M. Neusch, Aux sources de l’athéisme contemporain, op. cit., p. 159. 2
166
HORS DU TEMPS
?
frontière », à la source, d’après Rolland, de l’énergie religieuse1. Freud veut pénétrer le secret de cette part humaine et découvre, lui aussi, dans la réalité religieuse un produit de l’imagination, une pure création du psychisme humain projetée dans le monde extérieur. Que recherche l’homme du commun dans la religion ? Le rôle de celle-ci est avant tout d’apporter la consolation à l’homme éprouvé par la difficulté de la vie : « La vie telle qu’elle nous est imposée est trop dure pour nous, elle nous apporte trop de douleurs, de déceptions, de tâches insolubles. Pour la supporter, nous ne pouvons pas nous passer de remèdes sédatifs2. » L’homme est menacé par la souffrance d’une triple manière : menace issue du corps qui, voué à la déchéance et à la mort, est travaillé par la douleur et l’angoisse, sensation d’écrasement par le monde extérieur dont il peut subir le déchaînement des forces de manière inexorable et surpuissante, et menace encore des blessures résultant des relations qu’il entretient avec ses congénères. La religion tente de répondre aux possibilités de souffrance réservées par cette triple effraction et de conjurer, ainsi, ce destin funeste de l’homme dans le monde. « Les dieux conservent leur triple tâche, exorciser les effrois de la nature, réconcilier avec la cruauté du destin – en particulier tel qu’il se montre dans la mort – et dédommager des souffrances et privations qui sont imposées à l’homme par la vie en commun dans la culture3. » Qu’est-ce alors que la religion ? Une illusion, autrement dit un espoir émanant de certains désirs. Illusion religieuse : afin de supporter la vie, le désir blessé ou trahi invente la croyance en une « Providence attentionnée4 » et en l’immortalité. Le recours au divertissement, l’appel à des stupéfiants ou le refuge dans la maladie constituent les stratégies de certains hommes. Toutefois, la plupart d’entre eux répondent à la dureté de la vie en absorbant ce narcotique consolant que représente la religion. En faisant partager à ses fidèles une forme de « délire collectif », celle-ci leur évite une névrose individuelle. La religion appartient à cette tentative partagée par un grand nombre d’hommes « de se créer une assurance sur le bonheur et une protection contre la souffrance par un remodelage délirant de la réalité effective5 ». Les religions de l’humanité représentent ce « délire de masse ». Aujourd’hui les données ont, certes, quelque peu changé. Dans de nombreux domaines, la religion a cédé la place à la science. L’homme ne s’adresse plus guère aux dieux pour conjurer les forces de la nature et la soumettre à la
1
« Sur la seule base de ce sentiment océanique, on est selon lui en droit de se dire religieux, alors même qu’on récuse toute croyance et toute illusion. » (S. Freud, Le Malaise dans la culture, PUF, « Quadrige », 2000, p. 6). 2 Ibid., p. 17. 3 S. Freud, L’Avenir d’une illusion, PUF, « Quadrige », 2002, p. 18. 4 S. Freud, Le Malaise dans la culture, op. cit., p. 15. 5 Ibid., p. 24.
167
HORS DU TEMPS
?
volonté humaine : il s’en remet à la technique guidée par la science (non, parfois, sans une certaine religiosité d’ailleurs). Mais il abandonne plus difficilement les deux autres fonctions de la religion, car il a besoin de cette promesse de vie éternelle par laquelle la religion le console de la mort et lui garantit aussi dans l’au-delà un dédommagement capable de compenser les frustrations subies ici-bas. Elle représente, à ce titre, le plus puissant rempart contre les assauts de la réalité source de toute souffrance. Freud, analysant ce théâtre fascinant de l’être humain et son entrelacs de symboles, remonte jusqu’au fond marqué par la dépendance et la vulnérabilité du passé infantile, dont la psychanalyse lui a enseigné l’importance dans la constitution de l’homme. En l’homme, demeure toujours un enfant en quête de consolation. Il continue à réclamer ce « sédatif » que la religion incarne. Les dieux apparaissent ainsi, aux yeux du psychanalyste, comme autant d’acteurs derrière lesquels se profile la figure du Père1, « d’un père exalté jusqu’au grandiose2 ». Figure dont l’arrière-plan infantile et hors de la réalité peut générer un certain constat désolé quand l’on considère « que la grande majorité des mortels ne s’élèvera jamais au-dessus de cette conception de la vie3 ». Car, si la religion a perdu du terrain sur le plan d’un certain nombre de valeurs qu’elle incarne et exige, la figure du père protecteur persiste. D’ailleurs, lorsque l’on voit avec quel empressement nombre d’individus sont prêts à élire des escrocs spirituels, chefs de sectes et autres gourous, on réalise la solidité de cette image. Pères incomparables et de bien moindre envergure – comparer par exemple la figure exigeante du Dieu chrétien avec ces fantoches serait une aberration –, mais qui jouent de cette image dans leur stratégie d’« hameçonnage » des adeptes. Bouillotte, analgésique ou alibi, telle apparaît la religion. De quoi l’appréhender comme une modalité illusoire de réalisation d’une aspiration au bonheur que les conditions de la vie humaine ne cessent de bafouer. Ces approches, parce qu’elles tentent d’interroger sans concession l’origine de la religion, ont le mérite de mettre en avant un certain nombre de motifs susceptibles d’amener à croire en un Dieu et de dénoncer la part de frustration et de superstition qui peut s’y mêler pour un nombre non
1
« Un besoin provenant de l’enfance, aussi fort que celui de la protection paternelle, je ne saurais en indiquer. » (Ibid., p. 14). Ce n’est donc pas tant au « sentiment océanique », sentiment d’appartenance au tout du monde environnant, – survivance pour Freud du sentiment du moi primaire où la frontière du moi d’avec le monde extérieur n’est pas encore établie –, qu’il faut attribuer la source des besoins religieux. Freud n’écarte pas totalement le lien que peut avoir ce sentiment avec la dimension religieuse de l’homme. La mystique a sans doute, comme il le reconnaît, des choses à dire sur ce plan. Néanmoins, il estime que c’est bien plutôt du côté de ce besoin de protection, de ce « sentiment de désaide enfantin que l’on peut suivre d’un trait sûr l’origine de la position religieuse. » (Ibid.). 2 Ibid., p. 15. 3 Ibid., p. 16.
168
HORS DU TEMPS
?
négligeable de fidèles1. L’on ne peut manquer d’observer, à leur suite, les attitudes consistant à se réfugier derrière le bouclier des dogmes et des cultes imprégnés de vénérations superstitieuses. Toutefois, l’on peut objecter que cette seule approche d’ordre psychologique et sociologique, non contente d’être globalisante, est insuffisante ou réductionniste, qu’elle n’épuise pas tous les motifs de la croyance, dans la mesure où elle méconnaît la dimension proprement spirituelle de l’élan religieux, répondant à la quête de donner un sens supérieur à sa vie. L’espérance se nourrit de la quête d’un accomplissement au lieu d’un simple anéantissement. « Le souci du salut2 », selon l’expression de François Chirpaz, parle de cet élan qui dépasse les préoccupations et les difficultés de la vie quotidienne, et qui, se rapportant au caractère précaire de sa condition de mortel, dote le souci « d’une tonalité plus grave car il y va alors du sens de cette vie3 ». Il faut que l’homme ait senti la menace mortelle qui entame sa vie – perte d’un proche, menace de la maladie, de la misère, de la guerre… Ainsi exposé, se retrouvant « dans la proximité nue de son destin4 », il peut sentir, en conséquence, se déchirer l’espoir d’une pleine maîtrise sur sa vie. L’espérance, dès lors, est « refus non pas tant de la mort que de son interprétation comme anéantissement sans retour5 ». Double mouvement donc : la reconnaissance de la négativité profonde de la mort couplée au refus que cet arrêt de mort coïncide avec un effondrement dans le néant. D’où il ressort la raison d’être spécifique et irréductible de la quête du salut. Celle-ci « est donc espoir que la mort n’est pas le dernier mot du destin de l’homme, elle est appel à un sauveur qui saura dénouer les liens impitoyables de la nécessité parce qu’elle est, dans son mouvement même, acceptationrefus de la mort6 ». La religion peut apparaître alors comme condition de cette vie sensée et acquérir cette vocation d’accompagner l’homme sur le chemin de son accomplissement. La vie religieuse n’a donc rien d’une pure facilité, demandant à l’homme de prendre une certaine mesure de sa condition, et elle sait aussi se montrer exigeante, détournant ce dernier de bien des futilités et des égoïsmes en lui recommandant, notamment, une attention aiguë à l’autre7. Il faut reconnaître, 1
Pascal lui-même n’écrit-il pas : « Il y a peu de vrais Chrétiens, je dis même pour la foi. Il y en a bien qui croient, mais par superstition ». (B. Pascal, Pensées, op. cit., 256) ? 2 F. Chirpaz, « Le souci du salut », Lumière et vie, « Un chemin de liberté : le salut de Dieu », n°250, juin 2001. 3 Ibid., p. 8. 4 Ibid., p. 7. 5 Ibid., p. 13. 6 Ibid., p. 12. 7 L’invite exigeante et généreuse demandant au fidèle de faire de l’amour la règle du rapport qu’il établit avec l’autre représente, comme l’on sait, une expression centrale du christianisme. Ainsi, la formulation du Lévitique : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
169
HORS DU TEMPS
?
par ailleurs, la profondeur tragique de nombre de penseurs religieux – Pascal au premier chef. Mais, à l’image du christianisme, la dimension religieuse n’intervient pas moins en dernière instance pour mieux contourner et abolir le tragique, l’essentiel étant cette croyance d’un possible dépassement de soi par un absolu qui donne sens à l’être-au-monde. Sans doute la foi sait-elle replacer l’individu face à la singularité de sa condition, mais cet « horizon de transcendance1 », qui suggère à l’homme la présence de cette Autre réalité qui est celle du sacré ou du divin, vient résolument dénouer l’étroitesse du lien de perdition entre la vie et la mort. Aussi n’est-elle pas dans tous les cas, même si elle peut donner lieu à une méditation profonde et empreinte de gravité, une façon ultime de réduire la charge de notre existence subjective dans tout ce qui ne cesse de la menacer et de l’entamer ? Kierkegaard nous apparaît sur ce point comme une référence centrale, puisque la dimension tragique traverse toute son œuvre, alliée à la volonté farouche de s’en extraire. En cela, le philosophe est un auteur d’abord religieux, le destin chrétien étant le point nodal de sa pensée. Exister, dans cette perspective, revient à être devant Dieu. Comme l’on sait, la progression de l’individu vers Dieu se fait selon différents stades. Le philosophe distingue, en effet, trois étapes sur le chemin de la vie : les stades esthétique, éthique et religieux. Cheminement de pensée qui situe clairement la religion au sommet de l’existence. Celle-ci doit être considérée comme une tension entre le fini et l’infini et les trois stades énoncés représentent les promesses de son accomplissement. Revenons brièvement sur chacune des sphères d’existence ainsi distinguées. L’esthétique caractérise l’existence dont le rapport au monde est motivé par la recherche exclusive du plaisir. Aussi l’esthète n’entend-il rien se même. » (chap. 19, 18). L’être humain, amené à considérer l’autre homme comme son semblable, doit s’efforcer de nouer des relations pacifiées avec les autres, d’exclure tout levier de violence de son champ d’existence. Le prochain est l’homme appréhendé dans sa fragilité de créature exposée à de multiples tourments et, en particulier, à la violence que l’autre peut lui faire subir. Cet amour-là est agapè (agapaô : « accueillir avec affection ») : attention à l’autre incitant à porter secours à l’homme en détresse et à bannir l’indifférence. Écoute et compassion agissante, donc, résonnent comme les termes essentiels de cette invite biblique. Dieu étant amour, le fidèle, en aimant son prochain, manifeste par là-même son amour pour Dieu (L’Évangile selon saint Matthieu, chap. 22, 37-39) et la solidité d’une existence de foi pour laquelle l’amour est plus fort que la mort (Les Épîtres de saint Paul, « Épître aux Romains », chap. 8, 37 ; « Deuxième épître aux Corinthiens », chap. 5, 1 ; « Première épître aux Thessaloniciens », chap. 1, 10). Au-delà de l’intelligence des rapports humains, rappelant que seuls le discernement et la douceur peuvent instaurer des relations humaines dignes de ce nom, l’on conçoit, eu égard à la considération réaliste de la traînée sanguinolente du cours du monde, que cela suppose une espérance sans bornes… 1 Expression de F. Chirpaz dans son ouvrage L’Homme précaire, PUF, « L’interrogation philosophique », 2001. L’auteur conduit, à travers elle, une méditation sur cette force mystérieuse transcendante à l’homme qui, à partir de « l’interrogation inquiète » au sujet du sens de sa vie, peut se sentir invité à maintenir une ouverture. Voir en particulier, chap. VI, p. 216-232.
170
HORS DU TEMPS
?
refuser. Il mène son existence en suivant la courbe des caprices de sa fantaisie. Le Don Juan de l’opéra de Mozart représente on ne peut mieux ce type d’individualité. Il n’existe que dans une perpétuelle fuite en avant, hors de tout choix, dans le seul instant du plaisir. C’est pourquoi Don Juan, ne s’arrêtant sur aucune qualité particulière, ne choisit aucune femme. Vivant par et pour la jouissance, il chasse la femme, donc potentiellement toutes. L’esthétique, c’est l’existence comme non-choix et indifférence, vouée qu’elle est à l’essentielle dispersion entretenue par le seul aiguillon du désir. Parler de « choix » au sens rigoureux du terme, c’est basculer dans la sphère de l’éthique. Là où l’esthète n’exclut rien, la promesse d’une nouvelle jouissance le rendant toujours prêt à renoncer au plaisir actuel, l’individu éthique soumet son existence au choix. La sphère éthique, c’est l’existence selon son rapport à autrui, vouée à l’accomplissement du devoir. C’est le mari contre le séducteur, la responsabilité supposant choix volontaire, engagement et continuité du moi (sens du devoir, fidélité à soi et à autrui, vie qui devient elle-même en se fixant des règles), contre son émiettement et son inconstance (quête perpétuelle de plaisir ne supposant aucune décision ferme). Le philosophe reconnaît à la vie éthique une valeur certaine. Pour autant, à ce stade, le chemin spirituel de l’individu n’est pas encore abouti. Car la sphère de l’éthique est celle du général. Au service qu’il est de l’extériorité, l’homme éthique ne peut atteindre la singularité de l’individu. C’est pourquoi le stade religieux, régi par la foi, suppose une rupture des priorités par rapport à la vie éthique. La modalité religieuse de l’existence proposée par Kierkegaard se fonde sur la conscience de ne pas être à l’origine de son être, ainsi que d’avoir à répondre de soi et de son existence devant une existence supérieure. L’homme, nous l’avons précédemment évoqué, doit être appréhendé comme une synthèse de corps et d’esprit, de temps et d’éternité, de fini et d’infini, autrement dit comme un rapport entre deux choses. Ainsi envisagé, « l’homme n’est pas encore un moi », car le rapport est un « tiers négatif », c’est-à-dire qu’il implique la négation des deux réalités dont il est le rapport. C’est quand le rapport, au lieu de se concevoir par rapport à ses termes, est rapporté à lui-même, qu’il devient un « tiers positif » : il est le moi. Or, la situation de ce rapport est particulière, car il a été posé par autre chose que lui-même. On retrouve là, au fond, le thème traditionnel selon lequel le moi ne porte pas en lui-même la raison de son existence ; ce qui, en termes chrétiens, revient à dire que l’homme est une créature de Dieu. À partir de là, l’auteur considère que le désespoir consiste à vouloir se défaire de son moi pour un autre de sa propre invention, mais sans jamais pouvoir y parvenir. Ainsi est-il posé en dérivation. Cela peut paraître problématique, car pourquoi Dieu aurait-il créé cette distorsion capable de conduire au désespoir ? Contradiction avec la perfection qu’il est censé incarner ou bien pour que sa créature ait une chance de le trouver dans la Crainte et le Tremblement ? 171
HORS DU TEMPS
?
C’est ce que l’auteur semble suggérer lorsqu’il revient sur le commandement que Dieu a fait à Abraham de sacrifier son fils Isaac1. Cet acte se heurte, bien sûr, aux convictions éthiques d’Abraham. Mais ce dernier, décidé à prouver sa foi, se résout à surmonter son désarroi et à obéir au commandement divin. Pour cela, il se situe précisément au-dessus de la généralité du point de vue moral2, « dans un rapport absolu avec l’absolu3 ». C’est cette « suspension téléologique du moral4 », qui offre à Abraham la possibilité de prouver son engagement envers Dieu qui, en retour, épargnera son fils. Ainsi le scandale et le paradoxe qu’illustre le cas d’Abraham doivent-ils révéler la spécificité de la foi. Celle-ci se distingue radicalement de la moralité abstraite telle que, notamment, la formule la raison pratique kantienne ; elle est une autre sphère, non pas raisonnable mais purement religieuse. C’est pourquoi le devoir religieux peut commander au-delà de la loi morale, voire contre elle. À travers le cas exemplaire d’Abraham, Kierkegaard tient à marquer que la sphère religieuse ne peut être atteinte par la continuité du raisonnement, mais seulement par une décision, un saut qualitatif à même de donner un sens supérieur à son existence. De même, pour s’éviter le désespoir, l’individu doit accomplir le « saut de la foi », garant de son accomplissement. L’homme est appelé sur ce chemin de la foi, précisément par le sentiment d’angoisse et le désespoir de sa condition. Le désespoir de Kierkegaard apparaît au fond comme la « distorsion » nécessaire qui mène devant Dieu5, un Dieu qui l’appelle d’autant plus par son sacrifice. D’où le « saut » accompli ou, selon ses propres termes, « la plongée » en mesure de l’ouvrir à la part d’éternité de son moi. « Dans le possible le croyant détient l’éternel et sûr antidote du désespoir ; car Dieu peut tout à tout instant. C’est là la santé de la foi, qui résout les contradictions6 ». La foi est ainsi le saut depuis les « contradictions ». La foi ou le désespoir extirpé : « le contraire de désespérer c’est croire ; […] la formule d’un état d’où le désespoir est éliminé, se trouve donc être aussi la formule de la foi : en se rapportant à soi, en voulant être soi, le moi plonge à travers sa propre transparence dans la puissance qui l’a posé7 ». C’est dire,
1
La Genèse, chap. 22, 1-19. Point de vue qui énonce que le père doit aimer son fils plus que lui-même. Selon l’exigence morale, Abraham n’est pas le héros de la foi, mais un infanticide. 3 S. Kierkegaard, Crainte et Tremblement, op. cit., p. 86. 4 Ibid. 5 « Le moi est la synthèse consciente d’infini et de fini qui se rapporte à elle-même et dont le but est de devenir elle-même, ce qui ne peut se faire qu’en se rapportant à Dieu », Dieu étant la puissance qui a posé le rapport. Voir S. Kierkegaard, Traité du désespoir, in Miettes philosophiques – Le Concept de l’angoisse – Traité du désespoir, Gallimard, « Tel », 1990, p. 375. 6 Ibid., p. 386. 7 Ibid., p. 396. 2
172
HORS DU TEMPS
?
comme Camus déjà le remarquait, que « l’antinomie et le paradoxe deviennent critères du religieux. Ainsi cela même qui faisait désespérer du sens et de la profondeur de cette vie lui donne maintenant sa vérité et sa clarté1. » Il faut souligner tout d’abord que la démarche de Kierkegaard est emblématique d’une pensée chrétienne tragique au regard de laquelle l’approche plus générale de la vie religieuse est nettement moins déchirante. Ceci étant, l’approche kierkegaardienne de la foi d’après la philosophie des stades, renvoyant l’individu à son intériorité, a le mérite de faire sauter bien des vernis spéculatifs. Ainsi s’oppose-t-elle radicalement aux philosophes qui voudraient faire de la religion un idéal moral, à la manière de Kant, ou un moment du devenir de l’Esprit, à la manière de Hegel. Le philosophe danois se situe loin, non seulement de la pensée qui se fige en système, mais aussi de la foi qui s’abrite derrière des doctrines et des dogmes érigés par les théologiens, pour restituer à la foi sa dimension proprement spirituelle, la nature intime du choix de soi marqué par la rupture, le saut, termes emblématiques de l’acte de foi. En cela, à l’instar de Pascal, il souligne avec force les illusions de la philosophie rationaliste qui se figure que l’on peut atteindre la certitude de la foi en escamotant le moment du saut ou du pari. Mais cela ne met-il pas d’autant plus en évidence que, même lorsque la modalité religieuse s’affirme comme délibérément complexe, voire poignante, la perspective qui est la sienne, invitant à dépasser le moi empirique, vise, dans tous les cas, à glisser sur la contingence radicale de notre individualité, comme l’on escamote une partition musicale ? En ne jouant pas la note majeure ou, plutôt, en la rendant trop brièvement ? De sorte que l’on peut remarquer, avec Camus, que, quelle que soit la profondeur des pensées déployées, qu’il s’agisse de Pascal ou de Kierkegaard, l’enjeu est toujours d’échapper à la contingence, de « guérir » sitôt que l’on entre dans le registre religieux. L’abondance de vocabulaire à connotation médicale en atteste, particulièrement chez Kierkegaard. Point remarquable que cette complicité entre discours religieux et discours médical… Kierkegaard veut « guérir2 » comme en témoignent les termes médicaux qu’il ne cesse d’employer, tels que « antidote » ou « santé de la foi ». Mais faut-il guérir ? L’angoisse, en révélant l’homme en charge de son existence, doit-elle désigner pour autant la condition d’une liberté pourvue de transcendance ? La mort doit-elle être déniée sitôt qu’elle est reconnue ? Ne peut-on l’affronter sans considérer celle-ci comme déjà vaincue ? Et être prêt à tamiser de la sorte l’angoisse humaine ? Sommes-nous tenus d’atteindre l’équilibre au point d’espérer une transfiguration du réel ? À
1 2
A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 46. Ibid., p. 47.
173
HORS DU TEMPS
?
l’encontre du chevalier de la foi, l’on peut estimer, comme Camus y insiste, que l’important n’est pas de « guérir », mais de « vivre avec ses maux »1. Être sans espoir, ne pas attendre autre chose capable de briser l’insignifiance de nos cheminements, ne signifie pas désespérer. Nous avons tenté de le mettre en évidence au terme de notre questionnement sur l’acte suicidaire. Dans la mesure où subsiste un appétit de vivre, l’existence peut trouver son champ d’expression sans demander une justification supérieure. Elle peut être appréhendée et vécue comme ce cheminement qui se sait tendre sans cesse vers la chute, mais qui, s’il est habité d’une saveur persistante, peut se nourrir de sa propre stimulation. Stimulation qui trouve ses points d’appui à travers un certain nombre de termes importants : curiosité, promotion de l’instant créateur, humour et allégresse, dont nous tenterons de creuser le sillon. Pour l’heure, en tout cas, s’exprime, outre un sens aigu de notre propre dérision, la volonté d’appréhender l’existence hors de la perspective compensatoire proposée par la vision religieuse. Comme le relève Ion Omesco, la mort tragique n’est telle que si l’on ne peut trouver avec elle un quelconque accommodement, que si elle garde son caractère implacable. « La mort suivie par la résurrection, donc dépourvue de la négativité absolue qui lui est propre, tourne au faux-semblant2. » L’exigence est bien plutôt de s’employer à ce que Cioran nomme un « exercice de défascination3 », en excluant tout arrière-monde ou arrièrepensée, destinés à faire de la mort une fin provisoire. C’est pourquoi la pensée tragique ne peut guère se retrouver dans les idées de Rédemption et de salut visant à nous décharger du poids de notre finitude, parce qu’elle estime au plus profond que cela revient à dissimuler à l’homme sa mortalité constitutive. Pour l’homme qui prend la mesure de sa condition et se confronte alors à la précarité de celle-ci, il y a le vertige, l’angoisse, mais aussi très certainement l’appréhension de la vie comme un séjour mystérieux. Et l’on peut souscrire à l’analyse d’Edgar Morin qui voit, dans la confrontation de l’homme à l’énigme de sa condition, une source importante de l’élan religieux. « Je crois que cette métaphysique d’une vie au-delà de nos vies ne vient pas seulement de la mort, elle vient aussi du mystère de l’existence. Méditer sur l’existence donne, par opposition à l’idée de finitude, la presque 1
Ibid. I. Omesco, La Métamorphose de la tragédie, PUF, « Littératures modernes », 1978, p. 106. 3 Cioran, Le Mauvais Démiurge, in op. cit., p. 1249. Cioran emploie cette expression pour qualifier, en particulier, le scepticisme pyrrhonien qui savait jouer son rôle éminemment déstabilisant vis-à-vis des croyances. Estimant que la vie tout entière ne connaît « rien de plus profond » que l’apparence, le pyrrhonisme retrouvait un niveau d’indivision de la réalité, faisant de cette pensée une philosophie radicalement a-religieuse. Comme le commente Conche, à partir du moment où « l’intérieur » des choses disparaît, où se volatilise la dimension de la profondeur et de l’essence, « c’est aussi toute la sphère de la religion qui ne trouve plus aucune place ». (M. Conche, Pyrrhon ou l’apparence, op. cit., p. 179). 2
174
HORS DU TEMPS
?
idée de l’infini. Mais nous supportons mal cette idée de finitude. C’est elle pourtant qu’il faudrait finalement supporter1. » Nous l’avons mis en évidence avec la perdition : le tragique de la destinée humaine, ce n’est pas tant que tout va s’arrêter, mais ce démenti de la marche humaine par le fait que toute évolution implique involution, cette « contradiction intestine » dont Jankélévitch a si finement découpé les arêtes tranchantes, qui vient sans cesse enrayer sa marche et anéantir toute perspective sensée. Distorsion qui affecte l’homme dans la totalité de son être, son tragique même. Il nous paraît alors primordial d’insister sur le fait, au-delà de toutes les tentatives de relativisation, des paris ou des médications que l’homme se propose, que la mort n’est pas le mourir. Autrement dit, cette somme de petites morts qui jalonnent le trajet de l’existant, dont la vieillesse n’est ellemême qu’un indice et dont la mort finale ne constitue, pour ainsi dire, que le dernier jalon. La mort n’est pas réductible au trépas, à un accident de parcours, elle est présence. Existence usée dans son principe même, constituant notre mortalité intime, à l’image des personnages que Beckett nous demande de considérer. Si la croyance en une transcendance vient offrir un sens supérieur à l’inquiétude humaine, elle n’ôte rien à cette exposition de chaque instant caractérisant notre existence. C’est pourquoi la conscience tragique, si elle entend rester fidèle à ellemême, ne porte pas son regard vers le ciel, elle chemine sans échappatoires possibles. Son seul registre est celui de l’impitoyable, car la mort ne sortira pas du théâtre le plus intime de la vie. On a beau mettre des points de suspension à côté des tombeaux, cela ne change rien. « Oh ! ne me farde pas la mort, mon noble Ulysse2 !... » Conche reprend ces mots de l’ombre d’Achille dans l’Hadès qui expriment « le refus de toute illusion, la volonté de lucidité, qui est celle même d’Homère3 ». L’Hadès dépeint par Homère n’a rien d’un au-delà prometteur, il représente au contraire le triste séjour des défunts. Ce en quoi Achille répond à Ulysse qu’il aimerait mieux être un misérable serviteur plutôt que de régner sur des morts qui ne sont plus rien4. L’approche homérique vise, ainsi, à rejeter « tout ce que les religions et les philosophies ajoutent pour nous dorer la pilule de la vie. Il n’y a plus que la vie, sans plus, dans son évidence de buter sur la mort qui “tout achève” […]. Nous mourrons, il faut en prendre notre parti ; aucune promesse d’immortalité n’a été faite à l’homme, aucune 1
E. Morin, « L’homme et l’univers, du biologique au cosmique », Entretien avec Jean-Marie Brohm, Géraldine Noailly et Magali Uhl, 27 septembre 2001, p. 8 [En ligne]. Nous soulignons. http://www.philagora.net/philo-fac/edgar-morin/ (consulté le 12 décembre 2001) 2 Homère, Odyssée, Librairie Générale Française, « Le Livre de Poche », 1972, XI, p. 214. 3 M. Conche, « Devenir grec », Analyse de l’amour et autres sujets, PUF, « Perspectives critiques », 1997, p. 93-94. 4 « J’aimerais mieux, valet de bœufs, vivre en service chez un pauvre fermier, qui n’aurait pas grand-chère, que régner sur ces morts, sur tout ce peuple éteint ! » (Homère, Odyssée, op. cit., XI, p. 214).
175
HORS DU TEMPS
?
espérance qui aille au-delà de cette vie brève n’a de portée1. » Toute espérance de vie future est bannie. Il s’agit d’inciter l’homme à regarder la réalité en face, à épouser les termes de sa condition de mortel. Peut-on en cela, demande Conche, parler, comme d’aucuns, de « pessimisme radical2 » ? « Mais refuser de s’en laisser conter au sujet de la vie, la voir comme elle est, sous l’horizon de l’horreur finale, est-ce être “pessimiste”3 ? » La réponse est nette : c’est là une leçon, bien au contraire, « de lucidité et de courage », cherchant à « vivre la vie sur le fond d’une décision résolue »4. Le tragique nous paraît se maintenir seulement à ce prix, à cette lecture de la mort effectuée jusque dans ses dernières lignes. C’est dire combien, dans cette perspective, l’extrêmeonction, les poussières d’anges, la résurrection et son royaume des cieux n’ont pas droit de cité5. L’enjeu est de parvenir à s’affronter comme mortel. On pourrait répondre, pour finir, comme l’écrivain Charles Juliet à qui l’on demandait « Où est Dieu ? » : « Je n’ai aucune croyance. Je trouve que ce n’est pas ça l’important, ça ne change rien. Au contraire même, cette croyance peut détourner du travail que l’on a à faire sur soi-même6. » N’estil pas, à la limite, comme le disait ce prêtre avec qui s’entretenait l’écrivain, plus facile de croire en Dieu qu’en soi-même ? Contre ceux qui objectent le besoin humain de spiritualité pour conserver ses poumons à la religion, on peut estimer avec Juliet que nul n’est besoin de s’arrimer à une croyance pour avoir une quête spirituelle : « ça n’a rien à voir. Ça a à voir avec une nécessité intérieure. Cette démarche consiste à agir sur soi pour se transformer, se perfectionner, ce qui devrait être le propre de toute existence. »
1
M. Conche, « Devenir grec », op. cit., p. 94. M. Conche pense ici à l’analyse d’Henri-Irénée Marrou dans son ouvrage Histoire de l’éducation dans l’antiquité. 3 Ibid., p. 94. 4 Ibid., p. 94-95. 5 « Rien de plus étranger à la tragédie que l’idée de rédemption, de salut et d’immortalité ! » (Cioran, Précis de décomposition, in op. cit., p. 656). 6 Ch. Juliet, « Charles Juliet croit-il en Dieu ? », Entretien avec Laurence Seguin, Le Progrès, 6 novembre 2001. 2
176
HORS DU TEMPS
?
Une vague supplique « Il est plus facile d’élever un temple que d’y faire descendre l’objet du culte. » Samuel Beckett, L’Innommable.
Le réel reprend ses droits, de n’être que ce qu’il est : dénué d’intention et sans recours. Du coup, les postures d’attente ou les prières prennent un jour, sinon cocasse, tout au moins désastreux. Si Dieu est envisagé, c’est dès lors, avant tout, comme une figure de l’absence. La question de Dieu n’est, par conséquent, pas tant celle de son existence que celle de son absence. Ne retrouvons-nous pas, sur ce point, le propos des épicuriens qui considéraient que les Dieux ne s’occupent pas de nous1 ? Quand bien même Dieu existe, il est apathique, indifférent, pas à la hauteur, irrémédiablement absent. Dieu représente l’absent. Mais qu’est-ce que l’absent ? C’est celui que l’on peut attendre, celui qui promet qu’il va venir et qui pose des lapins. Vide pénible de l’absent dont En attendant Godot rend un écho puissant : quel est ce pouvoir de ne se manifester que par l’absence et de laisser espérer indéfiniment ceux qui l’attendent ? Rappelons que Godot n’est pas Dieu2, et nous verrons que la figure divine est évoquée en tant que telle. Quant à Godot, on ne sait pas qui il est vraiment, les quelques informations distillées à son propos étant trop lacunaires. L’important n’est pas là ; au contraire, 1
Rappelons que l’école épicurienne entend dépouiller l’élan religieux de toute superstition, estimant que les dieux, installés au loin dans les inter-mondes, sont radicalement séparés des hommes. Dans l’imagerie populaire, les dieux font figure de gouvernants du monde manifestant leur toute puissance par l’ordonnancement régulier des phénomènes naturels et leur colère dès lors que ces mêmes phénomènes se révèlent désordonnés et dangereux – foudre, tremblements de terre, épidémies, etc. Porte ouverte au discours d’impiété, à l’imagination des Enfers, aux pratiques sacrificielles pour apaiser le courroux des dieux, important du même coup l’enfer imaginé dans la vie même. Une telle conception ne fait qu’entretenir les hommes dans la crainte des dieux et de la mort. En conséquence, elle aggrave leurs tourments et contribue à les rendre malheureux. Or, les dieux considérés hors de ces représentations, rendus donc à leur condition divine, ne se préoccupent pas des affaires terrestres. Aussi n’interviennent-ils aucunement dans la vie des hommes, tout autant dans sa part vitale que dans sa dimension mortelle. En rappelant que les dieux ne se soucient pas du monde, on porte à la crainte qu’ils inspirent un coup décisif capable de rendre l’homme à luimême. Voir Épicure, Lettre à Ménécée, in op. cit., 123, 124, p. 191-192. Voir aussi Lucrèce, De la nature, op. cit., livre I, p. 20, ainsi que le paragraphe achevant le livre II, p. 82. 2 Beckett l’a exprimé clairement : « Si j’avais voulu dire Dieu, j’aurais écrit en attendant Dieu (God). » (cité par B. Salino, « “En attendant Godot”, le jour où la terre a tremblé », Le Monde des Livres, Dossier « Samuel Beckett. La musique du silence », 2 juin 2006, p. 7). Voir aussi le témoignage d’Alan Schneider : « À notre toute première rencontre, j’ai demandé à Sam qui ou quoi était Godot, mais – heureusement – pas quelle en était la signification et il m’a répondu […] que s’il l’avait su, il l’aurait dit dans sa pièce. » (A. Schneider, « Comme il vous plaira. Travailler avec Samuel Beckett », in T. Bishop et R. Federman (sous la dir.), Cahier de l’Herne / Samuel Beckett, Le Livre de Poche, « Biblio essais », 1990, p. 85).
177
HORS DU TEMPS
?
cette référence flottante, ce nom sans détermination précise, laisse toute la place à l’attente. Tout Godot se concentre dans ce terme1. Et Estragon nous le confirme : « On trouve toujours quelque chose, hein, Didi, pour nous donner l’impression d’exister2 ? » Aussi, voir dans l’attente de Godot, à laquelle se consacrent Vladimir et Estragon, une véritable quête d’un signe divin paraît abusif. Jean Onimus, notamment, procède à une telle assimilation3. Or l’auteur, malgré l’intérêt de ses réflexions, s’autorise sans doute d’une interprétation que l’œuvre se garde bien de livrer avec autant de netteté. Il semble oublier, en particulier, que l’humour, même franchement noir, ne cesse pas d’être présent et doit inciter à une interprétation nuancée des « symboles » divins que Beckett intègre dans la pièce. À travers (God)ot, outre sans doute une pirouette amusée de l’auteur, se déploient certes nombre de motifs religieux. La structure ouverte de l’œuvre autorise des jeux de mots, des allusions divines. Et, à travers un subtil tissage de citations et de références, Beckett ne laisse pas, en effet, d’introduire un arrière-plan religieux. Ainsi, notamment, mentionne-t-il la Terre sainte et l’histoire des larrons dont un seul fut sauvé, Estragon et Vladimir s’interrogeant au passage sur cette version des faits4. Réflexions et lieux communs reviennent aussi fréquemment, tels que « Tu crois que Dieu me voit5 ? » ou encore « À chacun sa petite croix6. » Non d’ailleurs précisément, comme ces répliques le laissent entendre, sans une certaine part de dérision. Mais revenons à Godot et à la dimension d’attente du temps qui s’offre à notre œil de spectateur. Ce temps-là pourrait représenter une force, puisque, englobé par l’attente, au lieu de se ratatiner sur lui-même, il semble se dilater considérablement. L’existence supposée de Godot, l’affirmation qu’on l’attend, plus encore, qu’il faut l’attendre semble, en effet, donner sens et épaisseur au fait qu’on se cramponne à ce temps qui s’écoule. VLADIMIR. – Que faisons-nous ici, voilà ce qu’il faut se demander. Nous avons la chance de le savoir. Oui, dans cette immense confusion, une seule chose est claire : nous attendons que Godot vienne. ESTRAGON. – C’est vrai.
1
« Godot est le nom de l’attente. » (L. Janvier, Pour Samuel Beckett, 10/18, 1973, p. 145). EAG, p. 97. 3 J. Onimus, Beckett, un écrivain devant Dieu, Desclée de Brouwer, « Les écrivains devant Dieu », 1968. Voir le chapitre intitulé « Dieu ? ». 4 À travers les interrogations de Vladimir, Beckett se réfère aux différentes versions des quatre évangélistes : un seul d’entre eux relate les faits en parlant de ce voleur sauvé, les deux autres n’en parlent pas, tandis que le dernier « dit qu’ils l’ont engueulé tous les deux », reprochant au Christ de ne pas les sauver de la mort. Pourquoi ces différentes versions des faits, alors que les quatre étaient théoriquement présents ? Pourquoi la version d’un des larrons sauvé sur les deux est-elle la seule qui soit généralement connue ? Estragon en conclut que « les gens sont des cons » (EAG, p. 14-16)… 5 Ibid., p. 108. 6 Ibid., p. 87. 2
178
HORS DU TEMPS
?
VLADIMIR. – […] Nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes au rendez-vous. Combien de gens peuvent en dire autant1 ?
Ainsi, Pozzo qui a priori incarne l’homme actif, toujours en mouvement et satisfait de lui-même, en dehors du temps de l’attente, finit par s’écrouler et est incapable de se relever seul. Pozzo fuit les temps morts, se sent solide, croit avoir réussi. Mais le temps le rattrape malgré tout et le frappe durement sans qu’il n’ait rien pu maîtriser. D’où, sans doute, son énervement final aux questions de Vladimir lui demandant quand et comment sa cécité ainsi que le mutisme de Lucky sont-ils survenus. – Quand ! Quand ! Un jour, ça ne vous suffit pas, un jour pareil aux autres il est devenu muet, un jour je suis devenu aveugle, un jour nous deviendrons sourds, un jour nous sommes nés, un jour nous mourrons, le même jour, le même instant, ça ne vous suffit pas2 ?
Vladimir et Estragon, eux, se livrent à la fragilité, réfléchissent davantage à leur existence, la meublent en tout cas sans agitation excessive. Et ce sont eux qui, malgré leur épuisement, relèveront Pozzo. L’homme actif, lorsqu’il tombe, est incapable de se remettre sur pied par lui-même ; il ne sait que crier au secours. Comme le souligne Onimus, l’écart entre les couples Vladimir-Estragon et Pozzo-Lucky est à cet égard intéressant. De là à voir dans l’attente de nos deux vagabonds, en contraste avec la vie trop accélérée de Pozzo et Lucky, l’expression d’« une force qui est l’espérance », Godot étant le symbole « de la plénitude, le don de la vraie vie »3, l’on peut considérer là encore qu’il s’agit d’une interprétation excessive. Car que nous dit Godot, caricature, sinon que l’on a sans doute tort de l’attendre ? Godot s’annonce comme une figure qui masque un vide sans terme. Expression de l’attente vaine du sens, Godot ne viendra pas, ne sait qu’indéfiniment rater ses rendez-vous. Se figure-t-on, d’ailleurs, que Vladimir et Estragon attendent vraiment Godot au sens où ils attendraient un vrai secours ? Ne savent-ils pas au fond qu’ils ont tort de l’attendre ? Tout au moins ne saventils pas trop ce qu’ils doivent en attendre : VLADIMIR. – Je suis curieux de savoir ce qu’il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. ESTRAGON. – Qu’est-ce qu’on lui a demandé au juste ? […] VLADIMIR. – Eh bien… Rien de bien précis. ESTRAGON. – Une sorte de prière. VLADIMIR. – Voilà. ESTRAGON. – Une vague supplique.
1
Ibid., p. 112. Ibid., p. 126. 3 J. Onimus, Beckett, un écrivain devant Dieu, op. cit., p. 84. 2
179
HORS DU TEMPS
?
VLADIMIR. – Si tu veux1.
Attente d’un secours, petit secours. Être auprès de Godot, ce serait, pour ce qui peut en être formulé, avoir la possibilité de dormir « au chaud, au sec, le ventre plein, sur la paille2 », être regonflés, rassasiés, sauvés3 de leur indigence de vagabonds. S’il venait… Beckett sonde jusqu’à la lie cette absence, ce puits du rien en livrant ses personnages au jeu éreintant de l’attente. Qu’ils croient ou non à sa venue n’a, au fond, aucune importance ; ce que montre Beckett, c’est bien, nous semble-t-il, la stérilité de l’attente. L’existence humaine se joue sans recours. Et si l’on prolonge cela jusqu’à la figure divine elle-même, il ressort que l’important n’est pas tant la question de l’existence de Dieu (et s’il y avait à pencher d’un côté, ce serait plutôt de celui de son inexistence) que celle de son absence. Tout se joue en l’homme. C’est de cette croyance en son existence, disons de manière large en celle d’une transcendance, que jaillissent une bonne partie des problèmes des individus, même si c’est de là aussi que naît une consolation. Ne rien attendre de l’extérieur et devoir n’attendre que de soi est évidemment plus angoissant et perçu par beaucoup comme le pire des poisons. D’aucuns estiment, nous l’avons vu, qu’il est primordial de parier ou qu’il faut « guérir ». Si l’on veut donner une signification aux nombreux éléments religieux distillés dans En attendant Godot, une telle perspective salvatrice est évoquée sous un jour sinon grotesque, tout au moins des plus défavorables : elle permet de faire patienter les hommes dans le meilleur des cas et, au pire, de les tromper. Car Godot semble consciemment jouer un tour : il sait entretenir l’attente en faisant dire au garçon qu’il viendra demain et semble se nourrir d’un jeu cruel ou d’une indifférence réitérée. Rien ne vient. Pas d’écho. Significatif est le moment où Vladimir croit entendre l’approche de Godot, alors que ce n’est que le bruit du vent dans les roseaux4. D’ailleurs, même lorsque « quelque chose » vient, c’est sous les dehors de messagers ou porte-parole supposés de Godot qui n’ont rien à dire, ou seulement des banalités. Comment mieux mettre en évidence l’inutilité dérisoire de toute croyance en ce qui pourrait constituer l’amélioration de notre condition. Et ce, d’autant plus grâce à des moyens surnaturels. Au bout du compte, la vision religieuse du monde peut difficilement ne pas être appréhendée comme un leurre et comme un empêchement majeur à rester lucide. Il est des termes mal entendus qui sont des plus significatifs. Ainsi, lorsque Vladimir, à propos de l’histoire des deux larrons, rappelle qu’ils étaient voués à la crucifixion en même temps que le « Sauveur », Estragon l’interrompt avec un « Le quoi ? » Cette incompréhension apparente n’est 1
EAG, p. 23. Ibid., p. 25. 3 Ibid., p. 104, 133. 4 Ibid., p. 25. 2
180
HORS DU TEMPS
?
sans doute pas fortuite, paraissant suggérer que l’idée de salut est tellement peu crédible que le mot de « sauveur » n’appartient pas au registre de vocabulaire susceptible d’être immédiatement audible. Le « raté » de communication n’est donc certainement pas anodin. Qu’est-ce à dire sinon que même si Dieu existe, il ne peut incarner qu’un étranger dont on aurait tort d’attendre quoi que ce soit ? En aucun cas, il ne peut évoquer un père protecteur. N’oublions pas, par ailleurs, eu égard à la date d’écriture de la pièce en 1949, que Vladimir et Estragon peuplent le monde issu de la seconde guerre mondiale, celui des camps d’extermination, des goulags, des ruines et de la bombe nucléaire. Ils portent donc aussi ce vide-là. Si bien que leur ciel est d’autant plus déserté. Inutile d’y chercher une quelconque transcendance. « Le maître en tout cas, nous n’allons pas […] commettre l’erreur de nous en occuper, il s’avérerait un simple fonctionnaire haut placé, à ce jeu-là on finirait par avoir besoin de Dieu, on a beau être besogneux, il est des bassesses qu’on préfère éviter. Restons en famille1 ». La croyance n’est pas vécue comme un audacieux pari, mais plutôt comme un relâchement. Se joue ainsi tout le contraire d’une fin porteuse de l’espérance, d’une rédemption. De même, il est des prières difficiles pour qui sent l’aspiration du néant. Au premier acte de Oh les beaux jours, Winnie, cherchant un stimulant pour commencer sa journée, entame une prière, comparable à une sorte de rite, « d’arrière-prière inaudible2 », qui peut susciter chez le spectateur tout autant ironie que pitié : « prières peut-être pas vaines3 ». À la fin du premier acte, elle s’encourage à prier, mais sans le faire, semblant déjà manquer de l’entrain suffisant : « Et maintenant ? […] Chante ta chanson, Winnie. (Un temps.) Non ? (Un temps.) Alors prie. (Un temps.) Prie ta prière, Winnie4. » Elle le répète encore une fois avant que le rideau ne se ferme : « Prie ta vieille prière, Winnie5. » Au deuxième acte, avec l’ensevelissement avancé de son corps, elle a perdu le goût de la prière : « Je priais autrefois. (Un temps.) Je dis, je priais autrefois. (Un temps.) Oui, j’avoue. (Sourire.) Plus maintenant. (Sourire plus large.) Non, non. » Le fugace sourire s’éteint et est suivi d’une pénible réflexion : « Autrefois…maintenant…comme c’est dur, pour l’esprit6. » Prière rendue illusoire et dérisoire par l’atroce expérience de la vie et du temps. Winnie est désormais purgée des faux espoirs et, en disant « oui, j’avoue », elle semble confuse d’avoir pu espérer auparavant. Cet autre chose illusoire, qui trahit en se dérobant à l’attente ou à la prière, laisse un paysage humain vide et accablé. Fin de partie expose cela avec force : 1
S. Beckett, L’Innommable, op. cit., p. 146. OBJ, p. 13. 3 Ibid., p. 17. 4 Ibid., p. 56. 5 Ibid., p. 57. 6 Ibid., p. 61. 2
181
HORS DU TEMPS
?
HAMM. – Prions Dieu. […] Vous y êtes ? CLOV (résigné). – Allons-y. HAMM (à Nagg). – Et toi ? NAGG (joignant les mains, fermant les yeux, débit précipité). – Notre Père qui êtes aux… HAMM. – Silence ! En silence ! Un peu de tenue ! Allons-y. (Attitudes de prière. Silence. Se décourageant le premier.) Alors ? CLOV (rouvrant les yeux). – Je t’en fous ! Et toi ? HAMM. – Bernique ! (A Nagg.) Et toi ? NAGG. – Attends. (Un temps. Rouvrant les yeux.) Macache ! HAMM. – Le salaud ! Il n’existe pas1 !
Malgré l’effort de mise en scène et de concentration, ça ne prend pas : les dés sont pipés. « Le salaud ! Il n’existe pas ! » L’espérance religieuse est discréditée et défigurée. Les personnages se sentent abandonnés dans une atmosphère empoisonnante, affirmant le néant qui les cerne. Beckett, on le voit, met en scène une nette gradation dans la déchéance. Dans Godot, il y a encore place au manège de l’attente, même si cette attente est essentiellement indéterminée. Dans Fin de partie, nous sommes au-delà de l’attente. Les personnages, les décors, le langage qui s’effiloche : « c’est le monde après la mort de Dieu2 ». L’univers est sombre et bouché, car il n’y a rien à attendre, aucun changement significatif à espérer. Nous arrivons à ce moment, comme le montre Onimus, où la révolte et l’horreur débouchent sur une sorte de désolation lucide et sereine : intériorisation d’un « Dieu-néant » donc, qui, à force d’exténuer sa créature, a fini par épuiser « les réserves d’angoisse qui lui donnaient prise sur elle − et l’abandonne hébétée, le regard figé sur le Rien3 ». On n’attend plus rien et c’est sans doute pourquoi l’on peut flairer de nauséabondes émanations dans la chambre grise où Hamm se meurt. HAMM. – Toute la maison pue le cadavre. CLOV. – Tout l’univers4.
Rappelons l’effort déployé pour couper court à tout germe de vie, l’empêcher coûte que coûte de renaître. Cela n’est peut-être pas sans lien avec cette mort de l’attente qui a rendu toute sa place au temps mortifère, au point que l’on fait en sorte de stopper tout élan vital. Là où, en tout cas, Vladimir et Estragon occupaient encore leur temps à regarder dehors, Hamm et Clov, rivés à leur intériorité, exposent et épousent le temps lui-même, cru, nu, qui les condamne irrémédiablement. Sans aucun dehors à considérer, 1
FP, p. 75-76. J. Onimus, Beckett, un écrivain devant Dieu, op. cit., p.76. 3 Ibid. 4 FP, p. 65. 2
182
HORS DU TEMPS
?
occupés « à se sentir dedans », ils « parlent le temps, ils le portent et le respirent : ils le jouent »1. Hamm en particulier, qui n’a de cesse de parler ce temps et de dire sa fin, incarne au plus près ce moi privé de toute illusion, de tout conduit d’échappement que peut proposer l’attente. Et, à travers la parole de Hamm, subjectivité aux prises avec la nécessité d’exprimer « le moi dans le temps », c’est bien « ce présent sans espoir, sans plus aucun espoir, du plus près qu’il était possible2 » que nous partageons. Nul recours, donc, pour la créature qui reconnaît sa solitude radicale. « L’Égéen, assoiffé de chaleur, de lumière, je le tuai, il se tua de bonne heure, en moi3 », dit Molloy. Le destin de tout un chacun est scellé par la mort. Croire en Dieu, c’est d’une manière ou d’une autre desserrer l’étau. Lien indissoluble du temps et de la mort au sein d’un univers indifférent, paysage de ruines où le désordre ici-bas ne renvoie à aucune espérance dans l’au-delà. On songe alors au couple Rooney, secoué d’un rire ravageur à l’annonce du texte du prêche du lendemain : « L’Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse tous ceux qui sont courbés4. » Le vieux couple formé par Maddy, s’éprouvant transparente à force d’épuisement5, et Dan Rooney, aveugle et usé lui aussi, se situe au bord du dernier glissement. Leur démarche est courbée, leurs pas traînants, leur souffle court. Comment accueilleraient-ils la phrase biblique sinon par un « rire sauvage » ? L’Éternel ne parvient ni à soutenir, ni à redresser, il est symbole plutôt d’impuissance et de dérision. Que l’on soit amoindri comme les Rooney ou que l’on doive parfois ramper dans la boue comme Molloy, ne permet aucunement d’espérer une patrie ailée et angélique. Imaginer une telle patrie est une rêverie consolante qui n’a pas grand-chose à dire à l’être purgé de l’illusion. La misère de l’homme est bel et bien sans Dieu. Les cieux sont vides. Pas de richesse promise après la mort qui n’apparaît décidément pas comme la porte de la vraie vie. Federico Garcia Lorca, avant d’être fusillé, s’est exprimé sur l’impossible élévation : « La douleur de l’homme et l’injustice constante qui sourd du monde… mon propre corps et ma propre pensée m’empêchent de transporter ma maison dans les étoiles6. » Nous ne voyons autour de nous que vie mortelle. Nous nous savons mortels, et c’est la raison pour laquelle la foi n’a pas d’assise rationnelle et se condamne à l’absurde. S’il est évidemment toujours possible d’avoir foi en une survie, de croire à l’immortalité de l’âme, cela ne relève que du domaine de la pure croyance et ne repose donc sur aucune certitude d’ordre 1
L. Janvier, Pour Samuel Beckett, op. cit., p. 172. Ibid., p. 174. 3 S. Beckett, Molloy, op. cit., p. 38. 4 S. Beckett, Tous ceux qui tombent, Minuit, 1957, p. 73-74. 5 « Ne vous occupez pas de moi. Je n’existe pas. Le fait est notoire. » (Ibid., p. 26). 6 A.-F. Hubau et R. Lenglet (anthologie), Le Dernier Mot, Librio, 2005, p. 82. 2
183
HORS DU TEMPS
?
un tant soit peu rationnel. Seule est certaine notre mort constitutive. L’homme est mis face à sa petitesse, ramené à sa petite aventure. Sous les dehors, donc, non d’un accomplissement dont s’alimente l’espérance, mais d’une disparition pure et simple. Cette perspective entame le projet d’espérer et ne parle plus que de gravité. Nous avons insisté sur le lien indissoluble de la vie et de la mort au sein duquel s’écrit notre partition d’existence. Et il nous semble, au terme de cette réflexion sur la part religieuse que l’homme est disposé ou non à se reconnaître, que celui-ci, dès lors qu’il est pleinement intériorisé, peut apporter un dernier élément de conclusion. Si, comme le reconnaît Mehl, rien ne peut interdire à l’homme, rendu à sa part intime et émotionnelle, d’estimer que cela vaut la peine de parier, il note par ailleurs un point d’importance qui achève de creuser l’écart entre la vision religieuse et la vision tragique de l’existence. L’auteur remarque, en effet, que « plus nous intégrons la mort à notre existence, plus nous l’humanisons, au point de la faire servir à l’édification de notre sagesse, plus aussi nous comprenons que cette survie n’a de sens que si elle est la survie de notre subjectivité la plus intime, la plus engagée dans notre existence charnelle présente, et moins par conséquent nous apercevons les garanties raisonnables de cette survie1 ». Dans la prison, l’aumônier, désemparé par la résistance de Meursault aux arguments qu’il s’essaie à développer, s’écrie dans un dernier dépit : « Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu’il vous est arrivé de souhaiter une autre vie2. » Face à son insistance, Meursault répondra que ce souhait ne saurait être autre que celui d’une « vie où je pourrais me souvenir de celleci3 ». Les souhaits d’une autre vie sont tissés de la traversée de celle-ci et de sa précarité indissoluble. Le vœu sans contours précis, formulé par le croyant, d’ouverture sur un ailleurs n’emporte-t-il pas sa subjectivité dans toute sa texture temporelle ? Et si, fidèle au message religieux, il prétend n’y voir que l’emportement d’une âme par un vent sacré, cette seconde vie, débarrassée de sa chair et de son sang, ne peut guère apparaître, aux yeux du regard tragique, qu’avec la texture d’une image. Pascal et Kierkegaard ont tous deux tenu à souligner les limites de la raison, s’agissant de la sphère religieuse, pour restituer sa place à la spiritualité du cœur. « Mais, selon les mots de Camus, si je reconnais les limites de la raison, je ne la nie pas pour autant, reconnaissant ses pouvoirs relatifs4. » Dès lors, la plongée dans le divin dont s’autorise l’individu religieux peut-elle sans conteste sacrifier son intelligence à l’irrationnel et, à ce point, liquéfier l’écho de sa chair ? Cette réussite provisoire qu’est l’éclosion d’une subjectivité est inséparable de notre incarnation charnelle. 1
R. Mehl, Le Vieillissement et la mort, op. cit., p. 136. A. Camus, L’Étranger, op. cit., p. 181. 3 Ibid. 4 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 48-49. 2
184
HORS DU TEMPS
?
Tout autant que sa déchirure intime, l’éclat de notre subjectivité relève de notre contingence, de notre finitude même. « La prise de conscience de notre subjectivité historique et incarnée frappe d’insuffisance et de vanité toutes les preuves de l’immortalité de l’âme. L’existence que la mort nous aide à dévoiler est aussi celle que la mort menace de la façon la plus aiguë1. » La vision tragique du destin humain ne peut se satisfaire de toute tentative visant à nous décharger du poids de notre finitude, non pour brandir un étendard héroïque, mais parce qu’elle estime au plus profond que c’est là aussi vider l’existence de sa source même et escamoter immanquablement l’appréhension de la mort. C’est dire que la démarche par laquelle le moi cherche à discerner son moi éternel, pour sincère qu’elle puisse être, se vide d’autant plus de toute portée élévatrice. S’expose ainsi à ce stade, peut-on dire, une impossibilité tout autant rationnelle que viscérale de s’en remettre à une quelconque transcendance divine. L’homme tragique est seul avec sa conscience d’être au monde et, s’il peut en être embarrassé et parfois malheureux, il n’en est pas moins convaincu par l’absence de signification acceptable. Privés de toute réalité sensée, nous n’avons rien à espérer. Nous ne scellerons donc pas les noces du néant et de l’Infini, de la poussière et de la grâce lumineuse. L’angoisse n’est pas le « tremplin d’éternité » de Kierkegaard, mais l’expression indépassable de notre finitude. Il s’agit de maintenir le tête-à-tête avec le « presque rien », cette trame du réel, son étroit tissu. À l’horizon ne se profile aucun salut. La mort est disparition, annulation, non pas accès au royaume de la paix retrouvée. L’homme se sachant délaissé et mortel, connaissant la crudité de la vie, soumise au règne du seul hasard, ne peut s’en remettre aux promesses divines. Et nous retrouvons Œdipe, le vieil aveugle guidé par sa fille Antigone, errant sur les chemins de la Grèce, attendant que la mort le frappe. Œdipe s’est crevé les yeux, exprimant par ce geste combien il avait été aveugle et que, malgré tous ses efforts pour se soustraire à l’annonce de sa chute, il n’avait fait que rejoindre son Destin, nous offrant l’exemple flagrant des infortunes humaines. Le chœur l’a qualifié d’atheos, à entendre non pas comme incroyant au sens moderne du terme, mais comme abandonné des dieux, ramené à sa simple condition humaine. Délaissé par les dieux, il creuse sa condition d’humain dans sa radicale finitude, faisant ainsi l’expérience, selon l’analyse de Dastur, « de la solitude absolue à laquelle le condamne sa conscience d’être mortel2 ». Mais que va faire Œdipe ? Il va assumer son abandon, vivre sa propre mort. Si le chœur déplore la naissance, les maux susceptibles de traverser l’existence humaine ou encore « l’inamicale vieillesse3 » qui achève d’abattre l’homme pour le rendre à sa fin promise, « la Mort, qui termine tout », la pièce nous montre aussi, dans la 1
R. Mehl, Le Vieillissement et la mort, op. cit., p. 136. F. Dastur, Comment vivre avec la mort ?, Pleins Feux, « Lundis Philosophie », 1998, p. 25. 3 Sophocle, Œdipe à Colone, op. cit., v. 1211-1238, p. 129. 2
185
HORS DU TEMPS
?
figure d’Œdipe, un homme capable d’affronter son sort. « Œdipe est un héros qui a appris, dans l’épreuve, à renoncer à sa présomption, et qui désormais vit, en tant que simple mortel, chaque jour sa propre mort1. » Et Œdipe, à partir de là, pourra accéder à une certaine sérénité, en assumant pleinement sa mort, la laissant être ce qu’elle est tout simplement, sa disparition pure et simple. Le scénario d’Œdipe s’achève, rappelant que la grandeur de l’homme n’est pas étrangère aux souffrances qu’il a su traverser. « C’est donc quand je ne suis plus rien, que je deviens vraiment un homme2. » À partir du moment où est récusée toute espérance sotériologique, il n’est rien d’autre à proposer que de tenter de trouver une forme de sagesse tragique de la vie dans le seul rapport de soi à soi, dans l’alliance lucide de l’être et de la vie. La pensée tragique, si elle veut maintenir le cap, ne peut se vouloir un point de départ vers le royaume du divin. Car, comme le demande Dastur, la mort doit-elle vraiment être considérée comme une ennemie ? L’affronter signifie-t-il forcément la combattre ou tenter de l’esquiver ? N’est-il pas possible de déployer son existence en connaissance de cause, sans se mentir chaque jour à soi-même ou sans puiser dans la foi religieuse un sens capable d’atténuer le caractère tragique de nos cheminements ? N’y a-t-il pas, pour l’être humain, une possibilité d’assumer la mort et d’y consentir ? Possibilité qui ne serait pas alors l’expression d’une défaite, mais qui consisterait à voir dans la mort elle-même la condition de la vie et à considérer la mortalité pas seulement comme une limite, mais aussi comme cette « ressource secrète » dont se nourrit l’existence3. De l’homme absurde, Camus disait que, s’il refuse de se détruire, il n’acceptera pas davantage l’espérance religieuse qui est une autre manière d’éluder la question. La pensée tragique ne peut guère proposer, à l’instar des religions, une forme de salut coïncidant avec une évasion vers le ciel. Seule une entreprise terrestre paraît envisageable et encore sans velléités de bonheur « tout cuit ». Un art de vivre seul dont il nous faudra tenter d’énoncer les composantes. S’il est un pari déchirant et exaltant à soutenir, ce n’est pas celui de Pascal ou de Platon4 mais, comme nous essaierons de le formuler, celui d’une sagesse tragique. S’il est donc une forme de « salut » individuel, il n’est pas du côté d’une quelconque divinité à laquelle on s’en remettrait, mais à chercher ici-bas, au plus près de soi-même, dans un chaos assumé. 1
F. Dastur, Comment vivre avec la mort ?, op. cit., p. 26. Sophocle, Œdipe à Colone, op. cit., v. 393, p. 94. 3 F. Dastur, Comment affronter la mort ?, op. cit., p. 9. 4 Voir le Phédon où Platon exprime sa croyance en l’immortalité de l’âme, pari qu’il appréhende comme « un risque qui vaut la peine d’être couru. » (Platon, Phédon, in Œuvres complètes, op. cit., 114 d, p. 1236). 2
186
CHAPITRE IV SAGESSE TRAGIQUE « Sois ami du présent qui passe : le futur et le passé te seront donnés par surcroît. » Clément Rosset, Le Réel et son double.
Lors d’un entretien, les mots suivants sont adressés à Morin, après qu’il a évoqué le vide qu’il éprouve lorsque le traverse la pensée de sa mort : « Vous n’êtes pas réconcilié avec la mort… » Ce à quoi il répond : « Non, mais je ne suis pas vraiment fâché1. » Précisément parce qu’il estime, outre que la pensée de sa propre disparition ne manque pas de l’anéantir parfois, que le vivre ne peut acquérir une quelconque intensité s’il occulte le tragique. À partir du moment où le vivant intègre la mort dans les cellules mêmes de son organisme, vivre intègre la mort en soi. « Le vivant intègre donc la mort jusqu’à ce que celle-ci le désintègre. La vie joue son jeu tragique contre la mort. » C’est dire que sans acceptation de la mort et de sa cruauté, aussi bien dans l’espace restreint de nos existences personnelles, que dans celui des communautés humaines que nous tissons, l’humanité perd toute densité. Et Morin le rappelle : « Elle ne peut se regarder en face. Mais on peut la regarder de différents biais. Je crois que cesser d’occulter la mort implique non pas qu’on se réconcilie avec elle, mais qu’on dialogue avec. » Comme nous l’avons vu, il ne s’agit pas de « réconciliation », dans la mesure où la mort ne peut se départir de son étrangeté. Néanmoins, contre tous les jeux de masque, reste à défendre l’idée d’une mort assumée. Qu’entendre par mort assumée ? Pas tant une sérénité naturelle et dominée, qui prétendrait énoncer présomptueusement un savoir mourir, mais une mort non occultée. La mort ne pouvant guère s’essayer qu’une fois, l’on n’apprend pas à mourir. L’on peut néanmoins s’efforcer de s’approprier sa propre mort, de la prendre en charge sans se mentir à soi-même, en lui rendant son caractère non substituable. Comprendre, intérioriser ceci que la mort, immanente et intérieure à l’existence humaine, nous accompagne tout au long de la vie et qu’elle ne peut être réduite au dernier terme de celle-ci. Puisque la mort œuvre à l'intérieur de nos vies, ne cherchons pas à écarter la mort des sources de la vie.
1
E. Morin, Entretien avec Isabelle Taubes, novembre 1998 (dossier « La mort : pourquoi il faut en parler ») [En ligne] : http://www.psychologies.com/Moi/Epreuves/Deuil/Articles-etDossiers/La-mort-pourquoi-il-faut-en-parler/Edgar-Morin-Pour-vivre-il-faut-risquer-sa-vie (consulté le 29 mars 2004)
187
SAGESSE TRAGIQUE
Les joies mondaines sont-elles pour autant pulvérisées par la menace mortelle ? N’est-ce pas plutôt l’inverse que le tragique est susceptible de nous enseigner ? Le héros tragique est gai, comme le relevait déjà Nietzsche dans la Naissance de la tragédie. Les crêtes et les abîmes semblent voués à se croiser…
188
SAGESSE TRAGIQUE
I. Gammes de l’extrême Quel volontarisme ? « La grandeur de l’homme est sa déchirure. » Georges Minois, Histoire du mal de vivre.
À partir du moment où notre condition est reconnue dans sa tragique fluidité, où aucun point fixe n’est donné, aucune ligne de fuite acceptée, depuis un ordre ontologique et religieux du réel jusqu’aux bonheurs de pacotille que l’on nous propose, que reste-t-il ? Nous considérer comme une apparence fugitive dans un univers indifférent, n’est-ce pas alors nous condamner à un nihilisme absolu ? Nous parlions précédemment du « goût » susceptible de se poser comme un rempart contre la tentation suicidaire. À partir de là, quelle attitude peut être recherchée ? L’enjeu est d’importance : quelle voie peut ouvrir ce goût de vivre couplé à une pensée en possession de vérités qui le contrarient ? Comment peut-il se formuler en connaissance de cause, en conservant par conséquent sa pleine lucidité ? Une sagesse de l’existence est-elle envisageable ? Pourquoi, en premier lieu, nous relier à l’idée de sagesse ? Si nous considérons en particulier la philosophie antique, celle-ci se voulait moins la construction d’un système qu’un exercice préparatoire à la sagesse, un exercice spirituel résultant d’un choix initial pour un mode de vie. Mise en évidence du choix de soi comme existant. Sur ce point, il est important de ne pas oublier Socrate et son enseignement éthique, qui insistait sur l’exigence d’examiner sa vie et celle des autres, en évoquant la lucidité envers soi : « une vie à laquelle cet examen ferait défaut ne mériterait pas d’être vécue1 ». Autrement dit, une vie qui ne recherche pas, ne s’examine pas, n’est pas digne d’être vécue, n’est pas, en tout cas, digne d’un homme. Ainsi, soulignant là le rôle central de l’expérience personnelle, une philosophie désengagée de l’existence ne mérite-t-elle pas d’être étudiée. Pourquoi alors garder la notion de « sagesse » ? Elle paraît indispensable pour signifier l’exigence d’unité entre la vie et la pensée. De quoi ne pas oublier, avant la tentative de formuler une vision cohérente du monde, de l’homme ou du divin, jusqu’à parfois en édifier un système, que la philosophie maintenait l’idée de philosophie comme art de vivre. Et ce en tant qu’exercice raisonné, discursif d’une sagesse à conquérir. En quoi la philosophie est d’abord école où la pensée est animée du souci d’enseigner à l’homme une façon rigoureuse et réfléchie de se rapporter à sa propre vie. De quoi non pas réinjecter du sens où l’on n’en discerne pas,
1
Platon, Apologie de Socrate, in Œuvres complètes, op. cit., 38 a, p. 88.
189
SAGESSE TRAGIQUE
mais donner une perspective à son existence en la plaçant dans un effort de soi sur soi que la philosophie est à même d’incarner. L’idée de sagesse rappelle qu’il s’agit de devenir le sujet de son existence, d’apprendre à vivre son existence entière, en s’efforçant d’élaborer celle-ci comme une œuvre d’art. Nous retrouvons ici la force de l’idée de sagesse telle que nous l’ont léguée en particulier les sagesses hellénistiques qui se voulaient des arts de vivre, visant à une stylisation de l’existence. Quelle peut être, en second lieu, la coloration de cette sagesse ? Parler de « sagesse » dans le cadre du tragique suppose un certain nombre de précisions. En effet, accolée à son image traditionnelle, celle-ci évoque spontanément l’idée de détachement du monde, de retrait du tumulte de la vie, au profit d’une certaine quiétude exempte de souffrance. Cette sagesselà, à l’image notamment de celle de Bouddha, prône la libération de l’attachement aux choses de la terre, l’arrêt du cours des passions afin de nous épargner angoisses, chagrins et déceptions. Lorsque le Bouddha, dans la nuit qui suit le septième jour de sa méditation, parvient à la bodhi, l’Illumination, c’est bien cette révélation qui advient et constitue son premier enseignement : la quête de la délivrance de la douleur, de ce monde de douleur, moyen de se libérer du cycle des réincarnations, d’obtenir la délivrance finale dans cette forme d’anéantissement, d’extinction complète, que représente le nirvana1. Si l’on se reporte au texte fondateur du bouddhisme, le Sermon de Bénarès2, qui énonce les Quatre Nobles Vérités enseignées par Bouddha à ses disciples, l’on voit combien tout est placé sous l’aune de la douleur. Voici, ô moines, la vérité sur la douleur : la naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, l’union avec ce qu’on n’aime pas est douleur, la séparation d’avec ce qu’on aime est douleur, ne pas obtenir son désir est douleur, pour abréger, le quintuple attachement aux choses terrestres est douleur.
Tel est l’énoncé de la première vérité. La dimension proprement instable de la vie, on le voit, est à la source de la douleur aussi bien physique que mentale, nous amenant à subir déceptions et pertes. Le terme exact, traduit ici par « douleur », est dukkha. Peter Harvey précise que ce terme désigne toutes les choses déplaisantes. « C’est à la fois la “souffrance” évidente et l’“insatisfaction” générale de la vie. » Ce qui revient à mettre en évidence que la souffrance est inséparable du « tissu même de la vie »3. 1
Rappelons que la pensée bouddhiste repose sur la doctrine de la transmigration : tous les êtres vivants transmigrent sans fin d’une existence à une autre. Les délivrer de la douleur suppose de les délivrer de la transmigration, autrement dit de l’obligation de renaître et, par le fait même, de vieillir, souffrir et mourir à nouveau. 2 Sermons du Bouddha, chap. 11. Les citations utilisées sont extraites de l’ouvrage de J. Russier, La Souffrance, PUF, « Initiation philosophique », 1963. 3 P. Harvey, Le Bouddhisme. Enseignements, histoire, pratiques, Seuil, 1993, p. 72.
190
SAGESSE TRAGIQUE
La seconde vérité s’attache à détecter l’origine de la douleur : « c’est la soif de l’existence, qui conduit de renaissance en renaissance, accompagnée du plaisir et de la convoitise, qui trouble çà et là son plaisir ; la soif de plaisirs, la soif d’existence, la soif de puissance ». La douleur et l’existence ne font qu’un et l’origine de la douleur se situe « dans ce lien de causalité qui, à travers les péripéties des existences individuelles et de leurs renaissances, unit l’un à l’autre l’existence au désir et le désir à l’existence1 ». Comment alors supprimer la douleur ? Cela passe par une conversion, un renversement d’attitude, prônant « l’extinction de cette soif par l’anéantissement complet du désir ». Il s’agit donc, comme l’énonce la troisième vérité, de renoncer au désir. Seule cette mort du désir peut rompre l’attachement à l’existence de laquelle provient la naissance et, de là, maladie, vieillesse et mort, en somme le cycle infernal de la souffrance. Pour sortir de ce cercle vicieux, c’est donc bien l’attachement à l’existence même, celle-ci ne faisant qu’un avec ce trajet de douleur, qui doit être rompu par l’extinction du désir. La quatrième vérité énonce le moyen de parvenir à ce détachement capable d’abolir la douleur : il s’agit du « chemin sacré à huit branches », supposant un entraînement long et exigeant, consistant pour les cinq premières en des règles d’ascèse (ne pas tuer de vivant, ne pas voler, ne pas toucher à la femme d’autrui, ne dire que la vérité et ne pas boire de boissons enivrantes). À cela s’ajoute la méditation, correspondant aux trois dernières branches (« application pure, attention pure, méditation pure »), sans laquelle il ne saurait y avoir de véritable disciple. Par la méditation, ce qui apparaissait comme la source inévitable du malheur se révèle étranger au Moi et permet au disciple d’atteindre la délivrance. Ainsi le résultat visé estil explicitement un état de paix, de repos et d’égalité d’âme, en mesure d’aboutir à l’affranchissement de toute existence. Cette sagesse-là implique par conséquent, comme l’exprime Conche, « le recul devant le monde, le repli sur soi devant la difficulté d’être, le vouloir être le moins possible, le vouloir ne pas être2 ». Certes, le bouddhisme ne prône pas l’inaction, recommandant en particulier la bienveillance et la compassion envers les êtres souffrants. Néanmoins, dès lors que nos actions demandent à être accomplies avec le plus grand détachement possible, il s’agit bien de « glisser en ce monde3 ». L’effort de sagesse auquel invite le bouddhisme révèle ainsi son incompatibilité avec la pensée tragique. Celle-ci, comme nous avons tenté de le mettre en évidence au fil de notre réflexion, entend en effet montrer le réel dans toute sa crudité, non pour convaincre l’homme du mépris des choses terrestres et l’amener à rompre ses attaches sensibles, mais pour l’inciter, au 1
J. Russier, La Souffrance, op. cit., p. 71. M. Conche, Nietzsche et le bouddhisme, Encre marine, 1997, p. 14. 3 Ibid., p. 13. 2
191
SAGESSE TRAGIQUE
contraire, à une prise en charge lucide de la réalité. Désadhérer au monde, c’est sans doute obtenir une certaine accalmie, mais c’est aussi retirer à la vie toute densité. Trouverons-nous plus d’écho auprès des philosophies hellénistiques, stoïcisme, épicurisme, cynisme et scepticisme ? Toutes partagent ce trait commun de viser une sagesse définie comme ataraxie, libération des émotions troublantes. Quête d’autant plus appuyée qu’elle s’inscrit dans un contexte politique particulièrement troublé, incitant l’individu à compter avant tout sur ses forces propres1. S’il est une éthique, elle est une « éthique du salut individuel, un art de rester soi-même dans la dissolution de toutes choses2 ». Le type de sagesse incarné par les philosophies hellénistiques répond au besoin de trouver, dans un monde en proie au désordre et à l’insécurité, une forme d’équilibre, une quiétude non compromises par les vicissitudes extérieures. Quoiqu’il en soit, est reconnu là aussi le lien étroit qui unit existence et souffrance, celle-ci étant appréhendée selon la part prépondérante qu’elle occupe dans nos vies. Éradiquer ce qui peut perturber l’existence étant l’enjeu primordial, l’effort de l’homme sur lui-même consiste à supprimer ce qui, en lui, peut être source de souffrance. Parmi ces efforts entrepris par la sagesse humaine pour lutter contre la souffrance, nous choisissons de nous intéresser à l’école stoïcienne. Ceci, en premier lieu, pour la richesse de nombre de ses analyses psychologiques dont nous retrouverons la portée par la suite. La philosophie, conçue dans son indissociabilité avec la forme de l’existence que l’on est capable de se donner, se confronte aux limites de l’existence. D’où un sens aigu du temps : il s’agit de se rendre présent à l’existence, de savoir recentrer celle-ci sur son présent. Point essentiel sur lequel nous reviendrons. Pour l’heure, il s’agit de marquer, au-delà de la profondeur de la réflexion, les limites d’une approche tout occupée par la volonté de délivrance vis-à-vis de la souffrance. Que nous propose donc la pensée stoïcienne ? Eu égard aux maux qui nous guettent, la visée qu’est l’ataraxie, l’impassibilité, est difficile et, pour cela, exigeante. C’est pourquoi l’individu doit être disposé à considérer tous les autres biens comme de peu de prix. Épictète peut alors écrire en ce sens : « Il faut veiller, peiner, se séparer des siens, souffrir le mépris d’un jeune esclave, être raillé par les premiers venus, avoir en tout le dessous, dans les honneurs, dans les charges publiques, devant les juges et dans la moindre affaire. Pèse tout cela, si tu veux recevoir en échange l’impassibilité, la
1
Rappelons que s’opèrent alors de grands bouleversements à l’intérieur du monde grec : s’amorce la fin de la cité grecque classique pour le passage à la période hellénistique. Celle-ci va de la mort d’Alexandre le Grand (323) à la mainmise de plus en plus prononcée de Rome (197-30 av. notre ère). 2 M. Conche, Pyrrhon ou l’apparence, op. cit., p. 11.
192
SAGESSE TRAGIQUE
liberté, le calme1. » Gouvernement de soi, vie intérieure, contre « choses du dehors » ; philosophe ou « particulier » happé par l’extérieur. Il faut choisir. L’absence de troubles se vend cher, loin des charges, des honneurs, de l’abondance. Agir sur ses opinions et, par voie de conséquence, sur ses désirs, est le meilleur moyen d’y parvenir. « Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux. Mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux2. » Comme ces propos d’Épictète le laissent entendre, la conversion du désir recherchée par le stoïcien suppose une adhésion à la nécessité conçue comme une totalité ordonnée par une loi rationnelle. Il est par conséquent déterminant de savoir établir la distinction entre ce qui dépend de nous, comme le fait d’être juste dans sa conduite et de se montrer bienveillant à l’égard de ses semblables3, et ce qui n’en dépend pas (la fortune, les conditions de notre naissance, la maladie, la mort). Ce qui éclaire un certain nombre de préceptes, stipulant, selon les mots de MarcAurèle, qu’il faut se satisfaire de sa « condition présente » et se réjouir de tout ce qui « présentement » arrive4. S’efforcer de vivre en accord avec la nature et la raison suppose de savoir agir sur son désir pour l’accorder à la nécessité. Un tel acquiescement à l’ordre cosmique, exprimant la maîtrise que nous pouvons avoir sur nos représentations, est appréhendé comme clé d’une vie heureuse. Dès lors, le sage s’éprouve libre et serein par l’assentiment qu’il sait donner uniquement aux choses qui sont en son pouvoir. « Si tu veux que tes enfants, ta femme et tes amis vivent toujours, tu es un sot ; tu veux, en effet, que ce qui ne dépend point de toi en dépende, et que ce qui est à autrui soit à toi. […] Applique-toi donc à ce que tu peux5. » Si je me représente la mort d’un proche comme l’expression d’une Raison universelle immanente à la nature, plutôt que de me condamner à l’affliction, je me dispose, au contraire, à consentir à ce sur quoi je n’ai aucune prise. Ainsi je ménage une voie de paix de l’âme, là où sans cette sagesse je serais voué à la souffrance. Les affections qui troublent ordinairement les hommes perdent leur emprise auprès du sage dont l’exercice actif de détachement envers ce qui ne relève pas de son pouvoir lui permet de rapporter les maux de la partie à l’harmonie du tout et de s’accommoder aux choses que le destin lui assigne. Ne ressort-il pas là le caractère problématique de la conclusion d’une telle démarche ? Il y a, certes, la mise en évidence des mirages de l’imagination qui aboutissent à s’aveugler quant à la réalité des choses, comme le fait que
1
Épictète, Manuel, in Pensées pour moi-même – Manuel d’Épictète, GF – Flammarion, 1964, XXIX, 6-7, p. 220. 2 Ibid., VIII, p. 210. 3 Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, in Pensées pour moi-même – Manuel d’Épictète, op. cit., livre IV, XXV, p. 71 4 Ibid., livre X, I, p. 161. 5 Épictète, Manuel, in op. cit., XIV, p. 212.
193
SAGESSE TRAGIQUE
tout vivant est exposé à la maladie et à la mort. Il y a aussi l’avertissement important sur les désirs vains et dévoyés (quête des honneurs, des richesses, du pouvoir, etc.) propres à l’insensé qui se figure qu’en accumulant sans cesse et en laissant libre jeu à son désir, il peut contourner sa précarité et se rendre heureux, tandis qu’il ouvre la porte à des sentiments néfastes – convoitise, jalousie, frustration, tyrannie de l’ambition… – et, au fond, au trouble perpétuel d’une âme absorbée par la possession de biens plus ou moins futiles. Mais la conversion du désir à laquelle nous sommes invités, disposée à rogner sur tout pour s’épargner souffrance et déchirement, aboutit au fond à l’affranchissement même de tout désir : « Car ce n’est pas en satisfaisant ses désirs qu’on se fait libre, mais en se délivrant du désir1 », écrit encore Épictète. N’aboutissons-nous pas alors à cette conclusion paradoxale soulignée, notamment, par Rosset ? Qu’obtenons-nous, en effet, sinon d’un côté « le monde qui existe et constitue le souverain bien auquel doivent se rallier tous les sages », de l’autre « l’ensemble des choses qui existent dans ce monde et que le sage doit prendre soin d’exclure constamment de sa pensée et de ses désirs »2 ? Il s’agit donc d’approuver l’ensemble, mais de se tenir à distance des éléments qui composent cet ensemble. La sagesse stoïcienne nous parle ainsi d’une approbation tronquée du réel. L’on comprend dès lors l’invitation des stoïciens à s’appréhender comme un acteur de théâtre3. La vie est comparable à un drame conçu par la raison divine. Savoir ajuster ses représentations en ce sens, c’est se disposer à endurer sans trouble les pertes qui affectent les hommes privés de sagesse. Le sage bouddhiste entend glisser en ce monde, tandis que le sage stoïcien se veut acteur d’une pièce de théâtre. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de traverser cette existence sans trop d’adhésion, sans être vraiment partie prenante. Les philosophes hellénistiques et les sages bouddhistes, concevant la sagesse à laquelle aspirer comme absence de souffrance, prônent ainsi, peu ou prou, un désinvestissement du réel, l’anéantissement du désir capable d’extirper l’attachement à l’existence. La sagesse prétend apaiser le mal-être des hommes, mais risque d’aboutir pour cela à une vie quasi-morte, déjà semi éteinte. Si nous considérons l’approche dans son ensemble, nous sommes conduits à une perspective de retrait, de détachement, inconciliable avec la vision tragique qui, décidée à assumer l’existence dans sa totalité, n’entend pas amputer celle-ci de sa part d’ombre.
1
Épictète, Entretiens, Librairie académique Didier & Cie, 1862, livre IV, chap. I, p. 377. C. Rosset, Principes de sagesse et de folie, op. cit., p. 39. 3 « Souviens-toi que tu es comme un acteur dans le rôle que l’auteur dramatique a voulu te donner : court, s’il est court ; long, s’il est long. S’il veut que tu joues un rôle de mendiant, joue-le encore convenablement. Fais de même pour un rôle de boiteux, de magistrat, de simple particulier. Il dépend de toi, en effet, de bien jouer le personnage qui t’est donné ; mais le choisir appartient à un autre. » (Épictète, Manuel, in op. cit., XVII, p. 213-214). 2
194
SAGESSE TRAGIQUE
À cet égard, les sagesses antiques et orientales nous offrent une image trop lissée de la souffrance qui, malgré leur perspective de retranchement, n’en fait pas moins partie du monde. Jeanne Russier écrit en ce sens, à propos des sagesses qui, comme le bouddhisme ou le stoïcisme, entendent surmonter la souffrance par la tenue en laisse du désir : « Derrière leurs artifices, on éprouve le besoin de retrouver la vraie nature de la souffrance, la réalité brutale de la blessure, passion inévitable dont ils s’efforcent vainement d’étouffer le cri1. » Peut-il vraiment exister cet homme détaché et impassible ? C’est dire, tout au moins, que la tentative d’être aussi peu que possible la proie de l’intranquillité ne peut guère qu’impliquer une existence purgée de l’intensité qu’elle peut receler. Ainsi entendue, se tourner vers une sagesse, dans le cadre de la pensée tragique, pourrait paraître surprenant, voire critiquable. Cela cependant concerne, selon l’analyse de Conche, cette sagesse plutôt conventionnelle faite « de compromis, de retrait, de tassement “désillusionné” sur soi2 ». Nous ne sommes alors plus dans le sillon du tragique, mais à une bifurcation qui recherche le détachement, propre à l’idéal antique et oriental de sagesse. Mais si nous renonçons à un tel idéal, est-ce dire qu’une sagesse de l’existence est pour autant impossible ? À cela, Nietzsche a opposé précisément une sagesse dite « tragique », autrement dit la quête d’un art de vivre supposant un acquiescement sans partage à l’existence. Le philosophe est parfaitement conscient de l’irréductible déchirure de l’homme en ce monde. Il reconnaît que la souffrance est une part fondamentale de toute existence. Mais précisément, si, comme l’exprime Bouddha, la souffrance et la vie ne font qu’un, vouloir nier la souffrance revient immanquablement à nier la vie. L’on ne peut, en effet, la passer au tamis pour en extraire les arêtes souffrantes sans du même coup l’assécher complètement. Car la souffrance et la joie sont des états corrélatifs. On n’aura pas l’un sans l’autre. « Car bonheur et malheur sont deux frères jumeaux qui ou bien grandissent ensemble, ou bien […] demeurent petits ensemble3 ! » Nietzsche a perçu l’étroite fraternité des termes, leur profonde union. Autrement dit, vouloir geler le monde de sa dimension perturbante et douloureuse, revient à le geler du même coup de l’allégresse qu’il peut aussi nous réserver. Disposition supposant en tant que telle débordement, surprise, accueil du monde en l’état, « sans possibilité de soustraction, d’exception ou de choix4 ». C’est pourquoi la sagesse tragique implique non une perspective de compromis, de retrait, mais la « volonté de souffrir », non, bien sûr, que souffrir soit souhaitable en soi, mais, parce que, sans la souffrance, rien de 1
J. Russier, La Souffrance, op. cit., p. 6. M. Conche, « La sagesse tragique », Orientation philosophique, op. cit., Note, p. 157. 3 F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., § 338, p. 229. 4 F. Nietzsche, La Volonté de puissance, trad. G. Bianquis, II, op. cit., livre IV, § 14, p. 275. 2
195
SAGESSE TRAGIQUE
grand ne peut s’accomplir. C’est pourquoi Nietzsche a, notamment, pu écrire en ce sens : « La culture de la souffrance, de la grande souffrance, ne savezvous pas que c’est là l’unique cause des dépassements de l’homme ? Cette tension de l’âme dans le malheur, qui l’aguerrit, son frisson au moment du grand naufrage, son ingéniosité et sa vaillance à supporter le malheur, à l’endurer, à l’interpréter, à l’exploiter jusqu’au bout, tout ce qui lui a jamais été donné de profondeur, de secret, de dissimulation, d’esprit, de ruse, de grandeur, n’a-t-il pas été acquis par la souffrance, à travers la culture de la grande souffrance1 ? » S’exprime là, au fond, la conscience simple, et en cela difficile, que l’on ne s’évade pas de la vie ou, plutôt, que si l’on prétend s’écarter de son tissu souffrant, de sa face d’ombre, on la vide du même coup de son élan même. La sagesse tragique ne peut, par conséquent, se concevoir qu’à partir de la rupture avec l’idée-maîtresse des sagesses traditionnelles, grecque ou bouddhique, à savoir celle de l’absence de trouble intérieur, de l’impassibilité, résultant d’un détachement volontaire. Dans la lignée de l’intention nietzschéenne, l’on peut, avec Conche, entendre alors par sagesse « un appel à la plus profonde vitalité ardemment assumée, et qui ne refuse pas la passion mais la contient et la surmonte2 ». Tenter de se modeler, de s’essayer à vivre avec ses propres fractures et non pas chercher à les occulter. Une sagesse désigne en ce sens la quête d’un art de vivre, sans ignorer ses fêlures, sans chercher à évacuer la souffrance inhérente au monde et à l’existence, mais en s’efforçant de vivre avec. Nous voici sur le rivage opposé de la sagesse : non pas vivre moins intensément pour moins souffrir, mais s’efforcer de mieux souffrir, aller jusqu’à vouloir la souffrance « comme prix d’une vie qui mérite d’être vécue3 », de son attachement à l’existence. La reconnaissance profonde de notre condition d’êtres voués à la mort est en mesure de conduire à cette exigence. Nulle morbidité là encore, mais la conscience qu’il n’est d’acceptation lucide et concrète de la réalité sans le risque d’angoisse qui lui est attaché. Ce n’est qu’en assumant l’angoisse, c’est-à-dire l’appréhension de la mort comme mort de moi-même et de tout ce qui m’entoure, et non en la refoulant, que l’on peut éprouver la force de son attachement à l’existence et, de là, se sentir incité à vivre aussi pleinement que possible. « Assumée, elle peut être un principe d’énergie et d’action par le sentiment d’urgence qu’elle crée4. » C’est dans cette perspective que s’inscrit également Dastur lorsqu’elle insiste, fidèle à l’exigence heideggerienne, sur l’importance de replacer la mort au centre de l’existence. La confrontation lucide à la maigreur et à la 1
F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, op. cit., § 225, p. 163-164. M. Conche, « La sagesse tragique », Orientation philosophique, op. cit., Note, p. 157. 3 M. Conche, Nietzsche et le bouddhisme, op. cit., p. 13-14. 4 M. Conche, Le Fondement de la morale, op. cit., p. 106. 2
196
SAGESSE TRAGIQUE
gratuité de nos cheminements, tout en nous ramenant à notre insignifiance, peut représenter une ouverture essentielle. Loin de paralyser l’action, la conscience de notre précarité est à même de donner tout son éclat à notre existence, nous incitant à déployer celle-ci en concentrant notre attention sur les instants précieux susceptibles de la traverser. Invitation à absorber la souffrance, à assumer notre constitution éphémère en nous efforçant de donner toute l’intensité dont nous sommes capables à chacun des moments de notre existence. Pari d’une sagesse tragique consistant ainsi, selon les mots de Conche, à savoir « donner la plus haute valeur à ce qui va périr1 ». Nous voici aux antipodes du pari chrétien de Pascal. L’enjeu n’est pas de miser sur une vie après la mort, mais d’essayer de vivre la meilleure vie possible dans la perspective du néant. La finitude du temps, l’échéance de la mort, restent au cœur des préoccupations, donnant tout son prix à l’usage du temps que l’on saura faire. « La sagesse de celui qui entend vivre humainement selon la sagesse de la nature est une sagesse tragique, car l’opposition de l’humain et du non humain n’est pas dépassée, elle est maintenue, et l’homme n’est alors rien de plus qu’une parcelle de la nature vouée à la mort2. » La sagesse tragique ne dispense donc en aucun cas de l’épreuve, de la difficulté d’exister. Elle suppose de se confronter au temps et à la mort qui en est l’épreuve suprême. « Elle se fonde sur la méditation de la vie comme vie mortelle – vie vécue sous l’horizon de la mort, de la non-vie. […] et la “sagesse tragique” est un volontarisme, une volonté de donner le plus de valeur possible à ce dont, pourtant, le Temps tout-puissant, à la longue, ne laissera rien subsister3. » Que peut par conséquent se proposer la pensée tragique ? Celle-ci ne peut envisager qu’un art de vivre mortel, c’est-à-dire une décision de vivre résolue, sans occulter les déchirures auxquelles nous expose une existence reconnue dans sa crudité. La sagesse tragique est cette acceptation sans réserve du devenir avec la certitude de l’anéantissement. Conche offre, nous semble-t-il, un pertinent résumé de ce que peut recouvrir au fond la notion de « sagesse tragique ».
1 M. Conche, Temps et destin, op. cit., p. 119. Voir aussi Confession d’un philosophe, où M. Conche exprime cela de manière similaire : « J’ai choisi ce qui seul s’accordait à ma nature et à l’ardeur que j’ai : ce que j’appelle une sagesse “tragique” – donner le plus de valeur à ce qui va périr. » (op. cit., p. 154). Le philosophe écrit encore en ce sens : « J’admets, avec Héraclite et le bouddhisme, l’impermanence universelle, la non-substantialité, l’évanescence de toutes choses ; mais je crois qu’il faut donner le plus de valeur possible à ce qui va périr, et c’est là sagesse tragique, non euphorique. » (M. Conche, Entretien avec S. Charles, in S. Charles, Une fin de siècle philosophique, op. cit., p. 98). 2 M. Conche, « La sagesse tragique », Orientation philosophique, op. cit., p. 174. 3 M. Conche, Le Fondement de la morale, op. cit., p. 2.
197
SAGESSE TRAGIQUE
Elle se recommande, tout d’abord, d’une « métaphysique du néant1 » où la mort signifie pure cessation de la vie, disparition totale, où tout n’est qu’écoulement sans soustraction possible. Ensuite, elle suppose une reconnaissance de la mort comme l’événement inévitable, fatal, et qu’il ne tient qu’à soi de subir avec passivité ou de vouloir (latitude du jeu). Puisque vie et mort sont indissociablement liées, vouloir la vie signifie aussi vouloir la mort. En sorte que : « Toute volonté doit être volonté de vie et (de) mort : voluntas fati2. » Enfin, la volonté tragique est une volonté du meilleur, de faire de son mieux en donnant le plus « de qualité possible, aux instants, aux actes, aux œuvres, quoi qu’il en soit de la durée – qui ne nous appartient pas3 ». Volonté donnant, ainsi, le plus de valeur à ce qui est, à ce que l’on entreprend de réaliser, sans prise en compte de ce que cela deviendra : art de vivre mortel. Vivre avec ses mortelles vérités. Vivre à hauteur de sa lucidité. Il nous faut garder l’esprit clair et la tête froide, ne pas biaiser avec l’évidence. Reprenons les mots de Rosset précédemment cités énonçant le principe de cruauté : « Tout ce qui vise à atténuer la cruauté de la vérité, à atténuer les aspérités du réel, a pour conséquence immanquable de discréditer la plus géniale des entreprises comme la plus estimable des causes4 ». Tout le reste n’est que subterfuge, incapacité à assumer son propre savoir. Principe de cruauté qui conserve ici toute sa pertinence, autrement dit essayer de vivre du mieux que l’on peut tout en sachant que l’on vit pour rien. Volonté du tragique : désir de vivre et de penser sans ne rien se masquer du fond intrinsèquement cruel et douloureux de la réalité, de se traiter soi-même avec cruauté. Cruauté signifiant du reste, du point de vue de l’esprit, comme le rappelait déjà Artaud : « rigueur, application et décision implacable, détermination irréversible, absolue5 ». Pour une affirmation inconditionnelle, sans restriction des données tragiques. De la sorte et pour ce qui dépend de soi, on se sent plus exposé sans doute à la morsure du réel, mais aussi sincère avec soi-même et plus attentif à la vie. Ainsi, de même que la volonté de délivrance est étrangère à la tragédie, là où les sagesses conventionnelles visent une suppression de la souffrance, la sagesse tragique entend s’efforcer d’assumer la souffrance. On peut donc, certes, « s’astreindre au vide6 », en adoptant une posture bouddhiste en quête de nirvâna, mais si la visée n’est pas celle d’un
1
Ibid., p. 104. Ibid., p. 105. 3 Ibid. 4 C. Rosset, Le Principe de cruauté, op. cit., p. 7. 5 A. Artaud, « Lettres sur la cruauté », Le Théâtre et son double, op. cit., première lettre, p. 158. 6 Cioran, Le Mauvais Démiurge, in op. cit., p. 1221. 2
198
SAGESSE TRAGIQUE
détachement une autre attitude peut être recherchée. Une autre forme de sagesse est envisageable, à la démarche tout opposée à la première. Il ne s’agit pas alors de se réfugier dans l’abstention, de vivre moins intensément pour recevoir le moins possible les assauts de la souffrance. La sagesse tragique ne vise pas l’anesthésie propre à toutes les grandes sagesses ; elle maintient la déchirure. Sagesse tragique, « dionysiaque » comme Nietzsche l’a formulé : accepter, aller jusqu’à vouloir la souffrance, afin de conserver l’intensité du vivre. Un dire « oui » au monde tel qu’il se donne à vivre, autrement dit la volonté d’une traversée du réel, y compris dans ses formes les plus douloureuses, dessinant un horizon du vivre sous la coupe du tragique sans considération de ce qui, entre joies et peines, l’emporte dans la balance. C’est sans doute ici que l’écart avec le pessimisme strict se creuse le plus nettement. Car, ainsi que nous le suggérions précédemment, comme l’optimisme, le pessimisme a une attitude comptable. Nietzsche, qui avait lu de près les pessimistes de son temps – et Schopenhauer au premier chef qu’il admirait mais dont il rejetait le ressentiment –, avait noté ce calcul de la somme des plaisirs et des déplaisirs qu’il estimait mesquin et méprisable : “Le monde est quelque chose qui, raisonnablement, ne devrait pas exister parce qu’il occasionne au sujet sensible plus de déplaisir que de plaisir” – un pareil bavardage s’appelle aujourd’hui pessimisme ! Le plaisir et le déplaisir sont des accessoires, ce ne sont pas des causes ; ce sont des évaluations de second ordre, dérivées d’une valeur dominante, – le langage du sentiment affirme ce qui est “utile” et “nuisible” et ce langage est variable et dépendant. Car, chaque fois que l’on dit que quelque chose est “utile” ou “nuisible”, il y a encore cent façons de demander utile à quoi ? nuisible en quoi ? Je méprise ce pessimisme de la sensibilité : il est une marque de profond appauvrissement vital1.
Le tragique vise une affirmation de la vie dans ce qu’elle a de plus terrible, et non pas la résignation. Ici réside la différence majeure d’avec Schopenhauer pour qui la tragédie fortifie en nous la résolution de mourir2. Le tragique, fort de l’effet avant tout « tonique » et non pas déprimant ou décourageant de la tragédie, n’est pas le chemin de la résignation, du renoncement à la volonté de vivre3. Nietzsche voit, au contraire, dans l’ivresse tragique un défi à la mort et une volonté d’affronter la totalité du vécu4. 1
F. Nietzsche, La Volonté de puissance, trad. H. Albert, op. cit., livre 3, § 312, p. 357. F. Nietzsche, « Avant-propos à La Naissance de la tragédie », Essai d’autocritique et autres préfaces, Points, « Points Essais », 1999, § 6, p. 43. 3 F. Nietzsche, La Volonté de puissance, trad. H. Albert, op. cit., § 363, p. 410-411. 4 Voir notamment Ibid., § 459, 460, 461, 483. Au § 460, Nietzsche explique le tournant décisif pour sa pensée, où il s’est détaché de l’influence de Schopenhauer : « Alors je compris que mon instinct voulait aboutir au contraire de ce qu’avait voulu Schopenhauer : à la 2
199
SAGESSE TRAGIQUE
Le philosophe distingue ainsi nettement la vision tragique de la vision pessimiste, estimant, à l’encontre de cette appréciation de l’existence en fonction de la prépondérance de la peine sur la joie, que la souffrance n’est pas un argument contre la vie1. Cioran qui, malgré son « mécontentement2 », reconnaît lui aussi à son œuvre un ton, non pas strictement pessimiste, mais tonique, voit percer un certain ressentiment dans le pessimisme (il pense notamment aux propos sévères et amers des moralistes, tels que Chamfort ou La Rochefoucauld, émanant de leur sensibilité blessée, « ulcérée » par « le grincement de la machine du monde »3). Ainsi la vengeance, l’amertume que traduit le venin des maximes s’érige-t-elle alors en doctrine du pire : « Toute amertume cache une vengeance et se traduit en un système : le pessimisme, – cette cruauté des vaincus qui ne sauraient pardonner à la vie d’avoir trompé leur attente4. » Doctrine du pire : la somme des joies est bien moindre que celle des douleurs. La joie elle-même, par définition instable et éphémère, s’inscrit sur un fond de douleur. En cela n’a-t-elle rien d’une grâce à travers laquelle les tristesses nous sont remises ; elle n’est qu’un leurre, une pure négativité en tant que cessation passagère d’une douleur. Aussi l’existence trouve-t-elle là sa condamnation et doit nous inciter à tendre vers le non-être. Logique du pire : ne rien ignorer de la part essentielle de la souffrance dans toute existence, sans y voir pour cela un critère de rejet. Il s’agit au contraire d’accepter notre existence pour ce qu’elle est, avec tout ce qu’elle peut comporter à nos yeux de cruel et de douloureux. Car la valeur de la vie ne se mesure pas d’après un calcul destiné à déterminer la proportion des joies et des peines en ce monde, mais dans le constat que la joie est malgré tout, en mesure de résister à ce qui peut la mettre en échec. C’est là ce qui fonde le caractère affirmateur de la pensée tragique, à savoir la persistance d’une joie capable de « triompher de la pire des peines5 », scellant au passage, selon les mots de Rosset, le « petit secret » de Nietzsche, dont il trouve l’expression dans « la chanson ivre » de Zarathoustra où ce dernier prononce les mots suivants : « la joie pèse plus que le chagrin6 ». Point
justification de la vie, même dans ce qu’elle a de plus terrible, de plus équivoque, de plus mensonger : - Je tenais pour cela entre les mains la formule “dionysien”. » (p. 492). 1 Ibid., § 16, p. 54. En ce sens, Nietzsche écrit : « Quiconque tire argument de la souffrance contre la vie, je le juge superficiel : ainsi nos pessimistes. De même quiconque voit une fin dans le bien-être. » (F. Nietzsche, La Volonté de puissance, trad. G. Bianquis, II, op. cit., § 90, p. 47). Voir aussi Par-delà bien et mal, op. cit., § 225, p. 163-164. 2 Voir le post-scriptum à La Force majeure où Rosset s’est attaché à caractériser ce qu’il appelle « le mécontentement de Cioran » (La Force majeure, Minuit, 1983, p. 95-102). Celuici équivaut au sentiment indéracinable de l’insignifiance rendant toute existence dérisoire. 3 Cioran, Précis de décomposition, in op. cit., p. 720. 4 Ibid., p. 721. 5 C. Rosset, Le Choix des mots, Minuit, 1995, p. 107. 6 Ibid.
200
SAGESSE TRAGIQUE
déterminant de la pensée tragique dont nous tenterons de rendre l’écho stimulant dans le dernier volet de notre réflexion. Relevons pour l’heure que la joie s’offre comme le témoignage même de notre capacité d’approbation inconditionnelle de la vie et la plus sûre invitation à poursuivre avec lucidité nos tragédies respectives. C’est une chose de considérer que la nausée ne peut manquer de caractériser le sentiment de l’existence à ses heures, c’en est une autre de considérer que l’existence est de ce fait indésirable et condamnable pour elle-même. La nausée, dans cette perspective, n’est pas seulement perçue comme une composante du sentiment de l’existence, mais comme un motif de condamnation, « un exemple parmi d’autres du mal général de l’existence1 ». Au regard de la pensée tragique, la souffrance intérieure n’est pas invitation à une quête de détachement ou au mépris du monde, mais plutôt au maintien d’une tension vive, car si elle ne peut manquer d’abattre parfois les humeurs, aucune félicité ne sera en mesure d’émerger sans assentiment à la totalité de la réalité. Cela suppose une victoire sur les mirages de l’idéalisme, les promesses fallacieuses du nihilisme passif, contre tout ce qui, en nous, peut tendre vers le renoncement, le déclin ou le rêve d’une évasion. Le pessimisme, trop empreint de dégoût et de nostalgie romantique – Schopenhauer lui a, on ne peut mieux, donné sa justification spéculative – n’invite pas à une entière confrontation avec les données tragiques. La douleur lui sert d’argument pour déclarer le non-être supérieur à l’être, et pour prôner, en conséquence, l’extinction du désir, la négation du Vouloirvivre par le biais d’une ascèse inspirée de l’enseignement bouddhique : « état d’abnégation volontaire, de résignation, de calme véritable et d’arrêt absolu du vouloir2 ». Ainsi et ainsi seulement « le malheureux » peut cesser d’être le dindon de la farce, « dupe de l’illusion », et « se retire du cercle ». Désormais, écrit Schopenhauer à la fin du Monde comme volonté et comme représentation, il ne reste devant nous que le Néant. Il s’agit certes d’un effort soutenu de détachement, et non d’un mol abandon au néant. Néanmoins, ce pessimisme-là ne court-il pas le risque de passer son temps à tourner le couteau dans la plaie du sinistre, de la sinistrose, pour au bout du compte coïncider avec une forme d’avachissement existentiel – forme d’ascétisme, imbibé d’aigreur, qui conduit à toiser le monde considéré comme grotesque, digne de mépris ? En quoi, selon Nietzsche, au lieu d’affronter loyalement le néant, le pessimisme incite à chercher des échappatoires. Aussi le philosophe voit-il dans cette nostalgie du néant la négation même de la sagesse tragique : elle conduit à fuir la souffrance, à ne plus endurer et aimer la vie.
1 2
C. Rosset, Principes de sagesse et de folie, op. cit., p. 43. Le Monde…, chap. 68, p. 477.
201
SAGESSE TRAGIQUE
À ce pessimisme de la sensibilité, qu’il qualifie de « résignationnisme1 », Nietzsche oppose un volontarisme qui garde sa portée essentielle dans l’assentiment sans partage à la réalité dont il se recommande. Ce qui a conduit, notamment, Camus à écrire : « Il apprend à aimer ce qui est, à se faire un appui de tout, et de la douleur d’abord2 ». De quoi faire ressortir ce que la tension du temps peut avoir de stimulant.
La grâce de l’occasion « Qui veut avoir à soi un seul instant sa propre vie […] doit s’approprier le présent : voir chaque présent comme le dernier, comme si ensuite la mort était certaine ; et dans l’obscurité se créer par soi-même la vie. » Carlo Michelstaedter, La Persuasion et la rhétorique.
« Je suis à toute heure préparé environ ce que je puis être3 », écrit Montaigne. Comme le commente Poulet, puisque se sentir, c’est se sentir perpétuellement dépossédé de soi-même, rendu à son indigence, un deuxième mouvement de conscience est envisageable : vivre pleinement conscient du temps, c’est faire de chaque occasion présente un nouvel usage de soi-même4. Montaigne écrit, ainsi, à propos de sa vie : « Principalement à cette heure, que j’aperçois la mienne si brève en temps, je la veux étendre en poids ; je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie, et par la vigueur de l’usage compenser la hâtiveté de son écoulement5. » Ce qui, au-delà de la conscience d’être sans cesse entraîné loin de soi par le temps, dessine une ouverture essentielle, celle de « vivre conscient de s’avancer dans une possession de soi qui se révèle comme inépuisable6 ». L’important consiste alors pour soi, non à rechercher une identité toujours illusoire, mais à être « prêt à recevoir le dépôt de tous ces moi possibles7 ». Mise en avant de la promptitude de la saisie. Elle vise le plus difficile car, apparemment, le plus simple : vivre au présent le présent. Comment, dès cette existence même, donner une densité à une existence qui ne cesse de passer ? Vivre à propos, s’accorder autant que possible au moment. C’est pourquoi Montaigne fustige ceux qui « passent leur temps » mollement, seulement en quête de confort. À cette fuite du temps de la vie, il oppose la
1
F. Nietzsche, « Avant-propos à La Naissance de la tragédie », Essai d’autocritique et autres préfaces, op. cit., § 6, p. 43. 2 Cité par O. Todd, Albert Camus, une vie, Gallimard, « Folio », 1999, p. 703. 3 M. de Montaigne, Essais, op. cit., I, chap. XX, p. 149. 4 G. Poulet, Études sur le temps humain, I, op. cit., p. 59. 5 M. de Montaigne, Essais, op. cit., III, chap. XIII, p. 410. 6 G. Poulet, Études sur le temps humain, I, op. cit., p. 60. 7 Ibid.
202
SAGESSE TRAGIQUE
« vigueur de l’usage », par laquelle l’esprit tente de s’ajuster à l’instant présent pour en tirer quelque enseignement et richesse pour lui-même. Montaigne ici n’oublie pas Sénèque qui, dans la Brièveté de la vie, insiste sur l’importance de la promptitude à user du temps, si l’on ne veut pas être seulement victime de la caducité. Le penseur antique écrit, se référant aux propos de Virgile : « “Pourquoi tarder ? dit-il, pourquoi hésiter ? Si tu ne t’en saisis, il fuit.” Et quand tu l’auras saisi, il fuira malgré tout ; aussi faut-il lutter de vitesse avec le temps par sa promptitude à en user ; il faut y puiser comme dans un torrent rapide et passager1. » Il s’agit d’être à la hauteur de l’expérience consistant à fixer le temps dans un usage. D’où, comme l’exprime Sénèque dans sa lettre 49 à Lucilius, une certaine indifférence pour la durée en tant que telle de la vie. Car l’important réside avant tout dans l’intensité de l’expérience, dans l’emploi que l’on aura su faire de notre temps de vie : « Enseigne-moi que le bien de la vie n’est pas dans la durée de celle-ci, mais dans son emploi ; qu’il peut advenir, que très fréquemment il advient qu’ayant vécu longtemps, on n’a guère vécu2. » Ce n’est pas la peine de multiplier les expériences ; il s’agit bien plutôt de savoir tirer le suc de ce qu’il nous est donné de traverser. La vie est, dès lors, l’ensemble des actes par lesquels nous avons créé notre être. Ainsi, un homme jeune peut-il avoir beaucoup vécu et un vieillard très peu. La véritable durée de la vie est celle que nous avons créée. La durée de l’expérience est en conséquence réduite à néant3. On crée soi-même la durée de sa vie, si bien qu’un clivage net peut s’établir entre, d’un côté, la fuite de soi, le gaspillage du temps, ancêtre du divertissement et, de l’autre, la vie véritable. Pensée de l’urgence, exigence de l’impératif présent, nourrie de la conscience de la proximité de la mort. Ainsi, Sénèque poursuit-il sa lettre en prenant l’exemple de la navigation, particulièrement menacée par la mort, transposant cette menace au cœur de nos existences : « Ne commets pas l’erreur de croire qu’en navigation seulement le plus mince intervalle sépare la vie de la mort. Quel que soit le lieu, cet espace est également réduit. Sans se montrer partout d’aussi près, la mort est partout aussi proche4. » On ne peut se sauver que maintenant et tout de suite, l’on n’aura pas d’autre occasion, et cela d’autant plus que, dans la perspective stoïcienne, l’âme est aussi mortelle que le corps. Nous n’avons donc pas la possibilité de nous dispenser de l’usage de l’instant présent. Et évacuer la vaine pensée du passé (sous le signe de l’irrévocable, du déjà
1
Sénèque, Brièveté de la vie, op. cit., IX, 2, p. 273. Sénèque, Lettres à Lucilius, op. cit., livre V, lettre 49, 10, p. 713. 3 Montaigne ne manque pas de se faire l’écho de cette perspective : « L’utilité du vivre n’est pas en l’espace, elle est en l’usage : tel a vécu longtemps, qui a peu vécu ; attendez-vous y pendant que vous y êtes. Il gît en votre volonté, non au nombre des ans, que vous ayez assez vécu. » (Essais, op. cit., I, chap. XX, p. 157-158). 4 Sénèque, Lettres à Lucilius, op. cit., lettre 49, 11, p. 713. 2
203
SAGESSE TRAGIQUE
dissout) et celle chimérique du futur (ne laissant place à aucune prise) pour nous concentrer sur le présent passe par la pensée de la mort. Marc-Aurèle insiste sur cette nécessité de toujours agir comme si l’acte que l’on posait était le dernier et que la mort nous attendait aussitôt après1. Une grande rigueur est donc fixée, faisant de l’art de vivre une maîtrise de la temporalité. Il s’agit de devenir auteurs de nous-mêmes, en reconnaissant comme seul temps véritable celui de la concentration. « Il faut tirer profit du présent2 », écrit l’empereur-philosophe, exprimant alors, au plus près, cette exigence d’attention au présent. Éléments fondateurs d’un art de vivre, profondément habité par la conscience que de la durée totale « un court et infime intervalle » nous a été assigné3. Et puisque « voici, tout près, le gouffre infini du passé et de l’avenir, où tout s’évanouit4 », de cet intervalle, il n’y a de réel que le présent de nos actes et de nos expériences. Les représentations que nous pouvons avoir de notre vie passée et future sont vides, puisque le passé n’est plus et que le futur n’est pas encore. Il importe de chasser de nos pensées ces portions du temps inexistantes et sans prise, à la source de sentiments vains ou fallacieux. Et cela ne peut passer que par l’effort d’attention aiguë au présent, inséparable de la pensée de la mort. En quoi celle-ci peut être appréhendée, selon Alain Le Ninèze, comme « un exercice de la sagesse : en donnant tout son prix à l’instant, en faisant apparaître chaque jour qu’il nous est donné de vivre comme une “chance inespérée” (Horace), elle favorise cet état de présence au présent qui est aussi expérience de la présence à soi5 ». S’il est une sagesse, elle ne consiste donc pas à projeter un possible, mais à savoir coïncider avec le moment qui se présente. Disponibilité au moment qu’enseigne la conscience aiguisée du temps. Nous avons surtout insisté sur les recommandations des stoïciens pour caractériser cette exigence spirituelle, en raison notamment des textes lumineux de Sénèque et de MarcAurèle, mais rappelons, comme l’évoque la précédente référence à Horace, que cet exercice de concentration sur le présent est recommandé tout autant par les épicuriens. Épicure a beau s’efforcer de désolidariser la vie de la mort, il n’en reste pas moins préoccupé par la brièveté de l’existence humaine. C’est pourquoi il ne manque pas de railler ceux qui perdent leur temps à préparer « ce qui les fera vivre6 », mais qui ne vivent jamais : 1
Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, in op. cit., livre II, V, p. 44. Voir aussi livre IV, XVII, où il écrit : « N’agis point comme si tu devais vivre des milliers d’années. » (p. 69). 2 Ibid., livre IV, XXVI, p. 72. 3 Ibid., livre V, XXIV, p. 90. 4 Ibid., livre V, XXIII, p. 90. 5 A. Le Ninèze, La Sagesse. La force du consentement, Autrement, « Morales », n°28, 2000, p. 63. 6 « Certains, tout au long de leur vie, préparent ce qui les fera vivre, sans voir en même temps que l’on nous a versé à tous la pharmacie de la naissance, qui est mortelle. » (Épicure, Sentences vaticanes, in op. cit., 30, p. 213).
204
SAGESSE TRAGIQUE
conscience profonde que la vie n’est pas pour le lendemain, mais pour le jour même, chaque minute du jour. L’on peut ainsi, avec Jankélévitch, parler d’« accommodation optique à la proximité de la mort1 », pour désigner cette exigence des Anciens de vivre chaque instant comme si c’était le dernier. Fort de cet éclairage, que la mort lui paraisse effectivement lointaine ou proche, l’homme alors doté d’un cœur qui « bat plus fort et plus vite » est à même « de vivre intensément ces moments si précieux que nous supposons être les derniers »2, loin des vains projets et d’un temps dispersé aux quatre vents d’une existence divertie d’elle-même. Ne jamais perdre de vue la dispersion et toujours repartir d’elle pour la tension de la saisie, l’effort de vivre dans la vérité de l’instant. C’est en quoi Montaigne rappelle que : « Notre grand et glorieux chef-d’œuvre, c’est vivre à propos3 », s’accorder au moment. Sur ce point, il paraît important de retenir également la pensée de Jankélévitch qui apporte un écho profond à cette promotion de l’instant. Commentant la pensée du philosophe, Bernard Sichère écrit : « Le temps signe sans doute la tragédie de l’irréversible mais il nous révèle en même temps la valeur irremplaçable et illuminante de l’instant4. » Le « presquerien », expression de nos limites et de nos dépits, de ce qui apparaît-disparaît sans cesse et nous interdit de nous installer nulle part, définit alors une tâche. « Il faut se tenir prêt, faire le guet et bondir comme fait le chasseur qui capture une proie agile5. » L’instant occasionnel se présente comme cette chance précieuse qu’il ne faut pas laisser filer. Le « presque-rien » appelle l’homme « à une création impromptue, à une improvisation6 » dont la qualité dépend de notre « attention lucide » et de la tension extrême. Savoir saisir l’occasion, comme instant qui est pour nous « une chance de réalisation, de connaissance ou d’amour7 ». Cette non-programmation, qui requiert notre entière disponibilité, est tout autant inconfortable et poignante qu’elle peut se révéler passionnante. Inconfortable, car l’occasion, fille de l’instantané et de l’irréversible, ne s’annoncera pas par des signes précurseurs et ne se présentera pas deux fois, en tout cas jamais sous la même forme. Imprévisible et non renouvelable, l’occasion demande esprit de finesse, attention extrême, « l’à-propos d’un éclair, d’un maintenant incandescent surpris sur le fait, d’un instant si fugitif que la seconde même où j’en parle est déjà loin de moi8 » ! L’image à retenir est celle de l’étoile 1
V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 2, op. cit., p. 27. Ibid. 3 M. de Montaigne, Essais, op. cit., III, chap. XIII, p. 406. 4 B. Sichère, « Traverses », Cinquante ans de philosophie française, ADPF, 1998, p. 93. 5 V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, op. cit., p. 38. 6 R. Maggiori, « Vladimir Jankélévitch. Le vagabond de l’entre-deux », Libération, 29 mars 1978. 7 V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, op. cit., p. 37. 8 Ibid., p. 38-39. 2
205
SAGESSE TRAGIQUE
filante mettant en évidence la difficulté de viser juste pour capter les étincelles de l’instable. La « faveur imprévue » de l’occasion demande donc, si l’on veut en profiter, « des âmes parfaitement disponibles pour la grâce occasionnelle de l’impromptu1 ». C’est dire que cette grâce que nous recherchons demande aussi que l’on sache la susciter et surtout la recevoir. Se tenir prêt, aux aguets. Cette attention lucide ne doit pas faire défaut, si l’on veut profiter de l’opportunité, et elle peut même, en cela, participer à la créer. L’improvisation s’allie à l’inspiration. Autrement dit, la grâce de l’occasion ne pourra être reçue que par « une conscience en état de grâce2 ». S’il est un art du bon usage, il réside alors dans ce savoureux mélange entre disposition d’esprit à la saisie et improvisation. « Tout peut devenir occasion pour une conscience inquiète, capable de féconder le hasard3. » Ainsi, si l’occasion éveille le génie créateur comme « l’électrochoc de l’inspiration », c’est bien le génie créateur qui fait en sorte que cette rencontre ne soit pas stérile, « occurrence muette », mais « une occasion riche de sens »4. Double mouvement en quoi l’improvisation peut acquérir la profondeur d’un « processus créateur », autrement dit, non une opération bâclée et exécutée à l’arraché, mais bien un point de départ essentiel, telle « la première démarche de l’invention créatrice à partir du rien de la feuille blanche, à partir de l’amorphe et de la parole balbutiante5 ». Dans l’occasion, l’homme peut trouver sa liberté créatrice, à laquelle il lui revient d’appliquer son travail et sa concentration, desquels peuvent émerger de fécondes inspirations. L’irréversibilité du temps, tissant cette succession de « never more » que nous évoquions au départ, définit cette tâche, qui est de savoir saisir et passionner ces instants dont l’unicité et la fragilité déclarent la valeur précieuse de l’occasion. C’est dire que la continuation n’est possible que par la discontinuation du survenir. Dans cette perspective, une conception linéaire, progressiste du temps ne tient décidément pas. Par opposition à Henri Bergson qui, pour aborder le temps, privilégie l’épaisseur de la durée, Gaston Bachelard a précisément montré, dans L’intuition de l’instant, que nous ne saisissons le temps qu’au cœur de l’instant vécu, nouveau, « créateur ». Appréhender le temps selon le mode de la durée, c’est voir une solidarité entre le passé et l’avenir, « une viscosité de la durée, qui fait que le passé reste la substance du présent, ou, autrement dit, que l’instant présent n’est jamais que le phénomène du passé6 », comme si un fil du temps reliait les différentes 1
Ibid., p. 39. Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid., p. 40. 5 Ibid. 6 G. Bachelard, La Dialectique de la durée, PUF, « Quadrige », 1993, p. 2. Nous soulignons. 2
206
SAGESSE TRAGIQUE
séquences. Or, si le présent n’est que phénomène ou effectuation du passé, il ne peut rien créer. Cette vision d’une flèche du temps, d’une droite orientée vers un avenir, d’un temps plein, n’est pas sans évoquer la vision d’un soubassement divin capable d’orienter le temps et de porter la durée. À ce titre, il n’est pas surprenant que le cheminement de Bergson ait abouti à une adhésion au christianisme. Dans cette optique, le temps est linéaire, la durée coule, hors des lacunes, du repos, des temps morts, du néant, de l’instant. Cioran rappelle que Simmel reprochait précisément à Bergson de n’avoir pas vu que la vie « pour se maintenir doit se détruire1 », que la réalité du temps déclare que nous ne pouvons nous assurer d’une durée métaphysique continue qui, en quelque sorte, nous soutiendrait dans l’être. C’est cette même évacuation de l’aspect tragique de l’existence que Bachelard met en cause. Donner une place à l’instant créateur signifie rompre avec un tel modèle linéaire et reconnaître que, loin d’une continuité uniforme, le temps est avant tout une série de ruptures. Si nous considérons le temps, et spécifiquement le temps humain dans lequel l’être perd et gagne, la discontinuité de nos actes, nous pouvons réaliser combien la durée, la continuité n’est qu’une construction de l’esprit. « L’être alternativement perd et gagne dans le temps ; la conscience s’y réalise ou s’y dissout2. » Puisque le passé n’est qu’un souvenir et l’avenir une prévision, Bachelard en conclut qu’ils ne sont que des habitudes3. « Notre histoire personnelle n’est donc que le récit de nos actions décousues et, en la racontant, c’est par des raisons, non par de la durée, que nous prétendons lui donner de la continuité4. » Ainsi, l’affirmation d’un temps linéaire est-elle un leurre, un piège spirituel. Le continu n’est qu’une construction mentale, notre monde est discontinu, notre temps éclaté. L’Intuition de l’instant souligne cette pluralité de dimensions du temps. Il n’apparaît continu que grâce à l’épaisseur que nous lui donnons en superposant plusieurs temps indépendants. Le temps n’a qu’une réalité, celle de l’Instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l’instant et suspendue entre deux néants. Le temps pourra sans doute renaître, mais il lui faudra d’abord mourir. Il ne pourra pas transporter son être d’un instant sur un autre pour en faire une durée. L’instant, c’est déjà la solitude... C’est la solitude dans sa valeur métaphysique la plus dépouillée. Mais une solitude d’un ordre plus sentimental confirme le tragique isolement de l’instant : par une sorte de violence créatrice, le temps limité à l’instant nous isole non seulement des autres mais de nous-mêmes, puisqu’il rompt avec notre passé le plus cher. […] Ce caractère dramatique de l’instant est peut-être susceptible d’en faire pressentir la réalité. Ce que nous voudrions souligner c’est que dans une telle rupture de l’être, l’idée du discontinu s’impose sans conteste. On objectera peut-être que ces instants dramatiques séparent deux durées plus monotones. Mais nous appelons monotone et régulière
1
Cioran, Entretien avec Sylvie Jaudeau, Entretiens, op. cit., p. 217. G. Bachelard, La Dialectique de la durée, op. cit., p. 32. 3 G. Bachelard, L’Intuition de l’instant, Le Livre de Poche, « Biblio essais », 2006, p. 51. 4 G. Bachelard, La Dialectique de la durée, op. cit., p. 34. 2
207
SAGESSE TRAGIQUE
toute évolution que nous n’examinons pas avec une attention passionnée. Si notre cœur était assez large pour aimer la vie dans son détail, nous verrions que tous les instants sont à la fois des détonateurs et des spoliateurs et qu’une nouveauté jeune ou tragique, toujours soudaine, ne cesse d’illustrer la discontinuité essentielle du Temps1.
Ramener l’esprit au réel et réfuter les valeurs de la durée vont de pair. Il faut reconnaître l’entière égalité du réel et de l’instant présent, parce qu’il est « le seul domaine où la réalité s’éprouve2 ». Et la perte d’un être cher le révèle cruellement dans le déchirement de l’instant porteur du deuil. Évidence affective donc de l’instant, gagnée en particulier dans la douleur de la rupture ultime qu’est celle de la mort d’un proche : « le deuil le plus cruel, c’est la conscience de l’avenir trahi et quand survient l’instant déchirant où un être cher ferme les yeux, immédiatement on sent avec quelle nouveauté hostile l’instant suivant “assaille” notre cœur3. » La continuité n’est qu’une illusion, une sorte de sommeil dont l’instant nous fait toujours sortir. La philosophie de l’instant illumine, ainsi, tout autant les assauts tragiques et soudains du temps que la dimension créatrice de la conscience. Instants pluriels et tous différents transportant la discontinuité dans les expériences concrètes. L’expérience de l’instant est à la fois une rupture, éveillant l’esprit à ce que la fausse continuité de la vie quotidienne nous fait ignorer, et toujours aussi une rencontre du monde. L’instant est un éveil de l’esprit, une surprise, un étonnement ou une douleur. Rupture, arrachement et ce qui se gagne, telle est la coloration de l’instant. La vie est toujours à gagner, ce en quoi elle est présente. Il importe alors de saisir combien l’homme est un nœud de rythmes, une décision, si l’on veut retenir les instants de grâce où il semble nous pousser des ailes, des pieds délicats. Dimension aérienne de ces instants vécus où nos efforts, notre inspiration, parviennent à inscrire dans l’existence un temps porteur, fécond et dense. Précisons qu’il ne s’agit en aucun cas de réintroduire une forme d’éternité. L’instant n’est pas atome d’éternité. Dans l’instant, c’est bien parce que je me livre à la fragilité, au risque de la discontinuité, que je puis en même temps y découvrir une liberté créatrice. L’instant reste éminemment temporel. Il introduit une rupture, « une sorte de jeu4 » capable d’orienter notre cheminement par ses décisions créatrices. Rien ne nous autorise à y voir une échappée hors du temps. « Il est, comme l’exprime Mehl, une tension particulière que nous donnons à la durée, mais il n’est pas hors de la durée. Nous ne pouvons transcender le temps qu’en restant à l’intérieur du temps5. »
1
G. Bachelard, L’Intuition de l’instant, op. cit., p. 13-15. Ibid., p. 14. 3 Ibid., p. 15. 4 R. Mehl, Le Vieillissement et la mort, op. cit., p. 18. 5 Ibid., p. 19. 2
208
SAGESSE TRAGIQUE
C’est « par ces décisions créatrices d’instants1 » qu’une existence, que ce soit celle d’un peuple ou d’un individu, peut troquer son statut d’existence purement temporelle pour celle d’existence historique. « Notre seule victoire sur le temps c’est l’histoire, mais nous n’accédons à l’histoire que pour être exposés et nous exposer de façon plus consciente à la mort2. » Comme la joie, l’instant créateur, par la plénitude qu’il offre, peut à ce titre évoquer l’éternité, mais si on le sonde dans sa totalité, il évoque également « la mort par sa fugitivité, et son reflux vers un passé aboli3 ». En laissant une part de nous derrière nous pour créer du nouveau, en nous souvenant aussi d’instants vécus, nous ne pouvons que garder la conscience de la part d’irrémédiable et de mortel dans tout ce que nous expérimentons. « L’instant nous avertit que c’est précisément dans les moments de sa plus grande plénitude que l’existence est la plus menacée. La continuité de la durée peut à chaque instant être rompue4. » Rupture mortelle et créatrice demeurent les deux faces de l’instant qui, lorsque nous parvenons à la saisir sur son versant exaltant, ne nous a donc en rien isolés du temps, seulement permis de le transformer. Ainsi s’agit-il de tenter d’épouser le mouvement irrégulier de la vie : puisque celle-ci n’est qu’évanouissement de moments, ce qui importe c’est une attention à l’ici et au maintenant, c’est-à-dire au présent fugitif, à la donation de l’immédiat. C’est dire que l’important n’est pas tant le résultat que l’action sur laquelle l’on concentre son attention et son désir. La réussite de ce que l’on entreprend est souhaitée bien entendu, mais dans la mesure où elle implique, outre mon application et ma compétence, quasiment toujours une part de chance, elle ne peut représenter la condition de mon investissement et de ma satisfaction. Si l’on garde à l’esprit, qui plus est, la vocation de toute réalisation à la dispersion et à l’oubli, l’important est de se concentrer sur la meilleure réalisation de l’œuvre que l’on a décidé d’entreprendre. Nous retrouvons la pertinence de l’association établie par Conche entre « volonté tragique » et « volonté du meilleur » pour caractériser la sagesse tragique, formulant cette exigence de toujours faire tout de son mieux sans se préoccuper de ce que cela devient. Se concentrer sur le présent paraît primordial parce qu’il est l’unique point de contact avec le réel. « Vanité des vanités, proclame l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité5. » Montaigne invitait à méditer cette sentence exprimant la vanité de tous les buts humains. Ce texte, estimait-il, « devrait être soigneusement et
1
Ibid., p. 18. Ibid., p. 19. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 L’Ecclésiaste, 1, p. 1055. 2
209
SAGESSE TRAGIQUE
continuellement médité par les gens d’entendement1 ». L’insensé se nourrit de l’illusion qu’il y a des buts valables et dignes d’être poursuivis, voire que sans cette poursuite d’une vie tout en projets il n’est aucune consistance. Si elle ne mène à rien, sa vie lui semble dépourvue d’épaisseur. Mais la vie trouve d’elle-même sa consistance dès lors que l’on est heureux d’accomplir telle ou telle tâche. Non pour le résultat, le but à atteindre mais pour ellemême. Jouissance d’être actif tout simplement, le but étant indifférent. Quelles leçons tirer, alors, de tels constats ? N’est-ce pas que notre façon coutumière d’appréhender le cours des choses demande à être révisée ? Nicolas Grimaldi écrit en ce sens : « Au lieu que le présent nous déçoive de si mal ressembler à l’avenir que nous avions imaginé, ne devrions-nous pas nous réjouir plutôt d’y trouver ce que nous n’attendions pas ? […] Un début de sagesse consisterait alors à ne pas attendre comme une fête l’avènement de ce que nous avons imaginé, mais à nous réjouir comme d’une surprise de ce que nous n’attendions pas et que nous n’aurions même jamais pu imaginer2. » Si l’on ne peut ôter la dimension d’attente de la conscience, presque tout pourrait être surprise pour celui qui, attendant toujours, n’attendrait rien pour autant. « Alors accueillerions-nous et célébrerionsnous comme une munificence la gloire de chaque instant3. » Promotion de l’attention contre l’attente. On songe alors à l’un des derniers aphorismes du Gai savoir qui prend ici, nous semble-t-il, toute sa puissance d’évocation : Ici j’étais assis, à attendre, Attendre – mais à n’attendre rien, Par-delà bien et mal, à savourer tantôt La lumière, tantôt l’ombre, N’étant moi-même tout entier que jeu, Que lac, que midi, que temps sans but4.
« Au fond, tous s’accordent sur ce point qu’il n’est, ou qu’il n’y aurait, de bonheur qu’ici et maintenant. La seule question consiste à déterminer s’il est un lieu pour l’ici et un temps pour le maintenir. Si oui, l’expérience de la vie est bienheureuse, pour se confondre avec l’expérience du présent et coïncider avec elle-même. Mais, dans le cas contraire, il ne saurait y avoir à proprement parler d’expérience du présent : l’expérience de la vie est alors une expérience cruelle de l’absence au cours de laquelle ni l’ici ni le maintenant ne se donneront jamais à éprouver, sinon par le biais et le regret du déjà loin et du déjà passé5. »
1
M. de Montaigne, Essais, op. cit., III, chap. IX, p. 211. N. Grimaldi, Bref traité du désenchantement, Le Livre de Poche, « Biblio essais », 2004, p. 92-93. 3 Ibid. 4 F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., Appendice, « Sils-Maria », p. 305. 5 C. Rosset, Le Philosophe et les sortilèges, Minuit, « Critique », 1985, p. 115-116. 2
210
SAGESSE TRAGIQUE
Chacun se retrouve face à son propre choix. Pour Rosset et tous ceux qui estiment qu’il n’y a presque rien à apprendre et donc de multiples nuances à saisir, si ténues soient-elles, celui-ci est fait. Il écrit : « Sois ami du présent qui passe : le futur et le passé te seront donnés par surcroît1. » Comme le relève Pierre Hadot, fort des leçons des Anciens, avant d’apprendre à mourir, philosopher c’est apprendre à « vivre dans le présent, c’est vivre comme si nous voyions le monde pour la première et la dernière fois2 ». Il nous apparaît que l’horizon du tragique sait ouvrir ces deux portes essentielles du philosopher qui n’oublie pas le vivre : éprouver le moment présent dans sa précarité, comme si donc le monde nous apparaissait pour la dernière fois et, dans son maintien qui a toujours de quoi surprendre, comme une première fois, une pleine découverte. Pas d’une première fois naïve, mais de celle précisément qui est revenue de la tourmente et qui peut voir et apprécier chaque paysage comme nouveau. Être ami du présent qui passe : savoir être dans le présent – projeter et regretter appartiennent au registre passionnel. Cioran nous semble s’exprimer en ce sens lorsqu’il écrit : « Ne regarde ni en avant ni en arrière, regarde en toi-même, sans peur ni regret. Nul ne descend en soi tant qu’il demeure dans la superstition du passé et de l’avenir3. » À l’encontre d’une attention détournée d’elle-même, parce que s’attardant sur le temps aboli du passé ou se projetant illusoirement dans un futur vaporeux, s’affirme donc la préférence de la réalité finie d’un présent immanent intensément vécu. À cet égard, la sagesse tragique implique très certainement également la générosité d’esprit au sens que lui donne Montaigne. Invitation à la générosité de l’esprit, c’est-à-dire ne jamais se contenter de ce que d’autres ou nous-mêmes avons trouvé en chemin, en quête de connaissance. La route est toujours ouverte. Pas de fin à nos recherches. C’est le signe d’une fermeture ou d’un rétrécissement d’esprit de se contenter ou de se laisser vaincre par quelque lassitude : « Nul esprit généreux ne s’arrête en soi : il prétend toujours et va outre ses forces ; il a des élans au-delà de ses effets ; s’il ne s’avance et ne se presse et ne s’accule et ne se choque, il n’est vif qu’à demi ; ses poursuites sont sans terme et sans forme ; son aliment c’est admiration, chasse, ambiguïté4. » C’est souligner combien le bonheur ne peut être un « but ». Celui-ci n’a pas à être cherché dans la mesure où il ne saurait être atteint ou reçu. Si le terme « bonheur » présente un intérêt, c’est pour exprimer ceci en tout cas qu’il ne réside pas dans un rapport à autre chose que soi. Une certaine manière d’être soi qui faisait écrire à Montaigne que « le sommet de la 1
C. Rosset, Le Réel et son double, op. cit., p. 84. P. Hadot, La Philosophie comme manière de vivre (Entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold I. Davidson), Le Livre de Poche, « Biblio essais », 2004, p. 260. 3 Cioran, Cahiers, op. cit., p. 368. Voir aussi De l’inconvénient d’être né, in op. cit., p. 1323. 4 M. de Montaigne, Essais, op. cit., III, chap. XIII, p. 357. 2
211
SAGESSE TRAGIQUE
sagesse humaine et de notre bonheur » ne réside que dans « l’amitié que chacun se doit »1. C’est dire que cette sagesse aventureuse suppose une disposition. Comme l’exprime Rosset en ce sens, vivre en bonne société avec soi-même, ne rien se cacher, s’accepter tel que l’on est, là réside la sagesse : « le meilleur profit qu’un sage puisse retirer de la philosophie consiste à vivre en “bonne société” avec lui-même, ce qui suppose qu’on n’a rien à se cacher2 ». Ne pas se vouloir un autre, intégrer l’unique. C’est rappeler que la vraie vie est ici et qu’elle n’acquiert sa densité que par notre présence attentive et active et notre capacité d’accueil des apparences. Nous ne sommes heureux que par le « oui » fondamental que nous disons à la vie et à nous-mêmes. Cela ne signifie pas, loin s’en faut, que nous puissions pour autant être heureux quoi qu’il arrive, quoi que nous éprouvions. Parler de sagesse tragique, c’est viser précisément une sagesse à la mesure de notre lucidité. Le « oui » n’est pas celui de l’insensé, car ce « oui » à la vie s’accompagne de la conscience que ce « oui » est aussi un « oui » à la douleur et à la mort. Nous retrouvons la force de l’approbation inconditionnelle à la réalité, telle que l’a formulée Nietzsche. Il n’est de véritable consentement à soimême que par une acceptation sans partage du devenir. Un oui à la vie telle qu’elle se donne, avec la souffrance inhérente à l’existence que supposent certaines heures de l’horloge. C’est là que ressort l’écart avec la perspective de sagesse des éthiques grecques. Si nous reprenons l’exemple de la philosophie stoïcienne, l’effort de concentration sur le présent s’inscrit dans la perspective plus vaste d’apprentissage de l’impassibilité. La méditation sur la mort et son imminence doit, certes, nous rappeler la valeur précieuse de chaque instant, mais c’est aussi pour la constituer en exercice spirituel. Penser constamment à la mort doit permettre de la dédramatiser, de la banaliser, en somme d’éradiquer l’angoisse qu’elle peut nous inspirer. « La perfection morale, écrit Marc-Aurèle, consiste en ceci : à passer chaque jour comme si c’était le dernier, à éviter l’agitation, la torpeur, la dissimulation3. » Il s’agit de replacer la mort dans l’économie d’ensemble de la nature, autrement dit de la concevoir comme cet événement naturel et nécessaire du cosmos qui ne dépend pas de nous. Parvenir à cette représentation, expression de notre consentement à l’ordre de la nature, c’est renforcer l’éthique de l’acceptation et éprouver, par conséquent, notre capacité de distanciation intérieure envers l’émotion que peuvent éprouver les hommes à la pensée de leur propre disparition. La pensée tragique, nous l’avons vu, n’entend pas retrancher du réel ce qui grince, inquiète et est susceptible de faire souffrir par une attitude d’impassibilité, car celle-ci, tout en n’excluant pas l’action, a ce défaut 1
Ibid., III, chap. X, p. 283. C. Rosset, Le Choix des mots, op. cit., p. 16. 3 Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, in op. cit., livre VII, LXIX, p. 125. 2
212
SAGESSE TRAGIQUE
majeur de viser précisément une vie vécue « à distance ». Vouloir supprimer ou réduire la souffrance suppose une réduction vitaliste, une rupture des attaches avec la vie sensible. En quoi, comme l’exprime Conche, la sagesse de la modération et de l’harmonie affirme « l’homme moins quelque chose (la raison sans la passion, la volonté sans le désir, l’esprit sans le corps, etc.)1 ». Approbation partielle de soi qui, pour procurer une certaine tranquillité, ne peut qu’impliquer une forme d’ascétisme mortifère. La pensée tragique ne cherche pas, quant à elle, à contourner l’inquiétude que suppose une vie vécue en pleine connaissance de cause. Si vouloir la vie, c’est vouloir la mort, ce n’est pas pour s’endurcir contre elle, mais c’est pour définir les contours d’une forme de vie ascendante. Autrement dit, s’efforcer de donner à notre vie toute l’intensité et la richesse dont nous sommes capables, puisant une énergie créatrice de la capacité d’accueil du réel immédiat dans sa fragilité et son instabilité hasardeuse. Attitude face à la vie qui ne peut passer que par un entier consentement, autrement dit en prenant en compte la condition humaine dans sa totalité, donc aussi la souffrance. « Comme dans tout pari sur la vie, sur la vie pleinement vécue, l’enjeu est à la mesure du risque encouru : s’il y a une force du consentement, elle ne pourra surgir que d’une adhésion sans réserve, non d’une acceptation résignée2. » La vie ne peut être intéressante et attirante qu’autant qu’elle conserve l’intégralité de son pouls, incluant par conséquent la passion, l’excès, la souffrance, la tristesse, le malheur, la solitude, la mort. Lorsque Nietzsche parle de l’amor fati, de l’amour du destin, c’est en reconnaissant, comme le veut Héraclite, l’unité des contraires : vie et mort, plaisir et douleur, joie et tristesse, ivresse et souffrance. C’est, comme Rosset s’est attaché lui aussi à le mettre en évidence, l’approbation en connaissance de cause qui permet de relier les contraires, « horreur » et « joie ». La sagesse tragique ne se place donc pas sous le signe de la mesure et de la tempérance, mais passe, au contraire, par une « rhétorique de l’extrême3 », une reconnaissance des alliances contradictoires, à même de désigner cette tension entre affirmation, acquiescement et lucidité, prise en compte de la souffrance dans sa gratuité. Ce en quoi, dans la lignée nietzschéenne, Rosset reconnaît « la nécessité du lien entre pensée tragique et pensée approbatrice4 ». La logique du pire dont se recommande la pensée tragique révèle pleinement son enseignement. Tragique et affirmation peuvent ainsi être appréhendés comme termes synonymes, parce que l’approbation est point de départ et aboutissement.
1
M. Conche, « La sagesse tragique », Orientation philosophique, op. cit., p. 161. A. Le Ninèze, La Sagesse. La force du consentement, op. cit., p. 240. 3 Ibid., p. 242. 4 C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 46. 2
213
SAGESSE TRAGIQUE
Tenter de penser pleinement le réel, nous l’avons vu, suppose, selon le commentaire d’Alain Le Ninèze, d’« accepter de le penser dans son absolue singularité qui inclut l’aléa, le non-sens, la gratuité du mal et de la souffrance1 ». Principe de cruauté, volonté de lucidité, qui refuse les versions édulcorées et rassurantes du réel consistant à le dissoudre en l’inscrivant dans un système lisse et rationnel, comme a pu le faire toute une tradition philosophique. De même, vivre résolument sous cet horizon signifie épouser l’impermanence du réel, aimer et vivre le présent sans occulter l’indifférence tragique de la réalité. Art de vivre qui reconnaît, au fond, dans la vie cette chance éphémère qu’il nous appartient de savoir saisir en un gai savoir désespéré. C’est dire que la sagesse tragique ne peut reconnaître son monde que dans le mouvant et l’incertain : « le monde de la sagesse tragique est celui où l’on est assuré de rien, où l’on ne peut compter sur rien, où il n’y a de constant que l’instabilité, bref le monde d’Héraclite2 ». Approbation qui ne peut aller sans déchirement, qui exige l’effort d’attention, d’amour et d’intelligence et, plus certainement encore, un art du jeu.
1 2
A. Le Ninèze, La Sagesse. La force du consentement, op. cit., p. 241. M. Conche, « La sagesse tragique », Orientation philosophique, op. cit., p. 163.
214
SAGESSE TRAGIQUE
II. Temps, mort, jeu Il peut désormais paraître requis de se référer à l’héraclitéisme de l’enfant-joueur, celui qui, sans pourquoi ni raison, pousse les pions ou lance les dés, en se jouant des tours, contours et détours du temps. « La vie est un enfant qui joue au tric-trac : c’est à un enfant que revient la royauté1 ». Tel est le jeu du Temps héraclitéen, royauté d’un enfant, que n’ignore pas le penseur tragique. Rendre le réel à ses apparences mouvantes et changeantes, c’est reconnaître du même coup tout le jeu de la Fortune2, autrement dit du hasard, englobant celui du Temps : la mouvance perpétuelle des choses, leur engloutissement promis. Le théâtre de nos vies est l’apparence ; elle est la scène où tout se passe, où tout se déroule, s’écoule, s’enfuit et meurt. Le principe de dissolution qui nous échoit déclare notre impuissance foncière, notre néant stomacal. Les amoureux de la stabilité n’y trouveront certes pas leur compte ; dans l’univers tragique pas de point fixe, de point d’ancrage, ni dans l’ordre de la connaissance, ni dans le monde, ni dans la sphère plus étroite de nos vies. Règnent le désordre, le mobilisme incessant, le flux mouvant des apparences. La totalité du réel ne peut être pensée comme ordonnée et raisonnable. Sa part peut, par conséquent, être rendue au jeu et au devenir ludique. S’il est un ordre, c’est celui que l’on constituera par soimême et pour soi-même, sans autre secours. « En résumé, écrit Conche, ou l’homme ne trouve dans le réel que l’ordre qu’il y apporte lui-même, ou, s’il veut tenir compte de tout, il n’y trouve que le désordre des pensées et des événements3. » Fortune, hasard, principe d’instabilité totale et d’arbitraire pur – en trois lettres s’annonce un terme : « jeu ». À entendre, précisément, comme l’activité, sans autre sens qu’elle-même indépendamment du but ou du résultat. Désordre foncier : impossible d’avoir affaire à cet ensemble structuré qu’est un monde, mais seulement à un ensemble à jamais inassemblable. Le monde est mouvant, glissant, mais c’est cette glissade qui, à la limite, est intéressante et non pas une illusoire fixité dans un monde maquillé de mots abstraits ou de catégories fatigantes. La Fortune a ses 1
Héraclite, Fragments, op. cit., fragment 124 (DK B52 / M 93), p. 304. Le corpus mythologique offre un éclairage des plus pertinents sur la Fortune. Celle-ci incarne la divinité qui préside à tous les événements, à la vie des hommes et à celle des peuples. Elle distribue les biens et les maux selon son caprice, sans raison ni pourquoi. Pour la dépeindre, on lui a parfois donné un gouvernail afin d’exprimer l’empire du hasard. Ainsi, dotée d’une ambivalence essentielle, peut-elle se révéler, alors que la roue tourne, Fortune dorée, complaisante, source de bienfaits, mais aussi, mauvaise Fortune, exprimée sous la figure d’une femme exposée sur un navire sans mât et sans gouvernail et dont les voiles sont déchirées par la violence du vent. 3 M. Conche, Pyrrhon ou l’apparence, op. cit., p. 301. 2
215
SAGESSE TRAGIQUE
voies, le jeu du Temps aussi, elles-mêmes pas incompatibles avec une certaine quiétude intérieure. Car dans ce monde rendu à sa donation immédiate, l’existant dévisse mais ne se noie pas pour autant ; il peut cheminer, en prêtant attention à chaque nuance des fuyantes apparences. N’est-ce pas de notre capacité même à accepter l’apparence comme telle que dépend une certaine quiétude ? « Le jeu des apparences n’invite pas à l’étourdissement, mais à un accueil de leur manifestation, et doit conduire à l’apaisement, forme de recueillement délivré de l’excuse du religieux, comme de toute hantise de l’être1. » En l’homme se joue un jeu dont il n’est nullement le maître. « La sagesse est de devenir le joueur de ce jeu en acceptant la règle du jeu et la distribution des chances2. » C’est à partir de là sans doute que peut se formuler un gai savoir, en retrouvant, au cœur même du devenir et de la destruction, le « oui », les forces affirmatives et actives. Expression d’une raison restaurée, délivrée de tout esprit de lourdeur et de ressentiment. Pensée qui reconnaît dans le devenir le seul être, qui consent à soi-même, mais aussi à l’existence tout entière. En quoi Nietzsche voyait la gaieté tragique du gai savoir comme « inséparable de la reconnaissance de la vie créatrice, au sein même de la souffrance et de la passion3 ». Et cette reconnaissance est gratitude et renaissance de l’esprit. Il ne s’agit donc en rien, comme le commente André Simha, d’une « approbation indifférenciée et résignée4 ». Ainsi, du « oui » de l’âne qui ne sait pas dire non et refuser le fardeau qu’on lui impose. Assentiment qui inclut une force de négation, supposant un dépassement du nihilisme. Il ne s’agit pas non plus de la violence destructrice du lion, qui ne sait que piétiner ce qui menace de l’entraver. C’est la négation qui est la condition de l’affirmation5. Et c’est l’innocence du jeu de l’enfant qui est à même de symboliser cette possibilité de l’affirmation : […] que peut encore l’enfant, dont le lion lui-même eût été incapable ? Pourquoi le lion ravisseur doit-il encore devenir enfant ? C’est que l’enfant est innocence et oubli, commencement nouveau, jeu, roue qui se meut d’elle-même, premier mobile, affirmation sainte. En vérité, mes frères, pour jouer le jeu des créateurs il faut être une affirmation sainte ; c’est son propre vouloir que veut à présent l’esprit ; qui a perdu le monde, il conquiert son propre monde6.
L’affirmation dans sa plénitude créatrice, c’est donc « un vouloir qui se veut ». La volonté de puissance désigne précisément cette volonté qui est 1
F. Cossutta, Le Scepticisme, PUF, « Que sais-je ? », 1994, p. 121. M. Conche, « La sagesse tragique », Orientation philosophique, op. cit., p. 168. 3 A. Simha, Nietzsche, Bordas, « Pour connaître », 1988, p. 115. 4 Ibid. 5 F. Nietzsche, Ecce homo, op. cit., « Pourquoi je suis un destin », § 4, p. 154. 6 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. G. Bianquis, in Œuvres, Flammarion, « Mille & une pages », 2000, « Des trois métamorphoses », p. 342. 2
216
SAGESSE TRAGIQUE
puissance, ne visant pas d’autre fin qu’elle-même. L’enfant-joueur incarne ce symbole héraclitéen du dieu qui joue et dont le jeu est totalement innocent : il joue aux dés et les combinaisons qui sortent ne peuvent être calculées. Savoir devenir le joueur de ce jeu signifie, par conséquent, prendre le risque d’exister en une implication consciente de sa dérision. C’est dire que, outre une capacité d’accueil, reste à posséder aussi en soi une certaine dose de rire. De sorte que l’on peut estimer, avec Éric Blondel, que « le rire n’est pas seulement un objet pour la philosophie : il peut être une attitude philosophique1 ».
Sentier humoristique « Pourquoi parlez-vous de la vie avec tant de frivolité ? Parce que je pense que la vie est une chose bien trop importante pour qu’on puisse en parler avec sérieux. » Oscar Wilde, Aphorismes.
« Rien n’est plus drôle que le malheur […]. Si, si, c’est la chose la plus comique au monde2. » Ces mots de Beckett donnent le ton, inaugurent le geste. Précarité. Éphémère. Vie saisie sur fond de mort : termes de notre finitude, de l’impuissance humaine face à une existence vouée à l’anéantissement. De quelle attitude face à la vie peut se recommander une pensée des abîmes ? Une telle pensée ne peut envisager qu’un art de vivre mortel, c’est-à-dire une manière de composer avec le réel dissolvant et avec soi-même, porteuse d’un consentement sans réserve à l’indifférence tragique du monde. Contours d’une sagesse tragique résidant dans l’alliance lucide de soi et de la vie, supposant la tentative de déployer son existence sans occulter les déchirures auxquelles nous expose une existence reconnue dans toute sa crudité. Tenter de se modeler, de s’essayer à vivre avec nos failles et notre angoisse plutôt que de chercher à les annihiler. Sinon l’on tue en soi, du même coup, tout bouillonnement vital, tout élan créateur, toute capacité d’action. Il s’agit alors d’envisager, de dessiner des gestes en mesure de composer notre partition d’existence avec le vide sous les yeux. Avec l’occasion, est ressortie l’exigence de présence aiguë au présent, sollicitant notre attention et notre concentration pour donner toute l’intensité dont nous sommes capables aux instants précieux susceptibles de scander notre cheminement. Le rire nous paraît également une articulation essentielle de cette souplesse. En ce sens, Georges Bataille déclarait : « J’échappe à la pesanteur en riant3. » Il estimait à ce titre que l’homme entier est celui qui n’a pas de 1
E. Blondel, Le Risible et le dérisoire, PUF, « Perspectives critiques », 1988, p. 11. FP, p. 33-34. 3 G. Bataille, Le Coupable, in Œuvres complètes, V, Gallimard, « Blanche », 1973, p. 251. 2
217
SAGESSE TRAGIQUE
but, mais dont la vie est une fête immotivée1. Puisque « la vie n’est qu’un rire sur les lèvres de la mort2 », il ne reste qu’à rire, d’un rire vrai et entier, franchement placé sous le signe de l’humour. Le rire ne peut-il pas, en effet, s’immiscer élégamment entre les filets de notre précarité ? L’humour n’est-il pas le plus tendre allié des a-larmes de la mort ? C’est avec ces alliances fragiles qu’il nous paraît important désormais de cheminer. De quoi, nous semble-t-il, mettre pleinement en évidence que la pensée tragique n’est pas une démarche morbide, mais un jeu, ainsi que la mort elle-même, à la fois grave et dérisoire. Zarathoustra voulait nous enseigner le rire. Aussi pouvons-nous dès lors nous recommander de ses paroles : Haut les cœurs, mes frères, Haut, toujours plus haut ! Et n’allez pas oublier non plus les jambes ! Levez la jambe aussi, vous qui êtes bons danseurs, et, mieux encore, tenez-vous sur la tête ! Cette couronne du rieur, cette couronne de roses, je l’ai mise moi-même, j’ai moimême déclaré saints mes éclats de rire. Je n’ai trouvé personne aujourd’hui qui fût assez puissant pour le faire. Zarathoustra le danseur, Zarathoustra le léger, qui fait signe de ses ailes, lui qui est prêt à l’envol, et fait signe à tous les oiseaux, fin prêt, ce bienheureux désinvolte : – Zarathoustra le prophète véridique, Zarathoustra le rieur véridique, ni impatient ni absolu, celui qui aime écarts et sauts : moi-même me suis posé cette couronne ! Cette couronne du rieur, cette couronne de roses : à vous, mes frères, je lance cette couronne ! J’ai sanctifié le rire : vous, hommes supérieurs, apprenez donc auprès de moi – à rire3 !
Grâce conquise sur la lourdeur, légèreté alliée de la gravité, à l’image des sauts et des entrechats du danseur accompli qui a appris à dominer la station pesante de son corps. Forme de consumation la plus élégante qui soit : le visage qui se fend, l’éclat du rire ! Et Zarathoustra peut encore poursuivre en écho : « Qui gravit les plus hautes cimes se rit de toutes tragédies jouées et de toutes tragédies vécues4. » Rire des jeux tragiques de la scène comme de la gravité tragique de la vie. Quel rire Zarathoustra entend-il nous enseigner ? Un rire conscient de notre petitesse et de la capacité de trouver de précieux points d’envol. Comment ne pas s’engluer dans la boue du tragique ? Il y a le rire qui est légèreté et innocence, expression de la manière de ne pas se prendre au sérieux au sein de sa propre gravité.
1
J.-M. Rey, « La mise en jeu », L’Arc, « Georges Bataille », n°32, 1967, Éditions Duponchelle, 1990, p. 21. 2 R. Jaccard, « La Comédie du bonheur », in Les Séductions de l’existence, op. cit., p. 78. 3 F. Nietzsche, « Avant-propos à La Naissance de la tragédie », Essai d’autocritique et autres préfaces, op. cit., § 7, p. 47-49. 4 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. M. de Gandillac, op. cit., « Du lire et de l’écrire », p. 55.
218
SAGESSE TRAGIQUE
Nietzsche en évoquant les « esprits libres et insolents » reconnaît dans ce périmètre « des cœurs brisés, fiers et incurablement blessés » et dont la bouffonnerie peut être appréhendée comme « le masque d’un savoir douloureux et trop lucide »1. C’est pourquoi, d’ailleurs, il n’hésite pas à fustiger Thomas Hobbes qui entendait délivrer les têtes pensantes du rire qu’il qualifiait de « triste infirmité de la nature humaine ». Le critère de classification s’inverse : « je serais tenté de classer les philosophes d’après la qualité de leur rire, en plaçant tout en haut de l’échelle ceux qui sont capables du rire d’or2 ». Autrement dit, un rire capable de s’accomplir aux dépens du sérieux. Contre l’esprit de pesanteur, éclot l’invitation à la danse. Or qu’est-ce que l’esprit de la danse ? Un esprit léger qui évacue le pesant fardeau du sérieux et du monde, qui, à travers chacun de ses pas, tente de façonner l’instant présent en conciliant la légèreté à la gravité. La danse et ses élans vigoureux expriment au plus près cette capacité à ne pas s’effondrer sous le poids de ses tourments, à embarquer sa souffrance dans les turbulences de son rire. « Le rire, joie au fond, est guetté par la souffrance, la tristesse et le danger, les maux qu’il élude ou nargue dans sa brève et parfois amère victoire. Joie de la liberté triomphante, il danse sur l’abîme : observez qu’il côtoie fréquemment les lieux où règnent ses contraires, la souffrance, la déréliction, la déchéance, l’horreur, la mort3 ». Plus loin que cela encore : point de rire, peut-être, qui ne soit plein et vraiment libérateur sans la connaissance de l’affliction et des larmes. Le rire émane directement des contrées souffrantes qui étreignent l’homme. « L’animal le plus souffrant qui soit sur la terre est celui qui a inventé – le rire4. » C’est en ce sens que Bataille écrivait dans la lignée de Nietzsche : « Si nous ne puisions naïvement à la source de la douleur, qui nous donne le secret insensé, nous ne pourrions avoir l’emportement du rire : nous aurions le visage opaque du calcul5. » S’éclaire l’impulsion du rire attachée à la perspective tragique : parce qu’aussi gratuit et hasardeux que chaque existence, son apparition et sa disparition. Pas de justification à chaque existence, pas plus qu’à l’embrasement de ce rire susceptible de tout balayer sur son passage. « Incontrôlé, incontrôlable, le rire fuse, nous secoue, nous déchire plus intimement et nous ouvre plus infiniment que ne le font l’affliction et les larmes, qui nous rassemblent plutôt sur nous-mêmes6 », écrit Dastur. Dans son élan, « il nous porte jusqu’au bord de l’abîme que nous avons en nous, 1
F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, op. cit., § 270, p. 231-232. Ibid., § 294, p. 242-243. 3 E. Blondel, Le Risible et le dérisoire, op. cit., p. 22. 4 F. Nietzsche, La Volonté de puissance, trad. G. Bianquis, II, op. cit., livre IV, § 541, p. 440. 5 G. Bataille, L’Impossible, Minuit, 1962, p. 136-137. 6 F. Dastur, La Mort, op. cit., p. 79. 2
219
SAGESSE TRAGIQUE
vers la profondeur sans fond d’une existence qui, dans sa mortalité foncière » se sait « loin de pouvoir jamais récupérer sa mise »1. En quoi Nietzsche considère que l’existence, délivrée du « but », ouvre au rire de l’existence, de soi-même2. Ce rire-là ne peut, ainsi, avoir lieu et prendre toute sa portée que pour celui qui se sait emporté « dans l’irrésistible mouvement d’une dépense injustifiée et d’un devenir innocent3 », qui n’ignore donc pas le jeu cosmique que nous avons retrouvé dans la figure de l’enfant d’Héraclite. C’est de cette gratuité qu’émerge le rire. Sans elle, pas de rire véritable. C’est pourquoi l’on peut estimer, avec Dastur, que l’angoisse et le rire ont une racine commune : « le rire n’éclate en nous que lorsque, comme dans l’angoisse, tout sol nous manque, et que dans ce suspens, nous nous voyons soudainement libérés de toutes les pesanteurs de la vie4 ». Le rire s’apparente à l’angoisse ; il nous ouvre à la gratuité de l’existence. « Dans le rire, nous faisons l’expérience que nous vivons “pour rien”, que nous vivons sans raison, et qu’il n’y a ni à chercher de raison, ni à expier le fait que nous existons5. » Le rire révèle la gratuité de ce qui se joue, tout en déclarant la gravité de ce jeu hors duquel il n’y a rien. De quel rire parlons-nous par conséquent ici ? Rire tragique, manifestant à la fois la vision de l’abîme et la possibilité de s’en tenir à quelque distance. Forme de révérence adressée à l’abîme. Forme de dépassement aussi du même abîme que l’on surplombe alors de la fulgurance de ses éclats, à la source d’une réelle stimulation de l’esprit. Dans cette optique, Fernando Arrabal rappelait ces mots de Beckett : « Les éclats de rire sont comme les coups de bâton donnés par le maître zen à son disciple afin d’éveiller son esprit6. » Encouragement, stimulant suprême ; il n’a rien à dire, rien à prouver, sinon une tenue digne, une persévérance de l’esprit. S’il est, en effet, une dignité suprême, ne réside-t-elle pas dans cette association de la façon de rire la plus turbulente avec l’esprit de gravité le plus profond ? C’est ainsi que le roi de Escurial demande à son bouffon Folial de s’esclaffer en lui disant : « Ris encore ! J’aime ce rire flamand qui contient des grincements de dents7. » Cioran relate l’épisode suivant : à un ami qui lui écrit que la vie ne lui dit plus rien, il répond : « Si tu veux un conseil, le voici : quand tu ne pourras plus rire, alors seulement tu devras te tuer. Mais tant que tu en es capable,
1
Ibid. F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., livre premier, § 1, p. 49-52. 3 F. Dastur, La Mort, op. cit., p. 79. 4 F. Dastur, « De l’angoisse à la joie d’être mortel », Le Nouvel Observateur, « Apprivoiser la mort pour mieux vivre », Hors-série n°62, avril-mai 2006, p. 47. 5 Ibid. 6 F. Arrabal, « Le coup de bâton du maître zen », Lire, n°234, avril 1995, p. 138. 7 M. de Ghelderode, Escurial, in Théâtre, I, Gallimard, « Blanche », 1950, p. 76. 2
220
SAGESSE TRAGIQUE
attends encore. Le rire est une victoire, la vraie, la seule, sur la vie et la mort1. » Tant que le rire se maintient, tant que l’on a la force de rire, résonne l’expression d’un poumon persistant, quel que soit le désespoir éprouvé à ce moment-là. Et « continuer » n’est pas un terme creux. « Rire est la seule excuse de la vie, la grande excuse de la vie ! […] Rire est une manifestation nihiliste, de même que la joie peut être un état funèbre2. » Se trémousser, pouffer, se tordre, exploser, le rire s’offre, pourrions-nous dire, comme cette secousse-rescousse traversant l’individu de part en part, susceptible de le délivrer de l’affliction et de l’abattement, témoignant par là même d’une vitalité persistante. La voie royale du rire : ne rien méconnaître de la dimension tragique de notre condition tout en y insérant la dimension du jeu. Un rire au cœur de la gravité qui ne se prend précisément pas au sérieux. La distinction entre la gravité et le sérieux prend, en effet, ici toute sa portée : « L’univers n’est pas sérieux. On doit s’en moquer tragiquement3. » Car « prendre les choses au sérieux, précise Cioran, cela veut dire les peser sans y participer ; les prendre au tragique, s’engager dans leur sort4. » Distinction essentielle qui recoupe également celle entre deux importantes tonalités du rire, l’humour et l’ironie. L’ironie, en effet, penche du côté du sérieux. Fussent-ils pertinents et profonds, ses procédés « mordants » font qu’elle s’accomplit aux dépens du monde et d’autrui. On rit aux dépens d’autrui sous le masque du sérieux. L’ironique, en donnant un sens différent à ses propos ou gestes que celui qu’ils sont censés refléter, en parlant a contrario, vise à railler l’autre, sans en avoir l’air. L’ironie désigne un rire sous-entendu, « sous-cape », par-delà le sérieux du propos. Et l’on sait les vertus que lui a trouvées Socrate. Ce détour permet à l’ironisé de réaliser son fourvoiement, de prendre pleinement conscience de ses propres erreurs. L’ironie, à ce moment-là, œuvre sur le terrain de la logique afin de mieux relever les contradictions du discours. Socrate simulait ainsi le nihilisme intégral en matière de savoir (« Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien »), simulation qui traduisait sans doute une réelle humilité, mais qui n’en était pas moins une ruse destinée à faire énoncer la vérité par son interlocuteur et, de ce fait, à mieux en démontrer le caractère universel. Le philosophe joue au niais pour déniaiser le niais, le réfuter de manière éclatante. La stratégie de l’ironie est simple. Il s’agit de dire le contraire, d’emprunter des chemins détournés pour
1
Cioran, Entretien avec Gerd Bergfleth, Entretiens, op. cit., p. 156. Cioran, Entretien avec Lea Vergine, Entretiens, op. cit., p. 141. Et le penseur roumain écrit à son propre sujet en guise de conclusion de son dernier ouvrage, Aveux et Anathèmes : « Après tout, je n’ai pas perdu mon temps, moi aussi je me suis trémoussé, comme tout un chacun, dans cet univers aberrant. » (Cioran, Aveux et Anathèmes, in op. cit., p. 1724). 3 Cioran, Le Crépuscule des pensées, in op. cit., p. 486. 4 Ibid., p. 353. 2
221
SAGESSE TRAGIQUE
parvenir à la vérité. Le philosophe s’avance masqué pour mieux faire éclater la vérité. Ici l’ironie est art de la persuasion. Mais, au-delà de cet art, l’ironie cherche aussi d’autres victoires. Sans traces apparentes de violence, autrui en prend pour son grade. Aussi a-t-elle des liens évidents avec la moquerie. C’est pourquoi l’on peut parler d’autodérision, mais il est impropre de parler d’auto-ironie, un double sens ironique ne pouvant tromper qu’autrui. Raillerie, taquinerie, sont les termes qui cheminent avec l’ironie. Les Fables de La Fontaine sont sans doute une parfaite illustration de la dimension mordante de l’ironie sous son air inoffensif. Elle prend autrui pour cible, blesse. L’ironie n’est donc telle que si elle comporte l’élément de dérision et l’intention de ridiculiser, de caricaturer le point de vue adverse. L’humour est plus complexe, il ne se targue pas de l’assurance de l’ironie. L’humour n’a pas de stratégie, de base ferme. Il va dans le sens même du tragique en ramenant le doute et la précarité sur le devant de la scène. Il n’a pas de vérité à énoncer, en cela il est, comme y insiste Jankélévitch, toujours en mouvement, essentiellement vagabond. Il ne peut s’installer nulle part, « il est le voyageur d’une errance infinie1 ». Légèreté, sourire et indulgence contre sérieux et raillerie. L’ironiste a un bouclier, l’humoriste des défroques. Il y a une tendresse et une pudeur dans l’humour qui le rendent porteur d’humanité. Le sourire bienveillant de l’un ne se confond pas avec les ricanements de l’autre. L’indulgence de Winnie, sa sérénité décrispée et bienveillante, prennent alors toute leur portée. Enfoncée jusqu’au cou, elle continue à parler, affrontant son malheur avec douceur et indulgence : « Encore un beau jour ! » Ainsi la définition de l’humour par Jankélévitch : « Une très légère mélancolie enveloppée dans un voile de tendresse2 ». Piste du mot : l’humour garde son lien avec son étymologie humorale. Tandis que l’ironie est sûre de son droit, se ménage une marge de sécurité en s’épargnant elle-même, l’humour est essentiellement capacité à rire de soi. L’on peut à cet égard songer, notamment, à Pierre Desproges glosant sur son cancer : « Noël au scanner, Pâques au cimetière » ou encore à Raymond Devos imaginant son émission posthume, s’entraînant sur scène à pousser un dernier soupir réussi. Robert Escarpit parle de conquête de la sympathie, exprimant par là cette capacité de l’humour à créer un périmètre de sympathie et de complicité fraternelle. « Ici commence vraiment le domaine de l’humour, celui qui corrige l’ironie destructrice par un clin d’œil complice3. » En s’incluant dans le rire, en se mettant « dans le même sac », l’humoriste sacrifie la quête de la domination au profit d’une alliance complice. C’est ce qui rend l’humoriste à même de tisser avec son auditoire 1
V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, op. cit., p. 156. Ibid., p. 160. 3 R. Escarpit, L’Humour, PUF, « Que sais-je ? », 1967, p. 115. 2
222
SAGESSE TRAGIQUE
ou son lecteur une sympathie bienveillante et humble, en mesure d’aider ses semblables « à supporter les petits malheurs et les grandes angoisses de la condition humaine1 ». Passage d’un rire de à un rire avec, l’humour a une portée plus profonde que l’ironie, car il est celui de l’être entier, de l’énergie vitale, du grotesque de l’existence. « Par un effort surhumain, l’humour devance le rire d’autrui, la moquerie, les écartant d’un revers de rire, en mettant les rieurs de son côté. Il est détachement. Ce serait un rire jaune s’il était forcé, mais il est liberté, victoire sur soi et le monde, joie d’un rire démystificateur et spontanément distancié : courage de la liberté tragique2. » C’est pourquoi l’accomplissement de l’ironie est de basculer dans la sphère de l’humour. Celui-ci va en effet plus loin que l’ironie car il s’inclut dans le rire, se moque de lui-même, de ce qui peut atteindre soi-même. Les personnages de Beckett illustrent au plus près cette disposition, dans la mesure où ils ne cessent de se moquer d’eux-mêmes. Écrasés par l’ennui, se sentant irrémédiablement croupir sur place, « quelque chose suit son cours » cependant, les entraînant dans la spirale de l’irréversible, et le jeu humoristique, à travers les propos « réconfortants » de Hamm, s’intercale pour exprimer combien la partie se joue en pure perte : « Mais nous respirons, nous changeons ! Nous perdons nos cheveux, nos dents ! Notre fraîcheur ! Nos idéaux3 ! » L’on ne peut manquer de penser également à Nagg et Nell qui, pris dans les rets de leur fin de partie, parviennent à rire de leurs moignons4, en se remémorant leur accident de tandem. Les personnages énoncent leurs chutes, leurs débâcles, et ce, calmement. C’est dire que l’humour n’est pas tant prise de distance que moyen de parler sans ambages de nos chutes, de notre mort. Dès que la souffrance menace trop, la tension humoristique est présente. Les deux mouvements s’accompagnent sans cesse. Les ouvrages se bâtissent-démolissent par les explosions humoristiques. Comme l’écrit Janvier à propos de l’écriture de Beckett : « Il n’est pas une transascendance tragique qui ne se double d’une trandescendance humoristique », la détente du sourire « ramenant la douleur à ce qu’elle est dans l’immense champ du devenir : une toute petite aventure »5. L’humour va, est en chemin, ne sait où il va, car il ne le sait sans doute que trop bien. « Nous vivons dans un monde fuyant où les choses n’arrivent qu’une fois, une seule fois dans toute l’éternité, et puis plus jamais… Et l’humour est peut-être un moyen pour l’homme de s’adapter à l’irréversibilité, de rendre la vie plus légère et plus coulante ; l’humour est 1
Ibid., p. 117. E. Blondel, Le Risible et le dérisoire, op. cit., p. 31. 3 FP, p. 25. 4 Ibid., p. 31. 5 L. Janvier, Pour Samuel Beckett, op. cit., p. 331. 2
223
SAGESSE TRAGIQUE
taillé dans la même étoffe fluide que le devenir ; l’humour est lui-même toute mobilité et toute fluence, et il s’accorde si bien au rythme de l’irréversibilité que la moindre répétition lui apparaît comme un radotage et une complaisance bouffonne1. » Nous ne pouvons nous établir dans la temporalité. Cette conscience est au cœur de l’humour. Jankélévitch parle de « pénultimité », de l’avant-dernier, qu’il relie au régime de l’humour. C’est dire que l’on ne se place ni au début ni à la fin, mais que l’on est en pleine continuation, que l’on se maintient dans la continuation. C’est pourquoi l’humour va, mais nulle part… La traversée nous laisse, comme le conclut le philosophe, au bord de la route, dans l’inachèvement. Savoir habiter le monde sur le mode de l’humour, c’est se savoir tendre sans cesse vers la chute et manifester la persévérance de l’esprit s’affrontant au pire. Le « loup des steppes », Harry Haller, au terme de sa confession et après son cheminement difficile, en vient précisément à l’apologie de la suprême sagesse, celle du rire humoristique et de sa stimulation profonde. La première prise de conscience déterminante de Harry, nous l’avons vu, a consisté à réaliser que chacun ne se définit que par son arrachement primordial et qu’il lui revient d’assumer son déracinement avec lucidité. Mais il comprend que cela ne saurait véritablement avoir lieu pour celui qui est dépourvu du sens de sa propre dérision. Pablo qui adoptera, plus tard, la figure de Mozart pour mieux le convaincre de la solidité de cet enseignement, lui déclare ainsi : « tout humour un peu élevé commence par cesser de prendre au sérieux sa propre personne2 ». Guidé par Hermine, « sorte de miroir3 » féminin de lui-même, Harry a suivi un chemin initiatique le conduisant peu à peu à consentir à lui-même et au monde. Hermine lui a appris, notamment, à briser la raideur de sa marche en lui enseignant des danses gaies et légères comme le fox-trot. Danse, musique, ivresse de la fête… Initiation au « jeux légers de la vie4 ». Sous l’impulsion d’Hermine, Harry est amené à comprendre que le goût de vivre dont il retrouve peu à peu la saveur ne peut acquérir sa densité sans la capacité d’associer la gravité à l’esprit de légèreté ou d’innocence. Mais il échoue à l’ultime étape, confondant le monde symbolique de fictions du théâtre magique avec la réalité : rattrapé par le froid et l’amertume, pensant voir là une invitation à réaliser le désir d’Hermine qui lui avait annoncé qu’il la tuerait, il lui plante un couteau dans le ventre lorsqu’il la voit allongée nue à côté de Pablo. Harry, réalisant qu’il a tué celle qu’il aimait, mesure l’horreur de son acte et réclame alors une punition. Que manifeste Harry à travers cet acte et sa demande de châtiment ? La mise 1
V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, op. cit., p. 160. H. Hesse, Le Loup des steppes, op. cit., « Le manuscrit de Harry Haller », p. 197. 3 Ibid., p. 109. 4 Ibid., p. 133. 2
224
SAGESSE TRAGIQUE
en scène avait valeur de test, au seuil duquel Harry a échoué, révélant là combien il reste prisonnier de ses tensions internes, de son pathétique, de son besoin de culpabilité et d’expiation. Au fond, il n’a su que manifester son incapacité à se déprendre de l’esprit de sérieux. Il est alors condamné à « apprendre à rire ». Pour cela, il aura pour guide Mozart, son artiste préféré. Outre l’accord avec les goûts personnels d’Harry, le choix de Mozart n’a rien de fortuit, dans la mesure où il incarne l’un des plus grands maîtres de l’alchimie de la profondeur et de la légèreté, creusant perpétuellement ses notes de ces tonalités irréductiblement contrastées du réel, sachant ainsi aspirer de la gravité la légèreté qui serpente dans ses filets. On retrouve là l’écho nietzschéen, qui, comme nous le verrons, n’a d’ailleurs pas manqué de saluer chez le musicien cette capacité à être léger par profondeur. Reconnaissance des alliances contradictoires là encore, du fait que nous ne sommes que ce contraste, à la source de notre distorsion, de notre déchirure intérieure tout autant que de notre capacité à retourner celle-ci en rire et en joie. Pour amener Harry à cette prise de conscience, Mozart va s’attacher à tordre à l’extrême cette distorsion. Pour cela, il lui fait écouter un concerto de Haendel via un appareil de T. S. F. Un rendu massacrant pour les oreilles d’Harry, qu’il qualifie de « mélange de viscose glutineuse et de caoutchouc mâché1 ». L’allusion à notre civilisation technique et à la désacralisation de l’art qu’elle peut opérer est bien sûr présente, mais le symbole va plus loin. Considérant la figure horrifiée du Loup des steppes, Mozart se met à rire, continuant à répandre dans l’air les notes de musique par le canal de l’appareil sacrilège. L’enjeu est d’amener Harry à savoir apprécier la beauté de cette musique par-delà les grésillements de l’appareil. Car l’esprit de cette musique n’est pas détruit, malgré ce qu’elle subit comme dommages. La T. S. F. ou la vie, c’est idem. « Toute la vie est ainsi, mon petit, et nous devons la laisser telle, et, si nous ne sommes pas des ânes bâtés, nous devons en rire2. » Savoir s’habituer à écouter la T. S. F. de la vie revient à apprendre à rire, « à concevoir l’humour de la vie3 ». Au bout du compte, Harry garde certes sa déchirure ; il la conservera jusqu’à la fin, comme l’écho intérieur sans doute de tout homme qui a sondé son angoisse. Mais, outre qu’il ne songe plus à s’ôter la vie, il perçoit désormais que s’il est une planche de salut pour l’existant, elle réside dans la capacité à assumer sa déchirure avec la distanciation offerte par l’appoint de l’humour : « j’étais prêt à recommencer une fois de plus la partie, à en goûter de nouveau les tortures, à frémir devant son absurdité, à retraverser encore et
1
Ibid., p. 241. Ibid., p. 243. 3 Ibid., p. 246. 2
225
SAGESSE TRAGIQUE
toujours l’enfer qui était en moi. Un jour, je saurais jouer la partie d’échecs. Un jour j’apprendrais à rire1. » Dans Fin de partie, Beckett établit également un parallèle entre l’existence et une partie d’échecs. Les premières paroles prononcées par Hamm le laissent entendre : À – (bâillements) – à moi. (Un temps.) De jouer2.
Partie d’échecs qui ne comporte aucun moyen de s’en sortir, comme Hamm, dans son épuisement, l’exprime très clairement : À moi. (Un temps.) De jouer. (Un temps. Avec lassitude.) Vieille fin de partie perdue, finir de perdre3.
La partie se joue en pure perte, mais reste la façon d’aborder l’échiquier du destin. L’humour ici est déterminant, circulant sans cesse dans les répliques, le tragique s’associant subtilement à la tragi-comédie. Comme Hamm, tous sont mal en point, rampants, coincés, paralysés, destinés de toute façon à choir d’une façon ou d’une autre. Mais aucun ne se fige dans la seule posture d’affliction. L’inspiration première est la souffrance, mais une souffrance habitée par un sens aigu de la dérision, comme en témoignent notamment ces propos de Vladimir : « Aucun doute, nous sommes servis sur un plateau4. » Ou encore, alors qu’il est ficelé par l’ennui : « Comme le temps passe quand on s’amuse5 ! » De même que la conscience lucide court le risque de se noyer à l’intérieur d’elle-même si elle se laisse fasciner par son propre tourment, toute œuvre court le risque de s’enrayer, de se figer. Mais il n’en est rien de l’écriture beckettienne qui, grâce à l’humour, parvient à court-circuiter tout risque de fixation. Même aux instants les plus tragiques, surtout peut-être à ces instants-là, elle garde, en effet, une liberté suffisante pour retourner sa noirceur intérieure en farce, nous offrant par là « le plaisir sans mélange d’un abaissement catastrophique6 ». On pense ici, par exemple, au couple Rooney et au rire sauvage qui les secoue lorsqu’ils évoquent le texte du prêche du lendemain. À l’énonciation que l’Éternel soutient tous ceux qui tombent, leur délabrement et leur épuisement opposent un tel contraste qu’ils en éclatent de rire. Ainsi trouvet-on en permanence la désacralisation, l’autodérision, jusqu’à l’autodestruction. L’humour brise l’étau, « l’absolu de la déréliction et du mal d’exister par la distance-transcendance qui les transforme en spectacle 1
Ibid., p. 249. FP, p. 16. 3 Ibid., p. 110. 4 EAG, p. 104. 5 Ibid., p. 107. 6 L. Janvier, Pour Samuel Beckett, op. cit., p. 334. 2
226
SAGESSE TRAGIQUE
contrasté1 ». La vitalité tragi-comique trouve ici son point d’orgue. Cet humour-là se donne comme un anti-pathos, révélant pleinement sa capacité à jouer de la mort et du pire. Le rire, en rendant momentanément maître de ses douleurs, permet à l’existant de se sauver « de la perdition où quelques-uns se plaisent » ou s’enlisent, et « des illusions où d’autres séjournent »2. « Quant à nous, qui avons l’honneur de survivre, ce n’est peut-être pas sans avoir grandi3. » À cet égard, la perception de la voie humoristique constitue un véritable stade existentiel, l’accès à une vision supérieure de l’existence. L’humour n’offre pas seulement un moyen d’expression, mais aussi un style de vie. Il va donc de pair avec une manière d’être, de vivre, de se risquer. Il révèle un choix d’existence. C’est pourquoi, avant d’être un art des mots, il est avant tout une attitude mentale, rejoignant la quête d’un art de vivre. Il ne veut nullement guérir ou réparer, il se sait et sait le monde incurable : autant en rire. Ainsi la bouffonnerie tragique de Beckett, exprimant que la cruauté et le malheur peuvent se muer en une profonde récréation de l’esprit qui a su traverser les arêtes douloureuses. L’auteur dote ses personnages de cette capacité de prise de recul, de mise à distance vis-à-vis d’eux-mêmes et de ce qui les ronge, permettant d’examiner le pire d’un œil amusé, avec une longue vue qui, en tant que telle, n’est pas sous l’emprise de son objet d’examen, mais peut la considérer avec la précision d’un œil aiguisé. C’est pourquoi l’humour n’est pas assimilable à une forme d’échappatoire, car il est un processus éminemment conscient. À cet égard, il offre une mise à distance qui n’est pas voile mais subtil éclairage, « coiffant ainsi la tragédie d’une autorité qui la maîtrise4 ». « L’humour, c’est la liberté5 », écrit Ionesco. Il ne nous fait aucunement oublier notre condition d’êtres voués à la mort, mais il parvient à nous projeter au-dessus d’elle. Il est « l’unique possibilité que nous ayons de nous détacher – mais seulement après l’avoir surmontée, assimilée, connue – de notre condition humaine comico-tragique, du malaise de l’existence. Prendre conscience de ce qui est atroce et en rire, c’est devenir maître de ce qui est atroce6. » L’humour dote les mots d’une épaisseur lumineuse, capable de ménager de subtiles ouvertures dans les chambres noires. Car l’humour, dans ses accents les plus profonds, flirte toujours avec le néant, se place à la lisière de celui-ci. Faculté de rire malgré tout, sur-tout : la gravité est toujours là, rôdant au cœur de « cette joie fragile, momentanée et inespérée qu’est 1
Ibid. Ibid. 3 Ibid., p. 335. 4 L. Janvier, Pour Samuel Beckett, op. cit., p. 265. 5 E. Ionesco, Notes et contre-notes, op. cit., p. 200. 6 Ibid., p. 201-202. 2
227
SAGESSE TRAGIQUE
l’humour1 ». L’humour, selon sa noire tonalité, exprime précisément cette conscience à la fois d’une forme de victoire de l’esprit sur la crudité du réel et de la nécessité de l’échec. Il faut y voir la lucidité du sujet qui, par là, opère un rétablissement élégant tout en assumant son sort impitoyable. Il ne s’agit pas alors d’échapper à l’insignifiance mais de l’amener, bien plutôt, à tourbillonner sur elle-même. Musique et valse des mots qui surplombent, dominent la déflagration promise. L’humour incarne cette aventure du corps et de l’esprit, tour à tour alliés et irréconciliés, s’orientant délibérément du côté de cette contrée où la souffrance n’est plus ennemie de la joie, ni la vie de la mort. Véritable attitude d’existence qui imprègne les comportements ; il ne rompt pas avec la lucidité, mais il en atténue ponctuellement les effets, la dote d’une certaine élégance. Instrument du tragique accompli, empreint d’une certaine sérénité sachant découper l’essentiel sur l’horizon du presque-rien : l’effort de présence au présent en pleine conscience de l’insignifiance de nos cheminements. L’humour ne tente pas de réinvestir un sens quelconque, dissolvant tout sens par ses éclats même. Tandis que l’ironie rentre sur un terrain interprétatif, l’humour, par son explosion et sa façon de tourner court, fait s’effondrer tout édifice sensé. Cela recoupe la distinction opérée par Rosset entre rire long qui s’inscrit dans une perspective explicative – ironie – démantèlement, et rire court qui se passe de toute interprétation de la destruction – humour – engloutissement. Là où l’ironie interprète, démantèle tel ou tel morceau d’un édifice, pour mieux le reconstruire selon ses vœux, l’humour se livre à la gratuité, engloutit tout indifféremment sur son passage. Il peut tout attaquer justement parce qu’il n’attaque rien de précis, n’ayant aucun sens à réinvestir. C’est ce qui rend possible l’humour noir, rire tragique par excellence. En ce qu’il ignore le sens, n’émerge pas de la contradiction (qui suppose un ordre ou un certain sens), il se réjouit de l’irruption du hasard. « Il n’est pas contre-signifiant, mais insignifiant2. » Chaos et hasard qui peuvent conduire à un renversement du schéma bergsonien qui, comme l’on sait, établit un lien entre comique et raideur, estimant que nous rions chaque fois qu’une personne nous donne l’impression d’une chose3. Si bien que l’on rit non d’un homme mais d’un « type4 », d’un caractère : traits fixés et exagérés qui font de l’humain un « machin ». D’où l’explication du principe du rire à laquelle aboutit Bergson : il est « du mécanique plaqué sur du vivant5 ». Mais si le rire émerge à la faveur d’une coïncidence de l’homme avec la marionnette, le 1
E. Blondel, Le Risible et le dérisoire, op. cit., p. 32. C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 177. 3 H. Bergson, Le Rire. Essai sur la signification du comique, PUF, « Quadrige », 1989, p. 44. 4 « Le personnage comique est un type. » (Ibid., p. 113). 5 Ibid., p. 29. 2
228
SAGESSE TRAGIQUE
pantin, n’est-ce pas que le pantin, le mécanique sont les termes premiers ? L’on peut estimer, alors, que l’instant comique ne naît pas tant du mécanique plaqué sur du vivant, que du vivant rendu à sa raideur, à sa dimension hasardeuse, au mécanique. « En sorte qu’au regard de la pensée tragique la formule du rire exterminateur est : du vivant plaqué sur du mécanique – ou du final surimposé au hasard – et, à la faveur d’une coïncidence rendue possible par le rire, se volatilisant à son contact1. » Cette reconnaissance de « la victoire du chaos sur l’apparence d’ordre », du « hasard comme “vérité” de “ce qui existe” »2, qu’orchestre le rire, signifie également une approbation, le rire ne pouvant être ce qu’il est sans plaisir, marque d’acquiescement. En cela, il témoigne toujours d’un sursaut supérieur de l’esprit s’affrontant au pire. Manière de jubiler de la réalité telle quelle, tout en allant au bout de l’insignifiance, du rien que l’on est. Va-et-vient perpétuel qui crée la danse du rire humoristique, qui fait tout valser dans un tourbillon lacrymal. Préparation même à l’ultime déflagration de la chair. L’humour est le plus propre et le plus prompt à manifester la récréation, la victoire de l’esprit et un plein accueil du réel. Dastur parle « de l’angoisse à la joie d’être mortel », dessinant un fil tendu entre ces deux dispositions. Nul lyrisme inconsidéré ici, mais la saisie de cette possibilité de bond allègre dans l’existence de la part de celui qui se révèle capable de s’ouvrir à sa gratuité, dont le rire témoigne au plus profond. La philosophe rappelle là ce point d’importance, consistant à réaliser que le rapport à établir à notre mortalité ne réside ni dans une fuite en avant consistant à ignorer l’angoisse d’être mortel, ni dans un quelconque endurcissement prétendant affronter celle-ci stoïquement, mais au contraire dans une ouverture lucide à celle-ci. C’est à partir de là seulement qu’au lieu d’apparaître comme la simple crispation de l’existant, elle peut se montrer comme cette invitation à vivre résolument en mortel. Surgissant du même sol meuble et instable, le rire et sa franche gaieté ne témoignent pas d’autre chose que de notre capacité de consentement à ce séjour mortel. C’est pourquoi l’enjeu du rire n’est pas de « rire de la mort », mais d’établir « dans et par le rire un juste rapport à ce qui épouvante dans la mort »3. Comme nous avons tenté de le mettre en évidence, le rire humoristique et la distanciation qu’il offre vis-à-vis de nos frêles postures sont l’expression même de cette capacité à affronter la réalité avec ce qu’elle peut comporter d’affreux et d’inquiétant. Le rire qui émerge de ces rivages n’est pas celui du rigolard compulsif, mais l’éclat de celui qui, se sachant suspendu à rien, saisit sa chance en une véritable joie d’exister. Car que dit le rire au plus profond, sinon que, aux confins de la mort, je puis encore me réjouir ? De quoi témoignent le rire et son embrasement 1
C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 179. Ibid. 3 F. Dastur, « De l’angoisse à la joie d’être mortel », op. cit., p. 47. 2
229
SAGESSE TRAGIQUE
sinon de notre capacité de réjouissance ? Si le rire « passe » par le corps, il nécessite, comme l’exprime Blondel, une représentation intellectuelle : « Joie du corps et dans le corps, le rire n’est proprement humain que si, à tort ou à raison, il a sa source ailleurs que dans le corps : sinon, il est insignifiant ou fatigant, ni plus ni moins qu’un geste machinal1. » En ce sens, le rire est réfléchi, il nécessite une représentation psychique. « Le rire est la pensée du corps, une pensée incarnée et extériorisée » ; il traduit une pensée, même si elle est indiscernable, mystérieuse, imperceptible. « On a l’impression que le corps, mécanique sans réflexion, rit tout seul, sans pensée ni émotion : en fait, il rit en songeant ou en s’émouvant à son insu2. » Le rire passe par la tête : il faut que j’aie déclaré risible ce qui peut passer pour neutre. Le rire intérieur témoigne sans doute le plus sûrement de cette dimension réfléchie du rire. Le rire est l’indice d’une joie pure, sans mélange, quels que soient son objet, sa visée, son point déclencheur ou ses effets corporels. Même en succédant aux larmes, il n’a pas d’arrière-pensée. « Et on a raison de rire du risible, même si l’on n’a pas toujours toutes les raisons de rire3. » Voire fondamentalement aucune, pourrions-nous ajouter. Le rire, et c’est là sa force, s’isole, sans l’oublier, de ce qui le fait émerger et qui pourrait l’arrêter : morale, sérieux, douleur, souffrance, tristesse, mort. En cela, le rire est la preuve que, au creux du dérisoire, toute joie n’est pas éteinte, qu’au contraire elle est en mesure de s’ébattre sur le délabrement et la pourriture. « Le plaisir du rire est la joie d’un corps mortel, qui saisit sa joie de vivre en narguant la mort4. » Approbation du rire qui est alors l’indice d’une approbation plus large, à savoir de l’approbation elle-même du tragique et de la possibilité d’une telle approbation. C’est ce qui conduit Rosset à conclure dans sa Logique du pire : « L’approbation elle-même n’est pas rire de la mort, mais fête devant la mort. La philosophie tragique ne commença pas lorsque les hommes eurent appris à rire de leurs cadavres, mais plutôt le jour mystérieux, tardivement reconnu par Nietzsche dans L’origine de la tragédie, où les Grecs confondirent en une seule fête le culte des morts, dont était née la tragédie, et le culte du dieu symbolisant le vin et l’ivresse : les Grandes Dionysies, qui le même jour célébraient tout à la fois les jeux de la vie, de la mort et du hasard5. » Ouverture sur un univers de joie où éclatent les limites de la condition humaine. D’aventures en aventures, sur le tragique balancier de nos existences, la joie n’a pas tout à fait dit son dernier mot. 1
E. Blondel, Le Risible et le dérisoire, op. cit., p. 19. Ibid. 3 Ibid., p. 25. 4 Ibid., p. 111. 5 C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 179-180. 2
230
SAGESSE TRAGIQUE
Que la joie persiste « .......... Éphémères ! / Qu’est l’homme ? Que n’est pas l’homme ? L’homme est le rêve / D’une ombre... Mais quelquefois, comme / Un rayon descendu d’en haut, la lueur brève / D’une joie embellit sa vie, et il connaît / Quelque douceur... » Pindare, Hymne Pythique, VIIIe Pythique.
« Il n’est aucun bien du monde qu’un examen lucide ne fasse apparaître en définitive comme dérisoire et indigne d’attention, ne serait-ce qu’en considération de sa constitution fragile, je veux dire de sa position à la fois éphémère et minuscule dans l’infinité du temps et de l’espace. L’étrange est que cependant la joie demeure, quoique suspendue à rien et privée de toute assise1. » Le rire, dans ses accents profonds et humoristiques, nous a mis sur la trace d’une capacité de réjouissance en mesure de résister à tout ce qui peut la mettre en échec. Ainsi, une joie aérienne, une pure joie de vivre, est-elle susceptible de jaillir face au hasard, c’est-à-dire un réel dépouillé de ses ornements, de ses arrière-mondes fantasmatiques. Celle-ci nous surprend d’autant plus lorsque, tout le dérisoire de l’existence éprouvé et reconnu, elle vient nous saisir au détour d’une envolée musicale, d’une marche paisible... En soi s’associent alors de manière splendide une allégresse et un calme profonds. William Styron raconte que l’écoute fortuite d’un passage de la Rhapsodie pour contralto de Brahms, jouée dans un film le soir même où il avait décidé de se tuer, lui « transperça le cœur comme une dague2 », réveilla des souvenirs joyeux et une forme d’allégresse, l’empêchant de mettre son projet suicidaire à exécution. Contre les orages qui entament l’homme, susceptibles de déchirer sa vie, semble alors s’établir, selon les mots de Curzio Malaparte, un « suprême équilibre du sang3 ». Comment qualifier cette joie énigmatique qui parvient à demeurer au sein de la lucidité ? Rosset, subtil connaisseur de cette allégresse aussi précieuse que fragile, répond très clairement : « La joie dont il est ici question ne se distingue en aucune façon de la joie de vivre, du simple plaisir d’exister4 ». Néanmoins, il importe de distinguer deux types de joies. Celle qui émane de l’illusion que le tragique de notre existence peut être éliminé. Celle-ci relève du registre de l’espoir, par définition hors de luimême. L’espoir est une projection dans le futur et, à ce titre, mû par « l’attrait d’une vie autre et améliorée que nul ne vivra jamais5 », il exprime son refus de l’ici et maintenant, son incapacité à admettre la réalité.
1
C. Rosset, La Force majeure, op. cit., p. 8. W. Styron, Face aux ténèbres, op. cit., p. 100. 3 C. Malaparte, Sang, GF – Flammarion, 1992, p. 38. 4 C. Rosset, La Force majeure, op. cit., p. 18. 5 Ibid., p. 28. 2
231
SAGESSE TRAGIQUE
Sur la rive opposée de cette joie qui croit pouvoir s’échapper de l’emprise du réel, on trouve celle qui le reconnaît et l’accepte dans toute sa dimension tragique. Celle-ci est évidemment paradoxale, puisqu’elle relie la réjouissance et la considération de la cruauté de l’existence, mais elle n’est pas illusoire. La joie n’est telle que si elle va de pair avec le sentiment du tragique. En cela dépasse-t-elle tout autant le pessimisme que l’optimisme. Elle est la joie véritable, c’est-à-dire un dire oui au monde comme il est, témoignant d’une forme d’approbation de l’existence contre toute attente. Quelles sont, en effet, ses caractéristiques ? Le mécanisme de la joie déborde « l’objet particulier qui l’a suscitée pour affecter immédiatement tout objet et aboutir à une affirmation du caractère jubilatoire de l’existence en général1 ». La joie est par définition envahissement. Aussi ne laisse-t-elle rien de côté dans le moment de son embrasement. Elle obéit, à cet égard, au même mécanisme que celui de la Nausée. Celle-ci a beau être suscitée par un élément précis du réel – ainsi la racine du marronnier sur laquelle se focalise l’attention de Roquentin –, il fait office aussitôt d’élément déclencheur, « sa masse noire et noueuse » imbibant alors l’ensemble des objets existants. Il en va de même pour la joie. Si celle-ci est causée par un objet particulier, elle parvient à le déborder pour exprimer la joie de vivre en général. Rosset prend l’exemple du plaisir sexuel qualifié, comme la joie, de « sorte de bien-être cosmique2 » qui sait transporter, autrement dit opérer un déplacement. Ce transport consiste précisément en un passage du singulier au général. Seconde caractéristique notable de la joie : celle-ci est paradoxale et irrationnelle car elle approuve l’existence en dépit de sa finitude, finitude qui se voit, néanmoins, justifiée à provoquer la joie : « La saveur de l’existence est celle du temps qui passe et change, du non-fixe, du jamais certain ni achevé ; c’est d’ailleurs en cette mouvance que consiste la meilleure et plus sûre “permanence” de la vie3. » L’auteur s’intéresse à l’automne, mettant en évidence le fait que son charme tient moins à ses caractéristiques qu’à sa situation intermédiaire entre l’été et l’hiver, donc à son impermanence, à sa finitude même. Ainsi, l’« être » de l’automne ne réside-t-il pas en lui-même, mais dans le fait qu’il modifie l’été pour se trouver modifié, à son tour, lors de la venue de l’hiver. C’est donc parce qu’il n’y a pas d’automne « en soi » que celui-ci existe et parvient à nous enchanter. Si le réel, l’existence sont cruels en raison de leur finitude renvoyant tout à l’éphémère et au dérisoire, cette même finitude est susceptible de dégager un certain charme des choses. Jankélévitch s’est attardé, lui aussi, sur ce mouvement des saisons, portant son attention en particulier sur le printemps et sa capacité à rester une surprise fondamentale. Le printemps finit et le froid de l’hiver revient lui 1
Ibid., p. 7. Ibid., p. 14. 3 Ibid., p. 20. 2
232
SAGESSE TRAGIQUE
aussi, mais au sortir de l’hiver, le printemps resurgit, provoquant un émerveillement renouvelé. Retour et surprise qui lui font acquérir sa valeur tout autant de sa capacité de retour que du fait qu’il va passer. Dans le Traité des vertus, le philosophe parle du « mystère printanier », exprimant là cette faculté à susciter en nous un tel émerveillement décollant de la seule mécanique répétitive. Au fond de ce mystère, le philosophe discerne « le mystère du recommencement continué ou du recommencement qui est commencement original, le paradoxe de l’ancienneté nouvelle, la sainte absurdité de la répétition toujours première1 ». Le revenir du printemps ne s’écarte pas du devenir. Il s’inscrit dans l’irréversibilité même du temps. Aussi revient-il mais sans être jamais tout à fait le même. Le retour du printemps, s’inscrivant dans la répétition des saisons, sait nous inspirer « une joyeuse surprise2 ». On pouvait s’y attendre pourtant ! Mais ce retour ne manque pas de nous surprendre : « c’est une surprise dans l’identique », le même et l’autre, révélant la coloration de « cette répétition dans l’altérité ». Répétition qui, par conséquent, n’en est pas vraiment une. Ainsi, tous les ans, nous fêtons tel ou tel anniversaire. Nous reprenons des gestes, des postures, des mises en scène : « toujours les mêmes et toujours autres, tout en étant les mêmes3 ». Moments que l’on revit « comme si » c’était la première fois et la dernière fois. C’est à chaque fois « la première-dernière fois » que Jankélévitch appelle « primultime ». Répétition d’ordre différentiel, source de jubilation, qui creuse là encore la différence d’avec, selon l’expression de Rosset, la répétition-rengaine dont se recommande le pessimisme de Schopenhauer. Répétition différentielle : en même temps que tout revient, tout est différent. Répétition rengaine : nous avons constamment le même spectacle sous les yeux. Nous pouvons, certes, percevoir une configuration nouvelle, mais celle-ci n’est qu’un leurre. Schopenhauer utilise, à propos de l’apparente nouveauté censée émerger dans l’histoire, l’image du kaléidoscope « qui, à chaque tour, montre une configuration nouvelle, alors qu’en réalité nous avons toujours la même chose devant les yeux4 ». « En tout temps la plante verdit et fleurit, l’insecte bourdonne, l’animal et l’homme subsistent dans leur indestructible jeunesse […]. Les peuples, eux aussi sont là comme des individualités immortelles […] quoique l’histoire prétende toujours raconter quelque chose de neuf5 ». Derrière l’apparente nouveauté des choses travaille l’identique : les cerises sont les mêmes, les peuples, même s’ils changent de nom, adoptent toujours
1
V. Jankélévitch, Traité des vertus, Bordas, « Bibliothèque générale de philosophie », 1949, p. 786. 2 V. Jankélévitch, Entretien avec Ruth Sheps, in G. Suarès, Vladimir Jankélévitch, La Manufacture, « Qui suis-je ? », 1986, p. 88. 3 Ibid. 4 A. Schopenhauer, Métaphysique de la mort, in op. cit., p. 119. 5 Ibid.
233
SAGESSE TRAGIQUE
les mêmes conduites et traversent les mêmes souffrances. Pas de changement, pas d’histoire. Schopenhauer ne sort jamais de la roue d’Ixion : répétition identique et vaine des mêmes illusions et des mêmes souffrances. Ce n’est donc pas ce chat ou cette fleur-ci qui intéressent le philosophe, seulement le fait qu’ils sont restés les mêmes. Rien de jubilatoire ne peut s’immiscer selon ce schéma de l’identique. À l’inverse, si c’est le même en tant qu’il est différent qui est considéré, la joie trouve un large champ d’expression. Attention et capacité d’appréciation de l’émergence du nouveau, de l’incongru. Le printemps revient certes, mais peut-être est-ce la dernière fois que je le vois et, dans tous les cas, il n’est jamais vraiment le même. Cette éclosion de la nature que j’apprécie en ce moment va bientôt s’éteindre pour laisser la place à l’été. Sa finitude même fait que je puis l’apprécier dans ses nuances et lui trouver un charme renouvelé et, si je puis m’attendre à son retour, je n’en serai pas moins surpris et émerveillé. C’est dire que la joie est le signe d’un plein contact avec le réel dans sa mouvance, sa profonde singularité, à travers ce qui le ronge et le dynamise provisoirement. Sentiment aussi soudain qu’indéfendable (puisqu’il n’y franchement pas de quoi se réjouir, aucun pan de la réalité, en raison de sa ténuité, n’étant digne de fixer l’intérêt), mais inentamé par la réfutation dont il reconnaît, par ailleurs, les arguments sans pour cela s’en trouver défait. Reprenons ces mots formulés dans La Force majeure, caractérisant la joie : « une réjouissance inconditionnelle de et à propos de l’existence ; or il n’est rien de moins réjouissant que l’existence, à considérer celle-ci en toute froideur et lucidité d’esprit1 ». Le propre et le privilège de la joie s’exposent dans ce paradoxal entrelacs, « que de s’éprouver comme parfaitement absurde et indéfendable : de demeurer allègre en pleine connaissance de cause, en complète possession des vérités qui la contrarient davantage2 ». En quoi la joie désigne cette expérience qui répond du réel sans aucune justification. Disposition d’esprit que Rosset traduit pleinement en ces termes : « Tout reste pensé, mais en même temps tout cesse de peser3. » C’est pourquoi le philosophe désigne fréquemment la joie par le terme d’allégresse, qui a cette qualité d’exprimer cette disposition du corps et de l’esprit exempte de toute pesanteur. L’on peut parler d’amour sans doute, mais l’amour reste le fruit d’une cause extérieure, tandis que la joie est en quelque sorte sans cause. Plus exactement, elle a des causes tellement multiples et entremêlées qu’il serait vain de tenter de les énumérer. La joie, au fond, désigne cette « pensée sans arrière-pensée4 » qui jouit de l’absence de tout manque. Jouissance d’exister, 1
C. Rosset, La Force majeure, op. cit., p. 22. Ibid., p. 101. 3 C. Rosset, Le Réel, op. cit., p. 77. 4 C. Rosset, L’Objet singulier, op. cit., p. 98. 2
234
SAGESSE TRAGIQUE
joie de vivre indépendante, au fond, des contrariétés ou des joies de la vie : « ce qu’il y a de particulier dans l’expérience de la joie de vivre est que celle-ci se présente toujours seule1 ». Le philosophe en trouve l’expression flagrante dans la figure de Figaro mis en scène dans Le barbier de Séville de Rossini. Figaro énonce, en effet, les tracas traversant son existence : le fait qu’on ne le laisse jamais en paix, qu’on l’accable de multiples corvées… Et, pourtant, Figaro se proclame le plus heureux des hommes, s’éprouvant porteur de cette « pure joie de vivre, indépendante des tracas ou des bonheurs que peut lui réserver sa propre expérience de la vie2 ». La joie incarne cette grâce qui, pour avoir lieu, ne requiert donc ni mobile, ni preuve, pour celui qui l’éprouve. C’est en quoi l’on peut parler avec Rosset d’une sorte de « crime parfait ». « Crime parfait que de naître, crime parfait que de vivre, crime encore plus parfait que de trouver son bonheur dans ce crime préliminaire d’être vivant3 ». La joie est pleinement ici et maintenant, dans une entière donation de l’immédiat. Sentiment jubilatoire d’exister qui ne doit son jaillissement à rien d’autre qu’à luimême et est, pour cela, à même de résister à tous les vents contraires. Ce en quoi « la joie est insondable, et il n’y a pas de peine qui puisse finir par l’effacer4 ». Tel est le paradoxe de la joie. Expérience de la vie au bord de l’abîme, de la vie qui porte la mort : preuve non seulement que toute joie n’est pas morte en soi, mais aussi et surtout qu’elle est, en son essence même, étrangère à tout motif raisonnable de réjouissance. Plus loin que cela encore : point de joie qui ne soit pleine et entière sans la connaissance de la tristesse. Distorsion et approbation ont partie liée. L’on peut se référer, là encore, à la pensée nietzschéenne estimant que la jubilation n’acquiert sa portée et sa profondeur que par la connaissance du tragique. Ressort précisément son intégrité du fait qu’elle n’ignore rien du caractère douloureux de la réalité. Alliance scellée entre la lucidité et la joie que Rosset qualifie alors, à juste titre, de « force majeure » : « la joie est la condition nécessaire, sinon de la vie en général, du moins de la vie menée en conscience et connaissance de cause. Car elle consiste en une folie qui permet paradoxalement – et est seule à le permettre – d’éviter toutes les autres folies, de préserver de l’existence névrotique et du mensonge permanent5. » Elle offre, ainsi, la réponse à la question centrale que nous pose le tragique : savoir s’il est « possible d’aimer la vie en conscience, c’est-à-dire sans être obligé tous les jours d’un peu se mentir à soi-même6 ». La joie énonce cette possibilité, car 1
C. Rosset, Le Choix des mots, op. cit., p. 99. Ibid., p. 88. 3 Ibid., p. 99. 4 Ibid., p. 106. 5 C. Rosset, La Force majeure, op. cit., p. 26. 6 C. Rosset, Le Choix des mots, op. cit., p. 16. 2
235
SAGESSE TRAGIQUE
que dit-elle sinon qu’éprouver la joie d’être au monde n’implique pas, loin s’en faut, que tout dans le monde soit réjouissant ? L’allégresse désigne cette expérience qui répond du réel sans aucune justification, trouvant là sa singularité propre – « singularité qui en fait peutêtre le moteur de la vie le plus sûr parce que le plus secret – que d’allier le goût de l’existence à une claire perception de son caractère objectivement indésirable1 ». Là est bien sa « force majeure ». Si bien que l’homme joyeux ne peut aucunement préciser le motif de sa réjouissance. La joie est autosuffisante ; elle est « un plein qui se suffit à lui-même et n’a besoin pour être d’aucun apport extérieur2 ». Elle se situe au cœur même du paradoxe : rien de plus affligeant que l’existence et pourtant je puis encore me réjouir. La joie témoigne d’une forme d’approbation suprême de la vie contre toute attente, d’alliance scellée au pire. Preuve flagrante que la vie se passe de justification. La Logique du pire est, ainsi, à même d’offrir un aboutissement jubilatoire. Affirmer et penser le pire jusqu’au bout aboutit à privilégier la joie malgré la texture hasardeuse du réel : « La pensée tragique, qui affirme hasard et non-être, est donc aussi pensée de fête. Ce qui se passe, ce qui existe, est doté de tous les caractères de la fête : irruptions inattendues, exceptionnelles, ne survenant qu’une fois et qu’on ne peut saisir qu’une fois ; occasions qui n’existent qu’en un temps, qu’en un lieu, que pour une personne, et dont la saveur unique, non repérable et non répétable, dote chaque instant de la vie des caractères de la fête, du jeu et de la jubilation3. » L’empreinte de la joie retrouve la survenue de l’occasion. C’est dire qu’il ne reste qu’à jubiler, célébrer ce qui se donne comme tel en reconnaissant que l’être n’est qu’apparence, qu’il n’y a rien de plus profond. S’expose le « lien étroit entre la fête et la représentation tragique du non-être4 », par conséquent, retrouvant la mouvance des apparences singulières, leur ensoleillement à la faveur des irruptions hasardeuses et inattendues, loin d’une morne répétition, au plus près, au contraire, d’une récréation festive. Ainsi, la reconnaissance de la nature entropique de notre condition n’affecte-t-elle pas immanquablement l’existence de morosité, car la joie équilibre, sans l’occulter, le dés-espoir. Enseignement essentiel prodigué par l’allégresse qui amène Rosset à prononcer les mots suivants : « Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la conception tragique de la vie peut nourrir le pessimisme mais peut aussi attiser la joie de vivre, en ce que celleci peut entendre les raisons de condamner la vie, de maudire toutes les
1
C. Rosset, L’Objet singulier, op. cit., p. 98. C. Rosset, La Force majeure, op. cit., p. 18. 3 C. Rosset, Logique du pire, op. cit., p. 113. 4 Ibid., p. 114. 2
236
SAGESSE TRAGIQUE
tristesses et les misères qui lui sont attachées, et cependant résister à toutes les raisons qui lui sont contraires. C’est une expérience ultime de la joie1. » Pourquoi la joie apporte-t-elle un tel sentiment de plénitude ? Précisément parce qu’elle surgit toujours sous les augures de l’imprévu, de la surprise. Comme l’analyse Jankélévitch, là où le bonheur planifie, rêve d’organisation, la joie s’épanouit dans la non-organisation, le désordre. Ainsi peut-on réunir toutes les conditions du bonheur – santé, fortune, honneurs, aventures amoureuses –, sans que pourtant sur tout ce bonheur ne se dépose l’allégresse. Tout est prêt pour recevoir le bonheur et pourtant, « il ne nous manque plus rien que d’être heureux effectivement2 ». La joie, « indocile et fantasque3 », ne vient et ne revient pas sur commande : l’on a beau s’efforcer de restaurer toutes les conditions (décor, circonstances, postures du corps et de l’esprit) pour revivre une joie disparue, celle-ci ne reviendra pas au gré de notre désir. « Elle préférera nous surprendre quand nous n’y compterons plus, si telle est son humeur, et les caprices de la mémoire affective, qui est une réversibilité gracieuse, prouvent à quel point la joie des hommes reste indépendante des systèmes qu’ils fabriquent pour la faire naître4. » Dans cette brève rencontre ne se niche donc pas un bonheur qui voudrait remplir sa visée d’installation. La joie ne s’organise pas, on l’éloigne en y pensant. Elle est bien cette espèce de grâce fantasque dont nous parle Jankélévitch. « La joie de vivre est le fait de la paix, qui est, non pas statique, mais dynamique5 ». Saisi par les sentiers lumineux de la Grèce, Henry Miller prononce ces mots, témoins d’une joie sans entraves, s’élevant dynamiquement dans le cœur de l’homme. Contrairement au mirage du bonheur, rêvant d’une stabilité capable de réaliser toutes ses aspirations, la joie évoque une expérience de la vie, fragile et temporaire, puisque ne nous installant jamais dans un état stable. La joie ne s’éternise pas et c’est en cela qu’elle ne rejoint pas le lot des mensonges auxquels l’homme s’accroche en fermant les yeux. La joie profonde suppose un dessillement du regard, la lucidité, l’éveil de l’esprit. Pas de joie possible pour qui reste attaché à ses illusions. La joie ne réinjecte pas l’éternité dans le temps. Au contraire, sa force est qu’elle émerge du temps non comme une sortie offrant un atome d’éternité, mais comme une célébration de l’instant supposant une prise en charge globale du réel. Parce qu’elle ne met pas à l’abri des orages de l’existence, la joie est mouvementée.
1
C. Rosset « L’avenir qu’on nous prépare », Entretien avec Jean Blain, Lire, n°281, déc. 1999 – janv. 2000, p. 38. 2 V. Jankélévitch, La Mauvaise Conscience, Alcan, 1933, p. 157. 3 Ibid. 4 Ibid., p. 157-158. 5 H. Miller, Le Colosse de Maroussi, Le Livre de Poche, « Biblio », 1999, p. 102.
237
SAGESSE TRAGIQUE
En cela, la joie est celle d’une victoire, elle est l’exaltation d’un esprit qui se sent à chaque fois renaître. La joie dit aussi que l’œil aimant permet de voir au-delà de ce que voit l’œil intelligent. C’est sans doute ce qui conduit Nietzsche à écrire : « Celui qui a beaucoup de joie doit être un homme bon : mais peut-être n’est-il pas le plus intelligent, bien qu’il atteigne ce à quoi le plus intelligent aspire de toute son intelligence1. » L’on peut rejoindre également ici Spinoza, en penseur appliqué de la joie. Celle-ci, ainsi que l’expose L’Éthique, est changement de l’esprit, passant à cette occasion à une perfection plus grande2. La lucidité s’accompagne d’un sens aigu de nos pénombres et de l’affliction qui en découle, mais la joie déclare qu’elle sait être plus profonde que cette douleur, ainsi que l’énonce « La seconde chanson à danser » de Zarathoustra : « L’univers est profond, profond, […] Plus que le Jour ne l’imagine. […] Profonde, certes, est sa douleur – […] Mais plus profonde encor sa joie3. » Ce en quoi elle est en mesure d’entrer dans la sphère du oui, de l’approbation. Joie d’être là, au monde tout simplement, trouvant son élan même dans un entier contentement de l’étreinte du temps présent. « Le jouisseur d’existence – l’homme heureux – se reconnaît précisément à ceci qu’il ne demande jamais autre chose que ce qui existe pour lui ici et maintenant4 ». Joie comme satisfaction momentanée, provisoire de notre être-là, aussi énigmatique que le réel lui-même. Ce que Nietzsche appelle « la grande santé » émane de ces parages où la souffrance n’est plus ennemie de la joie. La maladie a su procurer au philosophe un désir profond de santé, une volonté de vivre raffermie, parce qu’elle a surmonté, traversé les épreuves. Aussi le philosophe écrit-il dans le Gai Savoir : « on revient de pareils abîmes […] né à nouveau […], avec un goût plus affiné de la joie, avec un palais plus délicat pour toutes bonnes choses, avec des sens plus joyeux5 ». La maladie peut ainsi offrir une stimulation précieuse de la vie, rappelant que la santé n’est qu’une conquête perpétuelle. Elle révèle la capacité à surmonter les creux, à ruser avec les douleurs, ainsi que la qualité de son attachement à l’existence. Dans Ecce homo, Nietzsche exprime cela très clairement, lorsqu’il parle de cette capacité de la maladie à « être un stimulant énergique de la vie, du surplus de vie. C’est ainsi que m’apparaît maintenant en fait cette longue période de maladie : j’ai découvert pour ainsi dire de nouveau la vie, moi-même inclus, je dégustai toutes les bonnes choses et même les petites, comme d’autres n’y
1
F. Nietzsche, « Le voyageur et son ombre ». Cité par C. Rosset, La Force majeure, op. cit., p. 35. 2 B. Spinoza, L’Éthique, Gallimard, « Folio essais », 1994, proposition XI, scolie, p. 192. 3 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. G. Bianquis, in Œuvres, op. cit., p. 525. 4 C. Rosset, Principes de sagesse et de folie, op. cit., p. 47. 5 F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., Préface à la deuxième édition, § 4, p. 26.
238
SAGESSE TRAGIQUE
parviendraient pas aisément, – je fis de ma volonté de santé, de vivre, ma philosophie1… » Outre un souci de bonne santé, pour laquelle Nietzsche avait mis en place des règles très précises – alimentation légère et variée, climat sec et ensoleillé, entourage non hostile…2 –, c’est la grande santé qui est visée. Garder sa santé intacte est un enjeu important, gage de bonne digestion tout autant physique qu’intellectuelle, pour savoir oublier, tourner la page et ne pas témoigner contre la vie. Parvenir à la grande santé représente un échelon supplémentaire. Il s’agit « d’une nouvelle santé, plus vigoureuse, plus maligne, plus tenace, plus téméraire, plus joyeuse3 ». De même que le grand style émerge du triomphe du beau sur le monstrueux4, que le rire inclut les larmes, la grande santé sait traverser les tourments, les chutes et les déséquilibres. Celle-ci parle de vigueur de l’esprit, de réjouissance, et trouve au cœur de sa stimulation les gammes musicales. Rappelons que la musique est à ce point précieuse aux yeux du philosophe qu’il va jusqu’à estimer que : « Sans musique la vie serait une erreur5. » Nietzsche, en effet, recommande l’écoute stimulante de la musique de Bizet, de Rossini, de Chopin6 ou encore de Mozart. Le philosophe ne manque pas de saluer chez ce dernier « son “bon ton”, sa passion délicate, son plaisir d’enfant aux chinoiseries et aux fioritures, sa politesse qui part du cœur, son goût de la grâce, de la tendresse et de la danse, sa sensibilité proche des larmes7 ». Comme ces termes élogieux le laissent entendre, Mozart a exercé un charme certain sur Nietzsche, dans la mesure où, comme nous l’évoquions précédemment, il incarnait le musicien profondément habité du néant de la vie et qui n’en exprimait pas moins l’enchantement de vivre. Nietzsche célèbre « l’esprit de gaieté ensoleillé, de tendre légèreté de ce Mozart dont la gravité respire la douceur8 ». Légèreté de la profondeur toujours. À l’approbation de la vie dont sait témoigner une telle musique vient se joindre la fête. L’enchantement propre à la fête signifie un dépassement des angoisses par son enchantement inattendu. Ainsi les tristesses nous sont-elles remises sans que cela implique un quelconque oubli. La fête n’oublie rien et c’est en cela qu’elle est fortifiante. Elle est pleinement elle-même devant le tragique le plus manifeste, la détresse la plus pressante. C’est là que 1
F. Nietzsche, Ecce homo, op. cit., « Pourquoi je suis si sage », § 2, p. 58. Ibid., « Pourquoi je suis si avisé », § 1, 2. 3 F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., livre cinquième, § 382, p. 291. 4 F. Nietzsche, « Le voyageur et son ombre », Humain, trop humain, II, op. cit., § 96, p. 225. 5 F. Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, op. cit., « Maximes et pointes », § 33, p. 77. 6 De Chopin, il salue l’élégance, la grâce et la liberté d’esprit de celui qui sait danser dans les chaînes. F. Nietzsche, « Le voyageur et son ombre », Humain, trop humain, II, op. cit., § 159, p. 245-246. Voir aussi Ecce homo, op. cit., « Pourquoi je suis si avisé », § 7, p. 84. 7 F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, op. cit., § 245, p. 190. 8 F. Nietzsche, « Le voyageur et son ombre », Humain, trop humain, II, op. cit., § 165, p. 247. 2
239
SAGESSE TRAGIQUE
Nietzsche voyait précisément le privilège de l’ivresse dionysiaque qu’il assimilait à l’ivresse musicale. La fête, au fond, ne célèbre pas autre chose qu’une coïncidence provisoire de l’homme avec lui-même, avec son caractère désancré. Ce en quoi une longue fête peut se célébrer au milieu du désert1. Instants précieux précisément parce qu’ils ne libèrent pas l’homme de ses peines, mais de toute forme d’appui. Toutes les raisons possibles de défendre la vie viennent à manquer aussi subitement que massivement. Et c’est dans ce suspens, dans ce manque à penser toutes raisons d’exister que s’éprouve la joie de la fête, qui n’est autre que la joie même d’exister. La joie est puissante parce qu’insensée, privée d’attaches. À l’instar de la musique, la fête incarne ces moments d’intense jubilation au sein d’une vie irrémédiablement tragique, mais qui, approuvée à l’occasion de ces moments de miraculeuse légèreté, peut trouver toute sa stimulation. « Il vaut la peine de vivre sur cette Terre ; une seule journée avec Zarathoustra, une seule fête avec Zarathoustra m’ont enseigné l’amour de la Terre2 ! » Éclats, envolées, pirouettes humorales : gammes d’une vision tragique capable de faire émerger une authentique « musique » de l’existence avant qu’elle ne soit définitivement rongée par sa cacophonie létale. Ultime accommodement au pire. Se laisser entamer par le rire. Le laisser courir, œuvrer en nous jusqu’aux éclats, jusqu’aux larmes. Se laisser gagner par la joie et sa grâce inattendue. Rire humoristique, joie : déclinaisons d’une attitude consciente de l’engloutissement promis, mais ouverte à la donation de l’instant. Accueil des apparences qui ne connaissent rien de plus profond. Ici, sans doute, résident la « force majeure », la vitalité suprême – contre toute attente.
1
Nietzsche voyait comme condition de telles « fêtes rares » au milieu du désert la rencontre avec l’œuvre d’un auteur capable de réunir les qualités suivantes : « Concision nerveuse, calme et maturité ». (F. Nietzsche, « Le voyageur et son ombre », Humain, trop humain, II, op. cit., § 108, p. 228). 2 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. M. de Gandillac, op. cit., « Le Chant du marcheur de nuit », p. 382.
240
CONCLUSION « Il n’arrive jamais de grands événements intérieurs à ceux qui n’ont rien fait pour les appeler à eux ; et cependant le moindre accident de la vie porte en lui la semence d’un grand événement intérieur. » Maurice Maeterlink, La Sagesse et la destinée.
Penser le néant. La naissance coïncide avec les avenues de la mort : ouverture d’une plaie dont le sang ne cesse de se répandre sur nos talons. Les hommes sont prompts à se nourrir de leurres, avides qu’ils sont de baumes calmants destinés à occulter la dimension incurable de cette hémorragie. Dans l’univers réglé des hommes, la norme est clairement l’oubli de soi. D’où l’on voit émerger ces petits arrangements consistant à ignorer que la mort est la véritable épouse de chacun, présente en nous dès le départ et à tout instant. La voici, comme l’exprime Jean Cocteau, appréhendée du dehors, transformée en « fable » ou en « figure allégorique n’apparaissant qu’au dernier acte1 ». Éclot sur cette ligne de fuite la figure du mieux, située après, ailleurs, audessus, là-bas, au-delà, plus tard ou encore jadis. Ce mieux n’est qu’une persuasion réitérée par de multiples sentinelles des contrées ensoleillées et transcendantes ou des lendemains qui chantent. Ces hommes-là « survivent », davantage qu’ils ne vivent, en ne prêtant finalement au monde qu’une attention distraite, simple relais des promesses dont ils veulent se convaincre et des sortilèges qu’ils inventent pour se tenir à distance d’euxmêmes. Dès lors ne sont-ils profondément dérangés que par l’exercice de la lucidité, par la pensée qui se tient au bord du réel le plus abrupt et menace de les arracher à leurs illusions. De même qu’il est plus ardu de flirter avec le rien que de parler des Idées, de l’Esprit, de l’Être ou de Dieu, il n’est jamais aisé de se confronter au monde pour lui infliger la blessure d’un regard clairvoyant. La pensée tragique s’inscrit dans cette quête de la lucidité. En quoi elle peut apparaître comme une impitoyable machine de guerre, à la fois contre l’illusion d’être dépositaire d’une vie pour laquelle la mort ne devrait représenter qu’un pendentif terminal qui nous concerne peu, de posséder des vérités transcendantes que l’esprit, parent de l’éternel, serait en mesure de délivrer, et contre l’optimisme imbécile. La mort réduite à une simple limite externe n’est qu’un terme aplati pour étouffer le sentiment du mourir. L’esprit qui prétend décoller de son ancrage sensible pour nous entretenir de quelque entité inentamable ne fait que traduire sa tentative d’échappée vers des régions lointaines et prometteuses, déprises de la texture rugueuse et instable 1
J. Cocteau, La Difficulté d’être, Le Livre de Poche, « Biblio », 2001, p. 95.
241
CONCLUSION
de la réalité. L’optimisme, ce délire de l’esprit humain prêt à tout pour ignorer sa part d’ombre. À l’encontre de toute doublure destinée à fuir le réel ou à le compléter d’un sens, il s’agit de se situer loin de toute pensée consolante pour reconnaître le tragique constitutif de l’être humain : un être profondément seul, guetté par le néant fondateur, sans oublier toutes les petites morts essaimant son parcours – ennui, mélancolie, angoisse, malaises, maladie, ruptures affectives ou sentimentales, perte des êtres aimés… –, et qui, quelles que soient les histoires qu’il peut se raconter, devra un jour ou l’autre se reconnaître dans son miroir. Notre expérience immédiate de la réalité est celle de l’irréparable, de la cruauté, nous enracinant dans notre dimension dérisoire et insignifiante. Nous sommes ce pas grand-chose, ce presque rien pour qui tout est irrévocable, irrattrapable, sans recours. La pensée tragique, en nous amenant à affirmer et à penser le pire, nous désolidarise des élans entretenus par les époques optimistes et, plus largement, de toute quête d’un surréel, que celle-ci penche du côté de la raison ou de celui du cœur, à l’instar du Dieu chrétien. Nous avons pu, certes, reconnaître chez des penseurs religieux, tels que Pascal ou Kierkegaard, tout sauf une simple fuite en avant, mais au contraire une prise en compte du caractère tragique de notre réalité. Comme la foi chrétienne nous a semblé l’illustrer, le souci du salut, lorsqu’il est profond, est loin de se réduire à la promesse d’un paradis acidulé pour tout un chacun ; il suppose une confrontation avec son destin mortel. Mais ce déchirement doit faire d’autant plus ressortir l’éclat de cette nouvelle vie offerte par la résurrection. Dans cette perspective, de telles élaborations de l’esprit, quelles que soient leur subtilité ou leur profondeur, sont l’affaire de ceux qui croient, pas de ceux qui tentent de réfléchir sans concession. L’homme qui entend s’éterniser ne s’accroche-t-il pas à un rêve que notre état de perdition a de quoi démentir ? S’il n’est, bien sûr, aucune certitude en la matière, penser le pire jusqu’au bout suppose de se tenir au plus près de ce que nous pouvons énoncer sans recherche d’une justification supérieure. Le cheminement tragique que nous avons entrepris résonne sans doute alors, à bien des égards, comme un amer cheminement. A été mesurée la durée dérisoire des hommes, le néant auquel ils sont voués, sans qu’aucun au-delà salvateur ne soit revendiqué. De quoi apparaître, peut-être, aux yeux de certains comme un apôtre de l’autodestruction en mettant à mal un certain nombre des palliatifs qui empêchent l’humanité de sombrer : images-mondes consolantes, immortalité de l’âme, bonheur… Pas d’arrière ou de nouveau monde, un réel toujours mouvant, des cieux vidés. La situation de l’individu tragique peut sembler guère enviable : sans Dieu, travaillé par la déréliction et l’angoisse, conscient d’être rongé par un temps implacable qui le conduit droit à la tombe, il ne lui reste rien sinon une existence rendue à son insignifiance et purgée d’espoir. Rien à attendre. 242
CONCLUSION
Mais, pour autant que l’on se sente habité d’une vitalité persistante, de ce point zéro où apparaît et s’effondre tout ce qui vit, peut en être tirée une pensée courageuse et stimulante, ressaisissant alors de la confrontation au néant l’écho de cette « soif de vie dans les crépuscules » évoquée par Cioran. De quoi inciter à tenter de vivre sa vie pleinement, sans demander une quelconque justification à l’insignifiance ou à la dureté de notre présence au monde. Car si le climat dépressionnaire ne peut sans doute manquer de se faire connaître à ses heures, faisant alors briller l’attraction de la nuit et du silence, il ne s’agit nullement de déambuler avec un pistolet sur la tempe. Nous avons, certes, tenu à rappeler que considérer la conservation de soi comme un bien inconditionnel ne peut s’imposer, rien n’excluant le suicide justifié pour soi à tel ou tel moment de son parcours. Néanmoins, l’enjeu n’est pas de conduire quiconque au suicide effectif, la pensée tragique prônant affirmation totale plutôt que négation totale, effort d’acceptation de la réalité sans réserve ou arrière-pensée. Il s’agit d’inciter l’homme à regarder la réalité en face, à vivre résolument en mortel, autrement dit à essayer de vivre du mieux que l’on peut tout en sachant que l’on vit pour rien. Vivre de rien. À partir de là, avons-nous tenté de dessiner les contours d’une sagesse tragique, consistant à adopter vis-à-vis du monde non pas une posture de retrait pour se tenir autant que possible à l’abri des orages de l’existence, mais bien plutôt à tenter d’affronter celui-ci dans sa totalité. Art de vivre mortel supposant l’alliance lucide de soi et de la vie, sans chercher à minimiser ou évacuer la souffrance inhérente à l’existence. La visée n’est donc pas de chercher à moins souffrir, grâce à la quête d’un détachement vis-à-vis de notre immersion dans le monde, comme le recommande notamment la sagesse bouddhiste, mais de s’efforcer de mieux souffrir, comme prix de notre attachement à l’existence. La volupté et la douleur de vivre n’iront pas dissociées vers ces moments frêles et fragiles que l’on nomme « heureux ». On ne peut s’inventer sans troubles, sans tâtonnements et sans fièvres inquiètes. Sinon l’on se fige dans des postures d’impassibilité ou l’on tombe dans ces « bonheurs » dégoulinants et mensongers prônés par les entêtés de la forme naïve de leur vitalité, créant des êtres marchant à coup de somnifères et de psychotropes destinés à juguler les dépressions qui les guettent au tournant. Ce tournant du réel prêt toujours à reprendre ses droits et à rappeler que l’existence ne coïncide pas avec des visages faussement béats. La joie s’impose toujours au lieu même de la souffrance. Deux pôles qui ne se confondent pas, mais une identité des contraires, puisant à la même source turbulente de l’existence. Dès lors, la sagesse tragique vise une affirmation de la vie pour ce qu’elle est, avec tout ce qu’elle peut contenir de douloureux et d’inquiétant. Vie et mort, plaisir et douleur, joie et souffrance, 243
CONCLUSION
c’est tout un. On n’aura pas l’un sans l’autre, comme Nietzsche s’est employé à le rappeler. Seule donc l’approbation en connaissance de cause est à même de relier les contraires, « horreur » et « joie ». Vouloir purger la vie des affects susceptibles de nous faire souffrir, c’est obtenir sans doute un apaisement, mais c’est aussi retirer à la vie sa densité même. Une vie sans épreuves ou tourments est-elle seulement intéressante ? A-ton vraiment vécu si l’on n’a pas été confronté à la tempête intérieure susceptible de mettre en cause la poursuite de sa marche ? Une vie trop tranquille est, si l’on se fie à Sénèque, comparable à une mer morte1. Pour étayer cette quête d’une expérience aussi vaste que possible, ne se satisfaisant pas de la tiédeur, Paul Veyne cite ces mots de Simmel : « À l’eudémonisme s’oppose une attitude qui se retrouve chez les caractères les plus nobles ; une existence agitée, qui aura connu toutes les joies et toutes les douleurs et à qui rien d’humain – que ce soit haut ou bas – n’est resté étranger, nous paraît avoir une valeur plus élevée que les existences stables et moyennes ; elle donne le sentiment d’avoir une personnalité plus ample et significative, sentiment dont ne peuvent se passer ceux qui y ont goûté une fois, quoi qu’il leur en coûte2. » Peut-on, à ce titre-là, tenir à son désespoir ? Sans doute, parce qu’il ouvre à une perception plus ample, plus aiguisée du réel. Il s’agit alors de s’essayer à habiter le monde, selon un langage épuré de toute perspective de retranchement ou d’impassibilité comme de toute vapeur transcendante, jouant autant que possible sur le fil tranchant du temps. Invitation à épouser l’impermanence du réel, à assumer notre brève suspension au-dessus du vide, en nous efforçant de donner toute l’intensité et la qualité dont nous sommes capables à chacun des moments de notre existence, puisant une énergie créatrice de la capacité d’accueil du réel immédiat dans sa fragilité et son instabilité hasardeuse. La pensée tragique formule des termes exigeants… Elle incite à une prise en charge de la réalité telle qu’elle est, se concentrant sur des termes tissés d’impermanence. Répit contre repos, port contre paix, danse au-dessus du vide contre euphorie de commande, … et passionnants. Insister sur la déchirure irréductible de l’homme, c’est aussi, d’une certaine façon, lui rendre le temps, en lui conférant une fonction et un pouvoir avec, selon les termes de Bachelard, l’intuition de l’instant qu’il s’agit de discerner et de vivre, en une véritable création spirituelle.
1 2
Sénèque, Lettres à Lucilius, op. cit., livre VII, lettre 67, 14, p. 776. Ibid., Préface, Note 1, p. CXIII.
244
CONCLUSION
C’est en quoi nous avons insisté, en particulier, sur l’importance de l’occasion, requérant toute notre attention et notre concentration pour coïncider avec l’expérience présente. Exigence d’attention aiguë à l’instant présent, d’entière disponibilité pour savoir saisir la faveur imprévue de l’occasion afin d’en tirer quelque enseignement pour soi-même et d’aboutir, autant que possible, à de fécondes inspirations, tels les mots de la pensée trouvant leur premier souffle balbutiant sur la page blanche. Monde dont le devenir est à construire à chaque instant, hors de tout dogme et loin de toute apathie frivole. L’inactivité n’est pas de mise, elle serait la vraie nuisance au travail du penseur, de l’écrivain et de tout autre créateur. S’il est une portée féconde de la conscience tragique, elle réside dans cette capacité à percevoir le monde avec lucidité, sans pour autant sombrer dans la sécheresse, faisant ainsi de notre temps bref et fuyant un principe de tension et de création plutôt que d’abattement et de démission. Parce que la vraie vie est là, avec son cortège de beautés scintillantes, de drames sous-jacents, d’ennui terrassant et d’élans joyeux. Avec ce vide que nous tentons d’habiter. La vraie vie, seulement moins maquillée, plus à vif, plus squelettique, créant alors le désir de sentir battre davantage le pouls du réel et de mener une phrase à son terme. La conscience de notre mortalité profonde suscite l’humanité en l’homme, nous rend attentifs. Il ne s’agit donc nullement de prôner un avachissement pseudo masochiste dans le rien, de se complaire dans l’inaction ou la vie végétative, en une sorte d’oblomoverie de bon ton, propre à ceux que Sénèque appelle les « oisifs impénitents », dont l’inactivité est l’indice non du repos, mais de « faiblesse de nerfs et marasme1 ». Sénèque décrit deux types d’hommes également blâmables : d’un côté, « l’agitation turbulente » de ceux qui ne tiennent pas en place, qui se sentent tenus d’être toujours en action pour ne pas être livrés au sentiment de leur néant, et dont l’activité se résout dans « les sauts et les bonds d’une âme affolée » ; de l’autre, l’absence de mouvement des oisifs impénitents. Entre ces deux extrémités, il reste une marge importante sachant définir les termes d’une vie ascendante, d’une véritable activité, consistant à faire de son mieux dans ce que l’on entreprend, quoi qu’il en soit de la durée. C’est dire que ce que d’aucuns considèrent comme un cul-de-sac peut être appréhendé comme un chemin de vie, une vie qui sait qu’elle tend perpétuellement vers la chute, que la partie se joue en pure perte, mais qui, pour autant, ne se laisse pas délibérément choir avant l’heure, décidée qu’elle est à vivre résolument cette dépense injustifiée. Sans le vernis des systèmes philosophiques clos et lisses, sans le confort de l’optimisme ou l’excuse de la religion, l’individu assume sa propre errance. Pas de prétention donc à trouver un rivage sûr, mais la tentative en tout cas de
1
Sénèque, Lettres à Lucilius, op. cit., livre I, lettre 3, 5, p. 606.
245
CONCLUSION
naviguer avec intelligence et lucidité au milieu des récifs. La pensée tragique ne conclut pas, n’est pas taillée pour cela. Elle tente d’ouvrir des perspectives d’existence qui ne se nourrissent pas de stratégies d’évitement. On ne retient pas ce qui est voué à se défaire. En tout cas, vivre sous le régime de l’illusion, comme aller chercher un être qui ne se trouve nulle part ou se gargariser d’un bonheur dont la « stabilité » s’évanouit sitôt qu’elle est prononcée, ne fait que garantir un appauvrissement de la vie, puisqu’on la dépouille de tout ce qui la constitue : on aura atténué sa crudité certes, occulté sa cruauté peut-être, en écartant le fugace, l’éphémère, la mort, mais on aura tué, du même coup, son aspect multiforme, mobile, ludique aussi. Reconnaître le caractère poreux et toujours mouvant des apparences, c’est aussi nous rendre plus attentifs à l’irremplaçable valeur de l’instant, capable d’éclairer la conscience de cette compréhension profonde « que seule importe cette disponibilité vagabonde, la plus difficile à atteindre, qui nous fait ressentir chaque existence comme unique et chaque expérience comme nouvelle1 ». C’est ce qui a pu faire écrire à Cioran en guise de conclusion au Mauvais Démiurge : « Nous sommes tous au fond d’un enfer dont chaque instant est un miracle2. » Sans doute, entre la naissance et la mort, l’humanité est-elle condamnée à un certain nombre de tortures et de gesticulations inutiles. Sans doute, la vie n’est-elle qu’« une pirouette dans le vide3 », mais celle-ci peut, tout au moins, être accomplie avec élégance et selon un effort soutenu de présence au présent, comme si le monde nous apparaissait à chaque fois comme une première-dernière fois. La joie parle de cette entière disponibilité au jeu toujours singulier des apparences : irruptions inattendues, rencontres fortuites, ensoleillements imprévus, surprise éblouie devant l’émergence du nouveau, à l’instar du mystère printanier. À l’image du mouvement des saisons, le jeu mobile des éléments, leur unicité, leur finitude même parviennent à dégager pour l’œil attentif un charme certain de l’existence. Cruelle et impitoyable en raison de sa finitude, assignant toute chose à l’éphémère et au dérisoire, cette même finitude peut s’avérer, paradoxalement, à même de provoquer la joie. Nous voici loin d’une morne répétition, mais au plus près, au contraire, d’une récréation festive qui, n’attendant rien, parvient à se réjouir de l’éclosion provisoire et, en cela, toujours exceptionnelle de ce qui existe. Ne rien attendre, mais rester attentif et ouvert à tout. Paul Auster dans L’invention de la solitude parle de cet individu qui ne demandait jamais rien, sans pour autant refuser tel ou tel geste de ses proches. Ainsi lorsque A. venait lui rendre visite avec un poulet rôti dans les mains, S. s’exclamait « Ah, du poulet ! », ceci « ponctué d’un rire espiègle et un peu moqueur, comme s’il avait considéré son appétit avec ironie sans toutefois renier le 1
R. Jaccard, La Tentation nihiliste, PUF, « Quadrige », 1989, p.142. Cioran, Le Mauvais Démiurge, in op. cit., p. 1259. 3 Cioran, Des larmes et des saints, in op. cit., p. 312. 2
246
CONCLUSION
plaisir de manger. Dans ce rire, tout devenait absurde et lumineux. L’univers était retourné, balayé, et aussitôt rétabli comme une sorte de plaisanterie métaphysique. Un monde où il n’y avait pas de place pour un homme dépourvu du sens de son propre ridicule1. » Nous sommes tous, à notre manière, parfaitement ridicules, mais reste la façon d’appréhender notre petitesse. Certains préfèrent s’arroger une illusoire royauté, parée de grands mots ; d’autres choisissent – à moins que ce ne soit juste une question d’humeurs – de reconnaître et d’intégrer à leur cheminement le caractère dérisoire de notre existence. Est-ce dire pour autant qu’ils vivent moins que les autres, ployés sous le poids de leur mort, fascinés par ses griffes impitoyables ? Perdent-ils du même coup de vue toute la saveur de la vie ? Nous avons tenté de montrer que la vision tragique du destin humain n’a rien d’une mort que l’on s’injecte avant l’heure avec une certaine complaisance, mais d’un état d’esprit décidé à ne rien enjoliver et qui ne se ferme pas pour autant délibérément les portes de la vie. La considération du pire, en offrant précisément le sens de sa propre dérision, peut s’avérer non seulement une source importante d’énergie vitale et de créativité, mais aussi un terrain capable de faire émerger l’humour et de révéler l’écho d’une joie en mesure de résister à tout ce qui peut la mettre en échec. N’est-ce pas celui qui a intériorisé profondément sa constitution éphémère qui est le plus à même de mesurer le prix de son rire et de sa joie ? Leur éclat ne ressort-il pas d’autant plus ? L’on s’étonne souvent du rire des auteurs sombres et l’on dit « voyez comme une forme d’optimisme est décelable malgré tout chez cet homme ». Ici se glisse une profonde erreur d’appréciation. L’optimisme n’a rien à voir là-dedans, ces rires et sourires des penseurs les plus impitoyables émanent directement de leurs abîmes, exprimant alors la capacité à cheminer gracieusement à l’intérieur de leurs propres décombres sans se prendre au sérieux pour y emprunter un véritable sentier humoristique. On peut songer ici bien sûr à Nell rappelant que « rien n’est plus drôle que le malheur », mais aussi au personnage de Comment c’est, lorsqu’il déclare que ce qui est accompli par toute créature vivante l’est « à son cadavre défendant2 ». Façon d’affirmer le pire, d’exprimer, selon le commentaire de Janvier, « sa condition de mortel continu3 », investissant, dynamitant le langage par l’humour pour constater le pire et sa ligne ininterrompue. Éclats de rire inspirés de la traversée du pire ramenant notre cheminement à sa juste place d’un jeu à la fois grave et dérisoire : en face / le pire / jusqu’à ce / qu’il fasse rire4
1
P. Auster, L’Invention de la solitude, op. cit., p. 147-148. S. Beckett, Comment c’est, Minuit, 1961, p. 204. 3 L. Janvier, Pour Samuel Beckett, op. cit., p. 283. 4 S. Beckett, Poèmes, suivi de Mirlitonnades, Minuit, 1992, première « mirlitonnade », p. 35. 2
247
CONCLUSION
Expression d’une capacité de se tourner soi-même en dérision en intégrant la « plaisanterie métaphysique », d’endosser la gravité sans verser dans le sérieux empesé, mettant alors au jour une capacité de réjouissance au cœur de l’impitoyable. C’est dire que l’humour et la joie ne trouvent leur véritable élan qu’auprès d’une conscience lucide. S’il est donc un sens aigu de l’allégresse, il ne se trouve pas dans les bagages de l’optimiste s’attachant à fuir l’indifférence tragique du monde, mais au plus près de celui qui décide de compter avec son angoisse, qui a compris que c’est en se laissant porter par elle qu’il peut s’ouvrir pleinement aux éclats turbulents du rire humoristique et à la joie d’exister. Ainsi, le tragique sait-il dessiner un chemin qui n’a rien d’un entêtement à la morosité. De quoi mettre en évidence que la confrontation au néant n’a pas vocation à se cristalliser dans un « aquabonisme » empêchant de profiter du moment présent et détruisant l’aptitude à la joie. Le penseur tragique est loin de trouver son compte dans une posture de lamentation ; à l’instar notamment de Montaigne ou de Nietzsche, il suit dans le geste de la création le courant vital qui serpente en lui ; il sait en rire aussi, dispensant là un des plus riches enseignements sur la capacité de retourner sa noirceur intérieure en gaieté tragique. Insister sur le caractère constitutivement tragique de notre réalité aboutit à prôner le primat de l’instant et de la sensibilité face, notamment, au confort médiocre du présent mou de l’utile et de la consommation et, plus profondément encore, à privilégier rire tragique et allégresse. Dispositions d’esprit exprimant combien la pensée tragique n’est pas réductible à une démarche morbide, consciente qu’elle est que la souffrance et la cruauté peuvent nourrir des rires et des danses sachant considérer la réalité d’un œil bienveillant et amusé, et, au fond, une joie en mesure de tout absorber. L’humour s’offre ainsi comme cette « arme indispensable pour affronter sereinement la réalité, avec amour et sans haine1 ». La joie, comme cette grâce inattendue qui sait se manifester au cœur du paradoxe, réunissant considération du plus cruel et réjouissance. Association qui, pour apparaitre paradoxale et contraire à la raison, n’en est pas moins réelle dans les faits, ainsi que l’illustrent, notamment, le gai savoir de Nietzsche, l’allégresse qui émane des partitions musicales de Mozart ou, tout simplement, la joie qui vient nous investir devant le surgissement ondoyant et précaire du printemps, comme une expression flagrante de l’amour du réel. Force majeure contre toute attente. Témoignage même de la capacité d’acquiescement au réel dans sa totalité tragique.
1
M. Polac, C. Rosset, Franchise postale, PUF, « Perspectives critiques », 2003, p. 82.
248
Table des matières INTRODUCTION .................................................................................................... 5 CHAPITRE I. L’ÉPREUVE DU TRAGIQUE .................................................... 19 I. FIN DE PARTIE .................................................................................................. 22 La peste du destin............................................................................................ 22 La dislocation du temps par l’ennui ................................................................ 30 II. NON-ÊTRE ET INSIGNIFIANCE ........................................................................ 42 Angoisse et non-être ....................................................................................... 42 Non-sens, absurdité, insignifiance .................................................................. 51 III. LA VISION TRAGIQUE ................................................................................... 67 La perdition, l’état de mort ............................................................................. 67 Le crime d’être né ........................................................................................... 74 CHAPITRE II. ÉCHOS DU RÉEL ...................................................................... 85 I. DÉRIVE ONTOLOGIQUE.................................................................................... 88 Ici et là-bas ...................................................................................................... 89 La dévaluation du réel ..................................................................................... 97 II. REDESCENDRE LE CHEMIN DES IDÉES ......................................................... 106 Seulement idiot ............................................................................................. 107 Le réel retrouvé ............................................................................................. 118 CHAPITRE III. HORS DU TEMPS ? ................................................................ 125 I. LA LIBERTÉ À MORT ...................................................................................... 126 Hors la logique de la vie ............................................................................... 126 Ténébreuse liberté ......................................................................................... 132 Une affaire de goût........................................................................................ 138 II. LA PASSION DU POSSIBLE ? .......................................................................... 150 La pente de l’éternité..................................................................................... 150 Quel antidote ? .............................................................................................. 159 Une vague supplique ..................................................................................... 177 CHAPITRE IV. SAGESSE TRAGIQUE ........................................................... 187 I. GAMMES DE L’EXTRÊME ............................................................................... 189 Quel volontarisme ? ...................................................................................... 189 La grâce de l’occasion................................................................................... 202 II. TEMPS, MORT, JEU ....................................................................................... 215 Sentier humoristique ..................................................................................... 217 Que la joie persiste ........................................................................................ 231 CONCLUSION ..................................................................................................... 241 249
PHILOSOPHIE AUX ÉDITIONS L'HARMATTAN Dernières parutions DE L'UNIVERS ÉTERNEL À L'ÉTERNITÉ DE L'HOMME Jean-Jack Micalef Cet ouvrage retrace l'odyssée de l'univers et celle du devenir de l'Esprit incarné dans l'homme. L'auteur postule un univers éternel n'ayant jamais fait l'objet d'une création. Il s'oppose à la cosmologie du Big Bang qui s'inscrirait dans la tradition religieuse d'une genèse du monde. Un univers éternel permet de penser l'essence éternelle de l'homme dont la naissance ne serait plus exceptionnelle dans le cosmos. En effet, le sens général de l'évolution aurait une seule finalité : accoucher de l'Esprit pour que l'univers se comprenne lui-même à travers l'esprit de l'homme. (Coll. Ouverture Philosophique, 230 p., 24,5 euros) ISBN : 978-2-343-16813-5, EAN EBOOK : 9782140115073
AUGUSTE COMTE La religion de l'Humanité : l'échec d'une transmission Florian Uzan Auguste Comte fut un grand philosophe, concepteur de la sociologie, du positivisme et de la théorie des trois états. On oublie cependant qu'il fut aussi à l'origine d'une religion personnelle, un culte des morts destiné à relier et rallier l'humanité tout entière. Mais que reste-t-il de son oeuvre ? Si son influence quasi mondiale n'est plus à démontrer, comment expliquer l'échec de sa religion ? (Coll. Ouverture Philosophique, 288 p., 29 euros) ISBN : 978-2-343-16499-1, EAN EBOOK : 9782140114533
DÉCONSTRUIRE L'IMPOSTURE IDENTITAIRE Humanisme et éthique de la déconstruction Hamdou Rabby Sy Ce livre invite à ne jamais céder à la tentation du repli identitaire avec tous ses dérivés sectaires. Comme opium de toutes les sociétés, le repli identitaire est un péril mondial. Cette tentation inspire toutes les formes de haine, d'exclusion, d'intolérance. D'où l'urgence de renouer avec ce qui constitue l'identité humaine dans l'expression de sa dignité : penser. Et cela à partir de la déconstruction, pour porter un message d'espoir et d'avenir pour une humanité vivante et solidaire. Oser déconstruire est le seul impératif devant les périls de l'identitaire. Déconstruire, c'est nourrir la conviction et l'engagement pour l'impossible, condition de l'horizon de tous les possibles. (Coll. Ouverture Philosophique, 236 p., 24 euros) ISBN : 978-2-343-16825-8, EAN EBOOK : 9782140114915
MÉLANGES PHILOSOPHIQUES VOLUME 3 Christophe Yahot Ce volume III se veut un creuset et un lieu de ralliement de recherches transdisciplinaires sur les problématiques contemporaines. En témoignent les débats sur les enjeux de la monarchie, de l'adaptation des médias au numérique, l'esthétique alimentaire. La vigueur scientifique des auteurs tient pour beaucoup à leurs capacités d'ouvrir des perspectives innovantes dans cette conjoncture de crises de la modernité. Les uns nous conduisent aux sources de la spiritualité pour le devenir de l'humain ; les autres nous invitent à explorer les pistes de la « philosophie éco-citoyenne » pour un développement durable. (Coll. Harmattan Côte-d'Ivoire, 214 p., 22 euros) ISBN : 978-2-343-16798-5, EAN EBOOK : 9782140114700
BOÎTES NOIRES ET GILETS JAUNES Regards croisés sur la socialité à l'ère de l'anthropocène Sous la direction de Jean-François Petit, Vincent Puig, Vincent Laquais La période actuelle de l'anthropocène se caractérise par un bouleversement des équilibres systémiques. Cette situation nouvelle analysée par l'IRI et Ars Industrialis fait apparaître des questions nouvelles qui concernent, notamment, les réseaux sociaux, l'architecture du web, la gouvernementalité algorithmique, la contribution comme question politique, technologique et économique. Ces analyses croisent celles élaborées pendant trois ans au sein du groupe PHILOPRAT concernant l'identité collective dans une société d'individus, le statut des émotions et des peurs, l'enjeu des normes, le posthumanisme et le transhumanisme, le Buen Vivir et la capacitation, les Biens communs et les Commons. (Coll. Ouverture Philosophique, 258 p., 26 euros) ISBN : 978-2-343-16932-3, EAN EBOOK : 9782140114526
DARYUSH ASHOURI Un intellectuel hétérodoxe iranien Mohsen Mottaghi, Reza Rokoee Préface de Farhad Khosrokhavar Daryush Ashouri fait partie des intellectuels laïques qui s'appuient sur une tradition philosophique occidentale, pour éclairer quelques aspects des problèmes de la société iranienne. Ce livre se propose de mettre à la disposition des lecteurs francophones la traduction de quelques-uns de ses textes représentatifs des problématiques qui ont mobilisé les milieux intellectuels en Iran durant les cinquante dernières années. En regardant la trajectoire intellectuelle de Daryush Ashouri, on constate qu'il fait partie des quelques rares intellectuels iraniens qui ne se sont pas laissé influencer par les deux orthodoxies de leur époque que sont le marxisme et la religion musulmane. (Coll. L'Iran en transition, 254 p., 25 euros) ISBN : 978-2-343-16665-0, EAN EBOOK : 9782140112232
CROYANCE ET SOUMISSION De la critique de la religion à la critique sociale Réflexions à partir de Spinoza et Freud Marie-Pierre Frondziak Nous nous croyions sortis de la soumission. Pourtant, nous devons constater un retour en force de toutes les formes d'acceptation à des injonctions extérieures. Contre l'idée de servitude volontaire, l'auteur se propose, partant de Spinoza et de Freud, de comprendre ce qu'est l'essence même de la soumission et comment elle produit des croyances, dont les plus puissantes sont religieuses. Le progrès du savoir devait détruire les superstitions et donc l'asservissement. On propose ici l'inverse : c'est parce qu'ils sont d'abord soumis à leurs propres affects que les hommes croient en des superstitions. Seule la connaissance de cette mécanique affective peut laisser espérer une libération. (Coll. Ouverture Philosophique, 212 p., 21,5 euros) ISBN : 978-2-343-16365-9, EAN EBOOK : 9782140112379
À QUOI SERT LA CULTURE ? Gilles Lévêque La culture classique qui, pendant des siècles a nourri et élevé les esprits, était fondée sur une conception de l'homme désormais morte, notamment d'avoir subi les assauts de la science et du capitalisme. Elle n'est pourtant pas sans avoir laissé une héritière, à savoir la culture dite exigeante, celle qui est aujourd'hui diffusée dans les structures culturelles, mais dont on ne voit plus quelle fonction on pourrait lui assigner. Cette culture exigeante ne serait-elle au fond rien d'autre qu'un divertissement raffiné pour personnes distinguées ? Se réduirait-elle à n'être que l'expression identitaire, sans vérité ni universalité, d'un groupe social parmi tant d'autres ? Sa prétention à nous éclairer sur le monde et sur la vie ne serait-elle qu'une illusion ? Faudrait-il lui préférer la culture de masse, qui pour sa part échappe à l'accusation d'élitisme ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage entend répondre. (Coll. Pour Comprendre, 276 p., 28,5 euros) ISBN : 978-2-343-16894-4, EAN EBOOK : 9782140114243
LA BIOÉTHIQUE AU XXIE SIÈCLE Sous la direction de Abraham Rudnick. Traduit de l'anglais par Kouider Nizar. Préface de Bertrand Saint-Sernin Cet ouvrage traite de questions aussi diverses que la fin de vie, la procréation médicalement assistée, la recherche sur les cellules souches, les nanotechnologies et la bioéthique spéculative. Comment prendre des décisions dans un contexte particulier de fin de vie où le traitement de maintien de vie prolonge la souffrance ? Comment élaborer une éthique des nanotechnologies ? Tels sont quelques-uns des enjeux éthiquement complexes que ce livre examine. (Coll. Ouverture Philosophique, 288 p., 30 euros) ISBN : 978-2-343-16924-8, EAN EBOOK : 9782140114281
VIVRE SUR TERRE Comment dépasser le nihilisme contemporain Julien Lebrun En ce début de 21e siècle, malgré les catastrophes écologiques annoncées, aucun changement majeur n'a été mis en place. Nous semblons incapables de prendre en compte ce que les scientifiques ne cessent de nous répéter. Cette inertie ne s'explique pas par l'absence de solutions. Cette passivité repose en réalité sur notre conception du monde. Depuis l'avènement de la science moderne, nous percevons notre environnement comme un support inerte, taillable et corvéable à merci. Notre modèle social repose ainsi sur le déni d'une réalité pourtant évidente : nous n'existons pas sans environnement. Reprendre conscience de ce que nous sommes - comme du monde dans lequel nous vivons - constitue donc l'enjeu majeur de ce siècle. Il est temps de réapprendre à vivre sur terre. (Coll. Questions contemporaines, 230 p., 23,5 euros) ISBN : 978-2-343-16111-2, EAN EBOOK : 9782140112584
EDITH STEIN De l'idéologie à la foi Enoch Tompte-Tom Avec Edith Stein, nous entrons dans une dimension où la quête de la foi n'est pas exclusivement du domaine de la philosophie ni de la théologie. Pour mieux comprendre Edith Stein, il n'est pas possible de parler de la foi en philosophie et en théologie en dehors de certains préalables. Ces préalables sont vus sous les approches de philosophes et théologiens afin de souligner la similitude entre la philosophie et la théologie par rapport à la quête de la foi. Le chemin de la croix poursuivi par Edith Stein est un chemin peu ordinaire. Malgré sa sympathie pour la philosophie de Thomas d'Aquin, elle prend position en ce qui concerne la philosophie chrétienne qui doit être envisagée comme une solution à un problème ontologique et épistémologique : celui de la Vérité et de la Foi. (Coll. Ouverture Philosophique, 210 p., 19,5 euros) ISBN : 978-2-343-16693-3, EAN EBOOK : 9782140112669
LA SUBSISTANCE Pour une philosophie de la résurrection Clotaire Bambi-Kimpoudi Les questions de l'être, de la vérité, de la liberté, de la méthode et de la mort, qui rebondissent sous des colorations nouvelles, ne nécessitent-elles pas leur reconstruction en leur donnant un sens qui aborde les défis et dilemmes de notre temps ? N'exigent-elles pas de forger, à partir des nouveaux concepts fédérateurs, un système explicatif sur le sens de l'existence, au lieu de s'attarder à commenter et à critiquer les anciens systèmes de pensée ? Ce livre essaie de forger un système explicatif, le « subsistantialisme », qui assigne à la philosophie d'être une philosophie de la résurrection. (Coll. Harmattan Congo-Brazzaville, 268 p., 27 euros) ISBN : 978-2-343-16637-7, EAN EBOOK : 9782140112256
PHILOSOPHIE ET CIVILISATION Considérations sur l'idée d'Occident Mohamed Moulfi Les éléments théoriques et historiques ici proposés sont en oeuvre chez les philosophes pour penser le rapport de la philosophie au processus de civilisation occidentale en interaction avec l'en-dehors. L'exercice consiste à rendre intelligible l'historicisme qui pose le rapport de la Grèce et de la philosophie comme une origine d'une histoire intérieure à l'Occident, pour faire en définitive de la philosophie un devenir-monde. La charge de la philosophie est immense ; elle se doit de figurer le projet de l'Occident. En contrepoint, il y a lieu de considérer le rôle décisif de l' « en-dehors », non pas de cet Orient exotique que crée l'Occident, mais plutôt de celui du geste inverse par lequel l'Occident devient. (Coll. Ouverture Philosophique, 212 p., 21,5 euros) ISBN : 978-2-343-16538-7, EAN EBOOK : 9782140112270
L'ÉTHIQUE D'ARISTOTE APPLIQUÉE AUX ENTREPRENEURS Xavier Ragage Guidée par un oeil entrepreneurial, la célèbre oeuvre morale d'Aristote L'Ethique à Nicomaque se révèle étonnamment moderne. A la lire, les entrepreneurs dans nos sociétés libérales répondent fondamentalement à la définition du vertueux et du prudent qu'évoquait la tradition grecque. L'auteur vise à mettre en regard ces descriptions précises des valeurs éthiques étudiées par le grand philosophe, de l'amabilité au courage, et leur mise en pratique dans l'activité économique, des entreprises aux startups. Il s'ensuit une heureuse rencontre visant à donner autrement les clés du succès. (Coll. Questions contemporaines, 290 p., 30 euros) ISBN : 978-2-343-16205-8, EAN EBOOK : 9782140110818
LA HOMO, KONSCIA ERO DE DIO=NATURO La KorpoSpirito tra la okulvitroj de Spinoza Robert Molimard Cette traduction espéranto de L'Homme, avatar de Dieu (L'Harmattan) est de l'auteur même. Spinoza identifie Dieu à la Nature, substance unique qui constitue l'univers, dont matière et esprit sont deux facettes indissociables. Les trois correctrices, française, finlandaise et polonaises ont suggéré un autre titre (en français : L'Homme, parcelle consciente de Dieu=Nature). Cette vision du monde donne un sens à la vie. Professeur de médecine et physiologiste, l'auteur analyse ses conséquences pratiques sur l'Homme et son fonctionnement dans l'environnement. Toute cette étude, rédigée en espéranto, est accessible aux débutants. (204 p., 20,5 euros) ISBN : 978-2-343-16600-1, EAN EBOOK : 9782140111686
CORPS ET DÉCORS Avatars de la philosophie du corps entre Orient et Occident Sous la direction de Dandan Jiang, Jérôme Lèbre et Paolo Quintili, avec la collaboration de Laura Paulizzi La philosophie contemporaine et la phénoménologie du corps, en visant à rendre le corps plus multiple, plus habité par l'altérité y compris technique (Derrida, J.-L. Nancy), ont fait évoluer profondément le problème du lien entre âme et corps. Ces perspectives ont introduit dans le débat d'origine cartésienne des variantes liées à l'art, l'écriture et l'environnement. Orient et Occident se retrouvent ainsi confrontés à un corps aux multiples « décors », qui le spécifient, l'entourent, l'enrichissent. (Coll. Rationalismes, 290 p., 30 euros) ISBN : 978-2-343-16197-6, EAN EBOOK : 9782140111365
Structures éditoriales du groupe L’Harmattan L’Harmattan Italie Via degli Artisti, 15 10124 Torino [email protected]
L’Harmattan Sénégal 10 VDN en face Mermoz BP 45034 Dakar-Fann [email protected] L’Harmattan Cameroun TSINGA/FECAFOOT BP 11486 Yaoundé [email protected] L’Harmattan Burkina Faso Achille Somé – [email protected] L’Harmattan Guinée Almamya, rue KA 028 OKB Agency BP 3470 Conakry [email protected] L’Harmattan RDC 185, avenue Nyangwe Commune de Lingwala – Kinshasa [email protected] L’Harmattan Congo 67, boulevard Denis-Sassou-N’Guesso BP 2874 Brazzaville [email protected]
L’Harmattan Hongrie Kossuth l. u. 14-16. 1053 Budapest [email protected]
L’Harmattan Mali Sirakoro-Meguetana V31 Bamako [email protected] L’Harmattan Togo Djidjole – Lomé Maison Amela face EPP BATOME [email protected] L’Harmattan Côte d’Ivoire Résidence Karl – Cité des Arts Abidjan-Cocody 03 BP 1588 Abidjan [email protected] L’Harmattan Algérie 22, rue Moulay-Mohamed 31000 Oran [email protected] L’Harmattan Maroc 5, rue Ferrane-Kouicha, Talaâ-Elkbira Chrableyine, Fès-Médine 30000 Fès [email protected]
Nos librairies en France Librairie internationale 16, rue des Écoles – 75005 Paris [email protected] 01 40 46 79 11 www.librairieharmattan.com
Lib. sciences humaines & histoire 21, rue des Écoles – 75005 Paris [email protected] 01 46 34 13 71 www.librairieharmattansh.com
Librairie l’Espace Harmattan 21 bis, rue des Écoles – 75005 Paris [email protected] 01 43 29 49 42
Lib. Méditerranée & Moyen-Orient 7, rue des Carmes – 75005 Paris [email protected] 01 43 29 71 15
Librairie Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris [email protected] 01 42 22 67 13
Achevé d’imprimer par Corlet Numérique - 14110 Condé-sur-Noireau N° d’Imprimeur : 156360 - Mars 2019 - Imprimé en France
Emmanuelle Bruyas est docteure en philosophie et auteure de textes littéraires, fragments et nouvelles. Elle a été notamment cofondatrice et rédactrice en chef de la revue pluridisciplinaire L’Aleph de 1998 à 2005. Elle est membre du comité rédactionnel de la revue Alkemie depuis 2017. Publications : François Chirpaz, chemins de philosophie. Entretiens avec Emmanuelle Bruyas (L’Harmattan, 2014), Trajections (Bellier, 2016 – Ouvrage paru sous le nom d’Emma Bruyas-Veyrat). Site Internet : www.humus-plume.fr
Emmanuelle BRUYAS
La pensée tragique traverse l’irréductible déchirure de l’homme, considérant, outre les tourments auxquels il est exposé, sa vocation, comme celle de toute chose, à la mort et à l’oubli. Décidée à cheminer loin des rivages consolants, une telle pensée se recommande, selon Clément Rosset, d’une logique du pire, s’efforçant d’appréhender le réel dans sa présence singulière et chaotique, où chaque existence, émergence hasardeuse et éphémère, n’est arrimée à rien. Nous avons tenté de repérer les points d’impact de cette logique. Il s’est agi tout d’abord de penser l’épreuve de la condition humaine : découverte de celle-ci sous son jour précaire, l’enracinant au sein du réel destructeur. Nous avons envisagé ensuite les implications de cette traversée première, interrogeant la possibilité du suicide et celle de l’approche religieuse de notre destin. Si l’idée du suicide représente un important sas de liberté pour l’existant, la pensée tragique ne prône pourtant pas le passage à l’acte, celui-ci constituant, au fond, une tentative de neutralisation de la mort, plutôt qu’un véritable affrontement de notre finitude. Elle ne s’inscrit pas, non plus, dans la perspective de la foi religieuse, y discernant, quelle que puisse être la profondeur de son inspiration, une façon d’éluder l’impact de notre mortalité intime et la dureté de notre présence au monde. Dès lors, avons-nous essayé de cerner les contours d’une sagesse tragique. Invitation à un accueil sans partage de la totalité tragique du réel, sollicitant une attention aiguë à l’instant présent, reconnaissant aussi dans l’humour et dans la joie, plus encore, l’écho gracieux d’une capacité de jubilation à même de résister à la peine.
bibliothèque
Emmanuelle BRUYAS
CONSCIENCE TRAGIQUE Penser le néant, vivre de rien
CONSCIENCE TRAGIQUE
CONSCIENCE TRAGIQUE
Photo de couverture par E. Bruyas ISBN : 978-2-343-17160-9
26.50 €
OUVERTURE
PHILOSOPHIQUE bibliothèque