Edward Hopper lumière et obscurité 9781780428512, 1780428510
Edward Hopper exprime avec po(r)sie la solitude de lOCOhomme face a cet american way of life qui se d(r)veloppe dans les
269 115 56MB
French Pages 256 Year 2014;2012
SOMMAIRE......Page 4
INTRODUCTION......Page 6
EMERGENCE – UN MONDED’OBSCURITE ET DE LUMIERE......Page 10
MOMENTS DECISIFS......Page 34
AMOUR ET AQUARELLES......Page 98
LE SACRE D’UNE ICONE......Page 164
BIBLIOGRAPHIE......Page 250
NOTES......Page 252
LISTE DES ILLUSTRATIONS......Page 254
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Hopper
- Edward; Hopper
- Edward; Souter
- Gerry
File loading please wait...
Citation preview
Edward Hopper lumière et obscurité
Gerry Souter
Auteur : Gerry Souter Traduction : Aline Jorand Mise en page : Baseline Co. Ltd. 127-129A Nguyen Hue Blvd Fiditourist, 3e étage District 1, Ho Chi Minh-Ville Vietnam
© Confidential Concepts, worldwide, USA © Parkstone Press International, New York, USA © Heirs of Josephine N. Hopper, licensed by the Whitney Museum of American Art, pp. 6, 9, 10, 12, 14-15, 17, 18, 21, 22-23, 24, 27, 28-29, 30, 33, 34, 36, 38-39, 42, 45, 47, 50-51, 53, 54-55, 56, 60-61, 64-65, 67, 70-71, 73, 74, 76, 77, 79, 80-81, 82, 85, 86-87, 115, 116-117, 123, 138-139, 146-147, 168-169 © Sheldon Memorial Art Gallery, pp. 218-219 © Lyonel Feininger estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ VG Bild-Kunst, Bonn © The Georgia O'Keeffe Museum/ Artists Rights Society (ARS), New York © Charles Sheeler © John Sloan
Tous droits réservés Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sans autorisation préalable du détenteur des droits d’auteur et ce dans tous les pays. Sauf avis contraire, la propriété intellectuelle des reproductions qui figurent dans cet ouvrage appartient à leurs photographes respectifs. Malgré une recherche soutenue il n’a pas toujours été possible de connaître les détenteurs ou détentrices de la propriété intellectuelle des images. Lorsque la mention des photographes fait défaut nous serions reconnaissants à ceux qui voudraient bien nous envoyer des notifications à leur sujet. ISBN : 978-1-78042-851-2
EDWARD HOPPER lumière et obscurité
REMERCIEMENTS
L’
auteur souhaite remercier tout particulièrement Mlle Carol Rusk, la bibliothécaire du Benjamin and Irma Weiss Library du Whitney Museum of American Art (945 Madison Ave., New York, NY 10021, Etats-Unis), pour son aimable contribution à la recherche des lettres et des documents d’Edward et
Josephine Hopper à la bibliothèque Frances Mulhall Achilles du Whitney Museum of American Art.
Une source qui s’avéra essentielle pour la création de cet ouvrage est le livre Edward Hopper – An Intimate Biography de Gail Levin (University of California Press, Berkeley et Los Angeles, Californie, 1995). Ce livre fut écrit à partir des journaux intimes et des lettres de Josephine Nivison Hopper, accessibles lorsque Mlle Levin était chargée de la conservation de la collection Edward Hopper du Whitney Museum of American Art en 1976. Son ouvrage est un bon exemple d’érudition. La documentation précise sur laquelle s’est basé l’auteur pour décrire la vie de l’artiste vient compléter l’œuvre abondante de Mlle Levin au sujet d’Edward Hopper.
L’auteur souhaite également remercier la bibliothèque Chicago Art Institute Ryerson Library (Illinois).
S
OMM AIRE
Introduction
6
Emergence – un monde d’obscurité et de lumière
10
Moments décisifs
34
Amour et aquarelles
98
Le Sacre d’une icône
164
Bibliographie
251
Notes
252
Liste des illustrations
254
INTRODUCTION
L
es peintures à l’huile réalistes d‘Edward Hopper, ses aquarelles et ses gravures le rendirent célèbre pendant l’entre-deux-guerres en Amérique, des années 1920 aux années 1940. Pendant les vingt dernières années de sa vie, il connut les honneurs, les médailles, les expositions rétrospectives. Il
L’homme est son travail. Tout résultat provient forcément de quelque part. — Edward Hopper
reçut d’innombrables invitations aux musées et aux ouvertures de galeries. Il en refusait la plupart. C’était un ermite, otage d’une éducation qui le poussait en permanence à se dépasser. Il était prisonnier des
« Si vous ne savez pas le genre de personne que je suis
souvenirs humiliants du rejet qu’il avait vécu lors de son enfance. Il habitait un corps défaillant et il était
Et je ne sais pas le genre de personne que vous êtes
le seul représentant d’une philosophie sombre et silencieuse qui trouvait un écho chez pratiquement tous
Il se peut que le chemin tracé par d’autres triomphe sur ce monde
ceux qui furent confrontés à son travail. Les efforts créatifs de Hopper mettaient en exergue des éléments
Et il est probable qu’en rendant hommage à un dieu erroné nous
de l’art américain qui avaient été tus et oubliés. Ils représentaient également les courants artistiques à
perdions notre étoile. »
venir. Son travail est autobiographique. Edward Hopper et sa femme, Josephine – tous ceux qui les connaissaient les pensaient indissociables et ils le restèrent par conséquent dans l’histoire de l’art – furent mariés quarante-trois
Extrait tiré de A Ritual to Read to Each Other — William Edgar Stafford, 1914-1993
ans. Il mesurait un mètre quatre-vingt-quinze tandis qu’elle dépassait à peine le mètre cinquantequatre. Elle avait les cheveux roux de la couleur du cuivre. Toute leur vie fut pratiquement consacrée à l’art de Hopper. Josephine Nivison Hopper avait également un talent artistique modeste. Grâce à ses contacts, elle aida Hopper à exposer ses premières aquarelles. Néanmoins, dans l’univers de Hopper, il n’y avait de place que pour un seul artiste – lui, le soleil au centre de tout. Elle réussit pourtant à s’immiscer dans son monde égocentrique. Après leur mariage, sauf rares exceptions, les seules femmes qui apparaissaient dans les quelques tableaux de Hopper à thème féminin furent inspirées par la silhouette nue ou costumée de Jo. Mis à part la pose, elle commença dès 1933 à tenir un journal extrêmement intime sur leur vie commune ainsi qu’un livre de registre détaillé sur le travail de Hopper : taille, marque des peintures utilisées, peinture sur toile ou sur papier, peinture à l’huile ou à l’aquarelle, galerie accueillant l’œuvre et prix de vente – incluant la déduction des 33% de commission pour la galerie. Avec sa propre carrière d’artiste en lambeaux et écrasée par le poids de l’ombre créative et de l’indifférence de Hopper, elle établit un lien avec lui et devint son assistante, sa diariste, son laquais, son manager, son jongleur financier et son coach en matière de création. Goutte à goutte, le flot constant de ses encouragements volubiles eut raison des blocages, de l’incapacité de travailler et des dépressions caverneuses de Hopper. Elle savait néanmoins le mettre également hors de lui puis lui retourner le couteau de la culpabilité dans la plaie. Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû arrêter de rappeler à sa femme son statut de deuxième classe, que ce soit dans le ménage et en tant qu’artiste. Ils s’éclaboussaient mutuellement avec un dédain acide. Ils s’aiguillonnaient avec préméditation puis se battaient jusqu’au sang, tant physiquement qu’émotionnellement. Leur dépendance mutuelle persista néanmoins. Edward et Jo vécurent également de bons moments ensemble lorsqu’ils voyagèrent sur la côte Est des Etats-Unis dans les années 1920, s’arrêtant çà et là pour élaborer des esquisses et des aquarelles. Ils se lièrent d’amitié avec les personnes qui possédaient les maisons, les bateaux et les lieux qu’Edward dessinait et peignait. Ils marchèrent ensemble le long des rues de New York où ils avaient fait leurs études et ils firent partie du monde artistique de Greenwich Village. Des années 1920 jusqu’aux années 1960, ils embrassèrent tous les deux le mouvement réaliste d’art américain pendant que d’autres peintres et d’autres sculpteurs montaient au sommet puis en redescendaient. Hopper demeura solide comme un rocher parmi le chaos qui accueillit puis rejeta les impressionnistes, qui rejeta puis adula les expressionnistes, les surréalistes et autres « –istes » qui remontaient à la surface. Le travail de Hopper, en revanche, n’eut besoin d’aucun programme,
1. Autoportrait (Self-Portrait), 1903-1906.
n’appartint à aucune école. L’artiste n’eut besoin d’aucune signature et la valeur de son art ne
Huile sur toile, 65,8 x 55,8 cm.
chuta jamais. Semblable à la réussite financière que représentaient des artistes comme Alexander
Whitney Museum of American Art, New York,
Calder et Pablo Picasso, une fois que Hopper trouva son propre rythme créatif, ses tableaux et ses
legs de Josephine N. Hopper.
7
esquisses trouvèrent toujours acheteurs. Le monde de Hopper, en deux dimensions, se suffisait à lui-même avec ses compositions de collines, de bateaux et de maisons introspectives et solitaires qui, sous le talent du peintre, devenaient une collection songeuse d’allégories apparentes représentant une distribution silencieuse de personnages vierges, porteurs d’une histoire à accomplir, d’une histoire achevée et enfouie dans l’oubli ou bien alors en attente d’un événement qui allait changer leur existence. De sa naissance à Nyack (New York) en 1882, à sa mort à l’âge de quatre-vingt-cinq ans assis sur sa chaise dans l’appartement de New York où il habita pendant cinquante ans, Hopper passa huit décennies de sa vie à la poursuite de la lumière et de l’ombre. Il maîtrisa la représentation de nos vies et de notre environnement à travers ces deux pôles opposés. C’est grâce à Josephine, sa future secrétaire intimidée et constamment affairée à ses côtés, que nous avons aujourd’hui une petite fenêtre, qui permet de percevoir l’intérieur du monde solitaire de Hopper. Le voyage vers son intimité est une expérience riche à travers la découverte de son monde artistique et douloureux, à travers son abnégation massive. Le voyage dans la vie de Hopper nous montre l’évolution de l’artiste et son talent technique, puis nous mène à travers un labyrinthe schizophrénique qui serpente entre la rentabilité et le succès artistique, auquel vient s’ajouter une soif de reconnaissance marquée par une haine de soi. Tout cela pour figurer enfin, une fois son âge avancé, parmi les hommes immortels des beaux-arts. Beaucoup d’écrivains ont déjà fait ce voyage et je leur suis reconnaissant pour leurs découvertes et pour leur érudition. Je voudrais remercier également les musées et les institutions qui exposent le travail de Hopper et qui archivent les documents accumulés tout au long de sa vie. Je dois également beaucoup aux années que j’ai passées comme étudiant à la School of the Art Institute of Chicago où, pinceau à la main, j’ai dû livrer un combat solitaire contre mes propres démons. Je traversais tous les jours des galeries pour aller en cours. Tous les jours, je marchais devant le Oiseaux de nuit (pp.198-199) de Hopper et tous les jours, lorsque mon esprit n’était pas occupé par les préoccupations insignifiantes de la jeunesse, je sentais que mes possibilités d’atteindre le succès en tant que peintre étaient de plus en plus lointaines. Ce fut seulement plus tard que je découvris que cet art est supposé être douloureux lorsqu’on le pratique bien. Suivre la carrière tortueuse de Hopper réveille des souvenirs longtemps endormis. Chaque écrivain qui passe par cette expérience présente un Hopper légèrement différent. Bien que sa vie soit connue, que ses fréquentations aient été documentées, que l’on ait vérifié les événements et les dates importants de sa vie et bien que la totalité de son travail ait été catalogué, ce qui émerge reste toujours une énigme. Hopper, l’homme et l’artiste, est en effet une boîte énigmatique aux nombreux compartiments cachés et aux panneaux coulissants. A l’intérieur de cet espace profond et secret, il est possible de trouver une pierre de Rosette, un « Rosebud », une clef qui permettrait de comprendre le fonctionnement de cet homme. Puisque le seul chemin pour découvrir un artiste créatif réside dans la découverte des traces que ce dernier laissa derrière lui et qu’il choisit de révéler, les traces et les choix dispersés par Hopper invitent les écrivains curieux à mettre des chaussures de marche confortables et à s’engager sur le chemin. — Gerr y Souter Arlington Heights, Illinois « Personne ne peut prévoir exactement quelle direction l’art prendra dans les années à venir, cependant, du moins je le pense, il est possible qu’il y ait un rejet total de ce qui consisterait à inventer une conception arbitraire et st ylisé de l’art. Il y aura, je pense, une tentative de saisir à nouveau le caractère surprenant et accidentel de l a nature, ainsi qu’une analyse plus intime et plus compréhensive de ses 2. Jo en train de peindre (Jo Painting), 1936. Huile sur toile, 46,3 x 41,3 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
8
humeurs, avec un émerveillement et une humilité renouvelés de l a part de ceux qui sont encore capables d’avoir ces réactions fondamentales. »1 — Edward Hopper, 1933 Notes sur la peinture (extrait)
E
MERGENCE
–
UN MONDE
D’OBSCURITE ET DE LUMIERE
12
L
e 22 juillet 1882, Edward Hopper naquit dans la ville moyenne et prospère de Nyack (New York), sur le fleuve Hudson. Sa mère, Elizabeth Griffiths Smith Hopper était d’origine anglaise et galloise, alors que son père, Henry Hopper, avait des générations d’ancêtres anglais et
hollandais. Son père tenta sa chance dans le domaine de la vente et il finit par ouvrir un magasin d’articles de mercerie qui ne connut pas un grand succès. Edward était le deuxième enfant de la famille, arrivant deux années après sa sœur Marion.
« Mon dessein, dans la peinture, a toujours été de rendre la reproduction la plus exacte possible de mes impressions les plus intimes relatives à la nature. Si cet objectif est réalisable, on peut dire de la même manière que l’homme peut atteindre la perfection dans tout autre idéal de peinture ou dans toute autre activité humaine. »
Pendant que le père de Hopper peinait parmi les rouleaux de tissu, les boîtes de boutons et les
— Edward Hopper
cols en celluloïd, la mère d’Edward gardait son fils et sa fille à la maison et elle les éduquait en leur faisant découvrir des outils créatifs en rapport avec le théâtre et l’art. Une des possessions les plus chères du jeune Edward était un tableau d’ardoise noire avec sa craie. Il pouvait dessiner et effacer en toute liberté. Malheureusement, tout résultat qui s’avérait particulièrement satisfaisant était réduit à une trace éphémère. Il commença à esquisser et à peindre très tôt, prenant son carnet à dessin avec lui lors de ses marches fréquentes dans la campagne proche. La maison du 82 North Broadway appartenait à la mère veuve d’Elizabeth, Martha Griffiths Smith, et fut l’endroit où Liz et Garrett se marièrent en 1879. C’était une maison blanche à deux étages, avec une ossature en bois. Elle était pleine de coins et recoins, abritée par des arbres et creusée par des fenêtres aux volets fermés qui se cachaient sous des avant-toits décorés par des corniches. Il y avait une véranda posée en angle sur la partie avant de la maison. Pour Edward, cet endroit aux fenêtres sombres qui ne révélaient rien des vies de ceux qui l’habitaient était son chez lui, l’endroit où il pouvait savourer ses moments de solitude et le lieu qui fut son refuge pendant sa tendre enfance. L’image de cette maison apparut plus tard à maintes reprises dans ses tableaux. Le fait que le père de Hopper n’ait pas eu les moyens de transférer sa famille vers une maison dont ils seraient les seuls propriétaires dut affecter l’enfance victorienne d’Edward à une époque où les hommes étaient censés être les seuls à pourvoir aux besoins financiers de la famille. Sa grandmère, madame Smith, possédait la maison mais elle jouissait également d’une suprématie morale dans la communauté, car son père, le révérend Joseph W. Griffiths, avait fondé l’Église Baptiste à Nyack en 1854. Les femmes de la famille Hopper pourvoyaient aux besoins de la famille grâce à leurs rentes et aux paiements hypothécaires de leurs propriétés à Nyack. Edward et sa sœur aînée, Marion, étudièrent dans des écoles privées et rentraient chaque jour dans une maison propre nettoyée par leur bonne irlandaise, une maison où les courses étaient livrées avec d’autres achats faits à crédit en ville. A l’école, les notes de Hopper demeurèrent au-dessus de la moyenne tout au long de ses études secondaires. L’une de ses matières préférées était le français, qu’il étudia et apprit assez bien pour pouvoir le lire. A une époque où la taille moyenne d’un homme ne dépassait pas les 1,76 mètres, le jeune Edward mesurait déjà 1,82 mètres à l’âge de douze ans. Il était tout en bras et en jambes, ce qui lui valut d’être appelé « Grasshopper » (« la sauterelle ») par ses camarades. Il aimait les plaisanteries faites aux dépens des autres et il était souvent mauvais perdant. Beaucoup de ses amis se rappelleraient plus tard son esprit taquineur, un défaut de caractère persistant et agaçant qui le suivit toute sa vie, défaut débordant souvent vers le sadisme à l’âge adulte. Naturellement timide, il scrutait le monde derrière les têtes de ses camarades et finissait toujours au dernier rang dans les
3. Le Louvre et la Seine, 1907. Huile sur toile, 59,8 x 72,7 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
photographies de classe. Hopper passa sa puberté et son adolescence à se promener souvent au bord d’un lac
4. Le Pont Royal, 1909.
abondamment couvert de glace en hiver. Il esquissait les gens, les bateaux et les paysages. La
Huile sur toile, 60,9 x 73,6 cm.
construction de yachts prospéra à Nyack et les quais situés le long de la rivière devinrent l’un des
Whitney Museum of American Art, New York,
coins préférés d’Edward et de ses amis. Ils formèrent le Boys Yacht Club et ils apprirent à piloter leurs
legs de Josephine N. Hopper.
13
5. Bateau-Mouche (River Boat), 1909. Huile sur toile, 96,3 x 122,2 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
14
voiliers en atteignant divers degrés de compétence. De ce passé, Edward garda en lui un amour des bateaux et de la mer qui l’accompagnera toute sa vie. Le chemin de fer apparut également à cette époque, tout comme l’électricité et les rues pavées. Cela changea le visage de la ville, générant plus de circulation, la création de petites entreprises et l’arrivée d’une population d’immigrants majoritairement irlandais. Les maisons élégantes de l’époque victorienne situées le long du fleuve Hudson appartenaient aux riches barons industriels dont les ancêtres hollandais avaient accumulé des fortunes. Le monde de Hopper à la fin du XIXe siècle était celui, idyllique, d’un jeune garçon. L’éducation religieuse de Hopper à la Baptist Bible School allait à l’encontre des libertés convoitées à l’adolescence. Il avait baigné dans un enseignement qui prônait la vertu d’un style de vie austère et la nécessité de s’éloigner des satisfactions de la concupiscence, de la sexualité et d’un comportement immoral. Les baptistes croyaient fortement à l’efficacité de la trique pour punir les cas de mauvaise conduite, mais il semblerait qu’Edward fut rarement puni pour ses bêtises. C’était un jeune prince, un garçon talentueux et intouchable. Pourtant, sa personnalité devint introvertie comme s’il était gêné par son statut social ambigu : fils d’un père de classe moyenne englouti par la réussite bourgeoise du clan matriarcal des Smith. Sa méfiance et son habitude de se réfugier dans de longs silences évoluèrent plus tard vers des périodes de dépression qui étaient suscitées par l’inadéquation entre l’idée qu’il se faisait de ses compétences et la réalité ou bien alors parce que la carapace de son ego ne l’aidait plus à défendre ses ambitions. Il avait, déjà à cette époque, développé un masque placide qui servait à cacher les démons de l’inadaptation qui caractériserait plus tard sa carrière. S’il existe un héritage que Garrett Hopper laissa à son fils, ce fut l’amour de la lecture. Pendant que le père de Hopper essayait de se retrouver parmi ses livres d’affaires et sa comptabilité, Edward passait son temps dans la bibliothèque de la maison où les étagères croulaient sous le poids des livres de littérature classique anglaise, française et russe. De grands changements sociaux étaient en train d’avoir lieu pendant les Joyeuses Années 1890 et la rigueur religieuse victorienne avait été remplacée par la libre-pensée de l’époque d’Edouard VII. En lisant Tourgeniev, Hugo ou Tolstoï, Edward fuyait vers les livres pour apprendre à nommer les sensations qu’il ressentait mais ne pouvait dévoiler. Il utilisa la passion studieuse de son père comme un refuge. Il choisissait la plupart de ses amis dans les livres et non pas dans la vie. Leurs phrases – souvent lues à haute voix – devenant ainsi sa propre pensée. En 1895, le talent naturel de Hopper était devenu évident dans ses peintures à l’huile techniquement bien exécutées. Il représentait avec soin les détails dans ses dessins minutieux des bateaux de la marine et le gréement si longtemps étudié des yachts de course qui avaient été construits dans les chantiers navals de Nyack. Il eut tendance à retourner périodiquement vers la mer et ses plages tout au cours de sa vie. Il retournait continuellement vers le grand ciel redessiné en blanc sur bleu, allant de la couleur pâlissante de l’opale à un ton céruléen dangereux, vers les rochers en forme de ressac devant de longs balayages de dunes couronnées par de l’herbe bruissante. En 1899, il avait fini l’école secondaire et il se tourna vers la grande ville près du Hudson, vers le Center of American Art. La mère de Hopper s’assura qu’Edward et Marion soient confrontés à l’art à travers des livres, des revues, des documents et des illustrations. Elle dépensa une somme considérable en crayons, peintures, craies, cahiers de dessin, papiers d’aquarelle, pinceaux et stylos à encre. Alors que Marion préféra poursuivre l’apprentissage de l’art dramatique, Edward apprit diverses techniques artistiques, 6. Ile Saint-Louis, 1909.
16
observant comment la lumière ajoutait ou enlevait des dimensions aux objets et comment les lignes
Huile sur toile, 59,6 x 72,8 cm.
composaient des formes ou comment elles guidaient le regard du spectateur. Il commença son
Whitney Museum of American Art, New York,
apprentissage en faisant des copies de couvertures d’hebdomadaires, créées par les grands
legs de Josephine N. Hopper.
illustrateurs de l’époque : Edwin Austin Abbey, Charles Dana Gibson, Gilbert Gaul, et des esquisses
17
18
des anciens maîtres : Rembrandt et Jean-Auguste-Dominique Ingres. Hopper absorba tout leur raffinement mais il garda toujours un sens de l’humour, propre à lui, qui lui servait de soupape pour pouvoir parfois vider la pression que ses grands espoirs lui faisaient ressentir. Il continua longtemps à produire des caricatures et des dessins satiriques bien que l’âge et la vie aient endurci son visage. Ces dessins exprimaient souvent des émotions profondes, balayées avec humour comme pour ne pas attirer l’attention envers l’homme qui tenait le crayon. Avec l’approbation de son père et l’encouragement artistique de sa mère, il décida de poursuivre des études d’illustrateur commercial et s’inscrit à la New York School of Illustrating. Le début du siècle connut une « période dorée » pour l’illustration de revues et la création d’affiches. Les mécanismes d’imprimerie avaient rejoint la méthode photographique qui consistait à transférer le dessin fini sur une plaque d’impression en utilisant un écran en simili. Cette façon de réduire l’illustration à une série de points offrait une plus grande flexibilité car elle permettait de créer des documents de toutes tailles, adaptées à toute dimension de page ou à tout besoin de cadrage. La liberté d’employer différents moyens donnait à l’artiste une vaste liberté de production. Cette profusion de revues, d’annonces, d’affiches et d’histoires à illustrer fit que les bons illustrateurs qui respectaient les dates limites et qui avaient une facilité à capter l’idée fondamentale souhaitée pour l’image demandée était très sollicités. L’illustration générait de bons revenus. Les publications et les corporations qui associaient leur nom au travail de ces illustrateurs prisaient les artistes qui étaient les plus reconnus. C’était un monde d’hommes. Malgré leur talent, les femmes étaient rarement admises dans les écoles d’illustration. L’énergie créative des femmes était plutôt censée être appliquée à élever des enfants heureux et sages et à tenir une vie domestique convenable pour leur mari respectif. L’art féminin était considéré comme un passetemps, un amusement passager, une excuse pour avoir les mains occupées. Edward était en accord avec cette vision. Inscrit sur une base mensuelle, il faisait le trajet quotidiennement de Nyack à New York, travaillant dans la salle de classe et à la maison sur des feuilles d’entraînement conçues par le doyen de l’école, Charles Hope Provost. Ses feuilles d’entraînement à apprendre par cœur avaient été originellement conçues comme une aide à l’enseignement par correspondance, destinées au public le plus large possible, des talents en devenir, afin de rassembler le plus de frais de scolarité possibles. Hopper avait déjà passé du temps, après avoir fini ses études secondaires, à copier les illustrations de ses artistes préférés et à produire des croquis originaux de personnages et de scènes issues de la littérature. Après une année d’instruction peu approfondie auprès du doyen, Hopper éleva ses objectifs et décida d’entamer des études d’art et d’illustration commerciale. Ses parents consentirent à contribuer à ses frais de scolarité avec quinze dollars mensuels et en 1900, son portfolio impressionnant lui valut d’être accepté à la New York School of Art que dirigeait William Merritt Chase. Chase était le produit du système académique européen du XIXe siècle. Il était originaire de Williamsburg, dans l’Indiana. Ayant été une jeune promesse artistique, il avait réussi à trouver une clientèle locale assez nombreuse à Saint-Louis pour pouvoir se payer des études en Europe. Ses efforts lui permirent d’intégrer l’Académie royale de Munich en 1872. Son retour aux Etats-Unis dans les années 1870 suscita chez les critiques d’art, et chez les pronostiqueurs des tendances futures, la quasi-certitude que ce jeune homme deviendrait l’un des plus grands peintres de l’Amérique. Ils allaient pourtant être déçus. Le style de Chase se retranchait dans le réalisme européen et ses sujets manquaient d’authenticité américaine. Lorsque le réalisme pur et dur si en vogue en Amérique pendant le XIXe siècle devint désuet et commença à être remplacé par des représentations plus fictives et enjouées,
7. Après-Midi de juin ou L’Après-Midi de printemps, 1907.
Chase devint un « flâneur », terme désignant quelqu’un qui regarde la vie de manière détachée.
Huile sur toile, 59,7 x 73 cm.
Chase peignait la vie, mais une vie morale, édifiante et civilisée qui plaisait aux acheteurs d’art de
Whitney Museum of American Art, New York,
l’aristocratie et aux étudiants des beaux-arts soucieux de vendre leurs tableaux. Ses leçons de
legs de Josephine N. Hopper. 19
composition et sa technique irréprochable s’avérèrent précieuses pour beaucoup de ses élèves qui l’ont par la suite dépassé et même éclipsé : Marsden Hartley, Charles Demuth, Georgia O’Keeffe et Edward Hopper. Un autre instructeur qui croisa la route de Hopper fut le jeune Kenneth Hayes Miller. Tout en enseignant à l’école de New York, Miller développait son style de peinture qui mûrit dans les débuts des années 1920. Ses tableaux urbains luxuriants furent décrits par un critique contemporain comme « une tentative de rendre Titien à l’aise sur la 14th Street et de faire entrer Véronèse dans un grand magasin »2. Il suivait également la tradition des courants du XIXe siècle en donnant du poids et de la substance à ses personnages, utilisant une technique qui consistait à accumuler plusieurs couches de pigment en empâtement sous des glacis de couleur. Edward préférait la prédilection de Miller pour des sujets qui traitaient de la réalité urbaine, plutôt que les sujets de Chase, plus raffinés et toujours enracinés dans les tendances académiques européennes. Lorsque le jeune Edward se levait chaque jour à Nyack pour prendre le train à Hoboken puis faire le voyage en ferry jusqu’à New York, il était déjà un talent brut, autochtone et pratiquement autodidacte, à la recherche de sa voie. Ce talent le fit monter rapidement en tête de classe d’illustration chez Chase. Il connut le plaisir de peindre des modèles costumés ainsi que l’excitation d’appartenir à un groupuscule d’artistes. Ses camarades formaient un groupe de jeunes hommes pleins d’énergie qui ne demandaient qu’à oublier un peu les heures passées à examiner la manière dont une ombre façonne la forme d’une joue ou à analyser comment manier un fusain à la perfection pour suivre la courbe de la cuisse du modèle juste au-dessus du genou. Leur concentration était aussi intense que l’était leur détente. Beaucoup de ces garçons deviendraient plus tard des icônes de l’art américain : George Bellows, Rockwell Kent, Guy Pène du Bois, C. K.« Chat » Chatterton, Walter Tittle et d’autres, tel le poète Vachel Lindsay et l’acteur, Clifton Webb, qui finirent par accepter leur manque de talent pour le dessin pour devenir des icônes du monde des lettres et du théâtre. Les farces de Hopper et ses taquineries étaient conformes à cette ambiance mâle. Son humour sec faisait irruption par éclats et il laissa sa marque sur ceux qu’il touchait. Sa timidité, exprimée par une grande réserve, commença à disparaître au fur et à mesure qu’il se sentit plus à l’aise dans les ateliers crasseux où les étudiants grattaient leurs palettes pour les nettoyer à la fin de la journée, laissant des taches colorées sur les murs ou sur les vieux chevalets rangés les uns sur les autres. Il y avait également les « odeurs » de l’art : le graphite, les gommes usées, la poussière de craie, le fusain, l’huile de lin, la colle, le durcisseur, les châssis fabriqués en bois brut et la toile tendue comme une peau de tambour, l’odeur piquante de la transpiration et de la térébenthine, les pinceaux de soie et les crayons, le vernis et la céruse. Les miettes séchées et les restes pulvérisés trouvaient leur chemin vers le fond des fissures des chevalets, des escabeaux et des chaises renversées qui avaient été utilisées comme chevalets. On trouvait des gouttes de peinture sèches sur les tabliers, les blouses et les chaussures tachées. Cette preuve tangible de l’activité créative était un stimulant qui aidait l’esprit à se concentrer et qui calmait la main vacillante du petit matin. Ayant pour objectif d’en faire son gagne-pain, Hopper devait encore parfaire son apprentissage de l’illustration commerciale et connaître ses débouchés. Ses études comprenaient des cours avec les illustrateurs Arthur Keller et Franck Vincent DuMond. Il admirait toujours les grands illustrateurs commerciaux de son temps et leur capacité à capturer la vie sur une page. Au tournant du siècle, l’impressionnisme avait englouti l’Europe avec la transparence et la luminosité caractéristique des peintres tels que Monet, Seurat et Pissarro. Degas contrastait avec les 8. Les Lavoirs à pont Royal, 1907.
20
formes substantielles de Manet, Van Gogh et Cézanne. Chase envoyait Hopper et ses camarades au
Huile sur toile, 74,9 x 88,3 x 4,4 cm (cadre).
Metropolitan Museum of Art pour étudier Edouard Manet, tout comme le faisait une autre personne
Whitney Museum of American Art, New York,
qui eut une grande influence sur Hopper, Robert Henri, lequel commença à enseigner à la New York
legs de Josephine N. Hopper.
School of Art en 1902.
21
9. Ecluse de la Monnaie, 1909. Huile sur toile, 60,3 x 73,2 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper. 23
24
Henri étudia en France avec le technicien habile et le maître de l’allégorie romantique : William Adolphe Bouguereau. Henri passa rapidement du style trompe-l’œil méticuleux à une technique plus relâchée et à un coup de pinceau plus large qui caractérisait les post-impressionnistes. En tant qu’enseignant, il chercha à créer une approche de l’art plus complète en incorporant la lecture et la discussion d’œuvres d’écrivains dans ses cours de dessin. Hopper, lecteur chronique, fut captivé par la variété des intérêts artistiques d’Henri. Là où Chase prêchait de faire de l’art pour l’art, Henri faisait de l’art la base même de l’existence. « Le cours d’Henri était l’endroit où les jeunes devenaient rebelles » écrivit Guy du Bois. Vachel Lindsay signala que Henri exigeait à ses étudiants de réaliser des portraits qui dégageraient « …force, similitude et expressivité »3 Les nus de Hopper réalisés sous la tutelle d’Henri entre 1902 et 1904 représentent les modèles comme des formes solides, façonnées par la lumière et par l’ombre, au lieu de les dessiner comme des créatures linéaires flottant à l’intérieur de leur espace. Leur visage n’a pas d’identité, mais l’architecture de chaque corps est solide et leurs surfaces sont façonnées par la lumière qui donne la priorité au poids et à l’individualité sur chaque plan. L’une après l’autre, Hopper réalisa ses études et, l’une après l’autre, elles recevaient une marque rouge d’Henri en signe d’approbation. En 1905, Hopper avait déjà rejeté les natures mortes de Chase et ses conférences prétentieuses où il faisait étalage de ses connaissances à toute la classe devant un triste chevalet d’étudiant. Henri parlait personnellement à chaque artiste, susurrant des mots à leur oreille. Sa manière d’inciter les élèves à regarder au-delà des limites de l’atelier et à observer leur propre monde a inspiré certains des travaux les plus prophétiques de Hopper entre 1904 et 1906. Ses compositions verticales d’instantanés de scènes champêtres laissent présager l’approche minimaliste qui caractériserait le travail de Hopper dans le futur. Il utilisait le contraste entre la lumière et les ombres profondes pour modeler les masses et il adoucissait le tout avec des détails censés attirer l’œil. Ses tableaux manquaient cependant encore de maturité qu’il atteindrait plus tard. Robert Henri critiquait le travail de ses élèves dans un style particulier et intense. Il poussait les artistes à utiliser autant leur intellect que leurs pinceaux et leurs peintures. Il sanctionnait impitoyablement les tentatives infructueuses de ses élèves en les maculant d’une croix faite de deux coups de pinceau rageurs. Cette attitude motivait ses élèves à rechercher son approbation et à lui donner plus d’importance. En ce qui concerne les compétences artistiques d’Henri, Hopper était plutôt avare de compliments : « Henri n’était pas un très bon peintre, du moins je ne crois pas qu’il l’était. Il était meilleur comme enseignant. »4 Hopper devint un étudiant phare, obtenant une bourse pour étudier le dessin. Il obtint également le premier prix de peinture à l’huile lors d’un concours à l’école. Ces prix l’encouragèrent à poursuivre son éducation artistique en 1903 et en 1904, et son talent lui permit de gravir plusieurs échelons d’un coup, devenant rapidement l’enseignant des cours du samedi en dessin, en composition, en esquisse et en peinture. En 1905, le jeune Edward Hopper ressemblait à ses propres autoportraits (p.6) : ses yeux bleus profonds ombragés par des sourcils sans concession chutaient vers un nez bien dessiné et bien proportionné. Sa bouche, cependant, commençait déjà à raconter son histoire. C’était une bouche irascible, large et étirée avec une lèvre supérieure mince qui s’appuyait contre une lèvre basse insistante et exigeante. Son regard sur lui-même était peu flatteur et il se représenta sur la toile de manière implacable. Sa nature, inquiète et inexorable, le poussa vers différentes activités. Il commença à accepter des emplois d’illustration commerciale à temps partiel à l’agence C. C. Phillips and Company Advertising Agency pour gagner de l’argent. L’étudiant Coles Phillips avait fondé cette agence qui fonctionna pendant une année puis ferma. Coles reprit un travail
10. Le Parc de Saint-Cloud, 1907.
d’illustrateur indépendant. Hopper produisit quelques œuvres commerciales, mais son cœur n’y était
Huile sur toile, 74 x 86,7 x 2,5 cm (cadre).
pas. Il avait été étudiant et avait accumulé pendant sept ans un ensemble considérable de
Whitney Museum of American Art, New York,
connaissances qui avaient maintenant besoin d’être appliquées. Il avait apprécié l’instruction et les
legs de Josephine N. Hopper. 25
compliments de ses enseignants qui étaient, eux, les opposés. Bien que sa méthode s’améliorât et se peaufinât grâce à la pratique de différentes techniques, sa manière de penser l’art fut profondément affectée. Il eut besoin de savoir si sa propre personnalité et son expérience pourraient être exprimées par la peinture et trouver un public. Il cherchait comment assouvir son désir d’être un grand artiste tout en s’adonnant à un travail de création motivant. Il voulait devenir un peintre dans tous les sens du terme.
Paris, les impressionnistes et le grand amour En octobre 1906, il prit la route la plus courue par les artistes de l’époque, la route de Paris, le sanctuaire culturel du monde. A l’âge de vingt-quatre ans, le grand garçon de Nyack (New York) fit un saut pour « voir l’éléphant ». Au même moment où Hopper s’embarquait pour la capitale française, Paul Cézanne décédait, et le travail de ce dernier n’attira le public que quelques années après. Du groupe puissant des peintres impressionnistes et post-impressionnistes qui avait tenu les rênes du monde de l’art, il ne restait plus qu’Edgar Degas. Il habitait à Paris, pratiquement aveugle, et créait des sculptures en argile par le toucher. Le public l’ignora jusqu’après sa mort, en 1917. Mais Paris était devenu le rendez-vous de jeunes hommes – et de quelques jeunes femmes déterminées – et ils encombrèrent les rives de la Seine et ses ponts, le Quartier latin et Montparnasse avec leurs boîtes de peinture et leurs chevalets pliés. Ils se réunissaient aux tables du Dôme et du Moulin Rouge. Les prostituées prospéraient. Les proxénètes s’épanouissaient et beaucoup de jeunes artistes échangeaient leur talent pour un peu de vin et d’absinthe bon marché. S’appuyant sur les dossiers des chaises métalliques, ils se rassemblaient autour des tables de café, couvertes de verres et de petites soucoupes qui salissaient les nappes en papier, déjà gribouillées avec des dessins voués à disparaître. Les automobiles avançaient sur leurs roues à rayons en faisant des « pan » et des « teuf-teuf » ; elles s’annonçaient aux croisements en klaxonnant. La fumée des tuyaux d’échappement et l’odeur de l’huile de ricin brûlée s’ajoutaient à l’odeur du bois et du charbon brûlé dont la fumée sortait par les cheminées pour rejoindre les miasmes qui surplombaient la ville. Le crottin salissait les rues. Les urinoirs et les chariots des eaux usées contribuaient à alourdir l’odeur ambiante le matin, couvrant presque l’arôme des baguettes fraîches qui circulaient rapidement dans les charrettes des boulangeries vers les restaurants pour être mangées, avant qu’elles ne soient devenues dures et bonnes à donner à picorer aux oiseaux. Paris était un bouillonnement plein d’action. Les odeurs et la grandiose architecture s’enrichissaient d’îlots de lieux de loisirs où le temps semblait s’arrêter. Tout Américain avec un désir de réussite exacerbé devait se sentir totalement étranger à cette ambiance. Le 24 octobre, Edward Hopper arriva dans une église baptiste au 48 rue de Lille, appelée Eglise Evangélique Baptiste et tenue par madame Louis Jammes, une veuve qui vivait avec ses deux fils adolescents. La famille Hopper à New York l’avait connue par l’intermédiaire de leur église. Dès que cela fut possible, Edward appliqua une base de plâtre sur quelques panneaux de bois de 38 x 48 cm et se mit au travail avec ses peintures et ses pinceaux. Les couleurs dans sa boîte reflétaient les tons plus sombres qu’il avait utilisés pour travailler sous la tutelle d’Henri à New York : terre d’ombre, terre de Sienne, marron, gris, beige, et un bleu céruléen. Son œil recherchait la juxtaposition de formes géométriques. Les rayons de lumière qui tombaient sur les surfaces qu’il observait donnaient de la 11. Arbres dans la lumière, parc de Saint-Cloud (Trees in Sunlight, Parc de Saint-Cloud), 1907.
26
profondeur aux images et révélaient son imagination dynamique. Il représentait sur la toile des espaces déserts qui donnaient l’impression que quelqu’un venait juste de s’éloigner de la fenêtre, ou
Huile sur toile, 59,7 x 73 cm.
que le dernier membre d’une foule venait tout juste de passer sur un pont qui apparaissait tout à
Whitney Museum of American Art, New York,
coup solitaire. Après avoir passé plusieurs années à dessiner des modèles à l’école et à représenter
legs de Josephine N. Hopper.
de jeunes gens gais dans ses illustrations commerciales, les êtres humains disparurent du travail de
27
12. Le Pont des Arts, 1907. Huile sur toile, 59,5 x 73 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
28
30
Hopper, sauf comme objets compositionnels lointains, devenant de simples taches de peinture ou des objets à forme humanoïde. Il travaillait différentes techniques de manière équilibrée, produisant parfois des tableaux à l’huile, d’autres fois des esquisses des habitants des rues de Paris, créant une collection de caricatures en aquarelle du demi-monde et des profondeurs extrêmes de la société française. Ce genre de personnages ne lui était pas étranger. Lorsqu’il étudiait, il louait un petit atelier sur la 14th Street. Les prostituées tournaient dans ce secteur avec insouciance. Dans les lettres qu’il envoyait en Amérique, il mentionnait la grâce des femmes françaises et l’apparence rabougrie des hommes. Après le chaos et la saleté de la ville new-yorkaise, Paris lui semblait propre et accueillante. Habillé avec un costume fait sur mesure, chemise, cravate et portant un canotier dès que le temps le permettait, il passait la majeure partie de son temps à se balader dans les parcs, à descendre les chemins bordés des arbres du jardin des Tuileries, écoutant les musiciens jouer sur les belvédères et regardant les enfants faire naviguer leurs bateaux dans le bassin. Alors que la vie des Hopper en Amérique était d’un calme superficiel et qu’ils considéraient l’affichage des émotions en public comme un comportement inapproprié, Paris dut paraître au jeune artiste réprimé une caverne d’Ali Baba. Hopper avait peu d’attirance pour les cafés de trottoir célèbres du boulevard Montparnasse et du boulevard Saint-Germain. Comme le dit Patricia Wells, journaliste au New York Times, « …pour les français, un café est une extension de leur salle de séjour, il s’agit d’un endroit pour commencer et terminer la journée, pour bavarder et pour débattre, un endroit pour voir et être vu. Il y a longtemps que les Parisiens ont élevé à un véritable art le penchant humain pour ne rien faire. »5 Lors de certains salons célèbres de Gertrude Stein, Hopper put s’asseoir à côté de la vieille garde et de l’avant-garde : des romanciers, des peintres, des sculpteurs, des poètes et de riches expatriés selon l’occasion et la saison. « Je n’étais pas assez important pour qu’elle me connaisse » dit-il plus tard lors d’une interview. Quelques étudiants des Beaux-Arts de New York étaient déjà à Paris et ils l’aidèrent à explorer la capitale française. Patrick Henry Bruce et sa nouvelle femme étaient particulièrement serviables. Ils s’assurèrent qu’il appréciât le travail des peintres impressionnistes qui avaient percé vingt ans plus tôt : Pissarro, Renoir, Sisley, Monet et Cézanne. Hopper aimait l’œuvre de Pissarro mais pas celle de Cézanne, car il trouvait que le travail du peintre « manquait de substance ». Bruce et les autres artistes qui habitaient dans la résidence accompagnèrent l’initié dans son parcours des galeries où les tableaux de ces maîtres figuraient brillamment sur les murs. Il put apprécier la collection Gustave de Caillebotte au Palais du Luxembourg où l’artiste avait récupéré des tableaux autrefois condamnés à disparaître. Avec l’arrivée du printemps et de la pluie qui purifiait le ciel et formait des flaques d’eau dans les rues de Paris, Hopper remarqua une luminosité soudaine dans la ville. Il observa la lumière qui baignait les ombres tout d’un coup et combien les bâtiments de pierre semblaient briller. Les petites études d’huile sur planche qu’il réalisait à New York dans des tons ocre furent mises de côté et le soleil imprégna soudain sa création. Il peignit une série de tableaux de 60,3 x 73,2 cm représentant des scènes d’un Paris et d’une banlieue inondés de lumière. Il longeait la Seine et les canaux voisins où les bateaux de lavage (offrant des services de lessive) créaient des embouteillages pour attirer les clients. Dans Le Louvre et la Seine (p.10), le grand musée apparaît, doré, derrière deux bateaux de lavage à quai sur la Seine. Les pelouses en terrasse du parc de Saint-Cloud sont représentées par des couches épaisses de couleur jaune vert, transpercées par des troncs d’arbre qui montent vers un empâtement épais qui représente un ciel chaud. Il utilisa une palette caractéristique de l’impressionnisme lorsqu’il produisit Arbres dans la lumière
13. Le Quai des Grands Augustins, 1909. Huile sur toile, 59,7 x 72,4 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
14. Claude Monet, Le Pont de l’Europe, gare Saint-Lazare, 1877.
(p.27), Parc de Saint-Cloud (p.24) au même parc de Saint-Cloud. Son coup de pinceau, bref à
Huile sur toile, 64 x 80 cm.
certains endroits, se convertit plus haut en taches mouvementées d’alizarine puis se mélange à du
Musée Marmottan, Paris. 31
blanc zinc. Les arbres deviennent des entailles et des grands coups de pinceau verticaux de vert thalo et de jaune cadmium. Le peintre d’intérieur disparut lorsqu’il commença à s’attaquer à des sujets illuminés par la lumière naturelle du soleil, lorsqu’il commença à peindre la vie. La nature floue des huiles et des aquarelles de son époque parisienne semblait bouillonner avec une géométrie architecturale qui montrait un style en plein développement, comme s’il avait laissé les impressionnistes s’exprimer à travers lui. Tristement, la nature très européenne de ses sujets et la façon de les traiter ne correspondaient pas au réalisme pur qui redevenait à la mode aux Etats-Unis. En 1907, il était déjà très à l’aise à Paris, comme l’indique une lettre de madame Jammes aux parents de Hopper. Il était un véritable « fils à maman », s’adonnant à des amusements sains et négligeant le monde bohémien des artistes. Ce fut alors qu’il rencontra le premier vrai amour de sa vie. Son nom était Enid Saies. « Je suis allé dîner d ans une chapelle angl aise… avec une f ille galloise très brill ante. Elle étudie à l a Sorbonne et nous nous sommes considérablement amusés avec le programme du soir composé principalement de chansons sentimentales qui omet taient le son « h ».6 Enid se logeait également chez la veuve Jammes. Ses parents, tout comme ceux d’Edward, étaient très religieux et elle, comme Edward, ne donnait pas beaucoup d’importance à la religion. Enid n’était pas Galloise, mais ses parents, Anglais, étaient les propriétaires d’une maison au Pays de Galles. Elle était très brillante, à l’aise en français et en d’autres langues et elle aimait les livres. Elle eut certainement l’impact d’une explosion sur le monde austère de Hopper. Elle mesurait 1,76 mètres, avait les cheveux bruns et des yeux presque noisette. Hopper tomba certainement sous le charme de son accent britannique, probablement épicé par une touche d’accent gallois, et de son appréciation du sens de l’humour atypique et des habitudes américaines du peintre. Elle avait fini ses études à la Sorbonne et elle se préparait à rentrer en Angleterre l’été suivant. Pire encore, elle avait accepté la proposition en mariage d’un Français qui était de dix ans son aîné. Edward écrivit une lettre à sa mère lui disant qu’il souhaitait prolonger son voyage en profitant du fait qu’il était à Paris pour faire un tour en Europe. Avec le consentement parental – aveuglément donné, et ne sachant pas que son véritable projet était de poursuivre Enid – Hopper fit ses valises et traversa la Manche à Douvres puis prit un train pour Londres. Là-bas, il parcourut tristement la capitale anglaise, trouvant que la Tamise était « boueuse », la ville « miteuse » et que la culture anglaise était en général moins attirante que la française. De manière convenue, il gravit les marches pour visiter la National Gallery et le British Museum. Il écrivit que la nourriture n’égalait pas la qualité de celle qui était servie en France. Rien n’était aussi merveilleux que l’amour qu’il était parti suivre et il fit une dernière tentative pour changer sa situation. Hopper amena Enid dîner en ville. Il s’assit également avec elle dans le jardin de ses parents et, comme elle le dit plus tard à sa fille, Edward lui parla de son amour et de son désir de l’épouser. Elle resta fidèle à son fiancé. Hopper quitta finalement Londres le 19 juillet pour Amsterdam, Haarlem, Berlin et Bruxelles sans ouvrir son sac de pinceaux et de croquis. Lorsqu’il rentra à Paris le 1er août 1907, la ville était quasiment vide car tous les Parisiens essayaient de fuir la canicule. La « ville lumière » lui rappelait trop de souvenirs récents. Le 21 août, il prit un bateau pour les Etats-Unis, soucieux de mettre en pratique ce qu’il avait appris et décidé à se battre pour se faire un nom dans le monde des beaux-arts. Plus tard, Hopper écrivit à Enid et elle lui répondit, déprimée par le spectre de son mariage 15. Le Bistrot ou La Boutique du marchand de vin (Le Bistrot or The Wine Shop), 1909.
32
imminent. Elle rappelait à Edward les bons moments passés ensemble. « J’ai fait un beau gâchis de ma vie en général…oh, je me sens si mal… ».7 S’il s’agissait d’un appel pour qu’Edward vienne à son
Huile sur toile, 59,4 x 72,4 cm.
secours, cet appel resta lettre morte. Il n’était pas habitué au rejet. Elle abandonna finalement son
Whitney Museum of American Art, New York,
prétendant français, épousa un Suédois et éleva quatre enfants. De retour à New York, Edward
legs de Josephine N. Hopper.
Hopper découvrait que le vrai rejet avait plusieurs visages.
33
M
OMENTS DECISIFS
36
La Fuite
S
ans attaches romantiques, Hopper rentra d’Europe plein d’énergie et prêt à voir ses tableaux exposés dans les galeries. Il avait eu jusqu’ici des problèmes personnels provoqués par sa réserve et sa nature timide. Il rejetait certains loisirs qu’il considérait comme des distractions inutiles.
Cependant, le domaine qui ne l’avait jamais déçu était son travail. Il avait passé sept ans à perfectionner
« La seule personne qui m’ait vraiment inf luencé est moi-même. » — Edward Hopper
sa technique, son œil pour la composition et sa main pour l’exécution. L’explosion de lumière et de couleurs qu’il avait découvert en France l’avait éloigné de la palette sombre de Robert Henri qui était également parti à l’étranger, ce qui lui avait valu son succès ultérieur. Aujourd’hui, le moment était venu pour Hopper de tirer profit de son expérience. Ayant besoin de son indépendance sans quitter la ville, il se lança un défi économique : trouver un atelier et de l'argent. Malheureusement, deux mois seulement après son arrivée à New York, le 16 octobre 1907, la tentative de F. Auguste Heinze d’accaparer le marché de la United Copper fut dévoilée. La révélation dévoila un réseau d’administrations complices dans cette affaire. Des banques, des maisons de bourse et des sociétés fiduciaires étaient impliquées. La révélation soudaine de cette affaire de connivence entre banquiers et autres agents provoqua une chute de la bourse au printemps. Les détenteurs de comptes en banque éprouvèrent le besoin pressé de retirer leur argent jusqu’à ce que le problème soit résolu. Les clients se ruaient vers les banques de tout le pays. Aucune banque ne conserve cent pour cent de l’argent de ses clients dans ses caisses et, par conséquent, la hâte des clients à vider leurs comptes provoqua la panique bancaire de 1907. L’économie soudain immobilisée, l’argent et les investissements disponibles s’asséchèrent. Même les classes riches fermaient leur porte-monnaie, lançant un regard aigri sur des investissements qui ne pourraient pas leur garantir de gains. Le monde de l’art vit ses ventes baisser, les commandes furent annulées et les spectacles des « artistes prometteurs » furent reportés « …jusqu’à nouvel ordre ». Hopper n’eut d’autre choix que d’avoir recours à ses compétences comme illustrateur commercial afin de gagner de l’argent et de préserver un semblant d’indépendance vis-à-vis de sa famille. Ces événements provoquèrent sans nul doute le sourire entendu du matriarcat Smith-Hopper à Nyack. Il alla voir immédiatement ses amis de l’école de Beaux-Arts afin de trouver des espaces pour exposer son nouveau travail, juste le temps pour lui de se remettre de ce revers temporaire. Entre-temps, son portfolio artistique lui permit d’obtenir un poste d’illustrateur à la pige à la Sherman & Bryan Agency. Il s‘agissait de créer des annonces pour vendre des canotiers dans un style Art nouveau qui faisait rage à l’époque. Une frise de silhouettes d’hommes en simili en train de bavarder derrière l’image d’un canotier était une image peu innovatrice. Ce travail aida cependant Hopper à faire quelques économies dans le but de repartir rapidement à Paris. Alors que Hopper s’acharnait sur sa planche à dessin publicitaire, son mentor, Robert Henri, continuait à faire parler de lui dans le monde artistique new-yorkais. Pendant que les collectionneurs et les investisseurs s’éloignaient des artistes américains inconnus pour se tourner davantage vers le travail d’artistes européens qui avait plus de valeur – surtout suite à la panique qui avait saisi les marchés financiers américains –, Henri sentait que le talent local avait besoin d’être exposé et que le monde étriqué de l’art académique devait être secoué. En réunissant le travail de ses étudiants et en mettant modestement en veille sa propre célébrité, Henri inaugura le 3 février 1908 une exposition d’artistes
16. Le Pavillon de Flore au printemps (Le Pavillon de Flore in Spring), 1907. Huile sur toile, 60 x 72,4 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
indépendants à la Galerie MacBeth du 450 Fifth Avenue. Outre son propre travail, il présentait les tableaux de John Sloan, Ernest Lawson, George Luks, Everett Shinn, William Glackens, Arthur Davies et Maurice Prendergast.
17. Notre-Dame de Paris, 1907. Huile sur toile, 59,7 x 73 cm.
Les critiques de cette exposition appelée « Les Huit » furent tièdes et le Evening Mail dit des artistes qu’ils étaient voués à « …un avenir qui n’arrivera jamais ». Cette exposition eut cependant de l’impact
Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
et agit au-delà de son intention originale. Ce fut la première exposition sans jury et sans prix qui ait été organisée par un groupe d’artistes. Ce type d’exposition devint le modèle pour l’une des expositions les plus célèbres dans l’histoire de l’art moderne, le « Armory Show » de 1913.
8
Alors que le spectacle d’Henri à la Galerie MacBeth déconcertait les critiques, une autre exposition était en train de s’organiser depuis 1906. Elle s’intitulait Exposition de Tableaux et de Dessins d’Artistes
18. La Vallée de la Seine (Valley of the Seine), 1909. Huile sur toile, 66 x 96,2 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper. 37
Américains Contemporains. Installée au premier étage d’un bâtiment au 43-45 West 42nd Street, l’exposition dura du 9 au 31 mars 1908. Créée par les étudiants de la New York School of Art, Glenn Coleman, Arnold Friedman et Julius Glotz, cette exposition présentait quinze artistes dont l’un d’entre eux était Edward Hopper. Bien que l’exposition dût présenter les dernières tendances dans l’effort de constituer un « art national », Hopper et trois autres artistes exposèrent des tableaux français. Il soumit au public Le Louvre et la Seine (p.12), Le Parc de Saint-Cloud (p.24) et Le Pont des Arts (pp.28-29). Guy du Bois, l’ami d’école de Hopper, exposa Gaité Montparnasse. Il devint le porte-parole du groupe, utilisant ses contacts de presse pour que les critiques diffusent abondamment le succès du groupe. Il gagna l’admiration de Hopper au cours des années qui firent mûrir leur amitié. Ces jeunes peintres américains, avec Luks, Sloan, Glackens et Shinn au centre, avaient enfin trouvé un espace pour s’exprimer. Ils étaient au moins remarqués – même si c’était uniquement pour être ridiculisés. Ils continuèrent à suivre Henri, cherchant des sujets dans le paysage bitumé et urbain de New York et peignant avec la palette sombre des couleurs si chères à Goya, Manet, Velázquez et Frans Hals. Ensemble, ces jeunes rebelles furent mieux connus comme la « Ash Can School » de la peinture américaine. Alors que le réalisme urbain n’était pas un courant nouveau – Chase avait été un réaliste urbain – le groupe prenait comme sujet la classe populaire new-yorkaise, les ruelles, les trains élevés, les rues bondées, les logements et les quais embués. Le sujet et la nature du style de Hopper le séparaient des peintres « Ash Can », trop mornes et citadins. Si les critiques le mentionnaient parfois, son travail était tristement considéré comme « européen ». Il tourna cependant son intérêt vers des scènes plus nationales, créant le Bateau à vapeur (p.46) (il s’agissait en fait d’un bateau britannique qu’il avait vu traverser la Manche), Gare de métro (p.60-61), Train (p.62) et Remorqueur avec cheminée noire (p.47). Sa palette resta dans les couleurs claires et il tomba par la suite en disgrâce auprès d’Henri. Bien que Hopper ait été en désaccord avec lui, il restait cependant attiré par son exemple d’aller à l’étranger chaque été. Dans cette perspective, Hopper évitait les soirées d’ivresse avec les amis ainsi que les dépenses inutiles. Il cultiva une manière de vivre simple qui continuera longtemps, même après avoir connu le succès. En mars 1909, Hopper quitta New York et arriva à Plymouth, en Angleterre, le 17 mars. Il prit ensuite le chemin directement pour Paris via Cherbourg. Il se présenta sans perdre de temps chez madame Jammes à la Mission Baptiste du 48 rue de Lille. Cependant il trouva une situation bien différente de celle qu’il attendait. Madame Jammes était à l’hôpital, prête à mourir, et il lui était par conséquent impossible de le loger. Il fut obligé de payer une chambre d’hôtel jusqu’à ce que sa situation se résolve. Le 28 avril, la propriétaire âgée, qui avait materné Edward pendant son premier séjour en France et qui envoyait des lettres à Nyack parlant du merveilleux « fils à maman », décéda de vieillesse. Les fils de madame Jammes contrôlaient maintenant le sort du logement de Hopper. Il chercha à faire une bonne impression en assistant à son enterrement au cimetière de Courbevoie, et les fils à leur tour, lui permirent de garder la chambre chez leur mère. Edward mentionna le décès de madame Jammes dans une lettre envoyée à des proches, mais seulement comme un obstacle qui l’avait dérangé pour poursuivre ses projets. Il ne perdit pas de temps et se mit à travailler dans les endroits qui lui étaient familiers le long de la 19. Thomas Cole, Vue du mont Holyoke, Northampton,
Seine et dans la campagne française proche de Paris. Pendant ce séjour, sa palette s’approfondit et ses
Massachusetts, après un orage – Le Méandre (View from
coups de pinceau perdirent leur caractère agité et impressionniste. Le Pont Royal (p.12) et Le Pavillon de
Mount Holyoke, Northampton, Massachusetts, after a
Flore ont des structures plus abouties, tout comme Ile Saint-Louis (p.17). Ces trois bâtiments étaient
Thunderstorm – The Oxbow), 1836.
situés au bord de la Seine tranquille. Le Louvre menace dans l’ombre sous un orage qui approche,
Huile sur toile, 130,8 x 193 cm.
reflétant le mauvais temps qui semble marquer son séjour à Paris. Quand le soleil se montrait, Hopper
The Metropolitan Museum of Art, New York,
exploitait l’éclat de sa lumière pour donner une dimension aux murs comme dans le tableau Quais des
donation de Mme Russell Sage.
Grands Augustins (p.30) où ressort le relief des bâtiments lointains. Sa technique devenait de plus en plus solide et il utilisait la peinture à l’huile avec une assurance qu’il
20. Le Pont de Macomb (Macomb’s Dam Bridge), 1935.
40
continua à développer pour atteindre plus tard sa meilleure expression dans ses aquarelles. Ses esquisses
Huile sur toile, 88,9 x 152,9 cm.
de bâtiments, de bateaux et de ponts se caractérisaient par leur justesse, leur minimalisme et une dose
The Brooklyn Museum, Brooklyn, New York,
suffisante de méticulosité. La peinture à l’huile est par nature l’antithèse des illustrations commerciales,
legs de Mary T. Crockcroft.
linéaires et précises. Là où les illustrations sont méticuleuses, la peinture à l’huile révèle une tendance au
41
42
minimalisme qui s’affiche ouvertement. Le mélange dynamique d’angles et de formes qu’il créait pour les couvertures de magazines était absent du concept de simplicité de ses compositions à l’huile. Hopper était devenu maître dans l’art de peindre et de dessiner et il était à la recherche de sa voie. Finalement, le manque d’argent et le mauvais temps lui firent raccourcir sa deuxième visite dans la « ville lumière » et terminer son exploration européenne. Il partit le 31 juillet à bord du bateau à vapeur Ryndam de la ligne Hollande-Amérique et arriva à Hoboken (New Jersey) le 9 août 1909. Une fois de retour à New York, Hopper s’inspira de sa mémoire et de son imagination pour dessiner trois compositions qui avaient pour sujet des images qu’il avait probablement gardées dans son esprit lors de son passage sur le littoral français. Gail Levin, dans sa biographie déterminante sur Hopper9, nota un parallèle révélateur entre la Vallée de la Seine (p.38-39) de Hopper et Le Méandre (p.40) de Thomas Cole (p.40). Il s’agit d’une vue élevée du fleuve Hudson qui fait une boucle, formant une péninsule dans la vallée. Dans le tableau de Cole – exposé au Metropolitan Museum of Art en 1908 – un avant-plan très détaillé d’un massif d’arbustes et d’un arbre couvert de mousse et frappé par des éclairs se mélange à une menace d’orage qui hypnotise le spectateur. Au-delà de l’avant-plan lugubre et de l’orage sombre, la courbe de la rivière au loin s’étend en étant dévoilée par la lumière du soleil. Hopper qui grandit le long de l’Hudson vit probablement le tableau de Cole. Sa Vallée de la Seine est presque un hommage au Méandre, mais il renverse l’effet. Hopper peint un pont de chemin de fer blanc brillamment ensoleillé en face d’une forêt sombre qui ressemble peu aux palissades de l’Hudson. Derrière la forêt, on aperçoit une petite ville suggérée par des gribouillages au pinceau représentant des toits et des murs. Beaucoup plus loin, la Seine se replie sur elle-même, rappelant l’Hudson qui fait une boucle dans Le Méandre. Pour apprécier la représentation magistrale de cette scène par Hopper, il suffit de poser le regard près de la toile pour se rendre compte qu’il fallut très peu de coups de pinceau pour créer tous les détails centraux. Hopper semble s’amuser sur ce tableau, défiant les universitaires et les pastoralistes traditionnels du Vieux Monde sur leur propre terrain. Le Bistrot (p.33), un autre tableau de sa période post-parisienne, capte un instant de vie à la manière des impressionnistes et des post-impressionnistes. Seurat, Degas, Renoir peignirent des instants de vie, des moments qu’ils immortalisèrent. Ce tableau ressemble à une photographie, à un « moment décisif » repris des décennies plus tard par Henri Cartier-Bresson, André Kertesz ou Alfred Eisenstaedt, qui étudièrent tous les grands peintres. Assises confortablement à une table extérieure, comme des figurantes sur une scène, deux femmes se partagent une bouteille de bière. Plus loin, on aperçoit un pont jaune citron et une ruelle bordée par quatre cyprès secs et courbés par le vent. Le paysage ressemble à une toile de fond prête à être enroulée. Le Bistrot est un endroit issu de l’imagination et de la mémoire de Hopper. Il reste un lieu mythique. Intérieur d’été (p.67), peint en 1909 à New York, est un tableau plus abstrait. Une femme à moitié nue s’affale à côté d’un lit défait. En réalité, elle ne paraît pas assise sur le sol, mais donne plutôt l’impression de flotter parmi des formes colorées représentant une cheminée, un mur ou une porte aux volets fermés. La moquette vert pâle reçoit un rectangle de lumière chaude provenant de la fenêtre. La couleur marron du cadre de lit prend un certain retrait, tandis que tous les autres plans sont mis en avant, donnant à la pièce une apparence agitée et inachevée. La fille inconsolable semble être le restant d’un événement ayant eu lieu dans une rêverie solitaire. Tout comme le couple qui apparaît dans Le Bistrot, elle n’a pas d’identité. Ce sont tous des symboles, les premiers dans une longue liste de sujets fantômatiques chez Hopper. Les artistes du « Ash Can » de Robert Henri organisèrent une nouvelle exposition qui allait durer du 1er
21. L’Ile de Blackwell (Blackwell’s Island), 1911. Huile sur toile, 62,1 x 75,6 cm.
au 27 avril 1910 dans un ancien entrepôt du 35th West Street. Cette « Exposition d’artistes indépendants »
Whitney Museum of American Art, New York,
ne contrariait pas uniquement les académistes new-yorkais. En effet, ses dates chevauchaient celles d’une
legs de Josephine N. Hopper.
exposition organisée par la National Academy of Design. L’exposition offrait un espace aux artistes contre une participation de dix dollars pour exposer un tableau et, belle affaire, seulement dix-huit dollars pour en
22. James Abbott Whistler, Nocturne en bleu et or –
exposer deux. Cette possibilité d’exposer à prix réduit attira certains des artistes les plus renommés du « Ash
Le Pont de Battersea (Nocturne : Blue and Gold-Old
Can ». On enregistra 344 inscriptions, dont celle d’Edward Hopper.
Battersea Bridge), vers 1872-1875.
Compte tenu de son style de vie économe, Hopper se limita à une seule inscription. Il choisit Le Louvre et la Seine, un tableau des débuts de sa période française (1907), caractérisée par sa vive
Huile sur toile, 68,3 x 51,2 cm. Tate Britain, Londres. 43
palette impressionniste. Le fait d’avoir exposé son ancien travail fut quasiment suicidaire. N’importe quel tableau de 1909 aurait mieux réussi à montrer son évolution vers une esthétique personnelle. L’exposition reçut de bonnes critiques mais Hopper fut à nouveau ignoré. Profondément déterminé, Hopper économisa et produit à la chaîne des illustrations commerciales pour gagner assez d’argent pour se payer une nouvelle expédition à Paris. Le RMS Adriatic arriva à quai à Plymouth (Angleterre) le 11 mai 1910 et un Edward Hopper réservé débarqua avec uniquement ses propres finances et ses propres références pour l’épauler. Une fois à Paris, il prit une chambre bon marché à l’Hôtel des Ecoles du Quartier latin. Mais il ne resta qu’une semaine avant de faire à son tour le voyage que Robert Henri avait réalisé l’année précédente. Il prit un train pour Madrid. Il joua le touriste, se promenant au milieu des images et des sons, écrivant et assistant à une corrida « écœurante » dont une scène finit par être représentée beaucoup plus tard sur une gravure. L’emprise de l’Europe s’était estompée. Les plaisirs de Paris avaient diminué et son dernier voyage à l’étranger se termina par un départ de Cherbourg le 1er juillet à bord du Cincinnati, un navire à vapeur de la ligne Hambourg-Amérique. Contrairement à Henri, Hopper n’avait pas trouvé le succès financier et mondial en effectuant des voyages à l’étranger, même si ses errances avaient changé sa vie à jamais. En 1910, Hopper rentra aux Etats-Unis et fit face à la rigueur de New York. Il retrouva l’interminable routine de son activité d’illustrateur commercial et il chercha une solution pour pouvoir mettre en pratique ses brillantes compétences et devenir peintre. Le jeune Edward n’avait encore aucune idée de son avenir.
Ses Exigences Dans l’annuaire de la ville de New York de 1911, Edward Hopper est listé sous la catégorie « vendeur »10. Ses contemporains – ses collègues étudiants et ses amis – connaissaient un certain succès en tant qu’artistes. Alors que la situation économique s’arrangeait après la crise de la panique bancaire de 1907, même ces peintres quasiment inconnus vendaient des tableaux et faisaient couler de l’encre dans la presse – ils avaient l’avis favorable de la critique qui cherchait la prochaine tendance. Hopper, quant à lui, courait dans tous les sens. Il était réduit à traîner d’une agence d’art et de publicité à l’autre avec son portfolio, en essayant de colporter ses compétences d’illustrateur aux directeurs d’art qu’il considérait pour la plupart comme des béotiens. Il trouvait ce travail rabaissant et trop dégradant pour lui. Le marché de l’illustration au début du XXe siècle était composé de centaines de revues populaires, de revues spécialisées, de revues professionnelles, de publicités, d’histoires illustrées et d’affiches. Les nouveaux procédés d’impression photographique fournissaient aux illustrateurs une grande variété d’outils avec lesquels ils pouvaient créer des œuvres évocatrices et dynamiques. Cependant, la modernité des techniques avait toujours un certain retard à rattraper par rapport à ce qu’on demandait aux illustrateurs du point de vue du choix du sujet et de sa présentation. La jeunesse étant la valeur absolue, les éditeurs demandaient des personnages stéréotypés pour s’assurer que le lecteur s’identifierait immédiatement à ceux-ci. Le contenu était dicté ainsi que la composition des logotypes, des titres et des produits. Les directeurs artistiques se permettaient de modifier le résultat comme bon leur semblait. Ils inversaient les images, ils enlevaient la barbe du personnage ou ils rajoutaient des moustaches, ils atténuaient les couleurs du fond, ils ajoutaient des produits et ils recadraient en éliminant certains éléments qu’ils considéraient superflus. Ils piétinaient la créativité de l’artiste et Hopper considérait ces gestes comme un rejet supplémentaire de son travail, même s’il s’agissait d’un travail peu important. Néanmoins, ses illustrations aidaient à payer le loyer, les peintures à l’huile, les pinceaux et il mangeait à sa faim. Hopper faisait face à un problème majeur dans ce marché. Il était un très bon illustrateur. S’il avait souhaité renoncer à obtenir une reconnaissance comme artiste peintre, il aurait peut-être pu être classé 23. Briar Neck, Gloucester, 1912.
44
finalement aux côtés des illustrateurs tels que Gibson, Leyendecker, James Montgomery Flagg et N.C.
Huile sur toile, 61,4 x 73,6 cm.
Wyeth. Malgré son impression de prostituer son talent, il était malgré lui toujours recherché comme l’un
Whitney Museum of American Art, New York,
des meilleurs artistes publicitaires. Son ambivalence au regard de l’art de l’illustration est notoire dans
legs de Josephine N. Hopper.
son travail.11 En effet, ses personnages d’illustration souriaient rarement.
45
24. Bateau à vapeur (Tramp Steamer), 1908. Huile sur toile, 51,1 x 74,1 cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C., donation de Joseph H. Hirshhorn.
46
25. Remorqueur avec cheminée noire (Tugboat with Black Smokestack), 1908. Huile sur toile, 51,4 x 74,3 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
47
48
Illustrer pour gagner sa vie lui consumait tout son temps. Hopper était quelqu’un qui prenait beaucoup de temps pour démarrer une création, quelques soient les circonstances, et en 1911, sa production de tableaux diminua pour s’arrêter à deux seulement. Son tableau à l’huile Sailing (p.48) dépeint un « petit voilier catboat dont le foc et la grande voile occupent », selon Hopper, « quasiment toute la toile… ». C’est un tableau inspiré par ses souvenirs d’enfance passée sur les bords de l’Hudson. Une fois encore, il utilise son coup de pinceau avec modération, le voilier au poste de pilotage ouvert arrive au port avec force, ses voiles gonflées, laissant un sillage pâle sur une mer quasi opaque. Les voiles et le ciel reçoivent de lourdes couches de peinture et cachent un autoportrait qui se dérobe à l’œil nu de celui qui cherche. L’autre tableau, Blackwell Island (p.42), est une œuvre obscure et lunatique. Sa composition rappelle Le Bistrot mais son objectif est différent. Ce tableau est le résultat de la volonté de Hopper de découvrir le secret du succès pour devenir un grand artiste. Robert Henri était rentré d’Europe triomphalement, en 1901, pour s’installer à New York. De la fenêtre de son appartement du 58 East Street, il avait une vue de Blackwell Island (sur l’East River) et il peignit une scène hivernale digne d’une carte postale avec des morceaux de glace flottants. En 1909, George Bellows, l’un des peintres reconnus et adulé par Henri, choisit également cette île comme sujet. Il mit en valeur le pont de Queensborough et représenta le quai de Manhattan sur l’avant-plan. En 1910, Julius Golz – un autre favori d’Henri – obtint les éloges de la critique à l’« exposition d’artistes indépendants » pour sa représentation de Blackwell Island. Ayant déménagé de son atelier situé dans le quartier rouge, sur 14th Street, Hopper trouva un logement au 53 East 59th Street, très près de l’atelier de Robert Henri. Henri et deux de ses acolytes avaient connu le succès en choisissant de peindre Blackwell Island et il semblait que Hopper pourrait le faire également. Il connaissait l’œuvre de James MacNeil Whistler dont les images furent exposées au musée d’Art moderne en 1910 et il choisit une approche de l’île qui refléterait l’esthétisme de Whistler. L’utilisation capricieuse des tonalités si caractéristique de Whistler était en opposition directe avec l’impressionnisme. Le côté dépassé des Nocturnes de Whistler était en réalité une manière de s’approcher de l’esprit de l’art moderne plutôt que de l’impressionnisme. Sur ce tableau, Whistler se concentra sur les valeurs strictement formelles de la couleur et du trait, marquant un choix directement lié à ce qui deviendrait l’art abstrait au début du XXe siècle.12 L’usage de peintures à l’huile diluées et appliquées de manière spontanée pour créer des images issues de ses souvenirs sont des démarches qui plurent certainement à Hopper. Dans Blackwell Island de Hopper, la scène est éclairée par la lune et la composition ressemble à celle du Bistrot. Le pont occupe le côté gauche du tableau. Un bateau vogue en passant sous le pont de Queensbourough et les lumières étincellent dans les maisons parsemées le long des deux rives. Quelques coups de blanc zinc créent un reflet de la lumière de la lune. Cette lumière s’empare du centre géographique du tableau. C’est en observant Blackwell Island, ainsi que beaucoup d’autres tableaux de Hopper, que les peintres abstraits ultérieurs reconnurent un lien entre son style et leur courant artistique pour ce qui concerne l’usage de la couleur, des traits et des plans. Si Edward avait caressé l’idée que le thème si utilisé de Blackwell Island lui ouvrirait la porte de la réussite pour rejoindre ses anciens camarades d’école, il n’eut pas de chance. Robert Henri décida d’organiser une fois de plus une « Exposition d’artistes indépendants » au MacDowell Club du 108 West 59th Street. Cette série d’expositions fut conçue pour accueillir des séries de huit à douze artistes pendant des périodes de deux semaines. Dans chaque groupe, les artistes s’organisaient entre eux. Hopper fut sélectionné pour exposer ainsi que Sloan, Glackens, Luks, Speicher, Leon Kroll et Henri. La série d’expositions commença en novembre 1911. L’exposition de Hopper était prévue du 22
26. Promenade en mer (Sailing), 1911. Huile sur toile, 61 x 73,7 cm.
février au 5 mars 1912. Les artistes exposant avec lui étaient Guy du Bois (le héros de Hopper), George
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Pennsylvanie,
Bellows, Leon Kroll, Mountford Coolidge, Randall Davey, May Wilson Preston et Rufus J. Dryer. Hopper
donation de M. et Mme James H. Beal.
participa avec cinq huiles sur toile : Bateau-Mouche (pp.14-15), Vallée de la Seine, Le Bistrot (présenté avec un titre américanisé : The Wine Shop), Bateau à vapeur britannique et – le seul tableau d’art « américain » – le petit catboat joyeux, Voilier. Guy du Bois, qui dut investir considérablement de sa personne pour que Hopper soit intégré à l’exposition après son désastre précédent, resta très probablement interloqué. Hopper ne vendit rien et
27. Port de Gloucester (Gloucester Harbor), 1912. Huile sur toile, 66,5 x 96,8 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper. 49
la critique l’ignora à nouveau. Il rentra chez lui avec ses images françaises démodées et recommença à chercher un travail d’illustrateur. Comment était-ce possible qu’une personne intelligente et douée continue à offrir un produit que personne ne voulait acheter ? Il avait à trois reprises déjà voyagé en Europe, marchant sur les pas d’Henri. Il avait transféré son atelier à une adresse qui se trouvait juste en bas de la rue où habitait ce dernier. Il peignait même les sujets qu’Henri peignait. Il avait de grands amis et de grands admirateurs parmi ses anciens camarades d’école. En outre, l’idée de trimbaler son portfolio d’illustrations de porte en porte pour trouver un travail qui consisterait à dessiner des bretelles, des canotiers, des débutantes, des matchs de polo, des patrons sédentaires et des dockers musclés était pour lui un anathème. Edward Hopper voulait le succès, mais uniquement à sa façon. Après avoir été un garçon exemplaire pendant les premières vingt années de sa vie – fils parfait, élève modèle, meilleur farceur, technicien doué – il avait besoin de maintenir ce niveau de réussite tant applaudi. Le chemin artistique qu’il avait adopté était celui du minimalisme, d’impressions. Il plaisanta plus tard dans sa vie sur le fait d’« avoir toujours été un impressionniste » et il était probablement sincère. Son art était une expression d’images suggérées, représentées si adroitement qu’elles semblaient vivre devant les yeux du spectateur. De plus, l’émotion se dégageant de ses tableaux, sans tenir compte du sujet, semblait diaphane, légèrement hors de portée, implicite. Il avait l’art de jeter trois grands coups de pinceau par-ci pour créer une coque de bateau, ou un gribouillis de blanc zinc puis des taches de carmin par là pour représenter une ville française lointaine avec ses toits rouges. C’était comme si Hopper lui-même était une suggestion implicite. « Le grand art est l’expression externe de la vie intérieure de l’artiste, et cette vie intérieure constitue sa vision personnelle du monde. Même le talent créateur le plus incroyable ne peut remplacer un élément essentiel : l’imagination. »
L’Epoque des changements Ce dut être avec un soupir de résignation qu’il reprit son portfolio et replongea dans les foules anonymes qui se dépêchaient sur les trottoirs, en esquivant le fumier de cheval dans les rues et en étant surpris par le bruit des klaxons des voitures ou les sifflements secs des soupapes de voitures à vapeur. Il endura à nouveau l’entassement dans les tramways qui grognaient et cliquetaient en le transportant vers un autre travail d’illustration qu’il détestait et qui lui était pourtant nécessaire. Il y avait beaucoup de travail pour Edward Hopper. La revue System, the Magazine of Business l’embaucha et il commença une longue relation professionnelle avec l’éditeur en dessinant des hommes et des femmes dans des bureaux. Le salaire était généreux et il reçut assez de missions pour oser quitter New York et peindre de nouveaux sujets. Il choisit Gloucester (Massachusetts) sur la côte Est comme destination et le sociable Leon Kroll comme compagnon de voyage. Le grand baptiste taciturne et le petit juif loquace travaillèrent dur tout l’été sur les plages et dans les ports de la ville côtière ou aux environs. Hopper était anormalement productif, inspiré probablement par la bonne humeur permanente et la production prodigieuse de Kroll. Leon Kroll retournerait souvent par la suite à Gloucester, devenant un habitué jusque tard dans sa vie. Le côté plutôt pittoresque du port attirait beaucoup d’artistes d’autres régions, à tel point que Hopper avait des difficultés pour installer son chevalet sans gêner le travail d’un autre peintre. 28. Grands Mâts (Tall Masts), 1912.
Cette première expérience de peindre des scènes américaines à l’extérieur semblait l’inspirer et il
Huile sur toile, 61,6 x 74,3 cm.
produisit le Port de Gloucester (pp.50-51), Squam Light, Briar Neck (p.45), Grands Mâts (p.53) et
Whitney Museum of American Art, New York,
Quartier italien (p.123). Chacun de ces tableaux était une scène façonnée par la lumière brillante du
legs de Josephine N. Hopper.
soleil, sans ajouter aucun effet atmosphérique ni de semi-transparence. Pratiquement aucune figure humaine n’y figure, mais leurs bateaux, leurs maisons et les mâts des bateaux amarrés suggèrent
29. Village américain (American Village), 1912.
52
l’existence d’une population dynamique. Un empâtement épais dessine le ressac qui vient de s’écraser
Huile sur toile, 65,7 x 96,2 cm.
contre les rochers de Briar Neck et de grands rochers s’étalent derrière le quartier italien, fusionnant les
Whitney Museum of American Art, New York,
angles durs de leurs bords avec les avant-toits inclinés des maisons en bois. Squam Light présente un
legs de Josephine N. Hopper.
phare et ses dépendances balayés par le vent, perchés au-dessus d’une plage avec des doris échoués. Le
53
56
blanc épais du phare et des maisons blanchies par le soleil est peint à l’aide de coups de pinceau superposés. La facilité avec laquelle la scène est mise sur la toile suggère que Hopper s’amusait. Il n’y a que le ciel, toujours changeant, qui semble avoir été travaillé plus lourdement jusqu’à cacher l’une de ses nombreuses permutations. A son retour à New York, son esprit s’attardait encore sur son été alors qu’il regardait les petites villes défiler par la fenêtre de la voiture. De retour à la maison, il peignit Village américain (pp.54-55), une rue de village à la tombée du jour vue en contre-plongée depuis une passerelle. Les fenêtres des bâtiments aux façades de pierre reçoivent encore l’ombre de leurs auvents individuels qui se trouvent au rez-dechaussée cachent la foule qui fait des achats. Une lumière irrégulière fait ressortir une maison blanche et un tramway jaune au bout de la rue principale. Le reste de l’activité de la rue reste subtilement suggéré par des taches de peinture stratégiquement posées pendant que des nuages bas grondent avant l’arrivée d’un orage d’été. Revigoré par son été d’activité artistique, Hopper rejoignit Kroll, George Bellows, huit autres optimistes et Robert Henri, toujours omniprésent, au MacDowell Club. En janvier 1913, lorsque l’exposition fut prête et qu’elle ouvrit ses portes, deux tableaux de Hopper y figuraient : Squam Light et La Berge, un autre tableau de son époque parisienne représentant la Seine. Il montrait un refus quasi pathologique face à la possibilité de se séparer de son travail français, malgré l’indifférence monumentale que celui-ci suscitait. Comme c’était à prévoir, il ne vendit pas de tableaux et la critique le négligea à nouveau. Hopper se tourna à nouveau à contrecœur vers The System, Magazine of Business et il commença également à travailler dans l’illustration de fictions pour la revue Associated Sunday Magazine, un quotidien populaire qui assurait le supplément du dimanche de plusieurs journaux citadins importants. Une nouvelle épreuve attendait cependant Hopper et allait tester sa détermination. Des peintres étaient en train d’être sélectionnés pour l’ouverture d’une exposition au mois de février au coin de 25th Street et de l’Avenue de Lexington dans le hall caverneux de l’arsenal du régiment 69. Le « Armory Show » de 1913 allait bouleverser le monde de l’art et Edward Hopper entendait désespérément faire partie de l’agitation. L’ouverture du « Armory Show », le 17 février 1913, fit une entrée fracassante dans le monde de l’art américain avec 1250 tableaux, sculptures et autres travaux décoratifs réalisés par plus de 300 artistes européens et américains. En allant de Marcel Duchamp avec Nu descendant un escalier aux travaux réalistes du « Ash Can » américain, il n’y avait ni limites ni frontières. Les critiques se dépêchaient pour déceler le talent, moral ou créatif (ou les deux), mais suivirent surtout une ligne populaire, ou, comme l’écrivit un critique : « C’était un bon spectacle… mais n’en refaites pas. » Les dessinateurs humoristiques des journaux s’en donnèrent à cœur joie avec les travaux abstraits. Suite à de nombreuses expositions d’art indépendant réalisées en France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie, l’Association of American Painters and Sculptors International Exhibition of Modern Art eut le mérite de faire soudainement connaître les travaux de « gens de l’autre côté de l’Atlantique » à un monde artistique qui se caractérisait par une créativité étriquée, conservatrice et conformiste. C’est une vision qui avait dominé les Etats-Unis pendant des décennies. L’exposition démontrait à un large et nouveau public qu’il existait en effet des artistes américains qui pratiquaient l’alchimie, à la fois vive et intimiste, entre la peinture et la toile ou entre la pierre et le burin. Pendant la procédure de sélection, le Domestic Exhibition Committee fut présidé par William Glackens, un artiste appartenant au cercle d’Henri qui figurait parmi le groupe des « Huit » et qui participait régulièrement aux expositions chez MacDowell. Les sélections de ce comité réussirent à offenser quasiment tout le monde. Le comité exigeait en effet une certaine originalité et une touche personnelle sur chaque tableau pour pouvoir être admis à exposer. Hopper ne fut pas automatiquement invité à participer comme par le passé. Une réaction violente des artistes américains réussit finalement à laisser la porte ouverte à toute participation, même celle des artistes non invités. Hopper, avec son chapeau à la main et sans faire partie
30. Yonkers, 1916. Huile sur toile, 61,6 x 73,9 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper. 57
du cercle des favoris d’Henri, put soumettre deux de ses huiles sur toile réalisées en 1911 : Voilier et Blackwell Island. Seulement Voilier, le petit voilier heureux, fut admis. Une foule sans précédent se précipita vers le hall de l’Armory. Les éclats de rire, les exclamations et les malédictions ponctuaient le murmure grondant de la foule pendant qu’elle se déplaçait devant les travaux de Kandinsky, Picabia, Matisse, Charles Sheeler, Georgia O’Keeffe, Brancusi, Everett Shinn et John Sloan. Les murs semblaient être illuminés par ce bain de couleur et de mouvement. Comme beaucoup d’autres artistes américains, Hopper restait impatient près de son tableau, cherchant des réactions, écoutant les commentaires. Tout près, son ancien professeur et le leader des réalistes classiques, William Merritt Chase, soufflait et clamait à haute voix son avis sur ces tableaux qu’il appelait des « déchets ». Parmi la foule qui regardait les tableaux et qui murmurait, un fabricant de textile de Manhattan nommé Thomas F. Victor s’avança. Il aimait l’image du voilier, nota que son prix était de $300, et, comme il s’agissait d’un bon homme d’affaires, il proposa $250. Hopper accepta et un officier de l’exposition apposa un billet sur le cadre de la toile qui signalait qu’elle était « vendue ». Hopper avait enfin réussi à vendre un tableau, une scène inspirée par sa mémoire et par son imagination. Le prix de vente de $250 est équivalent à $5000 actuels.13 Cette somme significative en poche, Edward Hopper radieux et plein d’énergie prit le train vers Nyack pour montrer à ses parents qu’il était enfin sur la bonne piste du succès artistique. L’exposition légendaire ferma le 15 mars. Garrett Hopper, qui luttait contre une santé défaillante, décéda le 18 septembre 1913. Edward avait prouvé à son père ce dont il était capable. Ayant lutté lui-même en vain pour obtenir le succès, Garrett Hopper dut être extrêmement fier de son fils. A ce moment-clé, Edward Hopper devait faire le bilan de sa vie. La vente de son tableau était plus qu’un symbole. Cela représentait une porte qui s’ouvrait que la réalisation d’un objectif. C’était l’aboutissement de sa longue lutte vers le succès en tant que peintre et artiste. Il avait dépassé la trentaine et il avait développé une facilité pour peindre qui lui permettait d’exprimer ce qu’il voulait sur une toile. L’abstraction et le modernisme, tel qu’ils avaient été présentés dans le « Armory Show », n’avaient aucun secret pour lui. Il s’était investi dans le réalisme et dans sa capacité à transmettre sa propre personnalité dans son choix du sujet, dans sa présentation, dans l’ajout et la soustraction d’éléments à l’intérieur d’une scène donnée. Il avait besoin à présent de faire table rase du passé et de regarder vers l’avenir. En novembre 1913, il commença à enregistrer ses ventes dans un livre de comptes, notant soigneusement chaque rentrée d’argent, indépendamment de la source. Cela lui permit d’apprécier davantage le travail d’illustration qui lui permettait de poursuivre sa passion pour la peinture. Son expression créative avait mûri et chaque tableau vendu lui permettait de faire une pause pour se reposer du purgatoire de l’illustration commerciale. En décembre 1913, Hopper commença à chercher un nouvel atelier, plus ample. Il découvrit Washington Square à Greenwich Village et un bâtiment délabré, de style Renaissance grecque, au 3 Washington Square North, face au parc. Il avait été construit dans les années 1830, puis réhabilité en 1884 pour être converti en une série d’ateliers pour artistes. Parmi les artistes locataires, il y avait eu Thomas Eakins, Auguste St Gaudins et William Glackens. Hopper emménagea au quatrième étage. Il fallait monter soixante-quatorze marches pour atteindre un logement spartiate qui n’avait ni salle de bain privée ni chauffage central. Un poêle à charbon était installé dans un coin et un puits de lumière magnifique éclairait la pièce qui souffrait de fuites lors des orages. 31. Coin de rue à New York (Bar de quartier)
Les voisins de Hopper étaient des artistes de diverses sortes et l’un d’entre eux, Walter Tittle, avait
(New York Corner (Corner Saloon)), 1913.
été un ancien élève de Chase en même temps que Hopper. Leur amitié grandit et Tittle aida Hopper à
Huile sur toile, 61 x 73,7 cm.
trouver des contrats comme illustrateur. Que cela lui plaise ou non, Hopper commença à faire partie du
The Museum of Modern Art, New York,
monde artistique et bohémien qui s’était infiltré dans le quartier italien et irlandais de Greenwich Village.
Abby Aldrich Rockefeller Fund.
Le bâtiment de Washington North était le théâtre de nombreuses fêtes et Hopper n’avait qu’à monter ou descendre les escaliers pour y participer. Alors qu’il avait rejeté le comportement exubérant du groupe
32. Gare de métro (The El Station), 1908. Huile sur toile, 51,3 x 74,3 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
58
d’artistes qui fréquentaient Montmartre et la rive gauche à Paris, la proximité et la vitalité de Greenwich Village lui permettaient de se reposer de son travail et lui servirent peut-être même d’inspiration. C’est curieux que Hopper, cet homme de si grande taille qui était toujours au dernier plan dans les photos, à l’écart du groupe, continuât à être recherché par ses contemporains. Il était loin d’être le
59
62
peintre qui avait le plus de succès et il n’était en rien une personne qui affectionnait la vie sociale. Son travail avait été rejeté par les jurys d’expositions où il avait été admis à contrecœur alors que ses pairs exposaient sans aucun problème. Il travaillait dans leur ombre, mais rarement en leur compagnie. Il semblait chercher la clef du succès de tous ces peintres en allant là où ils trouvaient leurs sujets. Le monde de l’art américain offrait de nombreuses et diverses sources d’inspiration mais Hopper choisissait pourtant de marcher sur les pas de ces artistes. Il créait des tableaux qui laissaient la critique indifférente et qui ne se vendaient pas. Malgré la vitalité croissante du paysage artistique américain, Hopper devint un homme de 1,92 mètres invisible. Hopper continuait à passer inaperçu parmi ces peintres à succès. Si son intérieur bouillonnait, il maintenait une apparence calme. Il dégageait une assurance absolue qu’il semblait puiser dans la technique brillante qu’il avait démontrée dans les cours d’Henri et dans ce talent naturel qu’il étalait de manière si dédaigneuse sur ses illustrations. Ses amis et ses admirateurs restèrent fidèles à Hopper toute sa vie. Ils semblaient attendre patiemment l’éruption de son succès et l’arrivée de sa reconnaissance, ou bien alors ils trouvaient une sorte de soulagement ou de Schadenfreude (joie maligne) à voir Hopper, si maître de soi, confronté à maints échecs. Hopper se nourrissait de leur compagnie en cherchant leur reconnaissance plus que leur approbation, une reconnaissance telle qu’il l’avait toujours eue de la part de sa mère et de son père, de madame Jammes à Paris, d’Enid Saies, de ses maîtres William Merritt Chase et Robert Henri, de son supporter Guy du Bois et de Thomas F. Victor, le fabricant de tissu de Manhattan qui avait aimé son tableau du voilier à l’« Armory Show ». Tout comme un acteur qui a besoin d’applaudissements, un artiste a besoin de reconnaissance. Chaque rejet est à la fois le symbole d’un reproche ou d’un refus, non seulement de l’objet mais aussi de la personnalité de celui qui crée l’œuvre. Entre 1913 et 1923, le stoïcisme apparent de Hopper masquait sa crainte de l’échec et déconcertait ses contemporains. Il était logique de penser que quelque chose devrait arriver et tout le monde souhaitait être là pour être témoin de ce moment tant attendu. La Première Guerre mondiale surgit en Europe et les Etats-Unis se rangèrent bientôt du côté des Français et des Anglais comme le montrent les films de propagande britanniques qui étaient diffusés dans les cinémas en ville. Ces événements générèrent une augmentation dans la variété des sujets à illustrer. Hopper pouvait alors travailler d’autres thèmes que ceux des revues de fiction, dont il était obligé de lire les textes médiocres avant de pouvoir commencer une illustration de la couverture. La U.S. Printing and Litho Company sortait les affiches des films et payait Hopper $10 ($200 dollars actuels) pour leur création. Il était également payé pour regarder ces mélodrames silencieux en salle et il préférait ces films à la fiction à quatre sous. Ce fut à cette époque qu’il développa une fascination pour le cinéma qui ne le quitta plus jamais. Cependant, le fait de pouvoir regarder ces films gratuitement ne suffisait pas pour calmer son irritation lorsque les gérants de cinéma exigeaient qu’il effectue des changements sur ses dessins car ses interprétations réalistes n’étaient pas jugées conformes aux stéréotypes que les magnats du cinéma pensaient que le public accepterait. Après avoir gagné son pain dans l’obscurité, Hopper éprouva le besoin de décompresser. Un artiste qu’il connaissait, Bernard Karfiol, lui recommanda de visiter le village portuaire de Ogunquit (dans le Maine), un endroit où les artistes de New York se retrouvaient chaque été, attirés comme une volée de moineaux. Pour huit dollars par semaine, Hopper se logea à la pension de Shore Road, une des maisons préférées des artistes et il mangea régulièrement avec eux à la table commune. Il rencontra une jeune peintre, petite et rousse, du nom de Josephine Nivison qu’il avait déjà aperçue dans les cours d’Henri. En effet, le professeur avait peint un portrait complet de cette jeune femme, habillée avec un sarrau et tenant sa palette et ses pinceaux, intitulé Art Student. Le village attirait beaucoup de camarades de l’école de Hopper. Ils se réunissaient autour de la table et après le dîner pour se
33. Train (Railroad Train), 1908. Huile sur toile, 61 x 73,7 cm. Addison Gallery of American Art, Phillips Academy, Andover, Massachusetts, donation de Dr Fred T. Murphy.
remémorer leurs vieux souvenirs. Il se concentra sur une série de tableaux dans son format habituel, ce qui démontra à nouveau sa
34. Charles Sheeler, Paysage classique
capacité à faire beaucoup avec peu d’efforts. Des anses côtières y apparaissent baignées par la lumière
(Classic Landscape), 1931.
d’un soleil brillant et les doris, peints à coup de touches balayées, créent une mer bleue et plate ainsi
Huile sur toile, 63,5 x 81,5 cm.
que des ombres profondes. Deux de ces tableaux de falaises et de baies léchées par les vagues se
Mr and Mrs Barney A. Ebsworth Foundation,
distinguent particulièrement des autres.
Saint-Louis, Missouri. 63
L’un est Rochers et maisons (pp.116-117), un paysage qui apparaît sous un ciel de nuages, des stratus. Sous la lumière flatteuse, les maisons avec leurs avant-toits profonds et leurs toits à deux pentes semblent s’accroupir derrière un rocher énorme, arrondi par le temps et orné d’un massif d’arbustes dans sa partie inférieure. La sensation suscitée par ce tableau est celle de claustration et de mélancolie. Les maisons sont représentées comme des intrus à l’intérieur d’un paysage ancien. L’autre tableau, Route dans le Maine (p.115), est une simple vue d’une route rurale qui remonte en zigzag derrière un massif rocheux. Seule la première partie de la courbe est visible puis elle disparaît au coin, la courbe étant ponctuée par deux poteaux. Le soleil brille, le ciel est dégagé, et pourtant l’humeur qui se dégage du tableau suggère que quelqu’un vient de passer par-là ou est juste en train de s’approcher. Ce thème sera plus tard récurrent dans son travail. Au retour d’Ogunquit, il avait beaucoup de tableaux à montrer grâce à ce temps passé loin du calvaire de l’illustration. Mais une fois rentré, un calvaire bien différent l’attendait. Ses clients d’illustration avaient aligné plusieurs projets pour lui, y compris plusieurs scènes imaginaires de la Première Guerre mondiale pour la revue Everybody’s Magazine, montrant des actions de combat sanglantes et brutales dont il n’avait pas entendu parler. La Galerie Montross sur la 5th Avenue, au-dessus de la 49th Street, organisait une exposition et Edward fut invité. Plein d’optimisme, il soumit son dernier travail, Route dans le Maine. Guy du Bois exposa quatre de ses œuvres et sélectionna le tableau de son vieil ami pour en publier un commentaire dans Arts and Decoration Magazine – dont il était l’éditeur. Il utilisa les termes « austérité » et « calvitie » pour se référer à l’absence extrême de détails dans le tableau. Il parla des poteaux téléphoniques « sans fil », du pays « désert » et insista sur la route « stérile ». Son commentaire ressemblait quasiment à un affront mais il épargna le tableau de sa critique négative en mentionnant vers la fin « la chaleur et la couleur qui résonnent avec sincérité et vérité », puis il ajouta une tape amicale sur le dos : « Le peintre redonne plus que ce qu’il enlève. » L’effusion maladroite de du Bois mise à part, ses commentaires n’étaient pas loin de découvrir le fond de la pensée de Hopper ainsi que le style que le peintre était en train de développer et qui deviendrait, plus tard, une pulsion primaire dans les choix et les interprétations de ses sujets. Hopper ne trouva pas cette expérience amusante. Le tableau ne se vendit pas. Il apprit qu’une exposition de George Bellows sur le thème du Maine avait eu lieu. Son camarade avait été catalogué comme un peintre « …marchant sur les pas de Winslow Homer… tout comme Rockwell Kent. »14 Beaucoup de ses anciens camarades d’école avaient bonne presse, leurs ventes et leurs expositions augmentaient – même si quelques-uns n’atteignaient le succès qu’en étant comparés à des artistes qui avaient déjà réussi. Hopper ne souhaitait pas marcher dans les traces des autres. Continuant à se battre, Hopper se présenta en février 1915 au MacDowell Club avec deux tableaux. L’huile sur toile Coin de rue à New York (p.59) est une explosion d’activité humaine autour de la façade ornée et dorée d’un bar occupant le coin d’une rue. Sa composition montre un équilibre académique entre l’avant-plan, le moyen-plan et l’arrière-plan. Ce choix est tout sauf dynamique. Les personnages portent les habits noirs caractéristiques des ouvriers et ils se dirigent vers un kiosque de presse qui se trouve, lui aussi, sous le portique du grand bar. Le trottoir courbé donne l’effet d’une plate-forme en mouvement qui tourne à jamais comme les aiguilles d’une horloge ancienne sur laquelle seraient posés des personnages sculptés. La virtuosité de Hopper réussit à bien placer au hasard des éléments de couleur sur le tableau et à illuminer le tout avec des touches simples : les journaux, la lumière de la lampe 35. Coucher de soleil sur voie ferrée (Railroad Sunset), 1929. Huile sur toile, 74,3 x 121,9 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
à gaz qui apparaît à l’avant-plan, la décoration dorée au-dessus de la porte et l’enseigne du coiffeur donnent de la vivacité à la solidité urbaine du bâtiment en brique et au paysage urbain lointain. Le second tableau, Soir bleu (pp.70-71), était aussi révélateur pour le peintre que pour son public. Outre le fait évident que Hopper s’aventurait une fois de plus vers le thème français auquel la critique avait été si indifférente, il jouait la carte de la moralité américaine. Les Etats-Unis était un pays qui hésitait
36. Intérieur d’été (Summer Interior), 1909.
66
encore entre la modernité et ses anciennes valeurs victoriennes auxquelles il restait attaché. Après le
Huile sur toile, 61 x 73,7 cm.
tournant du siècle, le pays avait commencé à clamer que les comportements liés aux drogues, la
Whitney Museum of American Art, New York,
prostitution, les danses impudiques, le langage impoli, la traite des blanches et la littérature ou les cartes
legs de Josephine N. Hopper.
postales érotiques « …venaient de l’Europe continentale », à savoir la France. Juste avant que les
67
68
horreurs de la guerre moderne explosent à travers les champs de la Flandre, les Français décadents étaient considérés comme des piètres modèles pour les enfants américains – voire pour les adultes. Après tout, un préservatif n’avait-t-il pas été appelé « French letter » ? Le tableau Soir bleu de Hopper était un énorme rectangle horizontal. Un maquereau français (un proxénète de rue) à l’air sévère assis à une table circulaire y figure. Sur une deuxième table, on voit un homme avec un béret et un soldat. Ils parlent avec un clown qui a fini son service ; il est encore complètement maquillé et fume une cigarette. La troisième table accueille deux personnages mondains habillés en tenue de soirée ; ils boivent un verre de vin tout en conversant. Sur le plan supérieur, une femme avec un grand décolleté surplombe la scène. Elle porte un maquillage pesant avec rouge à lèvres, ombre à paupières et fard. Son regard toise les gens assis ; son expression hautaine manifeste le fait qu’elle est en attente. Tout en haut pendent des lanternes japonaises qui évoquent un cadre festif. Cette œuvre semble être sortie de l’imagination de Hopper, recrachée de son passé sexuellement réprimé et en accord avec la francophobie ambiante de la bonne société. Les familles américaines avaient en effet la certitude que leurs filles pouvaient être enlevées à tout moment du bal local pour être enfermées dans des maisons closes françaises. Hopper avait connu des personnages comme ceux qu’il représentait sur son tableau grâce à ses trois voyages à Paris. Son éducation baptiste et puritaine était telle qu’il était fort possible que sa première expérience sexuelle ait été avec une prostituée française. La presse à quatre sous de l’époque régalait ses lecteurs avec des histoires de filles vierges et pauvres attirées vers un triste sort ou des histoires de jeunes hommes de bonne famille ruinés par la maladie ou par la cécité. Les personnages du tableau de Hopper ont une touche d’authenticité. C’était la seconde fois qu’une histoire qu’il avait lue et illustrée avait réussi à apparaître dans son art personnel. Ce ne serait pas la dernière fois. Les critiques remarquèrent enfin Hopper. Son Coin de rue à New York (p.59) reçut une approbation générale, mais Soir bleu fut qualifiée comme une collection minable « …de Parisiens et buveurs d’absinthe endurcis ». La scène reflétait la débauche de la vie du demi-monde à Paris, le « Babylone moderne ». La francophobie ambiante annula toute valeur que le tableau aurait pu avoir en tant qu’analyse intéressante et émouvante de ses personnages. Seul Guy du Bois s’exprima avec sagacité dans sa critique : « Monsieur Hopper […] évite de montrer son enthousiasme et il utilise le langage artistique d’une manière tellement économe que l’on pourrait même le comparer à de la parcimonie si son expression n’était pas si froidement rationnelle. »
15
Aucun tableau ne fut vendu. Soir bleu fut enlevé et enroulé pour être redécouvert seulement après la mort de Hopper. Ce tableau fut hâtivement nommé Scène d’un café, jusqu’à ce qu’on découvre plus tard sa provenance.16 Les thèmes français n’attiraient plus le public. Il avait enduré tout le rejet qu’un artiste pouvait endurer et sa clientèle avait virtuellement diminué jusqu’à sa disparition quasi définitive. Il éprouvait le besoin d’échapper à ce qu’il considérait comme une « corvée » : l’art de l’illustration. Il se mit en quête d’une solution.
La Recherche de nouveaux outils Le loyer devait être payé, il devait y avoir assez d’argent pour se nourrir – Hopper ne cuisinait pas – et il devait également acheter du matériel. Les centimes qu’il dépensait quotidiennement dans les autobus, les trolleys et le métro lui permirent de faire connaître son portfolio à des nouveaux clients y compris aux revues The Farmer’s Wife et Wells Fargo Messenger. Il n’avait pas de téléphone et il était, par conséquent, courant qu’il se déplace pour recevoir des missions et pour déposer les travaux. Il avait la volonté de connaître à nouveau le succès qu’il avait eu à Ogunquit pendant l’été de 1915. Le groupe du MacDowell mené par Bellows, Henri et Kroll avait déplacé leur attention vers Ogunquit
37. Intérieur (Modèle lisant) (Interior (Model Reading)), 1925. Aquarelle et crayon sur papier ivoire, 35,3 x 50,6 cm. The Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois.
lors de cette saison et ils descendaient sur le petit port de manière grandiose. Ils se montraient avec leurs femmes et ils louaient des petites maisons d’été. Hopper continuait à s’asseoir à la table de la pension
38. Soir bleu, 1914.
où il se contentait de partager des pommes de terre et des petits gâteaux. Un brouillard dense couvrit
Huile sur toile, 91,4 x 182,9 cm.
la côte lors de cet été et ses anciens camarades d’école utilisèrent leurs fonds pour louer des ateliers,
Whitney Museum of American Art, New York,
embaucher des modèles et peindre à l’intérieur. Hopper se baladait avec son carnet de dessin en essayant
legs de Josephine N. Hopper. 69
de trouver des sujets à l’extérieur avant qu’ils disparaissent au gré des changements d’orientation de la brise maritime. L’été brumeux de 1915, à Ogunquit, fut décevant. Désespérément déterminé à éviter le travail d’illustration, il se décida à se mettre à enseigner. C.K. « Chat » Chatterton donnait des cours de sensibilisation artistique dans une école de filles – l’université de Vassar – et Hopper pensa que ce métier ne pouvait pas être très difficile. Il avait déjà fait de l’enseignement les samedis lorsqu’il étudiait à la New York School of Art. Il fit imprimer quelques cartes de présentation puis lança son nouveau projet. DESSIN PEINTURE ILLUSTRATION M. Edward HOPPER donnera des cours de dessin, de peinture, d’illustration et de composition d’images au 53 North Broadway, à Nyack, New York, à partir du mois d’octobre et chaque samedi matin de 9h00 à 12h00. M HOPPER fut l’élève de Chase, Henri, K. H. Miller entre autres et il est un ancien professeur de l’école de Chase. Pour plus d’information sur les périodes de cours, veuillez vous adresser au 53 North Broadway, Nyack, ou au 3 Washington Square North, New York.17 Les cours avaient lieu dans une pièce du salon, chez sa mère. Edward accumulait les étudiants et il acheta quelques moulages pour que les étudiants puissent les copier. Il convainquit sa mère de poser dans son fauteuil à bascule lorsqu’elle n’était pas en train de servir une limonade et des petits gâteaux aux étudiants. C’était une horreur, un cauchemar, un purgatoire. Pour éviter de tout laisser tomber, Hopper essayait de voir les choses avec humour. Il fit imprimer une autre carte, cette fois-ci en français, qui disait : Entreprise E. Hopper, fondée en 1882 Objets d’art et d’utilités diverses Peintures à l’huile, gravures, eaux-fortes, cours de peinture et de littérature, réparation de fenêtres et de lampes électriques, ramassage et transport de malles, visites guidées à la campagne, charpentier, blanchisseur, coiffeur, pompier, transport d’arbres et de fleurs, mariages et salles de fêtes, lectures, encyclopédie d’art et de sciences, mécanicien, remède rapide pour les maladies de l’esprit telles que l’inconstance, la frivolité et la fierté. Réductions disponibles pour les veuves et les orphelins. Échantillons à la demande. Exiger la marque déposée.18 Le groupe du MacDowell, C. K. Chatterton, Sloan et les autres se réunirent pour organiser une exposition de leurs œuvres plus récentes. Pendant qu’ils peignaient sur la côte du Massachusetts avec des modèles payés, à l’intérieur des chaumières chaleureuses qu’ils avaient louées, Hopper parcourait les côtes pleines de brouillard à la recherche de sujets. Il arriva à tirer de la pile de tableaux qu’il avait dans son atelier le tableau appelé Village américain, ainsi que quelques tableaux de Ogunquit réalisés la saison précédente. Cette exposition fut comme la précédente. Ce fut une déception. Il ne vendit rien. Il put heureusement ajouter quelques couvertures illustrées qu’il avait effectuées pour les deux revues Wells Fargo Messenger et son nouveau client, la revue commerciale Morse Dry Dock Dial (une publication sur la logistique). Il s’agissait de certaines de ses meilleures illustrations avec une touche artistique. Leur composition était d’une qualité bien au-dessus du travail peu valorisant auquel il était habitué. Son livre de comptes, qu’il tenait soigneusement, montre une liste de journées où il reçut de l’argent de ses ventes : « 1 dessin à ligne – $8, 1 dessin en simili – $35. » Pendant qu’il travaillait comme un esclave pour Country Gentleman Magazine, la lassitude que Hopper ressentait vis-à-vis de l’illustration sembla claire à l’éditeur de la revue, A. N. Hosking. Pour arriver à garder le bon travail de l’artiste et tenter d’alléger sa frustration, Hosking suggéra que Hopper change de moyen d’illustration pour l’aider à retrouver sa créativité. Il incita Hopper à essayer la gravure. Hopper devait être au courant du marché américain dynamique pour les gravures artistiques lorsqu’il commença à en créer en 1915. Logiquement, il choisit la gravure pour deux raisons : sa capacité à reproduire des dessins qu’il avait fait au crayon et l’aspect économique lié à la vente des 39. Les Poilus, 1915-1918.
72
reproductions – prenant en compte qu’une plaque de gravure pouvait produire beaucoup de copies
Gravure, 23,6 x 26,7 cm.
de l’original. Ce nouveau procédé sembla revigorer son agitation créative et il ressortit deux scènes de
Whitney Museum of American Art, New York,
ses souvenirs de France et de la côte américaine, ainsi que les croquis qu’il n’avait jamais encore
legs de Josephine N. Hopper.
convertis en tableaux.
73
74
Procédé pour une gravure à l’acide et technique de pointe sèche La planche de gravure est généralement en cuivre. Les lignes inscrites sur la planche située sous la surface plate et polie tiennent l’encre qui sera transférée sur un papier poreux. L’artiste commence une gravure en effectuant un dessin au crayon sur une planche de cuivre qui est recouverte d’une couche mince de cire, mieux connue sous le nom de « sol ». Le dessin est transféré vers la planche en utilisant un « stylet de gravure » pour couper la cire et atteindre le cuivre qu’il y a en dessous. Une fois que ce dessin est prêt à être gravé, l’acide est appliqué sur la surface et il « mordance » la plaque sur les lignes dessinées dans la cire, produisant des lignes et des fissures qui correspondent à l’image dessinée. Certains secteurs de l’image sont alors masqués de manière répétée, en utilisant de la cire et une laque ou un vernis, puis l’acide est à nouveau appliqué. Cette technique permet de créer des lignes de profondeur et de tonalité différentes qui changent le résultat final. Cette technique, qui demande uniquement à l’artiste de dessiner à travers la cire au lieu de devoir manier un outil qui ait la force suffisante pour couper le métal, fait que le travail coule beaucoup plus facilement qu’avec une technique de gravure classique. L’utilisation facile du stylet et la douceur des lignes résultant de l’utilisation de l’acide se combinent pour produire des caractéristiques dans l’œuvre finale qui ressemblent à celles d’un beau dessin au crayon. Il n’est pas nécessaire de graver tout le dessin au même moment. Il est possible d’appliquer des lignes, comme des hachures, sur une partie du dessin, puis de mordancer avec de l’acide et masquer cette partie avec une couche de cire pendant qu’un autre élément de l’image est en train d’être gravé. Chaque étape de ce travail est vérifiée avec une impression afin d’observer le résultat. Ces impressions de contrôle sont appelées « estampes » et beaucoup d’estampes peuvent être imprimées jusqu’à ce que la vérification finale ait été effectuée. Une autre méthode que Hopper étudia fut la gravure à pointe sèche. Cette forme de gravure utilise un stylet qui grave une planche sans utiliser de l’acide. Le stylet utilisé est plus aiguisé que le point arrondi du stylet utilisé pour la gravure à l’acide. En dessinant, le stylet coupe dans le cuivre en laissant ce que l’on appelle une « barbe » de l’un et l’autre côtés du sillon. Cette barbe donne aux dessins en pointe sèche une douceur des traits lorsque le dessin est imprimé19. Etre maître de tout le processus était également fondamental pour Hopper. Il s’acheta alors une planche à billets plate, à l’ancienne. De ses amis, C.K. Chatterton et l’illustrateur australien Martin Lewis, Hopper apprit les rudiments de la gravure et il commença à expérimenter cette technique. Il souhaitait utiliser uniquement le papier Umbria le plus blanc et l’encre la plus noire pour ses gravures finales. Trouvant qu’il était impossible d’obtenir une encre véritablement noire aux Etats-Unis, il se faisait livrer de l’encre de Francfort commandée en Angleterre. Hopper continuait à visiter les galeries avec ses amis, son voisin Walter Tittle et son ancien professeur, Kenneth Hayes Miller. Il fut particulièrement frappé par les travaux de Manet, Pissarro, Sisley, Monet, Renoir et Degas qu’il trouva à la galerie Durand-Ruel. Bien qu’une bonne partie de son travail semblait être influencée par le style de Cézanne – surtout les tableaux de rochers et de la mer faits à Ogonquit et plus tard à l’île de Monhegan – Hopper niait cette influence. Curieusement, ceux qui ne soutenaient pas Hopper dans son enthousiasme pour la gravure, assurèrent à cor et à cri, lorsqu’il avait démontré ses compétences, que c’était eux qui l’avaient persuadé de travailler cette technique. En 1916, il travailla dur la gravure en même temps qu’il continuait à faire des illustrations – pas plus de trois jours par semaine. On ne lui confiait jamais les grandes missions à cause de son incapacité à peindre le charme fragile des jolies filles et de son refus total de devoir se plier aux exigences des directeurs artistiques des grandes revues. Son terrain était celui des clients industriels, les revues commerciales et la fiction populaire de quatre sous. Au début de 1917 une nouvelle opportunité se fit jour pour exposer son travail avec le groupe du
40. Brise du soir (Evening Wind), 1921. Gravure, 33,7 x 40,6 cm.
MacDowell qui avait voyagé à Springfield (Ohio), la ville natale de Walter Tittle. Hopper participa avec
Whitney Museum of American Art, New York,
trois tableaux. L’exposition présentait des œuvres signées par les peintres habituels : Henri, Kroll, Davey,
legs de Josephine N. Hopper.
Sloan, Chatterton, Bellows et Andrew Dasburg, un peintre à cheval entre les influences de Cézanne et du cubisme. Les tableaux de Hopper ne montraient aucun lien entre eux, et il n’y avait aucune ligne
41. Edgar Degas, Femme nue se coiffant, vers 1879-1885.
directrice : Un Portrait de Mme Sullivan, dans le style d’Henri, Rochers et sable, la scène vivante d’une
Monotype, 31,3 x 27,9 cm.
rue animée et peuplée par la foule, qu’il représente en tachetant la toile avec son pinceau. La rue baigne
Musée du Louvre, Paris. 75
42. Nuit au parc (Night in the Park), 1921. Gravure, 33,7 x 37,5 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
76
43. Ombres nocturnes (Night Shadows), 1921. Gravure, 24,4 x 27,9 cm. Whitney Museum of American Art, New York, donation de Gertrude Vanderbilt Whitney.
77
dans la lumière d’un soleil de midi et on y aperçoit un tramway jaune, le tout enrichi d’un empâtement épais. L’œuvre s’appelait Rue, l’été. L’exposition présentait plusieurs tableaux des peintres les plus célèbres mais Hopper ne figurait pas sur la liste des éminences artistiques ni des peintres réputés. Lorsque American Art News publia une critique de cette exposition, le magazine la décrit comme la collection d’« un groupe de peintres astucieux du courant créé par Henri. » Hopper ne fut mentionné que parmi « les autres peintres représentés »20. Edward Hopper semblait apparemment avoir atteint à l’époque la fin de ses possibilités en ce qui concerne ses tableaux, au moins en termes de marché. Son amitié avec Walter Tittle continua à lui générer de l’emploi dans le domaine de l’illustration au fur et à mesure que Tittle devenait de plus en plus reconnu. Afin de garder son esprit créatif alors qu’il devait produire machinalement des illustrations pour payer ses factures, Hopper continua à améliorer ses compétences en gravure et continua à attendre de nouvelles occasions pour exposer son travail. Il fut invité à participer à la première exposition annuelle de l’organisation Painter-Gravers of America, qui fut fondée pour améliorer la qualité des gravures en Amérique. Parmi les fondateurs de ce groupe étaient George Bellows, qui réalisait des lithographies, et John Sloan, qui créait des gravures sur le thème de la vie urbaine depuis son arrivée à New York en 1904. L’aquarelliste John Marin avait déjà quasiment atteint les deux tiers de ce qui serait son œuvre, en produisant 180 plaques gravées entre 1905 et 191321. Julian Alden Weir, célèbre pour la spontanéité de ses pointes sèches, était le fondateur, avec Childe Hassam, qui avait gagné un grand nombre de médailles d’or pour son travail de tableaux et de gravures et qui était membre de l’endroit artistique à la mode à New York, le Club Salgamundi (véritable bouillonnement artistique). Hopper fut invité à participer avec ce groupe de graveurs expérimentés, probablement grâce à l’intervention de ses amis Bellows et Sloan car il était peu connu en tant qu’artiste graveur. Il présenta trois petites gravures et son autre ami fidèle, Guy du Bois, publia en mars 1917 l’une d’entre elles, Les Poilus (p.73), dans la revue Arts and Decoration Magazine. Puisque la gravure devenait un autre marché possible pour son travail, Hopper se sentit assez en confiance pour sous-louer son atelier et il utilisa une partie de son argent de l’illustration pour financer un autre été à Monhegan. Se promenant le long des côtes balayées par le vent et le long des baies qui accueillaient de nombreux bateaux, il échangea de nouveau des plaisanteries avec la jeune fille rousse, Josephine Nivison. Il se fit d’autres amitiés telles que celle du peintre Rockwell Kent et du passionné de gravure, Carl Zigrosser, qui travaillait pour Frederick Keppel & Co. où l’exposition des peintres graveurs avait eu lieu au printemps. Zigrosser devint plus tard le directeur de la galerie Weyhe à New York entre 1919 et 1940, puis il fut conservateur des gravures au Philadelphia Museum of Art de 1940 à 1963. Il était un collectionneur de gravures passionné et un écrivain prolifique sur le sujet. Robert Henri et Rockwell Kent se connurent à l’école de New York et Henri avait encouragé Kent à visiter Monhegan. Hopper avait le même âge que Kent et ils s’aperçurent certainement de leur intérêt commun pour la mer et pour l’énergie inépuisable de la nature. Comme Hopper, Rockwell Kent était solitaire et il rejetait toute influence des post-impressionnistes et du mouvement grandissant de l’expressionnisme abstrait. Ses lithographies étaient plus proches du réalisme de Hogarth et de Constable que de Monet ou de Cézanne. Illustrateur également, Kent avait une grande quantité de clients et il possédait par conséquent un public très large qui appréciait ses gravures dans les années 1920. Hopper vit probablement son propre avenir en tant que graveur dans le succès de Kent. Au printemps de 1918, la Chicago Society of Etchers fit appel à lui pour participer à une exposition 44. Intérieur, East Side (East Side Interior), 1922.
au Chicago Art Institute, et Hopper présenta Les Poilus, qu’il avait récemment terminé. Pour l’adapter
Gravure, 34,6 x 40,5 cm.
au public américain, il changea le nom en Somewhere in France. Pendant ce temps, il exposait
Whitney Museum of American Art, New York,
également des dessins, des aquarelles et des pastels avec le groupe de peintres du Club MacDowell. La
legs de Josephine N. Hopper.
grande participation de Hopper comprenait huit tableaux dont Quelque Part en France, La Station de métro (pp.60-61), La Fenêtre ouverte et La Corrida – un spectacle qui l’avait écœuré lorsqu’il avait visité
45. Paysage américain (American Landscape), 1920.
78
l’Espagne. Il choisit de peindre l’aspect le moins héroïque du spectacle où un picador monte un cheval
Gravure, 33,9 x 46,3 cm.
aux yeux bandés. Le cheval est transpercé par les cornes du taureau pendant que l’épaule de ce dernier
Whitney Museum of American Art, New York,
est piquée avec une banderille. Guy du Bois, dans sa critique de l’exposition pour la revue Arts and
legs de Josephine N. Hopper.
Decoration Magazine, mentionne curieusement « le maniement décoratif » réussi du sujet et il néglige
79
82
la représentation originale que Hopper fait de l’agonie du cheval, un aspect du tableau qui saute aux yeux dans l’arc linéaire horizontal de la composition. Les émotions fortes étaient rarement caractéristiques du travail de Hopper. Alors que la guerre en Europe se calmait, la réputation de Hopper s’améliorait. Il gagna un concours d’affiches subventionné par la United States Shipping Board Emergency Fleet Corporation avec une affiche qui montre un ouvrier aciériste en train de se défendre avec un marteau à long manche contre les tirs sanglants des baïonnettes, intitulé Smash the Hun. En plus d’avoir gagné le premier prix de $300, l’affiche fut publiée en couverture du Morse Dry Dock Dial Magazine par l’éditeur Bert Barnes qui avait suggéré que Hopper participât au concours. Cette revue faisait un grand usage du talent de Hopper comme dessinateur et elle appréciait la capacité du jeune homme à mettre une histoire en images. Cela lui ouvrit d’autres portes dans des revues telles que Scribners et il eut des contrats pour réaliser les couvertures couleur de la revue Hotel Management Magazine. De manière systématique, Hopper qualifiait en général ce genre de travail d’« assez terrible ». Imprimer des gravures ouvrit également de nouvelles portes à Edward Hopper et il laissait ses gravures en consigne au Chicago Art Institute, au National Arts Club de New York et chez des fabricants de gravures établis à Los Angeles. Ils les vendait à des prix modestes – moins de $20 chacune – mais son travail d’illustration paya assez pour pouvoir passer à nouveau un été insouciant et agréable en 1919 sur l’île de Monhegan avec Guy du Bois et sa femme Floy. Hopper pouvait compter sur son ami Guy pour lui faire de la publicité. Ses gravures lui avaient donné une certaine notoriété en tant qu’artiste. L’illustration – bien qu’il détestait son travail dans ce domaine – lui fournissait de l’argent et l’aidait à se construire une réputation. Il atteignait maintenant à la trentaine et les années 1920 approchaient. Pour une fois, sa vie prenait une bonne direction.
Rédemption en noir et blanc Gertrude Vanderbilt Whitney, sculptrice et mécène, fonda le Whitney Atelier Club au 4th West Street en 1918. C’était un repaire populaire pour les artistes de Greenwich Village qui pouvaient y prendre leur aise ou bien montrer leur travail. Guy du Bois obtint la possibilité de faire une exposition individuelle en novembre 1918 et il commença à insister tout de suite pour que Hopper expose également en individuel. Son insistance porta ses fruits et la salle fut réservée pour exposer le travail de Hopper en janvier 1920. Cette exposition fut la première présentation individuelle de l’art d’Edward, qui exposa pour la première fois depuis trois ans ses tableaux. L’ancien professeur de dessin de Hopper, Kenneth Hayes Miller, exposait également au Whitney Club, avec des tableaux de modèles féminins nus. Le prestige du club et les dames dévêties attirèrent les critiques. Les nus de Miller suscitèrent des commentaires convenables mais les critiques, qui connaissaient le parcours artistique de Hopper, restèrent abasourdis. Il avait ressorti toutes les vieilles toiles françaises qu’il avait exposées depuis son dernier voyage à Paris. A cette époque, Edward Hopper était déjà reconnu pour ses gravures de scènes américaines et pour ses illustrations patriotiques. Des seize huiles sur toile exposées au Whitney Club, onze étaient de Paris : Le Pont Neuf, Notre-Dame de Paris, L’Après-Midi de juin ou L’Après-Midi de printemps, Le Parc de St-Cloud, Le Quai des Grands Augustins, Le Bistrot, Le Pont des Arts, Le Louvre et la Seine, La Cité, Les Lavoirs. Les cinq restantes étaient des études de Monhegan et de la côte du Massachusetts. Guy du Bois fut sidéré et il fit de son mieux pour écrire une bonne critique dans sa revue en évitant le sujet des « vieux chevaux de bataille » français poussiéreux. Ses bonnes intentions et son langage soigneusement choisi ne suffirent cependant pas pour défendre une occasion bel et bien manquée. Aucun des tableaux ne fut vendu. Les critiques notèrent des commentaires polis sur l’artiste américain qui peignait des images françaises, puis s’en allèrent goûter le déjeuner-buffet du club. Hopper dut accepter le rejet de sa nostalgie mal venue et il continua son chemin. Il dessinait des
46. La Maison solitaire (The Lonely House), 1922.
esquisses la nuit au club, continuait son travail d’illustration, produisait des gravures avec sa planche et
Gravure, 33,9 x 42,4 cm.
attendait le voyage de l’été suivant. Son style de vie économe, son éthique de travail rigide, sa voracité
Whitney Museum of American Art, New York,
habituelle pour la lecture et l’absence de vie sociale l’avaient réduit à un fantôme squelettique et dégarni
legs de Josephine N. Hopper. 83
qui ressemblait à un prisonnier rapatrié de guerre plutôt qu’à un illustrateur reconnu. Il portait des lunettes pince-nez et il habillait son grand corps dégingandé avec un costume trois pièces. L’hiver, il portait un seau de charbon en montant les soixante-quatorze marches jusqu’à son atelier pour alimenter le poêle. Si la vie devenait trop difficile, il pouvait toujours prendre le ferry puis le train jusqu’à Nyack pour avoir un repas « fait maison » et pour passer une nuit dans son vieux lit. La « sauterelle » avait trente-huit ans et il avait besoin de faire un changement radical dans sa vie. La planche à gravure qui était au coin de son atelier continuait à produire des gravures issues de sa récolte récente de plaques de cuivre. Hopper les expédia à plusieurs galeries et à divers musées. Il notait leurs prix de vente tristement bas dans son livre de comptes. Il gagna $1594
22
en 1920
(équivalent à $15884 dollars actuels). Après avoir déduit le loyer, le matériel, le transport et quelque chose qu’il appelait des « dettes douteuses », il ne lui restait plus que $614,20 ($6120 actuels) pour vivre. L’Américain moyen gagnait en 1920 environ $100 par mois et un ouvrier de chaîne de montage dans une usine Modèle T de Ford gagnait $1800 à l’année. Edward arrivait à vivre mais il n’était pas riche. Heureusement, après la guerre, les Etats-Unis connurent une grande croissance dans l’agriculture, la manufacture, le transport et les loisirs. Pendant que l’Europe se débattait avec le problème de sa « génération perdue » de salariés, pendant qu’elle se reconstruisait et qu’elle connaissait une grande inflation, les Etats-Unis devenaient le grenier du monde et le leader mondial en technologie. Cela avait pour résultat une quantité plus importante de revenus disponibles chez la classe moyenne et haute. Cela leur permettait d’investir dans l’art et la décoration pour leurs nouvelles maisons. Posséder de l’art avait un cachet de nouveau riche qui faisait vendre et cela améliora la situation des artistes. La planche de Hopper continuait sans cesse à produire. Certaines de ses gravures les plus intéressantes et les plus célèbres des années 1920 furent : Paysage américain (pp.80-81), Brise du soir (p.74), Ombres nocturnes (p.77), Nuit dans le métro (p.91), Le Phare (p.84) et La Maison solitaire (p.82). Chacune indique une direction vers laquelle son art s’orienta et les chemins que celui-ci suivrait plus tard. Paysage américain raconte l’histoire d’un retour au foyer en 1920. Il montre un troupeau de vaches qui traverse une voie ferrée en se dirigeant vers une ferme et son étable. Une forêt capte les derniers rayons du soleil qui se couche. Ces rayons s’étalent également sur la première vache qui traverse la voie ferrée et sur l’étage supérieur d’une maison. Le ciel est dégagé et il porte encore la chaleur de l’été. La scène ne peut se passer qu’en Amérique. Les signes du progrès transpercent la prairie autrefois vierge, mais la vie continue comme elle l’a fait pendant cent ans. La technique de Hopper est vigoureuse. Il suggère plutôt que de reproduire simplement les ombres, la lumière et les masses sombres qui divisent la composition en tiers inégaux. Un cadrage pour enlever le vide qui se trouve sur les côtés de la scène principale détruirait la sensation d’un paysage ouvert et large. L’assurance qu’il avait acquise en assistant de manière assidue à des cours de dessin où il devait esquisser des modèles nus est visible dans la manière dont la jeune femme est représentée, agenouillée sur le lit face à la fenêtre dans sa gravure Brise du soir. L’image dégage un poids et une solidité. Elle regarde ailleurs vers le vide. La pièce est petite et simple, avec une cruche et un bol sur le buffet. A-telle entendu ou vu quelque chose ? Pourquoi a-t-elle besoin de se coucher nue sous la lumière devant une fenêtre ouverte ? Cette scène soulève tant de questions et il existe beaucoup d’interprétations symboliques probablement équivoques. Une des compétences savoureuses que Hopper avait réussi à développer – et qui provoquait la frustration agonisante des futurs écrivains d’art – était sa capacité à exposer la profondeur et le ronronnement de ses fantasmes internes d’une telle manière qu’il invitait le public à décharger son propre bagage psychologique sur la gravure ou le tableau qu’il regardait. Plus 47. Le Phare (Côte du Maine) (The Lighthouse, (Maine Coast)), 1921.
d’une fois, Hopper refusa de répondre à des questions qui cherchaient à analyser le contenu de son travail de manière approfondie. Dans une lettre il répondit :
Gravure, 39,3 x 43,6 cm.
84
Whitney Museum of American Art, New York,
« Il y a peu à dire. Le sujet a été complètement improvisé à partir de souvenirs d’aperçus à l’intérieur de
legs de Josephine N. Hopper.
pièces qui donnaient sur les rues de l’East Side lors de mes promenades dans cette partie de la ville. Il n’y
85
48. Le Catboat (The Catboat), 1922. Gravure, 33,9 x 40 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper. 87
88
a aucune relation avec quelque idéologie que ce soit concernant les pauvres et les opprimés. L’intérieur en lui-même était mon intérêt principal – simplement un morceau de New York, la ville qui m’intéresse tant, et le thème ne dérive pas non plus du courant appelé « Ash Can » auquel mon nom a parfois été associé à tort. »23 Quoi que les personnes disent de son travail, il était enfin en train de gagner progressivement de l’argent avec ses gravures et il réussissait à placer ses dernières œuvres dans les galeries et dans des expositions à Brooklyn, à Chicago, à Los Angeles et au Canada. Il réussit même à exposer son travail lors des expositions d’hiver et de printemps de la prétentieuse Académie nationale d’art. Il fut même comparé à l’un des graveurs chéris de l’Académie, le redoutable imprimeur et collectionneur de médailles d’or et d’argent, Childe Hassam. Au cours de l’automne de 1921, se sentant en confiance, Hopper plaça trois gravures chez le vendeur expérimenté et influent Frank K.M Rehn, pour être vendues en dépôt avec une commission de 33,33%. Un client de Rehn était le prestigieux Salmagundi Club, dont les adhérents étaient parmi les personnalités les plus en vue du monde artistique de New York. Hopper avait rendu visite à Rehn suite à la recommandation d’un vieux camarade d’école, Edmund Graecen, qui assistait aussi aux cours de William Merritt Chase, et qui est devenu plus tard le président de la Grand Central School of Art à Eastport, dans le Maine. Hopper arriva à la galerie de Rehn avec, bien sûr, une sélection de sa collection écornée de tableaux français. Rehn aperçut l’immaturité du travail, la palette impressionniste, et le caractère évident de thèmes rebattus et rejeta le lot. Alors que Hopper était debout parmi les ruines de ses anciens tableaux, un critique d’art du journal Tribune arriva par hasard et loua les vertus des gravures de Hopper qui étaient exposées sur les murs de l’Académie. Frank Rehn sentait que le travail de Hopper avait quelque chose d’intéressant mais il ne savait pas exactement quoi. Il accepta donc quelques gravures en dépôt. Les voyages de Hopper en Europe lui avaient permis de voir les gravures originales de Rembrandt. Ses gravures des années 1920 reflètent l’usage que le maître hollandais faisait de la lumière et des traits, ce qui se révèle dans des travaux tels que la quatrième estampe intitulée Les Trois Croix, gravée en 165324. Hopper poursuivait cet idéal avec ses gravures, et même s’il n’atteignit jamais la luminosité ou la subtilité de Rembrandt, il apprit et acquit assez de compétences pour donner à ses scènes un sens de la plénitude qui n’avait pas besoin d’être explicité. Les gravures du maître hollandais, cependant, avaient été conçues avec le même soin que ses tableaux. Les gravures de Hopper, bien qu’elles portassent la garantie d’un concept fort et d’une grande réalité symbolique, semblaient devoir leur existence à l’approbation des conservateurs de musée et aux galeries. Elles représentaient un mélange d’histoires et elles étaient un premier aperçu de sa vision profondément personnelle révélée en noir et blanc. Compte tenu de leur prix modeste, les gravures de Hopper devinrent des travaux qui lui généraient des pertes financières même après avoir été vendus. Hopper, à l’époque, n’était jamais loin d’exposer à nouveau. Ses collègues artistes avaient atteint des degrés variables de notoriété comme graveurs, indépendamment de leur travail de peinture à l’huile ou à l’aquarelle. Hopper maintint le comportement qu’il avait adopté en arrivant à New York : il marcha sur les pas des autres peintres. Son succès croissant comme artiste illustrateur et créateur d’affiches lui donnait une base pour continuer à placer ses gravures, son activité lui ouvrait les portes du monde des beaux-arts et de la reconnaissance qu’il avait cherchée si désespérément. Les deux œuvres Le Métro, la nuit (p.91) et Ombres nocturnes (p.77) ont leurs racines dans le genre de l’illustration. Ce sont des contes très humanistes. L’un exprime l’intimité et l’autre la crainte. Les deux auraient pu être une illustration pour une revue, ce qui constituait, à l’époque, la majeure partie de l’œuvre de Hopper. L’homme et la femme dans le wagon de Le Métro, la nuit sont plongés dans le moment présent et ignorent l’existence du public voyeur. La toile révèle une intensité et un talent de Hopper pour représenter des détails méticuleux : la main qui pend sur une sangle, l’ombre irrégulière
49. La Locomotive (The Locomotive), 1923.
des rideaux de la fenêtre, les fenêtres ouvertes qui noient leur conversation dans le bruit du vent et des
Gravure, 20,2 x 25,1 cm.
roues qui claquent sur les jointures des rails. L’intérieur du wagon, soigneusement représenté, constitue
The Museum of Modern Art, New York,
la scène de leur petit drame si intime.
donation de Abby Aldrich Rockefeller.
89
Ombres nocturnes montre un homme qui se hâte sous le regard vigilant d’un bar de coin de rue fermé qui ressemble à celui de son tableau Coin de rue américaine. L’homme entre dans la frange d’une lumière qui surgit à gauche de la composition, allumant les vitrines et étalant l’ombre longue d’un poteau non identifié sur les façades des bâtiments. L’angle sévère de l’ombre et l’intensité de la lumière laissent l’homme exposé et vulnérable et ne permet pas d’entrevoir ce qu’il y a au-delà de ce qui est couvert par l’ombre. Comme dans Le Métro, cette gravure invite le public à interpréter son histoire. Le Phare (p.85) et La Maison solitaire (p.82) n’exigent pas, d’autre part, d’explication supplémentaire. Leur image est entière et elle représente des paysages très américains. Le phare, la maison du gardien et les dépendances se perchent sur une côte rocheuse à marée basse. Le paysage est caressé par le vent et Hopper capture le poids brutal des rochers qui s’accroupissent sur la côte comme ils l’ont fait pendant des milliards d’années. Par la retombée continue des vagues, ils ont été façonnés et arrondis jusqu’à créer des et arrondis jusqu’à créer des mares et des flaques d’eau entre leurs épais doigts de pierre. Ces structures frappées par le sel apparaissent isolées et faibles, s’accrochant à la côte et se défendant contre la nature. La Maison solitaire est quasiment une créature vivante. L’image donne l’impression que le pied d’un éléphant a marqué le centre de la composition. Cette gravure date de 1922 et elle montre une maison attenante aux maisons voisines. Elle semble ressortir des maisons voisines comme s’il s’agissait de la dernière part de gâteau sur l’assiette. La personnalité sombre du bâtiment est représentée comme une fin en soi. Le portique est ouvert et les fenêtres encadrées du salon situées sous une série de stores empêchent complètement la lumière de rentrer dans les pièces. Toute l’identité de la maison repose sur sa façade en pierre ornée de colonnes, alors que le reste de la maison – là où les gens habitent – apparaît nu et ouvert sous la lumière écrasante du soleil. Les deux petits enfants qui jouent contre le mur sous le soleil sont réduits à des personnages insignifiants. Le plaisir que Hopper éprouvait à représenter des maisons et des structures simples pour les voir se suffire à elles-mêmes et la manière dont il les transformait en réceptacles de sa vision si particulière avaient commencé à prendre forme. En 1922 et 1923 sa technique de gravure et sa vision voyeuriste, scrutant dans les fenêtres et immobilisant les habitants à l’intérieur de leurs maisons dans des postures qui semblaient s’arrêter à des mi-gestes, avaient un certain attrait. Le thème récurrent de Brise du soir (p.74), Intérieur, East Side, Intérieur new-yorkais, La Baie vitrée, Intérieur au clair de lune, est celui de femmes observées par un artiste caché. A l’époque, l’utilisation de petits appareils photo, à pellicule rapide et au développement à haute énergie rendait possible un style de photographie candide, ouvrant le monde de l’image aux petites manies et aux postures inconscientes des personnes qui pouvaient être examinées minutieusement, comme s’ils n’appartenaient pas à cette vie. Les gravures de Hopper représentaient ces mêmes moments « capturés » de manière photographique. La liberté de l’artiste venait cependant s’y ajouter pour qu’il inonde chaque détail avec son symbolisme personnel, pour qu’il crée le point de vue et pour qu’il place chaque élément dans sa composition. Hopper avait passé sa vie entière à observer de loin alors qu’il dépassait progressivement le talent de ses camarades d’école et de ses amis. Son talent de dessinateur et son éducation puritaine l’avaient également cantonné à un rôle d’observateur. Il restait éloigné de l’action, des échanges avec ses pairs, des discours vantards sur la sexualité et de l’usage d’un langage grossier. L’art, comme le théâtre, est le refuge des personnes timides. Un acteur devient quelqu’un d’autre sur scène ou devant un appareil photo. Il parle de choses et fait des choses qui peuvent aller à l’encontre de sa nature. De manière semblable, un artiste exprime ses sensations et ses fantasmes sur une page, sur une toile ou sur un bloc de pierre. Hopper créa un petit groupe de personnages dans ses gravures et, plus tard, dans ses tableaux. Il s’agissait surtout de femmes au début, probablement parce qu’elles étaient toujours une énigme pour lui du fait de leur nature ambiguë, montrant parfois un visage de tendre abnégation pour se transformer 50. Nuit dans le métro (Night in the El Train), 1918.
90
rapidement en cruauté castratrice. Ces gravures artistiques étaient vues par ses pairs et par ceux qui
Gravure, 19,1 x 20,3 cm.
croyaient le connaître, comme l’expression du côté voyeuriste qui se cachait sous la coquille de Hopper.
The Philadelphia Museum of Art, Thomas Skelton
Les critiques virent dans son travail une approche fraîche d’une technique qui était devenue trop rigide
Harrison Fund, Philadelphie, Pennsylvanie.
car elle essayait d’attirer la clientèle bourgeoise qui pouvait acheter de l’art. L’Académie et de
91
92
nombreuses expositions favorisaient, à l’époque, les tableaux qui respectaient des critères d’excellence quelque peu austères : une technique bien menée, des scènes bucoliques, des allégories récurrentes, une nostalgie sentimentale, des natures mortes embaumées et des imitations incertaines de l’œuvre des artistes européens les plus reconnus. En revanche, les gravures de Hopper – ainsi que ses tableaux ultérieurs – obligeaient le public à s’arrêter, à faire des suppositions et à remplir les zones vides de l’histoire qui se déroulait avant et après l’instant capturé sur la toile. En 1923, la dernière année où Hopper se consacra à la gravure, il envoya deux reproductions simultanées de la gravure Intérieur, East Side à l’Art Institute of Chicago et au Los Angeles Museum. A sa surprise, les deux sortirent vainqueurs, gagnant le prix Logan de l’Art Institute ($25) et le prix M. et Mme William Alanson Bryan de la meilleure gravure américaine offert par la Print Makers Society of California. Lorsqu’il reçut la nouvelle, Hopper contacta Carl Zigrosserf, conservateur des gravures à la galerie Weyhe, et il augmenta fortement ses prix, poussant Brise du soir à $22 et East Side Interior à $25. S’il y eut une année qui représenta le faîte de la carrière d’Edward Hopper, ce fut 1923. Pour commencer, il arrêta de faire des gravures, redécouvrit l’aquarelle et trouva sa future femme. Si l’on en croit une documentation peu conséquente, il eut une liaison avec un de ses modèles, Jean Chéruy. Cette liaison se termina vers la fin de 1922 et Hopper se prépara à passer l’été sur la côte Est. Son succès récent comme graveur fournit une bonne partie de la motivation et des moyens financiers pour effectuer son voyage. Gloucester célébrait le tricentenaire de sa fondation, en 1623, et la ville bourdonnait d’une intense activité artistique. Deux organisations, la North Shore Arts Association, conservatrice et la Gloucester Society of Artists, libérale, montaient deux expositions opposées. Le spectacle conservateur avait un jury alors que les libéraux promettaient que leur exposition serait « ouverte à tous ». Pendant que le cliquetis et le mouvement des palettes et des pinceaux promettaient de pimenter ce haut lieu des peintres habitués, Hopper prenait conscience qu’il avait vécu de manière solitaire pendant quarante et un ans. Il n’était pas fait pour les réunions de société, mais il était un compagnon charmant en face à face lorsqu’il sentait que la personne était digne de son intérêt. Josephine Verstille Nivison faisait partie du monde artistique et bohémien de Greenwich Village. Elle travaillait dur à son métier et avait même été le sujet d’un portrait d’ensemble, intitulé Art Students et réalisé comme nous l’avons vu, par Robert Henri. Sa personnalité était extravertie et sociable. Elle mesurait un mètre cinquante-deux, couronné par une chevelure rousse cuivrée. Le trait le plus intéressant de son visage était un nez qui remontait à la pointe, lui donnant un air mutin. Née le 18 mars 1883 à Manhattan, elle passa sa petite enfance à déménager d’appartement en appartement. Elle devait supporter la promiscuité dans une cohabitation avec une tante opulente et bruyante, un père, Eldorado Nivison, un pianiste qui n’avait jamais connu le succès et qui, par conséquent, était devenu professeur de musique et sa mère, Mary Ann, dont le sang gaélique bouillonnait constamment. Pour se défendre et s’évader du chaos de sa vie familiale, Josephine dévorait les livres. Au Normal College de New York, elle obtint une licence en lettres, elle apprit le français pendant six ans et le latin pendant cinq ans. Elle avait lu, en outre, une quantité considérable de littérature classique. Comme ses parents, elle était toujours enthousiaste, pleine d’énergie et à la recherche de nouvelles façons de s’exprimer, que ce soit à travers le théâtre, le dessin ou la peinture. Après avoir passé un certain temps à prendre des cours universitaires de dessin, Josephine décida d’abandonner ses études et elle s’inscrit à la New York School of Art pour suivre des cours avec
51. Cimetière à Gloucester (Cemetery at Gloucester),
Robert Henri. Il devint son enseignant et son mentor, en ajoutant à l’enseignement artistique,
vers 1920.
l’enseignement d’une philosophie de vie particulière et libérale. Elle se plongea dans l’art du portrait
Dessin au crayon Conté, 35,6 x 53,3 cm.
et elle embrassa non seulement la philosophie d’Henri mais également sa vision de la peinture. En
Collection de Mme Lester Avnet, New York.
1906, elle quitta l’école pour commencer à enseigner dans une école de garçons à l’école privée 188, située au sud de l’East Side new-yorkais, puis à l’école PS 64, où elle resta pendant tout le printemps de 1912. L’ère des femmes soumises était en voie de disparition : un nombre croissant de femmes allaient à l’université et devenaient ainsi autonomes, obtenaient des diplômes dans diverses professions et
52. La Maison Adam (Adam’s House), 1928. Aquarelle, 40,6 x 63,5 cm. Wichita Art Museum, Wichita, Kansas, Collection Roland P. Murdoch. 93
rentraient lentement dans le monde du travail. Dans l’univers artistique dont Josephine faisait partie – même parmi les bohémiens libéraux – les artistes femmes étaient tolérées, mais n’étaient pas invitées à exposer avec les hommes « sérieux ». Leur art, même s’il était probablement admiré pour sa simplicité, était considéré comme frivole, convenable pour passer le temps mais dépourvu de courage intellectuel. Des peintres telles que Mary Cassatt ou Georgia O’Keeffe étaient des cas rares. Dans ce contexte, les collègues féminins de Josephine se rassemblaient pour exposer ensemble. Josephine appréciait sa liberté vis-à-vis de ses parents et, à l’âge de trente ans, elle emménagea au dernier étage d’une maison ancienne au 30 West 59th Street et elle y habita en collocation avec une étudiante de chant, Susie Belden. Entièrement dévouée à sa vie d’artiste, elle traquait Henri lors de ses expositions et conférences. Ses dessins apparaissaient (gratuitement) dans la revue libérale The Masses éditée par Max Eastman. Elle connaissait également la femme de l’éditeur de cette revue, une féministe appelée Ida Rauhs. Jo jouait dans plusieurs compagnies de théâtre, généralement sans être payée, et elle enseignait toujours pour gagner un salaire annuel de $1080. Elle réservait ses étés pour suivre ses amis peintres à Ogonquit et aux villages de la côte du Maine et pour créer des aquarelles, rencontrer des amis et s’amuser. Comme nous l’avons dit, elle rencontrait fréquemment Hopper lors de ces voyages. Alors que la Grande Guerre arrivait à sa fin en 1918, elle se porta volontaire pour partir à l’étranger, en France, dans le but d’aider les hommes blessés et rendus infirmes dans les tranchées. A trente-cinq ans, elle s’amusait à regarder les sammys pour trouver un mari. Elle prit des congés, régla ses affaires et partit faire de la thérapie occupationnelle pour les militaires américains à bord du U.S.S. Sierra mis à quai à Bordeaux. Plus tard, elle travailla en Bretagne et finalement à Brest. Avant décembre 1918, elle fut atteinte d’une bronchite et elle fut renvoyée à Boston, chez elle, où les médecins déterminèrent qu’elle était « moralement et physiquement inapte pour le service », selon le chef des infirmières. En juin 1919, elle rentra à New York, où aucun emploi ne l’attendait. Jo Nivison ne travaillait pas, n’avait aucun atelier, et elle cherchait désespérément à reprendre son activité. Elle trouva un atelier dans une maison à côté de l’église de l’Ascension à Greenwich Village et elle essaya de s’établir là-bas comme artiste et comme enseignante pour enfants malades à la Williard Parker School. Là-bas elle tomba malade d’une forme légère de diphtérie. Plus tard, elle essaya d’enseigner à l’école de garçons PS 122 de New York, mais elle était physiquement et mentalement inapte pour ce genre de travail. Elle déclara que sa mauvaise santé avait été causée par son travail à l’école Williard Parker – et qu’elle n’avait pas été informée des risques pour sa santé. Elle obtint ainsi une pension d’incapacité à vie déterminée par son salaire annuel de $1750.25 Cette pension lui permit d’avoir des bases financières plus solides pour poursuivre sa carrière artistique. Josephine commença par réduire son âge (sept années), passant de trente-six à vingtneuf ans, ce qui apparaît dans le recensement. Puis elle emménagea vers de nouveaux appartements du premier étage des Vanderbilt Ateliers sur 9th Street. Entourée d’autres artistes, elle aimait cet endroit qu’elle appelait « Titmouse Terrace»26. Avec son nouvel atelier et ce nouvel espace de vie pour travailler et étudier, elle acheta également un chat, Arthur, qui fut longtemps son fidèle compagnon. Accompagnée d’Arthur, elle reprit les voyages d’été pour peindre à Provincetown, Monhegan et sur la côte du Maine. Jo produisait des douzaines d’aquarelles et elle rejoignait avec enthousiasme la saison des rencontres, retrouvant sa santé et se faisant de nouveaux amis avec sa personnalité joyeuse et son énergie, en apparence sans bornes. Elle trouva un endroit pour exposer son travail à la Belmaison Gallery of Decorative Arts et fit une exposition avec un thème d’intérieur. Elle présenta une aquarelle : Provincetown Bedroom. Une gravure de Hopper était également exposée à cette occasion : Intérieur, East Side. Elle exposa des aquarelles de fleurs dans une autre exposition partagée avec Charles Sheeler, Walter Tittle, Joseph Stella et Charles Demuth. En décembre 1922, le catalogue d’une exposition à laquelle elle avait participé avec d’autres artistes importants tels que Modigliani et Picasso déclarait que 53. La Maison Talbot (Talbot’s House), 1926.
96
« les aquarelles de Nivison ajoutent une touche joyeuse de couleur à l’ensemble ». Elle commençait à
Aquarelle, 40,6 x 50,8 cm.
se faire remarquer et elle dut sentir que son voyage à Gloucester, durant l’été de 1923, serait plein de
Collection privée.
promesses créatives.
97
A
MOUR ET AQUARELLES
100
E
dward Hopper était sur un nuage. Ses gravures lui avaient permis d’atteindre un niveau semblable à celui de ses pairs et la fréquence avec laquelle il les exposait générait une demande encore plus
« Si je pouvais le dire avec des mots, il n’y aurait aucune
forte. Il avait atteint l’âge mûr de quarante et un ans et il avait passé les vingt dernières années seul
raison de peindre. »
à Manhattan. Ses liaisons ratées avec Enid Saies à Paris et avec Jean Chéruy à New York avaient fait
— Edward Hopper
diminuer son espoir de trouver l’âme sœur, mais sa carrière semblait bien en main lorsqu’il posa ses valises à Gloucester en juillet 1923. Il avait déjà remarqué une petite rousse à Gloucester, à Monhegan et dans les endroits de la Nouvelle Angleterre fréquentés par les autres artistes. Elle était souvent parmi un groupe d’autres peintres qu’il connaissait. Elle parlait et riait facilement. Un jour, il réussit à capter son attention. « Hé, j’ai vu votre chat hier » lui dit-il.
27
Josephine, qui avait amené Arthur avec elle à Gloucester, jaugea Hopper. Elle le trouva « grand, maigre et affamé », tout en s’avouant qu’elle trouvait les grands hommes plutôt intéressants. Leurs chevalets se trouveraient bientôt côte à côte et ils faisaient ensemble des promenades régulières tôt le matin. Hopper se lança un matin, alors que les vagues s’écrasaient contre les rochers de Bass Rock, en lui récitant en français un poème d’amour de Verlaine tiré d’un livre que lui avait donné Jean Chéruy. Lorsqu’il s’interrompit au milieu d’un vers, Jo le reprit instantanément, en français, sans en rompre le rythme. Hopper remarqua probablement la facilité de Josephine à réaliser des aquarelles en plein air. Elle peignait tout le temps dehors à la lumière naturelle. Pour la première fois depuis 1906, lorsqu’il s’était essayé à l’aquarelle en peignant des caricatures à Paris, il reconsidéra l’utilisation de cette technique pour son travail personnel. Jusqu’à l’été de 1923, Hopper avait uniquement utilisé l’aquarelle pour ses travaux d’illustration commerciale. Les éditeurs augmentaient l’usage de la photogravure en couleur et le travail fréquent de Hopper dans ce domaine lui avait permis de maîtriser la technique. Edward Hopper devait être au courant du marché croissant des aquarelles, de la même manière qu’il connaissait l’intérêt croissant pour les gravures. Des institutions telles que le Brooklyn Museum, le Worcester Art Museum, le Museum of Fine Arts de Boston et le Cleveland Museum étaient en train de se constituer des collections importantes d’œuvres américaines en aquarelle. L’art de l’aquarelle avait atteint sa maturité depuis l’œuvre brillante de Winslow Homer et de John Singer Sargent au XIXe siècle, depuis le pointillisme luminescent de Childe Hassam et les semi-abstractions fluides de John Marin qui suivirent sa première exposition individuelle à la galerie Alfred Steiglitz 291 en 1909. Hopper sortit ses tubes Windsor-Newton et ses pinceaux doux de zibeline. Il peignait à côté de Josephine, éprouvant un enthousiasme presque compétitif. Les peintres se promenaient pour chercher une belle vue du port, du bord de mer ou des vagues fringantes. Hopper et Josephine trouvaient et peignaient parfois des sujets rebattus, en essayant de ne pas mettre le pied de leurs chevalets dans le sable à l’endroit exact où un autre artiste s’était déjà installé auparavant. Hopper préférait se déplacer à l’intérieur des terres et observer de près les maisons anciennes qui semblaient pousser dans les rochers. En se séparant de son amour naturel pour la mer, il se concentra plutôt sur les maisons construites par des familles qui avaient habité près de la mer. Avec des toits mansardés en V, les maisons s’élevaient sur des rues pavées et des chaussées couvertes de sable. C’étaient des maisons simples aux façades touchées par le sel et le vent. Qu’il s’agisse de structures élégantes et ornées ou de rassemblements de grosses cabanes placées anarchiquement, les couleurs restaient vives. Les murs blanchis à la chaux étaient éblouissants sous le soleil. Les lucarnes sortaient des toits inclinés, leurs sommets disparaissant sous l’ombre profonde des avant-toits. Des moulures retournées décoraient les porches et les balustrades, leurs jointures semblaient être lissées par plusieurs générations de couches de peinture. Les cheminées de brique rouge transperçaient les toits, comme des doigts rouges sortant des maisons. Partout, des rideaux et des volets servaient à cacher l’intérieur des maisons des regards indiscrets des artistes, protégeant la vraie vie de cette ville et lui laissant un restant de dignité. Hopper aurait pu être en train de regarder sa propre maison blanche de Nyack (New Jersey), multipliée et transformée en des imitations étranges et grotesques. Eastern Point Light fut la première aquarelle que Hopper termina lors de cet été de 1923. Le phare et
54. La Mansarde (The Mansard Roof), 1923. Aquarelle sur papier, 33,2 x 46,2 cm. The Brooklyn Museum, New York.
la maison du gardien couronnée par un clocher blanc baignent dans les couleurs rose-lavande du petit matin, faisant tourner toute la palette de l’image autour des tons pastel. Ces tonalités contrastent avec le
55. Prospect Street, Gloucester, 1928.
treillis en fer délicat de la passerelle autour du phare qui est, elle, d’un noir profond. L’architecture montre
Aquarelle sur papier, 35,5 x 50,8 cm.
une solidité structurale alors que, en opposition à sa représentation des rochers dans sa gravure Le Phare
Collection privée.
101
de cette même année, les rochers semblent moins tangibles, la zone où se trouve l’herbe est un « couche sur couche » qui s’étale en cherchant ses frontières. La tour s’élève et domine une plage insignifiante. La technique souple contredit la précision qui est nécessaire pour construire un plan solide avec un seul coup de pinceau qui contient juste la quantité nécessaire de pigment d’aquarelle. Il créa avec désinvolture l’ambiance chargée de La Mansarde. Il dessina légèrement la structure et utilisa du papier pour créer un fond blanc. Hopper précipita une panoplie de lucarnes, de volets, d’avanttoits et de cheminées sur ce tableau pour caractériser les derniers étages. Sous ce fatras, des auvents d’un jaune brillant gonflent et se rétractent face au vent provenant de la mer et qui touche les terrasses des deuxièmes étages qui semblent prêtes à s’envoler. La sensation de grand vent est rendue par l’ombre vague des arbres environnants qui s’étale sur les maisons. Hopper transporta son chevalet vers le quartier italien de Gloucester où les maisons voyantes, couleur terre de Sienne, se levaient parmi le désordre et les déchets. Hopper esquissa rapidement ces maisons peu pittoresques qui montrent leur âge marqué par le climat. L’image permet facilement d’imaginer le sifflement du vent entre les bardeaux. La vitesse avec laquelle il travaillait dut laisser Jo Nivison sans haleine. Ses sujets n’étaient pas ceux des pictorialistes qui se pressaient pour peindre toujours les mêmes motifs de Gloucester. Hopper se détachait de la technique d’aquarelle des virtuoses pour peindre une vérité colorée et épurée qui montrait le caractère de ces maisons simples comme s’il s’agissait de portraits d’individus, les plaçant solidement entre la terre et le ciel, certaines plus éblouissantes que les autres, et montrant les planches de bois gris qui se cachaient sous la peinture pelée. Dans L’Eglise portugaise, seules les tours lointaines du sujet éponyme apparaissent sur le bord extrême d’une clôture en bois qui protège un terrain de jeu pour enfant. Un poteau se situe du côté droit de l’avant-plan. L’image possède une composition photographique, montrant de façon claire la relation entre ses différents éléments. La scène est pleine de vie et elle paraît avoir été jetée instantanément sur la toile, tout comme un appareil photo est capable de capter des instants de vie sur une pellicule. Ce cadrage curieux de la réalité est un avant-goût des toiles futures de Hopper représentant des ponts et des scènes urbaines qu’il n’avait pourtant pas encore perçus avec son nouveau regard, mais qu’il peindrait suite à son séjour à Gloucester en cet été de 1923. Il rentra à New York énergique et stimulé avec au moins dix-sept aquarelles réussies. Josephine avait une collection similaire, et les deux s’étaient rendus compte qu’ils avaient passé du temps à se faire la cour. A son arrivée, Jo trouva une invitation du Brooklyn museum pour exposer six de ses aquarelles dans une exposition d’aquarelles américaines et européennes. Avant l’aventure de l’été 1923, des conservateurs lui avaient rendu visite pour regarder le travail d’un autre artiste qui était sous sa coupe et ils avaient apprécié ses toiles. Elle recommanda le travail de son voisin Edward Hopper. Il avait acquis une certaine réputation comme graveur, mais pas en tant qu’aquarelliste. Il amena certains de ses tableaux pour les montrer. Les organisateurs de l’exposition du Brooklyn Museum choisirent six images de Gloucester réalisées par Hopper. Elles furent exposées à côté d’une collection plus hétéroclite de Josephine qui incluait une représentation d’Arthur, son chat. Après avoir ouvert l’exposition, les louanges des critiques se concentrèrent sur le travail de Hopper pour « sa vitalité et sa force » qui étaient si « stimulantes », ce qui fit de ses tableaux « l’un des meilleurs moments de l’exposition ». Cette fois ce fut le travail de Nivison qui passa inaperçu. Outre cette reconnaissance par la critique, Hopper découvrit qu’il avait également vendu dix-huit gravures. Le Brooklyn Museum acheta La Mansarde (p.98) pour $100. C’était le premier tableau que Hopper vendait après avoir vendu Voilier à l’« Armory Show » en 1913. Plus tard, deux de ses aquarelles furent présentées lors d’une exposition au Cleveland Museum et il gagna deux fois $25. Ce bond dans sa carrière artistique ne lui permettait néanmoins pas d’atteindre le montant des revenus qu’il gagnait dans l’illustration commerciale en 1923, mais c’était un bon début. Ces temps où Hopper et 56. Maison près de la voie ferrée
102
Nivison portaient frénétiquement leurs portfolios de peintures en montant et en descendant les escaliers
(House by the Railroad), 1925.
de leurs deux ateliers et les moments passés à manger ensemble au restaurant fortifièrent le lien personnel
Huile sur toile, 61 x 73,7 cm.
qui existait entre eux. Ils échangeaient des billets doux en français et Hopper dessinait pour elle des petites
The Museum of Modern Art, New York,
caricatures humoristiques lorsqu’ils fréquentaient le restaurant chinois du coin où on servait du chop suey.
donation anonyme.
Hopper en fit un tableau plus tard.
103
104
Vengé, Hopper intégra la 23e Exposition Internationale du Carnegie Institute à Pittsburgh. De manière prévisible et par esprit de provocation, il présenta l’un de ses tableaux parisiens, La Berge, peint sur les bords de la Seine, et, c’était prévisible, le jury refusa le tableau. Il fut prié de l’enlever, faute de quoi il lui serait demandé de payer pour sa conservation. Sa réaction à ce dernier rejet de ses aventures françaises reste inconnue, mais le tableau disparut. Edward et Jo parlèrent longtemps pendant le printemps de 1924 à propos de leur destination de l’été suivant. Josephine avait très envie de revisiter Provincetown et de faire partie de la saison artistique si dynamique de Cape Cod. Edward, cependant, était sur une lancée et souhaitait retourner à Gloucester pour reprendre son activité là où elle s’était interrompue. Ces discussions devinrent des disputes, autrement dit, une série de conflits qui s’intensifiaient et qui devinrent, par la suite, une habitude dans leur relation pendant les quarante ans qu’ils vécurent ensemble. Ils passèrent finalement de nouveau l’été à Gloucester, mais cette fois-ci en tant que mari et femme. Le 9 juillet 1924, Josephine et Hopper pressèrent Guy du Bois pour qu’il accepte de devenir le garçon d’honneur d’Edward à leur cérémonie de noces. Mais celui-ci avait d’autres projets, il n’avait pas envie et il se montra surtout méfiant lorsqu’ils lui avouèrent qu’il restait à trouver un prêtre pour officier. Ses protestations furent noyées par l’enthousiasme d’Edward et Jo et le trio commença à chercher une église – n’importe quelle église – qui pourrait les marier. Le fait qu’Edward se proclamait simplement chrétien, malgré sa stricte éducation baptiste, ne les aidait pas. Josephine était une épiscopalienne peu enthousiaste. Guy du Bois réussit finalement à leur faire comprendre qu’il avait besoin de rentrer dans le Connecticut. Il leur donna sa bénédiction puis partit. Décidés, Edward et Josephine marchèrent longtemps jusqu’à entrer dans le vestibule de l’église évangélique où ils furent reçus par le révérend Paul D. Elsessor de l’Eglise Huguenotte française.28 Rien n’aurait pu mieux leur convenir. La cérémonie se déroula en français et ils devinrent mari et femme. Quelque temps plus tard, lorsque Edward présenta sa femme aux familles Hopper et Smith réunies à Nyack, la désapprobation d’Elizabeth et de Marion, jusqu’ici célibataire, fut palpable. Personne, à leurs yeux, ne serait jamais assez à la hauteur pour épouser leur jeune prince Edward. Josephine demeura dans leur correspondance ultérieure comme « cette espèce de femme détestable ». Jo n’avait qu’Arthur le chat comme famille et Arthur semblait heureux avec sa nouvelle vie. Hopper, par contre, gardait une certaine distance par rapport à Arthur, considérant que ce chat rivalisait avec lui pour gagner l’affection et l’attention de Jo. La cohabitation – bien que Jo ait gardé son atelier sur 9th street une année supplémentaire après leur mariage – et leur nouveau statut de mari et femme amena Josephine à protester haut et fort contre les habitudes solitaires et peu sociables d’Edward. Lorsqu’elle le présentait à son grand cercle d’amis-artistes du Village, l’exubérance de Jo balayait tout sur son passage, contrairement au stoïcisme glacial et silencieux d’Edward. Hopper tendait à éviter les amis de Jo. Les journaux intimes de Jo racontent qu’elle arriva vierge au mariage. Malgré sa fréquentation du monde artistique et libéral qui aimait faire la fête et multiplier les aventures amoureuses, elle ne connaissait pas grand-chose à la sexualité. Hopper d’autre part, apparemment libéré des codes baptistes moralisateurs de bonne conduite et des péchés bibliques de la chair, ignora tout ressenti qu’il aurait pu avoir à l’égard de sa femme lors de leur première expérience sexuelle ainsi que lors des suivantes. Il lui défendait même de parler de sexualité ou de s’informer auprès de ses amies mariées, considérant qu’il s’agissait de « commérages » sur des questions privées dont personne ne devait se mêler. Hopper se présenta à leur nuit de noces avec le bagage victorien de la domination sexuelle masculine et il la prit directement et simplement, préférant, comme en témoignent les journaux intimes de Jo « …les assauts par l’arrière » !29 Pour Jo, la sexualité devint un devoir conjugal plutôt qu’un vrai échange d’affection. Dans tous les autres domaines, cependant, Jo et Edward s’appréciaient. Ils aimaient travailler ensemble et ils partageaient le goût d’une vie simple et un amour du voyage qui leur permettait de découvrir de nouveaux sujets. Elle découvrit que le silence profond de Hopper masquait une grande insécurité qui provoquait chez lui des humeurs changeantes et des attitudes égoïstes. Ces hauts et bas correspondaient
57. Maison Hodgkin, Cape Ann, Massachusetts
à l’euphorie que lui procurait son succès artistique et à l’éveil de son esprit compétitif face à la carrière
(Hodgkin’s House, Cape Ann, Massachusetts), 1928.
artistique de Jo qui se trouvait en plein développement. Une marée montante a tendance à soulever tous
Huile sur toile, 71,1 x 91,4 cm.
les bateaux sans distinction. Josephine préférait se dire que les bonnes choses qu’ils partageaient avaient
Collection privée.
105
plus d’importance que les sauts d’humeur de Hopper. Ils prirent leurs valises pour attraper le train qui les mènerait de nouveau à Gloucester. Après leur arrivée à la pension de madame Thebaud, près de Bass Rock où Hopper avait récité le poème de Verlaine à Jo, au-dessus des plages léchées par les vagues de Little Good Harbor, il partit revisiter plusieurs emplacements qu’il connaissait. Hopper vit la partie arrière de la maison des Haskell qu’il avait peinte en 1923. Cette fois, il descendit avec son chevalet et il s’installa devant le rez-de-chaussée. Il peignit le toit mansardé avec sa lucarne et l’ombre de l’avant-toit qui tombait sur les fenêtres en saillie et sur la véranda à colonnades, cette dernière s‘élevant au-dessus d’une pelouse sur laquelle on avait marché. Une fois de plus, les ombres formées par le soleil matinal fournissaient la structure du tableau. Deux poteaux qui pourraient avoir été éliminés ou considérés comme inutiles donnaient une hauteur et une profondeur supplémentaire à la scène. Chaque plan complexe de la maison fut défini avec un coup de pinceau précis, porteur d’une quantité précise d’eau et de pigment. Certains détails décoratifs en fer forgé qui se trouvaient sur les lucarnes ajoutaient des touches délicates à la multitude des volumes qui se trouvait en dessous. Les détails furent esquissés avec de rapides coups de pinceau fin. La perspective et le poids imposant de la structure montraient déjà ce que Hopper souhaitait exprimer. Cherchant des nouveaux points de vue, Hopper monta sur un chalutier fermé et condamné pour y produire Funnel of Trawler. Au départ, la composition était un mélange de formes, de lignes et d’ombres qui éclaircissait la vue des coques des bateaux de sauvetage situées sur les ponts et recouverts par leurs bâches. On aperçoit enfin les bras métaliques qui les tiennent en suspension et le gréement. Le grand tas sombre au centre de l’image représente la cheminée en fer du chalutier renforcée par des câbles d’acier qui passent juste derrière la trappe qui mène sous le pont, au centre inférieur du tableau. La dynamique compositionnelle peu commune de ce tableau devint une technique que Hopper réutilisa maintes fois par la suite. C’était, comme son aquarelle L’Eglise portugaise de 1923, une composition quasi photographique dans sa manière de placer des éléments à l’intérieur d’un cadre où tout changement d’angle, ou toute élimination d’un élément pourrait détruire l’effet de l’image. La capacité de Hopper à obliger l’œil du spectateur à percevoir les principes de base qui sous-tendent un tableau, amène cet œil à se promener en haut d’une colline dans Rochers au fort. Sous un ciel opaque et menaçant, les pierres, depuis des années entrelacées de brins d’herbe et de terre, mènent de la côte invisible vers un promontoire. Seuls un homme et son chien en occupent le sommet à côté d’une maison de bois sombre. Le reste des bâtiments qui autrefois occupait le lopin de terre semble faire maintenant partie du paysage, entremêlant leur silhouette aux couleurs délavées du vallonnement de la côte. Les critiques décrivaient unanimement ces maisons de Gloucester comme laides, vieillottes, hideuses et désagréables. Ils s’extasièrent néanmoins devant l’habileté de Hopper à extraire une certaine beauté d’une horreur architecturale. A une époque où le style d’architecture influencé par le style allemand du Bauhaus gagnait du terrain, tous les détails « bourgeois », les avant-toits, les corniches, les détails décoratifs de tout genre, étaient rejetés. Les critiques utilisaient à nouveau leurs concepts branchés pour décrire le travail de Hopper. Le talent de Hopper transformait cependant la vétusté et la monstruosité de ces maisons en belles expressions nostalgiques exprimées sur une page d’aquarelle. Comme en 1923, Edward Hopper rentra de Gloucester (Massachusetts) avec un portfolio plein de nouvelles aquarelles. Trottant à ses côtés comme un compagnon comblé, madame Hopper portait son propre lot de tableaux. Les deux discutaient pour déterminer la galerie à laquelle ils donneraient la priorité pour exposer leurs tableaux lorsque Guy du Bois suggéra la galerie qui accueillait les siens : C.W. Kraushaar Art Galleries. John Kraushaar prit l’une des aquarelles pour la regarder et secoua la tête. « Trop austère » dit-il. Hopper replia son travail et vécut à nouveau un échec cuisant. Il se souvint cependant cette fois-ci d’un propriétaire de galerie, Frank Rehn, qui avait rejeté ses tableaux français mais avait finalement accepté ses gravures. Ce dernier avait transféré sa galerie vers un emplacement plus spacieux au 693 Fifth Avenue. Il 58. Artillerie légère à Gettysburg
106
était sur le point d’organiser une nouvelle exposition pour l’automne, « Ten American Painters », où il
(Light Battery at Gettysburg), 1940.
présenterait le travail de Leon Kroll, William Merritt Chase, Abbot Handerson Thayer, Childe Hassam et
Huile sur toile, 45,7 x 68,6 cm.
d’autres encore. Rehn était, en outre, devenu un galeriste très demandé pendant l’année qui venait de
Nelson Gallery-Atkins Museum, Kansas City, Missouri,
s’écouler, surtout pour les peintres américains qu’il parvenait à promouvoir en exclusivité. Hopper se
donation des Friends of Art.
présenta devant lui avec son lot d’aquarelles rejetées.
107
59. Route 6, Eastham, 1941. Huile sur toile, 68,6 x 96,5 cm. Swope Art Museum, Terre Haute, Indiana.
108
60. Après-Midi à Cape Cod (Cape Cod Afternoon), 1936. Huile sur toile, 86,3 x 127 cm. Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Pennsylvanie.
109
110
Rehn était en train de sortir pour aller déjeuner et il demanda à Hopper d’étaler ses tableaux dans l’arrière-boutique pour les voir une fois qu’il serait rentré. Tandis que Rehn se préparait à sortir, Hopper s’exécuta. Un client qui regardait la galerie vit une de ses aquarelles où apparaissait une maison victorienne. « Cette maison ressemble énormément à la maison de ma grand-mère », dit-il. Rehn vendit tout de suite le tableau et le client sortit de la galerie avec son aquarelle sous le bras. Oubliant son déjeuner, le propriétaire de la galerie examina les tableaux que Hopper avait réalisés à Gloucester et il fut alors chaleureusement accueilli dans la « famille artistique » de Rehn. Plus tard, en octobre 1924, la galerie de Rehn présenta l’exposition « Recent Watercolors by Edward Hopper » montrant seize tableaux. Il les vendit tous, chacun au prix de $150. D’un seul coup, les recettes générées par cette exposition égalèrent quasiment le total de ses revenus de l’année 1923. Un critique du journal New York Sun, Henry McBride, reçut une note de Hopper, annonçant l’exposition. Il s’agissait d’une attitude commerciale rare de la part de l’artiste. McBride répondit : « Les gravures de cet artiste met tent l’accent sur le fait que même les taudis les plus sordides ont le pouvoir de sug gérer l a beauté à un artiste… La série d’aquarelles présentées en est un bel exemple. L’artiste exprime avec une force éloquente l a beauté jusqu’ici dissimulée de quelques bâtiments, soidisant hideux, construits pendant l’administration de Garf ield. Ces demeures sont si horribles que les personnes sensibles à l a beauté ont tout à fait raison de f rémir en passant dans les rues de Gloucester devant ces vestiges d’une ère sombre de l’histoire américaine. Un artiste aura su extraire une beauté de ces demeures et il sera désor mais impossible de poser le même regard sur elles. M. Hopper n’attaque pas Gloucester avec l a férocité qui caractérise M. Burchf ield lorsque ce dernier peint des scènes de Salem (Ohio). Hopper ne se moque pas. Il ne f ulmine pas. Il s’inscrit, tout simplement, et avec plus de véhémence que l a majorité, dans une démarche qui cherche à restaurer les for mes issues de l’époque mivictorienne pour qu’elles f inissent par trouver une pl ace dans nos cœurs. »30 Le critique d’art du New York Times considéra que l’exposition était « la plus considérable » de la galerie depuis que Rehn avait ouvert ses portes un an auparavant. Charles Burchfield, un artiste déjà bien établi, était souvent comparé à Hopper car ils prenaient tous les deux plaisir à peindre des vieilles maisons, des bateaux et d’autres sujets similaires. Les sujets de Burchfield se trouvaient en Ohio, son lieu de naissance, et il était influencé par la palette des Fauves et des impressionnistes. Il avait presque onze ans de moins que Hopper. A l’âge de trente-sept ans, il réussit à exposer individuellement au Museum of Modern Art. Plus tard dans la carrière de Hopper, certains suggérèrent qu’il avait commencé à peindre des tableaux de vieilles demeures après avoir vu les aquarelles de Burchfield. Hopper nia toujours cette influence bien qu’il appréciât le travail du jeune homme. Dans les années 1920, on raccourcissait les jupes, on avalait d’un trait des boissons alcoolisées illégales, on utilisait des moteurs plus grands dans des voitures également plus grandes, on récupérait le jazz des « bars à gin » et des bars illégaux fréquentés par la population noire pour le vendre aux amateurs appartenant à la haute société. Tout le monde parlait de vitesse et de modernisme, d’art déco et de Frank Lloyd Wright, le nouvel architecte des rêves de verdure. Il fallait se débarrasser du néoclassique, de la Renaissance grecque, des influences pesantes venant de l’Europe, de l’ennui et des décors chargés. Il fallait se défaire de tout ce qui pouvait rappeler la grande corruption des gros bonnets qui avaient prospéré à la fin du XIXe siècle avant l’arrivée de Teddy Roosevelt. Il s’agissait de « nettoyer la maison de fond en comble » pour permettre à Silent Cal Coolidge de gouverner avec un style également sobre. C’était le temps de la dissonance entre cubistes et modernistes pour occuper le sommet de l’avantgarde où la ligne, la couleur et le mouvement existaient uniquement en tant que tels, sans prendre en compte les limites imposées par la réalité ou sans l’obligation de rendre un sujet reconnaissable. Un exemple de ce courant est le travail de Wassily Kandinsky qui était passé de la représentation à l’abstraction entre 1900 et les premières années de 1920. Les artistes rejetaient la réalité et se joignaient à un style qui consistait à prendre de la distance par rapport au sujet afin de pouvoir codifier l’expression la plus pure. Hopper et les autres réalistes étaient clairement en danger de devenir des anachronismes. Cependant,
61. Maison Ryder (Ryder’s House), 1933. Huile sur toile, 91,6 x 127 cm.
ses images commencèrent à se vendre à un tel point que Rehn était enchanté car les clients retournaient
Smithsonian American Art Museum, Washington, D.C.,
pour acheter des aquarelles de Hopper. En novembre, il participa avec quatre tableaux à une exposition du
legs de Henry Ward Ranger à travers la National Academy
Chicago Arts Club. La demande dépassa le nombre de tableaux disponibles. Le collectionneur bostonien
of Design.
111
John Taylor Spaulding acheta les quatre aquarelles de Hopper lors de l’exposition de Rehn en 1924. Ce riche connaisseur de beaux-arts possédait des collections de tableaux de Renoir, Cézanne, Degas et ToulouseLautrec qu’il exposait chez lui avec des tableaux américains d’Henri, Bellows, Kent et Winslow Homer, le maître. Ce fut à côté de ces tableaux de Homer que le client choisit de pendre les aquarelles de Hopper. Elizabeth Cameron « Bee » Blanchard, une collectionneuse mondaine, aidait ses amis bourgeois à décorer leurs maisons chics new-yorkaises. Elle acheta trois aquarelles de Hopper à l’exposition de Rehn et finit par posséder neuf de ses tableaux. Plus tard, elle maintint une correspondance fréquente avec Josephine.31 La gravure n’était plus le métier qui générait la majorité de ses revenus. Ses tableaux avaient pris le dessus. L’aquarelle de Hopper L’Eglise portugaise fut exposée à Chicago et à Cleveland. Il envoya également une huile sur toile de 1923 intitulée Appartements (p.205) à la Pennsylvania Academy of Fine Arts et son tableau de 1922, Restaurant new-yorkais (p.203), fut exposé pour la première fois au Cleveland Museum. Ces deux tableaux étaient importants parce qu’ils présentaient les sujets et l’approche que Hopper affectionnait pour effectuer son travail de gravure. C’étaient des scènes aperçues, dont il se souvenait et qu’il avait reconstruites plus tard au calme, dans son atelier. Appartements ressemblait à un instant de vie photographié depuis la fenêtre d’un train en mouvement ou depuis une fenêtre située de l’autre côté d’une cour. Une femme au foyer, blonde et potelée, change les draps du lit d’une chambre en coin. A seulement quelques mètres derrière elle, on aperçoit d’autres fenêtres. Les murs sont en briques recouvertes d’un enduit et les fenêtres sont à glissières verticales. Les 62. Octobre à Cape Cod (October on Cape Cod), 1946.
112
meubles sont caractéristiques du mobilier utilisé par les classes moyennes : un bureau avec un miroir
Huile sur toile, 66 x 106,7 cm.
circulaire, une chaise rembourrée et un tableau sur le mur du fond. Rien ne laisse transparaître que la
Collection Loretta et Robert K. Lifton.
scène est différente de ce qu’elle semble être. Peut-être était-ce la pièce d’une personne malade ? Peut-
être quelqu’un était-il décédé dans cette chambre et cette jeune femme fut embauchée pour nettoyer la pièce ? La lumière du soleil coule par la fenêtre arrière, ce qui laisse supposer que la pièce se trouve dans la partie supérieure du bâtiment. Influencé par ses gravures, Hopper racontaient des histoires à travers ses tableaux et cette tendance s’accentua grâce à sa passion pour le cinéma muet et ses mélodrames voyeuristes. Après avoir travaillé comme créateur d’affiches de films pendant et après la Grande Guerre, il continua à assister régulièrement à des films dans un grand nombre de cinémas qui avaient fleuri partout dans Manhattan. Chaque membre du public s’asseyait tranquillement dans l’obscurité et regardait les gens sur l’écran révéler leurs sentiments, rire, se battre, aimer et vivre des tragédies. L’éclairage austère et l’usage des ombres qui caractérisaient les tableaux de Hopper furent adoptés ultérieurement par les réalisateurs de cinéma pour créer le film noir des années 1940 et 1950. D’un point de vue stylistique, le film noir se distinguait par l’effet austère de ses clairs-obscurs et par l’usage obsédant des ombres. Mais la caractéristique la plus importante de cette cinématographie était qu’elle explorait les profondeurs corrompues de la ville américaine, l’endroit vers lequel « le rêve américain se dirige pour mourir ».
32
Restaurant new-yorkais était le même genre de tableau qui représentait une tranche de vie. Une femme est assise à une table nous montrant son dos. Elle cache partiellement l’homme avec lequel elle est en train de dîner. Une serveuse portant un tablier blanc s’occupe de la table située à leur gauche pendant que, dans le fond, d’autres gens lisent probablement le menu en attendant qu’une table se libère. C’est l’hiver. Le manteau de la femme recouvre le dos de sa chaise et un autre manteau et un chapeau sont posés sur une étagère à sa droite. L’homme porte un costume d’affaires et son expression
63. Solitude, 1944.
est tendue. La femme porte un chapeau en forme de cloche et une fourrure autour du cou. Ils sont assis
Huile sur toile, 81,3 x 127 cm.
à une table près de la fenêtre et à côté d’une plante grimpante qui n’a de feuilles que sur une seule tige.
Collection privée.
113
Tous les éléments nécessaires pour créer un petit drame sont là. L’homme pourrait être en train d’embaucher ou d’interviewer la femme pendant qu’il coupe sa grillade. Ils tiennent une discussion et paraissent profondément concentrés. Les interprétations de cette scène sont infinies. L’année 1924 fut une année magique pour Edward Hopper. Son travail se vendait et tout laissait prédire qu’il pourrait enfin cesser de travailler dans l’illustration commerciale. Il avait exposé seize aquarelles dans une arrière-boutique de la galerie de Rehn et il avait dominé l’espace de l’exposition : « Ten American Painters ». George Bellows – l’un des « dix peintres » exposés – acheta même la Maison Haskell et Maisons dans le quartier italien pour sa propre collection. Hopper dut avoir reçu la nouvelle de cet achat avec un sourire discret car Bellows avait connu un grand succès rapide dans le courant américain réaliste alors qu’Edward avait dû beaucoup lutter pour trouver sa voie. Il rentrait tous les soirs chez lui pour trouver une femme agréable et il avait toujours un compagnon pour partager des moments lorsqu’il le souhaitait. Elle avait récemment commencé à l’aider à organiser les données relatives à ses ventes dans un registre de bibliothécaire relié, en toile, qui s’avérait être très utile. Bien que Jo commençât à tenir ce registre en 1924, elle utilisa les registres précédents des comptes de Hopper et lui posa des questions pour pouvoir établir sa liste. Elle commença avec la gravure Brise du soir (p.74) qui avait été vendue en 1921, puis énuméra ses expositions collectives et individuelles, que ce soit de ses tableaux ou de ses gravures. Pour chaque entrée, Hopper fournissait un petit croquis minuscule fait au crayon ou à l’encre, reproduisant brièvement l’œuvre. Peu à peu, Josephine devenait de plus en plus précieuse pour lui. Hopper n’était pas préparé pour recevoir toute la reconnaissance qu’il avait si désespérément recherchée et qui arrivait si soudainement. Plus il devenait, grâce à son art, connu du public – au moins du public qui avait de l’importance, celui qui consommait de l’art – plus il avait des obligations sociales et professionnelles à honorer. Robert Henri et ses amis qui avaient connu la réussite (George Bellows, Leon Kroll, Guy Pène du Bois, John Sloan, Ernest Lawson, George Luks, Everett Shinn, William Glackens, Arthur Davy et Maurice Prendergast) avaient appris la valeur de leur image et l’art de se faire de la publicité. Pendant que Hopper marchait sur leurs pas, cherchant des expositions, des galeristes et des acheteurs, il n’avait pas eu l’intention de dévoiler ne seraitce qu’une petite partie de son intimité. Madame Josephine Hopper devint son agent de publicité, le présentant (prudemment) aux amis qui seraient susceptibles de pouvoir exposer ou acheter son travail, et elle devint aussi son chien de garde, filtrant ses contacts avec le monde extérieur et chassant les personnes nuisibles. Bien qu’elle fût farouchement attachée aux heures passées devant son chevalet et bien qu’elle ait gardé la vie privée de Hopper loin des regards du grand public, Josephine était bavarde avec ceux qu’elle considérait comme des amis proches. Ses lettres et ses journaux intimes racontent les excentricités quotidiennes de Hopper, son entêtement affolant et le flot de commentaires négatifs sur son travail à elle. Chaque fois que leurs échanges violents aboutissaient à des gifles et des morsures, à des coups de pied et à des cris, les combats étaient entendus par tous leurs voisins à travers les murs fins de leur appartement au 3 Washington Square. Hopper aimait lire les critiques qui essayaient de le caser dans une « école » ou qui tentaient de définir son travail tout en s’extasiant devant sa manière de rendre beaux, ou du moins acceptables, des bâtiments horribles. Il n’avait jamais rejoint une cause ou exposé une théorie et il n’était sans doute pas un artiste affilié à une école. Hopper était, ou voulait être, un peintre qui avait de l’argent dans sa poche, des ventes à l’horizon et des vents favorables.
De Nouvelles Aventures Le 8 janvier 1925, l’année commença avec le décès de George Bellows. Pratiquement toute la communauté artistique assista aux obsèques et Hopper fut particulièrement touché par ce décès. Il peignit une aquarelle déserte intitulée Le Jour après l’enterrement, d’où se dégageait un ton de sombre désespoir qui était rare dans sa peinture. La mort prématurée de Bellows est arrivée au moment où l’étoile de 64. Route dans le Maine (Road in Maine), 1914.
114
Hopper s’élevait. Dans le même temps, ce décès rappelait à Hopper son statut de mouton noir au sein de
Huile sur toile, 61,6 x 74,3 cm.
la clique d’Henri. Le galeriste privé E.P. « Ned » Jennings venait de vendre quinze gravures de Hopper au
Whitney Museum of American Art, New York,
Metropolitan Museum of Art alors que Bellows avait pu faire sa première exposition individuelle dans ce
legs de Josephine N. Hopper.
musée dès 191133.
115
65. Rochers et maisons, Ogunquit (Rocks and Houses, Ogunquit), 1914. Huile sur toile, 61,6 x 74,3 cm. Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper.
116
118
Hopper avait cependant peu de temps pour s’attarder sur sa tristesse. En mars 1925, l’huile sur toile intitulée Appartements qu’il avait exposée à la Pennsylvania Academy of Fine Arts fut achetée par cette institution pour $340 dollars ($3872 dollars actuels) moins la commission de 15% qu’il payait à la galerie de Rehn. Deux mois plus tard, le Whitney Atelier lui demanda d’exposer lors de leur dixième exposition annuelle aux Anderson Galleries. Hopper ressortit de sa pile de toiles celles qui avaient été accueillies avec des bâillements lors des expositions précédentes, Coin de rue à New York réalisée en 1913 et Yonkers (p.56) de 1916. Ses dernières créations se trouvaient chez Rehn. Josephine continua à exposer son travail sous son nom de jeune fille et elle participa, avec deux tableaux, à l’exposition du Whitney Club : Un Arbre et Un Goût de Boston. Elle connut un tournant dans sa vie de femme et d’artiste indépendante lorsque Arthur, le chat, disparut. Après une recherche infructueuse, elle décida de renoncer à son atelier sur 9th Street où Arthur habitait loin de Hopper. Elle porta ses toiles au 3 Washington Square et les mit dans la zone de stockage du sous-sol puis habita à plein temps dans l’atelier de Hopper. Puisque l’atelier était le domaine d’Edward, elle installa son chevalet dans la cuisine. Pour montrer son travail aux visiteurs, elle était obligée de monter les tableaux qu’elle avait laissés au sous-sol. Outre l’accueil mitigé, pour ne pas dire carrément hostile, que Hopper réservait aux amis et aux mentors de Jo, elle subissait l’attitude de plus en plus condescendante d’Edward en ce qui concernait sa carrière indépendante d’artiste femme. Mais Hopper avait peu de temps pour s’attarder sur les sentiments de Jo. Son ami et son agent publicitaire personnel, Guy du Bois, venaient de vendre sa maison à Westport, dans le Connecticut, et il partait en bateau pour Paris avec sa femme, Floy, pour s’y installer à long terme. Avec le départ de Guy et s’étant par ailleurs probablement lassé de Gloucester et du Nord-Est, Hopper choisit brutalement de changer de destination pour partir en train vers l’Ouest des Etats-Unis afin d’y passer l’été. La disparition du chat de Jo rendait cette décision plus facile à prendre. Edward et Jo partirent via les chutes du Niagara et Chicago vers Santa Fe (Nouveau Mexique), en louant un compartiment individuel où ils se serraient tous les deux dans l’objectif de ne pas dépenser trop d’argent. Hopper suivait à nouveau les pas de ses collègues. Robert Henri, George Bellows, John Sloan et Randall Davey avaient tous fait le pèlerinage à l’Ouest. Henri et Bellows avaient fait un voyage à Santa Fe en 1917 et Henri y alla fréquemment jusqu’en 1922. En 1919, Santa Fe avait déjà une bonne réputation parmi les artistes originaires de la côte est. De leur côté, Sloan et Davey avaient convaincu leurs femmes de faire tous ensemble le voyage depuis New York à bord d’une voiture Simplex 1912. Il s’agissait d’un voyage difficile à faire en 1919 vu le manque d’infrastructures telles que l’eau, les stations essence, le logement et les routes. Ils partirent quand même en emportant une lettre de recommandation rédigée par Robert Henri. Plus tard, Sloan retournerait trente fois passer l’été à Santa Fe. Il habitait et il peignait dans un atelier sur Garcia Street, dans le quartier de Canyon Road. En 1920, Davey se fit construire une maison permanente à Santa Fe dans une scierie restaurée qui avait été originellement construite sur une grande étendue de terre par l’armée américaine en 1847. Il resta dans cette propriété et continua à peindre jusqu’à son décès en 1964. Hopper posa le pied sur le sol de Santa Fe et il détesta immédiatement presque tout. Malgré son désir d’explorer le nouveau matériel visuel, il se sentait mal à l’aise d’être séparé des scènes familières de Gloucester et du bord de mer de la côte nord-est. Il évitait la foule des touristes poussiéreux qui achetaient de la poterie et des bijoux fabriqués par des Indiens qui étalaient leur marchandise sur des couvertures posées sur la place centrale. Hopper préféra se promener dans les rues latérales qui fondaient sous la chaleur du soleil. Il tomba finalement sur une scène étrangement familière et il la représenta à l’aquarelle. ll appela la scène Tours de Saint-François mais il aurait bien pu l’appeler L’Eglise portugaise II. La similarité entre ce nouveau tableau et son aquarelle de 1923 était étonnante. Dans son nouveau tableau, les deux tours de l’église se trouvent derrière une cour et un mur bas fait en adobe qui occupe l’avant-plan. Un poteau s’élève à droite, projetant son ombre sur le mur. Le mur d’une maison accapare solidement le côté gauche de la scène. Les deux tableaux représentent des églises qui se trouvent à une certaine distance derrière des clôtures et des murs, reflétant probablement la révolte de Hopper contre son éducation baptiste. Toujours à la recherche de sujets qui le motivaient, il prit ses peintures pour aller vers les voies de
66. Corn Hill, 1930. Huile sur toile, 73,6 x 109,2 cm.
chemin de fer qui se trouvaient près de la gare de Santa Fe. Il trouva là-bas une vieille locomotive à vapeur
The Marion Koogler McNay Art Institute,
Denver & Rio Grand Western numéro 177 à dix roues et une chaudière à froid. Il peignit soigneusement
San Antonio, Texas.
119
67. La Bosse du chameau (The Camel’s Hump), 1931. Huile sur toile, 81,9 x 127,6 cm. Munson-Williams-Proctor Institute, Museum of Art, Utica, New York, legs de Edward W. Root.
120
68. Collines, South Truro (Hills, South Truro), 1930. Huile sur toile, 69,5 x 109,5 cm. The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio, Collection Hinman B. Hurlbut.
121
D & R.G. Locomotive sous un ciel ensoleillé en respectant les détails de son sujet : de l’entretoise du chasse-corps à la traînée de vapeur qui serpente au-delà des camions Andrews jusque sous le tender à charbon du moteur. Son pinceau d’aquarelle suggère de manière experte ces détails d’acier et de fer lourds par des taches de couleur et des ombres désormais caractéristiques de ses portraits industriels de bateaux, de ponts et de chemins de fer. Les maisons de Santa Fe ressemblaient plus à des forts qu’à des maisons délicatement et richement ornées de la côte du Maine et du Massachusetts. Les maisons du désert du Nouveau Mexique avaient toutes des structures artisanales et des murs épais construits avec des briques d’adobe. Elles avaient des hauts plafonds et des toits de tuiles. La véranda à colonnes qui s’enroule autour de la partie avant de la Ranch House, Santa Fe était un ajout purement pratique qui avait été construit pour donner de l’ombre aux fenêtres. Il est épuisant d’imaginer Hopper traîner dans la poussière orange, dans la boue retournée par les roues des voitures et dans le fumier qui tapissait les ruelles à la recherche de corrals clôturés, de vieux hangars séchés au soleil, de rues ensoleillées bordées par des maisons en adobe. Il dévisageait probablement les mesas et les collines proches, quasi dépourvues de végétation, dans l’espoir de trouver de l’inspiration. La méthode qui consistait à éviter les scènes banales du bord de mer et à peindre l’architecture sublime et volubile avait réussi à Gloucester. A Santa Fe, il n’y avait ni mer, ni air chargé de sel pour revigorer le paysage, juste le viento caliente pendant la journée et le vent froid du désert pendant la nuit. De toutes les aquarelles réalisées à Santa Fe cet été-là, St Michaels College, Santa Fe est celui qui se rapprochait le plus de ses tableaux de Gloucester. Un ciel bleu s’étale sur la toile. Un toit mansardé constellé de carreaux blancs montre ses fenêtres qui se situent des deux côtés d’un toit vitré pentu sous lequel se trouve la balustrade d’un balcon. Hopper suggérait, à coups de balayages au pinceau, la méticulosité des ornements et des crochets décoratifs de style européen qui se trouvaient sous les avanttoits et au-dessus des grandes fenêtres françaises du premier étage aux volets fermés. Une ligne de balustres blancs et gris traverse tout le premier étage. Des arbres jettent leur ombre sur la cour d’entrée. Des statues et des clôtures en fer forgé sont suggérées. Le tableau était original, avec ses détails européens si familiers, et pourtant il disparut du travail de Hopper jusqu’ à ce qu’il ait été, après sa mort, légué au Whitney Museum. Il finit le tableau mais ne lui trouva aucun impact. Il n’y voyait aucune vérité à partager avec le public. Il perdait sa motivation. De retour dans le silence de leur pièce, Hopper persuada Jo de poser pour une aquarelle. Elle s’assit devant le miroir du bureau, le dos en direction du lit et du chevalet, flanquée des deux côtés par leurs valises. Ses cheveux emmêlés tombaient sur ses épaules. Elle portait une chemise à manches longues et rien de plus. Le titre, Intérieur, fut changé plus tard par Hopper en Modèle lisant (p.68). Ce titre symbolisait la nouvelle tâche que Jo allait devoir accomplir pendant la carrière de Hopper. A part prendre des bains de soleil, faire des balades à cheval et passer la journée à se promener dans la ville, le résultat du voyage à Santa Fe, en nombre de tableaux, fut bien maigre. Hopper n’en produisit que treize. Mais durant cette année, il allait triompher dans un autre domaine. Il réalisa sa toute dernière illustration commerciale : trois dessins pour la revue Scribner’s Magazine pour illustrer une histoire qui fut publiée en février 1927, intitulé The Distance to Casper. Il avait réussi à couper les mailles du filet et à devenir libre. Comme pour oublier les scènes arides de l’Ouest, le retour de Edward et Josephine à New York fut marqué par un plaisir renouvelé d’assister à leur théâtre bien-aimé – une addiction. Les enseignes lumineuses des théâtres de Broadway éclairaient le quartier et le nombre de pièces jouées chaque nuit dépassait les 250. Jerôme Kern, George Gershwin et Oscar Hammerstein créèrent à cette époque les productions qui les rendirent célèbres : American in Paris, Show Boat et Funny Face avec Fred et Adèle Astaire. Les Hopper avait enfin les moyens d’acheter des billets pour assister aux grands théâtres et pour regarder leurs films muets préférés. Les oscars furent présentés pour la première fois en 1927 et Wings gagna le prix du meilleur film. Al Jolson, Marie Pickford, Rudolph Valentino, Clara Bow, Richard Arlen et Charlie Chaplin y assistèrent. Edward a même gardé les talons des billets, se constituant ainsi une 69. Quartier italien, Gloucester (Italian Quarter, Gloucester),
122
importante collection d’année en année.
1912.
Every mornin’, every evenin’
Huile sur toile, 61,4 x 73,3 cm.
Ain’t we got fun?
Whitney Museum of American Art, New York,
Not much money, oh but honey’
legs de Josephine N. Hopper.
Ain’t we got fun?
123
124
(Tous les matins, tous les soirs, On s’amuse, Y’a pas trop d’argent, Oh mais ma chérie, On s’amuse). Les auditeurs de radio écoutaient Grand Ole Opry en direct depuis Nashville (Tennessee). Les juke-box débitaient des succès tels que I’ll be With You in Apple Blossom Time et I’m Just Wild About Harry pendant que des jeunes femmes délurées et des jazz-babies dansaient le Charleston et le Black Bottom. 34 Dans cette ambiance chargée, Edward Hopper peignit l’un de ses tableaux les plus célèbres, une œuvre qui cristalliserait son style et sa philosophie en une toile unique au thème récurrent. Il l’intitula Maison près de la voie ferrée (p.103). Le tableau, comme la plupart de ses œuvres significatives, fut le produit de son imagination lorsqu’il peignait au 3 Washington Square. Les éléments du tableau proviennent tous de son observation des villes de la côte Est, où les hommes qui faisaient des affaires dans l’industrie maritime avaient construit leur fortune. Les maisons grandioses étaient le symbole du succès de chacun d’eux et les architectes de l’ère victorienne avaient exigé, à l’époque, d’avoir carte blanche pour revisiter les extravagances du passé. La décoration centrale du tableau est une magnifique maison de style Second Empire aux toits mansardés. Les fenêtres en arc se trouvent sous des moulures courbées. Sur le côté de la maison ressort un porche projeté en avant. Une balustrade est placée au-dessus d’une véranda à colonnades. Lorsque Hopper vit ce genre de maisons pour la première fois aux Etats-Unis, elles lui rappelèrent probablement des souvenirs des moments passés au bord de la Seine lorsqu’ils regardaient vers le Louvre. L’ornementation exagérée de ces maisons était devenue une sorte de plaisanterie architecturale vers la moitié des années 1920. Le magnifique manoir ancien du tableau de Hopper porte, cependant, une certaine dignité au sein d’un espace vide. La douairière s’accroche jalousement à sa place privilégiée. Une bande formée par des rails d’acier décapite proprement la vieille maison. Les fenêtres glacées dévisagent des scènes extérieures qui leur semblent étrangères. Cette représentation tragique d’une élégance abandonnée au nom de l’efficacité ou d’une forme d’art écrasée par une autre était fondamentale chez Hopper, cet homme qui quitta son Nyack rural pour vivre à New York. Ce thème deviendrait par la suite récurrent chez Hopper, autant pour des sujets d’architecture que pour les personnages qui habiteraient ses maisons imaginaires. Une autre huile sur toile qui fut peinte plus tôt, en 1924, intitulé Trottoirs new-yorkais (p.235), ramène fermement Hopper vers son milieu citadin, laissant présager une série de toiles ayant pour thème l’architecture urbaine de la deuxième partie de la décennie 1920. Comme dans Maison près de la voie ferrée, un vieux bâtiment domine le tableau, ses racines profondément ancrées dans le ciment comme le souligne le poids véritable des blocs de pierre horizontaux qui forment sa façade richardsonienne. Un portique à colonnades s’étend vers le trottoir comme le pont-levis ou la herse d’un château. Les fenêtres entrent profondément dans leurs embrasures de pierre. Un vent souffle dans cette rue comme dans beaucoup d’autres tableaux de Hopper. Le vent pousse un rideau vers l’intérieur d’une pièce tandis qu’un autre rideau oscille vers l’obscurité. Sur le trottoir immaculé, le voile bleu sombre d’une infirmière flotte derrière elle en même temps qu’elle pousse un landau noir. Le poids et la solidité structurale du bâtiment lui confèrent une certaine impatience mêlée à une atmosphère angoissante, comme s’il s’agissait d’un vieux crapaud sous une véranda qui attend qu’une mouche se pose à proximité pour lui sauter dessus. Le tableau invite le spectateur à imaginer une histoire. Hopper envoya ces deux tableaux à la New Society of Artists Seventh Exhibition pour non-membres, qui se tenait aux Anderson Galleries en janvier 1926. Un journaliste du New York Sunday World qui avait tendance à transformer les noms des présidents américains en adjectifs dépoussiéra son style : « …son apothéose finale est marquée par le tableau d’une maison grantienne ou garfieldienne complètement déserte à l’exception des pistes de chemin de fer qui traversent le premier plan de la toile et par le portrait d’une résidence new-yorkaise et McKinleyenne où apparaît une infirmière à voile bleu poussant un landau. M. Hopper ne prétend pas succomber à l’esthétisme et ne reproduit pas les clichés de notre époque ».
35
Lloyd Goodrich, alors jeune critique, dit de Maison près de la voie ferrée : « …(Ce fut) le tableau le
70. Matin à Cape Cod (Cape Cod Morning), 1950.
plus frappant de toute l’exposition… Sans avoir la prétention d’être rien de plus qu’un portrait simple et
Huile sur toile, 86,7 x 102,3 cm.
direct d’une maison laide dans un endroit laid, ce tableau est l’une des pièces du réalisme les plus
Smithsonian American Art Museum, Washington, D.C.,
poignantes et affligeantes que nous ayons jamais vue ».
donation de la Fondation Sara Roby.
36
125
Beaucoup plus tard, Goodrich écrivit, « Lorsque j’ai vu pour la première fois, en 1926, Maison près de la voie ferrée de Edward Hopper, j’ai senti qu’une nouvelle vision et un nouveau point de vue sur le monde contemporain venaient de surgir dans l’art américain. »
37
Cette « nouvelle vision » suscita l’intérêt des critiques qui avaient considéré Hopper comme un peintre prometteur du réalisme américain lorsqu’en février il exposa Dimanche chez Rehn, intitulé cette fois-ci Today in American Art. Bien qu’il fût originellement prévu de l’intituler Hoboken Façade, Hopper, qui avait pris le ferry exprès en direction de cette localité du New Jersey, rentra avec un tableau beaucoup plus profond. Dans Sunday (p.128), un homme chauve portant une chemise blanche sans col avec des bretelles voyantes est assis en train de fumer un cigare. Derrière lui se trouve un rang de vieilles devantures de magasins, l’un est vide et l’autre a des volets fermés. La rue baigne dans la lumière d’un soleil éblouissant. En ce qui concerne ce tableau, les critiques ont dû puiser dans tout leur bagage personnel comme s’ils avaient vu dans le travail de Hopper des profondeurs précédemment inconnues. Ils décrirent la silhouette assise comme « impuissante » et « pathétique » ou comme un « vieux barman… planté sur le seuil de sa porte, rejeté et dans l’ennui ».38 Ce fut une rafale de commentaires sur « l’américanisme » de Hopper et l’« americanéité (sic) » d’un « …ouvrier désespérément désœuvré porteur d’une chemise ». Le journal Brooklyn Eagle nota : « en évitant les clichés, Hopper crée de la beauté et il réussit même à injecter de l’humour en réalisant une représentation astucieuse de l’endroit et du personnage. »39 Comme si toute cette reconnaissance n’était pas déjà assez pour Hopper, le Boston Arts Club l’invita à exposer en février. Il eut l’occasion de voir cinq de ses toiles françaises exposées à cette occasion, Le Louvre (p.10), Le Pont des Arts (pp.28-29), Le Quai des Grands Augustins (p.30), Écluse de la Monnaie (pp.22-23) et Notre Dame de Paris (p.36). Jo exposa également une aquarelle, Guinney Boats, sous son nouveau nom, Josephine Hopper. Après avoir porté ses tableaux d’exposition en exposition pendant tout l’hiver, il passa un printemps froid et hanta les toits du Lower Manhattan avec ses aquarelles. En 1925, Hopper avait peint l’aquarelle Ligne de toits à Washington Square qui représentait les deux étages supérieurs d’une grande maison de grès rouge qui se situait près du bâtiment où il habitait à Washington Square. La façade de cette maison est recouverte de détails que les ombres lourdes font ressortir : des corniches, des crochets, des moulures et des encadrures voûtées ou carrées autour des fenêtres. Tous ces détails sont caractéristiques de l’époque victorienne. Les murs sont blanchis à la chaux et la brique est flétrie par la lumière du soleil. Ce tableau évoque fortement sa précédente gravure La Maison solitaire (p.82). Ici, cependant, la présence de meubles de terrasse sur l’avant-plan donne une indication de la hauteur de ce bâtiment lointain. La sensation d’isolement n’en est que plus forte. En 1926, il retourna sur les toits (il y retournerait souvent tout au long des années) trouvant une beauté particulière dans les cheminées, les réservoirs, les ventilateurs et la ferronnerie comme il avait pu trouver beaux des bateaux de pêche qui flottaient dans la mer de la côte est. Il peignit plusieurs tableaux sur ce thème : Rooftops, Manhattan Bridge et Lily Apartments et Skylight. Quatre aquarelles furent déposées chez Rehn pendant qu’Edward et Jo fuyaient la ville pour retrouver leurs plages confortables de Nouvelle-Angleterre. Pendant qu’Edward et Jo s’installaient dans leur routine de travail après le voyage en train, Rehn montrait l’huile sur toile obsédante Maison près de la voie ferrée à Stephen Clark, collectionneur et héritier de la fortune de l’usine Singer. Rehn avait contacté Clark en 1924, suggérant que les dernières aquarelles de Hopper étaient « …le meilleur dans le genre depuis Homer. »40 Clark acheta le tableau pour $600 ($6872 dollars actuels). Après avoir brièvement exploré Eastport et Bangor (Maine), les Hopper arrivèrent dans le village de pêcheurs en ruine de Rockland, et Edward plongea dans l’une de ses périodes les plus gratifiantes et les plus prolifiques. Il se perdit parmi les maisons antiques et les entrepôts pour admirer le paysage austère et l’héritage d’un passé lointain. Hopper s’inspira de sa passion pour l’histoire pour créer une aquarelle insolite, Campement de guerre 71. Ville minière de Pennsylvanie
126
de Sécession (Civil War Campground). Une perspective que la plupart des artistes réalistes de l’époque
(Pennsylvania Coal Town), 1947.
auraient perçue comme dépourvue de qualités rédemptrices est présentée. Elle prête une attention
Huile sur toile, 71,1 x 101,6 cm.
particulière à la conception et au symbolisme. Lors du début de la guerre civile, le Maine avait été parmi
The Butler Institute of American Art, Youngstown, Ohio.
les premiers états à répondre à l’appel du président Lincoln pour fournir des régiments de volontaires. Ce
127
128
fut sur la colline de Tillson que dix régiments de troupes s’assemblèrent et bivouaquèrent avant de partir ajouter leurs noms à la liste des 73000 soldats originaires du Pine State. Quelque part sur la colline, une tablette en pierre rappelle ce triste événement. Hopper peint la ligne d’une colline herbeuse et dorée, au-delà de laquelle un toit de maison est visible. Un ravin remonte la crête boisée d’une colline lointaine. Trois pylônes – un élément souvent utilisé par Hopper comme élément compositionnel – s’élèvent au sommet de la colline dorée. Les petits placards isolants en verre laissent deviner qu’il s’agit de pylônes portant des fils téléphoniques. Cet élément moderne traverse ce paysage qui appartient à l’Histoire. Auparavant, Hopper représentait toujours des poteaux dépourvus de fils, mais, dans ce tableau, il les esquisse légèrement dans un ciel dégagé. Après avoir rendu hommage au temps passé, Hopper se tourna à nouveau vers ses images de chemin de fer dans Traverse de chemin de fer (Railroad Crossing). Ce tableau est un exemple de technique et de composition dynamiques transformant une scène plutôt simple en une disposition profondément réussie de couches de lumière qui s’étalent depuis la route de gravier qui traverse les voies jusqu’à l’obscurité vigoureuse et tortillante des silhouettes d’arbres qui obscurcissent quasiment les ateliers et les bâtiments du fond de la colline. Tous les traits mènent le regard rapidement vers la gauche du tableau donnant la sensation qu’un train vient juste de passer par là. Un panneau de chemin de fer sur la gauche – auquel il manque un bras – nous ramène vers le centre de l’image. Les trains passent rapidement dans ce village, ne s’arrêtant jamais pour le regarder. Maison hantée (Haunted House) est une œuvre caractéristique de Hopper. Un entrepôt muré apparaît parmi d’autres entrepôts. Le spectateur peut imaginer les centaines d’odeurs provenant des amoncellements de détritus laissés par des milliers de cargaisons à l’intérieur du bâtiment abandonné. Cet ensemble d’entrepôts aux toits inclinés semble avoir été peint hâtivement sur l’herbe dorée remuée par le vent. Ils forment un amas dont la seule valeur est son bois rongé par le sel et ensuite utilisé comme lambris dans les salons d’hommes riches. Près de la côte, Hopper trouva deux chalutiers à perche échoués et prêts à être démantelés : Beam Trawley Osprey et Bow of Beam Trawler Widgeon. Autrefois, ce village avait connu les miasmes des bateaux de pêche alimentés au charbon et il avait entendu le bruit métallique des treuils en fer ou le son grinçant des filets de chanvre pleins. A présent, la côte sentait les vieux chalutiers rouillés, les écailles de poissons pourris depuis longtemps et les flaques d’huile étalées sur le sol. Les cabestans étaient silencieux ; les trous d’écubiers dans les yeux des bateaux semblaient vides et aveugles. L’amour de Hopper pour la mer et son irrésistible sentiment de nostalgie aidèrent à redonner une dignité à ces fossiles exsangues en présentant leurs nuances de délabrement. D’habitude, Hopper travaillait près de l’endroit où il logeait, mais avec un regard nouveau et une méfiance vis-à-vis de la menaçante réalité financière qui l’attendait de retour à New York, il alla plus loin, s’aventurant entre la côte et les collines du Maine. Il peignait seul, préférant se séparer de Jo comme il le faisait également avec les autres peintres qui arpentaient cette côte rocheuse. Elle devenait une simple distraction bavarde qu’il préférait éviter. Hopper s’arrêta devant Maison Talbot (p.97) et se dut de la réduire pour la faire tenir dans son tableau. Il cadra l’image en haut – en faisant disparaître la partie du toit qui servait aux promenades de la veuve – en bas et sur les côtés. Il put ainsi peindre cette maison de brique et de pierre Second Empire, avec ses avant-toits saillants et une véranda à colonnades qui faisait le tour de la façade. La pierre était d’un blanc impeccable, blanchie à la chaux et le toit mansardé possédait une lucarne. Hopper peignit également une scène d’intérieur, thème rare chez lui. Ce fut probablement lors d’un jour pluvieux. Un orgue de salon orné apparaît avec son tabouret à coussin. Ce dernier est posé sur un tapis à motifs à côté d’une chaise à pattes de lion, en bois raffiné, d’une table au plateau en marbre et d’une lampe à pétrole émaillée. Un pupitre à musique en cuivre chargé des partitions de ses compositions préférées (jazz excepté) attend près de l’orgue dans Le Boudoir de Mme Acorn (Mrs. Acorn’s Parlor). Edward et Jo retournèrent finalement à Gloucester et y restèrent jusqu’à ce qu’il fut temps de rentrer à New York à l’automne. La valise de Hopper était pleine avec trente aquarelles et une huile intitulée Rue de Gloucester (Gloucester Street). Cette représentation de maisons le long de Church Road jusqu’au coin
72. Dimanche (Sunday), 1926.
de Pine Street aurait pu être réalisée à l’aquarelle, mais Hopper choisit néanmoins la peinture à l’huile.
Huile sur toile, 73,7 x 86,4 cm.
L’effet esquissé et désinvolte de ses aquarelles précédentes disparut dans ce tableau. La proximité
Collection Phillips, Washington, D.C.
129
73. Matin en Caroline du Sud (South Carolina Morning), 1955. Huile sur toile, 77,6 x 102,2 cm. Whitney Museum of American Art, New York, donation faite à la mémoire de Otto L. Spaeth, par sa famille. 131
dynamique des formes claires et obscures et les détails suggérés deviennent l’image éternelle de véritables maisons avec leurs sous-sols, leurs placards et leurs garde-manger, avec les casseroles sur la cuisinière et les secrets cachés au fond des tiroirs dans les chambres à coucher du premier étage. Ces maisons observent tout ce qui passe dans la rue à travers leurs façades criblées de fenêtres. A son retour à New York, Hopper apprit que son admirateur de longue date, le collectionneur de Washington, Duncan Phillips, avait acheté Sunday, le tableau qui avait permis aux critiques de laisser libre cours à leur imagination, pour une somme de $600. Lorsque Phillips écrivit Brief Estimates of the Painters, il situa Dimanche dans une ville du Midwest, omettant le fait que Hopper l’avait peint à Hoboken (New Jersey). Phillips possédait cette assurance et cette détermination que certains hommes – tels que Teddy Roosevelt – utilisent pour asseoir leur autorité. Il modifiait les lieux où Hopper avait créé ses tableaux et niait toute preuve du contraire. Il proclama que l’aquarelle Locomotive était le pur produit de la lumière romantique californienne alors que la scène provenait du Nouveau Mexique. Mais ses chèques étaient conséquents et Hopper et Rehn lui en étaient reconnaissants. Avec l’aubaine de l’arrivée de nouveaux tableaux de son artiste primé, Rehn décida de monter une exposition individuelle du travail le plus récent de Hopper, à la Saint-Valentin, le 14 février 1927. Il y présenterait un nombre de tableaux sans précédent. Pour profiter de cette opportunité, Hopper se motiva pour terminer plusieurs huiles sur toile sur lesquelles il avait travaillé dans son studio. Pour respecter le programme serré, Josephine dut s’activer également. Outre le fait de devoir actualiser les comptes d’Edward dans le grand livre vert où elle notait les ventes et de devoir encadrer ses propres productions estivales à l’aquarelle, elle dut se déshabiller et s’asseoir sur un fauteuil pour poser pour Onze Heures du matin (p.214) de Hopper. Elle mit également un chapeau et un manteau pour scruter une tasse de café et pour figurer comme le seul protagoniste de Automat (p.197). Pour La Ville (p.171), Hopper alla à nouveau sur son toit et peignit un amas orné de bâtiments victoriens qui se trouvaient de l’autre côté de la rue. Cette image était le décor central d’une scène déserte au coin de la place de Washington Square, dépourvue d’arbres et dépouillé de sa foule habituelle. Un mur lointain d’appartements établit la limite de la place et regarde en même temps l’extérieur à travers ses centaines de fenêtres. Chacun de ces trois tableaux prend Dimanche comme modèle et révèle un certain conflit interne avec le personnage principal. Même le vieux bâtiment semble regarder dehors – comme le faisait la maison de Maison près de la voie ferrée – vers un paysage qu’il ne reconnaît plus. Hopper divise ses études intérieures de personnages en deux groupes. Dans Appartements, le spectateur se sent en dehors de la scène, voyeur, jetant un regard sur ce qui se passe à l’intérieur d’une fenêtre, coupé de l’action. Dans Onze Heures du matin et Automat, le public est un fantôme inaperçu qui se trouve dans la même pièce, partageant les mêmes murs avec le personnage, mais tout reste néanmoins hors de portée. Cette dichotomie continua tant que Hopper persista à exploiter sa capacité à raconter des histoires à travers des images, talent probablement acquis lors des années passées à illustrer les histoires créées par d’autres écrivains. L’illustration commerciale, ce métier qu’il avait tant détesté, lui avait donné les outils pour poser ses propres questions à travers sa maîtrise virtuose de l’art de la peinture. Pour ce qui est des critiques publiées dans plusieurs journaux new-yorkais, l’exposition de la SaintValentin à la galerie de Rehn fut un succès. « Edward Hopper bonifie sa réputation » chantait le gros titre de la colonne de Henry McBride du New York Sun. Pour le New York World, Hopper paraissait soudain « …beaucoup plus moderne… » que son étiquette conservatrice ancienne pouvait le laisser penser. Royal Cortissoz, le « doyen des critiques d’art américains » du New York Herald Tribune pendant trente-six ans, choisit de grommeler poliment, dans son style, comme s’il avançait sur un terrain miné, pendant qu’il regardait l’exposition multitechniques de Hopper constituée de quatre huiles, douze aquarelles et plusieurs gravures. Il écrivit : « (Hopper) utilise diverses techniques avec un succès variable… C’est un graveur compétent… Il peint bien, parfois en aquarelle… Les huiles déçoivent pour l a même raison que certaines de ses aquarelles 74. Midi (High Noon), 1949.
132
qui sont peu satisfaisantes. Son toucher est lourd, presque traînant. Dans les deux techniques,
Huile sur toile, 68,6 x 99,1 cm.
M. Hopper souf f re d’un regard trop littéral et terriblement banal sur ses sujets. « L’artiste, » avait dit
The Dayton Art Institute, Dayton, Ohio,
Whistler, « transparaît au travers de ce qu’il omet ». Cet artiste fait un genre de décl aration de facto,
donation de M. et Mme Anthony Haswell.
s’appliquant à donner de chaque détail une vision l a plus ordinaire possible. »
133
75. Soir à Cape Cod (Cape Cod Evening), 1939. Huile sur toile, 76,2 x 101,6 cm. National Gallery of Art, Washington, D.C., collection M. et Mme John Hay Whitney.
134
136
Pendant que Hopper grinçait des dents à cause des analyses sophistiquées que les critiques faisaient sur son travail et leur réflexe consistant à l’étiqueter comme membre du groupe de peintres dits de « The American Scene », Josephine envoyait une aquarelle intitulée Bateaux pour être exposée au Whitney Studio. Elle utilisa son nouveau nom professionnel, « Josephine N. Hopper ». Le choix difficile de la signature de ses tableaux traduisait un problème d’identité qui la hantait de plus en plus alors que l’étoile d’Edward montait et qu’elle devenait mieux connue comme « la femme de Hopper ». Le couple de peintres Diego Rivera et Frida Kahlo connut le même problème. Alors que Rivera recevait de plus en plus de commandes pour faire des peintures murales et alors que son prestige augmentait, Frida devenait plus connue comme « l’une des femmes de Rivera » lorsqu’elle exposait ses tableaux introspectifs. Les amis de Jo lui disaient qu’elle commettait une erreur à ne pas utiliser son nom de jeune fille et ils trouvaient que son deuxième prénom, « Verstille », était très français et en harmonie avec son beau style impressionniste. Si le partage de leur identité était un point à régler, leur passion mutuelle pour le théâtre inspira une autre huile sur toile intitulée Deuxième Rang à l’orchestre (p.228) qui fut livrée à Rehn en mars 1927. Ici, un couple formellement vêtu se prépare à s’asseoir sur des places chères près du couloir à seulement un rang de distance de l’emplacement de l’orchestre. Assis à un siège des loges, une femme seule lit un programme. La composition et les couleurs guident le regard vers un homme chauve habillé en smoking qui enlève son manteau tout en examinant l’endroit. Son expression paraît incertaine. A-t-il payé cher des places pour voir un mauvais spectacle ? Sa femme a l’air résignée. Bien que Deuxième Rang à l’orchestre fût apparemment l’idée de Jo, Hopper reprit par la suite le thème du théâtre dans plusieurs tableaux. En avril, la profusion de critiques positives fut telle, particulièrement celles de Lloyd Goodrich qui avait remplacé Guy du Bois comme son supporter principal, que Hopper écrivit un article pour The Arts Magazine. Bien qu’il visât à faire l’éloge du travail de son collègue, « l’americaniste » John Sloan, maintenant qu’il avait réussi à attirer l’attention du public, Hopper en profita pour présenter son avis personnel sur l’art. Il écrivit : « La trajectoire artistique de John Sloan a suivi la trajectoire habituelle de beaucoup de peintres qui, par nécessité, se voient obligés à commencer leur carrière en tant que dessinateur et illustrateur, travail dur qui leur permet d’acquérir la compétence technique suf f isante pour pouvoir gagner leur vie, laissant le travail d’expression personnelle pour leur temps libre, et atteignant f inalement l’émancipation complète de ce travail quotidien lorsque arrive la reconnaissance. Cet entraînement dif f icile des débuts a donné à Sloan une facilité et une inventivité qu’un peintre qui n’a point connu cette expérience est rarement capable d’atteindre. » Dans ce paragraphe, Hopper décrivit sa propre montée en haut de l’échelle. Il aurait pu également reconnaître que ses compétences d’illustrateur avaient été la clé de son propre succès. Cette « facilité » et cette « inventivité » faisaient autant partie de sa trousse à outils que ses tubes de peinture Windsor Newton. Plus bas, il ajoutait : « …certains artistes font preuve d’originalité et d’intelligence, ils ne se contentent plus d’être simplement des citoyens du monde de l’art, mais restent convaincus que l’art américain, d ans un f utur proche, devra être sevré de sa mère f rançaise. Ces hommes expriment concrètement leur conviction à travers leur travail. L’appel de l a terre devient de plus en plus perceptible d ans leurs tableaux… »
41
Gail Levin, le premier biographe de Hopper, dit dans son livre Edward Hopper – An Intimate Biography que cette façon qu’a Hopper de se référer à « lui » et à « ces hommes » reflète sa conviction qu’il n’était pas possible qu’un « …rôle créatif puisse être joué par les femmes, y compris par sa femme. Son attitude envers les femmes symbolise celle de la plupart des artistes masculins de sa génération. Il était cohérent dans sa dépréciation des artistes femmes, ayant tendance à les percevoir surtout comme des dilettantes
76. Soir d’été (Summer Evening), 1947.
qui peignaient des fleurs ainsi que d’autres sujets insignifiants et qui ne causaient que des ennuis aux
Huile sur toile, 76,2 x 106,7 cm.
hommes qui étaient dans la profession. »
Collection M. et Mme Gilbert H. Kinney.
42
137
77. Deuxième Etage ensoleillé (Second Story Sunlight), 1960. Huile sur toile, 101,9 x 127,5 cm. Whitney Museum of American Art, New York, acquisition, fonds donnés par les Friends of the Whitney Museum of American Art.
138
L’idée de Josephine pour le tableau Deuxième Rang à l’orchestre la plaça dans un rôle d’inspiratrice au sein du couple. En effet, Frank Rehn vendit le tableau $1500 ($16890 dollars actuels) – le prix le plus élevé payé jusque-là pour une toile originale de Hopper. La contribution de Josephine généra également une série de tableaux sur le thème du théâtre au cours des années suivantes. Ceci durera d’ailleurs jusqu’au dernier tableau de Hopper. Riche comme Crésus et prêt à se lancer une fois de plus dans le travail, pour bénéficier de plus de mobilité et de liberté pour trouver des sujets puisqu’il disposait de plus de temps pour peindre, il acheta une voiture Dodge d’occasion de 1925. C’était une quatre cylindres à quatre portes, à carrosserie rectangulaire et au toit plat, avec une boîte de trois vitesses et des phares incrustés dans les ailes avant. Un ami à Nyack apprit la conduite à Edward pendant que Jo restait assise sur le siège arrière, étourdie et excitée, en attendant de prendre le volant elle-même. Son tour n’arriva jamais. Selon les suppositions darwiniennes de l’époque, soutenues par des faits pseudo-scientifiques, les femmes étaient en général inaptes à conduire en raison de leur instabilité émotive, de leur faiblesse physique et de leur faiblesse intellectuelle. Reléguée sur le siège arrière, Jo rageait. Pendant les vingt années qui suivirent, ce concept néandertalien de supériorité mâle au volant et la féroce défense d’Edward face à ses prérogatives fournirent des prétextes à de violentes disputes qui dégénéraient parfois et se transformaient en coups de poing, en coups de pied et en morsures. Edward se disait certainement qu’après tout, la voiture avait été achetée pour faire avancer son art, et que c’était par conséquent à lui de mener la danse.
Sur La Route avec Ed et Jo Chargeant leur voiture avec leurs valises, leurs peintures, leurs pinceaux, leurs chevalets, leur térébenthine, leur huile de lin, leurs peintures à l’huile et leurs aquarelles, leurs toiles, leurs planches à dessin, leurs crayons à mine de graphite, les autres crayons, les gommes usées, le papier, le fixateur, le vernis, le panier de nourriture, le thermos, les livres, le jerricane d’essence, le liquide à frein, un entonnoir, un siphon, une trousse à outils, des courroies de ventilateur supplémentaires, des bougies d’allumage, des bidons d’huile, une pompe à graisse, une longueur de corde et des cartes routières, les Hopper partirent par la route vers le Maine. Avec Edward aux commandes, la Dodge haletait tout au long de la route US1 à soixante-dix kilomètres/heure. Ils s’arrêtèrent à Ogunquit pour visiter C. K. « Chat » Chatterton. C’était un peintre à succès du groupe « Ash Can » de Henri et des peintres du groupe mieux connu sous le nom de « The Eight ». Hopper et lui avaient autrefois partagé un studio et ils avaient eu un parcours similaire. Chatterton était de Newburgh (New York), juste au-dessus de Nyack en longeant le fleuve Hudson. La femme de Chatterton, Antoinette, accueillit les Hopper et tint compagnie à Jo pendant que C.K. et Edward se remémorèrent les bêtises commises lorsqu’ils étaient étudiants. Les Hopper voyagèrent sur un peu plus de 500 kilomètres et ils s’arrêtèrent près de Portland. Ils trouvèrent un phare nommé « Two Lights » à Cape Elizabeth (Maine). Depuis 1828, deux tours de pierre, situées à environ 270 mètres l’une de l’autre, fournissaient l’une une lumière constante et l’autre un signal clignotant. En 1924, la gendarmerie maritime des Etats-Unis mit la tour ouest hors service, laissant marcher uniquement la tour est qui mesurait près de vingt mètres et qui avait été construite en fer forgé en 1874. La maison du gardien et une station qui lançait des signaux sonores toutes les soixante secondes par temps de brouillard restèrent également en service. 78. Lyonel Feininger, Voiliers (Sailing Boats), 1929.
Les phares avaient toujours été l’un des sujets préférés de Hopper depuis sa période étudiante à l’école
Huile sur toile, 43 x 72 cm.
des Beaux-Arts, mais la structure magnifique des « Two Lights » semblait l’obséder. Sa tour était
The Detroit Institute of Art, Detroit, Michigan.
admirablement bien proportionnée avec un double pont autour de sa circonférence et des grandes fenêtres protégeant ses lentilles et ses miroirs tournants. La maison du gardien avait des avant-toits et une
79. The Long Leg, 1935.
décoration « en pain d’épice » absolument pas fonctionnelle. Les divers hangars et les autres dépendances
Huile sur toile, 50,8 x 76,2 cm.
avaient été ajoutés selon les besoins. Ajout sur ajout, ces bâtiments semblaient s’entasser sur le flanc de
Virginia Steele Scott Foundation, Pasadena, Californie.
la colline. Pour Hopper, l’emplacement agit comme un aimant qui ne cesserait de l’attirer au cours des années qui suivirent. Il peignit trois aquarelles élégantes du phare et de ses bâtiments pendant l’été 1927.
80. La Côte Lee (The Lee Shore), 1941.
140
Phare à Two Lights (pp.146-147) est une composition qui cadre la tour pour montrer sa base en béton,
Huile sur toile, 72,1 x 109,2 cm.
une section du tunnel de bardeaux qui connecte la tour à la maison (pour permettre aux hommes de se
Collection privée.
déplacer de l’une à l’autre par mauvais temps), un morceau du sommet du toit, un arbre et un buisson
141
144
en bataille. En combinant les formes naturelles et géométriques pour réussir à former une composition irréprochablement complète, le résultat ressemble à un devoir scolaire. Deux autres aquarelles intitulées chacune Phare à Two Lights explorent l’endroit en révélant les vues depuis la tour – toujours recadrée – et montrant les dépendances dans des compositions agréables, sous un ciel bleu et dégagé. La capacité de Hopper à être fidèle aux textures et aux nuances de couleur qui se trouvent dans l’ombre ajoute une qualité presque photographique à ces tableaux, évoquant les œuvres du « précisionniste » Charles Sheeler, sans manquer de conserver la fluidité caractéristique de la technique de l’aquarelle. En 1929, Hopper créa deux huiles sur toile à Cape Elizabeth. Il peignit le phare et le poste de gendarmerie maritime situé sur la plage. La différence entre sa technique à l’huile et celle de l’aquarelle est étonnante. Alors que ses aquarelles semblent être spontanées et remplies de détails exploratoires et pertinents qui donnent à chaque surface son propre caractère, les huiles semblent sculpter des masses situées sous un éclairage trop fort. Les formes géométriques et solides sont exposées sous un soleil bas et éblouissant. La réalité des bâtiments, leur fonction et leurs habitants sont suppléés par la réalité du tableau. C’est l’intrusion de la volonté et du pouvoir de l’artiste qui transforme un message intellectuel sous-jacent en objets immaculés. Il est intéressant de comparer ces tableaux à l’huile, Lighthouse Hill et Maison du Captaine Upton’s, réalisées en 1927, où les sujets paraissaient toujours frais et passionnants, indépendamment de la technique choisie. Ces deux tableaux conservent la fraîcheur caractéristique de l’aquarelle. Dans Lighthouse Hill, Hopper laisse les ombres définir la scène avec des formes horizontales, créant un océan d’herbe onduleux qui remonte la crête où se situent la maison et la tour. La Maison du Captaine Upton’s conserve le caractère d’une maison à structure complexe avec des avant-toits décorés tout en utilisant l’opacité de la peinture à l’huile et la virtuosité de Hopper pour manier le pinceau. Ce fut un tableau dont il dut certainement savourer la création au fur et à mesure que l’image prenait forme. Pendant que Hopper peignait, Josephine cherchait – à pied – un logement pour la nuit, des endroits pour manger et des toilettes publiques ou privées pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Il leur arriva même d’utiliser des toilettes à l’intérieur d’une remise où se trouvait un seau rempli de poissons coupés et pourris servant d’appâts pour les homards. Malgré toutes ces distractions, Jo réussit à peindre quelques aquarelles pendant cette période. Ils voyagèrent finalement vers Portland où Hopper peignit l’aquarelle, Custom House (Portland) – alors qu’il était assis dans sa voiture lors d’une averse. Ce nouvel usage de l’automobile ne faisait que la rendre plus utile. Hopper se sentait de plus en plus à l’aise en voiture et il fit des voyages supplémentaires dans le Connecticut et dans le Vermont, où il produisit encore plus d’aquarelles qu’il intégra au nouveau travail qu’il déposa à la mi-octobre dans la galerie de Rehn. De là, il conduisit Jo à Nyack et il mit la Dodge au repos sur des cales pendant l’hiver. Pendant que Rehn évaluait chacune des nouvelles aquarelles de Hopper à $250, Josephine déposait une petite pile de ses derniers travaux à la boutique de souvenirs du Whitney Studio Club pour vendre chaque tableau entre $5 et $50. De retour au 3 Washington Square, Rockwell Kent avait remplacé Walter Tittle en tant que voisin des Hopper. Tittle, grâce à son succès, avait émménagé dans un endroit plus à la mode, au centre ville. Kent était très différent de son voisin drôle et collet monté. Il était également l’un des anciens camarades d’école de Hopper et il habitait avec sa nouvelle femme et les enfants de son premier mariage dans un appartement de l’étage en dessous. Il buvait malgré la prohibition et il jouissait d’une carrière réussie et créative où il mélangeait l’illustration commerciale et d’autres projets à la peinture artistique. Hopper
81. Mer houleuse (Ground Swell), 1939.
continuait à grogner en portant du charbon et en remontant les soixante-quatorze marches de l’escalier
Huile sur toile, 91,4 x 127 cm.
jusqu’à son poêle. Il peignit également une ligne de séparation sur le sol de son studio au-delà de laquelle
Corcoran Gallery of Art, Washington, D.C.,
il était interdit à Josephine de marcher.
William A. Clark Fund.
Sur le chevalet qui était dans cette zone interdite se trouvait un tableau intitulé Pharmacie (p.177) que Hopper essayait de finir avant la fin de l’année. Ses voyages sur la côte à la recherche de nouveaux sujets lui
82. Winslow Homer, Une Brise fraîche – Un Bon Vent
avaient permis de développer de nouvelles idées et ce tableau représentait cette évolution dans sa créativité.
(Breezing Up (A Fair Wind)), 1873-1876.
Hopper rôdait la nuit dans les rues et près des ponts de chemin de fer, en scrutant les fenêtres éclairées.
Huile sur toile, 61,5 x 97 cm.
Pharmacie était une représentation de la pharmacie de Silbers avec sa vitrine éclairée offrant des « médicaments
National Gallery of Art, Washington, D.C.,
sur ordonnance » ainsi que le médicament en vente libre contre la paresse intestinale, « Ex Lax ».
donation de W. L. et May T. Mellon Foundation.
145
Cette pharmacie de coin de rue jette sa lumière sur le trottoir impeccable. Les embrasures de la porte à moitié dans l’ombre la font ressembler à une île au milieu de l’obscurité. Il pourrait s’agir d’un magasin d’articles et de services où une balance servant à peser la marchandise serait plantée à l’entrée pendant la journée. Alors qu’il venait juste de s’être affranchi des menottes de l’illustration commerciale, Hopper choisit de choquer en cherchant, lors de ses excursions nocturnes, des enseignes provocantes. La réaction ne se fit pas attendre. Les suggestions d’amis et des clients de Rehn semblaient exiger que Hopper change l’enseigne du bâtiment. Hopper utilisa alors de l’aquarelle pour transformer le « x » en « s », changeant ainsi « Ex Lax » pour « Es Lax ». Un avocat de Boston, John T. Spaulding, avait déjà acheté certaines aquarelles de Hopper et il acheta Pharmacie pour $1500. Il lui fut signalé que l’enseigne avait été modifiée et l’avocat collectionneur exigea que l’original « Ex Lax » soit restauré, ce que Hopper fit avec un peu d’eau et une éponge. Pendant ce temps, une image du tableau retouché était arrivée jusqu’aux bureaux d’Ex Lax et la compagnie donna à Edward l’autorisation d’utiliser librement le nom de leur produit. Alors que l’année 1927 se terminait, l’idylle de Hopper avec l’imprimerie, ou du moins avec la gravure, arrivait également à son terme. Le 15 janvier 1928, il prit sa plaque de cuivre et il gratta à la main une image de pointe sèche directement sur le métal. Deux femmes au théâtre regardent vers les marches d’un couloir qui se situe en bas. Il appela ce dessin Le Balcon. Deux semaines plus tard, il créa une autre pointe sèche, un nouveau Portrait de Jo. Avec ces deux pointes sèches, il ferma définitivement la porte sur ce chapitre de sa carrière qui avait tant stimulé sa créativité lorsqu’il n’arrivait pas à placer ses tableaux. Grâce à son succès, les aquarelles de Hopper se vendaient de plus en plus cher. Ses tableaux étaient à présent des exemplaires uniques de son travail et n’étaient plus des copies produites avec une plaque. L’ancienne planche à billets resta dans le coin de son studio pour le restant de sa vie, reléguée au rôle d’étagère pour poser son vieux feutre usé. Au début de 1928, Hopper créa « Captain Ed Staples », un personnage imaginaire qui apparut à maintes reprises sous différentes formes sur ses tableaux aux côtés d’un ensemble d’autres personnages qui remplaçaient les personnes réelles des scènes peintes par Hopper. Ses tableaux obsédants représentaient l’anxiété urbaine ou bucolique. « Staples » fut probablement un personnage inventé à partir de plusieurs personnes que Hopper avait rencontrées lors de ses voyages en Nouvelle-Angleterre. Josephine disait que « Ed » avait été « …imaginé par E. lui-même »43. Cet homme imaginaire portant un gilet et un pantalon noirs avec une chemise sans col à manches longues qui se tient devant une maison de bardeaux dans l’encadrure d’une fenêtre en saillie, couvert jusqu’aux chevilles par l’herbe du sol, semble représenter chez Hopper « monsieur tout le monde » : les mains dans les poches, incertain de ce qu’on attend de lui, prêt pour partir à des funérailles ou à une noce. Son visage, tout comme celui de son cousin, apparaît dans des scènes qui se situent dans les stations-service du bord de route, dans une cafétéria, dans des bureaux ou dans des chambres d’appartement. C’est le compagnon fictif de Josephine, qui fut toujours le modèle de Hopper pour toutes les femmes qu’il représentait sur ses toiles. Le Captain Staples original eut cependant une vie courte. Le tableau fut détruit dans un accident de chemin de fer au retour d’une exposition du Cleveland Museum. La progéniture du personnage perdura néanmoins. La routine avait été établie et elle varierait peu au cours des années qui suivirent. D’octobre à mai, Hopper s’attelait à terminer ses tableaux et à tisser des relations publiques en écrivant, en assistant à des expositions, en donnant des interviews et en faisant ce que Jo planifiait dans son agenda. Ils prenaient la route de juin à août, voyageant vers le Nord, en Nouvelle-Angleterre ou en direction de l’Ouest jusqu’au 83. Phare à Two Lights (Light at Two Lights), 1927.
Mexique ou vers le Sud à Charlotte (Caroline du Sud). 1928 fut le dernier été insouciant avant le crash
Aquarelle sur papier, 35,2 x 50,8 cm.
boursier de 1929 et le début de la grande dépression. Bien que leurs propres finances ne furent que très
Whitney Museum of American Art, New York,
peu touchées parce qu’ils ne possédaient pas d’actions, les nouveaux riches qui avaient acheté des
legs de Josephine N. Hopper.
collections de tableaux avec les revenus qu’ils obtenaient grâce à la bourse se mirent à fréquenter de moins en moins les galeries.
84. Cinq Heures du matin (Five A. M.), vers 1937.
148
La routine de voyage et de travail en studio changea peu avec la crise car ils avaient toujours été
Huile sur toile, 63,5 x 91,4 cm.
habitués à vivre simplement. Aucun des deux ne donnait de l’importance à la mode vestimentaire. Ils
Wichita Art Museum, Wichita, Kansas,
portaient leurs habits jusqu’à ce qu’ils soient usés jusqu’à la corde au niveau des genoux et des coudes.
Collection Roland P. Murdoch.
Josephine ne réparait pas les vêtements, ne faisait pas de couture, ni de tricot ni de crochet. Elle faisait
149
152
des tapis à partir de chiffons provenant de vêtements irrécupérables. Sa mère le lui avait appris. Les Hopper mangeaient des boîtes de conserves et des repas dans des petits restaurants puisque Jo ne cuisinait pas. Ils utilisaient chaque voiture qu’ils eurent après la Dodge jusqu’à ce qu’elle soit inutilisable, puis ils achetaient une nouvelle voiture qu’ils utilisaient encore jusqu’au bout. Les Hopper continuaient à acheter le matériel nécessaire pour produire des tableaux. Ils continuaient à travailler sur leurs chevalets, à assister au théâtre ou à regarder des films. Jo parlait et Edward ne faisait même pas semblant d’écouter. Jo disait que parler à Edward revenait à jeter une pierre dans un puits profond : on ne l’entendait jamais toucher le fond. L’année 1928 commença avec des vents froids et le poêle chauffait contre le mur. Hopper termina Vue du pont Williamsburg (From Williamsburg Bridge) (p. 164), une scène qu’il avait découverte en se promenant sur l’allée piétonne du pont qui traversait l’East River. Dans son tableau, deux solides immeubles constitués d’appartements avec de très hautes corniches ornées émergent du trottoir. Ils font partie d’une façade à la structure similaire, mais avec un étage en plus. Le tableau était le résultat d’un croquis réalisé au crayon qui fut ensuite dépouillé de plusieurs détails, la ferronnerie accessoire et l’escalier de secours y compris. Cette manière de faire disparaître les détails de ses sujets devint une façon pour Hopper de réduire ses scènes aux éléments essentiels de ses compositions. La silhouette d’une femme seule est assise sur un rebord de fenêtre qui donne vers la rue. La scène laisse deviner son mode de vie. Hopper réussit à donner à ce tableau le caractère d’une photographie prise en mouvement. Au bas du tableau, il peignit la balustrade qui longeait l’allée piétonne du pont où il vit la scène du tableau. Il invite ainsi le spectateur à l’observer de la même manière que lui et conserve un élément qu’il aurait pu facilement faire disparaître de la toile, en souhaitant certainement que le public réalise où il était situé lorsqu’il trouverait cette scène. Le soin que Hopper prenait pour choisir ce qui devait être représenté sur un tableau est encore plus évident dans Washington Bridge Loop, tableau qui fut livré, selon les données enregistrées par Jo, à la galerie de Rehn le 17 avril 1928. La toile de 89 x 152 centimètres montre une altération considérable de la perspective et des relations spatiales de la scène originale. Les croquis faits au crayon lithographique et au fusain montrent la scène originale avec plusieurs éléments : une structure en ferronnerie, le pont de signalisation et ses pylônes électriques, un entassement de bâtiments mélangés dans le fond de la scène et un réverbère solitaire au premier plan. Selon Hopper lui-même – une étrange révélation si l’on prend en compte sa nature généralement réservé par rapport à son art – il avait choisi la largeur de la toile pour la mettre au service de la composition du tableau. Il souhaitait que la largeur l’aide à suggérer que le contenu du tableau s’étendait au-delà des limites de la toile, ou à lui donner « …une grande étendue latérale… pour rendre le public conscient des espaces et des éléments qui se trouvent au-delà des limites de la scène elle-même ». Celleci fut une déclaration étrange pour beaucoup de raisons, surtout parce que les déformations spatiales de cette image lui permettent de rendre une représentation unique d’une scène qui sans cela serait banale. Ses déclarations sur l’art – et surtout sur son art – s’améliorèrent en vieillissant. Hopper était un grand lecteur, comme le confirma Josephine qui endurait les longs silences de son mari et son immersion dans la littérature. Il était difficile pour lui d’écrire, mais ses contemporains s’accrochaient à chacun de ses mots comme s’il s’agissait de bijoux, tant ils étaient rares. Les esquisses préparatoires de ce tableau montrent combien il filtra les éléments de cette scène, combien il éplucha et mit de côté les détails qui pourraient distraire le spectateur et comment il choisit de laisser les masses architecturales vers l’arrière-plan. Il étira les trois plans fondamentaux à travers la largeur exagérée de la scène. Finalement, comme il l’avait fait avec la femme de la fenêtre sur Vue du pont Williamsburg, il plaça une petite silhouette d’homme habillé avec un pardessus banal et un casque d’ouvrier en train de marcher vers les ombres qui s’étalent du côté gauche du tableau. Lorsque l’esquisse et le tableau furent montrés à une exposition éducative de la Andover Academy en
85. Phare à Two Lights (Light at Two Lights), 1927. Aquarelle, 35,6 x 50,8 cm. Collection Bount, Inc., Montgomery, Alabama.
1939, Hopper sortit à Charles Sawyer, l’organisateur de l’exposition, une tirade digne du Magicien d’Oz : « Ignorez cet homme derrière le rideau. »
86. Maison du capitaine Strout, Portland Head (Captain Strout’s House, Portland Head), 1927.
« Les esquisses qui servirent de base pour le tableau ne serviront que très peu pour expliquer l’image.
Aquarelle sur papier, 35,6 x 50,8 cm.
La couleur, l a composition et l a for me ont toutes été soumises, consciemment ou pas, à un processus
The Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut,
de simplif ication considérable. »
Collection Ella Gallup Sumner et Mary Catlin Sumner.
44
153
Ces esquisses représentaient, en effet, un trésor pour les enseignants d’art qui tenteraient de percevoir et d’analyser le procédé créatif de Hopper. Le propos du peintre est à peine étrange puisque la plupart des artistes reconnus hésitent à afficher les engrenages qui font tourner la machine de leur créativité. Les historiens d’art et les enseignants peuvent uniquement être reconnaissants que Josephine ait conservé tant de dessins et d’études préparatoires de son mari. A cette époque, Edward Root, le fils du secrétaire d’Etat du président Theodore Roosevelt, Elihu Root, fit une observation particulièrement astucieuse à propos de la place de Hopper dans l’art américain. Il était déjà un collectionneur enthousiaste du travail de Charles Burchfield, peintre qui fut maintes fois comparé à Hopper. Root assista à une exposition d’aquarelles de Hopper montée par Frank Rehn pour la Art Society d’Utica (New York). Dans un article journalistique, Root énumérait les compétences de Hopper : « …son regard sur l’apparence iconique, brillante et hautement déf inie du paysage américain ; son sens des surfaces architecturales qui lui donne la capacité de sug gérer une masse plus forte dans ses représentations de bâtiments que la masse réelle de ces bâtiments ; sa capacité à éliminer ce qui est accessoire dans toute ou une partie de l’image ; son instinct dans l’utilisation ef f icace des éléments de la composition ; sa méthode ample et délibérée mais néanmoins émotionnelle lorsqu’il conf igure son œuvre ; sa connaissance de la qualité et du poids de la peinture elle-même ».45 Dans ce long cantique de louanges, Root arriva à exprimer une grande partie de ce qui constituait l’attrait pour l’œuvre de Hopper. En comparaison avec d’autres artistes contemporains qui peignaient à l’intérieur du même courant, à savoir le réalisme américain, Hopper était totalement unique. Il n’appartenait à aucune école alors que Childe Hassan s’accrochait désespérément à l’impressionnisme américain. Hopper n’utilisait pas de palette créée par quelqu’un d’autre comme le fit Charles Bellows qui disait ne pas avoir « … le sens de la couleur ». Il n’était pas esclave d’un réalisme photographique comme pouvait l’être Charles Sheeler et il n’abandonnait pas sa compréhension du réalisme pour embrasser la gymnastique mentale et psychologique du modernisme. Il ne maintenait pas non plus autour de lui un groupe d’artistes dévoués comme le faisait Robert Henri. Hopper admirait le travail de Burchfield, Kent, Bellows et Sloan, et eux, à leur tour, suivaient désormais la rapide étoile montante de Hopper. New York maintenait une activité frénétique mais les Hopper respectaient leur routine annuelle. La Dodge se dirigea à nouveau vers le Nord-Est et s’arrêta à Gloucester (Massachusetts) le 28 juin 1928. Cette fois, Hopper ouvrit ses peintures à l’huile de marque Rembrandt et il s’attaqua au paysage familier. Cape Ann Granite se caractérise par une opacité générale autour de laquelle coulait une herbe lumineuse, comme un courant d’eau autour de vieux rochers. Wagon de marchandises, Gloucester présente des touffes dorées qui brillent sur l’avant-plan du tableau. Le rayon débarque sur un poteau vertical et avance contre le vent de la côte. L’ossature d’une dameuse artisanale est abandonnée et des énormes wagons de marchandises rouge toscan se reposent sur leurs rails devant des entrepôts où tout s’entasse. Un clocher d’une église catholique semble lointain sous un ciel de fin d’après-midi. La scène est riche en détails et pourtant économe en quantité de peinture appliquée, suggérant une présentation extrêmement simple. Dans un autre état d’esprit, un portrait enjoué de Maison Hodgkin à Cape Ann montre une maison qui semble à peine posée sur le sol. Ses avant-toits ressemblent à des ailes. En dessous, des lucarnes profondes et des auvents balayés par le vent sont soumis à une brise constante, de même que les collines environnantes. Cette maison des années 1850, également appelée « The Bird House » semble compter uniquement sur la clôture solide qui traverse la partie inférieure du tableau pour se défendre contre les éléments de la nature. 87. Le Phare à Two Lights (The Lighthouse at Two Lights), 1929. Huile sur toile, 74,9 x 109,9 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Hugo Kastor Fund.
Edward et Jo partirent vers Ongonquit pour visiter à nouveau G. K. Chatterton et sa femme Antoinette dans leur pavillon d’été. Chatteron, comme Hopper, connaissait un bond dans sa carrière, ce qui lui valut beaucoup d’expositions et de reconnaissance de son travail des vingt années précédentes. A sa surprise, Chatterton qui se rappelait la réunion joyeuse de leur dernière visite trouva Hopper déprimé. Chatterton s’en souviendra, à l’âge de quatre-vingt-onze ans, lors d’un entretien du 12 mai 1971 avec le journaliste canadien Alexander Ross :
88. Chambres sur la mer (Rooms by the Sea), 1951.
156
Huile sur toile, 74,3 x 101,6 cm.
« Il (Hopper) était tout à fait déprimé, parce que c’était le milieu de l’été et il n’avait encore rien fait.
Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut,
Alors je lui ai dit, « mais, qu’est-ce qu’il y a ? Il y a assez de choses à faire ici, tu ne crois pas » ? Il
legs de Stephen Carlton Clark.
répondit, « je n’y arrive pas ». Nous sommes alors montés dans l a voiture et nous avons roulé. Nous
157
158
sommes ensuite arrivés à un endroit qui avait l’air d’être le genre de sujet qui lui pl airait. Nous nous sommes arrêtés et avons regardé… non, il n’était pas intéressé. Ce n’était pas tout à fait ce qu’il lui fall ait. Quelque chose n’all ait pas… » Bien que la plupart de ses tableaux célèbres restassent à composer, ses dépressions causées par des expectatives inabouties ou des périodes de manque d’inspiration devinrent une entrave qui fit diminuer sa production. Il s’était habitué à une routine infatigable, mais beaucoup de facteurs tels que sa santé physique, sa relation avec Josephine ou ses démons internes commençaient à ébranler le mur solide qu’il avait réussi à ériger jusque-là autour de sa personne. Après son retour à New York, à la fin du mois de septembre, Hopper laissa le résultat de tout son travail estival à la galerie de Rehn et commença à faire des études et des esquisses pour peindre un nouveau tableau à large format, comme celui de Manhattan Bridge Loop. Il planifia de revisiter le thème de Blackwell Island, cette fois-ci sous la lumière du jour par opposition à la vue de la culée de pont de l’île qu’il avait peinte, en 1911, sous la lune. Il effectuait ses esquisses en noir et blanc avec tant de méticulosité qu’il notait même à côté les couleurs qu’il avait l’intention d’utiliser pour chaque élément. L’interprétation finale de cette huile sur toile pose l’île en plein milieu de la toile, entre un ciel bleu pâle chargé de fumée beige et une rivière trouble travaillée et retravaillée jusqu’à lui donner une texture humide et mouvementée. Un groupe de nuages de type cirrocumulus en forme de V occupe le centre supérieur du tableau au-dessus des bâtiments à caractère prémonitoire. Renommé « Welfare Island » en 1921, les bâtiments de prison de l’île abritaient des criminels dangereux, Tweed le « Patron infâme » y fut prisonnier en 1874 et Arthur Simon Flugenheimer devint le brutal « Schultz hollandais » qui réclama la possession du Bronx en 1928. Alors que le tableau était presque terminé, la très dangereuse Mae West, qui ajoutait des actes d’improvisation sexuelle à sa première pièce de théâtre, Sex, passa dix jours dans cette prison. L’île de Hopper est une compilation menaçante de condamnation pénale et d’architecture publique qu’il enfonce dans l’étroite bande de terre. Un petit bateau blanc à moteur passe, quasiment sur le bord de la partie droite de la toile, comme pour alléger cette image chargée de salles de travail, de cellules de prison et de lits de charité. Comme avec ses autres tableaux d’architecture new-yorkaise, une touche d’humanité envahit la scène autrement urbaine, dépouillée et retouchée. Un autre aspect des tableaux de Hopper est son allusion récurrente au voyeurisme que les gens pratiquent consciemment, ou inconsciemment, lorsqu’ils voyagent la nuit sur un train surélevé, en scrutant les fenêtres des appartements de l’autre côté de la rue. Des estampes de vie apparaissent à travers ces fenêtres qui défilent, volets et rideaux ouverts. Ces estampes manquent souvent de contexte, invitant le spectateur à interpréter ce qu’il voit, ce qui est tout à fait caractéristique du style de Hopper. Il commença à utiliser le thème du regard extérieur vers l’intérieur des bâtiments dans Appartements en 1923 et il le reprit dans Fenêtres de nuit. Fenêtres de nuit (p.206) est une huile sur toile de 1928 qui présente un appartement en coin avec trois fenêtres. Une femme habillée en lingerie rouge se penche à la fenêtre centrale. La nuit est chaude, et un rideau flotte à l’extérieur d’une fenêtre ouverte. Bien qu’une lampe de table rouge éclaire la fenêtre à l’autre bout de la scène, la pièce est également éclairée par une lampe de plafond centrale. La femme semble inviter des étrangers et des voisins à entrer pour voir un spectacle. Bien que la genèse de ce tableau semble avoir été inspirée par des intentions nobles, tant du point de vue littéraire qu’artistique, l’image semble être également inspirée par la sexualité réprimée de Hopper, comme le montre son désir récurrent de placer des femmes nues, ou semi-vêtues, devant des fenêtres ouvertes et l’idée de chaleur ou de nuit chaude symbolisée par l’image ubiquiste des rideaux flottants. L’année 1929 trouva les Hopper et le reste de la nation prospères et dopés par leur succès. Une
89. Soleil sur Brownstones (Sunlight on Brownstones), 1956. Huile sur toile, 75,6 x 101 cm.
nouvelle exposition individuelle eut lieu à la galerie de Rehn le 21 janvier et Hopper obtint l’approbation
Wichita Art Museum, Collection Roland P. Murdock,
de la critique. Le revenu total de Hopper qui apparaît dans son livre de registre pour 1928 arriva à $8486
Wichita, Kansas.
($98804 dollars actuels). Lui et Jo avaient assez d’argent pour aller au théâtre et ils pouvaient dépenser de temps en temps un peu d’argent pour aller manger dans un bon restaurant. Jo continuait cependant
90. Gens au soleil (People in the Sun), 1960.
à acheter systématiquement leurs vêtements à Woolworths et à Sears, le dîner sortait directement d’une
Huile sur toile, 102,6 x 153,4 cm.
boîte de conserve pour être réchauffé et Edward continuait à porter des seaux de charbon du sous-sol en
Smithsonian American Art Museum, Washington, D.C.,
remontant les marches jusqu’à son poêle.
donation de S.C. Johnson & Son, Inc.
159
Un exemple de leur style de vie économe apparaît dans le tableau de 1929, Chop Suey, qui est une représentation d’un restaurant chinois bon marché qu’ils fréquentaient sur Columbus Circle. Jo eut à se dépêcher pour poser comme les trois femmes assises aux tables. Une fois ce tableau laissé chez Rehn, les Hopper cassèrent leur tradition estivale et au lieu de se diriger vers le Nord-Est, le 1er avril, avec leur fidèle Dodge, ils visèrent le Sud vers Charleston (Caroline du sud), la dernière ville à la mode chez les écrivains et les artistes. Hopper déballa ses aquarelles et Jo les rangea dans une pièce au premier étage d’une pension qui était la propriété de la veuve Gertrude Wulbern Haltiwanger. Malgré tout son charme pittoresque, Hopper trouva Charleston un peu décevant. Il fut néanmoins inspiré par le thème de la guerre civile et il réussit à imaginer beaucoup de scènes de champs de bataille. Il fixa également son regard au-delà de la baie, vers Fort Sumter. La nouvelle destination suscita finalement peu de bons tableaux. Après avoir voyagé en Virginie en traversant la vallée de Shenandoah et après avoir visité le champ de bataille de Gettysburg en Pennsylvanie, les Hopper retournèrent à New York. Ils n’avaient pas l’intention de passer l’été dans la ville étouffante et ils repartirent bientôt vers le Maine. Comme d’habitude, les brises du bord de la mer et le charme trompeur et pittoresque des villes de la Nouvelle-Angleterre les revigorèrent. Ils arrivèrent à Cape Elizabeth et Edward s’installa à nouveau face au phare de Two Lights. Il peignit un tableau à l’huile auquel il donna le même titre que l’aquarelle originale qu’il avait peinte en 1927. Il répéta ce même procédé avec le poste de la gendarmerie maritime qui était sur la plage. Ces deux tableaux ont été analysés quelques lignes plus haut et la plupart de l’énergie de Hopper pendant ce séjour d’été se tourna vers la production d’aquarelles pour pouvoir enrichir le nombre de tableaux que Rehn avait dans sa galerie. Il travaillait dur lorsque, le 22 juillet, un exemplaire de la revue Time lui apprit le décès de Robert Henri. Bien que Henri l’ait aidé à stimuler son intellect pour l’appliquer à son art, au fur et à mesure que Hopper mûrissait, le style et la palette d’Henri le séduisaient moins. Hopper se sentait également mis à l’écart du cercle obséquieux d’artistes qui se rassemblaient autour d’Henri, l’empresario, pour qu’il les aide à exposer. Hopper dit plus tard : « Il me fallut dix ans pour me remettre de ma relation avec Henri. Henri n’était pas un très bon peintre, du moins je ne crois pas qu’il l’était. Il était meilleur comme enseignant. »46 Les pérégrinations estivales générèrent deux toiles et une douzaine d’aquarelles qui finirent à New York en septembre, juste à temps pour regarder les « combinards » de la frénésie consommatrice d’actions en bourse remplir les rues, se ruant sous les hautes fenêtres des maisons de courtage. Le Jeudi Noir, le 24 octobre 1929, symbolisa l’événement qui commença à asphyxier la vie économique de l’Amérique. Hopper eut un avant-goût de ce qui allait venir lorsqu’il finit Coucher de soleil sur voie ferrée (pp.6465), l’un de ses tableaux les plus frappants. La qualité de la lumière atmosphérique qui domine la toile rappelle les peintres luministes de la Hudson School du XIXe siècle. Son utilisation du pinceau fait penser à la technique impressionniste pour évoquer une progression qui commence par un coucher de soleil rouge profond pour finir avec une voûte violette qui représente le ciel du soir. Ce tableau rappelle la technique extrême que Hopper employait souvent pour représenter le ciel et l’eau. Ces éléments provoquaient souvent chez lui des crises. Le coucher du soleil rouge sang brûle le ciel qui se trouve derrière une cabane solitaire de contrôleur de chemin de fer, à côté d’une voie ferrée vide. Cette image était probablement porteuse d’un message sous-jacent trop lourd pour les hommes d’affaires autrefois riches et qui devraient bientôt se mettre à vendre des pommes aux coins des rues pour cinq centimes la pièce. Le tableau ne suscita aucun intérêt. Les gains de Hopper pour l’année réussirent à atteindre les $6211 ($72716 dollars actuels). Bien que ses revenus aient diminué d’un montant équivalent à $25000 actuels, son prestige augmenta nettement lorsqu’il fut invité à participer à l’exposition « Paintings by Nineteen Living Americans », organisée par le Museum of Modern Art. Il s’agissait de la deuxième exposition de sa première année d’ouverture. Il intégra facilement le cercle exclusif des peintres américains les plus reconnus. Dans les vingt années qui suivirent le succès créatif d’Edward Hopper, sa vie personnelle dut endurer les conséquences de sa notoriété. En effet, la vie avec Edward devint une épreuve de plus en plus grande 91. Regards sur la mer (Seawatchers), 1952.
162
pour Josephine. Elle devait littéralement se battre pour exister en tant qu’artiste. Paralysée par la
Huile sur toile, 76,2 x 101,6 cm.
dépression et par une santé faible, la production de Hopper diminua, mais plusieurs de ses plus grands
Collection privée.
tableaux restaient encore à composer.
163
L
E
SACRE
D’UNE ICONE
166
L’Apogée et le déclin
P
endant que l’hiver de 1930 saisissait la ville de New York – tant au niveau climatique que financier – Edward Hopper se réjouissait devant la lueur de son poêle quand il apprit que le Museum of
« Le terme « vie » tel qu’il est utilisé en art ne devrait pas
Modern Art avait acheté sa toile intitulé Maison près de la voie ferrée, devenant ainsi le premier
être ignoré car il s’applique entièrement, et le domaine de
tableau de la collection permanente du musée. L’avenir de Hopper reposait sur son chevalet, sous la forme
l’art devrait y réagir et non l’éviter. La peinture doit se
d’une nouvelle toile de grande taille qui représentait une série de magasins en enfilade le long de la 7th
consacrer entièrement à la vie et aux phénomènes de la
Avenue (son titre original). La scène est peinte sous la lumière basse du lever du soleil ; l’avenue est
nature car ils sont grandioses. » — Edward Hopper
dépourvue d’acheteurs ou d’habitants restés dans leurs appartements des étages supérieurs. Il intitula finalement ce tableau Tôt un dimanche matin (pp.174-175). La silhouette d’un personnage apparaissait originellement dans une fenêtre (comme dans son tableau Vue du pont Williamsburg), mais ultérieurement il l’effaça. C’est une huile sur toile légère, où une tache d’écailles blanches qui représente la boule posée sur la colonne-enseigne du coiffeur constitue l’élément qui apporte une sensation de soulagement. Le tableau fut acheté par le Whitney Museum of Art pour $3000 et il devint l’une des œuvres d’art de Hopper les plus reconnues. La revue The Arts Magazine publia une critique fabuleuse de ce dernier tableau. Cependant, après avoir remercié la revue pour ses propos agréables, Josephine suggéra que le graveur et l’éditeur de l’article soient mis en prison pour avoir « sali » le choix des éléments du tableau. Furieux, Hopper écrivit à Forbes Watson, l’éditeur : « Je viens juste d’apprendre qu’une lettre idiote de la part de ma femme vous est parvenue au sujet des commentaires de The Arts Port folio sur mon travail. Veuillez l’ignorer, cette lettre étant entièrement féminine et non of f icielle. Je rougis jusqu’aux pieds lorsque j’y pense »47. En juin 1930, les Hopper partirent en voyage à Cape Cod et ils arrivèrent à la petite communauté isolée de Truro (Massachusetts). Ils louèrent une petite maison qu’ils appelèrent « Bird Cage Cottage » située dans une grande ferme qui était la propriété du facteur du village, A. C. Burleigh Cobb. Elle était entourée par des collines ébouriffées sans l’ombre d’un arbre en vue, par des dunes couvertes d’herbe et des lopins de buissons broussailleux ; le couple adora leur désert maritime peigné par le vent. Il n’y avait que cinq cents habitants à Truro lorsque les Hopper visitèrent cet endroit. Edward se plongea dans la production boulimique d’aquarelles. Il se promenait parmi les bâtiments de la ferme de « Burly » Cobb, il notait les subtilités du poulailler. Il accompagnait Burly à son travail au bureau de poste et, plus tard, lorsque Burly était absent, le chevalet d’Edward servait à peindre la maison de Burly. L’église de South Truro attirait Hopper avec ses lignes raides, son clocher ressemblant à une pagode et sa façade au style classique à laquelle venait s’adosser une salle de réunions à haut plafond. Le cimetière vieilli qui se trouvait à côté ajoutait une atmosphère d’isolement à l’image générale. Dans Corn Hill (p.118), la colline apparaît dans une série de courbes recouvertes d’herbe verte et dorée. Elle est couronnée par un groupe de maisons simples ayant parfois un avant-toit ou une lucarne. En regardant les collines sous un soleil bas dans Collines, South Truro (p.121), les maisons apparaissent comme si elles étaient en train de couler dans les « vagues » vertes et dorées formées par les chemins. Le
92. Vue du pont Williamsburg (From Williamsburg Bridge), 1928. Huile sur toile, 73,7 x 109,2 cm. George A. Hearn Fund, The Metropolitan Museum of Art, New York.
vent souffle toujours sans relâche, se frottant continuellement au paysage changeant. Hopper travaillait chaque jour au même emplacement afin de capter les mêmes nuances de lumière et, pendant que le soleil
93. Manhattan Bridge Loop, 1928.
se couchait, les mêmes nuages de moustiques provenant des étangs stagnants des marécages se
Huile sur toile, 86,4 x 152,4 cm.
réveillaient. Jo peignait souvent assise sur le siège du passager de la Dodge, puis elle préparait le repas
Addison Gallery of American Art,
sous l’éclairage d’une lanterne.
Phillips Academy, Andover, Massachusetts,
Vu qu’il n’y avait pas de restaurants proches, Truro exigeait davantage de taches domestiques à Jo. Elle
donation de M. Stephan C. Clark.
découvrit qu’elle était compétente en cuisine. Ils avaient également leur propre pompe à eau et une bouilloire pour faire la lessive, ce qu’Edward acceptait de faire. Leurs vêtements n’avaient pas besoin
94. Toits (Rooftops), 1926.
d’être repassés, ils faisaient leurs ablutions du matin dans une bassine et les toilettes se trouvaient à
Aquarelle sur papier, 32,7 x 50,5 cm.
l’extérieur. Cette simplicité de vie dans leur petite maison les enracina à l’endroit. Hopper retrouva
Whitney Museum of American Art, New York,
l’énergie qu’il avait perdue l’été précédent.
legs de Josephine N. Hopper.
167
Pendant que les années 1930 généraient des problèmes bancaires, des pertes commerciales, des saisies et des banqueroutes, les tableaux d’Edward Hopper représentant des lieux américains devinrent des icônes d’une Amérique solide sur laquelle un nouvel avenir pouvait se construire. Son interprétation de ces endroits et les vastes silences qui semblaient entourer les habitants de ses tableaux donnaient également aux écrivains, aux critiques et aux journalistes d’art une quantité considérable de grain à moudre pour leurs moulins interprétatifs. En voici un exemple. Hopper livra Table pour dames (p.202) à la galerie de Rehn le 6 décembre 1930. Hopper avait peint une serveuse en train d’arranger un panier de fruits à la fenêtre d’un restaurant. Comme d’habitude, les Hopper prénommèrent chaque personnage. « Olga » la serveuse est blonde et plantureuse ; elle se courbe en avant au-dessus de deux côtelettes crues posées sur un lit de laitue face à un rang de melons jaunes. Derrière elle, « Anne Popebogales » (ou la fille de Automat [p.197]) joue le rôle de la caissière, pendant que le couple de Deuxième Rang à l’orchestre (« Max Scherer et sa femme Sadie ») occupe une table. Les couleurs sont riches et chaudes tandis que les personnages de Hopper semblent à l’aise dans ce parc psychiatrique aux significations implicites et imaginaires. Le lien entre les melons et la poitrine ample d’« Olga » fut ce qui fit couler le plus d’encre parmi les critiques et les écrivains. Le tableau fut vendu pour $4500 au Metropolitan Museum. Guy du Bois, pendant ce temps, publiait une monographie sur Hopper qui mettait en avant l’enchevêtrement des sensations réprimées qui se cachait sous les couches fines de peinture. « Depuis que l’avènement de Freud a inspiré en Amérique une demande croissante pour l’existence de la sensualité au sein de l’art et de la vie en général, le puritanisme est plus ridiculisé que jamais. Par conséquent, beaucoup de peintres s’en éloignent en s’aventurant sur des chemins sur lesquels leurs exigences capricieuses les perdent. Hopper, en contradiction directe avec ces « gringalets » est si sourd à toute considération banale qu’il peut, de manière naturelle, sans ef fort ni volonté spécif ique, rester lui même. »48 Avec l’aide de son ami, Hopper fut considéré comme un puritain silencieux et réprimé qui suivait son propre chemin dans la poursuite de fantasmes interdits qu’il transformait en images profondément codées, créées avec des touches légères et transparentes afin d’essayer de nier la viscosité de sa propre texture sensuelle. Hopper adora ce commentaire. Les années 1930 correspondirent également à l’abandon de projets passés. Ses peintures à l’huile devinrent plus orientées vers la représentation de personnages imaginés depuis son atelier. Un grand tableau – 152 x 198 cm – terminé en 1930 et intitulé Barber Shop présentait une fois de plus une jeune femme bien portante au centre de la scène ; il s’agissait cette fois-ci d’une manucure. Selon Gail Levin, biographe de Hopper, ce tableau doit son sujet à un salon de coiffure peint par John Sloan en 1915. Le travail de Sloan est une illustration joviale présentant une manucure, son client et une ambiance détendue au milieu des hommes du salon. La manucure de Hopper s’ennuie en lisant une revue sous la lumière jaune brillant de la fenêtre, à l’intérieur d’un local qui se trouve sous le niveau du trottoir. Sa composition est classique, divisée en tiers diagonaux par l’orientation de la lumière et une rampe usée qui semble être incroyablement basse vu la hauteur des marches de l’escalier. A l’extérieur, dans la rue, l’enseigne inclinée du coiffeur suit des lignes diagonales en rouge, blanc et bleu. Le thème de l’aliénation domestique et de la relation avec Josephine mit du temps à pénétrer le travail de Hopper. Sa carrière comme peintre avait été quasiment sublimée par son succès. Josephine était amère et se sentait ignorée, semblable à la femme à robe rouge du tableau Chambre à New York (pp.218-219). La femme se prépare à frapper la touche d’un piano pendant que son mari, rentré du bureau et en bras de chemise, lit le journal du soir. Elle est habillée pour sortir. Il est fatigué par sa journée de travail et le son de la touche du piano s’étalera peu à peu sur la solitude paisible de la pièce. Beaucoup de tableaux 95. Georgia O’Keeffe, Rue, New York I (Street, New York I), 1926.
revisiteront ce thème au fur et à mesure que les exigences de Jo augmenteront. Lorsque le tableau fut exposé au Whitney Museum en 1932, le critique d’art de The Herald Tribune,
Huile sur toile, 122,2 x 75,9 cm.
Cortissoz Royal, se limita à grommeler quelque chose et à piétiner devant le tableau, comme un passager
The Georgia O’Keeffe Foundation, Santa Fe, Nouveau
qui vient de manquer son dernier train :
Mexique, donation de la fondation Burnett.
« Observez Chambre à New York de Edward Hopper. Le thème est d’une banalité pure et l’exercice de l’artiste 96. La Ville (The City), 1927.
170
consiste uniquement à enregistrer un fait de manière exacte…. L’esprit photographique qui caractérise
Huile sur toile, 71,1 x 91,4 cm.
M. Hopper est partout dans ce tableau et on peut le retrouver dans les images de peintres expérimentés comme
University of Arizona, Museum of Art, Tucson, Arizona..
John Sloan, Kenneth Hays Miller et Walt Kuhn ainsi que chez de nombreux jeunes peintres. »49
171
172
Comparé aux peintres qui étaient moins modernes, Cortissoz voyait toujours Hopper comme un arriviste. Il appréciait la beauté de l’œuvre de l’impressionnisme ubiquiste américain de Childe Hassam dont la carrière commençait à chuter brutalement. Le critique conservateur ne réussissait pas à comprendre que Hopper fût maintenant au-dessus des critiques depuis qu’il avait atteint le sommet du monde artistique new-yorkais. En mars 1932, la prestigieuse National Academy of Design élut Hopper en tant que membre associé. Cette dernière avait été considérée pendant des décennies comme un sommet de reconnaissance et d’accomplissement. Pourtant Hopper déclina l’invitation. Les académiciens l’avaient mal traité lorsqu’il avait eu besoin de soutien et maintenant il les rejetait sans donner de plus amples explications. Lorsqu’une belle occasion se présentait pour rejeter les opinions poussiéreuses du monde conservateur de l’art, son silence faisait les gros titres des revues d’art et lui faisait beaucoup de publicité. Ayant gagné $8728 en 1931 (l’équivalent de presque $115000 dollars actuels), Hopper était devenu son propre conseiller et Jo le suivait en racontant son mécontentement domestique et professionnel aux amis au travers de longues lettres décousues. A Bee Blanchard elle écrivit : « Pour la femelle de cette espèce, il est désastreux de se marier lorsqu’elle est artiste ; sa conscience est trop dérangée. Elle ne peut plus suf f isamment habiter son être intérieur pour créer. Mais vivre sans se marier reste dur à accepter. »50 Et pourtant elle restait avec Hopper et vivait pour lui. Elle l’accompagnait dans la voiture lorsqu’ils se dirigeaient vers le Nord-Est, à Cape Cod, et dans leur retraite à Truro chaque été. Hopper, malgré ses silences grincheux, n’hésita pas à se précipiter en haut d’une colline pour récupérer une toile de Jo qui s’était éloignée de son chevalet emportée par le grand vent. Edward semblait prospérer dans un milieu solitaire et désert tandis que Jo avait besoin d’avoir des gens autour d’elle. Il fêta son cinquantième anniversaire avec une sérénité apportée par le succès, le 22 juillet 1932. Elle songeait quant à elle à son propre anniversaire, huit mois plus tard, avec la préoccupation de quelqu’un qui se rend compte que sa vie créative fut tronquée et sa vie sociale réprimée. Josephine était devenue davantage un acolyte au service d’Edward Hopper qu’une compagne et une partenaire pour « Eddie », son mari. Même avant de partir en voyage à Truro en 1932, Hopper se plaignait déjà de « ce » Cape Cod si « terrible » avec son paysage stérile. Une nouvelle crise de dépression s’annonçait. Il peignit une fois sur place, mais il glissa à nouveau vers une dépression, se plaignant de n’avoir « …prise » sur rien. Lorsque Jo suggéra de partir vers le Vermont, il choisit de rester, trempé dans l’ennui, à Truro au lieu de tolérer le calvaire d’être confronté à de nouveaux paysages. Aussitôt qu’il rentra à New York, Hopper se dépêcha d’aller sur le toit de son bâtiment avant que le climat ne change et il peignit City Roofs. Ce tableau évoque son aquarelle Toits de Washington Square, réalisé en 1926. Ce travail affiche une manipulation magistrale des formes et des couleurs pour créer une composition quasi abstraite en représentant des cheminées, des ventilateurs, des bâches de lucarnes et une partie d’un bâtiment de plusieurs étages qui se trouvait de l’autre côté de la rue. Les modernistes de l’époque durent pointer leur index tremblant vers ce tableau en criant triomphalement « Ah ! Ah ! Hopper devient l’un des nôtres ! » Ils auraient eu tort, comme les surréalistes, les dadaïstes, les expressionnistes, et même le groupe de Der Blaue Reiter – qui avaient tous clamé à un moment ou un autre que Hopper était membre de leur cercle philosophique. Avec des entrées d’argent presque aussi rapides que sa production de tableaux, Hopper prit une décision osée. Il déménagea dans un atelier plus grand dans le même bâtiment avec une chambre à coucher indépendante située vers l’arrière de l’appartement. Cette petite pièce fera également office d’atelier pour Jo. Au cours de l’année 1933, Jo obtint un héritage de son oncle Harry Woolsonwood qui leur permit d’acheter une maison secondaire pour l’été. Ce même été s’avéra être une perte de temps pour Hopper
97. Aurore en Pennsylvanie (Dawn in Pennsylvania), 1942. Huile sur toile, 61 x 111,7 cm. Collection privée.
qui n’arrivait pas à produire de nouveaux tableaux alors qu’il allait en voiture à Charlestown (New Hampshire) puis vers le Nord le long du fleuve Saint-Laurent pour descendre enfin par Gloucester pour
98. Tôt un dimanche matin (Early Sunday Morning), 1930.
retrouver leur chaumière louée à Truro. Il plut pendant plusieurs jours. Toute cette aventure généra
Huile sur toile, 89,4 x 153 cm.
seulement trois aquarelles. Cette issue humide et infortunée aida les Hopper à se décider à construire une
Whitney Museum of American Art, New York, acquisition
maison d’été permanente sur un terrain qu’ils achetèrent à Truro.
effectuée avec les fonds de Gertrude Vanderbilt Whitney. 173
Alfred H. Barr Jr., le premier directeur du Museum of Modern Art, organisa une exposition individuelle rétrospective du travail de Hopper en 1933. Hopper devenait un peintre régulier de ce musée autant que du Whitney Museum. Bien qu’il fût reconnaissant, la réserve de Hopper lorsqu’il devait parler de son travail attira à nouveau l’attention des écrivains et des critiques qui cherchaient à envahir son intimité. Josephine essayait d’être serviable en contrôlant les détails de ses expositions et en tentant de le libérer pour qu’il puisse continuer à travailler. Sa production de 1933 avait été plutôt lugubre en raison de la pluie et du fait qu’il avait passé du temps à conduire pour trouver de nouveaux sujets. Le couple se concentrait à présent sur la construction de leur nouvelle maison. Pendant l’hiver 1934, pendant que leur pavillon d’été était en gestation, Hopper accrocha une aquarelle sur un mur, Prospect Street, Gloucester, 1928 et fit une huile sur toile à partir de cette dernière. Il fit également des voyages en ferry à travers Weehawken (New Jersey) pour faire des esquisses de ce qui devint plus tard East Wind over Weehawken. Ce tableau montre une collection curieusement mal assortie de quatre maisons dont les entrées descendent vers le bord du trottoir et de la rue. Leur dissemblance crée un charme chaleureux sous un ciel froid. Dominant le premier plan, le symbole effronté du progrès est représenté par un panneau blanc sur lequel est écrit « à vendre ». Ces quatre vieilles « dames » semblent condamnées à être démolies. Bien que le sujet soit similaire, les maisons de Prospect Street apparaissent plus fières, plus prêtes à s’adapter aux changements, assises tranquillement derrière les pelouses de leurs jardinets d’entrée. Hopper conçut personnellement la maison de Truro et en construisit un modèle pendant que Jo luttait pour trouver un entrepreneur susceptible de demander un prix raisonnable. Leur départ pour Truro afin d’être présents pendant la construction, fut accompagné des disputes et cris habituels, des morsures et des gifles violentes, mais une fois en route, le moral d’Edward sembla remonter au fur et à mesure que ses blessures guérissaient. Leur nouvelle maison avait de l’eau courante au lieu d’une pompe extérieure et elle avait un intérieur spacieux composé d’une grande pièce qui regardait vers l’extérieur et vers le bord de mer à travers une fenêtre de trente-six carreaux. Il y avait une chambre à coucher, une cuisine, une salle de bains et une cave. Le studio arborait une cheminée de brique rouge qui contrastait avec les murs blancs prédominants sur toute la maison sauf dans la chambre à coucher où la décoration était gris clair. La lumière du nord inondait l’atelier de Hopper, ce qui était également une aubaine au niveau pratique puisque la maison n’avait pas pu avoir d’électricité en raison d’un accès impossible des poteaux électriques. Ils utilisaient des lampes à pétrole et à kérosène une fois le soleil couché. Comme dans leur nouvel appartement plus grand de New York, Jo dut utiliser la chambre à coucher à l’arrière de la maison pour peindre. Elle grogna en écrivant à Bee Blanchard : « Ce n’est pas mon idée d’une vraie maison. Celle-ci est la maison d’E. Hopper. Elle est à lui mais aussi à mon cher oncle décédé qui l’a payée avec son argent. » 51 Elle écrivit également en parlant d’Edward : « …(il est) déterminé à s’opposer à chacune de mes respirations… Je vis dans l’attente permanente de ses interdictions… Il se plaint de mes rages de la même manière qu’il les provoque. Et il s’oppose à ce que je l’appelle un sadique. » 52 Lorsque les amis venaient leur rendre visite dans leur nouvelle maison, les griffes étaient rétractées, les barbes étaient rasées et les Hopper étaient des hôtes raisonnablement aimables – même si Edward s’absentait généralement lorsqu’il s’agissait des amies artistes de Jo ou de voisines bavardes. En 99. John Sloan, Haymarket, Sixth Avenue, 1907.
novembre, ils durent finalement retourner à New York avec quelques aquarelles. Cependant, la recherche
Huile sur toile, 66,3 x 88,5 cm.
de nouveaux sujets, la construction de leur nouvelle maison et l’accueil d’un torrent interminable de
The Brooklyn Museum, New York,
connaissances firent chuter les revenus de Hopper à $3550.
donation de Mme Harry Payne Whitney.
L’année 1935 connut un déclin encore plus important de la fortune de Hopper. Elizabeth, la mère d’Edward, décéda le 20 mars à l’âge de quatre-vingt-un ans. Il avait passé toute sa vie à essayer de lui faire
100. Pharmacie (Drug Store), 1927.
176
plaisir et elle n’avait pas encore vu leur nouvelle maison. Cette mort, alors qu’il avait atteint une
Huile sur toile, 73,6 x 101,9 cm.
reconnaissance tant attendue, le secoua profondément. Son tableau triste, Maison au crépuscule, fut terminé
The Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts,
pendant qu’elle était malade. Il montre un appartement gris avec des corniches en pierre construit sur le bord
legs de John T. Spaulding.
d’un parc. C’est le crépuscule, après le coucher du soleil, et les lumières des pièces de l’appartement sont déjà
177
101. Sept Heures du matin (Seven A.M.), 1948. Huile sur toile, 76,7 x 101,9 cm. Whitney Museum of American Art, New York. 179
éclairées. Seules la tête et les épaules d’un personnage sont visibles depuis l’une des fenêtres du premier étage. Un épais groupe d’arbres et de feuillages sépare le toit de l’appartement du ciel jaune gris. La sensation évoquée est celle de la mélancolie. Il s’agit de la conclusion inévitable de ce qui n’est plus. Deux autres tableaux significatifs de 1935 furent Clam Digger et The Long Leg. Il est intéressant de noter que Clam Digger fut abandonné par Hopper car il n’arrivait pas à le terminer avec satisfaction. The Long Leg (p.141) est un tableau sur le thème de la navigation. Il montre une petite gaffe et ses amures qui reçoivent le vent de la mer. Un phare et ses dépendances regardent la scène depuis la côte. La vue était celle que l’on voyait depuis la grande fenêtre de la maison des Hopper qui donnait vers le nord. Malgré ces toiles, quelques aquarelles et quelques ventes, les revenus d’Edward ne dépassèrent pas les $2250 tandis que Jo ne vendit rien. Malgré la diminution de ses revenus, le travail de Hopper apparut dans vingt-trois expositions et il devint vivement conscient de son nouveau statut dans le monde de l’art contemporain. A cette fin, il se sentit obligé d’écrire en vitesse une lettre à Nathaniel J. Pousette-Dart, l’éditeur de Art of Today, pour démentir un article qui affirmait que « la direction et le virage » de Hopper avaient été fortement influencés par le travail de son ami, Charles Burchfield. Hopper bouillonnait : « Ce que vous entendez par direction et virage n’est pas tout à fait clair dans mon esprit, mais je suppose que vous voulez probablement parler du choix de mes sujets. Les peintres qui me connaissent bien savent depuis longtemps que de ce point de vue-là j’ai pris mon virage il y a bien longtemps. Il y a vingt-cinq ans, ou peut-être plus, avant qu’on n’entende parler de Burchf ield et j’avais déjà utilisé le genre de sujets que certains jugent prédominants dans l’art américain peut-être bien avant qu’il n’ait commencé à peindre lui-même : les maisons de l’ère de Garf ield, les gares, les poteaux télégraphiques, les usines, les petites rues des villes, etc. Si par direction et virage vous entendez notre vision ou la méthode de fonctionnement, il est évident que je suis dif férent de lui dans presque tous les domaines. Dans le développement de tout artiste, le germe du travail ultérieur se trouve toujours dans le travail qui le précède. Le noyau autour duquel l’artiste crée son travail est lui-même, le « moi » central, la personnalité ou peu importe comment on souhaite l’appeler, et cela change bien peu entre la naissance et la mort de l’artiste. Ce qu’il est une fois, il l’est pour toujours, avec quelques modif ications insignif iantes. Le fait de changer ses méthodes ou ses sujets ne font que changer peu ou pas du tout le fond de l’artiste. Vous pourrez sûrement vous rendre compte par ma lettre que je suis mécontent et je sais que Burchf ield s’est déjà senti ainsi face à des critiques détachées et injustes d’un genre similaire qui accusaient son travail d’être trop semblable au mien. Je vous invite à y réf léchir. » 53 Cette raclée publique donnée à Pousette-Dart, un ancien collègue et étudiant de Robert Henri en 1907 qui devint plus tard un directeur artistique de grande importance dans le monde de la publicité, dut être un moment délicieux pour Hopper si l’on prend en compte sa réprobation des artistes prétentieux du monde de l’art commercial. Pousette-Dart grommela et bredouilla une réponse boiteuse, mais la victoire fut clairement pour Hopper.
Les Affres de la gloire Avec la fin de la décennie 1930, les effets de la dépression sur l’économie américaine et mondiale s’allégèrent. Franklin Roosevelt avait saisi les rênes comme président et il appliquait des programmes osés – « socialistes » selon ses détracteurs – tels que le Works Progress Administration, le National Recovery Act and le Civilian Conservation Corps dans le but de créer des emplois et des opportunités pour tous les chômeurs. Au même moment, l’Europe était au bord d’une nouvelle guerre et les Alliés européens, la France et la Grande-Bretagne, faisaient appel à la capacité industrielle de l’Amérique. Hopper, un républicain conventionnel, méprisait Roosevelt et il était mécontent de ne pas avoir pu s’enregistrer à temps sur les listes électorales pour voter pour Wendell Wilkie lors de l’élection de 1936. 102. Août dans la ville (August in the City), 1945.
180
Cette année fut également celle de l’émancipation de Josephine. Pendant qu’elle était à New York,
Huile sur toile, 58,4 x 76,2 cm.
elle sortait furtivement pour prendre des leçons de conduite qui lui permirent d’obtenir son permis. Elle
Norton Museum of Art, West Palm Beach, Floride,
se disait que ce pas était essentiel pour avoir plus d’indépendance lorsqu’elle voyageait avec Edward à la
legs de R.H. Norton.
recherche de sujets pour peindre.
181
182
Pour Hopper, 1936 arriva avec une nouvelle vague de désespoir causée par son manque d’inspiration lors de sa retraite d’été à Truro. Le couple essaya de trouver des sujets au Vermont mais ce voyage ne donna aucun résultat. En même temps, Marion, la sœur de Hopper arriva dans la maison de son frère et elle fut logée dans le grenier avec, pour dormir, un lit de camp. Un soir, lors du dîner, Marion déballa pratiquement vingt années de reproches contenus sur Jo tandis que Hopper essayait, au milieu des deux femmes, de manger sa fricassée de poulet. Comme si cette situation n’était pas déjà assez infernale, Jo prit la voiture pour la conduire un après-midi en allant dîner avec Edward dans un restaurant local. Bien qu’il acceptât de s’asseoir rigidement à côté d’elle pendant qu’elle conduisait, il insista pour garer la voiture une fois qu’ils seraient arrivés. Jo à cette occasion se rebella et un Hopper enragé «…l’a tirée vers l’extérieur (de la voiture) par les jambes pendant qu’ elle s’accrochait au volant – puis il a grif fé ses bras nus et elle s’est retrouvée totalement par terre sur la route. Du coup, il s’est fâché après elle parce que les gens à l’intérieur (du restaurant) les regardaient par les fenêtres. » 54 Deux semaines après la dispute de la voiture, le cadeau d’anniversaire que Jo avait trouvé pour Hopper arriva. Elle lui avait acheté une bibliothèque de dix volumes sur la guerre civile illustrée par le photographe Matthew Brady. Il râla parce que cette distraction lui servirait maintenant d’excuse pour ne pas peindre. La sécheresse créative se poursuivit avec seulement trois huiles et une poignée d’aquarelles produites pendant l’année. Jo en train de peindre (p.9) fut le seul portrait qu’il n’ait jamais peint de sa femme. La toile montre les cheveux de Jo, qu’elle vient de laver, et des buissons dehors, derrière elle, pendant qu’elle peint une toile invisible. Elle espérait qu’il expose ce travail pour lui restituer un peu de son identité professionnelle. Un autre tableau qui fut produit cette année fut Après-Midi à Cape Cod (p.109), où l’on aperçoit le côté ombragé d’une maison et de ses dépendances délabrées sur un ciel toujours changeant qui lui causa beaucoup d’ennuis. Il gagna également en 1937 le W. A. Clark Prize et le Corcoran Golden Medal à la 15ème Biennale de Corcoran. Un grand tableau étrange émergea de cette année calme ; il peignit une étude architecturale des ateliers de New York, une entrée de métro et la façade du Circle Theater. Seuls le C et le E de CIRCLE peuvent être lus sur le toit du théâtre, parce que l’entrée de métro cache le reste. Un seul personnage lit le panneau d’affichage annonçant les spectacles à venir. C’est une image où les couleurs pastel et le vert clair entourent la couleur chaude et orange des lettres. Il s’agit d’un assemblage de plans qui est à la fois réaliste et abstrait ; toute la scène a lieu derrière un feu qui est rouge et qui se trouve sur l’avant-plan. Frank Rehn notait que le pipe-line de Hopper étaient en train de se tarir alors qu’approchait la décennie de 1940 et que l’inventaire de la galerie avait diminué. Dans le catalogue de sa contribution à l’exposition retrospective du Museum of Modern Art, Hopper avait écrit : « J’ai essayé de présenter mes sensations de la manière qui me semblait la plus agréable et la plus impressionnante possible. Les obstacles techniques de l’art dictent peut-être la forme. Ce cadre dérive également des limitations imposées par la personnalité de l’artiste. J’ai tenté de simplif ier cela ». « Lorsque je travaille, je suis conf ronté à l’intrusion récurrente et désagréable d’éléments qui ne font pas partie de ce qui m’intéresse dans mon sujet. C’est pour cette raison que j’ef face et que je remplace toujours ces éléments qui m’empêchent d’avoir la vision que je souhaite de mon sujet. Je les fais disparaître au fur et à mesure que je peins. La lutte pour éviter ce problème est, je pense, le lot de beaucoup de peintres qui considèrent qu’inventer de nouvelles formes est une technique qui présente peu d’intérêt ». « Je suis convaincu que les grands peintres, guidés par leur intellect, ont tenté de façonner cette technique ingrate de la toile et de la peinture pour pouvoir témoigner de leurs émotions. Dans mon cas, toute digression de ce grand dessein génère chez moi de l’ennui ». 55
103. Chambre à Brooklyn (Room in Brooklyn), 1932. Huile sur toile, 73,9 x 86,3 cm. Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts,
A la fin de l’été 1937, Hopper abandonna Truro pour aller dans le Vermont à la recherche de sujets. Il
Collection Hayden-Fonds Charles Henry Hayden.
réussit à produire quelques aquarelles, mais Jo écrivit sur la frustration de son mari en rappelant les 104. Soleil dans une chambre vide
phrases précédentes :
(Sun in an Empty Room), 1963.
« …L’impossibilité de reproduire sa vision d’une scène – que chaque coup de pinceau sur le papier
Huile sur toile, 73 x 100 cm.
contribue à détruire, le pousse de plus en plus vers une autre vision qu’il regrette. »
Collection privée.
56
183
Ils rentrèrent à New York sans un seul tableau à l’huile à montrer comme résultat de leurs voyages. Au début de 1938, Edward fut invité à figurer dans le jury des expositions à Philadelphie à la Pennsylvania Academy of Fine Arts et au Virginia Museum of Fine Arts de Richmond. Josephine vit une opportunité et elle lutta, accrochée au succès d’Edward, pour voir son aquarelle, Cape Cod Hills exposée à la 133ème Annual Exhibition of Oils à Philadelphie. Pour accompagner son tableau, Hopper exposa son huile sur toile Jo en train de peindre dans la même exposition. Elle prit ce geste comme une reconnaissance de son identité d’artiste au lieu de le voir comme une technique pour attirer l’attention. Jo envoya rapidement son aquarelle Le Théâtre Sheridan (p.233) pour qu’elle soit exposée à Richmond (Virginia) mais son tableau fut immédiatement refusé. Hopper ne reconnut jamais qu’un tableau de sa femme eut été renvoyé. Jo était navrée de voir que son nom n’avait même pas influencé les décideurs. Sa rage fut accompagnée par une rechute de colite, une inflammation du colon causant des douleurs abdominales, de la diarrhée et des saignements rectaux, maladie dont elle avait déjà souffert une année plus tôt. Edward travaillait sur son huile, Le Théâtre Sheridan, pendant qu’il soignait sa femme. Cependant il dut partir à Richmond pour son exposition puis à Indianapolis pour faire partie du jury d’une autre exposition au John Heron Art Institute. Jo resta seule. Ce fut la plus longue période de séparation qu’ils aient connue depuis qu’ils s’étaient mariés. Elle sombra dans la dépression, luttant à peine pour alimenter suffisamment leur vieux poêle à charbon. Lorsque Hopper rentra enfin, il tomba également malade avec de la fièvre. Une année avait passé depuis que Hopper avait produit sa dernière toile, Cinq Heures du matin (p.149) qui représente une entrée de port avec le phare d’une île créé par son imagination après avoir visité l’exposition, « Fantastic Art, Dada and Surrealism ». Par ailleurs, il utilisa ses souvenirs crées lors de ses récents voyages, lorsqu’il était jury d’exposition, pour trouver de l’inspiration. Jo posa comme une jeune femme qui voyageait seule dans un train de passagers. La femme de la toile lit pendant que sa fenêtre encadre le coucher du soleil. Hopper termina Compartment C, Car 293 en douze jours puis l’envoya à la galerie de Rehn. Pendant que le monde faisait face à une nouvelle guerre en Europe en 1939, Edward Hopper créa inconsciemment ce qui deviendrait son chef-d’œuvre : une série de tableaux, reliés non pas par leurs thèmes qui parcouraient tous ses centres d’intérêts mais par leur intensité et l’accomplissement final de cette vision personnelle qu’il avait si longtemps poursuivi. L’âge et l’infirmité commençaient à faire effet, faisant diminuer sa production à deux toiles par an. Josephine s’accrochait à lui, radotant auprès de qui voudrait bien l’entendre à propos de l’injustice du monde artistique, de son mari qui accaparait toute l’attention, de sa carrière ruinée. Elle l’agaçait, l’insultait, l’inspirait et le soignait pendant que l’art de Hopper donnait de lui une image sublimée contraire à ce qu’il était en réalité. La course créative qui dura deux décennies commença avec Cinéma new-yorkais. En ce qui concerne le cinéma, l’année 1939 fut magique : Autant en emporte le vent, Les Hauts de Hurlevent, Gunga Din, Dark Victory, La Chevauchée fantastique, Des Souris et des hommes, Goodbye Mr Chips, Ninotchka, Intermezzo, Mr Smith au sénat et Le Magicien d’Oz devinrent tous des classiques du cinéma américain. Edward Hopper commença son tableau Cinéma new-yorkais en décembre 1938 à partir d’une cinquantaine d’esquisses. Gail Levin suggère qu’il utilisa comme modèle de composition le tableau Intérieur (ou Le Viol) de Degas (p.231) qui avait été exposé au Metropolitan Museum comme un modèle compositionnel, avec sa perspective diagonale fuyante et décalée et avec une silhouette debout à l’extrême droite du tableau. Hopper choisit beaucoup de cinémas new-yorkais y compris le Strand, le Globe et le Republic pour copier des parties et des effets architecturaux afin d’assembler la composition finale. Pour peindre une hôtesse penchée contre les parois d’une niche murale, il utilisa comme modèle une Jo qui tremblait dans le couloir non chauffé, lui donnant de longs cheveux dorés ainsi qu’un visage plus jeune. Il lutta contre l’éclairage intérieur qui provenaient de beaucoup de sources différentes, chaudes et fraîches. Elles éclairaient les bords de grilles de cuivre ainsi que des clients que l’on peut vaguement distinguer assis au 105. Eté dans la ville (Summer in the City), 1949.
184
fond d’une obscurité silencieuse. Un escalier surréaliste mène vers le haut, s’éloignant de la niche murale
Huile sur toile, 50,8 x 76,2 cm.
sur laquelle Jo se penche. La jeune femme est perdue dans ses pensées ou dans son ennui ayant entendu
Berry-Hill Galleries, Inc., New York.
et vu le même film maintes fois jusqu’à ce qu’il perde tout son sens.
185
106. Excursion philosophique (Excursion into Philosophy), 1959. Huile sur toile, 76,2 x 101,6 cm. Collection privée.
186
107. Soleil dans la ville (City Sunlight), 1954. Huile sur toile, 71,6 x 101,9 cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C., donation de la fondation Joseph H. Hirshhorn.
187
Presque à la fin du tableau, Hopper commença à nouveau avec sa préoccupation morbide qui le persuadait que chaque coup de pinceau l’éloignait encore plus de son concept original. Jo restait enfermé dans la chambre à coucher afin de ne pas le distraire. Enfin, Frank Rehn vit le tableau le 2 février 1939, six semaines après que Hopper avait commencé à l’esquisser. C’était le premier de cinq tableaux exceptionnels peints cette année-là. Pour l’anniversaire de Jo, le 18 mars, Edward lui présenta un joli cadeau. Il s’agissait d’un petit dictionnaire français décoré à la main avec des roses en papier colorées et qui portait un vers en français qui disait : « Jour de naissance, mars 1939, les doigts de pied de Josie sont roses et elle trouvera du français partout où elle ira. » Outre ce détail, le cadeau comprenait $15 pour qu’elle s’achète une nouvelle robe. Hopper ne fut jamais un grand peintre d’action et le choix de son prochain sujet surprit tout le monde. Bridle Path montre trois cavaliers galopant avec leurs chevaux sur un chemin d’équitation de Central Park, sur le point d’entrer dans l’un des tunnels du parc parmi les aménagements rocheux. De grands immeubles constitués d’appartements regardent vers le bas cette scène forestière. Il dut faire beaucoup de recherche pour ce tableau, surtout en ce qui concerne les chevaux et l’équipement d’équitation. Il fit plusieurs visites sur place pour bien percevoir les couleurs et les textures, ce qui généra dix-huit esquisses préparatoires. Les chevaux semblent être directement sortis d’une chromolithographie Currier & Ives du XIXe siècle. Cependant, la précision de leur environnement et l’obscurité infernale du tunnel bâillant font de cette scène plus qu’une peinture de genre pour devenir une vision véritablement hopperienne. Se sentant obligé de fournir quelque chose à Rehn pour qu’il puisse vendre, il se dépêcha de terminer et l’amena à la galerie le 27 avril. Cette poussée d’énergie arriva à la fin du printemps new-yorkais et le couple partit bientôt pour Cape Cod. Trouvant qu’il avait épuisé Truro et ses environs immédiats pour trouver des sujets intéressants, Hopper voyagea ailleurs avec Jo, vers d’autres paysages. Il trouva une embrasure ici, un morceau de bois là-bas, ici une corniche, là-bas un avant-toit, et il commença alors à construire une composition qui présentait le coin d’une maison avec une fenêtre en saillie, un homme assis sur une marche et une femme avec les bras croisés, les deux avec leurs pensées tournées vers eux-mêmes. Il voulait peindre un colley sur le premier plan. Hopper cherchait et observait des images de chiens dans des livres de bibliothèque. Un jour, lors d’une sortie en voiture, un véhicule garé sur le bord de la route ouvrit sa portière et de l’intérieur en sauta un colley. Hopper arrêta sa voiture et pendant que Jo se présentait au chien et à ses maîtres, Edward fit ses esquisses au crayon. De retour à l’atelier de Truro, il peignit autour du chien un champ d’herbe dorée touchée par le vent et semblable à un nuage. Le chien détourne son regard de l’homme, de la femme et de la maison, Hopper avait organisé ses éléments disparates pour produire Soir à Cape Cod (pp.134-135). Quasiment sans faire de pause, il commença à esquisser son travail suivant. Jo vit tout de suite qu’il était revenu au thème des voiliers et de la mer et cela la rendit très heureuse. « Ed fait une grande et belle toile dans l’atelier – un voilier, des garçons au torse nu, des corps tout bronzés, beaucoup de mer et de ciel. Cela promet d’être une beauté. Frank Rehn sera enchanté. Tout le monde veut qu’Ed fasse des voiliers » 57 écrivit-elle à Marion Hopper. Le voilier avec son jeune équipage évite une bouée grâce à une houle causée par l’arrivée d’une vague sur un banc de sable où la mer est peu profonde. Une lumière dorée pénètre dans la scène, contrastant avec un ciel haut et sombre. Tous les regards sont sur la bouée alors qu’elle roule et émet un bruit métallique à côté du bateau. Hopper termina Mer houleuse (p.144) le 15 septembre et Jo et lui reprirent le chemin de New York un mois plus tôt que d’habitude avec deux toiles et aucune aquarelle. De retour à l’atelier du 3 Washington Square, les visites des amis reprirent. Ils passaient de façon 108. Fenêtre d’hôtel (Hotel Window), 1956.
informelle prendre le thé avec Jo qui leur montrait ses tableaux. Si Edward avait le malheur de montrer
Huile sur toile, 101,6 x 139,7 cm.
ses créations à ses amis lorsqu’ils avaient fini de regarder celles de sa femme, aussitôt les amis partis, Jo
Collection Thyssen-Bornemisza, Madrid.
explosait. En général, Hopper préférait fuir ces situations. Jo et Ed prirent un autobus pour Nyack afin de rendre visite à Marion. Pendant leur séjour là-bas, ils
109. Motel à l’Ouest (Western Motel), 1957.
188
virent une grande maison blanche appartenant au dramaturge Charles MacArthur et à sa femme, l’actrice
Huile sur toile, 76,8 x 128,3 cm.
Helen Hayes. Les deux célébrités avaient insisté pour que Hopper peigne une image de leur maison et
Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut,
Frank Rehn s’était fait leur allié et essayait de persuader le peintre. En novembre, les Hopper s’assirent face
legs de Stephen Carlton Clark, B.A.
aux MacArthur qui essayèrent de convaincre Edward. Helen Hays écrivit :
189
192
« Je n’ai jamais rencontré un individu aussi misanthrope, grincheux et grognon de ma vie… je n’ai pu que f létrir sous la f roideur de son refus. Je me suis éloignée dans un coin et je suis restée dans l’obscurité, perdue… J’ai été véritablement et totalement décontenancée par cet homme… » Elle se souvint de Hopper en train de se lamenter : « Je ne peux pas faire cette maison. Je ne veux pas peindre cette maison. Elle ne me dit rien… Je ne lui trouve aucune lumière ni aucun charme. »58 Après avoir été cajolé par Jo et intimidé par Frank, Hopper se présenta finalement un jour à la maison des MacArthur, se planta devant le bâtiment et commença à faire des esquisses. Le climat était changeant et il se trouvait parfois exposé au froid alors qu’il cherchait et se grattait pour trouver un brin d’inspiration. A partir de sa meilleure esquisse, il créa un dessin préparatoire, puis il transféra ce dessin sur une toile plus large, une technique utilisé dans l’art commercial. Il continua finalement à travailler sur le tableau pendant le mois de décembre puis le termina. Lorsque Helen exprima son désir de voir sa fille et son caniche apparaître dans le tableau également, Hopper sentit la moutarde lui monter au nez et refusa tout simplement. Les MacArthur aimèrent le tableau et payèrent le prix que Rehn avait établi, $2500, ce qui fit augmenter considérablement le total des revenus des ventes que Hopper obtint en 1939. L’année avait produit cinq toiles : American Movie, Bridle Path, Cape Cod Evening, Mer houleuse et la commande des MacArthur intitulé Pretty Penny. Chacun de ses tableaux était le point de départ du tourbillon des années 1940 qui approchait.
Confrontation (décennie 1940) Les Allemands envahirent violemment la Pologne le 1er septembre 1939 et rassemblèrent leurs forces pour livrer une Blitzkrieg (guerre éclair) en France en 1940. Les Européens qui étaient véritablement prévoyants – surtout ceux qui se souvenaient de la Grande Guerre de 1914-18 – firent leurs valises, liquidèrent leurs biens et prirent des billets pour fuir en navire à vapeur. Les juifs allemands, les intellectuels, les artistes, les écrivains et les physiciens avaient déjà quitté leur patrie lors de l’offensive française. Ils encombraient les villes portuaires et les quais des trains en direction de l’Ouest. La Grande-Bretagne était déjà en train d’envoyer des ballons de barrage et elle suspendait des barbelés le long de ses plages. Dans cette situation, le choix naturel d’un sanctuaire non touché par la guerre était les Etats-Unis. Les Hopper étaient repliés sur leurs disputes et leurs discours rituels peu transcendants, à tel point qu’ils passèrent à côté du désastre international alors même qu’il était en gestation. Ils étaient, comme d’habitude, impliqués dans le monde artistique de New York et le mois de janvier passa rapidement sans qu’aucune toile ne soit terminée à l’atelier du 3 Washington Square. Cependant Edward ne chômait pas, il se baladait dans la ville la nuit, scrutant les fenêtres au moment où les wagons du chemin de fer s’éloignaient rapidement. Il commença finalement à dessiner au fusain une secrétaire et son patron seuls dans un bureau la nuit. Jo était heureuse de voir les premiers signes d’un nouveau tableau. Edward semblait flotter également sur un nuage lorsqu’il laissa un soir de côte ses esquisses pour prendre Jo par la taille et lui faire danser sur toute la surface de l’atelier une valse de Strauss qui passait à la radio. Il fit poser Jo dans une robe courte et moulante et il prépara la composition de son tableau avec huit dessins préalables avant de transférer l’image vers une toile avec des coups de pinceau d’un bleu pâle. Combien de fois avait-il déjà dessiné des variations de cet environnement auparavant, en se penchant sur ses illustrations commerciales de bureaux, de classeurs à tiroirs et de bureaux lambrissés pour les histoires de diverses revues d’affaires ? Maintenant il peignait sa propre histoire, avec ses propres personnages. Pourquoi cette femme dévisageait-elle un morceau de papier qui était par terre, amené par la brise qui entrait par la fenêtre ? Est-ce que la robe moulante était supposée être provocante? Le patron était-il inconscient des charmes de la poitrine plantureuse de la jeune femme ? Les scénarios étaient interminables alors que Hopper représentait ses propres fantasmes nocturnes dans une composition qui lui appartenait exclusivement. Ces fantasmes plus tard continueraient à apparaître. Son habitude était de
110. Bureau, la nuit (Office at Night), 1940.
réduire graduellement, d’une esquisse à l’autre, le nombre d’éléments de la scène pour ajouter les
Huile sur toile, 55,8 x 63,5 cm.
éléments définitifs de l’histoire seulement à la fin de la création : la brise venant de la fenêtre et le papier
Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota,
par terre. Bureau, la nuit (p.192) rejoignit son répertoire de toiles qui racontent une histoire.
donation de la fondation T.B. Walker.
193
111. Hall d’hôtel (Hotel Lobby), 1943. Huile sur toile, 81,3 x 101,6 cm. Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, Indiana.
194
112. Conférence, la nuit (Conference at Night), 1949. Huile sur toile, 68,6 x 101,6 cm. Wichita Art Museum, Wichita, Kansas, Collection Roland P. Murdock.
195
Après avoir terminé sa dernière toile sur le thème de la guerre civile, Light Battery at Gettysburg (p.107), en avril, Edward et Jo chargèrent leur nouvelle Buick 1935 et se dirigèrent vers le Nord-Est. Les nouvelles de la guerre les traquaient, mais Hopper se pressait pour trouver des sujets sur les routes de ses voyages. Jo tomba en larmes lorsqu’elle apprit que Paris était occupée par les Allemands, mais fut étonnée lorsque les locaux lui demandaient pourquoi elle était si bouleversée par un événement qui arrivait si loin de leur petit village. Les aquarelles restèrent dans leur boîte pendant que Hopper restait déterminé à peindre une nouvelle huile sur toile. Sa quête trouva une fin à une station-service au bord de la route et une idée qui avait tourbillonné pendant des années se posa finalement. Jo écrivit à Marion : « Il fait une station-service, au crépuscule avec des lumières au-dessus d’une rangée de pompes à essence. Et lorsque nous allons les regarder, ces stations ne sont pas éclairées du tout. Ils ne gaspillent pas d’électricité et n’allument les lumières que lorsque la nuit est bien tombée, beaucoup plus tard que l’heure qu’Ed souhaiterait ».59 Intitulé Essence (pp.246-247), le tableau semble en même temps étrange et familier. La station-service, solitaire au bord d’une route étroite en face d’une forêt dense et impressionnante, est trop épurée, dépouillée jusqu’à laisser uniquement sur la scène des éléments essentiels grâce à la méthode de Hopper. Les pompes sont éclairées – deux à l’essence normale et une à l’essence à l’ « éthyle » également appelée « hi-test ». Un léger rayon de lumière blanche sort de l’intérieur de la station. Un homme utilise l’une des pompes (Ed et Jo l’appelèrent « le fils du Capitaine Ed Staples » qui avait été tué dans un accident de train en rentrant d’une exposition au Cleveland Museum, le lieu d’exposition de la toile originale « Staples » de 1929). Hopper visita quelques stations-service dans le secteur de Truro, rassemblant des idées et des esquisses qui contribuèrent aux douze dessins préparatoires. Cependant, seul un propriétaire de stationservice se rappelle d’Ed et de Jo clairement. Jimmy de Lory se rappelle que Jo était « …une petite femme écervelée » et Ed « …un conducteur épouvantable. » 60 Hopper montra Essence à la Whitney’s Annual Exhibition of Contemporary Art Painting. Terminer ce tableau avait été une véritable épreuve pour lui et il se plaignait de plus en plus chez son médecin de Boston de « se sentir fatigué » et « faible » après être resté longtemps debout devant son chevalet. Hopper approchait les soixante ans et les hommes grands et sveltes connaissent fréquemment des problèmes dans les articulations et dans les muscles en raison de leur taille et de la mauvaise irrigation sanguine de leurs extrémités. Mais lorsqu’il se sentait bien et fier de lui-même, Hopper fêtait l’événement en informant Jo que son travail était mauvais et que si elle arrivait à exposer, personne ne viendrait voir ses tableaux. Cela la faisait exploser comme une bombe et elle rageait et vitupérait. « Le sens de l’humour » de Hopper consistait à faire des farces ou à faire rager les autres. En vieillissant, cet humour devint de plus en plus cinglant, exacerbé par sa conviction que la femme est inférieure, surtout en tant qu’artiste. Puisque 1940 n’avait pas été une année financièrement exceptionnelle (Essence ne fut vendu qu’en 1943 au Museum of Modern Art pour la somme de $1800), générant seulement $3866 de revenus ($55400 dollars actuels). Hopper combattit à sa façon l’inactivité déprimante qui s’annonçait pour 1941 en esquissant des strip-teaseuses de maisons burlesques. Le burlesque était devenu une forme d’art noble et respectable qui avait propulsé beaucoup de comédiens et d’interprètes de radio et de télévision vers la 113. Edouard Manet, La Prune, vers 1877. Huile sur toile, 73,6 x 50,2 cm. National Gallery of Art, Washington, D.C.
célébrité. Le genre dérivait de la variété et de la comédie au sens large mais il s’était traduit en séries de spectacles de nudité vulgaires. Hopper aimait toucher les frontières des comportements socialement répréhensibles (chez les autres) si on prend en considération Soir bleu (pp.70-71), son esquisse d’une prostituée de Paris et l’huile sur toile de 1925, Les Contrebandiers (p.241). Ses tableaux montrent des
114. Automate (Automat), 1927.
femmes qui s’exposent aux fenêtres, à l’extérieur, sous un soleil brillant, ou dans des situations
Huile sur toile, 71,1 x 91,4 cm.
sexuellement connotées. Ce style continua à se reproduire pendant toute la durée de sa carrière. Le fait
Des Moines Art Center, Des Moines, Iowa,
que presque toutes ces scènes prenaient pour base des poses de Josephine fit qu’il lui sembla normal de
James D. Edmundson Fund, 1958.
demander à sa femme de se déshabiller pour prendre l’air d’une strip-teaseuse. Girlie Show (p.227) est une exhibition complète de l’idéal féminin de Hopper. Il réussit à transformer
196
115. Oiseaux de nuit (Nighthawks), 1942.
une petite dame nue à la fin de sa cinquantaine en une bombe rousse avec un corps jeune qui pourrait
Huile sur toile, 84,1 x 152,4 cm.
endurer cinq spectacles par jour. Le visage évoque celui de la prostituée française de Soir bleu, si mondaine
The Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois.
et pleine d’assurance. La pauvre Jo demeurait blottie près du poêle de l’atelier – qui brûlait quasiment sa
197
200
jambe – pendant qu’elle posait comme l’effeuilleuse hautaine qui paradait devant les garçons du premier rang. Elle posa et il peignit pendant février et mars, puis le 8 avril 1941 la toile fut soumise à Rehn. Ayant besoin de faire une pause, Hopper conduisit la Buick vers l’Ouest, cherchant à trouver de la matière fraîche et à voir de nouveaux lieux. Jo s’efforça de ne pas créer de problèmes et elle laissa Ed trouver son inspiration pour peindre pendant qu’ils regardaient les curiosités de l’Ouest des Etats-Unis, du Jardin des Dieux dans le Colorado aux plages de l’Oregon, le parc de Yellowstone et d’autres magnifiques paysages. En économisant toujours de l’argent, ils se logèrent dans des terrains à caravanes et dans des motels minables. Enfin, Hopper conduisit jusqu’à Cape Cod. Il s’arrêta à peine. Vers la fin de cette odyssée, Jo le harcelait pour qu’il s’arrête de peindre et cela suscita des cris, des invectives, des insultes et des critiques. Les pages du journal intime de Josephine racontent les jours lamentables qu’il passa à rouler du Wyoming au South Dakota, à maudire le monde en passant par l’Indiana et à rejeter Cleveland. Ils demeurèrent l’un à côté de l’autre pendant 10 000 miles, parcourus en soixante jours et lorsqu’ils s’arrêtèrent enfin devant leur pavillon d’été à Truro, ils étaient dans un état épouvantable. Le séjour n’avait généré que quatre aquarelles passables. Ce qui les sauva fut un tableau à l’huile d’un voilier intitulé La Côte à l’abri du vent (pp.142-143) que Hopper commença le 30 août. Pendant sa production, Edward devint plus agréable envers Jo, l’aidant à peindre à l’extérieur face au vent glacial de Cape Cod. Elle était heureuse qu’il ait commencé un nouveau tableau. Le voyage long et mentalement angoissant avaient usé Hopper et il se retrouva malade et sans énergie. En octobre il se força à finir une autre toile, Route 6, Eastham, montrant une maison et des dépendances à côté d’une route à deux voies d’un des comtés du Cap les plus fades. Heureusement, le temps passé à peindre un sujet très familier et à rattraper ses lectures adoucirent Hopper. Lorsqu’ils fermèrent la maison de Truro en novembre et qu’ils repartirent vers New York, leur relation orageuse s’était à nouveau équilibrée. La femme de Frank Rehn, Peggy, était décédée pendant l’été. Cet évènement dévastateur et évidemment déconcertant, ainsi que la maigre production de Hopper, fit baisser ses revenus annuels à environ $1560. Mais peu lui importait, sa muse l’avait encore abandonné. Pendant que le vent froid de décembre chassait les piétons désinvoltes des trottoirs, Hopper commença à esquisser finalement, soit à partir d’un souvenir, soit par observation directe, une intersection de Greenwich Avenue. Alors que tout le monde restait collé à la radio, en essayant de comprendre les nouvelles de la septième attaque japonaise de décembre sur la base navale américaine de Pearl Harbor, dans les îles hawaïennes, Hopper commençait à esquisser une île brillamment éclairée sous une nuit impitoyable. Pour Oiseaux de nuit – le titre suggéré par Jo dans une lettre qu’elle écrivit à Marion – Hopper plaça sa troupe de personnages dans un café-restaurant d’un coin de rue, éclairé par les lumières sévères et fluorescentes du plafond. Comme la proue d’un bateau très éclairé, le comptoir enfermé par les fenêtres et les quatre personnages de « l’équipage » labourent l’obscurité avec un angle tranchant. La lumière aveuglante illumine des bâtiments qui regardent vers le bas de la rue avec leurs yeux morts ; on peut vaguement distinguer les marchandises des magasins couverts par les ombres. Semblable à Pharmacie qui avait été peint en 1927, ce café-restaurant est un refuge. Ces « couche-tard » tiennent clairement des rôles comme s’il s’agissait des acteurs qui jouent dans un film muet. Hopper posa pour les deux hommes qui portent des chapeaux mous alors que Jo posait dans le rôle de la rousse. Comme s’il prenait une commande pour un nouveau verre, « Capitain Staples » se vit ressuscité comme l’homme qui sert au comptoir. Chaque personnage, ainsi que la conception de la scène dans sa totalité, fut travaillé à travers plusieurs esquisses. Chaque détail fut préparé, y compris l’image des percolateurs à café du Dixie Kitchen local où Jo achetait souvent de la nourriture à emporter pour le dîner.61 En choisissant de montrer certains détails
116. Chop Suey, 1929.
au spectateur, Hopper donnait de la crédibilité à une scène autrement improbable. Bien qu’un critique
Huile sur toile, 81,3 x 96,5 cm.
l’ait accusé de montrer chaque détail mondain dans ses tableaux, alors que les grands peintres étaient
Collection Barney A. Ebsworth.
normalement célèbres pour ce qu’ils omettaient, le procédé réducteur de Hopper, extrêmement sélectif, agissait comme un aimant. Chaque génération transposa depuis ses propres tensions, ses
117. Edgar Degas, Au Café, 1875-1876.
craintes, ses espoirs et ses satires sur ces personnages à jamais fermés à clef dans leur île de lumière
Huile sur toile, 92 x 68 cm.
qui sent le café.
Musée d’Orsay, Paris. 201
118. Table pour dames (Table for Ladies), 1930. Huile sur toile, 121,9 x 152,4 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, George A. Hearn Fund, 1931.
202
119. Restaurant new-yorkais (New York Restaurant), vers 1922. Huile sur toile, 61 x 76,2 cm. Muskegon Museum of Art, Muskegon, Michigan, achat du Hackley Picture Fund.
203
Tout à son honneur et grâce à la sagesse accumulée au cours des années de sa relation instable et dépendante, Jo restait loin de l’espace de l’atelier pendant que Hopper peignait Oiseaux de nuit. Elle dut être admise à l’hôpital et Hopper dépensa aimablement de l’argent pour lui payer une chambre semiprivée à l’hôpital. Lors du retour de Jo à la maison, le chaos normal reprit également, ayant pour résultat une nouvelle dispute avec des cris au sujet de la qualité médiocre de ses tableaux. La dispute se termina lorsque Hopper gifla Jo et lui frappa la tête contre une étagère. Hopper offrit plus tard une surprise à Jo pour son cinquante-neuvième anniversaire. Ce fut une carte faite à la main avec une dédicace en français qui allait guérir ses blessures. Retrouvant son énergie et sa bonne humeur, il peignit une autre toile. Il s’agissait de l’image d’une plate-forme de gare lugubre avec des bâtiments industriels dans le fond, intitulé Aurore en Pennsylvanie (p.172). La toile présente l’arrière bizarrement menaçant d’une voiture de passagers avec un lustre de bronze demeuré sombre et vide à côté du quai. En mai, le Chicago Art Institute acheta Oiseaux de nuit – le tableau qui deviendrait son chefd’œuvre le plus admiré. Le couple retourna à Truro, cet endroit qui leur était si familier. Ils trouvèrent cependant que la guerre avait laissé sa marque sur le village avec des tours d’observation en bord de mer qui servaient à guetter les sous-marins et les grenadiers allemands. Le rationnement de l’essence, de même que les visites des voisines qui venaient prendre le thé avec Josephine mirent un frein aux balades de Hopper qui était toujours à la recherche de nouveaux sujets. Il laissait sa femme seule la nuit pour aller marcher dans les rues avec son casque Air Raid Warden pendant les simulacres de pannes d’électricité. Après quelques phases de dépression, il réussit à produire plusieurs aquarelles, mais le couple rentra à l’atelier du 3 Washington Square en octobre avec tous leurs vêtements, craignant une expropriation de leur maison côtière par le gouvernement pour utiliser le terrain comme base militaire. Le tableau Hall d’hôtel fut commencé en 1943 pour la galerie de Rehn. Edward le délivra le 4 janvier et il étonna les partisans de son travail en changeant ses sujets habituellement issus de scènes de la classe moyenne ou basse – tel que Oiseaux de nuit ou n’importe quel autre tableau voyeuriste qui regardait à l’intérieur d’une fenêtre à la dérobée. Dans ce tableau, il montre le hall élégant d’un hôtel peuplé par des convives bien habillés. La toile est dominée par des nuances de bleu et de vert avec quelques touches dorées sur le cadre d’un tableau et dans les cheveux blonds d’une jeune femme qui lit une revue. L’atmosphère évoque un silence poussiéreux. Un couple de personnes âgées discute. La femme porte une robe rose brillant sous un manteau de fourrure noir et est assise sur une chaise mauve trop rembourrée. Elle regarde son compagnon. Lui est debout sur un tapis vert déroulé qui mène vers une porte tourniquet aux cadres en bois, suggérée sur l’avant-plan. Un lambrissage de bois sombre et un comptoir d’enregistrement créé dans la même matière finissent la pièce tandis qu’une embrasure avec des rideaux vert sombre contraste avec les nappes blanches de la salle à manger. Les colonnes cannelées qui sont de chaque côté du comptoir d’enregistrement et l’ascenseur de cuivre avec sa porte ancienne qui se trouve à côté de l’entrée de la salle à manger suggèrent qu’il s’agit d’un vieil hôtel. Les casiers de courrier sont vides, ce qui indique qu’il y a peu de clients. Peut-être que cet hôtel n’est pas aussi prospère qu’il apparaît au premier abord. Une nouvelle fois, Hopper offre une palette ouverte pour que le spectateur finisse de remplir les détails de l’histoire racontée par l’image. Il est probable qu’il ait connu beaucoup d’hôtels de ce genre lorsqu’il visitait certaines villes pour participer comme jury d’expositions. Comme d’habitude, Jo posa pour qu’il crée les deux femmes de cette scène et elle utilisa son propre manteau de fourrure noir pour jouer la matrone assise. Il y avait de l’animation à la demeure des Hopper sur le Washington Square. Jo était en train d’accrocher quelques-uns de ses tableaux au mur de son atelier et avait invité des amis à venir admirer le fruit de ses derniers efforts. Ayant décidé, pour une fois, de la laisser tranquille, Edward travaillait à 120. Appartements (Apartment Houses), 1923.
204
l’huile sur une seconde toile dans son atelier, loin du va-et-vient des invités. Entre deux vagues
Huile sur toile, 61 x 73,5 cm.
envahissantes, Jo avait posé en jeune fille dans le plus pur style Hopper : une poitrine généreuse, de
Pennsylvania Academy of Fine Arts, Philadelphie,
longs cheveux roux et des courbes qu’elle n’avait aucun complexe à exposer. Cette princesse Eté au
Pennsylvanie, John Lambert Fund.
chapeau de paille jaune invite aux plaisirs d’une chaude journée d’été – peut-être le fantasme d’un soldat
205
206
en permission. Elle se tient sur le porche d’un immeuble ancien mais respectable dans l’entrebâillement de la porte du vestibule, sous le souffle chaud de la brise estivale qui fait voler les rideaux de la fenêtre du premier étage. Après avoir remis Eté aux bons soins de Frank Rehn, les Hopper avaient pris la décision surprenante de repartir pour le Mexique en train, pour la durée de l’été, parce qu’à Truro on s’inquiétait de la guerre et du risque d’une pénurie d’essence, ce qui aurait ruiné leurs plans. Leur voyage avait tourné au cauchemar, en grande partie du fait de l’engouement des Mexicains pour le mañana – tout peut attendre « demain ». Ils avaient alors grandement souffert des horaires fantaisistes des trains bondés et du manque de nourriture. Hopper rentra avec six aquarelles qui furent ajoutées par Rehn à l’exposition et acclamées par la critique. Les ventes en 1943 avaient été minces, malgré l’achat de Essence par le Museum of Modern Art. Hopper n’avait rien pu peindre au cours des trois derniers mois cette année-là. 1944 s’avérait difficile, les hostilités étaient dans l’air et Jo n’avait fait aucun effort pour célébrer leurs trente ans de mariage. Edward avait beaucoup de mal à terminer deux huiles pour la saison. Une nouvelle Josephine nus, de la série des ingénues dénudées de Hopper, pose devant une fenêtre ouverte sur la ville et ses lumières dans Matin dans une ville (p.209). La seconde toile représente un banc de sable peuplé de mouettes au passage d’un chalutier de plaisance hérissé de canes à pêche, d’un beaupré et d’un foc. Le tableau est intitulé The Martha McKeen of Wellfleet qui pourrait se rapporter au nom du bateau, mais qui en fait est celui de la jeune femme qui les avait emmenés pêcher. Cette œuvre s’était révélée difficile à exécuter et Hopper avait dû attendre décembre pour la terminer dans son atelier de New York. Jo s’était retranchée dans la chambre à coucher pendant qu’Edward travaillait. Cependant, cette situation, exacerbée par la réclusion et les contraintes, tourna bientôt au vinaigre et les abus verbaux se transformèrent rapidement en bataille rangée qui se terminait par une chasse à travers les dunes. Ils étaient tous les deux armés d’un bâton pointu, mais celui de la femme était plus court que celui de son mari et elle tenta de le dissuader de la transpercer en lui criant que c’était son héritage à elle qui avait payé la maison de Truro. Cela sembla le calmer un peu et plus tard, il la félicita pour la qualité de quatre de ses aquarelles, ce qui la transforma une fois de plus, en l’une des plus ferventes admiratrices d’Edward Hopper. Une troisième huile d’une maison sur un coin de route abandonné de Cape Cod, intitulée Solitude #56 (p.113) rentra également à New York en compagnie des Hopper quelque peu secoués par leur dernière aventure, et Edward apprit qu’il avait été élu à l’Institute of Arts and Letters. Il ne fut pas du tout impressionné par ce titre « purement honorifique ». La dernière année de la guerre vit Hopper errer parmi les immeubles faisant face à la rue boisée de Riverside Drive. Il y avait découvert un détail architectural inhabituel – une espèce de tourelle aux formes arrondies modelant la découpe d’une allée en deçà de la rue principale. Sur la droite, se trouvait une petite porte lambrissée surmontée d’un moulage élégant ressemblant à une poterne de château ou à une issue de secours camouflée. Des objets d’art encombrent la pièce derrière les trois baies séparées par des rideaux. La pièce maîtresse est une sculpture en bronze d’une femme grecque ou romaine enceinte. Août dans la ville (p.181) est la première d’une série de peintures déconcertantes qui continuèrent jusque dans les années 1950. Pendant ce temps, même les nobles murs du sélect Salmagundi Club avaient ouverts au travail de Hopper. Frank Rehn fit entrer Bureau, la nuit (p.192) à l’exposition du soixante-quinzième anniversaire du Club. Le Salmagundi était un asile pour les réalistes de New York qui avaient hué l’exposition de l’« Armory Show » de 1913, et avaient décrié les modernistes européens (groupés parmi les « DP » – Personnes Déplacées) qui avaient fui les Allemands et s’étaient réfugiés aux Etats-Unis. Non loin du club où Hopper n’aurait même pas été invité à boire une tasse de café en 1921, au temps où il vendait ses toiles de Paris, maintenant, en 1945, son Bureau, la nuit emporta le Grand Prix de
121. Fenêtres de nuit (Night Windows), 1928.
1000$. Etant donné le refus de l’adhésion à la Design Academy, le prix aura sans doute été une
Huile sur toile, 73,7 x 86,4 cm.
bonne récompense.
The Museum of Modern Art, New York. 207
Il accepta d’intégrer le National Institute of Arts and Letters et y exhiba quatorze de ses œuvres en sa qualité de membre nouvellement élu. Plus tard, au cours de ce même mois, ses aquarelles furent exposées aux côtés de celles peintes par Winslow Homer au Brooklyn Museum. En juin, une autre exposition au Museum of Modern Art présentait son travail sous forme de collection permanente. Mais son chevalet restait toujours vide et un séjour à Truro ne fit pas naître de nouvelles idées. Il n’avait plus aucune envie de peindre en extérieur, interdisant même à Jo de prendre la voiture pour faire ses propres excursions en solitaire. Emprisonné dans une lassitude prolongée, Hopper écouta la proclamation du président Truman à la radio sur la victoire sur le Japon, « si heureux de ne pas l’avoir entendu de la voix de Roosevelt » dit Josephine d’un ton moqueur.
62
Finalement, à la fin août, Hopper porta dehors des rouleaux de toile, des tendeurs et des broches et construisit un tableau sur lequel il travailla au fusain avec une couleur bleue diluée jusqu’à ce que le squelette de Rooms for Tourists soit tracé. Cette nocturne illustre le devant d’une maison des années 1880 illuminée par des projecteurs et révèle l’ambiance chaleureuse d’un lit et d’un petit déjeuner. Presque toutes les fenêtres sont parées de tentures. L’éclairage doit venir d’un poteau ou d’un arbre situé dans le bosquet, juste en dehors du tableau, sur le côté droit de l’armature. Il passa beaucoup de temps à voyager à Provincetown, dans le Massachusetts pour faire les croquis d’environ huit esquisses. On peut seulement s’interroger sur ce que les résidents ont pensé de ce grand homme étrange, se mouvant dans l’ombre au long de la rue. Il finit la peinture mi-septembre et se sentit de taille à en commencer une autre en octobre : deux maisons blanches côte à côte derrière trois troncs nus d’arbre dans un ciel dénudé. The Two Puritans, un titre probablement tiré de plusieurs sources, soit des deux points de vue puritains d’Edward et de Jo sur la vie, soit de la pureté du décor. Si la première, la grande maison, représente Edward, avec les fenêtres toutes voyantes, la petite maison symbolise Jo : porte grande ouverte devant (sa bouche) et deux yeux sombres (les morts). Là encore, la vision de Hopper laisse un savoureux espace libre pour l’interprétation. De retour à New York en octobre, ils apprirent que la toile de Hopper, Hall d’hôtel, avait gagné la Logan Institute Medal décernée par le Chicago Art Institute, avec un prix de $500. Ils apprirent également que l’exposition annuelle du Musée Whitney avait relégué les participants réguliers au deuxième étage du bâtiment, tandis que « les peintres abstraits » avaient été commandités au premier étage, à une place de tout premier choix. La mise à l’écart des paysagistes américains réalistes avait causé moins de peine à Josephine que la nouvelle de l’exposition du Century Club censée illustrer les œuvres des anciens élèves de Robert Henri mais où aucune de ses élèves féminines n’était représentée. Dans sa soixantaine, alors que sa vie était désormais derrière elle, Josephine Hopper entama l’année 1946 dans un lit de malade. Puisqu’elle en avait le temps, elle écrivit au peintre Carl Sprinchorn, un de ses alliés masculins, une longue lettre de huit pages décrivant ses déboires, sa carrière dont Hopper était totalement indifférent. « Je suis restée au lit avec la grippe ou l’inf luenza ou enf in quelque chose comme cela, qui s’est mis dans mes yeux et m’a interdit toute lecture pendant près de deux semaines. Et je suis restée ainsi, à l’article de 122. Matin dans une ville (Morning in a City), 1944. Huile sur toile, 112 x 153 cm. Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachusetts.
la mort, souf f rant, non de la grippe mais du passage triste des années, toute cette quantité d’années et qu’en ai-je fait ? » « ...(Hopper) n’a voulu de moi aucune étincelle, aucun appui, peu importe le nom qu’on lui donne – aussi faible, inf ime, insignif iant, etc. soient-ils, et cela me tue. Comme nous le savons, il doit y avoir un pis-aller, un coin dans lequel on amasse des choses, où on sait comment ça se passe... E.H. est resté dans le
123. Une Femme au soleil (A Woman in the Sun), 1961. Huile sur toile, 101,9 x 155,5 cm.
208
brouillard, mais il me verrait plutôt morte que d’accepter mon aide. Et c’est la vérité de Dieu – je ne peux pas continuer à vivre en tant que l’os de son os…, en agissant
Whitney Museum of American Art, New York, donation
de cette façon. Guy du Bois fait entrer des gens et dehors en sortent des images d’Yvonne – images très belles
à l’occasion du cinquantième anniversaire de M. et Mme
d’ailleurs. E.H. déclare « mais elle est de son sang, elle est née du Bois ». J’ai seulement épousé un Hopper.
Albert Hackett au nom d’Edith and Lloyd Goodrich.
Une race vraiment dégoûtante. »
209
212
Plus tard elle observa : « Ces phares sont des autoportraits. A Two-Lights, au Cape Elizabeth, il était pitoyable de voir tous les pauvres oiseaux morts qui s’y étaient heurtés dans la nuit. Je sais juste ce qu’ils ressentirent. La lumière éblouissante sur le dessus les avait trompés et en aucune façon ils auraient pu savoir qu’ils s’y briseraient le cou. » 63 Pendant que Jo déversait sa misère sur Sprinchorn, Edward s’était mis à travailler sur une toile qu’il avait commencée en janvier. Dans toute sa simplicité, Approchant une ville est une peinture très viscérale manifestant une inquiétude claustrophobe. Les voies ferrées pénètrent diagonalement dans la gueule noire d’un tunnel sous les yeux morts des bâtiments agglutinés contre un mur de soutènement en béton, témoins de ce qui est aspiré en dessous. La terrible réalité des détails, presque photographiques, tels que les pantoufles et le gravier sous les rails, les bavures de la suie d’échappement souillant la voûte d’entrée de tunnel, la symétrie des fenêtres des bâtiments et leurs différents détails font penser à un menu sur les plaisirs de l’entrée aux enfers de Jérôme Bosch. Pendant qu’Edward travaillait, Jo inscrivit deux aquarelles pour entrer à une exposition organisée par le « Pen and Brush Club », une organisation essentiellement féminine, avec laquelle elle se sentait en communion naturelle. Mais son travail fut rejeté. Après avoir été abattue par ses propres congénères, elle commença à reconsidérer sa position privilégiée en tant qu’épouse d’un grand et très honoré peintre tout en se demandant ce qu’Edward avait bien pu voir en elle. Faire la maîtresse de maison, s’occuper de la cuisine et des corvées domestiques (excepté la blanchisserie, qui était le domaine d’Edward) et l’accompagner dans ses voyages et événements sociaux auxquels il ne pouvait pas se dérober, étaient-ce là les principales fonctions de sa vie ? « Toute conversation avec moi envoie son œil vers l’horloge... il écoutera assez longtemps pour faire des déclarations, après quoi il y mettra f in volontairement. Reprendre le dialogue l’ennuie. » Ses conversations avec Hopper lui donnaient l’impression de « ... prendre le temps d’un spécialiste dispendieux. » 64 Leurs relations furent calmes seulement jusqu’aux préparatifs de leur retour au Mexique en été 1946 (cette fois-ci en voiture). Une querelle insignifiante à propos du déballage de quelque chose qui avait déjà été emballé, fit pleuvoir les gifles, les coups de pied, et déclencha finalement un combat enragé. Cette fois, alors qu’il la traînait, hurlante, sur le plancher, Jo parvint à le mordre profondément. Quand ils furent apaisés, ils finirent de faire les bagages et partirent ensemble pour le Mexique, la main d’Edward enveloppée dans un bandage. Jo écrivit dans son journal intime : « ... quelqu’un qui le verrait ainsi, patient, saint, ne pourrait imaginer les sévices qu’il fait subir à une personne comme moi. » 65 Le voyage vers le Mexique fut, on pouvait s’y attendre, un autre désastre plein de querelles et de disputes sans fin. Alors, ne supportant pas les odeurs, la nourriture, le peuple et l’architecture, Hopper décida d’aller vers la frontière, au Nord, plutôt qu’au Sud, vers Oaxaca, comme elle l’aurait voulu. Ils traversèrent les Etats de l’Ouest, ajoutant quelques aquarelles à celles qu’ils avaient pu peindre au Mexique, et arrivèrent à Truro juste à point pour qu’Hopper sombre dans une autre crise de dépression provoquée par la pauvreté des sujets à peindre à Cape Cod. Par la suite, il réussit quand même à peindre une huile sur le sujet d’une maison blanche isolée avec son garage décrépi attenant, dans un champ d’herbes mortes, devant un mur de forêt sombre. Octobre à Cape Cod (p.112) est un travail silencieux, tranquille et désolé que Jo a comparé à une des poésies préférées de Hopper qu’il a souvent lue à haute voix, Wanderer’s Nightsong de Johann von Goethe : Sur tous les sommets tout Est tranquille maintenant, Sur toutes les cimes d’arbre Ecoute, toi A peine un souffle ; Les oiseaux sont endormis dans les arbres :
124. Soleil du matin (Morning Sun), 1952.
Attends : bientôt comme ces derniers
Huile sur toile, 71,4 x 101,9 cm.
Tu te reposeras.
Columbus Museum of Art, Columbus, Ohio. 213
125. Onze Heures du matin (Eleven A.M.), 1926. Huile sur toile, 73,3 x 91,6 cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C., donation de la fondation Joseph H. Hirshhorn.
214
126. Hôtel près de la voie ferrée (Hotel by a Railroad), 1952. Huile sur toile, 79,4 x 101,9 cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C., donation de la fondation Joseph H. Hirshhorn.
215
A l’âge de soixante-cinq ans, la vision d’Edward Hopper sur la vie, comme celle de Josephine, avait commencé à inclure sa mortalité ; il pouvait entrevoir le peu d’années qui s’étendait devant lui et commençait à ressentir les infirmités de l’âge. Aussi des substituts à ses humeurs et à ses fantasmes commenceront à prendre plus de place dans ses paysages fantaisistes. Le retour vers New York vit les Hopper engagés dans une bataille pour sauver leur maison que l’université de New York, propriétaire du bâtiment, voulait reprendre et transformer en bureaux et en salles de classe. D’anciens résidents vinrent prêter main-forte pour faire opposition à la transformation et aux avis d’expulsion. Le bâtiment était considéré comme étant un lieu créatif, vu ses locataires illustres passés et présents et les œuvres d’art qui avaient été et continuaient à y être créées. Les projets de l’université furent finalement étouffés par le tumulte, mais Hopper dut s’arrêter de peindre jusqu’en janvier 1947. Il convient de noter que les expressionnistes abstraits continuaient à occuper une place respectable à l’exposition annuelle d’art américain du Whitney Museum of American Art. Devançant De Kooning et Rothko, Jackson Pollock étudia à la Art Students League en 1929, avant de côtoyer le régionaliste et muraliste Thomas Benson. Après avoir travaillé dans le style réaliste des muralistes mexicains Rivera, Orozco et Siqueiros, il abandonna le réalisme pour la non-représentation complètement abstraite avec une technique drip and splash dès 1947. Les critiques accablaient déjà le « Whitney Annual » de questions sur la légitimité des réalistes américains et se réjouissaient de l’arrivée des émotions crues des expressionnistes. Les expressionnistes abstraits ne réussirent pas convaincre Hopper qui considérait qu’ils peignaient la couleur, la ligne et la conception juste comme ça. Hopper fit une entrée en force en janvier 1947 avec sa peinture les « Mini-Oiseaux de nuit » sur un stand de hot-dog d’une ville anonyme du Midwest. A l’opposé du traitement énervé de noir de Oiseaux de nuit, cette scène pourrait se dérouler à l’aube, au bord du fleuve où deux clients attendent que le serveur leur verse leur première tasse de café. Son point de vue ascendant monte à l’angle du pont qui mène vers un centre ville encore silencieux, avec ses petits immeubles. Chaque ville côtière de taille moyenne (telle que Nyack) a son Jimmy’s. La lumière du restaurant donne le même effet que Oiseaux de nuit mais elle est accueillante plutôt que défensive. L’utilisation brillante que Hopper fait de la lumière comme outil de narration est nulle part plus évidente que dans Ville minière de Pennsylvanie, la peinture qu’il termina en avril. Un homme ratisse un pan de pelouse entre deux maisons familiales pendant qu’un soleil de fin d’été brille entre elles. La chemise qu’il porte est démodée pour le milieu des années 1940 où toutes les chemises ont des cols. Son gilet et pantalon assortis semblent également montrer que c’est une scène d’époque. Avec son bord comique de couleur verte, le pot en terre cuite éclaire la scène pleine et lourde d’une ville industrielle. Jo a appelé le jardinier le « Polonais », adoptant l’étiquette de la personne déplacée donnée à beaucoup de réfugiés européens de l’après-guerre. S’il s’agit de l’un de ces personnages, on peut comprendre aisément les vêtements démodés. Si c’est un mineur, l’observation du coucher du soleil aurait une signification spéciale pour quelqu’un qui a travaillé toute la journée sous la terre. Pendant que la bataille au sujet de leur logement de Washington faisait rage, Jo et Edward se réfugièrent à Truro. Une fois caché là, Edward se rappela un vieux souvenir des jours où sa sœur Marion se faisait courtiser à Nyack. Soir d’été dépeint un jeune couple, par une soirée chaude, sous les feux d’une lampe au-dessus du porche arrière d’une maison blanche en bardeaux. La jeune fille fronce les sourcils tandis que le garçon s’explique. Quoi qu’il vende, elle n’achète pas et la rudesse de l’éclairage du porche s’ajoute au rejet du garçon. Marion ne s’est jamais mariée et maintenant elle vit seule dans la maison de Nyack. Cette peinture est le seul produit de leur été à Truro. Une exposition sur le travail de Hopper à la galerie de Rehn a marqué le début de 1948. Elle attira les critiques désireux de comparer son réalisme mûr aux expériences débutantes de plus en plus importantes des expressionnistes abstraits qui couvrent les murs des galeries. En plus de ce 127. Soleil dans une cafétéria (Sunlight in a Cafeteria), 1958.
216
développement précoce de la « nouvelle peinture américaine », New York avait aussi attiré un certain
Huile sur toile, 102,1 x 152,7 cm.
nombre de surréalistes européens. André Breton avait assumé le manteau du porte-parole, et essayé
Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut,
d’agrandir le mouvement surréaliste en insistant sur le fait que de nombreux peintres étaient vraiment
legs de Stephen Carlton Clark.
des surréalistes.
217
128. Chambre à New York (Room in New York), 1932. Huile sur toile, 73,7 x 91,4 cm. Sheldon Memorial Art Gallery, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, Nebraska. 219
220
Des peintres n’appartenant à aucune école, comme l’épouse de Diego Rivera, Frida Kahlo et Edward Hopper, furent allégrement proclamés peintres surréalistes en raison des évocations profondément personnelles et étranges de leurs peintures. Les deux artistes rejetèrent cette étiquette. Hopper a expliqué sa position de peintre non-représentatif en avril 1945 lorsqu’il répondit à la lettre d’un psychologue, Dr Roe, pour expliquer son travail. Hopper indiqua au sujet de ses critiques, entre autres : « Ils n’ont pas une grande opinion de moi en tant que coloriste, ce qui, je pense, est juste si vous considérez l a couleur en soi. Ils n’ont pas non plus une grande opinion de moi en tant que concepteur, ce qui, je pense, est juste si vous considérez l a conception en soi. Cependant, ces dernières critiques ne me dérangent pas, car mon intention dans l a peinture est loin de vouloir considérer l a for me, l a couleur et l a conception comme une f in en soi. »
66
Il resta constant dans ses vues : alors qu’on lui demandait son avis sur la « nouvelle peinture américaine », il répondit que ces peintres essayaient de créer « ... la peinture « pure » c’est-à-dire, un art qui utilise la forme, la pose de la couleur, et conçoit pour le simple fait de concevoir, indépendamment de l’expérience de l’homme sur la vie et de son association avec la nature ». Il rajoutait : « Je ne crois pas qu’un tel but puisse être réalisé par un être humain... que nous laisserions trop en dehors de l’expression par la peinture, de ce qui ne peut pas être exprimé en littérature. »67 Hopper écarta les expressionnistes de son esprit pensant qu’il s’agissait d’une phase temporaire dans l’art, alors qu’il circulait en voiture avec Jo, à Truro, pendant l’été de 1948. Sitôt arrivé, il occupa l’atelier principal, se coupant de toute lumière, sauf de celle qui tombait sur sa toile en provenance de la devanture d’une boutique à l’orée du bois. Jo s’installa dans la cuisine où la lumière était « toute mauvaise » pour peindre ses aquarelles, pendant que ses vaines souffrances et ses humiliations, ruminées en silence, étaient consignées sur les pages de son journal intime et dans ses lettres à ses amis. La peinture, Sept heures du matin, représente un magasin blanc. Une vieille horloge à balancier indiquant sept heures partage la fenêtre avec quelques bouteilles et des photos, rien ne donne un indice sur les produits ou les services du magasin. Une caisse enregistreuse est peinte en évidence sur l’intérieur foncé. En haut, au-dessus du magasin, une fenêtre ouverte laisse entrevoir un pan de mur bleu clair. Audelà du magasin, un bosquet foncé et menaçant constitué d’arbres aux troncs tordus, se détache dans l’ombre. Quelque chose cloche dans la perspective du mur sur lequel l’horloge est accrochée. C’est une peinture inquiétante que Hopper jugea très bonne. Alors qu’ils se mettaient à chercher de bons sujets à peindre au Cap, ils se mirent à penser à des amis qui venaient de décéder, entre autres l’épouse de John Dos Passos, Katy, qui avait été gentille avec Jo, et Frank Crowninshield, l’ancien rédacteur de Vanity Fair, qui avait été un supporter de Hopper dès 1929. Edward a commencé à se sentir stressé, poussé par le besoin de trouver quelque chose à peindre. Le 23 octobre, il se réveilla avec des douleurs à la poitrine. Elles s’atténuèrent mais inquiétèrent les Hopper malgré tout. La maladie récente de Jo et les problèmes de santé et de dépression d’Edward précédèrent une forte pluie qui les a maintenus enfermés à l’intérieur. Ils renoncèrent à leur travail et firent leurs bagages pour New York. Comme si sa créativité fut régie par les phases de la lune ou par la page d’un calendrier, Hopper se mit à son chevalet en janvier 1949 puisant dans le fourre-tout de ses idées plutôt que dans les choses réelles de la vie. Conférence, la nuit (p.195) aurait pu être le fruit de quelques sketches à bord d’un train en provenance d’El, mais le spectateur se trouve dans un bureau presque vide en compagnie des trois personnages. Quelques reflets de lumière passent à travers la fenêtre sans rideaux. Des tables de bois vides remplissent la petite pièce et des éclats de lumière, provenant de la fenêtre, éclaboussent le mur. Les personnages rassemblent un homme au nez fin en bec d’aigle, du genre Staples, qui a tout l’air d’être le directeur du bureau, gilet ouvert et manches retroussées. La femme blonde, imposante, avait inspiré à Jo la réflexion que c’était une « Déborah – une vraie reine. » Le troisième homme au chapeau mou aurait pu être son fils ou un sous-fifre qui serait venu aux
129. Bureau dans une petite ville (Office in a Small City),
nouvelles pour le démarrage du nouveau commerce. Le collectionneur Stephen Clark avait acheté le tableau à
1953.
Rehn et l’avait promptement rapporté. Il a expliqué que son épouse avait dit que cela ressemblait trop à la
Huile sur toile, 71,1 x 101,6 cm.
réunion d’une cellule communiste. La Guerre froide avec l’Union Soviétique avait remplacé la guerre chaude et
The Metropolitan Museum of Art, New York,
les Américains voyaient des communistes se cacher derrière chaque buisson.
George A. Hearn Fund. 221
Il y eut un tohu-bohu chez Hopper et ses collègues lorsque l’Institute of Arts and Letters admit Georgia O’Keeffe. Ce chauvinisme cavalier avait fait piquer une petite colère à Jo, sur le sort des femmes, colère qui se transforma en tempête quand Edward, poussé par l’ennui, se permit de lâcher quelques propos insultants. Ce fut alors un chapelet de remontrances hargneuses entrecoupées de propos cinglants sur la piètre qualité de sa vie et de ses frustrations. Mais cette fois, au lieu de se rebiffer contre les propos de Jo, Hopper tomba dans une profonde dépression et cela à la veille d’une opération de la prostate. Son seul remède contre le cafard fut de s’abreuver de films, ce qui déplut à Josephine qui devait peindre pour sa thérapie. Dans un regain d’énergie, Hopper parvint à conduire jusqu’à Truro. Après avoir beaucoup cherché un thème, comme d’habitude, il commença en août une toile, des personnages dans une allée menant à une maison à lucarnes. Mais sa faiblesse et son malaise général l’avaient rendu incapable de conduire. C’est Jo qui était au volant vers Wellfleet quand la voiture dérapa ; une aile du véhicule fut cabossée. Edward éclata de rage. C’était la fin, la fin de tout bafouillait-il. Elle se mit en colère à son tour et dit qu’elle vendrait la maison de Truro – payée avec son argent à elle – s’il le fallait, mais il n’y aurait pas de divorce. Hopper prit le volant jusqu’à Hyannis et apprit que le coût de la réparation était de $25. De nouveau, la maison de Truro était sauvée et il termina la toile, Midi (p.133). C’est un tableau bizarre très surréaliste dans son agencement : une maison blanche à deux lucarnes avec un toit de bardeau gris est balayée par la forte lumière du soleil sous un ciel bleu. Sous le porche, une fille blonde portant seulement une longue robe bleue ouverte regarde fixement ce qui semble être une plaine vide. Hopper a même construisit un modèle en papier pour étudier la chute de la lumière à travers les gouttières du toit. La maison semble plutôt faire partie d’un décor de théâtre, parce que le toit est trop bas. Si la fille était de taille moyenne, elle ne pourrait pas se tenir droite au deuxième étage. C’est plutôt une maison imaginaire, une maison de rêve. De retour à New York, Hopper fit le projet d’une exposition rétrospective avec Lloyd Goodrich, conservateur au Whitney tandis que Jo partait à la recherche d’un local pour exposer son travail. Elle fut interrompue par Edward qui lui demanda de poser pour le tableau d’une femme s’asseyant sur le bord d’un lit tandis qu’un homme nu au visage tourné vers le bas se trouve derrière elle. Des jets de lumière entrent par les fenêtres sans rideaux. Il n’y a aucun meuble dans l’appartement autre que le matelas et l’armature du lit. Jo n’était pas le bon modèle pour la femme robuste que Hopper avait en tête. Elle finit par poser pour les jambes pâles de l’homme maigre. Il remit Eté dans la ville (p.185) à Rehn le 13 décembre. Dix ans après, il peindrait l’inverse de cette peinture, transposant le fardeau sombre et l’atmosphère dans Excursion philosophique (p.185). L’année 1949 vit la paix revenir dans la maison. Les années 1950 semblaient prometteuses avec la rétrospective de Edward et la peinture du San Esteban de Josephine sur les murs du National Arts Club.
Son Opinion Les années 1950 furent une période marquante pour Edward Hopper qui était arrivé au summum de son art et de sa renommée. Il put se défendre, avec d’autres peintres réalistes, contre l’impact de la « nouvelle peinture américaine » qui avait commencé à envahir New York. Il était septuagénaire, sa santé était chancelante et son travail, avec lequel il ne faisait plus qu’un, de plus en plus introspectif. Curieusement, sa dernière peinture des années 1950 est une image-miroir de sa dernière peinture des années 1940. L’Excursion philosophique montre une femme moitié nue endormie sur un lit aux côtés d’un homme s’asseyant sur le bord du lit, entièrement vêtu de la tête aux pieds. La pièce est vide excepté une peinture sur le mur. On voit une fenêtre avec des volets ; l’ambiance est bucolique, pas urbaine. À côté de l’homme sur le lit se trouve un livre ouvert comme s’il le lisait et venait de le poser là (Jo déclara que c’était « Platon » dans son carnet des ventes). Rapidement peint, en seulement onze jours, Excursion philosophique semble correspondre à une reprise de souffle entre ce qui est arrivé dans le passé et ce qui se prépare pour le futur. 130. Bureau à New York (New York Office), 1962.
222
Juste avant la grande rétrospective de Hopper au Whitney le 9 février 1950, Edward rentra à
Huile sur toile, 101,6 x 139,7 cm.
l’hôpital de New York avec la diverticulose, une maladie de l’intestin et du gros intestin. Tandis qu’il
Collection du Montgomery Museum of Fine Arts,
était alité, Jo assista à la première de la rétrospective. Elle était consternée. Trop d’œuvres se trouvaient
Collection Blount, Montgomery, Alabama.
entassées les unes sur les autres dans un espace restreint. Leur chronologie laissait par ailleurs
223
131. Deux Comédiens (Two Comedians), 1965. Huile sur toile, 73,7 x 101,6 cm. Collection M. et Mme Frank Sinatra. 225
beaucoup à désirer. Elle écrivit dans son journal intime : « Il [Lloyd Goodrich] est terne et a très mauvais goût. Il est scolastique et assidu mais n’est pas l’imprésario qu’il se targue d’être. »68 Au moment de la clôture de l’exposition, le 26 mars, environ 24000 personnes avaient admiré les peintures et gravures à l’eau-forte de Hopper. Il était heureux, la critique aimable, et tous ceux qui signifiaient quelque chose avaient fait l’éloge de son talent. Time Magazine l’avait proclamé peintre pratiquement hors pair « de la scène américaine », une appellation qui avait irrité Hopper et ce d’autant plus qu’elle l’avait comparé à Charles Burchfield. Burchfield, lui, avait comparé la qualité classique de son travail à Winslow Homer et à Charles Eakins. Burchfield s’extasiait plus loin : « Contrairement à beaucoup d’artistes célèbres, il est inutile, ou même impossible, d’ignorer Hopper, l’homme, en étudiant son art. Avec Hopper, le tissu entier de son art semble être complètement entrelacé avec son caractère personnel et sa façon de vivre. Par moment il souf f re l’agonie ; si important pour lui est le besoin de peindre. » 69 Jo fut lumineuse aux côtés d’Edward, accrochée à son bras à toutes les réceptions et – au désespoir de nombreux – à faire la majeure partie de la conversation pour lui. Elle aurait pu se souvenir du commentaire de Lucy Bayard lors de sa visite à Truro l’année précédente alors qu’elle avait été bénie d’avoir un mari si fidèle et célèbre. Mais Jo avait une « mémoire d’éléphant ». Elle écrivit souvent qu’elle se rappelait chaque entaille, chaque babiole, chaque mot dur, chaque menace et chaque gifle. Avec une confiance en elle chancelante, elle jouait parfaitement son rôle en public. Dans le cadre de l’exposition, le magazine Life fit un grand reportage sur Hopper et son éloge déclencha chez Jo cette fureur, cette envie et cette peine qui la rongeaient de l’intérieur à chaque honneur qu’on faisait à son mari, honneurs qui culminèrent par un doctorat honorifique accordé par le Chicago Art Institute. Ils continuèrent par la suite leur routine annuelle et arrivèrent à Truro pour l’été. Parce qu’il avait vieilli, Edward avait moins d’énergie, il était devenu plus docile et laissait Jo conduire plus souvent. Puis un jour, alors qu’elle faisait un écart pour éviter une voiture qui approchait, il saisit le volant et leur vieille Buick percuta un poteau. Frénétique, Hopper l’extirpa de derrière le volant depuis la rue, et la força à s’asseoir sur le siège des passagers. Les gens du pays notèrent alors que les Hopper étaient arrivés pour l’été. Hopper travailla à ce qui serait son chant du cygne sur des vues architecturales droites faites à l’huile au Cap, pendant qu’il finissait Orléans, un portrait (p.248), une petite ville de Cape Cod. Tandis que sa composition est presque parfaite dans le sens académique, les bâtiments (occupés par un seul habitant) donnent le sentiment de quelque chose d’éphémère, comme placé sous un arbre de Noël ou servant à décorer la piste circulaire d’un train électrique pour enfant. Il peindrait des aquarelles pendant leurs voyages au Mexique, mais ses huiles regroupaient des personnages à la recherche de quelque chose en dehors du tableau. Le paysage purgé, urbain ou rural, servait seulement de cadre pour cette fonte des caractères dans l’esprit de Hopper. Ils avaient tous un air de ressemblance, pas physiquement, mais dans le fond de leur pensée ou dans leur concentration. Cette ressemblance est encore plus inconfortable quand on considère les bouleversements se produisant autour de Hopper au moment où ils ont été créés. Les tensions de la guerre froide entre la Chine et l’Union Soviétique contribuèrent à déclencher la guerre de Corée en 1950 qui traîna dans les sempiternelles conférences sur la paix de Paris et de Panmunjom. Mais cette guerre était moins importante pour Hopper, et d’autres peintres réalistes américains, que la bataille contre l’art non-objectif, les expressionnistes abstraits et les nouveaux peintres figuratifs expressionnistes en vogue à New York et en Californie qui les menaçaient de marginalisation. L’art dit « style » se caractérise par des couleurs et une composition appliquées avec de grands coups de pinceau, des filets de peinture posés sur la toile, des gestes énergiques, le tout sur des plans différents ; il tronque soudainement la science des réalités sous la poussée de Bellows, Sloan, Luks, Davies, Sheeler, du Bois, Krohl, Glackens, Prendergast et Robert Henri. Cette « troupe noire révolutionnaire », les « apôtres de la laideur », ainsi baptisés par la critique, avait réduit les peintres académiques, toujours enracinés dans 132. Girlie Show, 1941.
226
le XIXe siècle, à une simple mention de bas de page dans l’histoire de l’art américaine. Les critiques eux-
Huile sur toile, 81,3 x 96,5 cm.
mêmes ne parvenaient pas à interpréter ces nouveaux artistes qui « sortaient des normes ». Quelques
Collection privée.
critiques se lancèrent dans des descriptions incompréhensibles telles que « ... l’impossibilité de
227
133. Deuxième Rang à l’orchestre (Two on the Aisle), 1927. Huile sur toile, 101,6 x 121,9 cm. The Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio, donation d’Edward Drummond Libbey.
228
134. Premier Rang d’orchestre (First Row Orchestra), 1951. Huile sur toile, 79 x 101,9 cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C., donation de la fondation Joseph H. Hirshhorn.
229
230
desapercibiser (sic) une manifestation de ce type... incandescence génésiacale (sic)... »70 Un guide était nécessaire pour déchiffrer le code. De tous les réalistes en voie de disparition, Hopper était le plus respecté. Sa méthode mûre et réductrice distilla ses peintures dans des interprétations impossibles de la réalité ; ses créations d’un égoïsme enfiévré le conduirent à la réussite pendant toute sa vie par les coups de ses pinceaux sur la toile. Les tableaux de Hopper des années 1950 et des années 1960, dans leur version cachée de la réalité, étaient non moins enfiévrés que ceux de l’expressionnisme abstrait le plus explosif. Hopper était invulnérable. Il s’éleva au-dessus des bras croisés et des chariots cerclés des restes archéologiques de la « Ash Can », se démarquant des expressionnistes sensationnels diminués par leurs manifestes et leurs revendications sans fin. Les surréalistes qui l’avaient accueilli avaient seulement étreint la vapeur dans le ciel. Il joignit cette coterie des über-artistes qui défient les étiquettes : René Magritte, H.C. Westermann, Ivan Albright, Alexander Calder, Antoni Gaudí, Edward Weston et Georgia O’Keeffe. Chacun donna sa propre interprétation au mode d’expression qu’ils avaient choisi. Mark Strand, poète lauréat à la Library of Congress et gagnant du Prix Pulitzer de poésie écrivit à propos des peintures de Hopper : « Les peintures de Hopper sont courtes, un isolement des moments de la f iguration qui sug gèrent la tonalité de ce qui suivra, juste comme elles reportent la tonalité de ce qui les a précédées. La tonalité mais pas le contenu. L’implication mais pas l’évidence. Elles sont saturées de sug gestions. Plus elles sont théâtrales ou mises en scène, plus elles nous invitent à nous demander ce qui se produira après ; plus elles sont réalistes, plus elles nous invitent à construire un récit avec ce qui précédait... elles sont tout ce qui peut être glané, non pas de l’instant présent vécu, mais de ce qui venait avant et de ce qui viendra après, l’ombre de l’obscurité qui plane au-dessus d’elles fait que nos récits bâtis autour d’elles semblent sentimentaux et hors de contexte. »71 La peinture de Hopper, Matin à Cape Cod (p.124), caractérise ses dernières œuvres avec des personnages suspendus dans le temps. Peinte à Truro en octobre 1950, une femme, derrière une fenêtre en saillie, dévisage attentivement quelque chose au-delà de l’armature. La lumière pénètre dans la pièce à travers l’herbe dorée et touche les arbres de la forêt au fond. L’architecture de la fenêtre est impossible ; le côté vers la lumière est trop étroit. C’est un peu comme la poupe d’un bateau jaillissant du mur de bardeau de la maison. La fenêtre est seulement un dispositif pour contenir l’inquiétude de la femme. Le rendement de Hopper souffrit encore l’année suivante alors qu’il peignait l’huile, Premier Rang d’orchestre (p.229). Jo et lui avaient eu la chance de profiter de ces fauteuils dispendieux offerts par un ami. Le tableau met en scène leur bonne fortune dans l’assemblée bougonne des spectateurs avides de théâtre, mis sur leur trente et un, attendant la levée du rideau. Comme souvent, Hopper explore l’anticipation d’un événement, la périphérie, jamais l’événement en soi et, comme d’habitude, l’attente joyeuse ne fait pas partie de l’expérience. Toujours oublieux (ou pleins d’espoir), Edward et Josephine étaient repartis en voiture vers la pointe du Mexique, de nouveau en quête d’inspiration, pour découvrir seulement une vague de chaleur déferlant sur le pays. Incapable de supporter la chaleur, Edward se dirigea vers le nord, droit sur Santa Fe, pour revoir une nouvelle fois la ville après vingt-cinq ans. De l’avis de Hopper, elle n’avait pas changé en bien. Sur ce, ils repartirent, dormant dans des motels et des camps de touristes minables jusqu’à arriver enfin à Cape Cod. Dans l’atelier de Truro, Hopper peignit Chambres sur la mer (p.157), une vue depuis la porte de derrière, sur l’entrée de leur chambre à coucher. La lumière pénètre par la porte ouverte qui ne s’ouvre que sur la mer et la marche ordonnée des vagues. Bien qu’il ait été possible de voir ce phénomène de la maison – la pente raide d’une falaise sablonneuse ne pouvant être aperçue depuis la porte – comme
135. Cinéma new-yorkais (New York Movie), 1939.
indiqué dans le tableau, la prise de vue semble impossible puisqu’elle place la mer au ras de la porte.
Huile sur toile, 81,9 x 101,9 cm.
Hopper a fait une plaisanterie visuelle extrêmement rare.
The Museum of Modern Art, New York,
Hopper fut surpris d’apprendre que le Art Institute of Chicago avait attribué à Willem De Kooning le
donation anonyme.
prix Logan et acheté son mural, Excavation. Hopper avait gagné le même prix en 1923 ($25) pour une ses gravures à l’eau-forte. De Kooning représentait tout ce que Hopper détestait au sujet des expressionnistes
136. Edgar Degas, Intérieur (Le Viol), vers 1868-1869.
abstraits. Hopper ne manquait pas une occasion pour qualifier ces travaux non-objectifs de « passades ».
Huile sur toile, 81 x 116 cm.
Willem De Kooning développa les peintures gestuelles, l’art figuratif et les paysages urbains abstraits tout
Philadelphia Museum of Art, Philadelphie,
au long des années 1950.
Pennsylvannie.
231
137. Entracte (Intermission), 1963. Huile sur toile, 101,6 x 152,4 cm. Collection de M. and Mme Crosby Kemper.
232
138. Le Théâtre Sheridan (The Sheridan Theater), 1937. Huile sur toile, 43,1 x 63,5 cm. The Newark Museum, Newark, New Jersey, Felix Fuld Bequest Fund.
233
A leur retour à New York, Edward apprit qu’un groupe était en voie de formation, composé « des peintres objectifs essayant de se défendre » contre le Museum of Modern Art. Le musée avait semblé s’enticher dernièrement d’art non-objectif à la consternation des réalistes apparemment rétrogrades. Aux environs de Noël, Hopper essaya de nouveau de comprendre les raisons de ses ennuis conjugaux avec Jo. Il lui offrit une copie de la poésie de Rimbaud, dédicacée en français « Au petit chat qui sort ses griffes presque chaque jour ». Josephine avait noté que sa vue s’était affaiblie ; elle souffrait de maux chroniques dus au stress et avait commencé à critiquer si ouvertement le traitement et les souffrances causées par Edward que les amis et les connaissances occasionnelles qu’elle s’était acquis aux expositions commencèrent à y prêter attention. La façade de l’épouse dévouée commençait à se craqueler. Hopper avait réussi à la faire poser pour Soleil du matin à New York qui figurait encore une autre femme, en combinaison légère, rose, sur un lit, regardant la ville par la fenêtre. La femme est moins importante que la lumière qui la heurte et que le mur à côté du lit. Cette préoccupation de la lumière et des sources de lumière est un thème récurrent dans ces peintures figuratives. En 1952, il peignit aussi Hôtel près de la voie ferrée (p.215). Un couple déjà âgé se repose dans une petite chambre, probablement dans un hôtel-résidence. La femme est en combinaison légère, lit un livre et lui porte l’uniforme de la bourgeoisie vue par Hopper, chemise blanche, pantalon noir et gilet assorti. L’homme semble être en train de parler en faisant des gestes, mais elle ne prête aucune attention. Elle a déjà tout entendu. Au-delà de la fenêtre se trouvent les textures urbaines familières, le verre, le granit et les fenêtres vitrées, alors que des rails de chemin de fer suggèrent l’évasion (si seulement il n’était pas trop tard...). L’inverse de cette peinture Route à quatre voies (p.245) sera réalisé en 1956. Regards sur la mer (p.163) est la production de tableaux en 1952. Peint en octobre à Truro, un couple entre deux âges en costumes de bain regarde fixement vers la mer depuis la véranda de leur modeste maison de plage. Des vêtements flottent au vent sur une corde à linge. Ils font face à la mer, muets, comme si un grand évènement les avait frappés. Jo les a décrits dans son livre, comme elle l’a fait avec plusieurs des personnages d’Edward : « Sheila et Adam : femme irlandaise, douce, gentille, grand Yankee pêcheur de moules, de très braves gens, à la Nouvelle-Angleterre pour un bain tardif. Invention des personnages par E.H. » 72 À New York, la guerre contre les expressionnistes abstraits était montée d’un cran. Un nouveau magazine, Reality : A Journal of Artists’ Opinions était en voie de formation pour devenir l’organe des réalistes et des peintres objectifs menacés par la percée « des peintres d’action » sur leur terrain traditionnel, le Whitney Museum of American Art et le Museum of Modern Art. Les galeries autour de la ville accrochaient également toujours les travaux de Jackson Pollock, Willem De Kooning, Clyfford Still, Adolph Gottlieb, Franz Kline, Robert Motherwell, Barnett Newman, Ad Reinhardt et Mark Rothko. Tous des artistes « de l’école de New York », ce qui avait hérissé Hopper. Invité à assister à des réunions éditoriales et à contribuer à Reality, il avait accepté. Alors que le premier numéro devait sortir en 1953, il écrivit : « Le Grand Art est l’expression extérieure d’une vie intérieure chez l’artiste, et cette vie intérieure aura comme conséquence sa vision personnelle du monde. Aucune quantité d’invention habile ne peut remplacer l’élément essentiel de l’imagination. Une des faiblesses de la peinture abstraite est la tentative de substituer les inventions de l’intellect à une conception imaginative primitive. » « La vie intérieure d’un être humain est un vaste et complexe royaume qui ne se satisfait pas des 139. Trottoirs new-yorkais (New York Pavements), 1924. Huile sur toile, 61 x 73,7 cm. Chrysler Museum of Art, Norfolk, Virginie, prêt de la collection Walter P. Chrysler, Jr.
arrangements stimulants de la couleur, la forme, le concept. » « Le terme Vie utilisé dans l’art est quelque chose à ne pas mépriser, parce qu’il implique toute l’existence, et la raison d’être de l’art est d’en prendre acte et non de l’ignorer. » « La peinture devra traiter plus entièrement et moins obscurément des phénomènes de la vie et de la nature avant qu’elle ne puisse redevenir grande à nouveau. » 73
140. Eté (Summertime), 1943. Huile sur toile, 73,6 x 111,8 cm.
234
Le soutien de Hopper pour les peintres réalistes le mit en contact avec un public plus jeune alors que
Delaware Art museum, Wilmington, Delaware,
ses propres contemporains disparaissaient. Kenneth Hayes Miller, un de ses premiers instructeurs, venait
donation de Dora Sexton Brown.
de décéder. John Sloan, un autre contemporain, membre du groupe original des « Huit » de Henri était
235
238
mort en 1951. Hopper a continué à assister aux réunions de ces artistes et pour eux, son silence laconique tenait lieu de tranquille et sage approbation. Hopper fit un autre voyage pour le Mexique en 1953. C’était la montagne russe habituelle des bonnes périodes, bonne nourriture, mauvaise nourriture, pannes de voiture, maladies qui se terminèrent par une course vers la frontière des USA. Avec toujours aussi peu de résultats sur le plan de la productivité. Le grand événement d’art de l’année était le lancement de Reality et de son accueil positif dans la communauté artistique réaliste. Le complexe d’infériorité de Josephine avait été encore nourri par les excuses embarrassées de Lloyd Goodrich, conservateur au Whitney, qui ne l’avait pas incluse dans sa dernière exposition annuelle. Elle répliqua avec une lettre acide à Goodrich où elle disait : « Au cours des années j’ai appris que mes pauvres petits bâtards – sont des petits bâtards et leur existence même est inavouable. » 74 Mais ses sentiments de rejet s’évanouirent à l’occasion de l’exposition annuelle du Whitney le 14 octobre 1953. Hôtel près de la voie ferrée de Hopper avait été accroché à côté d’une huile de Josephine, Convent across the Square through Fire Escape. Robert Coates du New Yorker avait, dès le lendemain, qualifié Edward et Jo Hopper, ainsi qu’Henry Varnum Poor de réalistes acceptables. Un de ses petits bâtards avait trouvé une maison. New Yorker est la seule huile d’Edward Hopper en 1953. C’est encore en tant que voyeurs que nous entrons dans ce qui semble être le bureau d’un architecte ou d’un artiste en dessin mécanique, il fait une pause devant une planche à dessin. L’homme est l’homme de la rue de Hopper, chemise blanche et gilet foncé au teint blafard de citadin. Il regarde fixement un bâtiment en bas dans la rue, un amas triste et vieillot au toit monté d’un élément de ventilation. À côté de ce bâtiment se trouve le pan blanchâtre d’un autre bâtiment plus grand qui est soit un entrepôt, soit la moitié de ce qui constituait dans le passé deux bâtiments. Directement en face et juste au-dessous de la vue de l’artiste on voit ce qui semble être le dos d’un panneau publicitaire dont l’armature antique ne correspond pas aux murs sévères en béton de son bureau. Hopper se sentait-il assiégé dans sa petite communauté artistique de New York ? Était-il un artiste démodé emprisonné dans un monde moderne ? Quand Bureau dans une petite ville (p.220) fut terminé le 8 octobre 1953, il fut livré à la galerie de Rehn. Frank Rehn avait eu une crise cardiaque et son assistant John Clancy dirigeait désormais la galerie. Hopper était inquiet. Il n’avait jamais eu un autre agent, mais Clancy avait paru compétent et maintenant que la renommée de Hopper était établie, les ventes et les expositions étaient plus faciles à organiser. De 1954 à 1960, les Hopper continuèrent leurs déplacements saisonniers entre Truro, le Mexique et l’Ouest. Ils rentraient à New York chaque automne pour se mesurer aux expressionnistes ; Edward passait son temps à participer à des jurys d’exposition tandis que Jo commençait à avoir un certain succès pour trouver des expositions pour ses peintures. Malheureusement, les cataractes naissantes et les colites continuaient de l’affaiblir, tandis qu’Edward devait aller à l’hôpital régulièrement pour des interventions chirurgicales liées à des hernies et à sa prostate. L’électricité finalement fut installée dans leur résidence d’été de Truro en 1954, et un serveur sourd-muet assurait la corvée du transport de charbon dans leur appartement et dans les ateliers de Washington Square. Les peintures figuratives continuèrent pendant cette période. Soleil dans la ville (1954) (p.187) montre une fille rousse (substantiellement vieillie) regardant par la fenêtre pendant la journée, toujours vêtue de sa combinaison rose. De curieuses doubles fenêtres de chaque côté d’un extérieur massif donnent sur l’intérieur de l’appartement où elle se trouve, comme si la pièce avait été ajoutée après que l’immeuble fut construit. Les couleurs terreuses et une simple source lumineuse, à la Rembrandt, lui donnent un cachet hollandais. Matin en Caroline du Sud (1955) (p.187) s’éloignent de la formule de Hopper pour ses personnages. « Dina » (ainsi appelée par Jo), une métis, regarde les spectateurs du tableau, droit dans les yeux. Elle porte une robe rose, un chapeau à large bord assorti, et des chaussures à hauts talons. Elle croise les bras
141. Wagon-Salon (Chair Car), 1965.
et son regard fixe et direct semble solliciter des clients pour pénétrer dans cette douteuse maison grise
Huile sur toile, 101,6 x 127 cm.
plantée au milieu d’une prairie herbeuse.
Collection privée. 239
Quant à Fenêtre d’hôtel (p.189) terminé à New York en décembre 1955, cette œuvre nous fait pénétrer dans un hôtel bon marché au moment où une femme d’âge avancé mais élégante et soignée semble attendre un taxi. Sa présence paraît incongrue dans cet endroit. Le concept est probablement issu des promenades de Hopper, entre Broadway et la Cinquième Avenue, où il avait noté un nombre d’hôtels de deuxième classe ouverts aux clients de passage, à des représentants et des résidents retraités. Son apparence bien coiffée et bien vêtue efface un sentiment de vulnérabilité. Bien que les espaces autour d’elle soient géants et vides, elle demeure insouciante. 1955 semble avoir été l’année des femmes fortes chez Hopper. Ses cinq peintures à l’huile suivantes ont été accomplies entre 1956 et 1959 : Soleil sur Brownstones (1956), Route à quatre voies (1956), Motel à l’Ouest (1957), Soleil dans une cafétéria et Excursion philosophique (1959). Les personnages intercalés de Eté dans la ville peint en 1949 et le commentaire savoureux de la vie de Hopper dans Route à quatre voies ont fait tourner plus d’une tête parmi ses contemporains. Route à quatre voies (p.245) est artistiquement bien réussi. Des bandes de nuages bas, une bande de forêt dense, des bandes d’accotement vertes et des bandes de chaussée goudronnée jusqu’à la bande de nuance bleue, toutes passent devant la station-service avec ses pompes rouges – comme la station d’essence de Essence. Ici, l’agitation des bandes horizontales soulignent seulement l’immobilité implacable du propriétaire du garage, planté au soleil, fumant un petit cigare. Sortant de la fenêtre sur sa droite, comme le prête-nom sur un bateau de navigation, une femme (son épouse ?) le réprimande pour son apparente négligence. Selon les notes écrites sur les carnets de ventes et dans le journal intime, cela prit un certain temps à Jo de comprendre les implications qu’aurait ce tableau sur sa relation avec Hopper. Elle eut cependant peu de temps pour s’attarder sur ces pensées puisque Edward gagna la récompense 1956-57 de $1000 décernée par la Huntington Hartford Foundation, en plus d’un séjour de six mois à la « colonie » d’artistes de Lloyd Frank Wright en Californie. Ils profitèrent au maximum des douches chaudes, de la bonne nourriture et des ateliers spacieux (il y avait même un grand atelier pour Josephine). Les repas commun enchantèrent Jo mais poussèrent un Edward, ronchonnant, à l’extrémité de la table. Tandis qu’il se cachait de ses camarades d’art de la colonie, Hopper apprit que sa toile Route à quatre voies avait été vendue $6000. 1959 clôtura une décennie déterminante pour la pérennité de Hopper au titre de doyen des peintres réalistes américains ; l’expressionisme abstrait et les variations de l’art non-objectif étaient maintenant constamment sur les murs des musées et des principales galeries. Le Museum of Modern Art lança une exposition ambulante des grandes peintures. Leur impact secoua l’Europe et les bastions du bon goût pour engager les Espagnols, réveiller les Allemands, embarrasser l’Union Soviétique et tracasser vraiment les Français, qui n’avaient pas eu de peintre de catégorie supérieure depuis Dubuffet qui atteignait désormais la soixantaine. Aux Etats-Unis, certains critiques ouvrent enfin les yeux. John Canaday occupa la place de rédacteur d’art au New York Times et asséna le premier coup de massue dans son premier éditorial : Une Dissidence américaine : « Nous nous sommes faits avoir. » « On ne peut objecter que l’expressionisme abstrait soit une manifestation de la période compliquée où nous vivons. Les meilleurs expressionnistes abstraits sont bons comme ils ne l’ont jamais été – pour ne rien vous cacher. Mais pour parler du phénomène des charlatans et des personnes malavisées qui entourent cette poignée d’artistes sérieux et doués, permettez-nous d’admettre au moins que la nature de l’expressionisme abstrait permet une tolérance exceptionnelle pour l’incompétence et la tromperie... » « En reconnaissant un monstre de Frankenstein quand ils en voient un – et dernièrement on ne peut pas le manquer – certains critiques et professeurs pleurent, – mais qu’allons-nous faire ? Nous ne pouvons pas revenir à nouveau à ces vieux Grant Wood (paysagistes). Naturellement il n’est pas question de revenir en arrière, mais bien d’aller vers l’avant – quelque part. Il est peu probable que nous 142. Les Contrebandiers (The Bootleggers), 1925.
240
dépassions le stade de l’expressionisme abstrait puisqu’il est de plus en plus évident que ces artistes ont
Huile sur toile, 76,5 x 96,5 cm.
atteint peu à peu l’extrémité d’une impasse de plus en plus étroite au fond de l aquelle ils se sont trouvés
The Currier Museum of Art, Manchester,
bloqués. Dans l’un ou l’autre cas, ils exploitent un secteur très étroit – ce qui, en y pensant, peut
New Hampshire.
expliquer pourquoi ils ont de plus en plus besoin de peindre sur de si grandes toiles... Nous nous sommes
241
242
faits avoir. Dans la période la plus merveilleuse et la plus terrible de notre temps, les expressionnistes abstraits ont répondu par l’art le plus étroit et le plus bancal de l’histoire. Jamais auparavant les peintres ont fait si peu avec autant. »
75
Les Comédiens Gens au soleil (pp.160-161) est une toile imposante et un projet ambitieux pour un Hopper âgé de soixante-dix-huit ans, alors même qu’il entre dans les années 1960 qui seront les dernières années de sa vie. Jo continuait à s’occuper de leurs affaires. L’université de New York avait décidé d’installer le chauffage central, choisissant d’abord le gaz, à la grande peur de Jo, mais optant plus tard pour un chauffage à vapeur, moins risqué ; il y avait trois radiateurs. Le transport du charbon et des cendres prendrait fin également. Quand les nuages de pluie commençaient à menacer au-dessus de leur lucarne, abîmant la qualité de la lumière pour la peinture, ils se rendaient au cinéma, mais lorsque la lumière du soleil – l’obsession de Hopper – revenait dans la pièce, le dernier se remettait au travail. La scène montre cinq personnes tout habillées assises sur des transats posés sur un sol en béton, baignés avec satisfaction par les rayons du soleil. On note le pan d’un bâtiment en béton avec des rideaux aux tons dorés familiers sur le coin gauche supérieur de la toile. Une chaîne de montagnes, au loin, se trouve au-delà d’une prairie plane d’herbe dorée. Le tableau est étrangement idyllique, comme si les personnages étaient dans l’expectative. Les montagnes sont en dents de scie, avec des cimes régulièrement espacées de la couleur des vagues de la mer. Là encore, l’inclusion de certains détails dans les vêtements, les chaises pliantes, les rideaux plissés contribue à exprimer une réalité effrayante. Hopper indiqua que l’idée lui était venue en observant des gens en train d’apprécier le soleil dans le Washington Park de New York, mais son extrapolation de ces adorateurs citadins du soleil dans une prairie de l’ouest inverse l’impression suscitée par la scène originale. Jo et Edward continuèrent à soutenir la faction des artistes anti-abstraction de New York. Il signa une lettre commune de protestation au Whitney Museum, alors que de plus jeunes artistes manifestaient devant le Museum of Modern Art qui avait complètement embrassé le mouvement des expressionnistes. Edward était un protestataire réticent contre le Whitney puisque sa carrière avait commencé là, dans les années 1920. Le musée avait été son partenaire privilégié pendant quarante ans et le travail de Jo se trouvait accroché sur ses murs lors de chaque exposition annuelle. Mais son rejet du « gobbledegook » des expressionnistes demandait qu’il appuyât les protestataires. Jo souffrit un revers lorsqu’une galerie, dirigée et possédée par Herman Gulack, qui avait accepté ses œuvres, avait fait faillite et lui avait rendu ses peintures. Gulack avait été son admirateur et sauveur quand il avait ouvert sa galerie, et elle était désormais obligée de montrer ses tableaux dans son propre atelier, une épreuve rendue difficile par les soixante-quatorze marches de l’escalier d’accès. Pour briser leur isolement lors d’un nouveau séjour à Truro, les Hopper achetèrent un phonographe et Edward fut tellement ému par les valses de Strauss qu’il prit Jo par la taille et ils dansèrent, malgré leurs rhumatismes. Deux autres événements marquèrent l’été. Dans Provincetown, pas très loin de Truro, s’ouvrit une école pour cette peinture abstraite tant détestée, et Hopper a terminé une grande toile, Deuxième Etage ensoleillé (pp.138-139). Sur le balcon du deuxième étage d’une maison blanche, une grand-mère aux cheveux gris lit son journal tandis qu’une jeune fille blonde (sa petite-fille ?) est assise sur la balustrade en bikini comme pour exhiber ses charmes voluptueux à tout le voisinage. Jo – qui posa pour les deux personnages – appela la fille « Toots » et décida qu’elle ne voulait en dire aucun mal : « ... un agneau dans l’habit du loup ».76 Un des points culminants de la saison 1961-1962 avait été pour Hopper de renouer contact avec le conservateur Karl Zigrosser qui souhaitait monter une rétrospective complète des gravures à l’eau-forte de Hopper au Philadelphia Museum of Art. Plutôt que de demander à Hopper de tirer de nouvelles
143. Scène de rue, Gloucester (Street Scene, Gloucester),
impressions sur la presse antique qui trônait encore dans l’atelier de New York, Zigrosser lui présenta
1934.
Colker, un graveur de Philadelphie. La résurrection des plaques de Hopper qui avaient été protégées avec
Huile sur toile, 71,7 x 91,4 cm.
des enduits à la cire d’abeille, du nettoyage au tirage des copies finales, vit le maître donner plus qu’un
The Edwin and Virginia Irwin Memorial,
coup de main à Colker, en lui imposant ses exigences (papier de l’Ombrie, encre noire de Francfort
Cincinnati Art Museum, Cincinnati.
243
disponible dans les années 1920, une technique spéciale pour l’essuyage de l’encre, etc.).77 La dernière étape, selon Colker, était l’œil critique de Jo à la livraison des copies. Elle avait fondamentalement repris à son compte toutes les critiques de son mari, mais les copies durent malgré tout passer l’examen. La visite de Colker à l’atelier était ponctuée par l’obligation de devoir regarder poliment les tableaux de Jo dont Colker dit qu’ils étaient « ... des Hopper de deuxième classe ».78 Une Femme au soleil (pp.210-211), peint à Truro en octobre 1961 est un autre nu exposé, celui d’une femme, au saut du lit, à la lumière du soleil du matin traversant la fenêtre. Elle fume une cigarette. Dans son cahier de registre, Jo écrivit que Hopper avait qualifié la fille de « garce intelligente ».79 Deux peintures furent terminées en 1962 : Bureau à New York (p.223) et Route et arbres. Il serait difficile d’imaginer deux œuvres plus différentes. À New York, Jo continua d’écrire une correspondance volumineuse et son journal intime, énumérant la plupart du temps la liste grandissante de leurs infirmités et de leurs maladies ainsi que celle déprimante de leurs amis défunts. Hopper lutta contre des accès de fatigue pour finir Bureau à New York entre avril et mai. Une fille examinant un document se tient dans un bureau devant une large baie vitrée. Les grands piliers de granit encadrant la fenêtre suggèrent un bâtiment cossu telle une banque. La lumière du soleil frappe la façade de la banque, rejetant la ruelle et le bâtiment proche dans l’ombre. Cet effet a pour conséquence de projeter vers l’avant la zone ombragée par rapport à la façade saturée de soleil de la banque. La fenêtre rejoint la partie ombragée dans un va-et-vient ne ressemblant pas au courant réaliste, mais plutôt au travail de Hans Hofmann, considéré comme l’un des plus vieux bastions de l’expressionisme abstrait. Dans Route et arbres, peint avant leur retour à Truro en novembre 1962, Hopper montre une forêt à l’affût, tentant d’attirer dans un guet-apens quiconque empruntera la route, réduite à une simple bande de gris. La forme et la légèreté des troncs d’arbre espacés le long de la chaussée leur donne une humanité curieuse et hostile qui se détache des bois sombres derrière eux. Le talent de Hopper pour évoquer une menace idyllique n’eut jamais à utiliser si peu de moyens. Une occasion unique de pénétrer la personnalité maintenant âgée de Hopper se présenta sous la forme d’un portrait demandé par Raphael Soyer, pour faire partie d’un portrait de groupe en hommage au peintre Thomas Eakins. Hopper avait toujours estimé qu’Eakins était un plus grand peintre que Manet et avait permis que son portrait fasse partie du collage de groupe. Soyer décrivit l’impression qu’il avait de Hopper, dans son journal intime, après la première session. « Il y a une solitude en lui, une lassitude habituelle, une tristesse f risant la colère. Sa voix brise le silence fort et sépulcral (sic). Il posait toujours avec les mains pliées sur la table. Nous avons à peine parlé. » 80 Le portrait suscita la colère de Jo, qui estimait que Soyer cherchait à se faire de la publicité sous le prétexte de rendre hommage à Eakins. Sans compter qu’Hopper avait rarement posé pour elle. Ceci raviva ses sentiments de rejet, fit revivre les abus et réveilla les vieilles querelles. Au printemps de 1963, Hopper travailla entre mars et avril pour finir Entracte (p.232), un autre sujet de théâtre montrant une femme aux cheveux bruns courts portant une robe noire et des chaussures à talons assortis. Elle est assise seule sur une rangée de deux sièges sur le devant gauche de la scène. Hopper la nomma « Nora » dans ses notes. Son manque de bijoux, son manque d’intérêt pour l’entracte en cours et l’emplacement de son siège illustrent l’indifférence qu’elle éprouve pour cette sortie en solitaire. Le dernier tableau de 1963 vint, comme d’habitude, en octobre. Soleil dans une chambre vide (p.183) représente le summum de sa technique réductrice. Il nous reste une fenêtre et la lumière du soleil frappant le plancher et deux murs. Une fois encore, comme avec Bureau à New York, ces différents degrés d’ombre et de lumière créent des aires de décalage, fluctuent de l’avant vers l’arrière et vice versa dans un même et seul espace, 144. Route à quatre voies (Four Lane Road), 1956. Huile sur toile, 68,6 x 104,1 cm. Collection privée.
avec seulement des fenêtres et des arbres dont le feuillage, là-bas, sert à ancrer la peinture dans la réalité. Ces expériences avec le soleil sur des surfaces plurent peintres abstraits aguerris, car il avait utilisé les rapports spatiaux sous leur forme la plus pure. Comme remarquait le critique John Canaday, du New York Times, en 1964, à l’occasion de la première rétrospective depuis les années 1950 de Hopper au Whitney Museum :
145. Essence (Gas), 1940.
244
Huile sur toile, 66,7 x 102,2 cm.
« Il est demeuré dans les bonnes grâces des peintres abstraits, parce que, seul parmi des réalistes américains,
The Museum of Modern Art, New York,
il travaille d’une manière facilement rattachée à l’abstraction dans la disposition soigneuse, la pureté
Mme Simon Guggenheim Fund.
inventive de ses modèles extérieurs. »
245
248
Cette rétrospective avait rendu Hopper nerveux. Serait-il toujours démodé ? Avait-il dépassé la valeur de sa vision ? A l’âge de quatre-vingt-trois ans, ces questions le préoccupaient toujours. Il se déplaçait lentement avec une canne, souffrait de la fatigue et dépendait encore plus de Josephine comme gardienne de son intimité. Ils se chicanaient et se disputaient toujours, mais ils ne dépassaient plus le stade des injures. Leurs infirmités avaient éliminé tout abus physique. A la plus légère critique ou au plus léger doute sur le talent ou la place de son mari dans l’histoire de l’art, Jo bondissait sur le contrevenant comme une lionne protégeant ses petits. Selon Josephine, 70.000 personnes ont visité la rétrospective de Hopper avant qu’elle ne se déplace à travers tout le pays. Pas mauvais pour un vieux réaliste... En décembre 1964 il commença une nouvelle toile à New York. Il revint à son amour des trains et l’intitula Wagon-Salon. L’intérieur de la voiture et les chaises sont incroyablement grands. L’extérieur défile alors qu’une lumière éthérée inonde le vaste espace intérieur et laisse des taches jaunes épaisses d’empâtement sur la moquette. Tandis que les chaises façonnent des ombres sur ces taches jaunes, les passagers n’en laissent aucune comme s’ils n’existaient pas vraiment. Chacun pour soi dans cette cathédrale sur roues... Où la porte nue au bout de la voiture mène-t-elle ? Étant loyaux à leurs racines conservatrices, les Hopper ont décliné une invitation à l’inauguration de Lyndon Johnson en janvier 1965. Sa sœur Marion, le dernier lien entre Edward et son passé, mourut le 17 juillet après que Jo et lui l’eurent soignée pendant une semaine à Nyack. Jo trouva le moyen de se plaindre après avoir été chargée de s’occuper des affaires de Marion, puisqu’ Edward ne se sentait pas le courage de le faire. Ils avaient fait l’aller-retour à Nyack par l’autobus parce qu’Edward ne pouvait plus conduire et que Jo avait la vue trop faible pour prendre le volant. Après cette épreuve, ils se rendirent à Truro en août, emmenés par leur homme à tout faire, Eddy Brady. Ils y restèrent jusqu’en octobre sans peindre. Edward finit par faire quelques esquisses au crayon et prit ses pinceaux pour faire une recherche dans les bleus. Une scène apparaît avec des décors de théâtre suggérés sur les côtés. Au centre de la scène, vus depuis le public, deux clowns vêtus de blanc apparaissent, un Pierrot et sa fidèle Pierrette. Main dans la main, ils font une courbette d’adieu. Il l’intitula Deux Comédiens (pp.224-225). Il ne pouvait y avoir aucun doute quant à l’identité suggérée du couple. De retour à New York, Edward fut pris de douleurs graves et entra à l’hôpital. Une semaine plus tard, Jo l’y rejoint après une fracture de la hanche et de la jambe à la suite d’une glissade sur de la cire. Ses cataractes se compliquèrent d’un glaucome. Ils quittèrent l’hôpital en décembre 1966 et revinrent dans leur foyer au sommet du 3 Washington Square. Edward était faible et avait besoin de l’aide de Jo. Elle a fait ce qu’elle a pu avec sa vue très diminuée. La santé de Hopper continua d’empirer après une nouvelle opération de hernie. Josephine écrivit à une amie, Catherine Rogers, au sujet de son entrée dans l’atelier le 15 mai 1967 : « Et quand l’heure a sonné, il était à la maison, ici dans sa grande chaise dans le grand atelier – il a pris une minute pour mourir. Aucune douleur, aucun bruit, les yeux secs (sic) et même heureux et très beau dans la mort, comme un El Greco... Nous étions seuls là vers la f in de l’après-midi et lui dans sa chaise. Aucune lutte, aucune douleur, même heureux, et avait l’air si beau. » 81 Hopper fut enterré dans le cimetière de famille le 17 mai 1967 après une cérémonie très privée. Jo lui survécut assez longtemps pour léguer les peintures, les croquis et les gravures à l’eau-forte de son mari au Whitney Museum of American Art. Elle leur donna également ses journaux intimes, ses dossiers et carnets, ses lettres et tout son travail. Jo vécut dix mois de plus qu’Edward, jusqu’au 6 mars 1968, juste avant son quatre-vingt-cinquième anniversaire. Après quarante-trois ans de mariage, ils étaient de nouveau réunis dans la mort. Le travail de Josephine Nivison Hopper a été rejeté et considéré aujourd'hui encore sans aucune valeur.
146. Orléans, un portrait (Portrait of Orleans), 1950.
Le travail d'Edward Hopper est un trésor national, exposé de temps en temps pour les générations futures.
Huile sur toile, 66 x 101,6 cm.
Il est perpétuellement visible au Whitney.
Collection privée.
249
BIBLIOGRAPHIE Edward Hopper
Edward Hopper : An Intimate Biography
de Sheena Wagstaff, David Anfam, Brian O’Doherty
de Gail Levin
Tate Gallery (1 août 2004)
University of California Press ; première édition (10 avril 1998)
er
The Paintings of Edward Hopper de Edward Hopper (Editeur), Gail Levin, Whitney Museum of American Art W. W. Norton & Company (15 janvier 2001)
Edward Hopper : The Watercolours de Virginia M. Mecklenburg, Edward Hopper, Margaret Lynne Ausfeld, National Museum of American Art (U. S.), Montgomery Museum of Fine Arts
Hopper : Mark Strand, Knopf ; réédition
W. W. Norton & Company (1er septembre 1999)
(13 novembre 2001) Edward Hopper : An American Master (Great Masters) Edward Hopper : The Art and the Artist
de Ita G. Berkow
de Gail Levin
New Line Books (30 septembre 2005)
W. W. Norton & Company ; édition réimprimée (octobre 1996) Edward Hopper as Illustrator Edward Hopper : A Journal of His Work de Edward Hopper, Deborah Lyons, Brian O’Doherty W. W. Norton & Company ; première édition (novembre 1997)
de Gail Levin W .W. Norton & Co Inc. ; nouvelle édition (janvier 1984)
Edward Hopper’s New York
Hopper’s Places :
de Avis Berman, Edward Hopper
de Gail Levin, University of California Press ; première édition
Pomegranate Communications (février 2005)
(10 décembre 1998)
251
NOTES 1
2
Edward Hopper, Notes on Painting, « Edward Hopper Retrospective
24
Rembrandt, Les Troix Croix, 1653, Rijksprentenkabinet, Amsterdam
Exhibition », catalogue, Museum of Modern Art, 193, avec la permission
25
Gail Levin, Edward Hopper – An Intimate Biography, op. cit.
de : Francis Mulhall Achilles Library, Whitney Museum of American Art
26
Josephine Hopper, Journal intime de Josephine Hopper,
http://butlerart.com/book,
Kenneth
Hayes
Miller,
Nannette
V. Maciejunes
10 janvier 1956 27
William Johnson, interview inédite avec Edward et Jo Hopper,
3
Vachel Lindsay, Lettre à son père, 10 décembre 1903
4
Edward Hopper, American Masters, p.14
28
Gail Levin, Edward Hopper – An Intimate Biography, op. cit.
5
Patricia Wells, « Where to Sit to See and be Seen », New York Times,
29
Josephine Hopper, Journal intime de Josephine Hopper,
30 octobre 1956
6 juin 1982 6
7
8
10 octobre 1944
Edward Hopper, Lettre à sa mère, 29 décembre 1906
30
Enid M. Saies à Edward Hopper, Lettre, 1907, Derby, Angleterre http://www.bidingtons.com. Pedigree and Provenance, Ash Can
Also Sell, New York Sun, 25 octobre 1924 31
School, Margaret Morse 9
Henry McBride, Edward Hopper’s Watercolors Prove Interesting –
Virginia M. Mecklenburg, Edward Hopper – The Watercolors, National Museum of American Art, W.W. Norton & Company,
Gail Levin, Edward Hopper, An Intimate Biography, University of
New York, 1999
California Press, Berkeley, CA, 1995 32 10
Ibid.
11
Gail Levin, Edward Hopper as Illustrator, Whitney Museum of
Steven Murray, « The Ten Best English-language Noirs », San Francisco Noir, 2005, p.8
33
Gail Levin, Edward Hopper – An Intimate Biography, op. cit.
34
Kingwood College Library, American Cultural History 1920-1929
American Art, New York, 1979 12
Mark Harden, James MacNeil Whistler, www.glyphs/art/com
13
American
kclibrary.nhmccd.edu/decade20.html Institute
of
Economic
Research
calculation, 35
http://www.aier.org/index.html 14
Gail Levin, Edward Hopper – An Intimate Biography, op. cit.
15
Guy Pène du Bois, « Exhibitions in the Galleries », Arts and
3 janvier 1926, p.7 36
Lloyd Goodrich, « New York Exhibitions », The Arts, 9 février 1926, p.68
37
Lloyd Goodrich, Edward Hopper, Harry N. Abrams, Inc. New York,
Decoration, 15 avril 1915, p.238
1989
16
Gail Levin, Edward Hopper – An Intimate Biography, op. cit.
17
Ibid.
18
Ibid.
Biography) : Elizabeth Luther Cary, « Many Types of Art are Now on
19
www.intaglio-fine-art.com/etching-info-about.php
Exhibition », New York Times, 28 février 1926, sec 8, p.12. Margaret
20
Henri et al. at MacDowell Club, American Art News,
Breuning, « Exhibitions of Contemporary American Artists Feature
17 février 1917, p.3
Lenten Week in Local Galleries », New York Evening Post, 27 février
21
http://www.artnet.com/johnmarin
1926, p.9
22
Gail Levin, Edward Hopper – An Intimate Biography, op. cit.
39
« America Today », Brooklyn Daily Eagle, 7 mars 1926 p.E7
23
Edward Hopper à Marian Ragan, lettre, 10 février 1956, Montclair Art
40
Garrett McCoy, « Charles Burchfield and Edward Hopper », Journal of
38
Museum, New Jersey
252
« The New Society is Arranging Its Exhibit », New York Sunday World,
(Propos recueuillis par Gail Levin in Edward Hopper – An Intimate
the Archives of American Art, 7 juillet-octobre, 1967
41
Edward Hopper, « John Sloan », The Arts, 9 mars 1926, pp.172-178
61
Josephine Hopper, Journal intime de Josephine Hopper, 14 mars 1959
42
Gail Levin, Edward Hopper – An Intimate Biography, op. cit.
62
Josephine Hopper, Journal intime de Josephine Hopper, 15 août 1945
43
Josephine Hopper, Journal intime de Josephine Hopper, 11 août 1954
63
Josephine Hopper, Lettre à Carl Sprinchorn, 10 février 1946, Frances
44
Hopper à Charles H. Sawyer, Lettre, 19 octobre 1939, Lloyd Goodrich,
Mulhall Achilles Library, Whitney Museum of American Art 64
Josephine Hopper, Journal intime de Josephine Hopper, 8 avril 1946
65
Josephine Hopper, citation, interview réalisée par Brian O’Doherty,
Edward Hopper, New York, Harry S. Abrams, 1971 45
Edward W. Root, « To the Editor of the Press », Utica Daily Press, 3
American Masters, p.25
mars 1928, p.9 66 46
Citation d’Edward Hopper par Brian O’Doherty, American Masters :
Edward Hopper, Lettre à « Dr Roe », 20 avril 1945, Frances Mulhall Achilles Library, Whitney Museum of American Art
« The Voice and the Myth », Universe Books, New York, 1988, p.14 67 47
Edward Hopper à Forbes Watson, 29 avril 1930
48
Guy Pène du Bois, Edward Hopper, monographie
49
Royal Cortissoz, « Some Modern Paintings from American and French
Edward Hopper, Lettre à Mme Frank B. Davidson, de Richmond, Indiana, 22 janvier 1947
68
Josephine Hopper, Journal intime de Josephine Hopper, 8 février 1950
69
Charles Burchfield : « Hopper, Career of Silent Poetry » Art News,
Hands », New York Herald Tribune, 27 novembre 1932, p.10
mars 1950, p.63
50
Josephine Hopper, Lettre à Bee Blanchard, 18 juillet 1932
51
Josephine Hopper, Lettre à Bee Blanchard, 14 juin 1934
critique, Sunday Times (Londres), Horizon Magazine, novembre, 1959,
52
Josephine Hopper, Extrait non daté, 1934
vol. 11, no. 2, p.42
53
Edward Hopper, Lettre à The Art of Today, vol. 6, no. 2, février 1935,
70
71
54
Josephine Hopper, Journal intime de Josephine Hopper, 11 août 1937
55
Edward Hopper, Notes on Painting, catalogue du Museum of Modern
72
Registre d’Edward Hopper, p.47, Frances Mulhall Achilles Library, Whitney Museum of American Art
73
Edward Hopper, Reality : a Journal of Artists’ Opinions, juin, 1952, Frances Mulhall Achilles Library, Whitney Museum of American Art
Art, « Edward Hopper Retrospective Exhibition », 1933, p.17 (Frances 74
Mulhall Achilles Library, Whitney Museum of American Art) 56
Mark Strand, Edward Hopper, Ecco Press, Hopewell, New Jersey : c. 1994, p.23
p.11, (Frances Mulhall Achilles Library, Whitney Museum of American Art)
John Russell, The « New American Painting » Captures Europe,
Josephine Hopper, Lettre à Lloyd Goodrich, 23 mars 1953, Frances Mulhall Achilles Library, Whitney Museum of American Art
Josephine Hopper, Journal intime de Josephine Hopper, 14 novembre 75
John Canaday, New York Times, 1959, citation extraite de la revue
1937 Horizon Magazine, « New American Painting, » novembre, 1959, 57
58
Jo Hopper, Lettre à Marion Hopper, août 1939 Helen Hayes, interviewée par Gail Levin, 27 octobre 1980, Gail Levin,
Vol. 11, No. 2. p.121 76
Josephine Hopper, Lettre à Mme Malcolm Chase, 18 janvier 1961
ed., Edward Hopper Symposium at the Whitney Museum of American
77
Gail Levin, Edward Hopper – An Intimate Biography, op. cit.
Art, « Six Who Knew Hopper, » Art Journal, 41, summer, 1981, p.129
78
Ibid.
59
Jo Hopper, Lettre à Marion Hopper, 13 septembre 1940
79
Josephine Hopper, Registre III, p.75, octobre 1961
60
Jimmy De Lory, interviewé par Gail Levin, 29 juillet 1991, Edward
80
Edward Hopper, citation extraite de Soyer, Diary of an Artist,
Hopper, An Intimate Biography, Gail Levin, University of California Press, Berkeley, Californie, 1995
pp.71-72, d’après Levin, Edward Hopper – An Intimate Biography, p.555 81
Josephine Hopper, Lettre à Catherine Rogers, 4 juin 1967
253
LISTE DES ILLUSTRATIONS A
E
Août dans la ville (August in the City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Ecluse de la Monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23
Appartements (Apartment Houses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Entracte (Intermission) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Après-Midi à Cape Cod (Cape Cod Afternoon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Essence (Gas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246-247
Après-Midi de juin ou L’Après-Midi de printemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Eté (Summertime) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236-237
Arbres dans la lumière, parc de Saint-Cloud
Eté dans la ville (Summer in the City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
(Trees in Sunlight, parc de Saint-Cloud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Excursion philosophique (Excursion into Philosophy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Artillerie légère à Gettysburg (Light Battery at Gettysburg) . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Au Café, Edgar Degas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
F/G
Aurore en Pennsylvanie (Dawn in Pennsylvania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Une Femme au soleil (A Woman in the Sun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-211
Automate (Automat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Femme nue se coiffant, Edgar Degas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Autoportrait (Self-Portrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Fenêtre d’hôtel (Hotel Window) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Fenêtres de nuit (Night Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
B
Gare de métro (The El Station) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-61
Bateau à vapeur (Tramp Steamer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Gens au soleil (People in the Sun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160-161
Bateau-mouche (River Boat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-15 Le Bistrot ou La Boutique du marchand de vin
Girlie Show . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Grands Mâts (Tall Masts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
(Le Bistrot or The Wine Shop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 La Bosse du chameau (The Camel’s Hump) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Briar Neck, Gloucester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Brise du soir (Evening Wind) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Une Brise fraîche – Un Bon Vent (Breezing Up (A Fair Wind)), Winslow Homer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Bureau à New York (New York Office) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Bureau dans une petite ville (Office in a Small City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Bureau, la nuit (Office at Night) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
C Le Catboat (The Catboat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-87 Chambre à Brooklyn (Room in Brooklyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
H Hall d’hôtel (Hotel Lobby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Haymarket, Sixth Avenue, John Sloan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Hôtel près de la voie ferrée (Hotel by a Railroad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
I/J L’Ile de Blackwell (Blackwell’s Island) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Ile Saint-Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Intérieur (Le Viol), Edgar Degas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Intérieur (Modèle lisant) (Interior (Model Reading)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Intérieur d’été (Summer Interior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Intérieur, East Side (East Side Interior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Jo en train de peindre (Jo Painting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Chambre à New York (Room in New York) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218-219 Chambres sur la mer (Rooms by the Sea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Chop Suey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Cimetière à Gloucester (Cemetery at Gloucester) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
L Les Lavoirs à pont Royal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
La Locomotive (The Locomotive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Cinéma new-yorkais (New York Movie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
The Long Leg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Cinq Heures du matin (Five A.M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Le Louvre et la Seine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Coin de rue à New York (New York Corner (Corner Saloon)) . . . . . . . . . . . . . . . .59 Collines, South Truro (Hills, South Truro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
M
Conférence, la nuit (Conference at Night) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
La Maison Adam (Adam’s House) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94-95
Les Contrebandiers (The Bootleggers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Maison du capitaine Strout, Portland Head (Captain
Corn Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 La Côte Lee (The Lee Shore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142-143 Coucher de soleil sur voie ferrée (Railroad Sunset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65
Strout’s House, Portland Head) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Maison Hodgkin, Cape Ann, Massachusetts (Hodgkin’s House, Cape Ann, Massachusetts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Maison près de la voie ferrée (House by the Railroad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
254
D
Maison Ryder (Ryder’s House) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Deux Comédiens (Two Comedians) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224-225
La Maison solitaire (The Lonely House) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Deuxième Etage ensoleillé (Second Story Sunlight) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138-139
La Maison Talbot (Talbot’s House) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Deuxième Rang à l’orchestre (Two on the Aisle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Manhattan Bridge Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Dimanche (Sunday) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
La Mansarde (The Mansard Roof) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Matin à Cape Cod (Cape Cod Morning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Rochers et maisons, Ogunquit (Rocks and Houses, Ogunquit) . . . . . . . . . . .116-117
Matin dans une ville (Morning in a City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Route 6, Eastham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Matin en Caroline du Sud (South Carolina Morning) . . . . . . . . . . . . . . . . . .130-131 Mer houleuse (Ground Swell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Midi (High Noon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Route à quatre voies (Four Lane Road) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Route dans le Maine (Road in Maine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Motel à l’Ouest (Western Motel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190-191
Rue, New York I (Street, New York I), Georgia O’Keeffe . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
N
S
Nocturne en bleu et or – Le Pont de Battersea (Nocturne : Blue and Gold-Old Battersea Bridge), James Abbott Whistler . . .43 Notre-Dame de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Scène de rue, Gloucester (Street Scene, Gloucester) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Sept Heures du matin (Seven A.M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178-179
Nuit au parc (Night in the Park) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Soir à Cape Cod (Cape Cod Evening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134-135
Nuit dans le métro (Night in the El Train) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Soir bleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-71 Soir d’été (Summer Evening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
O
Soleil dans la ville (City Sunlight) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Octobre à Cape Cod (October on Cape Cod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Oiseaux de nuit (Nighthawks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198-199
Soleil dans une cafétéria (Sunlight in a Cafeteria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Ombres nocturnes (Night Shadows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Soleil dans une chambre vide (Sun in an Empty Room) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Onze Heures du matin (Eleven A.M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Soleil du matin (Morning Sun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Orléans, portrait (Portrait of Orleans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Soleil sur Brownstones (Sunlight on Brownstones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Solitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
P Le Parc de Saint-Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Le Pavillon de Flore au printemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
T
Paysage américain (American Landscape) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81
Table pour dames (Table for Ladies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Paysage classique (Classic Landscape), Charles Sheeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Le Théâtre Sheridan (The Sheridan Theater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Le Phare (Côte du Maine) (The Lighthouse, (Maine Coast)) . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Toits (Rooftops) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168-169
Phare à Two Lights (Light at Two Lights) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146-147, 150-151 Le Phare à Two Lights (The Lighthouse at Two Lights) . . . . . . . . . . . . . . . . .154-155 Pharmacie (Drug Store) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Les Poilus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Tôt un dimanche matin (Early Sunday Morning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174-175 Train (Railroad Train) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Trottoirs new-yorkais (New York Pavements) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Le Pont de l’Europe, Gare Saint-Lazare, Claude Monet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Le Pont de Macomb (Macomb’s Dam Bridge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Le Pont des Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29 Le Pont Royal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Port de Gloucester (Gloucester Harbor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-51
V La Vallée de la Seine (Valley of the Seine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-39 Village américain (American Village) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-55
Premier Rang d’orchestre (First Row Orchestra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
La Ville (The City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Promenade en mer (Sailing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Ville minière de Pennsylvanie (Pennsylvania Coal Town) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Prospect Street, Gloucester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Voiliers (Sailing Boats), Lyonel Feininger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
La Prune, Edouard Manet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Vue du mont Holyoke, Northampton, Massachusetts, après un orage – Le Méandre (View from Mount Holyoke,
Q Le Quai des Grands Augustins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Northampton, Massachusetts, after a Thunderstorm –
Quartier italien, Gloucester (Italian Quarter, Gloucester) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
The Oxbow), Thomas Cole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Vue du pont Williamsburg (From Williamsburg Bridge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
R Regards sur la mer (Seawatchers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Remorqueur avec cheminée noire
W/Y
(Tugboat with Black Smokestack) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Wagon-Salon (Chair Car) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Restaurant new-yorkais (New York Restaurant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Yonkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 255
E
dward Hopper exprime avec poésie la solitude de l’homme face à cet american way of life qui se développe dans les années 1920. S’inspirant du cinéma par les prises de vue ou les attitudes des personnages, ses peintures reflètent et dénoncent l’aliénation de la culture de masse. Avec ses toiles aux couleurs froides, peuplées de personnages anonymes, l’œuvre d’Hopper symbolise aussi le reflet de la Grande Dépression. A travers des reproductions variées (gravures, aquarelles, huiles sur toile), l’auteur, par une analyse tant artistique que thématique, nous apporte un éclairage nouveau sur l’univers énigmatique et torturé de ce peintre majeur.
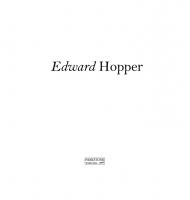


![Edward Hopper: An Intimate Biography [1 ed.]
0394546644, 9780394546643](https://ebin.pub/img/200x200/edward-hopper-an-intimate-biography-1nbsped-0394546644-9780394546643.jpg)





